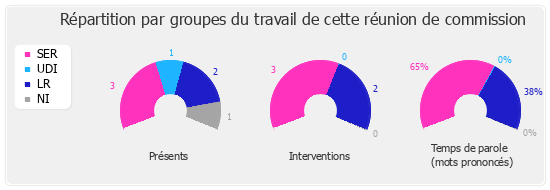Commission des affaires européennes
Réunion du 11 janvier 2017 à 8h30
La réunion
COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES
Mercredi 11 janvier 2017
Présidence de Mme Danielle Auroi, Présidente de la Commission
La séance est ouverte à 8 h 40 (audition non ouverte à la presse)
Audition de M. Étienne Balibar, Professeur émérite à l'université de Paris-Ouest, sur l'avenir de l'Europe.

Chers collègues, nous commençons cette année 2017 sous les meilleurs auspices : avec la philosophie, en la personne d'Étienne Balibar, philosophe mais aussi intellectuel engagé.
Recueil de textes publiés entre 2010 et 2015, votre dernier ouvrage, monsieur, s'intitule L'Europe, crise et fin ? Son esprit est conforme à celui de ce cycle d'auditions, dans le cadre duquel nous interrogeons des intellectuels, des économistes, des responsables institutionnels, des représentants de la société civile, tous ceux qui peuvent nous donner des raisons de placer encore quelque espoir dans l'Union européenne. Après qu'un premier État membre a quitté l'Union européenne, est-ce un mouvement irréversible qui s'ouvre ? Vous appelez de vos voeux une nouvelle Union européenne, mais cela a-t-il encore du sens aujourd'hui ? L'Union peut-elle être transformée ou faut-il en passer par son implosion ? À cet égard, vous-même avez déjà comparé l'« exclusion intérieure » de la Grèce et l'« inclusion extérieure » du Royaume-Uni à laquelle pourra mener le Brexit.
Vous avez beaucoup travaillé sur les notions d'identité, de racisme et de frontières qui nous préoccupent aujourd'hui. Quelle analyse faites-vous donc de la montée des nationalismes dans l'Union européenne ? Est-elle aussi irréversible que les journaux nous le disent ? Dans un texte publié par Libération au mois de mars dernier, vous écriviez que « la crise des réfugiés signe l'échec du projet européen, de la solidarité et de la démocratie », en insistant sur la responsabilité de la France. Quelques mois plus tard, quel regard portez-vous sur l'évolution de la situation ? J'aimerais notamment que vous reveniez sur une idée que vous avez développée dans un autre article : cet afflux migratoire constituerait un nouvel élargissement de l'Union, non territorial mais démographique et politique – un élargissement de la définition même de l'Europe et de ses objectifs.
Vous avez réfléchi à la place de l'Union européenne dans le monde et à son rôle dans la mondialisation. Si, comme l'affirme Carl Schmitt, la politique est le lieu de la distinction entre « l'ami » et « l'ennemi », l'Europe ne manque-t-elle pas d'un ennemi commun à tous les États membres, qui permettrait un rassemblement au-delà des clivages culturels, linguistiques et historiques ?
Comment espérer encore ? Membres de la commission des affaires européennes, nous sommes des Européens convaincus, et nous pensons que l'Europe est le bon échelon pour continuer à construire la démocratie.
Je vous remercie très vivement, madame la présidente, de l'honneur que vous me faites en m'invitant à contribuer, modestement, à vos travaux et à m'exprimer devant une partie de la représentation nationale. Merci, mesdames et messieurs les députés, de votre attention.
Vous n'imaginez sans doute pas, madame la présidente, que je dispose de réponses simples et définitives à aucune des questions que vous posez. Il est plusieurs façons de pratiquer la philosophie, que j'ai enseignée toute ma vie, et je n'oserai qualifier la mienne de « socratique », ce serait extraordinairement prétentieux – on comparait Socrate à une torpille qui paralyse ses interlocuteurs et les plonge dans l'embarras –, mais il est certain que je ne me suis pas arrangé avec l'âge : je tends de plus en plus à poser des questions qui permettent de débrouiller la complexité des problèmes plutôt qu'à apporter des réponses. Ce n'est pas forcément une qualité lorsqu'il est question d'affaires publiques urgentes…
J'ai lu avec un vif intérêt les comptes rendus des précédentes auditions. J'en ai été impressionné et me suis demandé si je pouvais fournir une contribution de la même qualité. Ce qui m'a frappé tout de suite, c'est que vous avez auditionné des experts de la question européenne : l'ancien président du Conseil des ministres italien et actuel président de la fondation Jacques Delors – Notre Europe Enrico Letta, mon collègue politologue Antoine Vauchez ou encore Luuk van Middelaar, l'ancienne plume du président du Conseil européen. C'est en tant que citoyen que la question européenne me paraît fondamentale, c'est pour cela que j'essaie d'apprendre, y compris de mes propres erreurs, et d'en dire quelque chose, mais je n'ai nullement la prétention de parler en tant qu'expert.
Au début du recueil que vous avez bien voulu citer, j'indique que je m'exprime en tant que citoyen européen de nationalité française. Certains y ont lu une renonciation provocatrice à la nationalité française au profit d'une autre, tandis que d'autres ont trouvé quelque peu utopique et virtuelle l'idée d'une citoyenneté européenne. De mon point de vue, non seulement il n'y a pas de contradiction entre la citoyenneté française et la citoyenneté européenne mais, dans la conjoncture historique présente, il nous faut absolument nous situer, constamment et simultanément, à ces deux niveaux complémentaires pour réfléchir aux problèmes de la démocratie ou à l'avenir des peuples européens. Certes, cela ne va pas sans difficultés ni, dans la transition historique que nous vivons, sans conflits d'intérêts ni tensions institutionnelles, mais cette situation est destinée à durer – peut-être indéfiniment. Comment peut-on encore se penser comme citoyen européen quand l'Europe s'effondre ou semble entrer dans une phase de désagrégation ? Je ne considère pas du tout la situation présente comme le fruit du hasard. C'est le point d'aboutissement d'une crise de très longue durée, dont les germes étaient peut-être dans les institutions européennes elles-mêmes, et nous sommes au pied du mur.
Cela étant, par principe, je considère que rien n'est acquis. Peut-être le principe est-il même plus vrai que jamais, si l'on veut bien tenir compte des derniers débats au Royaume-Uni ou des vues exprimées très récemment par Mme Merkel sur la question de savoir si le Brexit serait « doux » ou « dur ». Il est tout à fait prématuré de s'exprimer comme si le Royaume-Uni était déjà hors de l'Union : il est toujours dedans, quoique dans une position très étrange, qui se traduit en particulier par la limitation de ses droits ou de ses prérogatives d'État membre pour toute une série de questions politiques, une limitation « self-inflicted », dont on peut estimer qu'elle est le fait des Britanniques eux-mêmes et l'effet des réactions qu'ils ont provoquées. Juridiquement, le Royaume-Uni est toujours membre de l'Union européenne. Nous ne savons toujours pas quand ni comment il sortira de l'Union européenne. Nous ne savons même pas si le Royaume-Uni et le continent européen suivront ensuite des voies réellement divergentes – cela me paraît au contraire tout à fait improbable. Rien n'est fait, aucune négociation n'a encore eu lieu et les positions de principe arrêtées, notamment, au niveau du Conseil européen, sont plutôt, pour l'heure, des rodomontades.
Inévitablement, il en résultera une situation non seulement complexe mais probablement tendue et plus conflictuelle que jamais, mais sera-t-elle substantiellement différente de la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la Grèce ? Alors que celle-ci est de plein droit membre de l'Union européenne, le ministre des finances grec est prié, lors de certaines négociations financières, de bien vouloir quitter la salle au moment où se décident, dans son dos et sur son dos, les formes de sa soumission à une espèce de diktat. Sur le plan financier, budgétaire et économique, aujourd'hui totalement intriqué avec le plan politique, et indissociable de celui-ci, la Grèce se trouve de facto dans une situation d'« exclusion intérieure », soumise à un régime de protectorat ou de souveraineté diminuée. Depuis le début de la crise grecque, qui n'était évidemment pas une crise purement et simplement grecque mais une crise du système financier européen tout entier, sont appliquées à la Grèce, pour régler le problème de sa dette, des procédures qui le sont depuis des décennies aux pays du tiers-monde par le Fonds monétaire international ou d'autres instances. Autant dire à la Grèce que si elle reste formellement membre de l'Union européenne, elle n'en est en réalité plus membre à part entière.
En lisant les comptes rendus des précédentes auditions, j'ai noté que la question d'une Europe à géométrie variable était l'objet de longues discussions ; vous-même, madame la présidente, posiez aux personnes auditionnées la question de savoir si elles envisageaient un recentrement de l'Europe sur un noyau dur et cohérent ou une union à géométrie variable. Mais prenons déjà acte de l'existence, dans les faits, de cette Europe à géométrie variable. Se superposent d'ores et déjà, sur différents plans – le plan judiciaire, le plan de la sécurité avec l'espace Schengen, le plan monétaire –, des structures qui ne se recouvrent pas complètement et ne font pas toujours bon ménage entre elles.
J'ai parlé d'effondrement. Nous répétons tellement que l'Europe connaît une très grave crise, mettant en cause son existence même, que l'énoncer encore une fois n'apporte guère au débat. Dans le livre que vous avez cité, j'emploie l'expression d'interregnum, que j'emprunte à Gramsci. Je m'en servirai à nouveau, pour désigner une situation paradoxale et d'une certaine façon intenable qui nous crée évidemment des responsabilités historiques : d'un côté, nous ne pouvons pas revenir en arrière, il y a de l'irréversible ; d'un autre, nous semblons ne pas pouvoir avancer, ne pas pouvoir inventer le nouveau. Ce que je viens de dire à propos du Brexit me semble illustrer l'idée de l'irréversible. Je peux évidemment me tromper mais le retour à l'ordre européen classique, tel qu'il a existé, par-delà des vicissitudes terribles et des transformations considérables, depuis l'émergence, au milieu du XVIIe siècle, du système des États-nations et du jus publicum europaeum, jusqu'au milieu du XXe siècle, avec l'affrontement des systèmes politiques, les deux guerres mondiales et la guerre froide, ce retour en arrière me paraît absolument impossible, même si, pour différentes raisons, nombre de nos compatriotes, voire une majorité de citoyens européens, se laissent persuader qu'il serait une solution.
Cette impossibilité ne tient pas tant à l'intrication croissante des sociétés européennes et aux liens toujours plus étroits entre les peuples européens qu'à la place des nations dans le monde d'aujourd'hui. La souveraineté économique ne peut plus s'inscrire dans le cadre des États-nations européens ; ce ne sont certes pas de toutes petites nations, ils sont de tailles diverses, mais ce ne sont pas non plus des Großmächte, comme disait encore Carl Schmitt, ni des espaces continentaux. L'idée selon laquelle, en renonçant à la construction européenne, les États européens amélioreraient leur situation économique, occuperaient une meilleure place dans la concurrence mondiale, pourraient valoriser le travail national ou retrouver une souveraineté monétaire me semble une mystification. L'Amérique de Trump ne parviendra pas à un tel résultat, nonobstant les prétentions du président élu, et les États européens, même ceux qui sont apparemment les plus puissants, y parviendraient encore moins. Cela rend d'autant plus grave le problème que créent la perte de légitimité de la construction européenne et la difficulté qu'il y a à inventer une structure post-nationale qui ne soit pas la fusion des nations ni leur incorporation à un ensemble bureaucratique ou idéologique qui les ferait disparaître, mais qui leur permette de se renforcer les unes les autres par la coopération et l'inévitable délégation de leurs intérêts communs à des instances de gouvernement et de représentation communes.
Cela m'amène à la crise du système politique européen. Pardonnez la généralité d'un propos peut-être insuffisamment technique, insuffisamment ancré dans les réalités concrètes, mais ce qui se passe aux États-Unis me conforte dans l'idée que les systèmes politiques démocratiques et républicains sont en crise partout, en particulier dans les grandes nations capitalistes développées – le problème des anciennes puissances socialistes est autre –, et ce pour différentes raisons, la « mondialisation » n'étant qu'un mot pour évoquer tout cela. Dans une intervention récente, j'ai d'ailleurs esquissé un parallèle entre le problème des États-Unis d'aujourd'hui, où j'enseigne une partie de l'année – sans que cela fasse de moi un expert –, et celui de l'Europe en tant que telle. Deux raisons à la crise de nos systèmes politiques sont plus particulièrement évidentes.
Tout d'abord, les systèmes de sécurité sociale sont en crise. Sans doute Alain Supiot serait-il l'interlocuteur idéal pour évoquer cette question, d'autant qu'il vient de rééditer son rapport sur l'Europe sociale. Pour ma part, j'ai soutenu l'idée que des pays comme la France, l'Allemagne ou les États-Unis d'après le New Deal avaient, sous des formes et à des degrés très divers, incorporé à la définition même de la citoyenneté une dimension sociale fondamentale. J'ai même parlé, pour provoquer les réactions, d'« État national social » : dans certains pays comme l'Italie, la Constitution met l'accent sur les droits sociaux. La cohésion nationale dépend effectivement, dans une très large mesure, du fait que les politiques sociales sont institutionnalisées, que ne règne pas entre concitoyens une concurrence sauvage et, évidemment, de politiques sociales conçues à l'échelle de la nation comme une sorte de contrat moral entre les citoyens. Or, dans le monde entier, ces systèmes de citoyenneté à la fois nationale et sociale, inscrits au coeur des institutions politiques, ont fait l'objet, en particulier depuis le thatchérisme, d'une tentative à bien des égards réussie de détricotage et de démantèlement, et la construction européenne n'a pas arrangé les choses.
Il ne serait pourtant pas impossible par principe que la citoyenneté européenne comporte une dimension sociale. Bien au contraire ! Du début des années 1970 au début des années 1990, la question de l'Europe sociale a constamment été mise sur le tapis. Évidemment, tout le monde n'avait pas le même point de vue, et l'Europe sociale avait aussi ses adversaires. En outre, la transposition des institutions fondamentales de la sécurité sociale du niveau national au niveau européen n'était pas évidente ; derrière la diversité des systèmes sociaux, bismarckiens ou beveridgiens par exemple, il y a des histoires différentes, et le modèle dont nous aurions besoin aujourd'hui n'est pas exactement celui qui a été construit à travers les luttes et les politiques du siècle dernier. Il aurait donc fallu inventer à l'échelle de l'Europe quelque chose de nouveau, ce qui n'avait rien de facile.
En cette matière, je rends un hommage mitigé à Jacques Delors. Pourquoi et comment a-t-il cédé sur l'Europe sociale, lui qui ne cessait de répéter que la construction européenne franchirait une étape décisive si l'on construisait d'un côté l'unité monétaire et de l'autre l'Europe sociale ? Nous avons construit l'unité monétaire et enterré l'Europe sociale ; c'est la conséquence des grands changements intervenus dans le monde à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Au fond, l'inscription dans le traité de Maastricht, dans des textes quasi constitutionnels, de la règle de la concurrence libre et non faussée signifiait que l'objectif de solidarité devait céder devant les impératifs du marché – je suis bien conscient que l'Allemagne et la France y ont poussé. Quand nous avons instauré l'euro et créé une Banque centrale européenne dont les objectifs de soutien à l'économie sont en deçà de ceux de la Réserve fédérale américaine, quand nous en sommes arrivés à la règle d'or budgétaire, dont j'aurai la charité de ne pas rappeler qu'elle a signé le destin de la présidence Hollande dès son premier jour, nous avons inscrit au coeur de la construction européenne l'antithèse même de l'idée d'Europe sociale, et érigé un obstacle apparemment insurmontable sur la voie de celle-ci.
D'une manière dont je conviens qu'elle est dangereuse, j'ai comparé l'Union européenne à l'Union soviétique, l'autre tentative de construction politique européenne supranationale du XXe siècle. Au coeur de la construction soviétique était le dogme idéologique de la planification économique autoritaire. Au coeur de la construction européenne est le dogme, image inversée du précédent, de la concurrence sauvage. Aussi longtemps que ce dogme ne sera pas remis en cause, la question de l'Europe sociale ne pourra être reposée ni donc résolue, et si elle ne peut être résolue, même partiellement, ou si les citoyens européens n'ont pas le sentiment que l'on tente de la résoudre, la crise de légitimité du système politique s'aggravera encore. Or avec elle vient ce que l'on nomme à tort – car on étiquette ainsi des éléments incompatibles entre eux – le populisme, qui est en réalité le retour de flamme extraordinairement violent du nationalisme, un phénomène qui contamine tout le monde.
La remise en question des institutions politiques tient aussi à ce que les frontières n'ont plus le statut qu'elles avaient précédemment. Je n'ai jamais été partisan de leur abolition. La question des frontières se pose au niveau national et au niveau communautaire, non seulement pour des raisons de sécurité évidentes que je ne conteste pas – même si je me méfie terriblement de l'idéologie sécuritaire, dont je crains qu'elle ne bouffe l'ensemble de l'équilibre institutionnel – mais aussi pour des raisons qui ont à voir avec la façon de gérer les flux de circulation dans l'intérêt des populations. Il faut trouver le bon équilibre entre la protection d'une part, la régulation ou la coopération internationale d'autre part, aux niveaux culturel et économique comme à d'autres niveaux. Là encore se pose un problème sur lequel nous butons et qui ne se présente pas en termes de « tout ou rien » – d'autant moins que l'on ne choisit pas les formes sous lesquelles il s'impose à nous, comme on le voit avec la crise des réfugiés et la situation à nos portes – mais sur lequel on ne peut fermer les yeux.
J'ai critiqué, dans mon ouvrage, le théorème des vases communicants. Je suis en effet convaincu que la crise des systèmes politiques qu'il nous faut affronter pour rester les citoyens actifs que nous voulons être n'est pas d'un côté nationale, d'un autre côté communautaire : elle est une. Ne soyons pas obnubilés par la crise des institutions européennes comme si les institutions nationales se portaient bien. La démocratie se porte très mal en Europe parce qu'elle n'a jamais été suffisamment prise au sérieux : les citoyens européens n'ont pas le sentiment de pouvoir se faire entendre au niveau communautaire, la délégation est beaucoup trop forte, les niveaux intermédiaires sont trop nombreux, le Parlement européen a trop peu de pouvoirs. Cela étant, la démocratie se porte très mal au niveau national également. L'un après l'autre, les États membres deviennent ingouvernables – et je crains que l'on assiste en France à la même chose que ce qui se passe en Italie ou au Royaume-Uni. Or, les peuples ingouvernables sont tentés par des solutions démagogiques ou extrémistes. Il faut donc soigner la démocratie en France en même temps qu'il faut construire la démocratie européenne ; ces exigences sont indissociables. On ne peut élever le niveau de contrôle parlementaire et citoyen des décisions politiques en appliquant le théorème des vases communicants : ou cela passera par la nation et elle regagnera en souveraineté mais alors les institutions européennes devront accepter de régresser, ou ce sera l'inverse. Je m'inquiète donc du résultat des élections à venir en Allemagne et en France. Elles prendront forme de test à ce sujet, mais elles risquent d'être source de déceptions supplémentaires car on persiste à dissocier les deux aspects du problème.
Si j'avais un voeu à formuler, ce serait que par-delà les appartenances politiques et les divergences idéologiques, nous placions l'avenir de l'Europe au centre du débat précédant les élections prévues en France et en Allemagne, que nous interpellions les candidats sur ce point et que nous acceptions que des citoyens d'autres pays européens qui partagent nos préoccupations aient droit à la parole chez nous pour formuler leurs propres attentes.

Le philosophe est donc aussi un mathématicien qui nous parle de géométrie variable et qui, surtout, nous invite à résoudre la quadrature du cercle… Je suis, comme vous, citoyen européen et d'autant plus européen qu'alsacien, mais je suis aussi farouchement cocardier.
On ne peut faire comme si les Britanniques n'étaient plus en Europe, nous avez-vous dit – mais y furent-ils jamais ?
Je me suis rendu en Grèce dans le cadre de la mission organisée par le bureau de notre commission. Nous avons étudié de manière approfondie la situation de nos amis grecs et leur avons apporté notre soutien dans la mesure de nos moyens. Mais la question souvent entendue à propos de la dette grecque est : « Qui paye ? », et, indépendamment de la nécessaire solidarité européenne dont nous sommes tous partisans, on ne peut empêcher que les citoyens européens se la posent.
Vous tenez l'appartenance à l'Europe pour irréversible tant il est difficile d'en sortir. Cette garantie me paraît très fragile au moment où la crise du système politique européen est ressentie partout. Pourtant, que serons-nous dans le monde de demain si les pays membres de l'Union ne s'accordent pas, enfin, en matière de politique étrangère, d'économie et de politique énergétique ? Mais, dans tous ces domaines, les prises de décision se heurtent à des considérations relatives à l'indépendance nationale et à la souveraineté des États. Le diagnostic étant posé, quelle est l'ordonnance ?

Vous avez dit ne pas être un spécialiste de la mécanique européenne et c'est précisément ce qui nous intéresse car l'Union souffre des effets d'une autojustification permanente qui empêche la réflexion de prendre de la hauteur.
Vous avez justement souligné qu'en raison des échanges entre les pays membres, de leurs intérêts communs et de leur interdépendance, l'Europe continuera d'exister et que l'on ne reviendra pas à l'antérieur. Cependant, le projet européen – la création d'un espace supranational uni par des valeurs communes, projet affirmé depuis qu'a été décidée l'élection des parlementaires européens au suffrage universel direct, et dont l'apogée fut le projet de traité constitutionnel présenté en 2005 et rejeté par les Français – est extrêmement affaibli, comme la crise des migrants l'a montré sans équivoque : l'attitude des pays du groupe de Višegrad prouve que les sensibilités ne sont pas les mêmes en tous lieux.
La difficulté à unifier l'Europe autour de valeurs communes étant manifeste, ne faut-il pas faire le deuil d'un projet qui semble se poursuivre sur sa lancée comme continue de courir un canard sans tête ? J'ai cru à ce projet et je l'ai défendu, mais le temps n'est-il pas venu de tirer les enseignements nécessaires de l'échec du traité constitutionnel ? Ne faut-il pas revenir à ce qu'est l'Europe – un espace de coopération entre des États qui ont des intérêts communs et une monnaie commune – et repartir sur d'autres bases avec une ambition moindre mais plus réaliste ?

Vous avez plusieurs fois plaidé, monsieur Balibar, en faveur d'une Europe qui se fasse « médiateur évanouissant », expliquant qu'elle pouvait « contribuer de façon décisive, sinon à transformer le monde (…) du moins à en infléchir les évolutions annoncées, mais à la condition de « s'évanouir » à mesure que son intervention, ou sa médiation, se ferait plus déterminante : c'est-à-dire à la condition de se distinguer de plus en plus des images et des mythes de son « identité » enserrée par des frontières imaginaires ».
Il faudrait ne jamais écrire ! (Sourires)

Dans cette perspective, vous insistez sur le rôle clef des intellectuels. Or, ils pâtissent du grave manque de crédibilité et de confiance qui touche les élites. Sans doute parce que je suis un député paysan, la philosophie me plaît beaucoup, mais je considère qu'au temps de la réflexion doit succéder celui de l'action. Je crains qu'en tournant en rond dans l'analyse nous ne laissions s'épuiser le temps si précieux dont nous disposons pour construire une Europe économique, sociale et de paix, tout en permettant à ceux qui s'opposent à la construction européenne de se mettre en ordre de marche. Comment créer les liens nécessaires à la fabrication de l'Europe que nous appelons de nos voeux ?

Au contraire de M. Yves Daniel, je me demande si ce n'est pas faute d'avoir analysé autant que nous l'aurions dû ce qui était en cours au sein de l'Union européenne que nous en sommes arrivés à la situation actuelle.
J'ai donc été courtoisement invité à m'extraire du jargon philosophique pour entrer dans la réalité, ce qui ne me déplaît pas. Différemment formulées, vos questions sont les mêmes : que faire, avec qui et comment ? Pour commencer, j'abandonnerai la notion de « médiateur évanouissant ». J'admets que cette référence allusive à un certain concept philosophique est peu compréhensible, sinon en contradiction avec ce que je souhaite : non pas que l'Union européenne s'évanouisse mais bien qu'elle s'affirme et se construise.
Vous invitez, monsieur Caresche, à ce que nous tirions les leçons de l'échec du traité constitutionnel en nous repliant sur une conception plus modeste de l'Europe. Mais jusqu'où entendez-vous vous replier ? Renoncer à ce qui est en effet la quadrature du cercle, c'est renoncer à l'idée que l'intérêt des peuples européens est d'inventer quelque chose qui n'a jamais existé dans l'histoire : une structure à la fois supranationale et démocratique, ce qui ne va pas de soi, les exemples impériaux le montrent, et qui combine la continuité des traditions nationales et la protection de certains intérêts de nos populations avec une entrée agissante et éventuellement offensive dans le champ irréversible de la mondialisation.
Si l'on renonce à l'idée que quelque chose peut être inventé et accepté, on ne peut décider seul où l'on s'arrêtera. La construction européenne s'est faite par étapes. Si rien ne sert de dire que le tournant du traité de Maastricht n'aurait pas dû être pris, il faut réfléchir de manière critique à ce qui a été fait. On constate alors que l'on a par ce texte abouti à une construction dans laquelle, paradoxalement, l'impératif de l'unité et de la supranationalité est affirmé – et, à l'occasion, imposé – mais qu'en réalité la logique à l'oeuvre au sein de l'Union européenne est celle de la mondialisation : une concurrence internationale sans limites. Les fractures évidentes qui divisent l'Europe d'Est en Ouest et du Nord au Sud sont la conséquence d'une gouvernance européenne qui impose aux États membres de l'Union les règles régissant les relations économiques et financières internationales. Si l'on ne reprend pas les choses en main – ce qui pose la question de savoir qui y est prêt –, si l'on ne modifie pas ces relations, les fractures s'aggraveront inévitablement. Si vous voulez en rabattre au sujet de l'intégration européenne, je ne sais où vous vous arrêterez.
Le Royaume-Uni a-t-il réellement appartenu à l'Europe, m'a demandé M. Schneider ? Oui, mais pas à la manière de la France ou à celle de l'Italie ; il est d'ailleurs devenu évident qu'aucun pays n'est membre de l'Union de la même façon. Si l'on a permis que le Royaume-Uni ait un pied dans l'Union et un pied en dehors, singulièrement pour préserver les intérêts de la City, c'est parce que les Européens le voulaient – et qu'une partie d'entre eux continue peut-être de le souhaiter.
Qui paye la dette grecque ? Cette question a fait l'objet de manipulations au cours de la négociation avec la Grèce. La réticence de l'opinion publique à payer a été invoquée pour influencer les peuples et implanter dans l'esprit des citoyens européens l'idée que la restructuration de la dette grecque leur coûterait des sommes pharamineuses, ce qui est contestable puisque tout dépend des termes convenus et de la conjoncture économique.
Avec l'assentiment de fait – même s'il dit le contraire – de M. Michel Sapin, M. Jeroen Dijsselbloem, président de l'Eurogroupe, derrière lequel se tient toujours M. Wolfgang Schäuble, ministre allemand des finances, vient à nouveau de faire tomber le couperet en disant que le Mécanisme européen de stabilité suspendait l'allégement de court terme de la dette de la Grèce, au motif que son Premier ministre a annoncé des mesures en faveur des retraités très modestes. Certes, l'Union européenne paye en ce moment, mais qui paye-t-elle ? Les banques, puisque les citoyens grecs ne voient rien ou très peu du dispositif d'allégement de la dette publique, qui se traduit par un transfert permettant de régler les intérêts dus aux établissements bancaires. Je ne dis pas que les banques doivent périr mais qu'il faut savoir comment les risques sont gérés.
On crée des liens, monsieur Daniel, en rendant les liens désirables, en rehaussant d'un cran le niveau d'échanges, de circulation des idées, d'activation du débat politique à l'échelle européenne. J'ai pensé, il y a vingt ans, que se créerait, pour parler comme Jürgen Habermas, une sphère politique européenne, mais je n'avais pas l'illusion que ce serait facile. Non seulement cela passe par des intellectuels et par des représentants du peuple qui ont des intérêts de caste mais cela se heurte à des obstacles considérables dont le premier est celui de la langue, obstacles d'autant plus difficiles à surmonter que les systèmes éducatifs de nos pays ne donnent pas aux classes populaires les meilleurs moyens de le faire. Il faut donc des passeurs, des traducteurs… Aussi longtemps que le débat politique restera strictement clos dans l'espace national, on butera sur l'obstacle que vous signalez : non seulement nous ne trouverons pas de solutions aux problèmes qui se posent à nous mais la nécessité même de trouver des solutions ne sera pas perceptible à nos compatriotes et à nos concitoyens.

C'est à cette réflexion que notre présidente nous a invités sans relâche depuis cinq ans, et je l'en remercie.

Je vous remercie à mon tour pour ces aimables propos et je remercie notre invité, qui nous a confortés dans l'idée que, tout en restant dans le concret, nous devons nous interroger. Parce que nous sommes persuadés que nous finirons par construire l'Union européenne, nous continuerons de vous lire et de vous écouter, monsieur Balibar.
La séance est levée à 9 h 45