Intervention de Geneviève Fioraso
Réunion du 7 décembre 2016 à 9h30
Commission des affaires économiques
 Geneviève Fioraso :
Geneviève Fioraso :Merci, Madame la présidente, de m'accueillir dans cette commission que je connais bien pour l'avoir fréquentée pendant cinq ans sans y être jamais revenue depuis. Merci, par avance, pour votre indulgence, car je ne suis pas au mieux de ma forme : j'étais à Dakar pour un sommet sur la sécurité, où l'information, le renseignement et le spatial en Afrique ont été évoqués ; je suis revenue ce matin dans un avion militaire qui s'est posé à cinq heures et demie, au terme d'un vol assez long.
Ce rapport se veut pratique et pragmatique, nous avons souhaité qu'il s'adresse à l'ensemble des acteurs du spatial : les organismes de recherche, les industriels, mais aussi toute une chaîne de sous-traitance, car une grande partie de l'industrie est concernée par le spatial, qui est aujourd'hui le plus important pourvoyeur de données.
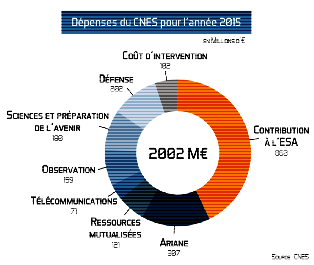 Le budget spatial de la France est constant – il a même un peu augmenté depuis 2013 –, de l'ordre de 2,2 milliards d'euros par an en moyenne. Par comparaison, le budget du ministère de la recherche est de 7,8 milliards d'euros, et l'ensemble de l'effort réalisé en faveur de la recherche publique, en y incluant le Programme d'investissements d'avenir (PIA) ainsi que tous les ministères investis, représente 15 milliards d'euros. Avec 2,2 milliards d'euros, c'est un gros budget qui est consacré la recherche spatiale publique.
Le budget spatial de la France est constant – il a même un peu augmenté depuis 2013 –, de l'ordre de 2,2 milliards d'euros par an en moyenne. Par comparaison, le budget du ministère de la recherche est de 7,8 milliards d'euros, et l'ensemble de l'effort réalisé en faveur de la recherche publique, en y incluant le Programme d'investissements d'avenir (PIA) ainsi que tous les ministères investis, représente 15 milliards d'euros. Avec 2,2 milliards d'euros, c'est un gros budget qui est consacré la recherche spatiale publique.
Avec 860 millions d'euros, la contribution versée à l'ESA au titre du programme Ariane est la plus importante des dépenses du CNES. Viennent ensuite les travaux de remise à jour et de rénovation du lanceur Ariane : 307 millions. Le troisième poste de dépenses – 202 millions – concerne la défense, pour les activités de surveillance et d'observation. Vient ensuite, avec 188 millions d'euros, tout ce qui touche aux sciences, à la préparation de l'avenir et à l'exploration. Les dépenses consacrées à l'observation de la Terre, pour des implications dans le domaine de l'environnement viennent en cinquième position : 159 millions d'euros ; en sixième position, les ressources mutualisées représentent un montant de 121 millions d'euros. Les coûts d'intervention, qui viennent en septième place, s'élèvent à 102 millions d'euros. On remarque que les dépenses consacrées aux télécommunications, avec 71 millions d'euros, ne viennent qu'en huitième position : ce n'est qu'une toute petite partie des dépenses du CNES. Je reviendrai plus tard sur ces dépenses de télécommunications.
Je rappelle que le CNES emploie 2 400 personnes. C'est la plus importante agence spatiale européenne ; la raison en tient à l'histoire, et tout particulièrement à la fusée Ariane.
En dehors de l'Union européenne, huit pays ont la capacité de lancer une fusée : les États-Unis, la Russie, le Japon, l'Inde, la Chine, Israël, la Corée du Sud, la Corée du Nord, qui s'est livrée à quelques essais peu fructueux, et bientôt l'Iran.
Pour ce qui est des budgets consacrés au spatial par ces pays, on ne connaît pas les chiffres de la Chine alors que ce pays investit massivement dans ce secteur. Les États-Unis dépensent près de 18 milliards d'euros par an, la Russie vient en deuxième position avec 5,5 milliards d'euros, l'Allemagne — qui vient très récemment de dépasser la France — dépense 2, 2 milliards d'euros, la France 2,1 milliards d'euros, et le Royaume-Uni, qui vient loin derrière mais dont l'investissement est en phase de croissance, 363 millions d'euros.
Si l'on considère le budget par habitant, la France se situe en troisième position derrière les États-Unis et la Russie, et devant l'Allemagne et le Royaume-Uni.
Le budget global de l'Agence spatiale européenne (ESA) s'élève à 5,2 milliards d'euros pour l'année 2016, sur lesquels 3,7 milliards d'euros sont investis dans les projets propres, et 1,5 milliard d'euros sous-traités, en quelque sorte, dans le cadre d'une maîtrise d'ouvrage déléguée par l'Union européenne. L'Union européenne consacre environ 50 % par an du budget de l'ESA au spatial. Sa part dans le secteur spatial va croissant, même si la coordination entre ESA et l'Union européenne mériterait d'être améliorée – mais les choses se sont arrangées récemment. En tout état de cause, l'Agence spatiale européenne est le principal opérateur de l'Union européenne dans ce domaine.
L'observation de la terre constitue le premier poste de dépenses de l'ESA, qui lui consacre 1,6 milliard d'euros ; les lanceurs représentent le deuxième poste avec 1 milliard d'euros, et le premier lancement d'Ariane 6 est envisagé en 2020. La navigation et la géolocalisation, sous-traitée pour le compte de l'Union européenne dans le cadre du programme Galileo, viennent en troisième position avec 609,5 millions d'euros. Les programmes scientifiques, pour lesquels l'ESA investit 507,9 millions d'euros, se placent en quatrième position. Les télécoms ne viennent qu'en sixième position et ne représentent que 359,3 millions d'euros, soit moins de 7 % du budget global de l'ESA. La présentation des zones géographiques où le marché des télécoms est mature sera l'occasion de mettre en évidence le décalage entre l'Europe et le reste du monde.
Le secteur spatial est important en termes d'abord de souveraineté : si vous dépendez d'un opérateur américain pour lancer vos satellites, vous ne maîtrisez plus votre agenda de lancements et vous perdez toute possibilité d'accès autonome à l'espace. C'est pourquoi, même s'il nécessite un énorme investissement, Ariane 6 est un projet essentiel : la concurrence du lanceur de l'américain SpaceX venait menacer le modèle Ariane 5ME. Nous avions donc besoin d'un lanceur moins coûteux, c'est-à-dire sans participation publique systématique à chaque vol, et surtout plus modulaire, avec une configuration à deux ou quatre boosters permettant d'emmener des charges de cinq à dix tonnes.
La maîtriser du lanceur est le socle indispensable à la compétitivité de la filière. Ariane 6, c'est vrai, n'a pas de version réutilisable pour l'instant, à l'image de ce à quoi travaille SpaceX, qui connaît des succès, mais également pas mal de déboires, ou de ce qu'a réussi Amazon avec un lanceur plus petit. Construire un lanceur réutilisable nous aurait condamnés à ne pas avoir de lanceur compétitif jusqu'à l'année 2028 ; il n'est par ailleurs pas évident qu'un tel appareil corresponde à notre modèle économique.
En revanche, des évolutions d'Ariane 6 sont prévues, et le CNES travaille sur le moteur Prometheus, qui permettra de diviser par dix le coût du moteur, en utilisant une configuration et un carburant différents ; on travaille également sur la réutilisabilité d'une petite partie d'Ariane. Autrement dit, les recherches se poursuivent afin de ne pas être pris au dépourvu le moment venu, pour peu que le modèle économique soit convaincant.
Ariane 6 fait partie d'une offre globale proposée au centre spatial de Kourou, allant du plus petit lanceur — le lanceur italien Vega — jusqu'à Ariane 6, en passant par Soyouz ; l'Europe bénéficie ainsi d'une gamme complète.
Le centre spatial guyanais constitue le deuxième segment de souveraineté du secteur spatial européen ; par le lanceur comme par le centre spatial, la France apparaît comme le fer de lance de l'Europe. J'insiste sur ce point, il n'y a pas beaucoup de secteurs stratégiques où la France peut se poser en leader au niveau européen. Arianespace est le numéro 1 mondial de son secteur : depuis les deux derniers lancements – quatre satellites Galileo d'un coup et une fusée Vega –, nous en sommes à soixante-seize lancements réussis d'affilée, ce qui constitue un record mondial absolu.
Pour l'avenir, je propose dans mon rapport que l'Europe s'approprie cette base spatiale encore davantage qu'elle ne le fait aujourd'hui à travers un programme dynamique de modernisation intitulé EuroK 25, en développant notamment une offre pour les microlanceurs afin de servir l'aval de la filière. Si l'Europe sait valoriser sa propre base spatiale, elle pourra s'imprégner de la notion de préférence européenne que nous avons pour l'instant bien du mal à faire prévaloir.
Le troisième segment de souveraineté du secteur spatial européen est Galileo. Ce programme a démarré en 1999 avec bien des difficultés, dans le but de concurrencer le modèle GPS. Il existe aujourd'hui dans le monde un système de géolocalisation russe, un système chinois, le système américain GPS, qui est le plus répandu, auxquels vient s'ajouter Galileo. Avec bien des hauts et des bas, les crédits de ce programme ont été multipliés par cinq ; aujourd'hui enfin, l'Europe offre ses premiers services Galileo, et les États-Unis, qui y étaient farouchement opposés au départ, reconnaissent désormais l'intérêt dans un monde peu pacifique, de disposer d'une redondance de leur système GPS. Du coup, Galileo offrira des performances supérieures à celle du GPS, notamment au niveau des distances d'observation.
J'ai insisté sur la nécessité de bâtir un socle solide pour ensuite développer l'aval : sans ce socle, il n'y a plus de souveraineté européenne. Mais pour que Galileo soit utile, il faut qu'il soit utilisé dans tous les systèmes embarqués, dans ce que l'on appelle l'internet des objets, particulièrement dans les systèmes de mobilité, les avions et surtout les automobiles. Pour cela, il faut une réglementation européenne très persuasive, ce qui n'est pas gagné du côté de l'Union européenne… La commissaire polonaise chargée de l'espace, comme son collègue chargé du numérique et celui chargé du marché intérieur, sont bien convaincus qu'il va falloir l'imposer. Et comme d'habitude, ils sont engagés dans une discussion très serrée avec la commissaire chargée de la concurrence : pour la direction générale de la concurrence, la concurrence s'entend à l'intérieur de l'Europe et non à l'extérieur… Une petite conversion culturelle s'impose. Pour l'utilisateur final, c'est totalement invisible : on ne voit jamais si on utilise le GPS ou Galileo sur son portable ou dans son outil de mobilité. Mais il est essentiel pour notre industrie d'utiliser davantage Galileo : il y a donc bien un enjeu important de réglementation européenne.
Une fois que l'on dispose d'un socle solide, disais-je, il devient possible de développer l'aval. L'Europe, et singulièrement la France, est plus performante dans le domaine des grandes infrastructures que dans le développement des services aval, largement trustés par Google, Amazon, Facebook, Apple et d'autres comme Virgin Galactic. Depuis cinq ou six ans, les GAFA se sont intéressés au spatial, car ils ont constaté que ce secteur était le plus important pourvoyeur de données.
Personne ne sait que, pour asseoir le diagnostic établi par les 5 000 scientifiques étudiant le réchauffement climatique, 54 % des données utilisées provenaient exclusivement du spatial, et pour partie dans les 46 % restants… Le nouvel or noir industriel n'est plus le pétrole : c'est le big data – en bon français, les métadonnées.
Le marché des métadonnées a crû de 23,5 % en 2015, et passera de 18,3 milliards de dollars en 2014 à 92 milliards de dollars en 2026 ; c'est le marché mondial qui connaît la plus forte croissance. Et qui dit marché dit développement de services, création d'entreprises, et du coup création d'emplois.
Quel est l'impact de la révolution numérique sur le spatial ? D'abord sur les instruments eux-mêmes : à côté des gros lanceurs, on voit naître des objets bizarres mais avec de grandes capacités, rendus possibles par l'extrême miniaturisation et la diversification des acteurs comme les GAFA qui ont fait irruption dans le secteur spatial, avec leur créativité mais également une culture différente. Sitôt qu'ils investissent un secteur nouveau, ils y apportent forcément des conceptions et des idées nouvelles : ainsi, Amazon a créé son vaisseau destiné au tourisme spatial, le New Shepard, et a déjà réussi à le faire se poser à son point de lancement. De son côté, Google travaille à un projet de ballon dénommé Loon, auquel le CNES participe, et Facebook développe le projet Internet.org afin de rendre le réseau accessible sur l'ensemble de la planète. On connaît mal le projet sur lequel travaille Apple, mais il existe bel et bien. Virgin Galactic développe le projet OneWeb d'une constellation de 900 satellites capable de donner à tous accès à internet, quels que soient le territoire et sa richesse. Des entreprises françaises ont intégré ce projet ainsi que la société Airbus Defence and Space, qui y a investi plus de 150 millions d'euros. OneWeb apparaît bel et bien comme un véritable projet de rupture.
Des entreprises de taille intermédiaire s'intéressent également à l'espace : ainsi Sodern, une entreprise traditionnelle à première vue, dont le patron est un ancien de la direction générale de l'armement (DGA), qui emploie 300 personnes, et dont l'actionnariat compte Airbus et, pour une moindre part, la DGA ainsi que d'autres acteurs. Cette entreprise connaît une véritable révolution, assez emblématique de l'évolution actuelle du secteur spatial. Son produit phare, ce sont les viseurs d'étoiles. Jusqu'à présent, Sodern en fabriquait une cinquantaine d'exemplaires par an ; en s'intégrant au projet OneWeb, elle va en produire 1 800 modèles par an, et pour un prix qui sera cinquante à cent fois moins cher. C'est un changement de paradigme total pour cette entreprise qui, enthousiasmée par le projet, a pris le sujet à bras-le-corps, a introduit la pratique de l'e-management et a intégré l'ensemble de son personnel dans un changement d'organisation. Ces traceurs d'étoiles seront certes moins performants que les précédents, produits à seulement cinquante exemplaires par an, tout en demeurant de grande qualité, notamment grâce au recours à de nouvelles technologies, dont les imprimantes 3D. Pour Sodern, le changement est radical, mais d'autres entreprises du même type se lancent également dans de profondes mutations.
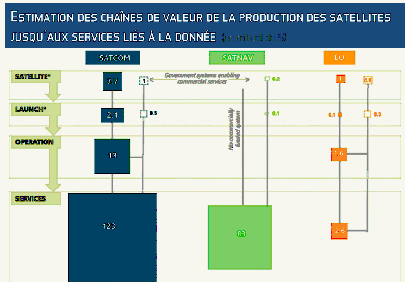 Ainsi, dans le domaine des nouveaux objets spatiaux, la France est plutôt bien placée. Le Stratobus de Thales Alenia Space, qui sera opérationnel en 2020, naviguera à une hauteur intermédiaire entre l'orbite géostationnaire et l'orbite basse (LEO – Low Earth orbit) ; il fera fonction de transporteur et de ravitailleur spatial. Le Sparrow (moineau) est un autre de ces petits objets, produit par Airbus Safran Launchers, filiale d'Airbus et Safran créée pour construire le lanceur Ariane 6. En revanche, nous sommes moins présents dans le secteur des services aval est plus faible, là où se trouve un gros gisement potentiel de création d'emplois.
Ainsi, dans le domaine des nouveaux objets spatiaux, la France est plutôt bien placée. Le Stratobus de Thales Alenia Space, qui sera opérationnel en 2020, naviguera à une hauteur intermédiaire entre l'orbite géostationnaire et l'orbite basse (LEO – Low Earth orbit) ; il fera fonction de transporteur et de ravitailleur spatial. Le Sparrow (moineau) est un autre de ces petits objets, produit par Airbus Safran Launchers, filiale d'Airbus et Safran créée pour construire le lanceur Ariane 6. En revanche, nous sommes moins présents dans le secteur des services aval est plus faible, là où se trouve un gros gisement potentiel de création d'emplois.
Vous constatez sur le schéma précédent que, dans le secteur des satellites de communication (SATCOM), l'investissement public consacré aux satellites eux-mêmes et aux lanceurs représente, respectivement, au niveau mondial, 3,7 milliards de dollars et 2,1 milliards de dollars ; l'aval de la filière, autrement dit les services, représente 123 milliards de dollars… On mesure ainsi le nombre d'emplois et de créations d'entreprises que le levier public est susceptible de générer. Le marché des télécoms est, au niveau mondial, le numéro 1 et le plus mature ; c'est bel et bien le marché sur lequel il faudrait « mettre le paquet » en amont tant il est prometteur et porteur pour l'aval.
Deuxième segment : les satellites de navigation et de géolocalisation (SATNAV). Avec le projet Galileo, nous tenons le bon bout, même si ce n'est pas le marché numéro 1 : il n'en est pas moins extrêmement porteur en termes de potentiel en aval, au niveau des services et des applications.
Vient en troisième position le marché de l'observation de la terre (EO), dont nous avons vu tout à l'heure qu'il était prioritaire après celui des lanceurs dans le budget de l'ESA : même s'il représente un investissement très utile, on constate qu'il vient très loin derrière en termes de potentiel de création d'emplois.
Ce décalage entre les investissements réalisés par l'Europe et le CNES et le potentiel de création d'emplois s'explique en partie par l'importance de la contribution française et européenne dans les lanceurs, qui constituent l'investissement numéro 1 ; reste qu'un correctif s'impose si nous voulons développer les applications en amont et créer des emplois là où le marché est le plus porteur. D'où la nécessité de rapprocher le spatial du numérique.
Permettez-moi une anecdote. Lorsque j'ai pris mes fonctions ministérielles en 2012, on commençait à parler de SpaceX, mais dans des termes bien différents de ceux que j'entends aujourd'hui de la part des acteurs européens, particulièrement des Français. On soutenait alors que SpaceX n'était qu'un feu de paille, que ses promoteurs allaient se « crasher » du fait de leur manque d'expérience, tout comme les GAFA, bref, que l'on s'était totalement trompé dans l'expertise. Fort heureusement, la décision de lancer Ariane 6 et de mettre au point une vraie stratégie européenne a été boostée par cette concurrence majoritairement américaine aujourd'hui, mais qui se profile de la part de la Chine et d'autres pays émergents. Aujourd'hui, tout le monde a bien pris conscience qu'un changement de paradigme est intervenu dans le domaine du spatial – ce qui ne signifie pas qu'il faille pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain : nous devons conserver nos compétences et notre expertise dans les domaines où nous sommes performants.
Des initiatives européennes de valorisation sont d'ores et déjà à l'oeuvre ; l'ESA développe le programme ARTES (Advanced Research in Telecommunications Systems), qui, dans le secteur des télécommunications, valorise toutes les compétences dont nous disposons dans le domaine spatial. En réponse à la question de la présidente, Mme Frédérique Massat, je peux indiquer que, lors de la dernière réunion interministérielle de l'ESA, un effort supplémentaire a été décidé dans le domaine des télécommunications par rapport au budget initialement prévu. Ce choix va dans le bon sens, en cohérence avec les priorités retenues et la nécessité de viser les marchés les plus porteurs.
L'Union européenne a également lancé un appel à projets afin de favoriser les applications liées aux données Copernicus. Copernicus est grand programme européen d'observation dont les applications sont multiples, dans les domaines de l'agriculture et de l'environnement notamment. Malheureusement, les données Copernicus, en format open data, ne sont pas directement accessibles aux entreprises, notamment les PMI et PME : il faut les travailler pour les rendre utilisables. Du coup, ces données exclusivement financées par les États membres de l'Union européenne sont à 98 % utilisées par les GAFA, ce qui est pour le moins paradoxal, tout simplement parce que les GAFA ont les moyens de sous-traiter à des sociétés de services et d'ingénierie en informatique (SSII) le traitement de ces données, avant d'en alimenter leurs cibles commerciales : n'oublions pas qu'ils fonctionnent comme des annonceurs en commercialisant des données dûment ciblées et marketées en fonction de leur clientèle.
Les pays européens ont également mis en place des clusters, dont un pour les données, situé au Luxembourg, qui trouve sa première application dans le domaine financier, les FinTech, mais aussi dans d'autres domaines comme l'environnement.
Un cluster « télécoms » très puissant a été créé au Royaume-Uni : en 2011, l'ESA avait décidé d'y installer sa direction des télécoms – malheureusement pour la France, dans la mesure où, on l'a vu, c'est le secteur le plus porteur. Les femmes étant assez rares dans le spatial, je tiens à saluer au passage l'excellence de la directrice de cet établissement, Mme Magali Vaissiere, l'une des meilleures de l'ESA. En trois ans, elle a su créer un pôle particulièrement efficace, qui va de la recherche sur les télécoms jusqu'à la création de startups, dont certaines ont établi des partenariats avec les grands donneurs d'ordres. Dans ce laps de temps, soixante-cinq entreprises ont été créées, qui emploient un nombre important de salariés. L'effet cluster sur les télécoms a bien joué au Royaume-Uni ; il nous faut le développer davantage en France.
De son côté, le CNES a créé il y a huit mois une direction de l'innovation, des applications et de la science, implantée à Toulouse, comme nous l'avions nous-même préconisé, de façon à penser « applications et services » sitôt que l'on commence à réfléchir aux lanceurs et des satellites. Une direction du numérique est également en cours de création. Nous aurions préféré que cette direction soit intégrée à la direction de l'innovation car lorsqu'ils sont dans une direction autonome, les informaticiens ont précisément tendance à très vite s'autonomiser… Heureusement, je sais que le directeur de l'innovation, M. Lionel Suchet est extrêmement vigilant sur ce point.
Au niveau des pouvoirs publics, le ministère chargé de l'environnement et des transports est pour l'instant le seul à s'être saisi de la question en mettant en place un plan satellitaire, notamment pour l'observation de l'environnement, la prévention des catastrophes, et la gestion plus rapide des catastrophes naturelles. Nous préconisons que les pouvoirs publics, y compris les régions, s'approprient cet outil formidable et de moins en moins coûteux qu'est le spatial.
En 2012, constatant que les acteurs français n'étaient pas en ordre de marche, j'avais mis en place, sur le modèle du Conseil pour la recherche aéronautique civile (CORAC), le COSPACE qui rassemble les grands industriels, le CNES, l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA), mais également, c'est moins fréquent, les clients et les acteurs du numérique, comme Eutelsat, des startups et de grandes SSII. Il est toujours bon que les grands donneurs d'ordres aient leurs clients en face d'eux pour leur rappeler ce que sont les besoins des usagers.
C'est ainsi que nous avons créé, adossés à quatre pôles de compétitivité, les « boosters », c'est-à-dire des lieux qui accompagnent la création de startups et qui les mettent en relation avec les donneurs d'ordres afin de leur faciliter l'accès au marché.
Dans le même esprit, nous avons regroupé toutes les données satellitaires sur la plate-forme d'exploitation des produits Sentinel (PEPS), qui sont traités pour être immédiatement utilisables par les startups – je vous ai dit tout à l'heure que 98 % des données brutes en open data issues de Copernicus sont utilisées et valorisées par les GAFA. Pour travailler et cibler les métadonnées de façon à les rendre utilisables, la SSII Atos expérimente une plateforme, en lien avec le CNES, des centres de recherche et des laboratoires publics, pour permettre aux PME-PMI, aux ETI et aux startups d'avoir un accès privilégié immédiat à ces données.
J'en viens aux applications fondées sur les usages, dont on n'imagine pas la variété.
Pour l'observation de la Terre, il s'agit de la prévision météorologique – à sept jours, et non plus à six jours –, la cartographie, la surveillance des risques naturels, climatiques et environnementaux, l'aide aux populations en détresse, la surveillance des frontières, la défense (très haute résolution nouvelle génération, système d'alerte, etc.)
Pour les télécommunications, il s'agit de l'accès aux réseaux de télévision, téléphonie et mobile – marché le plus en expansion.
Pour le positionnement, nous trouvons la localisation de tout type de véhicule et la régulation des trains – les TGV sont actuellement régulés par le spatial ; les applications utilisant les données de localisation des smartphones ; l'horloge atomique, avec la synchronisation des systèmes bancaires, des réseaux de télécommunications et de distribution de l'énergie ; enfin, tout ce qui touche à l'IoT, l'internet des objets, en pleine expansion dans l'aviation et l'automobile.
Enfin, dans le domaine de la science, les applications concernent la composition d'une comète, l'environnement martien, la structure des trous noirs, la découverte d'exoplanètes, les applications santé des vols habités, etc. Il faut savoir que 60 % des expériences que va faire Thomas Pesquet dans l'espace concernent la santé, notamment pour la lutte contre l'ostéoporose et certaines maladies musculaires ou cardiaques : dans l'espace, on perd 20 % de sa masse musculaire et 20 % de sa masse osseuse… On y est d'autant mieux placé pour travailler sur ces sujets.
En conclusion, le domaine de l'espace ne doit pas rester réservé aux spécialistes. Il n'est pas normal qu'un secteur autant concerné par les métadonnées soit aussi fermé sur lui-même – on parle de la grande famille de l'espace ; il faut absolument qu'elle s'élargisse. Je me suis aperçue qu'en deux ans, en m'intéressant à l'espace comme ministre, je connaissais à peu près tout le monde en Europe et beaucoup de gens à l'international, ce qui n'est pas normal. Il faut donc ouvrir le domaine de l'espace, d'où le titre de mon rapport, « Open space ».
C'est ainsi qu'il faut une ouverture du spatial aux applications nées des usages, avec une priorité pour les télécommunications, ainsi qu'aux cultures, pratiques et métiers liés au digital. À côté des ingénieurs classiques, il convient d'embaucher des data scientists, des data miner, mais aussi des hackers, pour apporter une nouvelle culture dans les agences. Le spatial doit aussi s'ouvrir aux nouveaux modèles économiques, du fait du coût moindre que représentent les constellations de satellites. Il doit également s'ouvrir à la culture du risque. M. Jean-Jacques Dordain, ancien directeur général de l'ESA, se réjouissait de 74 vols sans anicroche ; mais cela signifie aussi qu'on n'a pas pris assez de risques. SpaceX, y compris sur des vols institutionnels, a « planté » sa fusée plusieurs fois ; mais nos collègues démocrates et républicains trouvent cela normal : pour eux, cela fait partie du processus d'innovation. Nous avons tout à apprendre de cette culture du risque pour progresser.
Il faut également ouvrir le spatial à la parité. Pour avoir des applications pertinentes, la profession doit s'ouvrir davantage aux femmes, d'autant que celles qui viennent sont vraiment très talentueuses. Enfin, il faut ouvrir le spatial à l'open space pour les citoyens. Actuellement, nos grandes SSII s'adressent aux intermédiaires, aux entreprises, mais pas aux citoyens, alors que les nouveaux entrants, les GAFA, s'adressent, eux, à l'utilisateur final.

