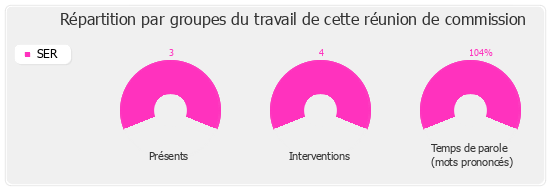Délégation de l'assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
Réunion du 25 mai 2016 à 14h00
La réunion
La séance est ouverte à 14 heures.
Présidence de Mme Catherine Coutelle, présidente.
La Délégation procède à l'audition de Mme Florence Rochefort, présidente de l'Institut Émilie du Châtelet pour le développement et la diffusion des recherches sur les femmes, le sexe et le genre, historienne et chercheuse au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), sur les études de genre.

Nous allons poursuivre nos auditions sur les études de genre. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mme Florence Rochefort, présidente de l'Institut Émilie du Châtelet.
Vous le savez sans doute, madame, nous avons déposé, en 2014, dans le cadre du projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, un amendement qui consiste à intégrer à la politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes des actions visant à porter à la connaissance du public les recherches françaises et internationales sur la construction sociale des rôles sexués. Nous étions, à cette époque, en France, en pleine polémique sur le genre.
En 2014, vous avez publié, avec Laurie Laufer, un ouvrage intitulé Qu'est-ce que le genre ?
Pouvez-vous nous présenter l'Institut Émilie du Châtelet, nous parler de ses travaux et de la place qu'il occupe dans la recherche française, en termes d'études de genre ?
Enfin, pouvez-vous définir ce que sont, pour vous, les études de genre et nous expliquer quelle est votre conception de ces études ?
Madame la présidente, mesdames les députées, je vous remercie de votre invitation et me réjouis de pouvoir à nouveau faire le point, devant cette délégation, sur les études de genre.
J'interviens aujourd'hui à la fois en tant que chercheuse au CNRS et présidente de l'Institut Émilie du Châtelet. J'ai construit mon propos liminaire à partir de ce que fait l'Institut et des études de genre en général. J'aborderai la question de la définition du genre et des études de genre, puis la question de l'institutionnalisation, enfin, celle de la diffusion et de la circulation des savoirs.
L'institut Émilie du Châtelet (IEC) se consacre depuis dix ans au développement et à la diffusion des études sur les femmes, le sexe et le genre. L'Institut est une fédération de recherche qui rassemble quinze établissements. Il a été labellisé « Domaine d'intérêt majeur » (DIM) par la région Île-de-France lorsque, souhaitant apporter un soutien aux études de genre, elle a mis en place cet ambitieux programme d'aide à la recherche.
L'IEC a été à nouveau retenu lors de la dernière campagne de labellisation, qui s'achèvera en décembre 2016, au sein d'un dispositif plus large regroupant le réseau IEC sur le genre et un réseau sur les discriminations, le DIM « Genre, inégalités, discriminations » (GID), que je copréside, avec Patrick Simon, directeur d'études à l'Institut national d'études démographiques (INED), et la collaboration de la secrétaire générale, Sylvie Blumenkrantz.
L'IEC, grâce au soutien de la région Île-de-France, a permis, en leur attribuant des allocations, à quatre-vingt-sept jeunes chercheuses et chercheurs, cinquante doctorants et doctorantes et trente-sept post-doctorat, de réaliser leurs recherches sur le genre dans vingt-cinq disciplines différentes, l'IEC ayant volontairement fait ce choix pour essaimer le genre dans toutes les disciplines. Nous nous félicitons de ce choix, car l'effet « soutien public » et « allocations » a été déterminant pour légitimer les études de genre dans des disciplines nouvelles ou plus traditionnelles.
Nous avons mené plusieurs actions, comme des colloques scientifiques, de grandes conférences sur les parcours de personnalités, des publications d'ouvrages, des aides pour des manifestations scientifiques. Au regard de notre expérience, l'essaimage a été plutôt fructueux. Il suffit, parfois, d'une petite somme d'argent pour qu'un colloque très important puisse avoir lieu. Nous avons également mené à bien la traduction d'ouvrages majeurs. Trois sont déjà parus et trois autres paraîtront prochainement.
Je reviendrai ensuite sur la politique de diffusion, qui est également une mission de l'Institut et qui consiste à mettre en réseau le potentiel d'études de genre sur le territoire de l'Île-de-France, sachant que les thèmes d'allocations ne concernent pas forcément la région et que les thèmes de colloques sont internationaux. Simplement, les institutions qui portent ces études sont, elles, enracinées dans le territoire de l'Île-de-France.
J'en viens à la notion de genre et d'études de genre.
On peut définir le genre comme un concept susceptible de diverses théorisations, un concept, une notion, qui désigne la façon dont les sociétés, à différentes époques et dans différentes aires géographiques, ont organisé les relations entre les sexes, pensé le féminin et le masculin, inventé des normes de féminité et de masculinité.
On peut parler du genre comme d'un système de relations hiérarchisées, dont on étudie les rouages et les évolutions et ce qu'il induit comme rapports sociaux dans tous les domaines, mais aussi en termes de représentations, d'images, d'affects, de symboles.
L'intérêt de ce concept est qu'il a permis de réfléchir, non seulement aux femmes, même si elles restent un sujet d'étude primordial, mais aussi aux hommes en tant qu'être sexués, aux normes liées à la sexualité et, plus généralement, à la façon dont toutes les institutions ou les espaces sont genrés, c'est-à-dire constitués selon un langage, un code du masculin et du féminin, qui assigne des rôles prédéfinis aux uns et aux autres, par héritage historique et par reproduction plus ou moins conscientes des hiérarchies.
La grande majorité des thématiques abordées dans les études de genre et dans les sciences humaines en général sont en prise avec le social, et donc, le politique. Ainsi, la thématique des inégalités est centrale dans notre champ. Comment se fabriquent-elles ? Par quel biais ? Comment se corrigent-elles ? À partir de quel processus de mutations économiques, sociales, culturelles, religieuses ? Avec quels moyens ? Avec quelles actions ? Le prochain colloque du GID, en juin prochain, porte précisément sur le thème « Agir pour l'égalité ».
Cela ouvre un vaste champ de questions, déjà soulevées par les mouvements féministes depuis le XIXe siècle, mais transposées dans le champ scientifique, dans toutes les disciplines : ce qui a paru longtemps naturel, à savoir la faiblesse du corps et de l'intelligence des femmes, par exemple, qui justifiait leur incapacité politique ou professionnelle, leur statut inférieur assujetti aux lois, aux coutumes et aux moeurs, cette supposée loi de la nature a fait l'objet d'analyses de plus en plus précises pour prouver l'égalité, démonter les mécanismes sociaux, politiques et culturels, qui fabriquent les inégalités et les discriminations.
Tous les champs du savoir ont été questionnés par les études de genre, y compris le fonctionnement de la science elle-même, pour comprendre l'occultation ou l'exclusion des femmes, dans le champ de la connaissance, comme productrices de savoir.
Cette démarche a abouti à de nombreux résultats dans tous les domaines, comme le travail ou l'éducation, et à de nouveau sujets, comme la sexualité, l'histoire médicale, la représentation et l'évolution dans l'histoire du sexe biologique, ou encore le champ politique. Enfin, de nouvelles disciplines, comme la géographie, l'information et la communication, s'intéressent désormais à ces problématiques.
On peut considérer les études de genre comme un vaste champ pouvant réunir tous les spécialistes qui mettent en oeuvre dans leurs travaux une problématique de genre. Ce n'est donc pas une discipline, mais bien un champ, qui nécessite plusieurs formes d'institutionnalisation.
Le terme de « genre » tend désormais à englober les recherches sur des thématiques proches, comme les femmes, le sexe, les sexualités. Il est d'usage international. C'est ce qui a fait son succès dans le monde entier, où nous sommes réputés être les spécialistes des études de genre. C'est pour cette raison que nous sommes convoqués, appelés, invités, et que nous rentrons dans une science internationale.
Le terme de « genre » est aussi d'usage politique dans les organismes internationaux. Il continue de désigner des questions spécifiques à la politique publique internationale. Il permet d'insister sur la pluridisciplinarité, y compris dans un dialogue avec les sciences dures.
Nous avons organisé un colloque sur la santé avec des médecins, afin d'établir un dialogue entre sciences dures et sciences humaines et sociales, ce qui permet d'expérimenter, de confronter, d'échanger, de dialoguer autour de questionnements communs.
Chaque discipline a sa propre méthode, sa propre problématique, mais elle va aussi se nourrir de l'apport des autres travaux. Il y a donc à la fois du disciplinaire, du pluridisciplinaire et du transversal. Le transversal, c'est ce qui passe d'une discipline à l'autre, d'une frontière d'un champ à l'autre, ou encore d'une frontière géographique à l'autre, parce qu'il y a beaucoup d'échanges internationaux autour de ces questions, avec des conceptualisations différentes selon les pays. C'est dans cette confrontation que se dynamise le champ des études de genre.
Pour rendre compte de l'ampleur des enjeux, je citerai quelques ateliers, sur le thème de la santé, qui viennent d'être mis en ligne sur notre site : normalisation des corps, cancer, grossesses et maternité, morbidité et mortalité, transgenre, santé et travail, vieillissement, virus de l'immunodéficience humaine (VIH), santé sexuelle. Ces ateliers ont contribué à faire connaître les nouveaux travaux de recherche et à appréhender ces thématiques de façon genrée.
Les polémiques autour du mariage entre personnes de même sexe ont été préjudiciables aux études de genre, du fait d'un dénigrement systématique du terme de « genre » et d'une focalisation de certains groupes politiques contre les chercheurs et chercheuses et universitaires.
Les institutions universitaires et de recherche déjà engagées dans le soutien aux études de genre ont cependant poursuivi leurs efforts, comme le CNRS et les universités, notamment, ou encore les régions, en particulier la région Île-de-France. Mais le fait que des groupes extrémistes aient fait de la stigmatisation des études de genre leur leitmotiv a renforcé les préjugés d'une partie de l'opinion ou de nos collègues hostiles et a, par ailleurs, interrompu, dans une certaine mesure, le dialogue fructueux qui s'était instauré depuis de nombreuses années entre les élus et responsables politiques et les études sur les femmes et le genre.
Pour répondre à ces attaques, nous avons décidé, au sein de l'Institut Émilie du Châtelet, de publier un ouvrage qui rende accessible le fruit de nos travaux. Dans Qu'est-ce que le genre ?, que j'ai codirigé, avec Laurie Laufer, psychanalyste et professeure de psychopathologie à l'université Paris Diderot, qui préside le conseil scientifique de l'Institut Émilie du Châtelet, nous avons choisi d'expliquer, à travers des questions de société relativement courantes ou d'actualité et à travers quelques approches disciplinaires, comment la notion de genre était « une catégorie utile d'analyse », comme l'écrivait déjà en 1986 la célèbre historienne Joan Scott.
L'ouvrage réunit treize chapitres, dans treize disciplines ou domaines différents, qui permettent d'aborder de grandes questions de société. Pourquoi les femmes valent-elles moins que les hommes, en termes de salaires ? Pourquoi sexualité et égalité ne font-elles pas bon ménage ? Comment expliquer les mobilisations contre la théorie du genre ? Comment le genre permet-il d'enrichir et de développer un point de vue critique en études cinématographiques, en psychanalyse ? En quoi le genre est-il un concept sécularisateur ?
La façon dont toutes ces questions sont abordées vise un public savant, mais pas forcément spécialiste. Les éditions Payot ont accepté de publier ce livre directement en poche, au prix de dix euros, ce qui a permis de toucher un large public. Un éditeur espagnol et un éditeur italien ont jugé que le livre répondait aussi aux questionnements de leur actualité et il va bientôt paraître dans ces deux langues.
En résumé, les études de genre permettent de relever les défis soulevés par les féminismes, en interrogeant les savoirs déjà constitués, en posant de nouvelles questions, qui concernent les champs eux-mêmes et les méthodes. Ces questionnements donnent lieu à des résultats d'enquêtes, à des modélisations théoriques, à des comparaisons internationales. Ils permettent de produire des savoirs nouveaux, de renouveler des champs disciplinaires et d'inspirer de nouvelles politiques publiques.
Les études de genre nécessitent un soutien pour poursuivre la vague d'institutionnalisation qui a marqué la France depuis plusieurs années. C'est un processus en cours, qui ne cesse de prendre de l'ampleur – ce dont nous nous félicitons –, au sein des établissements universitaires et de recherche, des nouveaux découpages territoriaux de la recherche, comme les communautés d'universités et établissements (COMUE), et des réseaux qui se sont créés. Cela étant, il ne faut pas se masquer la difficulté de pérenniser ces réseaux qui, souvent, s'appuient sur des personnalités, ou sur une conjoncture, laquelle n'est pas forcément pérenne. Par conséquent, le problème de pérennisation de ces institutions au sein des disciplines comme du transdisciplinaire demeure.
Par ailleurs, on peut avoir une impression d'essaimage. C'est la rançon du succès. Si l'on veut que chaque discipline, chaque université puisse fournir une formation initiale sur le genre, il y aura essaimage. C'est une bonne chose, car nous souhaitons qu'il y ait du genre partout et qu'on puisse se poser cette question dans toutes les disciplines et dans tous les territoires. L'essaimage rend les réseaux plus nécessaires encore pour mettre en synergie ces potentiels sur des thématiques précises et favoriser le dialogue.
La circulation et la diffusion des savoirs sur le genre sont un enjeu d'avenir majeur.
L'Institut Émilie du Châtelet a également pour mission d'instaurer un dialogue permanent entre le monde de la recherche, les acteurs politiques, institutionnels, associatifs ou professionnels oeuvrant à l'égalité des sexes.
Un conseil d'orientation travaille en étroite collaboration avec les membres scientifiques de l'Institut Émilie du Châtelet pour organiser des assises annuelles, qui rassemblent des chercheurs, des personnalités de terrain associatif, des élus ou des professionnels qui réfléchissent à leurs pratiques. Cela donne lieu à un partage d'expériences et à une interpellation réciproque, afin de saisir ce qui, sur le terrain social et politique, nécessiterait d'autres travaux universitaires sur le genre pour mieux comprendre et analyser une question – les violences, par exemple – et ce qui, dans le domaine de la recherche, apporterait de nouvelles perspectives pour l'action sociale, politique, culturelle, ou de nouvelles données, de nouveaux concepts… L'IEC organise également des cafés où se prolonge le débat.
Les dernières assises que nous avons organisées portaient précisément sur la circulation des savoirs. Je pense que cela peut intéresser d'autres interlocuteurs qui s'intéressent à ce champ d'étude, nous avons mis, ces dernières années, nombre de savoirs en circulation sur notre site et sur Dailymotion, et nous avons produit des livres.
Nous nous sommes demandé s'il ne manquait pas un maillon au fameux « triangle de velours ». À côté de ce triangle, nous proposons de réfléchir à d'autres formes géométriques, comme le carré, en ajoutant aux politiques publiques, à la recherche et au monde associatif, la médiation des savoirs.
Depuis une trentaine d'années, l'effort a été considérable dans tous les domaines de la recherche et au niveau du soutien politique, mais il est nécessaire, aujourd'hui, de se poser la question de l'accompagnement de ces savoirs. Je ne reviendrai pas sur le triste arrêt de l'expérience des « ABCD de l'égalité », mais la transmission de ces savoirs dans l'enseignement primaire et secondaire est un véritable enjeu.
Il y a une accumulation de savoirs, une masse critique importante, qui reste un peu bloquée dans sa forteresse, mais je crois que ce n'est pas du fait des chercheurs. Tout est prêt à être diffusé, mais il y a un blocage. L'enseignement et la formation continue sont des vecteurs essentiels pour remédier à cette situation. Nous sommes plusieurs réseaux à avoir constaté notre échec à l'égard des écoles de journalisme, par exemple, qui constituent, pour l'instant, un bastion infranchissable, malgré la présence de journalistes très engagées lors de nos débats et de nos assises.
Le soutien à la diffusion et à la circulation des savoirs, ainsi qu'aux réseaux qui les portent, est un autre défi à relever, sans oublier la production. L'aide à la jeune recherche et les allocations sont le maillon indispensable pour que des travaux puissent être entrepris, la jeune génération contribuant elle-même à la circulation des savoirs par l'enseignement.

Vous avez dit, sans les nommer, qu'il y avait des disciplines rétives au genre. Y a-t-il des disciplines, nouvelles ou traditionnelles, qui n'ont aucun accès au genre ? Je pensais notamment aux mathématiques. Les mathématiciens sont-ils favorables à un regard sexué sur les études de mathématiques ?
Pourquoi est-il si difficile de pratiquer l'interdisciplinarité à l'université ? Est-ce une question d'évaluation des chercheurs, qui ne sont évalués qu'en termes disciplinaires ? Cela est-il dû à la formation des chercheurs ?
Cela pose problème, car aujourd'hui, on va nécessairement demander à un ingénieur ou à un chercheur qui occupe un nouveau poste d'être transversal, interdisciplinaire, dès lors qu'il a un certain niveau de responsabilité. Pour ma part, je fais le lien avec la réforme du collège, qui est si difficile à mener, les enseignants étant formés uniquement dans leur discipline. Cette réticence sur la transversalité au collège remonte jusqu'à l'université.
Pour répondre à votre question sur l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité ou la pluridisciplinarité, ce n'est pas un reproche qu'on peut faire aux études de genre. Au contraire, je crois qu'elles ont été un laboratoire en matière de transdisciplinarité.
Cela étant, c'est une question que nous nous sommes posée. Un rapport a été remis au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, il y a à peu près cinq ans, auquel j'ai participé en tant que présidente de l'IEC, et qui posait la question de l'équilibre entre disciplines et pluridisciplinarité.
Pour l'instant, il convient, semble-t-il, de proposer à la fois des enseignements pluridisciplinaires et des enseignements disciplinaires, parce que la méthodologie est avant tout disciplinaire.
Une fois arrivé à un certain stade de la recherche, il n'en est pas moins difficile de maîtriser toutes les méthodologies et, à l'exception de quelques sujets qui se prêtent vraiment à la pluridisciplinarité, il s'agit, la plupart du temps, de deux disciplines : je pense, par exemple, aux sociologues anthropologues ou aux sociologues historiens. Il faut donc s'axer sur les deux types de formation, pour avoir à la fois l'acquis de la pluridisciplinarité et la méthodologie d'une discipline.
Cela étant, vous avez raison, madame la présidente, le problème vient de la façon dont fonctionnent les universités et dont se fait l'évaluation des chercheurs, qu'on encourage à faire du pluridisciplinaire, alors que cela n'est jamais réellement valorisé dans les évaluations annuelles ou dans les évaluations de carrière. Les blocages se situent à plusieurs niveaux.

Vous avez parlé de la médiation en termes de genre, mais nous nous interrogeons sur la médiation scientifique, qui n'est absolument pas valorisée dans la carrière des chercheurs. C'est regrettable, car il serait souhaitable que la culture scientifique et technique soit davantage connue, appréciée et travaillée.
J'aimerais savoir, par ailleurs, si vous participez à la formation des maîtres, dans le cadre des écoles de formation des professeurs. À l'évidence, il faut d'abord former les formateurs, pour que ceux-ci puissent, à leur tour, sur ces bases, former les nouveaux professeurs des écoles.
En tout cas, c'est ce que nous avons souhaité. Nous sommes une dizaine d'associations à avoir été auditionnées, au mois de juillet, au Sénat. Il y a eu une bonne synergie entre tous les réseaux pour réclamer des enseignements obligatoires à ce niveau. C'était une des priorités de notre démarche puisque se mettaient en place, non seulement les futurs programmes, mais aussi les écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE).
Cela étant, nous avons été victimes d'une mauvaise conjoncture. Je ne sais pas si nous avons été entendues, et ce sera très dommageable à long terme. Fort heureusement, tout n'a pas été bloqué, mais certains blocages vont perdurer. Autrement dit, tout ce qui n'a pas pu se faire, quelle qu'en soit la raison, aura des répercussions sur des plans, qui sont quadriennaux ou quinquennaux – je pense à la mise en place des programmes et aux ESPE.
Pour répondre à votre question, si nous étions sollicitées, nous serions ravies d'y enseigner. Certaines de nos collègues, disponibles, extrêmement bien formées, spécialistes des études de genre, sont déjà dans les ESPE et ne demandent qu'à avoir plus d'heures pour délivrer leur savoir. Je suis d'accord avec vous, c'est un enjeu majeur.
En ce qui concerne la valorisation, cela ne suffit pas. Il faut pouvoir mettre en circulation et accompagner cette circulation.

Nous travaillons actuellement sur le projet de loi Égalité et citoyenneté. Comment pourrions-nous faire entrer les études de genre dans le troisième volet de ce texte, qui vise à lutter contre les discriminations ? Les discriminations ne partent pas de rien. Les études de genre pourraient aider à comprendre leur genèse. Quel type d'amendement pourrions-nous déposer pour les faire entrer dans le projet de loi, et sans que cela apparaisse comme un cavalier ?
Il serait intéressant d'avoir une lecture critique, au sens positif du terme, c'est-à-dire d'apporter des éléments de réflexion autour du projet de loi. Pour commencer, il suffirait de genrer et sexuer les termes utilisés.
Les espaces sont tous genrés, Certains espaces peuvent sembler neutres, mais quand on parle de « jeunesse », par exemple, on ne parle pas de la même chose selon qu'il s'agit de filles ou de garçons. Il y a donc un travail à faire dans l'élaboration même du texte de loi. Il existe, d'ailleurs, de très beaux travaux sur le genre et le droit, dont l'objectif est que la loi et le droit soient genrés.
Par ailleurs, il y a une problématique difficile à faire comprendre et qui demande un peu de pédagogie : il faut sexuer et genrer ce qui paraît neutre et, dans le même temps, ouvrir des espaces réellement neutres, pour que chacun, sans renoncer à son appartenance de genre, puisse ne pas être enfermé dans cette appartenance.
Cette dialectique, qu'on peut réintroduire dans un texte de loi, est difficile à traduire concrètement, mais il faut en tenir compte. Il n'est pas évident de s'emparer de cet outil. Cela demande une formation, une expertise, une compétence, une réflexion, un échange.
De la même façon, on a pensé que la mixité serait une solution. Or on s'aperçoit, depuis de nombreuses années, qu'il faut un apprentissage, que la mixité était une étape, que l'on doit valoriser et préserver, mais qui demande un apprentissage, une pédagogie, une réflexion sur ce qu'on fait de la mixité et sur la façon de la rendre égalitaire.
Ce ne sont que des généralités qui tournent autour de ce projet. Je n'ai malheureusement pas d'amendement à vous proposer, madame la rapporteure !

Cet après-midi, va être signée au Conseil économique, social et environnemental (CESE) une convention d'engagement pour une communication publique sans stéréotype de sexe. L'initiative vient du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh). J'ai proposé au président de l'Assemblée nationale de signer cette convention. J'espère qu'elle recevra de sa part un accueil favorable, et que notre institution sera exemplaire dans ce domaine. Cela étant, certains députés ont encore du mal à dire « madame la présidente ». Nous en sommes là… Comme vous le voyez, nous partons de loin !

On constate que les études universitaires sont très cloisonnées et que les filles sont très peu représentées au sein des cursus scientifiques, comme les mathématiques, la physique, les sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS). Elles sont, en revanche, très nombreuses dans les études littéraires ou les sciences humaines.
Ne pensez-vous pas que des cursus universitaires plus équilibrés permettraient, d'une part, de mieux diffuser les thèses féministes dans toutes les disciplines, d'autre part, de favoriser l'interdisciplinarité ?
C'est depuis longtemps une priorité que de combattre les stéréotypes qui fabriquent des carrières universitaires ou des carrières professionnelles favorisant la ségrégation des sexes et le fait que les femmes suivent des orientations offrant beaucoup moins de débouchés. Cette question peut se travailler en amont, mais elle demande de la dextérité, du temps et des moyens.
Pour autant, il ne faut pas en arriver au contre-stéréotype. Les expériences récentes nous ont sensibilisées au fait que la façon de transmettre nos savoirs peut provoquer très vite des réticences. Il faudrait peut-être trouver d'autres moyens, mener plus d'actions de terrain, de sensibilisation, pour que ce souhait vienne des élèves eux-mêmes.
Par exemple, faire systématiquement l'apologie de la jeune fille sportive, même si cela passe mieux que de faire l'apologie du jeune homme suivant des études de lettres. Ce n'est pas forcément de cette façon qu'on peut faire prendre conscience du problème.
Ou bien le contre-modèle ne suffit pas. Si on dénonce un stéréotype, ce n'est pas forcément dans le contre-stéréotype qu'on trouvera la solution, même si l'objectif est de rééquilibrer les choses, pour que les individus ne soient plus discriminés par leur appartenance de genre. Pour ce faire, je pense qu'il faut expérimenter d'autres méthodes socio-éducatives.

Sur votre site, vous faites part, dans le cadre de vos recherches, d'un travail sur le féminisme et la laïcité tout au long du XXe siècle : Le pouvoir du genre, laïcités et religions 1905-2005. Vous dites qu'aujourd'hui, les études portent sur les différentes adaptations ou rejets des mondes religieux face à l'interprétation féministe, et que les féministes elles-mêmes sont mobilisées sur l'émancipation des femmes.
On a le sentiment, dans le débat public, aujourd'hui, que les féministes sont assez divisées dans leur approche de la laïcité et sur les positions à avoir. Quel est votre sentiment sur ce sujet ?
C'est une question difficile, qui ne relève pas de l'Institut Émilie du Châtelet puisqu'il s'agit de mes propres travaux de recherche. C'est donc à titre personnel que je m'exprimerai.
Une partie de mes recherches porte sur les questions de laïcité, de sécularisation et de genre, l'autre partie, sous ma casquette de présidente de l'IEC, étant l'animation de la recherche, et c'est surtout à ce titre que je suis intervenue aujourd'hui. Cela étant, je me suis déjà exprimée publiquement sur cette question dans différentes auditions.
Du point de vue de la recherche, il y a un important travail de pédagogie à mener autour de l'histoire de la laïcisation et de la sécularisation. Le débat public est souvent piégé par un manque de connaissances. Je pense, par exemple, au fait que la laïcisation s'est aussi faite avec des acteurs religieux libéraux et qu'il n'y a pas une opposition fondamentale entre religion et laïcité, mais entre certains types de religions.
C'est sur ces questions que je travaille, en m'appuyant sur l'histoire des droits des femmes aux XIXe et XXe siècles et sur l'histoire du féminisme, pour essayer de comprendre comment se sont fabriqués les débats d'aujourd'hui.

Quel est votre sentiment sur les débats d'aujourd'hui ? Comment les choses ont-elles évolué depuis le début du XXe siècle et l'instauration de la laïcité ? Vous avez raison de le souligner, certains religieux libéraux ont été favorables à la laïcité et à la séparation des Églises et de l'État. Mais aujourd'hui, ce débat se cristallise dans la société et les féministes sont, me semble-t-il, fortement divisées.
Il y a, en effet, une très forte division, à l'image de ce qu'il se passe dans le reste de la société et dans les mouvements politiques. Cette division n'est pas spécifique au féminisme, sauf que l'enjeu de genre et d'égalité des sexes est très fort.
En réalité, on trouve de l'articulation avec le féminisme dans les deux « camps ». C'est une question de choix politique féministe, une question de conception de la laïcité et de son articulation avec l'égalité des sexes. Il n'y a pas un camp qui soit plus féministe ou moins féministe que l'autre. Ce sont des choix entre une certaine politique laïque féministe ou une autre.
En l'occurrence, il s'agit de choix de société. Quel type de laïcité souhaite-t-on ? Comment conçoit-on l'organisation et la régulation religieuses dans l'espace public, et selon quels principes ? Quel type de société imagine-t-on dans l'avenir ? Quelle place veut-on laisser aux acteurs et actrices du religieux dans cette société ? Ce sont des choix assez clivants, mais je ne les hiérarchiserai pas. Je peux expliquer la logique d'un camp comme de l'autre et les dangers potentiels d'une laïcité qui se rigidifie et qui manque peut-être de dialogue.
Je pense que lancer la problématique du voile à l'université tant qu'il n'y a pas de problème spécifique, par exemple, est une erreur fondamentale. Ce n'est pas une position de principe, mais une position pragmatique. Si un problème très concret, très factuel, se présente, il y a les moyens de le résoudre et cela peut peut-être aller jusqu'à réguler le religieux dans le cadre de l'université. Mais, pour l'instant, ce n'est pas le cas.
S'il s'agit d'une loi préventive, il faut absolument distinguer, dans les manifestations publiques d'appartenance religieuse, ce qui serait de l'ordre d'un fondamentalisme propre à des individus, d'un fondamentalisme qui serait dangereux pour la République et pour l'espace public.
Pour l'instant, aucun événement ne laisse à penser qu'une loi serait nécessaire dans les universités. L'aspect préventif qui serait mis en avant pourrait être tout à fait contreproductif et amener des personnes, qui appartiennent à des minorités sociales et ethniques et qui se sentent déjà stigmatisées, à se radicaliser. En instaurant le dialogue, en revanche, on pourra peut-être éviter la radicalisation.

Je suis d'accord avec vous. Je ne suis pas pour une loi préventive, mais, comme vous l'avez dit, c'est un point de vue personnel. Nous n'avons discuté de cela dans le cadre de la Délégation.
Dans certains cas dont on a pu entendre parler, celui, par exemple, d'une professeure contestée par des étudiants, estimez-vous que l'université est suffisamment réactive ? Peut-il y avoir absence de réaction, par peur de stigmatiser ?
On l'a constaté à l'hôpital, certaines familles – les femmes étant souvent accompagnées – refusent des hommes médecins. L'hôpital, dans ce cas, peut faire appliquer son règlement intérieur sans qu'il y ait besoin d'une loi. Les institutions ne sont-elles pas, aujourd'hui, paralysées par la peur de réagir ?
Je ne pense pas qu'elles le soient.
Tout comme il y a des chargés de mission sur l'égalité femmes-hommes, il y a, dans chaque université, des chargés de mission laïcité, pour médiatiser d'éventuels conflits. Selon le type de conflit, les réponses peuvent être différenciées.
À l'hôpital, il y a la charte de la laïcité, dont l'objectif est d'expliquer ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Cela montre, là encore, le besoin de pédagogie et de diffusion du savoir.

Y a-t-il un correspondant égalité femmes-hommes dans toutes les universités ? Je vous pose la question, parce qu'il me semble que nous n'avions pas inscrit l'obligation dans la loi. Mais c'était une recommandation forte.
Elle n'a sans doute pas été suivie partout. Mais la pratique se répand de plus en plus et permet d'avoir un retour de terrain extrêmement précieux.

On m'a signalé, hier, qu'il y avait, en Allemagne, une référente égalité femmes-hommes dans toutes les collectivités locales. En France, la nécessité de créer un tel poste est laissée à l'appréciation des politiques locales. J'estime que c'est dommage.
Par ailleurs, comment pourriez-vous intervenir auprès du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour qu'il y ait une institutionnalisation des études de genre et, plus que des recommandations, leur inscription dans les programmes ? D'autant que certaines universités considèrent qu'elles participent aux études de genre avec un programme d'un quart d'heure, tandis que d'autres assurent un programme sur plusieurs jours. Là encore, il est regrettable que ce soit laissé à l'appréciation des universités.
Certes, mais il ne faut pas oublier que les universités sont autonomes. D'ailleurs, dans le rapport qui a été élaboré au sein du ministère, la question du respect de l'autonomie des universités a été soulevée. Il faut donc être incitatif.
Une des solutions évoquées était de créer des chaires qui pourraient être financées par des structures extérieures. Il existe des chaires thématiques, où l'on embauche des professeurs sur un thème précis. Certaines ont été financées par l'Union européenne.
Il y a également la possibilité de rendre obligatoires quelques enseignements de formation initiale, mais ce serait déjà perçu comme un coup de force. Ce rapport de force est peut-être envisageable, mais cela relève du politique.
Par ailleurs, il y a des politiques incitatives de sensibilisation et de soutien. Si les jeunes chercheurs ou les jeunes docteurs sont soutenus sur ces thématiques, il y aura un effet d'entraînement sur le long terme, car un bon tiers de nos allocataires a déjà trouvé un poste. Cela crée des générations.

La région Île-de-France vous a accordé ce que vous appelez un « DIM », c'est-à-dire un label « Domaine d'intérêt majeur », pour la période 2012-2015. A-t-il été renouvelé ?
Les élections régionales ayant eu lieu récemment, c'est en cours. Rien n'a encore été décidé, mais je crois avoir compris que le dispositif pouvait être conservé.
Quoi qu'il en soit, à chaque fin de contrat, il y a un nouvel appel d'offres. Pour notre part, nous avons déjà vécu deux fois ces appels d'offres et, à chaque fois, ce sont les élus de la région qui décident des thématiques prioritaires. C'est un bon exemple de politique publique de soutien aux études de genre.
Il semblerait qu'il y ait un appel d'offres en 2018.
Nous sommes une fédération de recherche qui existe légalement jusqu'à fin décembre 2018. Ensuite, nos partenaires peuvent décider de renouveler la convention relative à l'existence juridique de cette fédération.
Cela étant, notre partenariat avec la région se termine fin 2016 – ce qui était décidé depuis le début. Nous aurons peut-être un moyen de continuer à exister en 2017, mais nous n'avons pas encore la réponse. Nous serons en mesure de postuler en 2018 si les thématiques du genre ou de l'égalité des sexes, par exemple, sont retenues, et ce sera à la région de mettre le dispositif en place.
Nous avons eu la chance de bénéficier de cette politique ambitieuse de soutien à la recherche, qui a été mise en oeuvre par Marc Lipinski, au début du mandat de Jean-Paul Huchon.
Cela a stimulé nos collègues pour demander des aides régionales. Plusieurs régions ont investi, d'une façon moins importante, certes, parce qu'elles avaient moins de chercheurs. Il y a, en effet, une masse considérable de chercheurs et d'universitaires en Île-de-France, ce qui justifie le budget qui leur est consacré. Cela étant, il y a eu, dans certaines régions, une véritable sensibilisation à ces questions. Cela rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'essaimage.

Je vous remercie, madame Rochefort, pour votre participation à nos travaux. Votre intervention était fort intéressante et montre qu'il est très important de valoriser ces études. La situation est toujours un peu fragile. Il faut donc continuer à mener ces combats.
L'audition s'achève à 14 heures 55.
Membres présents
Présentes. – Mme Catherine Coutelle, Mme Conchita Lacuey, Mme Maud Olivier.
Excusée. – Mme Françoise Guégot.