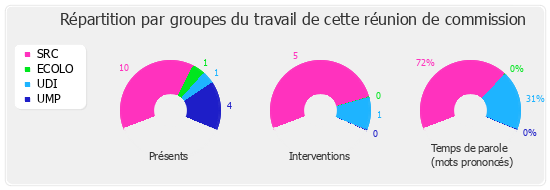Commission des affaires européennes
Réunion du 21 novembre 2013 à 8h30
La réunion
Audition de M. Olivier Blanchard, chef économiste du FMI, sur la situation économique et financière de l'Union européenne et de la zone euro, et sur l'approfondissement de l'Union économique et monétaire 2
COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES
Jeudi 21 novembre 2013
Présidence de Mme Danielle Auroi, Présidente de la Commission des affaires européennes
La séance est ouverte à 8 h 30
Audition de M. Olivier Blanchard, chef économiste du FMI, sur la situation économique et financière de l'Union européenne et de la zone euro, et sur l'approfondissement de l'Union économique et monétaire

Mes chers collègues, nous nous réjouissons d'accueillir, pour la première fois, M. Olivier Blanchard, chef économiste du Fonds monétaire international. Vous êtes, monsieur, un économiste de référence et nous sommes impatients que vous nous fassiez partager vos analyses sur l'économie mondiale, dont l'évolution depuis la faillite de Lehman Brothers en 2008 a ébranlé bien des certitudes, y compris celles du FMI et de la Commission européenne.
Je remercie Arnaud Richard et Razzy Hammadi, auteurs d'un rapport d'information sur le pacte pour la croissance et l'emploi, d'avoir pris l'initiative de cette audition.
Quelle appréciation portez-vous, monsieur Blanchard, sur la situation et les politiques économiques en Europe, mais aussi aux États-Unis et en Asie ? S'agissant des politiques budgétaires conduites en Europe, le FMI a reconnu qu'elles pouvaient amputer la croissance. Quelles conséquences faut-il en tirer ?
Comment mesurer les effets macroéconomiques de l'accroissement des inégalités et de la pauvreté ces dernières années ? La présidence de l'Union va revenir à la Grèce, où l'austérité exerce ses ravages sociaux. Que proposez-vous pour « corriger le tir » ? Dans son rapport semestriel sur la dette, le FMI évoque un prélèvement de 10 % sur les patrimoines privés des quinze États de la zone euro pour ramener les déficits publics à un niveau raisonnable. Un impôt sur la fortune européen, même très faible, pourrait-il être une piste ?
Quelle analyse faites-vous de la politique monétaire de la zone euro au regard de la situation économique des États ? Et qu'en penser au regard des politiques monétaires américaine, chinoise et japonaise ? Faudrait-il faire évoluer le mandat de la Banque centrale européenne (BCE) ? Selon quelles modalités approfondir l'Union économique et monétaire ?
Alors que s'annonce l'« opération vérité » concernant le bilan des banques avant la dévolution du contrôle bancaire à la BCE l'année prochaine, dans quel état sont les banques européennes, notamment par rapport aux banques américaines ? Si des recapitalisations se révélaient nécessaires, quelles seraient les modalités les plus adaptées ? Quel est donc l'état des banques françaises ? Quels seraient les moyens de les renforcer ? Que pensez-vous du projet de mécanisme de résolution unique, fondé sur un fonds de résolution unique, en cours de discussion ?
La zone euro doit-elle se doter d'un budget propre ? Est-ce l'échelle pertinente pour se doter d'une capacité d'endettement commune ?
Enfin, quel bilan dressez-vous des missions de la Troïka en Grèce, en Irlande et au Portugal ?
Je répondrai d'abord aux questions que vous m'avez adressées par écrit, avant d'en venir à celles que vous venez de me poser.
S'agissant de la croissance dans la zone euro, nos chiffres sont connus : un taux négatif en 2013, et + 1 % en 2014. Se conjuguent, pour freiner la croissance cette année, la consolidation budgétaire, d'une part, et la fragilité des banques, d'autre part, qui les amène à restreindre le crédit, mais à des degrés différents selon les pays. En Allemagne, la consolidation budgétaire est quasiment nulle et les banques ne se portent pas trop mal, alors que la situation est tout autre dans les pays de la périphérie. Pourquoi prévoyons-nous une croissance positive l'an prochain ? Parce que la consolidation budgétaire sera plus faible et la situation des banques devrait s'améliorer, les résultats qu'elles dégageront leur permettront d'augmenter leurs fonds propres. Nous prévoyons donc une croissance de 1 %, ce qui est, il faut le souligner, nettement insuffisant, et la perspective est stable pour le chômage. À terme, les faibles gains de productivité laissent augurer d'une croissance tendancielle faible, de l'ordre de 1 % par an, mais il devrait y avoir un effet de rattrapage. En tout état de cause, les perspectives ne sont guère enthousiasmantes.
La France n'est qu'un cas particulier de cette déclinaison. L'un des principaux facteurs de la faiblesse de la croissance cette année est la consolidation budgétaire, qui aura été l'une des plus fortes en Europe. Nous l'avions estimée plus tôt dans l'année à 1,8 point de PIB, elle sera finalement proche d'1,4 point de PIB, mais avec un effet multiplicateur de 1, cela diminue la croissance d'autant.–. Les exportations vers la zone euro restent un point faible. En revanche, les banques se portent plutôt bien et les conditions de prêt sont correctes. Nous nous interrogeons sur l'importance des « animal spirits », c'est-à-dire des effets psychologiques de la politique menée et des incertitudes qu'elle introduit dans les esprits, mais les méthodes économétriques mesurent difficilement de tels phénomènes et il est difficile d'établir des causalités. C'est toutefois certainement un élément du débat. Nous anticipons une amélioration l'année prochaine parce que la consolidation budgétaire sera beaucoup plus faible. À moyen terme, la croissance annuelle devrait rester de l'ordre de 1 %. Les réformes structurelles, on en parle depuis vingt ans. Je vous renvoie à la commission présidée par Michel Camdessus, dont j'ai fait partie, et au rapport de Jacques Attali, qui restent d'actualité. Il est clair que l'un des problèmes de la France réside dans la taille de l'État, le volume de ses dépenses et, par voie de conséquence, le poids de sa fiscalité.
L'austérité était-elle nécessaire ? Je crois que oui en raison des niveaux de dette atteints à cause de la crise et de la diminution des revenus. Il est crucial d'avoir un plan d'ajustement crédible, indépendamment ou presque du niveau d'endettement de départ. L'histoire montre que des pays s'en sortent en partant de très haut et que d'autres explosent en partant de très bas. Rétrospectivement, le rythme d'ajustement me semble avoir été peut-être trop rapide au regard de la faiblesse de la croissance et du système financier, mais les gouvernements ont vu dans la rapidité un gage de crédibilité. Toutefois, les pays sous-programme n'avaient pas vraiment le choix car l'ajustement se déduisait du montant des prêts que leurs créanciers acceptaient de leur consentir. Mais c'est le passé.
Dans les années à venir, la consolidation budgétaire devrait être plus limitée. Il y a seulement deux pays, l'Irlande et le Portugal, où la consolidation budgétaire, qui correspond à l'amélioration du solde budgétaire corrigé des effets conjoncturels, sera supérieure à 1 % du PIB. Pour les autres pays, c'est moins. En France, ce sera 0,5 % l'année prochaine. En l'état, les plans sont raisonnables. En revanche, si la croissance venait à ralentir, sans doute faudrait-il les réviser.
Dans certains pays, il me semble que l'inquiétude provient plus de la place de l'État que du déficit lui-même. Une stratégie qui miserait sur une baisse équivalente des dépenses et des impôts, c'est-à-dire neutre pour le déficit, permettrait sans doute d'obtenir en contrepartie un ralentissement du rythme de réduction des déficits sans perte de crédibilité. Pour ce faire, il faudrait convaincre à la fois Bruxelles et les investisseurs qui craindraient que le Gouvernement ne relâche l'effort budgétaire. À mon avis, ils seraient plutôt rassurés par un tel programme pourvu qu'il soit crédible parce qu'ils penseraient que le pays s'est enfin attaqué au vrai problème. J'ignore si, à ce stade, cette option est jouable politiquement mais il faut la garder en réserve.
Par ailleurs, le taux d'investissement de l'Allemagne est bas et c'est la raison, au moins du point de vue mécanique, du surplus du compte courant. Mesuré en points de PIB, l'investissement public est la moitié de ce qu'il est en France. Cet agrégat étant traité comme n'importe quelle autre dépense, on le comprime pour réduire le déficit. D'où cette question qui n'est pas nouvelle : les États ne devraient-ils pas avoir un compte de capital et un compte courant pour distinguer l'investissement du paiement des fonctionnaires ? En France comme en Allemagne, il serait opportun de favoriser des projets d'intérêt public. Un traitement spécifique des investissements permettrait de les augmenter avec des effets bénéfiques à court comme à moyen terme.

Je suis particulièrement sensible à ce dernier point car à l'heure actuelle on confond le court et le long termes.
J'ai lu les quatre vérités que vous avez dites à propos de l'année 2011, ce qui m'a conduit à douter de notre capacité à y voir clair dans un monde qui change. Vous mettez en cause les modèles, notamment le lien entre fiscalité et croissance en doublant voire triplant le multiplicateur qui mesure l'impact des hausses d'impôtbaisses des dépenses sur l'activité économique. Comment en arrivez-vous à un tel écart ?
Plus généralement, il me semble que la science économique redevient une science humaine puisque la crise a mis en lumière le panurgisme des marchés, révélé l'importance de l'opinion, y compris de celle des experts, qui ne sont pourtant pas toujours plus éclairés que les autres. Ce constat renvoie à une autre question : qui fabrique l'opinion ? qui la gouverne ? N'y a-t-il pas une contradiction de plus en plus manifeste entre la libération des échanges économiques et financiers et le cadre de la gouvernance politique et économique ? Jusqu'où les politiques financières peuvent-elles s'émanciper des politiques économiques ? L'Italie, sous l'impulsion de Mario Monti puis d'Enrico Letta, a fait des efforts considérables mais sans impact notable sur les taux. Pourtant, l'Italie dispose d'un socle industriel qui n'est pas négligeable et l'Espagne n'a pas une économie comparable. Je me demande vraiment comment faire la différence entre les effets et les causes.

Que pensez-vous, monsieur le chef économiste, du niveau des charges sociales en France, qui la distingue nettement des pays comparables ? Les dépenses sociales ont-elles un effet contra cyclique bénéfique et faut-il les préserver ? Ou les baisser en guise de signal aux marchés, en profitant des marges de manoeuvre qui doivent exister puisque les services publics ne sont pas meilleurs qu'ailleurs ?
Par ailleurs, que penser de la course effrénée à la productivité et à la compétitivité ? Mon raisonnement est peut-être naïf mais un chômeur coûte bien plus que les allocations qu'il reçoit. Souvent, les familles se décomposent : la femme reste seule avec les enfants, formant un foyer monoparental totalement assisté, les enfants dévissent sur le plan scolaire. On n'a jamais pris la peine de faire un chiffrage global. Alors, ne serait-il pas préférable de maintenir au travail des gens un peu sous-productifs, ce qui se traduirait par une baisse de la productivité macroéconomique, plutôt que de persévérer dans ce système d'exclusion ? Bien des pays ont encore beaucoup de petits emplois privés alors que, chez nous, on ne supporte pas l'idée de ne pas recruter que des « athlètes ».

De vos propos, je conclus que l'Europe aura de grandes difficultés à sortir de la crise et que sa croissance potentielle restera obérée par sa compétitivité. Comment l'améliorer ?
Dans l'avis que la Commission européenne vient de rendre sur les projets de budget, elle note un important effort de consolidation budgétaire ainsi que les excédents considérables de l'Allemagne au point d'envisager une enquête en vertu du pacte de stabilité rénové. Ces déséquilibres pèsent-ils sur la croissance européenne ?
Quels sont les effets comparés d'une hausse des recettes et d'une baisse des dépenses sur la croissance ? Peut-on conclure dans un sens ou dans l'autre car on entend des choses très contradictoires ?

Même si les échanges internes sont déterminants pour la zone euro, quel est l'impact de la conjoncture internationale ?
Selon vous, le niveau de la dette n'importe pas tant que le rythme de sa réduction. En tant que rapporteur spécial pour les engagements financiers de l'État, je constate néanmoins que la charge de la dette représente, avec 46 milliards, la première mission de l'État, et qu'un relèvement des taux risquerait de nous faire déraper à nouveau. Ne pensez-vous pas que les incertitudes entravent notre action ?

Comment jugez-vous le pacte de croissance de l'Union européenne ? Des marges de manoeuvre pourraient-elles être dégagées à ce niveau, avec des eurobonds, des ressources propres et un endettement direct ?

Je suis attentivement les travaux de M. Blanchard et j'ai cru comprendre que, dans le débat sur les moyens d'alléger le fardeau de la dette, vous préconisiez de laisser, dans une certaine mesure, filer l'inflation autour de 4 %, afin d'« euthanasier » partiellement les détenteurs de la rente. Faut-il en déduire que l'ensemble de la dette ne doit pas être remboursé, ne serait-ce que parce que la priorité en Europe, c'est la croissance ? Un tel programme est-il compatible avec les missions de la BCE ? Les principaux pays de la zone ne devraient-ils pas avoir le courage de faire évoluer la doctrine ?
Je vais essayer de répondre a toutes ces questions, qui sont toutes importantes.
Sur les multiplicateurs : Au début de la crise, il y a cinq ans, les multiplicateurs n'avaient pas pratiquement pas fait l'objet de recherches récentes du fait du déclin de la politique budgétaire en tant qu'instrument de politique conjoncturelle. Nos bureaux spécialisés par pays en étaient donc restés à des chiffres généraux, à savoir un multiplicateur inférieur à 1 – entre 0,5 et 0,7 – puisque, en économie ouverte, une bonne partie de la dépense va à l'étranger. Quand la crise a commence, j'ai demandé à mon équipe de recenser l'ensemble des travaux sur ce sujet pour voir si des chercheurs étaient arrivés à d'autres chiffres. De fait, les estimations varient entre 0 et 3. Les résultats ont été publiés dans une étude du FMI en 2009. Parallèlement, nous nous sommes rendu compte très vite que, dans la crise, le coefficient était en réalité plus fort parce que, en temps normal, les effets de la politique budgétaire sont partiellement compensés par la politique monétaire, mais pas quand les taux d'intérêt sont à zéro. On en a tenu compte à partir de 2010, dans toute une série de programmes.
Sur la science économique : Oui, la science économique est une science humaine puisque les investisseurs sont des êtres humains. La crise nous a fait admettre que les marchés financiers sont loin d'être parfaits, que le comportement des opérateurs est parfois celui de moutons de Panurge, même si on peut le rationaliser. La position du FMI a d'ailleurs considérablement évolué au sujet des contrôle des capitaux. Ils étaient largement rejetés avant 2008, ils font maintenant partie de la trousse a outils. Nous avons aussi beaucoup travaillé à une approche macro prudentielle, en imaginant des instruments destinés à limiter l'exposition aux risques des acteurs financiers, mais nous n'en sommes qu'au début du processus.
Sur charges sociales et chômage : Nous avons beaucoup d'études économétriques sur le lien entre le niveau des charges sociales et le chômage, dont il ressort qu'il existe, mais qu'il est lâche. Néanmoins, plus le niveau de charges est élevé, plus la corrélation avec le taux de chômage est forte. La France se situe sans doute dans cette zone.
Sur productivité et chômage : Si les gains de productivité s'accompagnaient systématiquement d'une augmentation du chômage, la question de Monsieur Savary mériterait d'être posée. Mais, historiquement, c'est l'inverse que l'on observe. Cela ne signifie pas pour autant que tout le monde gagne : les perdants sont ceux qui n'ont pas les qualifications nécessaires. À mon avis, chercher à réduire les gains de productivité pour éviter le chômage serait une erreur. Il faut plutôt rechercher une meilleure organisation du marché du travail qui passe par la flex-sécurité à la danoise ou la réforme de la formation professionnelle qui est en cours, et dont j'espère qu'elle sera menée a bien.
Sur la croissance a terme : Oui, la croissance potentielle européenne sera faible à terme, entre 1 % et 1,5 % en fonction de l'évolution démographique des différents pays. Les travaux de Philippe Aghion montrent que, quand on est à la frontière, on avance doucement. Il ne faut pas se faire d'illusion, on ne reviendra pas à des taux de 3 % ou 4 %. Cela dit, il existe des petites réformes, celles prônées par les rapports Camdessus et Attali, qui, mises bout à bout, peuvent avoir des effets importants. Ainsi, la plus grosse part du pouvoir d'achat gagné par les Français ces deux dernières années provient de l'entrée sur le marché de Free, soit 0,3 point de pouvoir d'achat en plus à cause de l'effondrement des prix des télécommunications. Il ne faut être ni trop optimiste, ni trop pessimiste.
Sur le compte courant allemand : L'excédent des comptes courants allemands est au coeur des débats aujourd'hui. Il y a deux questions à se poser. Premièrement, du point de vue allemand, ce niveau est-il le bon ? Un surplus important peut être justifié quand on anticipe une forte baisse de la population et quand il est nécessaire d'épargner beaucoup. Or, le taux d'épargne allemand se situe dans la moyenne des pays avancés. Ce qui surprend, en revanche, c'est la faiblesse du taux d'investissement. C'est, parmi les pays avances, en Allemagne qu'il est le plus bas (ainsi qu'en Angleterre). Sans doute les entreprises allemandes ont-elles intérêt à investir non pas en Allemagne mais plutôt en Pologne ou en Hongrie, en raison d'un avantage comparatif puisqu'elle est très proche. Mais ce n'est pas l'explication puisque si l'on ajoute les investissements directs à l'étranger à l'investissement domestique, l'Allemagne reste tout de même au bas de l'échelle. À cause de la faiblesse de l'investissement public. Les Allemands devraient donc se demander si il ne serait pas dans leur propre intérêt d'augmenter l'investissement, et en particulier l'investissement public.
D'autre part, l'Allemagne devrait-elle aider les autres ? Certains suggèrent d'augmenter la demande domestique pour stimuler les exportations des autres pays et augmenter légèrement l'inflation allemande. Ce raisonnement n'est pas faux mais les effets quantitatifs d'une telle politique seraient faibles. De plus, les Allemands n'y sont pas favorables. En revanche, il faut les convaincre de soutenir, d'une part, la politique monétaire de la BCE, et, d'autre part, l'union bancaire. C'est ça qu'il faut leur demander.
Sur l'ajustement par les recettes ou les dépenses : De l'augmentation des impôts ou de la baisse des dépenses, laquelle a-t-elle les effets les plus forts ? Autant vous dire que les résultats sont très hétérogènes. Selon la théorie keynésienne traditionnelle, la diminution des dépenses devrait se ressentir davantage parce que, au premier tour, le multiplicateur est de 1 alors qu'il est moindre en cas de hausses d'impôt parce que les gens commencent par puiser dans leur épargne. En pratique, un certain nombre d'études concluent à une hiérarchie inverse. Plusieurs explications sont avancées, comme une politique monétaire plus conciliante si la banque centrale préfère les baisses de dépense, ou bien une question de crédibilité : dans les pays où la charge de l'État est très lourde, la diminution des dépenses peut avoir un effet psychologique positif, mais les corrélations sont très mal établies.
Sur l'environnement international : La contagion a joué un rôle important dans le début de la crise, mais, aujourd'hui, la conjoncture internationale est favorable à l'Union européenne. Les autres pays la tirent dans le bon sens. La reprise américaine est solide, avec le risque, à terme, qu'elle entraîne une hausse des taux d'intérêt. Les pays émergents se portent bien, même si c'est un peu moins bien que pendant la décennie 2000-2010 quand les prix des matières premières et les taux d'intérêt étaient bas. La croissance y sera toujours forte, mais moins qu'autrefois. À court terme, le changement de la politique monétaire américaine leur crée des problèmes de flux de capitaux, mais ils peuvent les résoudre. L'environnement international est donc porteur et les difficultés européennes sont en réalité largement internes.
Sur le niveau de dette et la politique budgétaire : Le niveau de la dette est énorme, mais pas le poids de la dette grâce au niveau bas des taux d'intérêt. Ce ne sera pas éternel, mais, pour le moment, le poids de la dette n'est pas insupportable. Ce qui compte, c'est que le niveau de la dette soit tel que les investisseurs ne paniquent pas, d'où l'importance de la crédibilité de la trajectoire. C'est la raison pour laquelle on peut concevoir d'un ralentissement du retour à l'équilibre en échange d'une baisse des dépenses.
Sur la politique économique dans la zone euro : Les limites posées à la politique budgétaire par le pacte de croissance me paraissent raisonnables, si les autorités européennes sont capables de flexibilité. Selon la lecture que j'en fais, la crise en Europe ne vient pas de politiques budgétaires irresponsables, sauf en Grèce. Ailleurs, l'arrivée de l'euro, les perspectives de croissance ont provoqué un boom de la demande privée, de logement en particulier. Mais les anticipations se sont révélées trop optimistes et les prix se sont effondrés. À l'epoque, l'analyse était que l'Espagne mettait en oeuvre une politique budgétaire parfaitement responsable. Les règles actuellement en vigueur à Bruxelles lui auraient valu un certificat de bonne conduite.
Pour éviter que cela se produise à nouveau, il faudrait que Bruxelles réfléchisse davantage à des mesures macro prudentielles. Si, rétrospectivement, on imagine un scénario différent pour l'Espagne, afin d'empêcher une telle bulle immobilière et un déficit du compte courant de 10 %, il aurait fallu renforcer davantage les ratios de capitaux, diminuer les loan to value ratios, c'est-à-dire le rapport entre le montant du prêt et la valeur du bien immobilier financé, et agir de façon très agressive pour arrêter la machine. Ainsi, les règles actuelles, notamment en matière de ratios de capitaux, n'auraient pas empêché la crise espagnole. Il y a toute une réflexion qui reste à mener même si ce qui a été fait est bien.
Sur l'inflation. Si l'inflation et les taux d'intérêt nominaux avaient été un peut plus élevés avant la crise, disons 4% et 6% respectivement, la marge de manoeuvre pour les diminuer aurait été plus grande. Quand je rappelais ces évidences avant la crise, on me répondait que l'on n'aurait jamais besoin de baisser les taux d'intérêt en dessous de zéro. Or cela fait cinq ans que dure la trappe à liquidité et on en voit les effets. Ne faudrait-il pas, si cela devait arriver une nouvelle fois, se donner un peu plus de marge de manoeuvre ? Pour moi, la question reste sur la table.
Enfin, j'ignorais jusqu'à hier l'hypothèse d'un impôt de 10 % sur le patrimoine privé, quand les journaux français en ont fait état. Elle doit sortir d'une étude d'un chercheur du Fonds, mais elle ne représente pas la position du Fonds.

Nous vous remercions, monsieur Blanchard, et espérons vous revoir à Paris, quand la situation aura évolué, dans un sens que nous souhaitons positif.
La séance est levée à 9 h 45