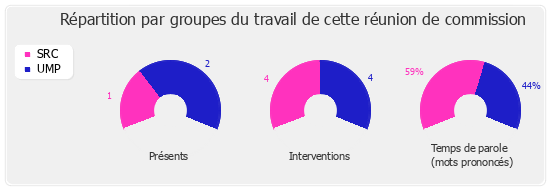Mission d'information commune sur la banque publique d'investissement, bpifrance
Réunion du 13 mai 2015 à 11h00
La réunion

Nous poursuivons les travaux de la mission d'information commune sur Bpifrance par l'audition de M. Arnaud Caudoux, directeur exécutif, directeur financier de Bpifrance et directeur en charge des garanties.
La direction financière de BPI-Groupe comprend la direction financière à proprement parler, qui regroupe les fonctions classiques telles que le contrôle de gestion, la comptabilité, la salle de marchés qui intervient essentiellement sur les marchés de dettes et de taux, et la direction capitaux et bilan, qui s'assure que les équilibres sont respectés, en termes de liquidités et de taux, entre l'actif – c'est-à-dire les prêts que nous accordons aux entreprises et les investissements que nous réalisons – et le passif, c'est-à-dire nos fonds propres, les dettes correspondant aux emprunts réalisés sur les marchés ou auprès de tiers et les ressources issues de l'État ou des régions. La direction financière de BPI-Groupe comprend également la direction financière de Bpifrance Investissement, ainsi que la direction des risques, qui fixe la doctrine en matière de gestion des risques et s'assure que celle-ci est respectée lors de l'exécution et du suivi des opérations, et la direction informatique, qui gère environ 500 000 dossiers « vivants » en stock, tous traités par nos systèmes d'information, lesquels sont par ailleurs connectés au système bancaire puisqu'en tant qu'établissement de place, nous interagissons avec l'ensemble des banques.
Quant à la garantie, dont je suis également en charge, elle est un des métiers historiques de Bpifrance Financement. Elle consiste à partager avec les établissements commerciaux le risque lié aux prêts que ceux-ci accordent aux entreprises, en l'espèce aux PME et aux TPE, en s'adossant à des fonds de garantie dotés par l'État – par des dotations budgétaires ou grâce au programme d'investissements d'avenir (PIA) – et par les régions.
J'en viens maintenant à la présentation du modèle économique de Bpifrance. À l'instar des autres établissements bancaires, nous disposons de trois types de ressources. Cependant, si les deux premières sont communes à l'ensemble des banques, la troisième nous est spécifique.
Premier type de ressources : les fonds propres. Notre capital est détenu principalement par l'État et la Caisse des dépôts et consignations, qui possèdent chacun 50 % de BPI-Groupe. Par ailleurs, les banques commerciales sont actionnaires, à hauteur de 10 %, de Bpifrance Financement, ce qui nous permet de nous assurer que nous demeurons bien un établissement de place qui aide les différents établissements à financer le mieux possible les entreprises, dans une logique d'adaptation à leurs besoins et à ceux des banques. Notre capital s'élève à environ 22 milliards d'euros, dont deux milliards n'ont pas été formellement payés et sont donc encore potentiellement libérables.
Deuxième type de ressources : celles que nous empruntons, principalement sur les marchés. Dès lors que, contrairement aux autres établissements, nous ne prenons pas de dépôts auprès de nos clients, il nous faut refinancer intégralement notre portefeuille de prêts. Actuellement, environ 25 milliards d'euros sont prêtés à des entreprises françaises, dont 2,7 milliards de fonds propres qui relèvent de Bpifrance Financement. Au-delà de ces 2,7 milliards, tout ce que nous prêtons doit être refinancé en empruntant sur les marchés obligataires et en souscrivant des prêts bilatéraux auprès d'un certain nombre d'institutions. Nous n'émettons pas de dettes dans un autre but que celui-là. Nous n'investissons ainsi que nos fonds propres : nous nous interdisons formellement – cela figure dans nos statuts – d'émettre de la dette pour investir en fonds propres dans des entreprises. Cette pratique peut se rencontrer chez des investisseurs de très court terme. Nous sommes, quant à nous, des investisseurs de long terme et, en tant que tels, nous devons être prêts à subir la baisse de valeur des entreprises dans lesquelles nous investissons. Ces investissements se font donc en fonds propres ou, le cas échéant, avec de l'argent que nous gérons pour le compte de tiers, qu'il s'agisse d'acteurs industriels, dans le cadre de fonds sectoriels ou de fonds filières, ou du Programme d'investissements d'avenir (PIA) qui nous confie de l'argent pour investir dans l'amorçage.
Le troisième type de ressources dont nous disposons est propre à la BPI ; il s'agit des fonds de garantie, qui sont très importants dans notre modèle. L'activité de garantie est la plus risquée, puisqu'elle consiste précisément à partager le risque avec les banques sur leurs dossiers les plus durs. Ces fonds de garantie protègent nos fonds propres de ce que l'on appelle les premières pertes, qu'ils encaissent avant que nous soyons à risque en tant qu'établissement. Tout l'art consiste donc à trouver l'effet de levier optimal pour les dotations de l'État. Avec un euro de dotation publique, nous devons en faire le plus possible tout en assurant un niveau de sécurité qui protège l'établissement et son capital, qui appartient à l'État.
Ces trois types de ressources nous permettent de prendre des risques, y compris de manière très agressive par rapport à un établissement normal, grâce aux fonds de garantie, et d'exercer un effet de levier important, grâce au niveau de nos fonds propres et au fait que nous sommes une banque régulée. En théorie, nous pouvons aujourd'hui « faire » dix fois nos fonds propres, mais nous considérons que ce ne serait pas raisonnable, compte tenu du poids des investissements en capital dans les entreprises. Quoi qu'il en soit, nous avons une capacité de levier très forte, que nous pouvons matérialiser par l'émission de dette pour faire des prêts.

Vous avez indiqué que Bpifrance n'était pas une banque ordinaire et que, de ce fait, elle pouvait prendre des risques de manière plus agressive qu'un établissement normal. Pourtant, son taux de sinistralité ne nous paraît pas important, comparé à celui de banques traditionnelles. On peut donc se demander si Bpifrance prend des risques suffisants.
C'est une très bonne question. Les fonds de garantie nous permettent de prendre, en partenariat avec d'autres établissements, un risque beaucoup plus important qu'une banque qui n'en dispose pas, car ce risque affecte d'abord les fonds de garantie, qui sont des éléments séparés dans notre bilan ; il n'affecte pas le coût du risque comptable. Celui-ci, qui figure dans notre compte de résultat – il s'élève, en 2014, à une vingtaine de millions d'euros – porte sur le risque que nous prenons directement sur nos fonds propres. L'année dernière a été, pour nous comme pour les autres établissements, une bonne année en la matière. Parallèlement, les fonds de garantie sont impactés, en 2014 à hauteur de 300 millions d'euros, qui correspondent à des risques que nous avons pris en partenariat avec des banques en les garantissant sur leurs crédits.
Il convient de distinguer les provisions que nous passons sur les fonds de garantie eux-mêmes – et qui s'élèvent aujourd'hui à environ 2 milliards d'euros – et les provisions que nous passons sur fonds propres, lesquelles relèvent de deux catégories : la provision collective – que nous passons parce que nous savons que, sur les 25 milliards d'euros de prêts que nous avons accordés aux entreprises, nous aurons des pertes, pertes que nous savons estimer statistiquement et que nous comptabilisons aujourd'hui à hauteur de 500 millions d'euros – et les provisions que nous passons sur les risques avérés, c'est-à-dire lorsque les dossiers ont fait défaut dans l'année. Le coût du risque est égal à la différence entre les provisions passées pour risque avéré et celles que nous avons reprises sur d'anciens dossiers qui ont fait défaut. Ce coût s'élève, en 2014, à une vingtaine de millions d'euros, soit dix points de base de notre encours de 25 milliards, ce qui est très faible. Ce résultat est lié notamment à des reprises de provisions – les recouvrements s'étant mieux passés que prévu – et, de manière générale, au taux de défaut très bas des entreprises en 2014.

Bpifrance a indiqué, hier, qu'elle ne prendrait pas de participation dans Ascométal, alors que M. Montebourg avait annoncé, au printemps 2014, que l'État, accompagné de la BPI, entrerait au capital de l'entreprise, laquelle, je le rappelle, emploie 1 740 salariés, dont 580 en Lorraine. Bpifrance n'a pas expliqué les raisons de sa décision, mais il se dit qu'elle jugerait l'investissement trop risqué. Pouvez-vous nous donner quelques explications à ce sujet ?
Je précise que je n'ai évoqué, pour l'instant, que le coût du risque pris par Bpifrance Financement, c'est-à-dire lié à de la dette qui ferait défaut. Il comprend une deuxième partie, constituée des pertes que l'on peut subir dans les dossiers d'investissement. Mais il se trouve que, pour des raisons comptables, cette partie est classée, non pas en coût du risque, mais en perte sur investissement, donc en moins-value ou en dépréciation.
S'agissant d'Ascométal, je crois qu'une solution a été trouvée sans Bpifrance. En effet, celle-ci – c'est un élément important de notre doctrine, qui a été votée par le Parlement – ne peut pas prendre le risque d'être l'actionnaire majoritaire d'une société en situation de retournement qui a besoin d'une action très forte pour revenir à une situation financière saine.

Que représente la provision concernant ERAMET, qui est de 300 millions ? Par ailleurs, j'ai le sentiment que vous agissez plus en pompiers, sans véritable gestion en amont du contentieux, qui permettrait d'éviter qu'il ne survienne. Quelles sont les procédures existantes ou en cours d'élaboration en la matière ?
En ce qui concerne ERAMET, il s'agit d'investissements. Les 300 millions d'euros que vous évoquez figurent donc dans nos comptes en tant que dépréciation ; il ne s'agit pas d'une provision au sens du coût du risque. Ils ne sont donc pas comptabilisés dans la provision collective qui couvre les 25 milliards d'euros de prêts. ERAMET est un investissement en fonds propres, en l'espèce une mise en équivalence. Le cours du titre a beaucoup baissé en 2013, puis il s'est apprécié en 2014. Cela se traduit, dans nos comptes, par une moins-value de l'ordre de 300 millions d'euros, qui s'ajoute donc aux 500 millions de la provision collective.
S'agissant de la gestion du contentieux, il est important que nous sachions accompagner les entreprises, que nous soyons actionnaires ou prêteurs. En tant qu'actionnaires, nous sommes présents tout au long de la vie de l'entreprise et, si des difficultés se présentent, nous cherchons, avec le management et les autres actionnaires, à les résoudre de manière active, non seulement parce que c'est notre intérêt d'actionnaire, mais aussi parce que, pour les entreprises, notre valeur réside essentiellement dans leur accompagnement sous différentes formes.
Lorsque nous intervenons en tant que prêteurs, le sujet est un peu plus complexe. Nos chargés d'affaires parlent à leurs clients plusieurs fois par an, ce qui nous permet de connaître leurs difficultés, mais nous n'avons pas les moyens d'influence directe dont dispose l'actionnaire. En tout état de cause, nous anticipons : le coût du risque comprend une analyse de situation. Il existe ce que l'on appelle, dans le jargon de la BCE, une watchlist, c'est-à-dire une liste d'entreprises pour lesquelles nous passons des provisions car nous savons que, même si elles continuent de rembourser leur dette, elles commencent à avoir des difficultés. Cette liste est suivie très attentivement par le chargé d'affaires et par le siège. Nous cherchons donc, avec ces entreprises, des solutions avant que leurs problèmes ne deviennent à proprement parler des problèmes financiers.
En amont du contentieux et du recouvrement, il y a une phase durant laquelle, comme dans tous les établissements bancaires, nous cherchons des solutions de restructuration financière. Avant cette étape, nos chargés d'affaires, qui ont pour mission de parler à leurs clients et de limiter leur coût du risque, se rapprochent de l'entreprise en cas de difficultés et cherchent avec leur interlocuteur à anticiper les problèmes. Suivant les situations, nous jouons un rôle d'alerte auprès de l'entrepreneur ou celui-ci nous saisit d'un problème. Quoi qu'il en soit, cette relation de proximité est fondamentale : le seul qui puisse aller voir le chef d'entreprise et parler avec lui des problèmes qu'il rencontre, c'est celui qui lui a prêté de l'argent et qui a avec lui une relation de confiance. Cela ne se voit pas, mais c'est le coeur du métier de prêteur.

Ce suivi de proximité des entreprises est-il effectué de la même façon dans l'ensemble des régions ?
Par ailleurs, je souhaiterais que vous reveniez sur l'activité de garantie de Bpifrance : des évolutions sont-elles intervenues depuis sa création, qu'il s'agisse de l'orientation de l'activité ou du ciblage de certains secteurs ? Nous savons, par exemple, que le montant en deçà duquel la garantie de Bpifrance peut être déléguée a été porté de 100 000 à 200 000 euros.
Enfin, la société de caution mutuelle pour les entreprises d'artisanat et de proximité, la SIAGI, propose une lettre de pré-garantie, qui permet à l'entreprise de disposer d'un accord de principe avant que le prêt ne lui soit accordé. Qu'en pensez-vous ?

Pourriez-vous nous présenter l'accord que vous avez signé avec le Fonds européen d'investissement (FEI) dans le cadre du plan Juncker ?
Tous les chargés d'affaires ont le même profil et sont placés sous l'autorité de directeurs régionaux, eux-mêmes rattachés à Joël Darnaud. La gestion est donc homogène sur l'ensemble du territoire. Bien sûr, chaque situation est particulière, mais l'ensemble de nos chargés d'affaires utilisent les mêmes modes d'évaluation et de management, ont les mêmes objectifs, la même culture et la même formation.
S'agissant de la garantie, nous avons fait effectivement, il y a deux ans, un choix fondamental en matière d'orientation. Ce choix consiste à faire davantage confiance aux banques et à travailler plus vite avec elles, en augmentant le plafond de la délégation que nous leur confions.
Il existe en effet deux façons de faire de la garantie. Soit nos chargés d'affaires sont sollicités par des banques ou des entreprises auxquelles ils vont proposer une garantie afin de partager le risque ; c'est la méthode que nous appliquions pour les dossiers supérieurs à 100 000 euros. Soit nous offrons aux chargés d'affaires des banques la possibilité, pour des montants donnés et en fonction de critères prédéfinis, de déclarer directement des garanties, sans même nous demander une autorisation préalable. Cette procédure, qui présente l'avantage d'être très rapide, très souple et très efficace en termes de coûts pour les TPE, était applicable aux dossiers inférieurs à 100 000 euros. Nous avons décidé de porter ce plafond à 200 000 euros. Il s'agit d'un acte fort, car nous renonçons à toute forme d'instruction avant de prendre notre part de risque. Nous faisons donc confiance aux banques pour activer notre garantie à bon escient. Elles peuvent ainsi faire beaucoup plus, très rapidement.
Nous avons, en outre, étendu le champ de cette garantie en délégation au financement de la trésorerie, alors qu'auparavant, comme il s'agit de financements plus complexes qui comportent un risque plus important, nous étudiions chaque dossier. Nous espérons pouvoir ainsi atteindre un plus grand nombre de TPE, qui sont les entreprises les plus concernées par les problèmes de trésorerie. J'ajoute que nous avons également étendu ces garanties à l'outre-mer, ce qui n'était pas le cas avant pour des raisons techniques.
L'autre choix important qui a été fait il y a deux ans a consisté précisément à relancer les garanties de trésorerie, que nous avions testées dans le cadre du plan de relance. Il s'agit d'un domaine dans lequel nous n'intervenions pas auparavant, dans la mesure où le financement de la trésorerie, par découvert ou par ligne de crédit, est l'objet même du marché bancaire. Mais, compte tenu des tensions qui sont apparues il y a deux ans, nous avons décidé de garantir les banques lorsqu'elles financent de la trésorerie à moyen terme, c'est-à-dire cinq ans. Nous offrons ainsi un confort à l'entreprise en lui donnant une visibilité sur ses crédits de trésorerie.
Par ailleurs, nous ne définissons pas d'orientation sectorielle a priori. Nous ne cherchons pas à être plus forts que les banques ; ce sont elles qui savent quand et sur quel type de dossiers elles ont besoin d'une garantie. Si l'on prend en compte l'ensemble des agences bancaires, les chargés d'affaires qui s'adressent aux TPE sont au nombre de 20 000, contre 500 à Bpifrance. Nous leur faisons donc confiance, et la délégation nous permet de nous démultiplier.
Il convient enfin de noter que le montant des garanties est assez stable, ce qui tombe bien, car nous n'avons pas les moyens de faire davantage. On constate, depuis quelques mois, un renversement qui reflète assez bien l'évolution de la conjoncture : les financements de créations et de transmissions d'entreprise, très complexes pour les banques, augmentent, tandis que les recours défensifs à la garantie, donc les financements d'investissements – qui sont, comme pour la trésorerie, des crédits assez classiques pour les banques –, diminuent un peu. On retrouve ainsi les finalités d'un cycle économique dynamique : en 2014, les créations représentent environ 2 milliards d'euros, les transmissions environ 1,4 milliard et les investissements environ 1,3 milliard.
L'innovation, quant à elle, représente 230 millions d'euros. Cela peut paraître peu, mais il s'agit d'une finalité très ciblée : ces crédits s'adressent à des entreprises labellisées innovantes et au financement de R&D. Nous encourageons les banques à intervenir dans ce secteur mais, en réalité, les activités de ce type sont assez peu financées par des crédits bancaires. Pour les banques qui le souhaitent, il est possible alors de bénéficier d'une garantie supérieure à la moyenne, mais il s'agit d'objets assez spécifiques, qui se développeront sans doute que si le marché bancaire et l'économie repartent.
Au demeurant, un financement bancaire garanti ne remplacera jamais les aides à l'innovation, qui interviennent en amont de la dette bancaire et même du capital-risque et qu'il est donc absolument indispensable de préserver. Le risque est très important – on perd un dossier sur deux –, mais tous les success stories de ces dix dernières années ont bénéficié de l'aide à l'innovation. Il faut donc trouver des solutions au manque de dotations.
L'accord que nous venons de conclure avec le Fonds européen d'investissement (FEI) dans le cadre du plan Juncker est une de ces solutions. Il nous permettra en effet de consacrer environ 400 millions à des Prêts Innovation (PI-FEI), que nous accorderons nous-mêmes et qui seront garantis à la fois sur fonds d'État et sur fonds du FEI. Le profil de risque se rapproche d'une aide à l'innovation : ce type de prêts est moins agressif qu'une subvention ou qu'une avance remboursable mais beaucoup plus risqué qu'un prêt bancaire, même garanti.
Ils peuvent, le cas échéant, s'adresser également à des TPE très ambitieuses – je pense à des start-ups qui auraient un programme d'investissement très important –, mais la cible du Prêt Innovation est constituée d'entreprises qui ont une capacité d'endettement. Ce produit-là ne remplacera donc ni l'avance remboursable ni la subvention. En revanche, il nous permettra d'améliorer grandement le financement de la R&D d'entreprises dont la trajectoire de croissance très forte est difficile à appréhender pour un banquier normal, qui a besoin de prévisibilité. Je pense à des entreprises dont l'EBITDA (les résultats avant frais financiers, impôts, dépréciations et amortissements) peut être encore négatif et dont les prévisions de croissance sont tellement vertigineuses qu'elles sont difficiles à croire.

J'ai moi-même pu constater, dans ma circonscription, que les banques avaient peur de ce type d'entreprises dont elles ne connaissent pas le modèle économique, si bien que certaines ne sont pas parvenues à se faire financer alors même que la BPI était à leurs côtés. Ne faut-il pas apprendre aux banques traditionnelles à travailler avec ces start-up innovantes, qui seront de plus en plus nombreuses ?
Il faut être conscient du fait que les banques souhaitent entrer au bon moment dans ces entreprises, et elles s'appuient, pour cela, sur Bpifrance. Pour autant, elles ne sont pas faites pour financer une entreprise dont le taux de croissance sera peut-être de 50 % par an mais qui a aussi 50 % de chances de ne pas se développer du tout. Pour ce modèle-là, il existe le capital-risque, qui s'est particulièrement bien développé en France, grâce à l'action de CDC Entreprises puis de Bpifrance.
L'une de nos missions est d'assurer le passage de relais entre le capital-risque et la banque ou l'investisseur plus classique. C'est l'objet des outils intermédiaires que sont les prêts mezzanine ou les venture loan, auxquels s'apparentera d'ailleurs le PI-FEI. Ces produits nécessitent cependant des compétences très pointues dont les banques ne disposent pas de manière délocalisée. Dans la mesure où, grâce à l'innovation et au capital-risque, nous connaissons le business model de ces entreprises, nous pouvons leur expliquer la manière dont elles fonctionnent et quantifier le risque mais la banque de réseau classique est rarement adaptée à ce type d'opérations. En revanche, certaines banques, dans certains secteurs, ont des experts centralisés qui sont capables de fixer au crédit – qui vaut beaucoup plus cher – un prix beaucoup plus élevé, mais cela reste encore assez rare. À cet égard, la centralisation peut avoir du bon. Néanmoins, encore une fois, ce sont les subventions – elles existent d'ailleurs dans tous les pays – qui rendront le dossier « digeste » pour les acteurs financiers.
J'en viens à la lettre de pré-garantie proposée par la SIAGI, société que nous connaissons très bien pour en être le premier actionnaire après les chambres de métiers et d'artisanat. Il s'agit d'un dispositif que nous avons testé dans les années 1990 et dont nous sommes un peu revenus. Je le vois comme le pendant de la délégation de décision. Notre objectif est de faciliter le travail de l'entrepreneur et celui de la banque. Pour cela, le « parcours client » doit être le plus simple et le plus rapide possible. Or, dans le cas de la lettre de pré-garantie, il nous faudrait recevoir l'entrepreneur et étudier son dossier une première fois avant qu'il n'ait vu sa banque, puis une seconde fois après qu'il aura présenté à celle-ci sa lettre de pré-garantie sous conditions. Une telle procédure nous a paru, d'une part, assez complexe, pour la BPI, pour l'entreprise et pour la banque et, d'autre part, chronophage pour nos chargés d'affaires. En effet, ce type de produits n'attire pas seulement les entrepreneurs qui ont une véritable démarche d'emprunt, mais aussi ceux qui se demandent simplement s'ils auraient la garantie dans l'hypothèse où ils emprunteraient. Pour ces raisons, nous avons fait le choix de ne pas explorer cette piste et de privilégier la délégation, qui fonctionne de manière inverse puisqu'elle permet à la banque de savoir, lorsqu'elle rencontre un entrepreneur, s'il aura droit ou non à la garantie de Bpifrance.

Ma première question est d'ordre politique : entre les ratios de solvabilité, qui sont fixes, et les ratios de rentabilité qui lui sont imposés par ses actionnaires, la BPI ne se trouve-t-elle pas prise dans une contradiction ? Comment, en effet, être rentable en soutenant des projets qui peuvent être risqués ?
Par ailleurs, la France est le deuxième pays européen en matière de capital-risque, ce dont nous pouvons nous féliciter. En revanche, nous ne sommes pas très bien classés en matière d'amorçage. Du reste, nous rencontrons régulièrement des entrepreneurs qui nous font part de leurs difficultés au cours de cette phase de développement de leur entreprise. Comment expliquer un tel décalage ?
En ce qui concerne l'équilibre entre solvabilité et rentabilité, nous sommes pris dans la même spirale que l'ensemble des banques. Le choix a été fait de soumettre la banque publique de développement française à la régulation de la BCE – de nombreux pays n'ont pas fait le même choix. Cette régulation est de nature à rassurer le contribuable, elle nous oblige à adopter les meilleures pratiques bancaires et à jouer notre rôle d'établissement de place de manière plus efficace. Loin de moi, donc, l'idée de remettre en cause ce choix, mais il est exigeant.
C'est une obligation dès lors que l'on considère que la BPI, même si elle est publique et partenaire des autres banques, est d'abord une banque de marché fonctionnant comme les autres. Certaines banques publiques, notamment la KfW allemande, ne sont pas régulées par la BCE. La KfW est pourtant dix fois plus importante que la BPI, puisque son champ de mission couvre à la fois celui de la BPI et celui de la Caisse des dépôts. Celle-ci, d'ailleurs, n'est pas non plus régulée par la BCE, alors qu'elle ressemble à bien des égards à une banque. Être régulé par la BCE reste donc d'une certaine façon un choix, celui de fonctionner d'abord comme une banque. Ce choix reflète ce que sont nos métiers, qui sont strictement bancaires, et traduit la volonté d'avoir les meilleures pratiques et d'être établissement de place.
Quoi qu'il en soit, la BPI se voit imposer, à ce titre, des ratios de solvabilité dont les minima réglementaires augmentent depuis plusieurs années et continueront à augmenter jusqu'en 2019, pour atteindre environ 12 %. Parallèlement, elle est soumise à des exigences de rentabilité par ses actionnaires qui, pour augmenter le ratio de solvabilité, apportent des fonds propres qui ne peuvent pas baisser à proportion de l'augmentation du ratio. Cette spirale représente pour le financement de l'économie un risque, qui a été un peu masqué par le quantitative easing de la BCE mais qui est réel et qui va perdurer.
Notre chance tient à deux éléments. Tout d'abord, les exigences de rentabilité de notre actionnaire tiennent compte de nos métiers, de sorte qu'il nous demande, non pas 10 % à 12 % de retour sur fonds propres, mais 3 % à 4 %, soit le coût du capital de l'État. Aujourd'hui, il nous est possible de parvenir à ce niveau de rentabilité, grâce au second élément, qui est que nous gérons des ressources publiques. Les fonds de garantie sont en effet un amortisseur de risque considérable, donc un lisseur de résultats. La caractéristique de notre profil risque-rentabilité est ainsi d'être beaucoup plus stable que celui d'une banque et globalement un peu moins élevé. Depuis 2008, le retour sur investissement – je parle ici uniquement du financement bancaire et non de l'investissement, qui n'est pas soumis à ces contraintes – est toujours compris entre 2 % et 4 %.
Au demeurant, les métiers du financement de l'innovation et de la garantie, ne ressemblent pas à des métiers bancaires. Si l'on ne retient que le métier de prêteur, notre rentabilité est nettement plus élevée, puisqu'elle se situe autour de 6 %. Elle traduit notre volontarisme et notre discernement dans le choix des dossiers que nous finançons. C'est important, car le coût du risque est un dragon qui dort : on ne sait pas exactement quand il va se mettre à cracher du feu mais on est certain que cela va arriver. Il faut donc y être attentif, pour le bien des entreprises elles-mêmes puisque notre capacité à intervenir en dépend directement.

Cela signifie-t-il a contrario que si l'État et la Caisse des dépôts demandaient une rentabilité moindre, vous pourriez prendre davantage de risques ?
Le risque n'est pas un continuum. Il n'y a pas de voie moyenne : soit le dragon dort, soit il crache du feu. Si on me dit, demain, que je peux diminuer le ROE (Return on equity) de 5 %, je ne pourrai pas régler mon curseur pour augmenter le coût du risque de 5 %. C'est une question de discipline, qui vaut pour la banque comme pour l'entreprise : prêter à une entreprise qui n'a pas les moyens d'emprunter n'a aucun sens – à l'exception de l'existence d'outils adaptés à des cas particuliers, comme les start-up qui entrent en phase de croissance.
Notre niveau de rentabilité correspond, pour ce qui est du financement, à la rentabilité accessible, aujourd'hui en France, au métier de prêteur, dans le cadre réglementaire bancaire que vous avez évoqué et avec une efficacité opérationnelle assez satisfaisante. L'autre mesure importante de la rentabilité est le coefficient d'exploitation, c'est-à-dire le rapport entre le produit net bancaire et les charges opérationnelles de la société. Ce coefficient d'exploitation est, pour la BPI, de 45 %, ce qui, comparé à celui des autres banques intervenant dans ce secteur d'activité, est plutôt satisfaisant.

Ces bons résultats sont notamment liés à la régionalisation de la BPI qui permet à ses directeurs régionaux d'avoir une bonne connaissance du terrain. Comment allez-vous vous organiser dans le cadre de la nouvelle carte régionale ? Allez-vous conserver la structure actuelle, qui montre son utilité ?
Il est hors de question de fermer des directions régionales ; elles ne seront donc plus régionales au sens administratif du terme, mais elles auront toujours des directeurs régionaux à leur tête. Nous allons même ouvrir des délégations, c'est-à-dire des succursales d'antennes régionales, dans quelques villes – nous avons ouvert la première à Bourg-en-Bresse la semaine dernière – où nous considérons qu'il existe un potentiel entrepreneurial qui justifie cette relation de proximité. Il est en effet important d'être proche des PME et des ETI, pour la qualité du service comme pour la maîtrise des risques. Les modèles quantitatifs sont utiles, mais si l'on s'en contente, on s'expose à de très mauvaises surprises car il faut connaître l'entreprise, pour appréhender réellement le risque. Ainsi, nos chargés d'affaires et notre comité d'engagement sont capables de déjuger un modèle de risque parce qu'ils savent soit que l'entreprise est très bonne, soit, au contraire, qu'elle rencontre des difficultés qui ne se traduisent pas dans les chiffres. La proximité est donc absolument fondamentale pour l'équilibre de la banque et pour notre rôle de conseil aux entrepreneurs.
Il y a actuellement 24 directions régionales et 42 antennes, et la décision a été prise, en accord avec nos actionnaires, d'ouvrir quatre ou cinq agences supplémentaires.
Par ailleurs, contrairement à M. le rapporteur, je n'ai pas le sentiment que la France soit mal classée au plan européen en matière de capital-amorçage. Qu'elle porte sur la présence des fonds d'amorçage ou sur le nombre d'accélérateurs ou d'incubateurs sur le terrain, il me semble que la comparaison ne nous est pas défavorable. En tout état de cause, la BPI fait beaucoup pour soutenir l'amorçage sous toutes ses formes. Aux entrepreneurs dont les projets ne sont pas suffisamment ambitieux pour qu'ils aient besoin de lever des fonds propres et de recourir au capital-amorçage, nous proposons, avec France active et le Réseau Entreprendre, des outils de soutien tels que des petits prêts d'accompagnement à la naissance de l'entreprise. Quant à ceux qui ont besoin de lever du capital, ils peuvent s'adresser au Fonds national d'amorçage, créé par le PIA et doté de 400 millions d'euros – ce qui est beaucoup –, qui finance des fonds d'amorçage capables de faire des premiers tours de table, voire des premiers tours de table bis si cela se justifie.

À ce propos, je suppose que nous allons assister, dans le cadre de la réorganisation territoriale, au regroupement de fonds régionaux. En ce qui concerne l'amorçage, la difficulté est liée au fait qu'on ne peut pas attendre le niveau de rentabilité d'une banque commerciale lorsque l'on intervient dans des secteurs où beaucoup de projets sont risqués.
La gestion des outils régionaux, notamment des fonds d'investissement, qui est le plus souvent assurée par des acteurs privés, est à la main des régions. Il leur appartient donc de mener ou non une politique de fusion. Nous y sommes, quant à nous, plutôt favorables, car nous estimons que la bonne gestion d'un fonds d'investissement dépend d'abord de sa taille : plus son aire d'action sera étendue et plus le montant qu'il a sous gestion sera important, plus il sera en mesure d'identifier les bons investissements, d'avoir des équipes capables de les analyser puis d'accompagner les entreprises de manière professionnelle. Quant aux fonds d'innovation et aux fonds de garantie régionaux que nous gérons directement, ils sont aux mains des régions, mais nous faisons le pari qu'un regroupement aura lieu ; nous sommes au service des conseils régionaux dans ce domaine.
En ce qui concerne l'amorçage, son financement a peu à voir avec la dette bancaire. Nous traitons en effet le financement de la création à travers la garantie, de sorte que nous ne nous heurtons pas, dans ce domaine, aux exigences de rentabilité. Ce sont les fonds publics qui nous permettent de soutenir France active aussi bien que la Société générale ou la BNP lorsqu'elles accordent un prêt à un entrepreneur. Qu'il s'agisse des banques commerciales ou des différents réseaux d'accompagnement – France Initiative, France active et le Réseau entreprendre –, ils le font mieux, avec notre garantie, que nous ne le ferions directement. La BPI ne finance donc pas la création en dette, sur ses fonds propres, mais elle soutient ceux qui le font en leur apportant sa garantie. Quant aux entrepreneurs qui ont besoin d'aller plus vite, à une échelle plus importante, ils peuvent faire appel au capital-risque. C'est, là aussi, un secteur que nous connaissons bien et que nous soutenons fortement, en particulier grâce au PIA. Mais il s'agit effectivement d'un segment difficile, voire impossible, pour le marché.

Nous avons eu l'occasion d'évoquer la question du coût de la commission de garantie. Pouvez-vous nous confirmer que le mécanisme de la garantie est appliqué de manière uniforme dans l'ensemble du territoire et que cette commission est appelée dans toutes les situations en une seule fois au moment où les prêts sont accordés ?
Par ailleurs, le taux de la commission dépend-il du risque tel qu'il est apprécié par Bpifrance dans son analyse du dossier de l'entreprise ?
Pour un fonds donné, donc une situation de risque donnée, les commissions sont appliquées de manière uniforme sur l'ensemble du territoire. Lorsque les fonds de garantie régionaux que nous gérons co-garantissent avec des fonds nationaux, nous veillons à ce que le tarif de la garantie régionale soit bien homogène. Nous ne négocions pas le niveau de tarification avec les régions : il est le même dans tous les territoires.
Par ailleurs, il est exact que nous avons choisi, il y a maintenant plusieurs années, de prélever la commission en une seule fois ; c'est préférable pour nous et pour l'entrepreneur. C'est la banque qui paie la commission de garantie car c'est elle qui sera indemnisée en cas de problème, et non l'entrepreneur. Or, lorsque le paiement de la commission de garantie était échelonné dans le temps, nous observions deux dérives :
– Premièrement, la banque reportait souvent directement sur l'entrepreneur la charge du paiement de la garantie, ce qu'il nous était très difficile de contrôler en amont. Ainsi, nous pouvions nous trouver contraints de prélever les entrepreneurs. Le seul moyen d'empêcher cette pratique, qui n'est pas très correcte, est de négocier les modalités de paiement de la commission en amont.
– Deuxièmement, on court le risque qu'en cours de route, du fait de l'entrepreneur ou du banquier, la garantie ne soit plus payée. Or, dans ce cas, nous déchoyons le bénéficiaire de la garantie, ce qui est très désagréable pour la banque – mais après tout, elle est victime de sa mauvaise gestion – mais aussi pour l'entrepreneur, qui n'est plus protégé contre l'hypothèque sur sa résidence principale et le recours à ses sûretés personnelles. Pour ces deux raisons, nous avons donc fait le choix de prélever la commission up front, c'est-à-dire en une fois au moment où la garantie est accordée.
Le coût de celle-ci reste le même, 0,7 % du prêt par an – soit 3 % à 3,5 % du montant total d'un prêt de sept ans amortissable –, mais il est, de ce fait, plus visible, surtout dans un contexte où les taux sont très bas. Payer 0,7 % par an, ce n'est en effet pas la même chose lorsque l'on emprunte à 1 % ou à 4 %.
Nous sommes donc victimes de deux phénomènes qui ont modifié la perception du coût de la garantie : d'une part, il a, du fait de la baisse des taux, beaucoup augmenté en proportion relative et, d'autre part, il est prélevé up front. Toutefois, la banque n'est pas tenue de le reporter directement : elle peut également intégrer la commission dans le montant du prêt ou la rééchelonner auprès de son client. Nous ne sommes pas en mesure d'imposer une de ces options à la banque. Or, le fait est que les retours de perception que nous avons eus correspondent aux situations où la banque a reporté directement le coût de la commission. Elle est libre de faire mais, pour les entreprises auxquelles cela poserait un véritable problème, il est parfaitement possible de s'accorder avec la banque sur un rééchelonnement.
J'ajoute qu'il est plus efficace opérationnellement d'avoir un seul flux financier plutôt que d'en avoir un par trimestre pendant sept ans, par exemple. De fait, la commission n'est pas chère et, en fin de vie d'un prêt, elle ne se monte qu'à quelques dizaines d'euros, de sorte qu'il arrivait que nous ayons des coûts d'opération supérieurs aux montants des commissions…

Je souhaiterais revenir sur la répartition des refinancements de Bpifrance, dont 62 % sont effectués auprès des marchés financiers. Le coût est-il, pour vous, différent selon que vous avez recours aux institutions publiques ou aux marchés ? Par ailleurs, Bpifrance envisage-t-elle de solliciter de manière plus importante la BCE ?
Dans nos financements, la part des marchés obligataires est effectivement de 60 % – et même probablement de 65 % aujourd'hui –, et elle va croître, compte tenu de l'augmentation de nos besoins de refinancement. La part des prêts bilatéraux devient donc marginale. Le fait d'être présent sur les marchés nous donne un prix de marché ; il nous est donc très difficile d'obtenir des conditions différentes dans le cadre de ces prêts – même si cela arrive : nous sommes, avec la BEI, à quelques points de base en dessous de notre prix de marché. Nous parvenons cependant à maintenir notre équilibre économique sans difficultés particulières.
Étant régulés par la BCE, nous avons accès, en contrepartie de la réglementation à laquelle nous sommes soumis, à ses facilités, c'est-à-dire au dépôt au jour le jour, au refinancement à un mois et à trois mois et aux opérations de refinancement ciblées à long terme (TLTRO) lorsque l'occasion se présente. Les TLTRO sont fléchées sur des augmentations d'encours de financement de l'économie, et compte tenu des perspectives de croissance de notre encours nous en avons profité à hauteur d'1 milliard d'euros. Ces facilités de dépôt et d'emprunt au jour le jour sont d'une importance majeure, pour nous comme pour les autres banques, pour gérer la trésorerie au quotidien.
En conclusion, je souhaiterais dire un mot de la dotation pour le financement de l'innovation. Dans le tableau que nous vous avons communiqué, la baisse des dotations se lit d'abord comme une baisse du Fonds unique interministériel, qui soutient les pôles de compétitivité. Or, il faut avoir conscience qu'au-delà de ce fonds, la dotation dont nous bénéficions pour l'aide à l'innovation est passée de 195 millions en 2013 à 175 millions en 2014 et à 159 millions en 2015, avant l'annulation de crédits qui va intervenir. Si cette annulation est équivalente à ce qu'elle fut les années précédentes, nous serons passés en deux ans de 195 millions à 145 millions d'euros.
Jusqu'à présent, nous nous sommes efforcés d'être inventifs pour pallier cette évolution. Nous avons proposé des produits un peu plus sélectifs, et nous avons pu, grâce aux dotations du PIA, nous développer dans d'autres champs de soutien. Mais, en fin d'année, si nous n'avons pas trouvé de solution, nous ne pourrons pas financer des projets que nous jugeons pourtant parfaitement valables, et la situation sera plus critique encore l'année prochaine.
Je me permets d'insister sur le fait que, dans le domaine de l'innovation, rien ne remplace les subventions et les avances remboursables. Encore une fois, tous les pays ont un dispositif puissant dans ce domaine. En taillant dans ce budget, on compromet l'avenir des entreprises innovantes en France. En effet, ces dernières années, toutes les success stories ont bénéficié des aides à l'innovation de l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), puis d'OSEO, puis de Bpifrance. Qui plus est, le potentiel entrepreneurial se développant, nous estimons les besoins dans ce domaine à 200 millions d'euros par an.
Conscients des contraintes budgétaires de l'État, nous avons proposé des solutions. La création d'une fondation pour l'innovation est une option. Elle est probablement complexe à réaliser financièrement, mais il faut étudier toutes les possibilités pour sécuriser ce domaine de notre action, qui est indispensable pour permettre aux entreprises de vivre la suite de l'aventure.