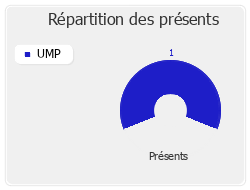Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
Réunion du 20 mai 2014 à 9h00
La réunion
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
MISSION D'ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Mardi 20 mai 2014
La séance est ouverte à neuf heures cinq
(Présidence de M. Pierre Morange, rapporteur)
La Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) procède d'abord à l'audition, ouverte à la presse, de M. François Bonnet, secrétaire national de la Chambre nationale des services d'ambulances (CNSA), et M. Marc Basset, conseiller économique, de M. Jean-Claude Maksymiuk, président de la Fédération nationale des artisans ambulanciers (FNAA), et M. Serge Beaujean, secrétaire, et de M. Bernard Pelletier, président de la Fédération nationale des ambulanciers privés (FNAP).

Les dépenses prises en charge au titre du transport de patients ont représenté quelque 4 milliards d'euros sur l'exercice 2013 ; elles ont augmenté de plus de 60 % entre 2000 et 2010. Cette progression dynamique, près de deux fois supérieure à celle constatée sur les autres postes de dépenses de l'assurance maladie, s'explique par le vieillissement de la population, l'augmentation du nombre des patients atteints par des affections de longue durée (ALD), l'hospitalisation à domicile (HAD) et la restructuration des plateaux techniques. Mais elle trouve aussi son origine, selon le rapport de la Cour des comptes sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale publié en septembre 2012 et le rapport Rénovation du modèle économique pour le transport sanitaire terrestre remis en septembre 2010 au ministère de la santé et des sports par M. Didier Eyssartier, dans une offre insuffisamment construite.
La philosophie de la MECSS s'inscrit dans une logique de recherche du meilleur rapport coût-efficacité. S'agissant du transport de patients, qui n'est pas une prestation mais un acte médical, il convient d'analyser précisément les différents paramètres qui influent sur la dépense, afin de réduire les zones d'ombre par une rationalisation du système. La situation de nos comptes sociaux rend plus ardente que jamais cette nécessité.
La Cour des comptes estime que près de 450 millions d'euros seraient susceptibles d'être économisés grâce à un effort de rationalisation et de coordination portant sur trois grands axes : l'amélioration de la prescription, cet acte médical devant être justifié par des considérations strictement médicales, la réforme de la garde ambulancière et un contrôle de la facturation à la fois plus structuré et plus tenace.
Je souhaite donc vous entendre sur ces différents sujets. Je remercie la Chambre nationale des services d'ambulances (CNSA) de nous avoir fait parvenir une réponse écrite – sans doute collégiale – au questionnaire que nous vous avions adressé.
Si le transport de patients est notre coeur de métier, nous sommes aussi des citoyens responsables. La maîtrise de la dépense sociale nous tient donc à coeur, comme le service rendu aux usagers.
Si le maillage des entreprises de transport sanitaire sur le territoire national est important, il regroupe des entreprises très différentes, tant en secteur rural qu'en secteur urbain. L'entreprise moyenne emploie huit à dix salariés. De nombreuses entreprises – c'est le cas dans mon département du Finistère – ne comptent que deux ou trois véhicules ; mais le service est large, puisqu'il permet de répondre aux besoins de l'ensemble de nos concitoyens.
Il importe de rappeler que le transport sanitaire – véhicules sanitaires légers (VSL) et ambulances – ne représente que 2,1 ou 2,2 milliards d'euros des 4 milliards d'euros dont vous avez parlé. Certes, c'est une dépense importante, mais elle doit être relativisée, d'autant que, en dix ans, la dépense imputable aux taxis a doublé, voire triplé.

Les chiffres sont connus : le transport de patients est assuré par environ 14 000 ambulances, 14 000 VSL et 37 000 taxis conventionnés. Quelle est la part des entreprises de transport sanitaire qui possèdent des taxis ?
La réglementation applicable aux VSL, notamment le numerus clausus, et l'augmentation de la demande de transport assis professionnalisé (TAP) ont conduit un certain nombre d'entreprises à se tourner vers d'autres secteurs, dont celui des taxis. Selon l'assurance maladie, 40 % à 50 % des entreprises de transport sanitaire possèdent aujourd'hui des taxis.

Ces véhicules sont-ils comptabilisés dans les taxis conventionnés ? Et quelle est la part des taxis qui sont détenus par une entreprise de transport sanitaire ?
Ils sont comptabilisés dans les 37 000. Quant à savoir combien il y a de taxis dans les entreprises de transport sanitaire, c'est plus difficile.

Je m'étonne que vous ne connaissiez pas ce chiffre, alors que vous représentez l'ensemble du secteur. C'est un élément qui n'est pas neutre pour les organismes assurantiels, sachant que la stratégie d'une entreprise et celle d'un artisan ne sont pas les mêmes.
Ce qui conduit les entreprises de transport sanitaire à privilégier le taxi plutôt que le transport sanitaire, c'est aussi une démarche économique : la tarification en taxi est une fois et demie supérieure à celle du VSL. Il est donc logique que le chef d'entreprise opte pour le taxi.
Selon la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et la Cour des comptes, il s'agit bien d'une fois et demie.
Nous ne pouvons avancer aucun élément objectif sur la répartition des entreprises de transport sanitaire qui posséderaient des taxis, car les deux types de transports relèvent de deux réglementations différentes et de deux numéros d'identification ou codes indépendants pour l'assurance maladie – laquelle est donc la seule à détenir l'information.
En milieu rural, il est plus facile pour de nombreuses entreprises d'obtenir des autorisations de stationnement que dans les grandes villes. Le chiffre qui a été cité doit donc être relativisé : si beaucoup d'entreprises rurales de transport sanitaire possèdent des taxis, il est plus difficile de connaître leur nombre par rapport aux 37 000 taxis conventionnés.

Il n'est pas interdit aux fédérations professionnelles de chercher à acquérir une connaissance plus pointue de l'offre mise à disposition.
Les entreprises qui sont dans ce cas adhèrent à deux fédérations : une fédération de transport sanitaire pour l'activité de transport sanitaire, et une fédération de taxis pour l'activité taxis. Il n'y a pas de transversalité.

Mais dès lors que l'activité de taxis peut avoir une vocation sanitaire, il n'est pas absurde d'améliorer la connaissance du marché.
Que pensez-vous de l'estimation de la Cour des comptes quant aux marges de manoeuvre susceptibles d'être dégagées ?
L'écart de tarification entre les VSL et les taxis offre une première piste pour parvenir à ces 450 millions d'euros d'économies. Les dépenses de taxi s'élèvent aujourd'hui à 1,2 milliard d'euros, contre 800 millions d'euros pour les VSL ; ces dernières n'ont pratiquement pas augmenté en dix ans. 400 millions d'euros pourraient être facilement économisés.
Deuxième piste : lorsque le référentiel d'aide à la prescription a été publié, en 2006, la FNAP avait défendu l'idée que le transport n'était pas un droit, mais un besoin. Pourquoi l'assuré social pris en charge à 100 % doit-il emprunter un transport de patients alors qu'il peut prendre sa voiture ou les transports en commun, tandis que le transport d'un non-voyant qui ne souffre d'aucune affection particulière mais doit se rendre à une visite médicale n'est pas pris en charge ? Nous souhaitions donc revoir le motif de la prescription de transport sur le fondement de la notion de besoin, mais cela fut un échec. La FNAP continue néanmoins de considérer qu'il est possible de réguler la dépense à travers la prescription pour offrir la prestation à celui qui en a réellement besoin.

Il est vrai que, en matière de transport sanitaire, l'offre est assez disparate et hétérogène sur le territoire français. Les ratios par habitant, qui n'ont pas été réactualisés, sont souvent malaisés à expliciter. Quelle est votre position sur ce sujet ?
Le décret du 26 août 2012 a actualisé la réglementation relative aux autorisations de mise en service des véhicules et les agréments d'entreprises. Un directeur général d'agence régionale de santé (ARS) accorde l'autorisation en se fondant sur quatre points. J'observe que, dans certains départements, les agréments sont refusés lorsque l'entreprise a changé de direction, par exemple parce que le quota de VSL est déjà atteint. Celui qui ne possède plus de VSL va alors demander une licence de taxi – d'autant que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la tarification de ce mode de transport est une fois et demie supérieure. S'il faut veiller à ce que l'offre de transport soit en adéquation avec les besoins, il faut aussi prendre garde à l'aspect administratif, qui pénalise le transport sanitaire. Alors que le VSL est le mode de transport le moins onéreux pour l'assurance maladie, il semble parfois qu'il ne soit pas encouragé. C'est pourquoi, il faut revoir les plafonds. Des véhicules sanitaires manquent dans certaines régions. Il faudra bien, un jour ou l'autre, clarifier les rôles de chacun : l'ambulance et le VSL ont une vocation de transport sanitaire, les taxis ont une vocation de transport de personnes.

Quel est votre avis sur la recommandation de la Cour des comptes qui prône l'instauration d'un double plafonnement en lieu et place du plafonnement global qui existe aujourd'hui pour les VSL et les ambulances pour mettre fin à la possibilité de transformer des VSL en ambulances ?
S'agissant de la démographie et de l'implantation des véhicules par rapport à la population, l'offre est moins hétérogène qu'il n'y paraît. En effet, elle n'est pas appréhendée au regard de la chaîne de soins. On constate que plus la densité de population dans un département est faible, plus il compte de véhicules de transport de patients, ce qui paraît légitime, puisque la chaîne de soins est de plus en plus longue.
Quant au plafond du nombre de véhicules, vous n'ignorez pas qu'il est contourné par l'ouverture massive du conventionnement accordé aux taxis. Le numerus clausus des véhicules de transport sanitaire a été instauré par une loi de 1992 et mis en oeuvre par des décrets de 1995. Ce plafonnement des véhicules de transport sanitaire a été contourné dès l'origine, notamment pour le TAP, par la mise en place du conventionnement de l'assurance maladie avec les taxis. Il semble que ce plafond ait été arrêté de façon arbitraire, pour diminuer l'offre et donc la dépense, selon le dogme de l'assurance maladie, sans objectiver les incidences par rapport à la chaîne de soins. Compte tenu de la profitabilité négative du VSL, les entreprises ont donc abandonné ce marché au profit de l'activité de taxi conventionné. L'évolution des dépenses de taxi est donc liée à la diminution en volume du nombre de transports en VSL.

Lorsque vous dites que les entreprises ont investi le secteur du taxi pour des raisons de profitabilité, parlez-vous des entreprises de taxis, ou des entreprises de transport sanitaire qui ont investi dans les taxis ?
Tout est possible. En milieu rural, ce sont principalement des artisans qui s'installent. Un certain nombre d'entreprises se sont tournées vers des rachats de licence. Quelques entreprises commencent à être structurées. Il peut s'agir d'entreprises de transport sanitaire, mais aussi de vraies entreprises de taxis qui se spécialisent dans le transport de patients. La profitabilité moyenne d'un transport est de 47 euros pour un taxi, et de 32 euros pour un VSL. Malgré les efforts qui sont effectués sur la structuration tarifaire, l'activité de VSL diminue en volume. Si l'on devait restructurer l'ensemble du TAP demain, cela se solderait nécessairement par un surcoût pour l'assurance maladie.
Le plafonnement existe déjà. Depuis le décret d'août 2012 précité, on ne peut pratiquement plus transformer de VSL en ambulances. Plus exactement, c'est à l'appréciation des ARS.

Cela n'a donc pas de valeur normative ou réglementaire.
Dans le cadre de cette libre appréciation, les ARS s'intéressent-elles au stock, au flux ou aux deux ?
L'ARS ne maîtrise que le nombre de véhicules de transport sanitaire, alors même que l'offre de taxis conventionnés a ouvert un gouffre financier. Nous avions demandé à la direction générale de l'offre de soins (DGOS) que la circulaire relative à l'application du décret de 2012 prenne en compte la totalité de l'offre de transports remboursable par l'assurance maladie. Aujourd'hui, aucun acteur ne possède la maîtrise globale du TAP. Le ministère de la santé ne peut pas réglementer le transport par taxi conventionné, qui relève du ministère de l'intérieur. Cette dualité empêche le pilotage du dossier. C'est en vain que, depuis 1998, l'assurance maladie et le ministère de la santé ont cherché une convergence avec les professionnels sur les deux types de véhicules.
Initialement, il devait y avoir une convention commune sur le TAP. Notre convention avec l'assurance maladie a déjà été renouvelée deux fois depuis 2003. Mais personne n'a eu le courage politique de gérer cette situation – pour le plus grand profit des taxis.
Tout simplement à cause de la pression des taxis.
Oui. Nous demandons que les règles du jeu soient les mêmes pour tous. Le VSL soulève une difficulté : il est défini comme un véhicule de transport sanitaire, qui ne peut être emprunté que sur prescription médicale, alors que le taxi – qui a accès au transport de patients – est ouvert à de multiples marchés. En outre, notre tarification relève du contrôle de l'assurance maladie, alors que celle des taxis relève du ministère des finances. Les courbes d'évolution des dépenses sur dix ans – que nous vous avons fournies – sont significatives.

Quelle appréciation portez-vous sur la pertinence et l'efficacité de la garde ambulancière ? La Cour des comptes et le rapport de M. Didier Eyssartier se sont interrogés à cet égard, car, dans certaines régions, elle n'est rentable qu'à partir de quatre déplacements. Vous semble-t-il opportun de faire appel aux structures existantes – c'est-à-dire aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) – dans ces secteurs afin d'éviter les doublons dans l'offre de transports ?
Je rejoins les propos de mes collègues sur le contingentement de véhicules sanitaires. Le critère retenu a toujours été le nombre d'habitants, alors qu'il faudrait se fonder aussi sur les structures hospitalières et sur les plateaux techniques pour traiter le problème de la garde.
Permettez-moi de rappeler quelques chiffres. Il y a plus de 62 millions de trajets par an, pour plus de 5 millions de patients transportés, ce qui représente 8 % de la population. Quant au nombre de véhicules par département, il faut rappeler que, pour 100 000 habitants, on compte 23 ambulances, 27,8 VSL et 63 taxis.
Une refonte de la garde ambulancière est nécessaire, car le dispositif – y compris les prises en charge – est obsolète. Les sapeurs-pompiers et le ministère de l'intérieur ont été placés devant le fait accompli à l'issue de négociations sur la question qui ont duré plusieurs années et auxquelles ils n'ont pas participé. Les entreprises de transport sanitaire ont dû ensuite mettre en place des référentiels ; mais comment travailler avec les sapeurs-pompiers sans avoir négocié avec eux au préalable ? Il faut refondre complètement la garde départementale. Aujourd'hui, elle est obligatoire. Il me semble qu'on ne peut contraindre tous les ambulanciers à effectuer des transports urgents. Mieux vaudrait en faire une spécialité, basée sur le volontariat ; nous aurions ainsi une garde plus efficace et des équipes structurées pour des missions d'urgence.
Les secteurs sont aussi à revoir. Nous réclamons depuis plusieurs années une refonte complète de la garde, notamment des indemnités, qui n'ont pas évolué depuis 2003 et ne sont pas attractives pour des entreprises privées contraintes à une certaine productivité.
Pour notre part, nous considérons que la garde doit être rémunérée au coût réel des interventions. Nous sommes favorables à une fongibilité des enveloppes soins de ville et des missions d'intérêt général et à l'aide à la contractualisation (MIGAC). Les indemnités de garde s'élèvent à 346 euros et un abattement de 60 % est appliqué à l'indemnité liée aux interventions ; lors d'une carence ambulancière, l'intervention des sapeurs-pompiers est rémunérée à concurrence de 117 euros, mais jusqu'à 120 euros, voire 140 euros dans certaines régions ; les transports médicalisés sont également onéreux, même s'ils ne représentent que 3 % ou 4 % du volume total des transports urgents. Il faut refondre toute l'enveloppe, optimiser les secteurs de garde, et retenir le critère de l'activité. Dans certains secteurs, il y a quatre ambulances de garde pour une nuit ; ce nombre pourrait être réduit à deux.
Il importe également d'optimiser la tarification et de réduire les carences ambulancières, pour arriver à un taux de 5 %. En période de garde, un ambulancier par secteur est disponible pour intervenir en cas d'appel du centre 15. Or le nombre de carences ambulancière rémunérées pour les SDIS et le nombre de carences réelles enregistrées par les services d'aide médicale urgente (SAMU) sont différents.
Toutes ces propositions passent par une coordination des transports, à travers une plateforme centralisée, qui peut être départementale ou régionale.
Les interventions que nous demandent les SAMU ne relèvent pas toutes de l'urgence vitale. Dans certains cas, ils pourraient envoyer un médecin libéral.
J'en viens à la suggestion de la Cour des comptes de faire appel aux SDIS lorsque le nombre de transports urgents est faible. La FNAP considère que, dans tous les secteurs, il faut d'abord laisser le transporteur sanitaire remplir ses missions. S'il existe des endroits reculés où les délais d'intervention ne sont plus de l'ordre de vingt minutes, mais plutôt de trente à quarante minutes, vous conviendrez qu'un transport qui n'est pas très urgent peut attendre jusqu'à quarante minutes.

Dans la note que vous nous avez fait parvenir en complément des réponses au questionnaire que nous vous avions adressé, vous faites référence à l'indemnité de la garde ambulancière par période de douze heures, qui s'établit à 346 euros. Il convient d'y ajouter la tarification pour chaque déplacement minorée de 60 %, qui n'est pas mentionnée dans votre note.
Par ailleurs, la mise à disposition de moyens doit se fonder sur un principe édicté dans la loi, celui de l'utilisation du transport le moins coûteux. Au-delà du fait que le transport de patients obéit à une prescription médicale, il y a la logique de rationalisation. Nous avons donc d'un côté un critère sanitaire, de l'autre un critère économique.
S'agissant de la garde, je rappelle que l'expérimentation qui a été conduite a mis en évidence un besoin de gouvernance sur lequel les organisations syndicales ont souhaité insister. Les départements où cela fonctionne bien sont ceux où il existe une vraie gouvernance, avec une vraie optimisation dans la mise en oeuvre des moyens – sectorisation, cahier des charges… De fait, les volumes sont souvent au rendez-vous.
En ce qui concerne la structuration tarifaire, il faut rappeler que les 346 euros découlent d'un calcul un peu ancien. À l'époque où celui-ci a été fait, le coût du personnel roulant représentait 60 % du chiffre d'affaires des entreprises. Comme il était nécessaire de mobiliser deux personnes quel que soit le nombre des interventions effectuées, et nonobstant les autres coûts de fonctionnement, nous avions calculé que le coût de revient de ces personnes était de 346 euros en 2003, mais il s'élève aujourd'hui à 408 euros.
Il est clair que, lorsque l'organisation de la garde départementale n'est pas structurée, l'équilibre économique ne peut être atteint par les entreprises de transport sanitaire. D'autres phénomènes comme le nombre d'interventions et la densité de population entrent en ligne de compte, et posent un problème particulier dans les zones fortement rurales.
Dans les zones rurales où la garde fonctionne bien, où elle est bien pilotée, avec une gouvernance et une traçabilité, l'activité est au rendez-vous. Si nous vidons les zones rurales des moyens de transport en ambulance, nous n'aurons plus d'effecteurs.
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les 40 % de facturation du prix correspondent aux coûts de fonctionnement. Or nos coûts de fonctionnement ont augmenté plus vite que nos tarifs. Dans certains cas, plus l'entreprise sort, plus elle perd d'argent. C'est la raison pour laquelle elles se retirent du système de garde.

Aussi ne peut-on se contenter d'avancer ce chiffre de 346 euros : il y a une indemnité facturée à 40 % pour chaque déplacement.
Ils ne correspondent qu'aux coûts de fonctionnement.

Vous dites que les 346 euros n'ont pas été réévalués. On ne peut jouer sur tous les tableaux : il faut un raisonnement global.
Tout à fait. En ce qui concerne l'urgence pré-hospitalière, on peut considérer que le modèle économique a atteint ses limites. Je rappelle que la Cour des comptes a estimé le coût des sorties des SDIS à au moins 150 euros, et jusqu'à 750 euros.

Selon l'Assemblée des départements de France (ADF), le coût de déplacement des SDIS serait supérieur à 1 000 euros, dans la mesure où l'armement de chaque véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) correspond au coût réel. En revanche, ils sont opérationnels dans tous les cas de figure, qu'ils se déplacent ou non. Il s'agit donc d'optimiser les structures existantes.
On constate aujourd'hui une évolution des pathologies, plus endogènes qu'exogènes. L'arrivée de tout nouvel acteur dans la chaîne de soins pose des problèmes de structure et d'organisation. Il importe donc de définir les missions de chacun, à quel prix et comment. Les départements qui tracent des activités peuvent démontrer que les interventions des ambulanciers sont compétitives par rapport à celles des SDIS.

Que pouvez-vous dire du covoiturage, de la géolocalisation, ou de tout ce qui peut être envisagé en termes d'optimisation du mode de transport ?
En ce qui concerne la géolocalisation, nous avons signé en 2008 un avenant à la convention avec l'assurance maladie qui prévoyait une expérimentation. Mais il est resté sans suite : nous n'avons pas eu de retour de l'expérimentation qui avait été lancée. Les entreprises se sont presque toutes équipées. Il reste à relancer – c'est l'objet de l'avenant qui vient d'être signé – le code de bonnes pratiques.
Elle a été conduite en 2008, et ouverte à 200 ou 300 entreprises. Nous avons tout transmis à la CNAMTS, mais n'avons eu aucun retour de sa part.

Nous aimerions connaître les territoires où les entreprises se sont impliquées dans l'expérimentation.
S'agissant de nombre de véhicules équipés, nous avons atteint la cible fixée par la convention. Tous les éléments ont été transmis à l'assurance maladie. Il lui reste à exploiter les données fournies par la géolocalisation, pour la traçabilité des trajets et des horaires, pour vérifier que le service facturé correspond bien à celui qui a été accompli. La profession est prête à généraliser cette expérimentation.
Un second volet concerne l'urgence pré-hospitalière assurée avec ambulance, en relation avec les centres 15. En la matière, la géolocalisation des véhicules est essentielle pour permettre au médecin régulateur de prendre la bonne décision. Mais l'interopérabilité des systèmes informatiques est compliquée à mettre en place. Comme le rappelait M. Bernard Pelletier, les carences ambulancières sont estimées sur des critères subjectifs ; on ignore si des ambulances sont disponibles ou pas. Là où des expérimentations sur la géolocalisation ou la traçabilité des véhicules ont été conduites, le taux d'activité des ambulanciers – y compris en garde – a augmenté.
En ce qui concerne le covoiturage, la CNSA est plus en retrait. On demande aujourd'hui aux transporteurs sanitaires – aux VSL – de faire du covoiturage, donc d'imposer des contraintes à leurs patients en termes de confort, alors que les taxis peuvent offrir des prestations individuelles sans imposer ces contraintes à leurs clients.

Dès lors qu'on établit un principe, il est le même pour tous. La logique du covoiturage concerne donc tout le monde.
Sur le plan réglementaire, rien ne permet aujourd'hui de l'imposer aux patients. Nous avions demandé que les prescriptions soient établies de manière à pouvoir éventuellement interdire le covoiturage. Actuellement, ce sont les entreprises qui demandent au patient son accord pour être transporté en covoiturage. C'est délicat tant vis-à-vis du patient que vis-à-vis de la chaîne de soins. Il ne me paraît pas légitime de laisser cette responsabilité à la profession.
Comme la FNAA et la Fédération nationale des transporteurs sanitaires (FNTS), la FNAP a signé avec l'assurance maladie tous les accords en vigueur sur les VSL. Le VSL est le parent pauvre du TAP. Nous avons conscience que les années où nous réclamions à l'assurance maladie des revalorisations tarifaires sont derrière nous. Les accords passés avec l'assurance maladie, à partir des avenants n° 5 et n° 6 à la convention entre l'assurance maladie et les transporteurs sanitaires, visent à redonner de la productivité au VSL. Celle-ci passe par une tarification intéressante sur les courses courtes. En effet, on a constaté que les entreprises n'utilisaient pas de VSL pour les courses courtes par manque de rentabilité. L'activité VSL se trouve ainsi « revalorisée », comme elle l'est par le transport partagé ou le covoiturage. Le VSL est le seul moyen de transport conventionné qui peut transporter jusqu'à trois patients, avec une tarification dégressive. Il s'agit désormais de favoriser le VSL, qui est le transport le moins onéreux et peut donc être un outil de régulation de la dépense.

Permettez-moi d'insister : le principe de libre choix du patient n'a aucune valeur législative. C'est un élément de type conventionnel, qui a été assimilé à tort à un principe législatif. En la matière, le seul principe ayant valeur législative est celui énoncé par l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, qui précise que « les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire ». Par conséquent, les desiderata du patient n'ont qu'un rôle marginal à jouer par rapport à la prescription médicale et à l'impératif de bonne gestion des deniers publics.
C'est en effet ce que nous avait affirmé la Cour des comptes. Mais le code de la santé publique pose le principe du libre choix du transporteur par le patient.

Le libre choix du patient ne s'applique qu'au praticien, et en aucun cas au transport du patient. C'est par analogie que ce raisonnement, qui s'apparente à une prise d'otages, a été fait, sans doute aussi parce que nous vivons dans une société où les tendances consuméristes sont à l'oeuvre. Mais la situation qui est la nôtre nous impose une rationalisation des dépenses de l'assurance maladie. Sachez que, à la MECSS, le mot « économies » est respecté. En matière de transport de patients, les seuls principes qui prévalent sont l'état sanitaire du patient – autrement dit la motivation de la prescription médicale – et la définition du transport le moins onéreux vers l'établissement le plus proche adapté à sa situation.
J'attire cependant votre attention sur le mécanisme tel qu'il fonctionne au quotidien ; l'assurance maladie et la chaîne de soins n'ont mis en place aucune logistique à ce niveau.

Nous sommes d'accord sur le constat – qui pourrait s'appliquer à tous les postes de dépenses de l'assurance maladie, voire à tout notre système de protection sociale : l'absence de vraie gouvernance, de rationalisation et de coordination, la multiplicité des centres de décision font que le système est contre-productif. Vous avez été auditionné par Mme Catherine Lemorton, présidente de la commission des affaires sociales, dans le cadre de la mission d'information sur l'organisation de la permanence des soins. En matière de transport sanitaire, nous constatons que l'absence d'articulation entre l'offre et la demande aboutit à un phénomène d'engorgement, et donc à une inadaptation de l'offre. Cela démontre une absence totale de rationalisation et de gestion des besoins.
Depuis plus d'une décennie, la profession a déployé tout son possible pour introduire de la logistique. Nous avons signé en 2003 un contrat de bonnes pratiques avec les fédérations hospitalières publiques et privées et les fédérations ambulancières. Ce dossier n'a été piloté ni par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ni par les établissements de soins. Nous avons donc réitéré en 2009-2010, avec la mise en place d'un référentiel pour le transport post-hospitalier ; nous y avons introduit la notion de plateforme de régulation des transports au sein des établissements de santé, en demandant qu'elle soit réservée aux transports sanitaires. Comme on pouvait s'y attendre, le dossier a avorté en raison du blocage des fédérations de taxis. Aujourd'hui, toutes les plateformes logistiques qui essayent de se mettre en place, notamment en Poitou-Charentes à l'initiative de l'ARS, sont bloquées par les taxis. S'il existait une véritable gouvernance et un appui décisionnel à l'ensemble des parties, qui permette de mettre en place ces plateformes logistiques, nous arriverions à faire comprendre à la patientèle que c'est le mode de transport le moins onéreux qui est pris en charge ; mais si cela ne repose que sur notre profession, ce ne sera pas possible. La vraie difficulté réside dans l'absence de gouvernance de la profession, qui dépend pour une part du ministère des transports, pour une part de celui de la santé et pour une autre de l'assurance maladie. En résumé, il manque un pilotage du transport sanitaire. Or c'est un domaine complexe.

Venons-en au sujet des deux flottes – ambulances et VSL. La pratique qui consistait à transformer des VSL en ambulances a-t-elle définitivement cessé ?
Oui, car le décret d'août 2012 a bloqué cette possibilité.
Certes, mais les conditions sont très contraignantes.

Reconnaissez qu'il était tout de même difficile à admettre que le prix de revente d'une autorisation de mise en service d'une ambulance puisse aller jusqu'à 250 000 euros. Confirmez-vous ce chiffre ?
Cela s'est pratiqué surtout dans les très grandes villes, où, dans les années 2000, les entreprises n'ont pas pu continuer à exercer. Nous avons assisté à une ré-atomisation du secteur, puisque nous sommes passés de 4 700 entreprises au début de 2000 à 5 700 entreprises aujourd'hui. Le phénomène a surtout touché les grandes villes. Les autorisations sont revendues à des artisans, qui travaillent dix-huit heures par jour, avec seulement un véhicule et deux personnes, au mépris du respect d'un certain nombre de réglementations professionnelles.

Je suis heureux de vous l'entendre dire. Nous sommes entrés dans une logique mercantile, bien qu'elle s'adosse à des référentiels techniques par le biais de l'agrément. C'est un vrai dévoiement, puisque nous assistons à l'instrumentalisation d'un système à vocation sanitaire.
Lorsqu'on regarde le paysage du transport sanitaire en France, on peut s'interroger sur l'absence de concentration du secteur. On est en droit de se demander s'il ne va pas basculer entièrement dans l'artisanat. Aujourd'hui, ce sont les entreprises les plus structurées qui ont le plus de difficultés économiques.

On observe un double mouvement : une tendance à l'atomisation, que vous venez de décrire, et une tendance à la concentration qui s'explique par les problématiques de gestion de la masse salariale et de rationalisation des moyens. Vous savez que les prescripteurs des établissements de soins sont à l'origine de près de 63 % de la dépense de transport de patients. En matière de prescription de transports, les référentiels ne sont pas assez respectés, ce qui a conduit certains à préconiser une budgétisation de cette dépense à l'intérieur de la comptabilité hospitalière, pour responsabiliser l'hôpital et sensibiliser les prescripteurs à la nécessité d'une rationalisation.
Sachant que le transport sanitaire répond à des critères techniques exigeants, notamment en termes d'armement des véhicules, ne craignez-vous pas que l'atomisation du paysage du transport sanitaire entraîne un risque sanitaire, dans la mesure où ces micro-entreprises ne sont pas assez solides pour assumer un entretien des véhicules permettant de répondre aux exigences du service qui leur est confié ?
Que pensez-vous de la budgétisation hospitalière du transport de patients ? Nous avons reçu la direction de la sécurité sociale (DSS), qui est un peu en retrait sur ce dossier. Nous avons cru comprendre que les fédérations de transporteurs de patients redoutaient que cette mesure ne favorise une concentration du marché du transport de patients à partir des établissements de soins, ce qui aurait inévitablement des incidences économiques. Sachez que cette mesure, qui a toute sa légitimité dans une économie de marché, serait mise en oeuvre en tenant compte de la spécificité du secteur : c'est une prescription médicale, financée par de l'argent public à vocation sociale et sanitaire.
Sur le premier point, je vous rejoins : il suffit de regarder ce que nous voyons passer comme véhicules ambulances à Paris pour mesurer le danger que représente cette évolution.

Nous avons des exemples concrets d'entreprises très artisanales dans leurs modalités de fonctionnement, que ce soit au titre de l'ambulance ou du VSL ou de la formation du personnel. Cela pose la question de l'insuffisance du contrôle des autorités de tutelle, à savoir l'ARS pour l'agrément et l'assurance maladie pour le conventionnement, sachant que, si un retrait d'agrément entraîne un déconventionnement, l'inverse n'est pas vrai.
Il existe des moyens très simples d'imposer des règles économiques de référence. L'assurance maladie détient, à travers les remboursements, les profils d'activités par véhicule ou par structure.
Nous préconisons depuis longtemps la création d'un diplôme de chef d'entreprise de transport sanitaire. La profession a besoin d'être structurée. Nous avons mis en place un diplôme d'État en 2006 ; nous avions le projet de mettre en place ce diplôme de chef d'entreprise. Nous voyons trop de véhicules mal équipés ou sous-dimensionnés, et de personnels insuffisamment qualifiés, voire non diplômés, y compris pour ce qui concerne l'accueil des patients. Disons-le, dans cette démarche, on s'intéresse aux transports davantage qu'aux patients. Tout cela est grave et préjudiciable pour la profession.
J'en viens à la budgétisation du transport de patients des hôpitaux. Permettez-moi de vous faire observer que la circulaire du 27 juin 2013 qui a transféré des transports à la charge des hôpitaux vers l'assurance maladie ne va pas dans ce sens. Les hôpitaux sont conscients que le volume de transports ne fait qu'augmenter du fait de l'organisation de la chaîne de soins. On ne peut pas filialiser, mettre en place des plateaux d'excellence, réduire les durées de séjour, adresser les patients à des établissements adaptés à leur état de santé et encourager les retours précoces vers les hôpitaux de périphérie sans provoquer des transports. Il n'existe d'ailleurs aucune étude sérieuse pour démontrer que l'on peut faire des économies à ce niveau. M. Van Roekeghem, directeur général de la CNAMTS, a lui-même reconnu, lors de la dernière réunion à laquelle nous avons participé, qu'il allait devoir adapter sa communication à la réalité des chiffres. Il faut savoir que nous transportons chaque année 1 % de patients de plus, que le nombre de patients transportés est itératif, et que parmi les patients transportés, cinq pathologies dominent. Je veux bien que l'on sensibilise chacun sur le respect de la prescription ; mais, pour faire des économies sur la dépense totale, il faut introduire de la logistique et du suivi. Or ce n'est pas la logique qui est suivie ; comme je l'ai rappelé avec le transfert des dépenses de transport à la charge des hôpitaux vers l'assurance maladie, les hôpitaux eux-mêmes constatent qu'ils ne savent pas gérer les flux de transport. En somme, les hôpitaux sont-ils de bons gestionnaires du transport ?
Permettez-moi de revenir sur « l'élitisme » des entreprises de transport sanitaire. Nous souhaitons tous que nos entreprises soient aussi performantes que possible. Vous avez évoqué un coût de 250 000 euros pour la cession d'autorisation de mise en service d'une ambulance. C'est très exagéré ; en zone rurale, les autorisations se négocient 10 000 euros, 15 000 euros ou 20 000 euros. Si les entreprises cèdent leurs autorisations, c'est parce que leur situation économique n'est plus tenable. Nous dénonçons comme vous les entreprises qui ne répondent pas aux exigences de la réglementation ; mais comment redresser leur productivité ? Nombre d'entreprises rurales de transport sanitaire sont contraintes d'avoir une activité parallèle – de taxi par exemple – pour financer leur activité principale.

Faisons attention à l'argumentaire. Nous comprenons que l'aspect économique soit au coeur des préoccupations des chefs d'entreprise, mais nous sommes dans un financement social – qui ne se fonde pas sur une justification économique, mais sur une justification médicale, qui a pour objet de rationaliser le plus possible l'utilisation de l'argent public pour fournir une réponse à une souffrance humaine. Certes, les moyens qui sont mobilisés obéissent aux principes d'une économie de marché, avec des charges et des produits. J'ai évoqué le prix de revente d'une autorisation pour une ambulance – 250 000 euros dans les centres urbains ; je crains que l'atomisation du paysage du transport de patients n'aboutisse de fait à une dérive, puisqu'il faudra bien amortir l'investissement, et que cela risque d'entraîner de la précarité sur les plans technique, humain et sanitaire. Il ne s'agit pas de diaboliser les uns ou les autres ; pour la MECSS, le sujet est celui de la rationalisation et de l'optimisation.
Quelle est votre position sur les appels d'offres passés par les établissements de santé ? J'ai bien noté qu'un mouvement inverse avait eu lieu, monsieur François Bonnet ; mais cela n'interdit pas de réfléchir sur le sujet. J'ai compris que vous redoutiez une concentration de type monopolistique au profit des grandes entreprises, qui auraient seules la capacité de répondre aux appels d'offres. Cependant, le raisonnement est un peu court, car on peut aussi imaginer une mutualisation de structures pour répondre à ces appels d'offres.
Nous ne sommes pas opposés à ce qu'il y ait des appels d'offres pour réguler et mieux organiser la dépense. En revanche, nous refusons que des entreprises « restent sur le carreau » – et c'est pourquoi nous nous opposons à l'article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Quid des entreprises rurales éloignées d'un centre hospitalier ? Quid des investissements consentis dans le cadre d'un appel d'offres par une entreprise qui perdrait le marché quelques années après ? Nous n'avons pas obtenu de réponse à ces questions.

À l'inverse, on peut envisager que l'absence de procédure d'appel d'offres pérennise des situations qui s'enracinent dans une histoire particulière, ou des réseaux de relations, et qui évincent les nouveaux arrivants. Nous comprenons votre inquiétude, mais au moins la procédure d'appel d'offres a-t-elle l'avantage de se fonder sur des critères techniques qui sont les mêmes pour tous. Il ne s'agit pas de le faire du jour au lendemain : nous laisserons le temps de l'adaptation aux structures. Quoi qu'il en soit, la crainte de voir disparaître des micro-entreprises ne peut être le seul argument pour s'opposer à la mise en oeuvre d'une procédure de mise en concurrence.
Bien entendu, il faut éviter les « petits arrangements entre amis ».

Le moins qu'on puisse dire est que cela existe… Toute profession a ses « moutons noirs ». Il s'agit donc d'apporter la transparence nécessaire.
Nous avons évoqué tout à l'heure les centres de régulation des appels, qui permettraient d'avoir un tour de rôle équilibré pour l'ensemble des entreprises. C'est assez facile à mettre en place.

Venons-en au contrôle de la facturation et à la lutte contre la fraude. Toute profession ayant son lot de fraudeurs, un certain nombre d'échos médiatiques ont entaché la réputation de la vôtre. Quelles propositions formulez-vous pour que ces quelques cas ne viennent pas ternir son image ?
J'ai entendu vos interrogations sur les taxis. Au-delà de l'existence de deux autorités de tutelle, le ministère de la santé et celui de l'intérieur, vous avez le sentiment que les règles, les obligations et les facturations ne sont pas les mêmes – ce qui est exact. Comment assurer une équité de traitement entre les deux modes de transport ?
Sur la dépense, quelques questions méritent d'être posées. Quel est le service médical rendu par un transport de patients ou un transport sanitaire ? Que se passe-t-il ailleurs en Europe ? Les transports assurés par taxi conventionné ou VSL sont-ils adaptés aux besoins de la population ? Quels sont les vrais besoins de celle-ci ?

Justement, avez-vous des informations à nous donner sur la pratique dans les autres pays européens ?
En Allemagne et dans les pays anglo-saxons, il existe, en plus des ambulances, des véhicules réservés au transport de patients exigeant une surveillance constante, et enfin des véhicules dédiés au transport ou au déplacement de patients nécessitant soit de l'accompagnement, soit de la manutention, conformément aux normes européennes, qui prévoient trois types de véhicules : les véhicules d'unités de soins intensifs, les ambulances avec surveillance des patients, et enfin les véhicules dédiés au déplacement de patients multiples, qui peuvent être aussi bien un patient en brancard ne nécessitant pas de surveillance constante qu'un malade en fauteuil roulant ou un patient ayant besoin d'être accompagné. Il s'agit donc de transport partagé, avec une dimension logistique – marche qu'il nous reste à franchir en France.
Par ailleurs, les taxis ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie dans les autres pays européens. Seuls les véhicules techniques le sont. Comme je l'ai déjà mentionné, il faut se demander si le transport par taxi conventionné ou par VSL est adapté aux besoins des patients.
J'en viens aux appels d'offres. Le référentiel que nous avons voulu mettre en place en 2010 est une façon d'aborder le sujet. Il suppose un vrai tour de rôle, avec une vraie clé de répartition en fonction des moyens, sur des critères objectifs d'analyse, de suivi qualitatif, de suivi de la formation et du service rendu. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, tout le monde « fait du prix » aux heures de forte activité. Nombre d'hôpitaux se servent de la garde ambulancière comme d'un système post-hospitalier, parce qu'il n'existe pas de réponse libérale en la matière. Le risque de l'appel d'offres, c'est que les prix baissent en période de forte activité. Mais, en période de faible activité, qui acheminera les patients jusqu'à la chaîne de soins ? L'objectif de ce référentiel était de répondre à cette question : il a avorté en raison de la multitude des acteurs, de l'incompréhension du système et d'un manque de volonté de la tutelle.
J'en viens à la fraude. L'avenant de 2008 de la convention avec l'assurance maladie prévoit la mise en oeuvre de la géolocalisation. Il ne peut donc plus y avoir de fraude, puisque nous transmettons à l'assurance maladie l'ensemble des éléments du déplacement relevés par des outils certifiés et inviolables.

Dès lors que l'élément intentionnel de la fraude est démontré, le déconventionnement qui peut s'ensuivre doit-il systématiquement s'accompagner d'un retrait de l'agrément ?
Bien entendu. Sachant que, seul un transport assuré par un prestataire conventionné peut être remboursé, une entreprise qui se voit retirer le conventionnement ne peut pas survivre économiquement.
Cela dit, il est rare qu'une sanction soit prononcée – y compris par l'assurance maladie. À y regarder de plus près, ce que l'on qualifie de fraude relève parfois du « misérabilisme administratif » de la part de certaines entreprises, qui tentent simplement de reconstituer leurs facturations. Je ne nie pas que la fraude existe dans notre secteur – comme dans tous les métiers. Mais je suis un peu perplexe lorsque j'entends chiffrer à des centaines de millions d'euros les sommes pouvant être récupérées. Demain, les entreprises devront tracer ce qui a été fait. Nous disposons déjà d'outils qui permettent d'analyser l'activité d'une entreprise ; on peut produire un chiffre d'affaires par personne, par véhicule… En réalité, l'assurance maladie – qui connaît les standards professionnels – dispose déjà des outils de requête et de télétransmission pertinents qui lui permettraient d'observer et de détecter la fraude. En revanche, pour les taxis, seul le montant de la course est communiqué à l'assurance maladie, sans détail.

Nous constatons qu'il existe, entre les entreprises que vous représentez et les taxis, une sorte de compétition sur le transport de patients. Je note que vous appelez à une évaluation du service médical rendu et à la mise en place de dispositifs de géolocalisation analogues à ceux des véhicules de transports sanitaires pour les taxis. Avez-vous d'autres demandes à formuler ?
Nous demandons un conventionnement unique pour assurer une égalité entre tous les acteurs. L'ouverture des VSL au secteur médico-social soulève une difficulté juridique, puisque ces véhicules ne peuvent être utilisés que sur prescription médicale. Il va donc bien falloir poser la question du statut juridique de ces véhicules. Nous réclamons depuis longtemps la séparation de l'activité ambulances et de l'activité TAP. Celle-ci doit être pratiquée avec des obligations conventionnelles, un tarif conventionnel unique et des normes sanitaires qui s'appliquent à tous. Aujourd'hui, un patient peut monter dans un taxi qui vient de transporter un client accompagné d'un animal, par exemple. Si l'on souhaite aller vers le déplacement de personnes à vocation de santé, on peut se permettre un abaissement des normes sanitaires ; si l'on veut aller vers des véhicules sanitaires réservés au transport de patients, c'est une autre approche et une autre organisation qu'il faut mettre en oeuvre. Depuis quinze ans, nous sommes confrontés à cet obstacle. Mais la profession manque aujourd'hui tellement de perspectives qu'elle est assez ouverte à la discussion.
Nous luttons bien sûr contre la fraude. Cette lutte recouvre deux aspects : la dématérialisation de la prescription, qui est en cours, et la traçabilité des missions. Peu d'entreprises rurales ont acquis un système de géolocalisation ; elles considèrent qu'il ne s'agit pas d'un acte de « production » pour elles. Cela a un coût, mais ne leur apporte rien à première vue. Il faudra donc les sensibiliser à l'importance de cet élément, peut-être par une aide financière.
Il est symbolique. Et nous venons de signer un accord avec l'assurance maladie sur le sujet.
Je n'ai pas les chiffres précis, mais je vous les transmettrai. Près de 80 % des véhicules sont équipés.
En ce qui concerne les taxis, une tentative d'harmonisation a eu lieu à travers les travaux conduits en 1998. Malheureusement, la pression des taxis n'a pas permis d'aller plus loin. Nous étions pourtant d'accord sur une harmonisation des contraintes, un contingentement des véhicules et une convention unique. Tous ces travaux ont donc déjà eu lieu en amont. Pourquoi ne pas les reprendre ? Dans les faits, l'expérience montre que c'est souvent le plus fort qui gagne…
Je rejoins mes collègues. La profession est attentive à tout ce qui est susceptible d'être mis en place.
Pour ce qui est des appels d'offres, il me semble qu'il faudrait commencer par mettre en place, au sein des structures hospitalières, des plateformes de régulation centralisées. Compte tenu de la dispersion des prescriptions dans les hôpitaux, nous sommes aujourd'hui appelés par les différents services, sans aucune régulation centralisée.
Nous n'avons pas évoqué les coordonnateurs ambulanciers, qui jouent un rôle très important dans notre profession. Ils connaissent la région, les ambulanciers, le paysage, ce qui peut être un élément important pour le covoiturage, et aussi le tour de rôle – que les ambulanciers ont la possibilité de vérifier. Il est impératif d'en passer par là avant d'en arriver aux appels d'offres.
Nous avons cité des petites entreprises qui ne respectent pas la réglementation. Permettez-moi de dire que les véhicules sont obligés de la respecter, puisqu'ils sont contrôlés par les ARS.

Certes, mais les capacités de contrôle des ARS sont quelque peu aléatoires, et force est de reconnaître que, sur le transport de patients, elles n'ont pas les moyens d'exercer ce contrôle dans les faits.
Les entreprises qui mettent spontanément en place une démarche qualité – par la certification par exemple – ne sont pas reconnues, même dans les appels d'offres. La vraie problématique à poser est aujourd'hui la suivante : quel est le service rendu à la chaîne de soins et au patient ? Il n'existe aucune analyse, y compris à la Haute Autorité de santé (HAS), qui n'édicte aucune préconisation en matière de transport de patients, alors que les normes de certification de services ou ISO permettent de régler un certain nombre de problèmes. Une entreprise qui s'engage dans cette voie doit donc être reconnue.

Je vous remercie pour l'ensemble des informations que vous nous avez fournies. N'hésitez pas à nous transmettre toutes précisions écrites qui pourraient nous permettre d'avancer sur ce sujet qui n'a pas fait l'objet de toute l'attention qu'il méritait de la part des autorités de tutelle.
La MECSS procède ensuite à l'audition, ouverte à la presse, de M. Gérard Gabet, président de la Fédération française des taxis de province (FFTP), et M. Tony Bordenave, secrétaire général, de M. Jean-Claude Richard, président de la Fédération nationale des artisans du taxi (FNAT), de M. Didier Hogrel, président de la Fédération nationale du taxi (FNDT), et Mme Frédérique Paillard, vice-présidente, responsable de la commission CPAM, de Mme Armelle Lamblin et M. Gregorio Roberti, membres de la commission affaires sociales de la Fédération nationale des taxis indépendants (FNTI), et de M. Alain Griset, président de l'Union nationale des taxis.

L'offre de transport de patients souffre d'une gouvernance éclatée entre le ministère de la santé et le ministère de l'intérieur – dont dépendent les taxis que vous représentez, mesdames et messieurs, de sorte que les différents transporteurs ne sont pas soumis au même cadre réglementaire. En outre, la complexité du transport de patients varie selon que celui-ci s'effectue en ambulance, en VSL, en véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) ou en taxi conventionné.
Concentrée sur cinq pathologies, la prescription de transport émane à 63 % environ des établissements de soins. Elle est en revanche extrêmement dispersée et hétérogène selon les territoires, dont le maillage est censé répondre aux besoins variés de nos concitoyens.
L'objectif de la MECSS, structure parlementaire paritaire, est de s'en assurer, comme plus généralement de la rationalisation des moyens financiers, techniques et humains dévolus au transport de patients. La situation budgétaire de la nation l'exige, et c'est notre coeur de métier que de rechercher le meilleur rapport coût-efficacité en matière de protection sanitaire et sociale, dans l'intérêt de nos concitoyens.
L'évolution des dépenses de transport varie selon le mode de transport utilisé : en forte augmentation pour les ambulances et les taxis, elles stagnent s'agissant des VSL. Quel est votre sentiment à ce sujet ?
Selon la Cour des comptes, quelque 450 millions d'euros pourraient être économisés sur ces dépenses, essentiellement par trois moyens. D'abord, un meilleur respect du référentiel de prescription, puisque le mode de transport doit dépendre de motifs médicaux et non du bon vouloir du patient. Rappelons que le code de la sécurité sociale pose le principe du trajet et du mode de transport le moins onéreux, ainsi que la règle de l'établissement le plus proche, et que le libre choix du transporteur n'a qu'une valeur conventionnelle, à la différence du principe de libre choix du praticien d'ordre législatif. La deuxième source d'économies est l'amélioration de la garde ambulancière, qui ne correspond pas à votre coeur de métier. La troisième résiderait dans le contrôle de la facturation. Que pensez-vous de ces préconisations, ainsi que de celles qui ont pu être formulées par ailleurs en la matière, notamment dans le rapport de M. Didier Eyssartier ?
À nos yeux, il ne serait pas réaliste d'espérer réduire l'enveloppe allouée au transport de patients au cours des mois et des années à venir. Mieux vaut s'intéresser à ce que le transport peut faire gagner globalement à la sécurité sociale en cas d'hospitalisation. Car, si l'on cherche, comme le rappelle la Cour des comptes, à développer l'ambulatoire, pour réaliser des économies importantes s'agissant des frais d'hospitalisation, cela impliquera l'augmentation du volume de transports. Au lieu d'isoler cette ligne de dépenses, voyons donc les économies supplémentaires qu'elle permet de réaliser sur d'autres postes.
Ensuite, il faut effectivement étudier de plus près l'offre de transports. Beaucoup d'autorisations de stationnement – qui donnent le droit de mettre en service un taxi sur la voie publique – ont été délivrées depuis une dizaine d'années, dans des communes où le transport de malades assis représente 90 % à 95 % de l'activité de ces professionnels. Aujourd'hui, en vertu d'une décision de la CNAMTS, un taxi doit être exploité depuis deux ans pour être conventionné ; il l'est alors automatiquement. Selon le rapport de la mission de concertation Taxis-VTC conduite par M. Thomas Thévenoud, le conventionnement ne devrait plus être automatique, mais déterminé par les besoins du territoire. Nous considérons pour notre part que le délai de deux ans pourrait être prolongé, par exemple jusqu'à cinq ans, afin d'éviter les effets d'aubaine.
J'en viens à un problème récurrent qu'ont successivement abordé les lois de financement de la sécurité sociale pour 2013 et pour 2014, en permettant d'expérimenter la passation d'appels d'offres, puis la création de plateformes de coordination – non sans susciter quelque émoi au sein de la profession. Aucun des décrets d'application de ces dispositions n'est paru à ce jour. Si l'on peut comprendre que l'on cherche à améliorer le parcours de soins du patient, toutes les expérimentations menées jusqu'à présent, en particulier en Poitou-Charentes, montrent que ces outils ne permettent pas d'assurer un juste équilibre entre les professionnels du secteur. Si la CNAMTS souhaite développer ces plateformes, il convient d'en encadrer le fonctionnement afin d'éviter qu'elles ne soient réservées à quelques professionnels au nom d'intérêts purement individuels, comme c'est, hélas, le cas actuellement.
Je songe en particulier au département de la Charente, où, il y a quelques années, anticipant les évolutions législatives, la caisse primaire d'assurance maladie a souhaité installer une plateforme d'orientation des patients, organisée par les professionnels du transport sanitaire eux-mêmes. En réalité, un seul professionnel a décidé de créer la plateforme et celle-ci oriente presque exclusivement les patients des hôpitaux vers quelques transporteurs.
Du préfet, non ; quant à l'ARS, en Poitou-Charentes, elle a très peu travaillé sur le sujet, préférant laisser les professionnels s'organiser.
Il ne l'a pas été du tout. Le nouveau préfet a un peu repris les choses en main en demandant à l'ARS de revoir le dispositif. Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, celui-ci ne fonctionne pas ; il ne devrait donc pas être étendu.

Vous faites allusion à une atteinte au principe de libre concurrence, principe reconnu par le Conseil constitutionnel sur le fondement de la liberté d'entreprise. En avez-vous saisi l'Autorité de la concurrence ?
Non. Nous avons commencé par solliciter le préfet pour qu'il demande au directeur général de l'ARS de remettre ce fonctionnement en cause. Cela a été fait il y a peu : le nouveau directeur général, récemment nommé, a organisé une réunion à ce sujet la semaine dernière. Si la situation ne change pas, nous saisirons l'Autorité de la concurrence.

Cette situation, qui s'apparente à une entente de marché, fait-elle également l'objet de procédures judiciaires ? En d'autres termes, y a-t-il eu dépôt de plaintes ?
Pour l'instant aucune plainte formelle n'a été formulée, car la démarche en est à ses débuts et, sur place, la profession a privilégié la concertation. Mais, naturellement, cette éventualité peut être envisagée.
En ce qui concerne le libre choix du transporteur, j'ai entendu vos arguments ; toutefois, nombre de nos patients, surtout les plus fragiles, souhaitent pouvoir bénéficier du même transporteur aussi bien au retour qu'à l'aller. Dans le cadre des expérimentations qui ont été menées, en particulier en Charente, l'une des demandes de la profession tendait donc à leur laisser ce choix.

N'oublions pas que ce principe n'est pas inscrit en tant que tel dans le code de la sécurité sociale, de sorte que sa valeur n'est ni législative ni réglementaire, mais uniquement conventionnelle.
Certes, mais les patients auxquels nous avons affaire sont souvent dans une situation difficile.

Je connais le sujet : je suis médecin. Il faut évidemment tenir compte de la situation de précarité dans laquelle la maladie les place, mais sans renoncer à rationaliser le dispositif. Le terme d'économies n'a rien d'un gros mot. À cet égard, vous avez d'ailleurs eu tout à fait raison de vous placer dans la perspective globale de la permanence des soins et du parcours de soins, au sein duquel une dépense peut être source d'économies ailleurs – à condition, toutefois, d'assurer une coordination qui fait aujourd'hui défaut, d'où les problèmes de délais d'attente, de libération des patients à des tranches horaires très concentrées, etc. Cela dit, il n'est pas interdit d'espérer dégager des marges de manoeuvre sur la seule ligne du transport de patients.
Dans l'Eure, où je préside la Fédération des taxis indépendants, nous sommes confrontés au même type de problèmes. Certes, les dépenses de transport en taxi augmentent alors que les dépenses de transport en VSL stagnent. Mais il convient de préciser que, dans nos départements, les sociétés d'ambulances créent de plus en plus de taxis pour compenser le manque de profitabilité des VSL.

Les représentants des fédérations d'ambulances ont eu quelque difficulté à nous indiquer le nombre d'entreprises qui se sont ainsi enrichies d'une flotte de taxis. De fait, dans la comptabilité globale du parc – quelque 37 000 taxis sont conventionnés –, nous peinons à distinguer l'activité relevant du métier d'artisan taxi, dans sa polyvalence, de celle d'entreprises de transport sanitaire qui complètent leur offre pour rendre l'exercice plus rentable. Pourriez-vous nous fournir des chiffres précis ?
Dans les Alpes-de-Haute-Provence, par exemple, plus de 40 % des autorisations de stationnement de taxis sont détenues par les sociétés d'ambulances. C'est énorme. Ces entreprises de transport sanitaire deviennent de fait des entreprises mixtes. Dans de nombreux départements, dont l'Eure où je travaille également, ce sont majoritairement les sociétés d'ambulances qui demandent des autorisations de stationnement de taxis aux commissions départementales, et ce afin de pouvoir proposer, au bout de deux ans en théorie, du transport de patient assis, à distinguer du transport sanitaire. Cela nous pose un problème. Nous avons donc demandé à la CNAMTS et aux CPAM des départements de nous indiquer la répartition précise des autorisations de stationnement conventionné entre les entreprises de transport sanitaire et les autres.
Il est exact que les dépenses de transports en VSL sont stables, et pour cause : le nombre de ces véhicules est contrôlé par l'ARS. En revanche, depuis le 1er juin 2008, un taxi peut être conventionné automatiquement au bout de deux ans d'exercice. La profession dénonce cette disposition et souhaite sinon prolonger ce délai, du moins adapter l'offre à la demande, ainsi qu'à l'enveloppe budgétaire des CPAM, puisque la progression des dépenses de transport dépasse celle fixée par l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM).
Précisons que la demande de transports se développe davantage dans certains départements qui comptent un peu plus de retraités que d'autres. Cette hausse de la demande résulte notamment de l'augmentation du nombre de patients soignés en oncologie. L'éloignement des structures de soins adaptées oblige à de longs trajets : lorsqu'ils résident dans l'Eure, ces patients doivent aller se faire soigner dans le département voisin de Seine-Maritime, distant d'une soixantaine de kilomètres, ou en région parisienne.
L'indéniable augmentation des dépenses de transport en taxi par rapport aux dépenses de transport en VSL est donc liée au comportement des entreprises de transport sanitaire, d'une part, à la forte hausse de la demande couplée au manque de structures de soins dans de nombreux départements, d'autre part.

Pour remédier au premier de ces problèmes, faut-il, selon vous, suivre la Cour des comptes lorsqu'elle propose de substituer, dans chaque département, au plafond global de VSL et d'ambulances un double plafonnement, l'un pour les ambulances, l'autre commun aux VSL et aux taxis conventionnés ?
Plutôt que fixer un objectif au niveau national, il faut tenir compte de la situation départementale ou régionale, très variable. À l'intérieur même d'un département, certains cantons se distinguent – malheureusement – des autres par un plus grand nombre de patients soignés en oncologie. Les CPAM semblent donc les mieux placées pour décider, en commission paritaire avec les taxis, du nombre de véhicules qui doivent être mis en service. Je parlerais donc moins de plafonnement que d'adaptation.

Vous suggérez de considérer les transports assis professionnalisés de manière globale et d'appliquer les mêmes règles à tous les transporteurs. Cela n'implique-t-il pas également des règles communes en matière de covoiturage ou de géolocalisation, comme le préconisent certains rapports ?
Rappelons d'abord que, dans la majorité des départements, ce ne sont pas les commissions départementales qui délivrent les autorisations de stationnement, mais les maires, hélas sans toujours tenir compte des avis de la commission et encore moins de celui de la CPAM. Dès lors, il est tout à fait possible, dans de petites communes, d'obtenir la création d'un taxi parce que l'on est ami avec le maire.
Dans mon département, le nombre de taxis est passé de 160 véhicules en 1991 à près de 400 aujourd'hui ! Dans la plupart des cas, le transport de malades assis est leur seule activité, et 40 % d'entre eux appartiennent à des sociétés d'ambulances.
Des règles communes à l'activité de transport assis professionnalisé : pourquoi pas ? Nous y travaillons ensemble. Mais quel type de règles adopter ? Jusqu'où aller ? Jusqu'où l'État, en particulier, va-t-il aller ? Membres d'une profession artisanale et indépendante, nous tenons à notre liberté d'action. N'oublions pas non plus que le taxi transporte des malades assis depuis 1914, avant même les VSL.
Mais nous aimerions pouvoir aussi pratiquer le transport partagé, qui nous est désormais interdit en Seine-Maritime alors qu'il permet aux caisses d'assurance maladie de réaliser des économies, étant entendu qu'il doit être réservé à certaines situations : tout à fait envisageable en hospitalisation de jour, il est en revanche inadapté à un patient qui vient d'être soigné pour un cancer.
S'il faut assurément réglementer l'activité, nous ne sommes pas favorables à un contrôle systématique. Les taxis font du TAP et complètent l'offre de transport de malades assis, mais aussi des courses classiques.

Vous demandez que les maires tiennent compte de l'avis des CPAM pour délivrer les autorisations : ne craignez-vous pas, justement, les critères médicaux qui s'imposeraient alors à vous ?
Nous souhaitons l'installation d'une commission nationale, qui définirait une sorte de charte destinée aux prestataires de TAP.
Oui et non : tout dépend de son prix. Nous venons de dépenser des sommes exorbitantes – 2 300 euros par taxi en moyenne – pour installer les nouvelles enseignes lumineuses, nous ne souhaitons pas nous équiper d'autres matériels aussi onéreux dans l'immédiat. Nous voulons améliorer notre technique et notre capacité de travail, mais aussi préserver l'économie de nos entreprises.

Mais vous n'êtes pas opposés par principe à la géolocalisation, abstraction faite de ces considérations économiques ?
Des économies doivent être réalisées, c'est entendu. Mais l'offre crée la demande. Or ce sont les maires qui ont distribué les licences sans discernement, sans jamais écouter les représentants de la profession. Interrogés, les demandeurs de ces autorisations annoncent pourtant qu'ils ne feront que du transport de malades assis. Les ambulanciers s'installent et le maire, bien souvent contre l'avis de la commission, délivre les autorisations de stationnement. Dans une commune de mon département, la Marne, il y a quatre licences de taxi pour 300 habitants ! Les maires commencent à se rendre compte qu'ils ont créé une situation difficile à maîtriser. Maintenant l'assurance maladie nous demande de faire des ristournes alors que, presque partout, c'est des maires, et d'eux seuls, qu'a dépendu la décision.
L'assurance maladie a posé la limite des deux ans avant d'obtenir le conventionnement, que l'on envisage de porter à cinq ans. Mais les grandes sociétés d'ambulances qui disposent de nombreux taxis peuvent mettre un véhicule en sourdine pendant deux ans, le temps qu'il soit conventionné ; ce n'est pas le cas de l'artisan qui s'installe tout seul et qui est bien obligé de travailler.
Les maires ont inondé la France de taxis : qu'ils prennent leurs responsabilités ! J'aimerais que ce soit dit dans votre rapport.
En effet, les commissions départementales sont consultatives et non délibératives, notamment dans les communes de moins de 20 000 habitants, et les maires sont libres de leur choix. Nous nous heurtons ici à une pression politique, surtout en période pré-électorale. Une disposition législative va permettre de transférer au président de l'établissement public de coopération intercommunale les pouvoirs de police du maire en la matière. C'est une première étape. Mais nous aurions aimé que la décision appartienne au préfet ; or, politiquement, nous n'avons pas été suivis. On pourrait toutefois résoudre le problème par un moyen plus indirect, en agissant sur le conventionnement plutôt que sur l'attribution d'autorisations de stationnement : les demandeurs se décourageront s'ils savent par avance que le conventionnement ne sera pas systématique.
Il est évidemment difficile d'interdire par la loi aux entreprises de transport sanitaire de posséder un parc taxis, mais il faudrait tenter de séparer les activités. Sachez d'ailleurs que les autorisations de stationnement détenues par des entreprises de transport sanitaire ne sont pas utilisées conformément à la loi. Je songe à une petite commune de l'Eure où cinq autorisations de stationnement ont été délivrées, dont quatre à des transporteurs sanitaires. Le soir après dix-huit heures et le week-end, aucun de ces quatre taxis n'est disponible pour la clientèle, alors que la loi impose l'exploitation effective et continue de l'autorisation. Les clients ne bénéficient donc pas du service qu'ils sont en droit d'attendre. Au demeurant, c'est ainsi que l'on a un temps contourné l'ancien numerus clausus sur les VSL.
Comme nous l'avons expliqué au directeur de cabinet du ministère de l'intérieur lorsqu'il nous a reçus en janvier 2013, des taxis sont nécessaires pour suppléer les grandes entreprises de transport sanitaire, qui s'installent toujours à proximité des grosses structures de soins pour rentabiliser leur activité. Les VSL n'étant payés qu'en charge, ces entreprises préfèrent les aller-retour, les lignes directes, aux transversales, de sorte qu'elles ne desservent pas volontiers les lieux reculés. Il faut pourtant bien que chaque citoyen puisse accéder aux soins si son état de santé l'exige. Mais ces sociétés refusent des courses qui ne sont pas rentables pour elles. Ainsi, dans l'Eure, un patient qui sollicite le dimanche après-midi une grosse entreprise de transport sanitaire pour se faire hospitaliser à Paris n'obtiendra aucune réponse.
Ce ne sont pas d'abord les artisans taxis, les très petites entreprises, qui ont favorisé la hausse de la dépense ou qui en ont profité : ce sont les entreprises de transport sanitaire, en utilisant la possibilité qui leur était offerte de compléter leur parc. Voilà pourquoi on pourrait freiner l'expansion en mettant fin à la systématicité du conventionnement – M. Thomas Thévenoud l'a très bien compris – pour adapter les décisions à la situation locale, sans imposer, je le répète, un objectif national.
Il y a eu une époque où beaucoup de sociétés d'ambulances ont transformé leurs agréments de VSL en autorisations de mise en service d'ambulances, puis ont demandé des autorisations de stationnement pour exploiter des taxis.
Dans mon département du Var, la préfecture se fonde sur un tableau des indices d'activité économique pour délivrer les autorisations de stationnement, sachant que la décision appartient ensuite au maire. Pourquoi les CPAM ne se serviraient-elles pas du même outil au sein des commissions départementales ? Le conventionnement serait accordé en fonction des besoins, sans durée préalable d'exploitation.
Cela permettrait également de limiter la spéculation sur les licences de taxi, qui atteignent des prix délirants.
Dans les Alpes-Maritimes, la dernière qui ait été vendue s'est négociée autour de 400 000 euros !
En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la population est aisée.
En milieu rural, une licence de taxi se négociait 50 000 euros à 60 000 euros il y a quelques années, contre 120 000 euros à 150 000 euros aujourd'hui. C'est, entre autres, le conventionnement qui lui confère une telle valeur.
Pourquoi ne pas miser aussi sur le transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) ? Ce domaine a connu des dérives : les véhicules TPMR ont été ajoutés aux parcs existants, surtout à ceux d'entreprises d'ambulances ; en réalité, ils servaient à tout sauf à transporter des personnes en fauteuil roulant et, chez nous, l'affaire s'est terminée au tribunal administratif. Aujourd'hui, ce mode de transport intermédiaire entre le transport assis et le transport couché, plus confortable pour le patient qui reste sur son fauteuil tout au long de la prise en charge, plus onéreux qu'une course en TAP mais moins coûteux que le transport en ambulance, pourrait intéresser de nombreux professionnels des TAP. Il faudrait négocier le tarif, car l'investissement à consentir est plus élevé que pour un simple taxi.
S'agissant des temps d'attente, nous sommes témoins de situations inadmissibles. Comment se fait-il que les patients que nous accompagnons dans des centres hospitaliers publics, où les médecins sont salariés de l'État, ne soient reçus qu'à neuf heures alors qu'ils sont convoqués à huit heures ? Ce fonctionnement coûte de l'argent à la sécurité sociale – même si le coût des temps d'immobilisation du véhicule est plafonné – et désorganise nos plannings.

Ce sont donc non seulement la géolocalisation et le covoiturage qu'il paraîtrait logique de généraliser si l'on veut traiter tous les professionnels de manière équitable et les soumettre à une autorité et à des règles communes, mais aussi la gestion rationnelle du parcours de soins en vue de limiter les temps d'attente, qui a d'ailleurs pour corollaire l'organisation de l'espace afin d'éviter des files interminables.
Vous nous demandiez tout à l'heure des chiffres précis. On observe couramment, à la campagne, des entreprises de transport sanitaire acheter plus de 100 000 euros des autorisations de stationnement de taxis, sans clientèle, ou presque, ni numéro de téléphone : pour ce prix, elles n'acquièrent que le droit d'utiliser le taxi, afin de pallier leur manque de véhicules.
Au titulaire de l'autorisation de stationnement.
Nous constatons et déplorons le transfert des autorisations vers les entreprises de transport sanitaire. Mais allons plus loin : pourquoi ce phénomène ? Parce que la rentabilité d'un VSL n'est plus assurée. Les transports en ambulance représentent aujourd'hui 33 % des transports de patients, ambulances et TAP confondus ; cette part est en baisse. Auparavant, les bénéfices réalisés grâce aux ambulances compensaient les pertes dues au transport en VSL. Désormais, à 85 centimes d'euros le tarif kilométrique, plus le forfait, l'exploitation des VSL n'est plus rentable. Si l'on créait aujourd'hui une entreprise disposant de dix VSL, elle ne pourrait atteindre l'équilibre. Or le tarif des taxis est parfois moindre que celui des VSL, mais souvent plus élevé. C'est donc par l'acquisition d'autorisations de stationnement que les sociétés d'ambulances cherchent à obtenir une compensation économique, en bénéficiant de la facturation applicable aux taxis. Ne vaudrait-il donc pas mieux leur délivrer des autorisations de véhicules sanitaires légers supplémentaires ? Après tout, c'est bien de transport « sanitaire » dont il est question.

Vous souhaitez en somme que le secteur soit harmonisé et que le système qui conduit à mettre des véhicules sur le marché sans justification, de manière artificielle, soit revu. Reste à savoir si les pratiques de conditionnement du marché par certaines plateformes, que vous avez évoquées, sont des cas isolés.
S'agissant de la facturation, dont le contrôle fait partie des sources d'économies identifiées par la Cour des comptes, votre profession compte – comme toutes les autres – des moutons noirs dont les pratiques dans ce domaine ont pu entacher son honneur. Il convient de faire le tri pour s'assurer que les moyens financiers et humains employés servent bien l'objectif initial.
Vous l'avez compris, les conséquences de la différence de facturation entre ambulances et taxis sont un véritable fléau pour notre profession.
Je suis présidente de la fédération du taxi de l'Yonne. Ce département est aux mains d'un seul ambulancier qui y gère les transports de patients à sa guise ; il a racheté toutes les entreprises de transport sanitaire existantes, il acquiert toutes les licences de taxi disponibles. Je connais bien son fonctionnement pour avoir travaillé chez lui.
Le mode de facturation est totalement obsolète : nous sommes plus chers en cas d'hospitalisation et en sortie ; dès qu'un ambulancier dispose d'une flotte suffisante, il facture donc en taxi les trajets pour hospitalisation et en VSL les trajets pour consultation. De notre côté, les facturations sont très claires. J'ai déjà fait l'objet de deux contrôles de la sécurité sociale dont je suis sortie blanchie, fort heureusement.
Nous avons demandé au ministère de la santé des chiffres concernant les dépenses de transport des artisans taxis et celles des ambulanciers, selon que ceux-ci mobilisent des taxis ou des VSL. Aujourd'hui, la CNAMTS n'est pas en mesure de nous fournir ces informations.

La situation dont vous faites état n'a rien d'anecdotique : il ne s'agit de rien de moins qu'une organisation de marché, contraire au cadre législatif et réglementaire comme aux valeurs de la République, doublée d'un détournement de fonds publics, fonds qui étaient en l'occurrence destinés à soulager la souffrance des malades. Et ce, semble-t-il, dans la plus grande indifférence des autorités de tutelle – les ARS, les préfectures, les CPAM –, voire des autorités judiciaires. Cela laisse perplexe. Qui en est responsable ? Chacun des acteurs incrimine les autres.
Cela confirme la nécessité d'instaurer des règles communes et transparentes, notamment en matière tarifaire, et d'en contrôler l'application. Il convient toutefois de distinguer le service rendu, et les véhicules utilisés, en fonction des besoins du patient et l'équipement médical qu'ils supposent. La médicalisation du véhicule est inutile lorsque le patient se rend à une consultation ou va se soumettre à des examens simples. Les VSL ne transportent que des patients, alors que les taxis transportent aussi des clients. Cette diversité est-elle compatible avec les exigences médicales et leurs conséquences techniques ? Les conditions d'hygiène requises sont-elles toujours réunies ? On nous a parlé de transport d'animaux dans des taxis susceptibles d'accueillir des malades. Qu'en pensez-vous ?
J'ai géré une flotte de véhicules pour le compte de la société d'ambulances à laquelle j'ai fait allusion, et je m'occupais des désinfections. Les VSL n'ont jamais été désinfectés. De plus, les VSL assuraient un service de taxi payant, ce qui est formellement interdit par la loi.
Voilà la situation : les deux professions s'affrontent, alors qu'elles ne devraient pas être en concurrence.
Les LOTI – du nom de la loi d'organisation des transports intérieurs de 1982 –, c'est-à-dire les véhicules légers de transport de personnes, sont un autre fléau. Ils font du transport de malades assis.
L'ambulancier auquel j'ai fait référence est régulièrement contrôlé par la sécurité sociale et frappé tous les six mois d'une amende de 200 000 euros pour fraude. Il y a six mois, il a refusé de payer. J'ai protesté auprès de la sécurité sociale dans mon département, où les sanctions sont rares. On contrôle les artisans taxis qui sont seuls, tandis que cette entreprise qui emploie 187 personnes, ne fait l'objet d'aucune vérification ! Il y a vraiment un problème en France. Je me battrai jusqu'au bout pour défendre les artisans taxis. La fraude existe dans notre profession, comme dans toutes les autres. Mais il faut que les sanctions tombent. Des fraudes, j'en observe tous les jours. Cela ne peut plus durer !

Cette organisation monopolistique qui évoque des pratiques mafieuses, puisqu'elle régit un marché irrigué par l'argent public, est proprement intolérable. Au-delà des cas particuliers que vous citez, avez-vous une vision d'ensemble de ces infractions et de leur répartition sur le territoire ?

Vos fédérations ne se sont-elles pas organisées pour combattre et faire sanctionner ces atteintes au principe de libre concurrence et à la réglementation en vigueur ?
Face à l'administration, il est toujours difficile d'expliquer des faits. Certains de mes collègues ont monté des dossiers. Moi aussi, à propos d'un artisan taxi de mon département. Rien n'y a fait. La sécurité sociale a été prévenue, de même que le préfet et les gendarmes ; des dossiers sont arrivés en conseil de discipline ; et pourtant, les intéressés continuent d'exercer. Ils doivent être écartés de la profession, car leurs pratiques illégales, inadmissibles, nuisent à l'image des artisans respectueux de la loi.
On dit que les taxis exagèrent en matière de transport de malades assis. Mais nous ne pouvons pas abuser du système puisque ce n'est pas nous qui sommes prescripteurs, ce sont les médecins et les établissements hospitaliers.
Des sociétés d'ambulances, notamment dans le Midi, ont été sanctionnées pour avoir facturé au tarif ambulance des dialyses effectuées en VSL. Dans ce cas, c'est l'ambulancier qui est sanctionné, alors que le médecin, responsable de la prescription, n'encourt aucune amende. Ce n'est pas admissible. Je ne défends pas les ambulanciers, qui ont leur part de responsabilité. Mais les CPAM et les préfectures doivent agir. Des conseils de discipline existent. Il faut sanctionner le non-respect des règles.

Vous êtes donc favorable à des poursuites non seulement administratives, mais aussi au pénal.
Elle se monte à 60 %. Titulaire d'une licence de transport intérieur, je transporte donc aussi des colis – essentiellement la presse –, et j'ai réduit mon activité de transport de malades assis.
Non : dans mon département, la proportion est de 95 % à 98 %.

Le transport de patients, nous a-t-on dit, rapporterait en moyenne 30 000 euros par an à un taxi. Est-ce bien cela ?
En Haute-Normandie, la moyenne est de 38 000 euros.
Je le répète, les entreprises de transport sanitaire s'implantent là où leur activité peut être pérenne ; ce n'est pas le cas dans nos nombreux départements ruraux, dans de petites communes de 1 000 habitants ou 1 500 habitants. Pour garantir à tous nos concitoyens l'accès aux soins, une offre complémentaire doit exister. C'est là que nous, taxis, intervenons. Voilà pourquoi le TAP représente plus de 50 % de notre chiffre d'affaires. Nous assurons le lien social, nous transportons les personnes âgées, nous rendons service aux habitants des petites communes, mais le chiffre d'affaires que nous réalisons ainsi ne nous permet pas de pérenniser notre activité. Le TAP est donc très important pour nos entreprises, soyez-en convaincus. Les entreprises de transport sanitaire, elles, ne sont pas intéressées par les trajets transversaux, par la desserte de petites communes reculées, qui ne sont pas rentables pour elles. Je le répète, nous sommes donc complémentaires.
Dans ce contexte, voici nos propositions.
Premièrement, nous pourrions faire du transport partagé, limité à trois passagers, en facturant la course au taximètre, sans remise, et en répartissant le coût entre les assurés transportés. La loi serait respectée et les caisses d'assurance maladie feraient des économies.
Deuxièmement, nous pourrions, comme le suggérait ma collègue, utiliser des véhicules équipés pour transporter des personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant électrique – nous le faisons déjà quotidiennement pour les personnes en fauteuil pliant. À l'heure actuelle, les médecins sont obligés de prescrire à ces personnes un transport en ambulance, qui coûte trois fois plus cher qu'un trajet en taxi. Certes, l'enveloppe budgétaire allouée aux TAP augmenterait, mais l'enveloppe globale des transports de patients serait réduite.

Vos entreprises ont-elles mis en oeuvre des contrats ayant pour objet d'améliorer la coordination et la qualité des soins (CAQS) ?
Par ailleurs, la dématérialisation de la prescription et de la facturation vous paraît-elle opérationnelle ?
Nous sommes engagés dans une procédure de concertation avec la CNAMTS au sujet du logiciel d'aide à la prise en charge « PEC + TIRAT » et de ses évolutions, notamment la prescription médicale de transport dématérialisée. Le problème est notamment que les caisses d'assurance maladie ne pourront obliger les médecins prescripteurs à se doter des équipements nécessaires à celle-ci.

Nous sommes conscients du problème. M. Frédéric Van Roekeghem a d'ailleurs suggéré, lorsque nous l'avons auditionné, que la prescription dématérialisée serait expérimentée en ville, où l'informatisation est entrée dans les moeurs, avant de l'être à l'hôpital où l'évolution est plus laborieuse, ne serait-ce qu'en raison des problèmes d'identification individuelle de la prescription.
Par ailleurs, on pourrait prendre modèle sur les structures de soins les mieux organisées – je songe notamment à certains établissements parisiens –, qui parviennent par exemple à regrouper au cours d'une même matinée les consultations d'anesthésie et de chirurgie préalables à une intervention chirurgicale en oncologie. On éviterait ainsi de multiplier des trajets longs et coûteux dans les nombreux départements où il faut parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour rejoindre une structure adaptée.
Ne pourrait-on également obliger les entreprises de transport sanitaire, qui sont parfois tentées d'utiliser le type de véhicule le plus propre à assurer leur équilibre financier, à facturer au moins coûtant comme l'impose le code de la sécurité sociale ?
Je songe par exemple à un cas où le prescripteur opte pour un VSL plutôt que pour un taxi, alors qu'il n'a le droit de sélectionner que le TAP, sans distinction entre ces deux types de véhicule.
Le but de votre mission, monsieur le président, est d'économiser.
Mieux vaut, en effet, parler de rationalisation du système, dès lors que le budget du transport de patients ne peut qu'augmenter, du fait des progrès qui prolongent l'espérance de vie, du vieillissement de la population et du regroupement des centres de soins.

Rationalisation et économies se tiennent. Si notre pays était correctement géré, il n'aurait pas de tels déficits.
Comme chefs d'entreprise, nous ne pouvons qu'être d'accord avec vous !
Vous l'avez compris, le coût du transport et ses dérives résultent de la mixité de certaines professions plutôt que d'une profession proprement dite.
Nous, taxis, souhaitons être représentés au sein des ARS. Peut-être pourriez-vous relayer cette demande dans vos préconisations. Nous aurions ainsi accès à des chiffres qui nous font aujourd'hui défaut et pourrions prendre la mesure des dérives, au-delà des cas ponctuels. En la matière, notre fédération soupçonne que l'opacité est intentionnelle : les CPAM connaissent sans doute ces chiffres par l'intermédiaire des entreprises mixtes, et pourraient nous les donner si elles le voulaient, puisque le code APE d'activité principale attribué par l'INSEE aux sociétés d'ambulances n'est pas le même que celui des entreprises de taxi.

La mise en oeuvre de l'article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, sur l'expérimentation de procédures d'appels d'offres, suppose elle aussi la transparence. De ce point de vue, les contrats d'amélioration de la qualité des soins (CAQS) présentent un intérêt méthodologique. La généralisation de ces expérimentations serait propice à l'uniformisation des règles et des pratiques, sous la tutelle d'une autorité commune et collégiale. Qu'en pensez-vous ?
Quant à la dématérialisation, indépendamment des problèmes qu'elle pose aux prescripteurs, êtes-vous équipés, vous, transporteurs ?
La dématérialisation n'a pas été expérimentée dans mon département. Mais je sais que le logiciel « PEC+TIRAT » fonctionne très bien : grâce à lui, les taxis disposent des données relatives aux assurés à jour de leurs droits.
Non. Le dispositif est encore en phase expérimentale. Selon un agent de la sécurité sociale avec lequel je me suis entretenue récemment, la dématérialisation est en cours dans les pharmacies, chez les opticiens, chez certains dentistes, mais elle n'est pas totale : il existe encore des supports papier.
En ce qui concerne la géolocalisation, elle présente des avantages, mais aussi des inconvénients. L'artisan taxi reste une personne indépendante. Il est d'ailleurs inutile de nous « pister » puisque, pour contrôler la cohérence de la facturation, il suffit de croiser les données dont dispose la CNAMTS, concernant, par exemple, les heures de prise en charge.
La convention nationale entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) et les taxis doit impérativement être revue, ce qui suppose d'installer une commission de concertation afin d'établir une charte de qualité encadrant les obligations des prestataires de TAP – aide au déplacement, transmission des dossiers médicaux, asepsie du véhicule. Dans notre département, la CPAM nous considère comme une profession « ingérable » : qu'une prise de sang soit effectuée dans le Nord ou dans le Sud, le tarif est le même, mais l'on ne peut pas en dire autant du transport. Voilà pourquoi notre activité doit être encadrée, pour en finir avec les négociations tarifaires auxquelles on assiste dans certains départements en vue d'obtenir des remises qui peuvent atteindre 20 % ou 25 %. Nous voulons être payés pour notre travail réel. Le taxi attend : il est payé pour son attente ; le taxi n'attend pas : il fait une course directe.

Les situations d'organisation de marché que vous évoquez sont-elles des cas particuliers ou bien la règle commune ?
Dans les départements où exercent des entreprises d'ambulance très importantes – dans l'Yonne, en Haute-Saône, en Franche-Comté –, un véritable monopole s'est instauré et entraîne des dérives. Mais, comme l'a dit Mme Frédérique Paillard, les autorités administratives et judiciaires réagissent peu : les premières ne sanctionnent guère ; les secondes mènent rarement à leur terme les procédures ouvertes.
Ces cas sont loin d'être prioritaires dans le monceau de dossiers à traiter.

Les comités opérationnels départementaux anti-fraude (CODAF), qui réunissent magistrats et représentants des administrations préfectorale, douanière et fiscale ainsi que des branches assurantielles, pourraient légitimement s'en saisir.
Toujours est-il que, à ce jour, malgré nos demandes, bien des problèmes n'ont pas été traités comme nous l'aurions voulu.
Vous parlez de règles communes, monsieur le député, mais n'oublions pas une différence fondamentale, que personne, semble-t-il, ne conteste : les taxis travaillent avec le tarif fixé par l'autorité administrative et le taximètre, ce qui n'est pas le cas des ambulances.
Quant à la géolocalisation, elle peut être envisagée dans le cadre de la modernisation de notre profession, mais ne doit pas servir, comme on l'a constaté dans le cas des véhicules de tourisme avec chauffeur, à détourner la réglementation professionnelle, en matière par exemple de zone de prise en charge. L'éditeur du dispositif doit donc intégrer la réglementation des différentes professions.
Ensuite, tous les acteurs du transport de malades assis regrettent que, depuis quelques années, la CNAMTS se soit quelque peu déchargée sur les caisses primaires locales de ses responsabilités en la matière, ce qui encourage la diversité des pratiques et l'opacité globale. Nous souhaitons une reprise en main qui, sans nécessairement entraîner un retrait des caisses locales du dispositif, fasse valoir sur tout le territoire des règles claires et vérifiables.
Outre la convention nationale, il me paraît indispensable d'installer une commission de concertation nationale entre la profession et la CNAMTS afin de remédier aux problèmes d'organisation et de structuration du secteur et, au quotidien, aux dysfonctionnements dont nous sommes témoins.
Enfin, il faut étudier de près l'organisation du transport de malades assis au sein des entreprises mixtes – ambulances, VSL, taxis, voire pompes funèbres. Nous aurions intérêt à connaître les rôles de chacun, surtout lorsque les règles tarifaires varient avec le type de véhicule. Faut-il aller jusqu'à interdire d'utiliser les deux modes de transport au sein d'une même entreprise ? Notre profession est majoritairement favorable à la séparation des deux activités. Nous l'avons dit au député Thomas Thévenoud à propos des VSL et des taxis. Quand un patient doit emprunter un VSL, qu'on ne lui envoie pas un taxi et réciproquement.
Chaque département a sa convention départementale avec l'assurance maladie, et aucune ne ressemble à une autre : selon les cas, les taxis travaillent au compteur, avec des remises qui varient de 5 % à 15 %, au distancier, avec des forfaits intra-muros ou non, avec ou sans approches, etc. Ce n'est pas acceptable ! Il faut établir une convention nationale et revoir les conventions départementales, car dans certains endroits la situation est inadmissible.
Avant la première convention nationale, qui date de 1995, on ne constatait pas de dérives financières. Les taxis qui assuraient le transport de malades assis étaient payés directement par le patient, lequel envoyait la facture, avec la prescription de transport, à la sécurité sociale pour se faire rembourser. Quand on paie soi-même, on est plus conscient de ce que l'on coûte.
Les problèmes datent de cette époque et se sont amplifiés en 2008. L'irresponsabilité des assurés, des transporteurs, des services médicaux ont aggravé la situation.
Aujourd'hui, nous sommes confrontés à la multiplication de conventions départementales qui varient selon le bon vouloir du directeur de la caisse, et le dispositif est devenu totalement incontrôlable du point de vue financier. Il faut donc absolument une commission de concertation nationale et une convention nationale à laquelle les caisses primaires se réfèrent.
Quant au paiement, pourquoi ne pas en revenir à l'ancien système ?
Sur ce dernier point, je serais plus prudent, car, à l'époque dont parle mon collègue, nous acquittions la facture, mais le patient attendait d'être payé pour nous rembourser, ce qu'il ne faisait pas systématiquement !

Merci, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos réflexions et vos préconisations ainsi que – sans vous inciter le moins du monde à la délation – tout élément non conforme aux règles de l'État de droit dont vous pourriez être témoins. Nous en tiendrons compte dans notre travail collégial.
La MECSS procède enfin à l'audition, ouverte à la presse, de M. Christian Espagno, adjoint au directeur général de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP), et M. Jamel Mahcer, manager.

Nous souhaiterions connaître les réflexions de l'ANAP sur l'organisation du transport sanitaire, notamment sur les expérimentations en cours dans ce domaine.
L'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux est jeune puisqu'elle est issue de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST). C'est une agence de petite taille, puisque nous ne pouvons pas employer plus de quatre-vingt-seize équivalents temps plein. Nos missions sont très clairement définies par la loi : il s'agit d'aider les établissements de santé et médico-sociaux, mais aussi, aux termes de la convention constitutive de l'ANAP, les ARS, à améliorer leurs performances. Ce point est d'importance, car il signifie que l'ANAP n'est en rien une agence de contrôle ou de régulation : notre rôle est d'aider à faire et certainement pas de faire à la place de ces établissements.
Depuis cinq ans, l'ANAP a accumulé une expérience et des outils qui doivent être diffusés à l'ensemble des établissements sanitaires et médico-sociaux et des ARS, ces dernières devant à notre sens jouer un rôle fondamental dans la diffusion de cette culture de la performance.
Depuis sa création, l'ANAP travaille sur des sujets tels que les coopérations entre les établissements – nous menons en la matière plusieurs expérimentations –, les systèmes d'information dans le cadre du programme « Hôpital numérique », les parcours de santé, notamment ceux des personnes âgées en risque de perte d'autonomie (PAERPA), ou encore le développement de la chirurgie ambulatoire. Toutes ces problématiques ont un impact sur le transport de patients.
C'est donc tout naturellement que, dès 2012, le conseil d'administration de l'ANAP a souhaité qu'elle se penche sur la question. En dépit de nombreux travaux de très grande qualité, notamment le rapport de M. Didier Eyssartier ou celui de la Cour des comptes, et de décisions réglementaires, le transport de patients reste en effet le parent pauvre de la gestion hospitalière. Chacun reconnaît pourtant que la prescription de transport fait partie du soin. Il est bon à ce propos de rappeler aux médecins qu'il s'agit d'un acte médical qui engage leur responsabilité.
Déclinant les recommandations du rapport de M. Didier Eyssartier, nos réflexions ciblent trois niveaux : le niveau de l'établissement, l'échelon territorial et le niveau national.
Au niveau des établissements de santé, il s'agissait de les aider à mieux maîtriser leurs dépenses de transport. Nous avons voulu analyser leur processus interne de gestion des demandes de transport sanitaire. Ces travaux, qui ont duré douze mois, ont abouti à la publication d'un guide en mai 2013. Notre réflexion sur l'organisation territoriale du transport de patients devrait être achevée d'ici à la fin de l'année et donnera lieu, elle aussi, à publication.
Nous avons travaillé avec sept établissements répartis dans deux régions, l'Île-de-France et Champagne-Ardenne, ainsi que cinq caisses primaires d'assurance maladie (CPAM). Nous avons tenu les transporteurs informés de l'état d'avancement de nos travaux, qui se sont déroulés en deux étapes : une première phase consacrée à l'établissement d'un diagnostic, une seconde à l'appui à la mise en oeuvre des solutions d'amélioration de la performance qui ont été identifiées à travers la mise en place d'une feuille de route.
Pour établir le diagnostic, nous avons procédé à une analyse de type qualitatif, à travers des entretiens avec l'ensemble des acteurs concernés au sein des établissements de soins, direction, corps médical, soignants, service financier, etc. Nous avons également mené une analyse quantitative, en recueillant l'ensemble des informations dont les établissements disposaient relativement aux transports sanitaires, qu'il s'agisse de transport pris en charge par l'établissement de santé ou par l'assurance maladie.
À partir de ces analyses, nous avons développé et mis à la disposition des établissements un outil d'autoévaluation de la fonction Transports sanitaires en établissement, que nous avons appelé « QuickEval ». Il permet, à travers une grille d'évaluation assez étoffée, d'aider l'établissement à évaluer son degré de maturité, ses points forts et ses points faibles, et lui propose un certain nombre de mesures correctrices.
Nos observations globales nous ont d'abord révélé le niveau très faible d'organisation des transports sanitaires au sein des établissements. La plupart sont dépourvus de procédures standardisées, chaque service ayant élaboré sur le tas ses propres pratiques organisationnelles. En outre, si les établissements disposent désormais d'une connaissance relativement précise des coûts à leur charge, ils sont incapables de préciser le volume et la nature des prestations de transport, voire la part respective de chaque service ou unité dans la dépense de transport.
Tant s'en faut, alors qu'un tel outil permettrait aux établissements de mettre le doigt sur leurs points faibles. En outre, si son extension progressive permet aux établissements de santé d'améliorer la connaissance de leurs dépenses, elle ne leur permet pas encore d'en connaître le contenu. Faute d'une telle connaissance, il est impossible de mettre en place des mesures correctrices.
Nous avons également constaté des dysfonctionnements. Par exemple des patients se présentent sans prescription de transport. Or la régulation de leur situation est chronophage et source de dépenses inutiles, tant en personnel qu'en moyens financiers. Nous avons également observé une très grande hétérogénéité des pratiques au sein même des établissements, chaque service ayant ses propres habitudes.

Les dépenses qu'entraîne l'absence de prescription sont-elles importantes ou leur niveau est-il anecdotique ?
Sans avoir de chiffres précis en tête, je peux vous dire de façon très claire que ce n'est absolument pas anecdotique, de tels dysfonctionnements se produisant chaque jour dans un certain nombre d'établissements. Ils sont le corollaire d'un manque de sensibilisation de l'ensemble des acteurs des établissements à ce problème, au premier chef des médecins prescripteurs. Je plaide coupable, puisque j'ai exercé pendant vingt-cinq ans comme chirurgien au sein d'un hôpital sans me préoccuper de ce sujet qui, à mes yeux, relevait de l'administratif. Il y a donc un très gros effort de pédagogie à faire auprès de tous les échelons des établissements. Ainsi, les commissions médicales d'établissement (CME) devraient systématiquement prévoir un volet transport de patients dans le cadre du projet médical d'établissement, ce qui est très loin d'être le cas à l'heure actuelle.

Où en est-on en matière d'individualisation de la facturation au sein des établissements de soins ?
Depuis la création du registre partagé des professionnels de santé (RPPS), il est possible, théoriquement, de connaître le nom du prescripteur. Cela dit, peu d'établissements ont établi une traçabilité nominative des prescriptions, alors que cela permettrait de responsabiliser les acteurs. C'est là une piste exploitable à court terme.
Il faut également informer les prescripteurs de la différence de coût significative entre les divers modes de transport, ambulance, VSL ou taxis s'agissant du transport assis professionnalisé. Là encore, les directions des établissements et les CME pourraient sensibiliser à cette question des médecins prescripteurs qui font preuve d'une méconnaissance quasi totale du sujet.
Nous avons également observé qu'une réglementation trop complexe pour le remboursement au patient du transport dans son véhicule personnel limitait le recours à cette modalité de transport, alors qu'on aurait avantage, sur le plan financier, à se tourner davantage vers ce type de prise en charge, notamment en cas de chirurgie ambulatoire. On a constaté par exemple que les frais de parking n'étaient pas pris en charge, ce qui n'est pas forcément anecdotique pour les patients.
Nous avons constaté également que l'existence d'un contrat entre l'établissement et les prestataires de transport exerçait une pression à la baisse sur les tarifs. Les conventions entre CPAM et établissement ont le même effet, en sensibilisant ce dernier au coût des transports de patients pour l'assurance maladie.
Enfin, certains établissements commencent à réfléchir à améliorer la répartition des transports entre VSL et taxis pour les TAP, par exemple dans un cadre contractuel, afin de pouvoir, dans chaque cas, choisir le mode de transport le plus performant sur le plan économique.

Cela renvoie à la question de la budgétisation de la prestation de transport au sein de l'hôpital et de la possibilité pour les établissements de passer des appels d'offres, solution préconisée par la Cour des comptes. Quel est le sentiment de l'ANAP à ce sujet ?
Notre réflexion sur l'organisation territoriale du transport de patients nous a conduits à évaluer les expériences étrangères de ce mode de régulation. Celles-ci ont mis en évidence le caractère très concentrateur du système d'appel d'offres, qui privilégie certains transporteurs. En France, où le marché du transport sanitaire est particulièrement éclaté entre de nombreuses PME, un tel système risquerait de provoquer une restructuration à marche forcée. Or on sait qu'une telle restructuration est susceptible, soit de générer des blocages, soit de provoquer de nombreuses faillites. D'autre part, ce type de démarche suppose un degré de maturité que la plupart des établissements n'ont pas encore atteint. Si cette solution n'est donc pas à écarter a priori, il faut prendre garde que les solutions les plus brutales et les plus simples ne sont pas nécessairement les plus pertinentes.
Nos expérimentations ont également permis de pointer des modifications ponctuelles de l'organisation du transport qui peuvent se révéler d'une grande efficacité, parce qu'elles sont bien acceptées sur le terrain. Il en est ainsi du covoiturage, en particulier pour des transports itératifs en cas de pathologies chroniques, qui connaissent un développement considérable. Les patients peuvent même y trouver, comme dans les salons d'attente pour la chirurgie ambulatoire, l'occasion de confronter leurs expériences.
Nous n'avons pas été beaucoup plus loin, mais cela ne semble pas d'une mise en oeuvre compliquée à partir du moment où les transporteurs disposent de véhicules rendant possible une telle organisation. Si c'est aujourd'hui rarement le cas, c'est faute d'une demande suffisante, mais il s'agit là d'une piste à exploiter à court terme.

Avez-vous, au cours de ces expérimentations, rencontré le cas d'un établissement qui aurait appliqué toutes les préconisations de rationalisation de la dépense de transport ?
Nous n'avons malheureusement pas trouvé d'établissement exemplaire dans tous ces domaines. En revanche, certains établissements sont particulièrement sensibilisés à telle ou telle problématique. L'hôpital privé nord parisien de Sarcelles, par exemple, qui compte beaucoup de patients sous dialyse, a réalisé un important travail en matière d'organisation du covoiturage, en étroite collaboration avec la CPAM afin d'identifier les patients éligibles.
Autre exemple, le centre hospitalier de Martigues s'intéresse depuis très longtemps à la thématique de l'organisation de la gestion des flux, notamment afin de lutter contre l'engorgement des urgences.

On pourrait aussi citer la réorganisation des urgences de l'hôpital Beaujon, pilotée par le cabinet McKinsey, qui a permis de réduire de 30 % à 40 % le délai d'attente.
Même si certains acteurs ont pris à coeur le sujet, le transport de patients reste le parent pauvre des établissements, alors même qu'il est reconnu comme un maillon de la chaîne de soins. Cela dit, la situation évolue.

Avez-vous constaté des économies dans chacun de ces deux cas, qu'il s'agisse de l'hôpital privé nord parisien ou du centre hospitalier de Martigues ?
Sans avoir d'évaluation précise, nous avons observé une tendance intéressante. Nous avons constaté, en outre, que les acteurs ont amplifié le dispositif. Nous poursuivons notre collaboration avec ces acteurs, de façon à tirer un enseignement de ces expérimentations et à disposer de résultats chiffrés.
Nos travaux relatifs à l'organisation des transports non urgents au sein des établissements sanitaires nous ont convaincus de la nécessité de la pédagogie afin qu'il existe à tous les niveaux des établissements une véritable prise de conscience de l'importance du problème. C'est pourquoi l'enjeu majeur aujourd'hui est de diffuser le plus largement possible les outils de rationalisation déjà identifiés.
Notre projet, actuellement en cours, a deux objectifs : réfléchir aux modalités d'organisation territoriale du transport de patients à l'échelon d'un territoire ; élaborer une méthodologie permettant d'anticiper l'impact des réorganisations sanitaires sur les transports.
Aujourd'hui les schémas régionaux d'organisation des soins ou les schémas régionaux d'investissement en santé élaborés par les ARS ne prennent pas en compte la variable du transport sanitaire, faute de disposer d'outils prospectifs leur permettant d'évaluer l'impact, sur les transports sanitaires, de telle ou telle évolution de l'offre de soins. C'est pourquoi nous travaillons à la mise en place d'un logiciel qui, à partir d'une dizaine de facteurs, permette non seulement d'établir une cartographie des transports de patients existants, mais aussi d'évaluer l'impact de telle ou telle réorganisation sanitaire sur les transports. Il ne s'agit pas de réguler l'ensemble de l'offre de soins à partir de l'offre de transport, mais de permettre une prise en considération en amont de ce facteur.
Nous avons par ailleurs analysé les solutions d'organisation de la demande de transports de patients mises en place en France par certaines ARS et à l'étranger, notamment aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Canada et en Espagne. La plupart d'entre elles visent à centraliser les demandes selon un périmètre variable : région, bassin de vie, voire au sein d'une organisation territoriale de l'ensemble de la demande de transports, et pas seulement de transport de patients.
Par définition, ces plateformes de gestion de la demande imposent aux transporteurs l'obligation de coopérer entre eux, mais elles n'entraînent pas systématiquement une concentration à marche forcée. On retrouve deux types d'organisation, selon que la plateforme a été mise en place par la tutelle ou à l'initiative des transporteurs eux-mêmes, comme c'est le cas au Québec. Le risque est de biaiser les conditions de la concurrence si un transporteur pilote l'ensemble de la plateforme.

La féroce compétition économique qui sévit entre les acteurs de ce secteur n'est pas favorable à ce type d'initiative, qui comporte des risques de situation monopolistique et d'atteinte à la liberté économique.
Préconisez-vous un modèle particulier de réorganisation de la demande de transport sanitaire ?
Je me permettrai d'autant moins de vous donner des réponses simplistes que, en tant qu'agence d'appui à la performance, nous ne sommes pas là pour être directifs : notre rôle est d'analyser les solutions existantes et de dresser un inventaire objectif des avantages et des inconvénients qu'elles présentent. Il revient ensuite aux structures ad hoc de faire les choix qui relèvent de leur responsabilité. À mon avis, si l'on veut mettre en place une organisation véritablement efficace de la demande de transport de patients, on n'évitera pas la nécessité d'une réflexion en profondeur sur la pertinence de certaines règles du code de la santé publique, telle celle du libre choix du patient. Il me semble que le souci de préserver le colloque singulier, qui fonde le libre choix du médecin, n'a pas à être étendu au choix du mode de transport : les deux n'ont pas les mêmes implications au regard du consentement éclairé.

Croyez bien que j'ai abordé cette question sans ménagement en rappelant aux fédérations de taxis que cette règle de la liberté de choix n'avait aucune valeur législative face à l'obligation d'assurer la meilleure allocation de crédits publics à destination sanitaire et sociale.
En tout état de cause, une réflexion doit être menée dans l'ensemble des établissements et auprès des transporteurs. Il n'y aura pas d'organisation rationnelle de la demande de transport si chaque patient peut librement choisir son transporteur.
Ce type de plateforme peut être mis en place par la tutelle – régions, caisse d'assurance maladie, voire un groupe d'établissements – qui en confie assez souvent la gestion à un opérateur indépendant. L'avantage d'une telle solution est qu'elle ne présente pas de risque de conflit d'intérêts et est a priori plus favorable à une organisation rationnelle. Elle suppose cependant un niveau de maturité que l'ensemble des acteurs, notamment les établissements, n'a pas encore atteint.

On peut craindre que des transporteurs gestionnaires de telles plateformes tiennent compte avant tout de leurs intérêts propres.
Les ARS ne se sont pas suffisamment préoccupées de ces problèmes d'atteinte à la concurrence dans leur politique de conventionnement avec les transporteurs. L'inertie dont elles font preuve dans la mise en oeuvre de la rationalisation et de l'homogénéisation des procédures de conventionnement laisse quelque peu perplexe.
Absolument. Ce sera l'objectif de la troisième phase de nos travaux : comment, à partir de toutes les expérimentations, mettre en oeuvre à l'échelon national une méthodologie et des outils de rationalisation de l'offre de transport sanitaire.
Les exemples étrangers de recours à la procédure de l'appel d'offres montrent que ce système provoque une réduction drastique du nombre de transporteurs. En Catalogne, le nombre des sociétés de transport sanitaire est passé, en dix ans, de cinquante-trois à onze.
Tels sont les travaux que nous avons menés. À titre personnel, j'attends beaucoup de la mise en place d'un outil prospectif pour permettre aux ARS d'introduire la dimension du transport de patients dans l'ensemble de leur réflexion sur l'organisation de l'offre de soins.

La Cour des comptes estime qu'un meilleur contrôle de la facturation de la prestation de transport sanitaire permettrait de dégager 120 millions d'euros d'économies. L'ANAP a-t-il des préconisations à faire en la matière ?
Une meilleure connaissance de la dépense de transport de patients et une meilleure traçabilité des prestations de transport ne peuvent qu'améliorer le contrôle de la facturation en permettant d'identifier les comportements déviants.
Par ailleurs, nous consacrerons un chapitre de nos travaux à la géolocalisation, qui est non seulement un moyen de contrôler la réalité de la prestation de transport, mais qui est aussi indispensable à la mise en oeuvre d'une gestion efficace de la demande de transport de patients. Je rappelle cependant que notre mission est de faire des propositions, y compris dans ce domaine, et non de réguler à la place du régulateur.

Que vous ont appris ces expérimentations s'agissant de la dématérialisation de la facturation ?
Au moment d'élaborer notre programme de travail sur le transport de patients, nous nous sommes rapprochés de la CNAMTS à propos de la géolocalisation et de la dématérialisation des prescriptions.
S'agissant du contrôle de la facturation, la mise en place d'un processus de vérification est un élément fondamental. C'est la dynamique que nous avons fait le pari de privilégier à travers nos réflexions sur l'organisation opérationnelle du transport de patients.

Les ARS vous semblent-elles suffisamment attentives au sujet ? L'ANAP a-t-elle engagé une réflexion sur le transport médico-social ?
Il est vrai que ce sont des structures récentes, qu'elles ne sont pas homogènes sur le plan de leur organisation interne et qu'elles sont accablées de circulaires. Nous sommes cependant convaincus qu'il n'y aura pas de déploiement à grande échelle auprès des établissements sanitaires et médico-sociaux sans le relais des ARS.
Voilà pourquoi, dans les deux ans qui viennent, nous allons axer nos efforts sur l'appui aux ARS, notamment en ce qui concerne le transport de patients. Nous avons élaboré des outils d'aide à la performance des ARS, et nous comptons mettre en place dès juillet des sessions nationales et interrégionales afin d'échanger avec les ARS au cours de séances de quarante-huit heures. Actuellement, leur maturité est encore insuffisante.
En ce qui concerne le secteur médico-social, nous n'y avons pas encore consacré de travaux spécifiques, mais un certain nombre de nos réflexions nous conduisent à aborder cette problématique. Nous mettons à la disposition des établissements médico-sociaux des tableaux de bord afin de leur permettre d'améliorer leur gestion.
Enfin, dans le cadre de leur stage de MBA, trois étudiants de Dauphine mènent actuellement au sein de l'ANAP, sous l'égide de Jamel Mahcer, une réflexion prospective sur le transport sanitaire dans le secteur médico-social.
La séance est levée à treize heures quinze.