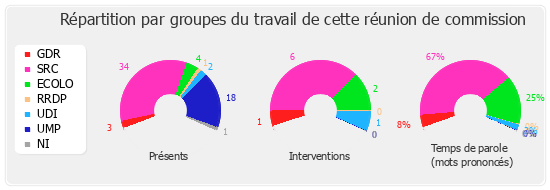Commission des affaires européennes
Réunion du 17 décembre 2014 à 11h30
La réunion
COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES
Mercredi 17 décembre 2014
Présidence de Mme Danielle Auroi, Présidente de la Commission
La séance est ouverte à 11 h 30
Audition, conjointe avec la commission des Finances et la commission des Affaires économiques, de M. Jean Pisani-Ferry, commissaire général de France Stratégie, et de M. Guillaume Duval, rédacteur en chef d'Alternatives économiques, sur la relance de l'investissement en Europe

Messieurs, en vous recevant ce matin, nous accueillons deux Européens convaincus, mais lucides. Si vous vous accordez sur certains constats, vous divergez sur certains aspects des remèdes qui doivent être mis en oeuvre pour sortir de la crise dans laquelle l'Europe se morfond.
Nous vous avons invités pour faire le point sur la question de l'investissement en Europe. La relance de l'économie européenne, donc l'amélioration de la situation de l'emploi, passe par un effort partagé d'investissement ; en ce domaine, l'échelle européenne est incontestablement la bonne, notamment pour les investissements dans le domaine de la transition énergétique. Nous souhaitons bien sûr vous entendre en particulier sur le plan Juncker, qui sera avalisé cette semaine par le Conseil européen.
La question de l'investissement est également au coeur des rapports franco-allemands, puisque le rapport que vous avez établi, monsieur le commissaire général, avec M. Henrik Enderlein, insiste sur la nécessité d'investir davantage.
Sur ce point, d'ailleurs, le consensus est large ; mais sur le niveau d'investissement, sur les modalités de financement, sur les priorités, les divergences entre États membres, et entre experts, sont grandes.
Le rapport établi par MM. Pisani-Ferry et Enderlein insiste sur la question de la croissance, mais n'occulte pas les problèmes de fond que sont l'évolution démographique ou la question des travailleurs pauvres, plus nombreux en Allemagne qu'en France. Je suis également sensible à ce que vous dites de la nécessité d'engager l'Europe à accélérer sa transition vers une économie numérique et une économie moins carbonée ; vous décrivez, et c'est très intéressant, les outils financiers qui permettront d'atteindre ces buts. Pourrez-vous revenir sur ce point ?
Vous souhaitez également changer la formule d'indexation du salaire minimum : mais comment alors lutter contre le phénomène des travailleurs pauvres ? Vous fixez pour objectif une diminution du ratio des dépenses publiques de cinq points en quelques années, ce qui représente tout de même 100 milliards d'euros : où trouver cet argent ? Où porter le scalpel sans réduire notre niveau de protection sociale ni la qualité de nos services publics ?
Vous évoquez enfin, dans ce rapport, un « Schengen économique » et une Europe de l'énergie. Comment envisagez-vous la convergence franco-allemande en ces domaines ?

Merci, madame la présidente, d'avoir organisé cette audition qui s'annonce très intéressante.
Monsieur Pisani-Ferry, la commission des Finances vous a reçu lorsque vous avez été nommé membre du Haut Conseil des finances publiques ; nous avions alors évoqué les notions indispensables, mais complexes et difficiles à manier, de croissance potentielle et de solde structurel. France Stratégie a rendu, au mois de juin dernier, un passionnant rapport intitulé Quelle France dans dix ans ? À partir de ce rapport, et de celui que vous avez écrit avec M. Henrik Enderlein, je voudrais vous interroger sur la question de la dépense publique.
Il est habituel de considérer que son niveau actuel de 57 % du PIB est très excessif ; mais il faut aussi s'interroger plus précisément sur la qualité de la dépense publique et sur sa contribution à la croissance. Là aussi, une idée convenue consiste à dire que toute dépense d'investissement est favorable à la croissance : cela ne me paraît pas incontestable.
Or, dans ces deux rapports, vous ne semblez pas adhérer à l'idée – qui fut notre credo pendant des décennies – selon laquelle tout accroissement de la dépense publique aurait un effet positif sur la croissance. Vous semblez considérer que le niveau de dépense publique atteint aujourd'hui est excessif, et appelle des réformes de structure.
Certains membres de la commission des Finances n'hésitent pas à considérer que toute réduction de dépenses publiques est beaucoup plus récessive qu'un accroissement de fiscalité. Ces sujets sont complexes, et je ne voudrais pas me montrer trop catégorique ; mais j'ai eu le sentiment, à vous lire, que vous estimiez qu'il fallait à tout le moins nous interroger sur l'efficacité de nos dépenses publiques.
Monsieur Duval, je ne suis pas un lecteur assidu d'Alternatives économiques mais je trouve toujours cette publication stimulante. Je vous adresse donc les mêmes questions qu'à M. Pisani-Ferry.

La commission des Affaires économiques a commencé ses travaux ce matin par une audition du président du Centre national des études spatiales : nous avons donc parlé conquête spatiale, économie réelle, réussite européenne et accords fructueux avec nos voisins allemands.
Mais nous voyons aussi se développer des dynamiques anxiogènes – oscillations des cours de bourse, dégradation de la note de notre pays par les agences de notation, commentaires catastrophistes des médias et des économistes... Ne pensez-vous pas que ces « agents d'ambiance » ont un effet dépresseur sur l'économie réelle ? Cet incessant brouhaha ne décourage-t-il pas les investisseurs ?
Merci, madame la présidente, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les députés, de nous donner l'occasion rare de nous exprimer devant ces trois commissions réunies. J'utiliserai aussi, dans ma réponse, les différents travaux de France Stratégie.
L'investissement, vous avez raison, est au coeur du débat européen – non pas tant d'ailleurs parce qu'il serait partout l'aspect le plus préoccupant de l'économie, quoiqu'il soit incontestablement trop faible, mais plutôt parce qu'il peut constituer, comme l'a dit Mario Draghi, un point de rencontre entre les tenants de l'offre et ceux de la demande : l'investissement, c'est la demande d'aujourd'hui et l'offre de demain. Il est donc possible, à l'échelle européenne, de parler d'investissement de façon fructueuse ; c'est ce qui explique le plan Juncker, mais aussi la commande du rapport que j'ai rédigé avec Henrik Enderlein. Cela montre aussi a contrario les difficultés que nous rencontrons à établir un diagnostic macroéconomique partagé.
Il faut distinguer l'investissement public de l'investissement privé. La situation du premier est alarmante dans certains pays où l'ajustement a été très violent – il a pu baisser de 50 %, voire 70 %, ce qui met en cause le niveau minimal de renouvellement des équipements publics. Il a également diminué fortement en Allemagne, dès les années 2000, car c'est ainsi que s'est fait l'ajustement des dépenses publiques : pour ce pays, la question du relèvement du niveau d'investissement se pose, en dehors de toute considération conjoncturelle. En effet, l'Allemagne a choisi d'appliquer une règle sur la dette publique, c'est-à-dire sur le passif, mais ne possède pas de règle correspondante sur l'actif public. Ce que souligne le rapport que j'ai rendu avec Henrik Enderlein, c'est la nécessité d'un rééquilibrage : ce que nous léguons aux générations futures n'est évidemment pas une considération secondaire, mais il ne faut alors pas se préoccuper seulement du passif, mais aussi des actifs.
La question de l'investissement public se pose moins évidemment en France, où il est demeuré à un niveau sensiblement supérieur à celui de l'Allemagne comme d'autres pays. En revanche, il convient de nous interroger sur l'allocation des fonds, de nous demander si nous faisons vraiment les bons choix, tant du point de vue des citoyens qu'en termes de croissance.
Quant à l'investissement privé, qui est évidemment le résultat du comportement des entreprises, notre diagnostic est là encore qu'il est très faible : contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, où il s'est redressé, il demeure en Europe sensiblement inférieur à ses niveaux antérieurs à la crise. C'est inquiétant, même si on envisage seulement ce chiffre comme le signe d'une inquiétude des entreprises sur leurs perspectives de croissance ; il existe un risque de perpétuation de niveaux d'investissements trop faibles, ce qui mettrait en danger la modernisation de notre appareil productif et donc nos capacités de croissance à moyen terme. Il est donc légitime de prendre des initiatives pour soutenir l'investissement privé.
Le plan Juncker intervient dans ce contexte. Il vise à soutenir l'investissement, avec des moyens très limités : 16 milliards d'euros de garanties sur le budget européen et 5 milliards d'euros apportés par la Banque européenne d'investissement – BEI. À l'échelle européenne, c'est évidemment infime ; l'idée est de se servir de cet apport pour partager le risque entre le nouveau Fonds européen pour les investissements stratégiques et les investisseurs privés, afin de permettre un développement de l'investissement. Dans la situation actuelle, nous pouvons en effet craindre que le système bancaire ne souhaite prendre moins de risques qu'auparavant. C'est même, d'une certaine façon, ce que nous lui demandons : le système bancaire assure en effet, dans les économies européennes, l'essentiel de l'intermédiation – contrairement aux États-Unis, par exemple, où le marché des capitaux joue un rôle beaucoup plus important. Traditionnellement, ce sont donc les banques qui portent le risque. Mais, pour des raisons de stabilité financière et de protection des finances publiques, nous leur enjoignons aujourd'hui d'en prendre moins : hausse des ratios de capital, de liquidités, baisse du ratio d'endettement, mécanismes de résolution des crises bancaires afin que les finances publiques ne soient plus en première ligne... À moyen terme, nous devrions avoir un marché des capitaux plus développé et un système bancaire plus sûr ; mais, dans une phase de transition, il faut soutenir la prise de risque, et c'est le principe du plan Juncker.
C'est donc une bonne initiative, quoiqu'elle ait plusieurs limites. Le chiffre de 315 milliards d'euros annoncé par M. Juncker doit être mis en regard des 21 milliards réellement mobilisés ; pour aller du second au premier, il faut un multiplicateur très élevé. Soit.
Mais quelles seront les meilleures formes de mobilisation de l'argent public ? Dans certains cas, on peut souhaiter une prise de risque plus élevée, avec un multiplicateur plus faible : je crains que, pour atteindre un objectif si élevé par rapport à la mise de fonds initiale, le Fonds européen ne soit conduit à intervenir dans des projets auxquels l'apport public n'était pas indispensable. Nous en avons déjà un certain nombre d'exemples : il arrive que la BEI finance des projets qui auraient pu se financer entièrement sur les marchés. Or, s'il s'agit d'améliorer marginalement les conditions de financement de tel ou tel projet, en se substituant à des investisseurs privés, l'effet macroéconomique sera nul. Il apparaît donc essentiel de s'interroger sur les domaines d'intervention, et de se limiter à soutenir des projets auxquels cette aide est vraiment indispensable.
Deuxième réserve : les montants demeurent très faibles. La possibilité ouverte aux États membres d'apporter des compléments de financement devrait donc, à mon sens, être utilisée. Cela pose la question du traitement de ces fonds dans la comptabilité européenne : il est possible qu'ils n'entrent pas dans le calcul du déficit, comme cela s'est déjà fait pour le Mécanisme européen de stabilité. Les modalités exactes des interventions des États membres demeurent à préciser, mais il faut à coup sûr envisager d'utiliser cette possibilité.
Enfin, du point de vue de l'investissement privé, nous ne sommes pas condamnés à agir uniquement par des mécanismes financiers : l'action par la réglementation et la fiscalité peut constituer un levier intéressant. D'un point de vue macroéconomique, nous souhaitons en effet accélérer l'investissement alors que les perspectives d'augmentation de la demande demeurent modestes – même s'il faut bien sûr espérer que la Banque centrale européenne – BCE – agira, comme elle l'a laissé entendre, pour favoriser la demande. Mais les entreprises peuvent aussi être incitées à investir pour substituer à un capital ancien, en voie d'obsolescence, un capital nouveau, plus performant énergétiquement par exemple, ou parce qu'il utiliserait mieux les technologies numériques : il faut pour cela des initiatives publiques. Si le prix du carbone demeure au niveau où il est, c'est-à-dire extrêmement déprimé, si de fortes incertitudes demeurent sur les standards européens en matière de protection des données, pour ne prendre que ces exemples, alors les entreprises ne sont pas incitées à consentir ces investissements. L'accélération de la transition énergétique, de la transition vers le numérique conduira les entreprises à investir : c'est donc, je le répète, un levier intéressant.
Évidemment, ce n'est pas sans conséquence pour les entreprises, qui doivent dévaluer le vieux stock de capital plus vite, et donc rogner leurs profits. L'opération n'est pas sans coût pour l'économie, ni en dernière analyse pour les finances publiques. Mais dans une situation où les entreprises font face moins à des contraintes de profit qu'à des contraintes de demande, il est légitime d'envisager d'utiliser ce levier.
Il faut également aborder la question de l'investissement public au niveau européen. Dans le rapport que j'ai rendu avec Henrik Enderlein, nous proposons un volet « investissement privé » – proche du plan Juncker – mais aussi un volet « investissement public », qu'il faut soutenir dans les pays où il est particulièrement déprimé. Nous proposons donc la création d'un fonds spécifique pour la zone euro.
S'agissant de la dépense publique française, madame la présidente, France Stratégie a travaillé pour comprendre les raisons du niveau élevé de dépense publique dans notre pays : 12 points de dépenses primaires de plus que l'Allemagne, 7 points de plus que la moyenne de la zone euro. C'est pour une part la conséquence de choix collectifs, que l'on peut ou pas souhaiter remettre en cause, mais qui n'entraînent en eux-mêmes aucune conséquence néfaste : nous avons ainsi fait le choix d'un système de retraites essentiellement public, contrairement à d'autres pays, ce qui n'est pas un indicateur d'inefficacité. En revanche, lorsque nous consacrons 40 milliards d'euros à la politique du logement, avec des résultats médiocres, lorsque nous dépensons sensiblement plus pour l'enseignement secondaire que d'autres pays – mais moins pour l'enseignement primaire –, lorsque nos dépenses de santé sont plus élevées que les indicateurs de santé publique ne semblent le justifier, on peut supposer un relativement mauvais emploi des fonds publics. C'est sur ces points qu'il faut travailler.
La France doit donc se fixer, de ce point de vue, des objectifs ambitieux à moyen terme. De plus, les débats récents montrent un écart croissant entre ces dépenses élevées et le niveau de fiscalité que nous sommes collectivement prêts à accepter. Le raisonnement ne serait pas le même pour les pays scandinaves, par exemple, où l'acceptation de l'impôt est plus forte que chez nous.
Vous me demandez, monsieur le président de la commission des Finances, si je prends mes distances vis-à-vis de l'idée que la dépense publique créerait de la croissance. Tout dépend de l'échelle de temps à laquelle on raisonne. Je ne crois pas que les ajustements budgétaires soient spontanément favorables à la croissance : à moyen terme, il faut se fixer l'objectif d'un niveau de dépenses publiques à la fois efficace et cohérent avec les préférences collectives. Mais cet ajustement doit se faire graduellement. Les débats sur ce point ont été nourris lors de la discussion du projet de lois de finances pour 2015 : j'étais pour ma part partisan de la prudence dans la conjoncture très molle que nous connaissons aujourd'hui.
J'aime beaucoup, monsieur le président de la commission des Affaires économiques, votre expression « agents d'ambiance ». Quel est le rôle des économistes dans les anticipations collectives ? Je ne crois pas, pour ma part, que ma profession ait été responsable des événements que nous avons connus ces dernières années... La crise a été le résultat de faits tout à fait réels, malheureusement, et nous devons avoir des regrets, c'est plutôt de n'avoir pas été assez vigoureux, en 2009, pour insister sur la nécessité de traiter la situation bancaire. Faire semblant de croire que le système bancaire européen allait bien risquait de mener vers une situation peu enviable, à la japonaise. Nous aurions sans doute aussi dû nous montrer plus lucides sur le fait qu'un ajustement budgétaire collectif, alors que les économies européennes étaient encore très faibles, était très risqué. Je regrette plus de n'avoir pas été assez alarmiste que de m'être montré trop pessimiste.
Votre question porte peut-être implicitement sur les commentaires sur la baisse du prix du pétrole. Celle-ci constitue indubitablement une bonne nouvelle pour nos économies, puisqu'elle aura pour conséquence un transfert massif de pouvoir d'achat pour nos économies, mais elle intervient dans un contexte où l'on ne peut que se poser des questions, notamment à propos de la Russie.
Merci, madame la présidente, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les députés, de me donner à mon tour l'occasion de prendre la parole dans ce cadre prestigieux.
La situation européenne est à l'heure actuelle tout sauf optimale : vous en êtes certainement tous conscients, mais je voudrais vous faire mesurer à quel point elle est catastrophique. En 2013, les comptes extérieurs de la zone euro ont été excédentaires de 240 milliards d'euros, c'est-à-dire 2,4 % du PIB de cette zone. Les résultats pour 2014 seront sans doute à peu près identiques : nous aurions donc pu, en 2013 comme en 2014, consommer et investir dans la zone euro 240 milliards d'euros de plus, 2,4 points de PIB de plus, sans que cela pose le moindre problème de financement à nos économies, sans avoir besoin d'aller chercher de l'argent au Qatar, en Chine ou aux États-Unis. Au lieu de détruire 1,2 million d'emplois dans la zone euro l'an dernier, nous aurions pu en créer 1,2 million !
Il est certes plus facile de décrire cette situation que de la résoudre, d'autant que ces excédents ne sont pas équitablement répartis. Mais tel est bien le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, et auquel le plan Juncker essaie de répondre.
Je voudrais aussi souligner à quel point les politiques menées en Europe aujourd'hui sont contre-productives, notamment en ce qui concerne leur axe principal, c'est-à-dire le désendettement public. En 2012, en 2013, et encore en 2014, les États-Unis s'endettent moins que l'Europe en points de PIB : leur déficit budgétaire reste d'environ deux fois ce qu'il est en Europe, mais leur politique économique leur permet d'avoir à la fois croissance et inflation. Leur endettement public est donc réduit.
Sans même aborder la question du chômage, on constate donc que notre situation actuelle est absolument sous-optimale. Il est bon que certains de nos partenaires commencent à s'en rendre compte et à accepter que l'on agisse pour sortir de cette impasse.
S'agissant de la situation française, monsieur le président de la commission des Affaires économiques, parmi les « agents d'ambiance », il n'y a pas que les journalistes et les économistes, mais aussi des hommes et femmes politiques. Aujourd'hui, l'appréciation de la situation de la France en Europe est mauvaise : les dirigeants de notre pays semblent eux-mêmes avoir accepté l'idée que nous sommes devenus l'homme malade de l'Europe. C'est tout à fait inexact : l'économie française est, avec l'économie allemande, celle qui a le moins mal résisté à la crise ; la France a sauvé la zone euro en maintenant sa demande intérieure, quand celle-ci s'écroulait en Grèce, au Portugal, en Espagne, en Italie... En effet, nous n'avons baissé ni nos coûts du travail, ni nos dépenses publiques durant cette période.
Il est vrai que cette politique menée alors est à l'origine de difficultés supplémentaires aujourd'hui : nos voisins ayant baissé leur coût du travail, les prix industriels ont baissé et les marges des entreprises françaises également ; nos voisins ayant diminué leur demande intérieure, la France a moins exporté vers l'Europe et, comme elle sait moins bien que l'Allemagne exporter hors d'Europe, le déficit de son commerce extérieur a crû. L'Espagne était le pays du monde avec lequel nos excédents extérieurs étaient les plus importants : aujourd'hui, nous avons un déficit, puisque les Espagnols ne consomment plus rien et qu'ils produisent des voitures pour des coûts inférieurs aux nôtres.
Je ne crois donc pas beaucoup que l'idée d'engager aujourd'hui la France dans la course au moins-disant social – où nos partenaires sont certes engagés depuis longtemps – soit de nature à résoudre les problèmes français, ni d'ailleurs européens. La conséquence de cette politique, déjà visible d'ailleurs, sera la réduction de la demande intérieure française. Certes, la demande intérieure grecque se redresse légèrement, mais elle représente 3 % du PIB de la zone euro ; la demande intérieure française, c'est 20 %... On ne pourra donc par ces politiques que prolonger, voire aggraver, la stagnation économique de l'Europe.
Il est urgent que chacun prenne conscience de cet état de choses : les dirigeants français, convaincus que la France serait devenue l'homme malade de l'Europe, se privent de la possibilité de prendre des initiatives en faveur d'une autre politique que celle de la course au moins-disant social. Ils ont tort.
Monsieur le président de la commission des Finances, M. Pisani-Ferry a déjà montré ce qui tenait, dans notre niveau de dépenses publiques, à des choix collectifs. Les Américains ont ainsi des dépenses publiques de santé très inférieures aux nôtres, mais ils payent globalement beaucoup plus pour leur santé, parce qu'ils l'assurent de façon privée : c'est un état sous-optimal, mais ils commencent tout juste à s'en rendre compte. Les choix de société varient donc énormément.
Je voudrais donc surtout insister sur le fait que la maîtrise des dépenses publiques est déjà très importante. En particulier, des efforts tout à fait considérables ont été consentis par l'État employeur et producteur depuis quinze ans : la part du PIB consacrée à faire produire des services par l'État a diminué – elle a diminué si fortement pour l'État central que cela n'a pas compensé la légère hausse des collectivités locales. La part dans le PIB des salaires et des consommations intermédiaires qui servent à produire des services publics a baissé. Nous dépensons aujourd'hui 1,5 point de PIB de moins pour l'éducation qu'au milieu des années 1990, et je ne suis pas absolument certain que ce soit une bonne idée. Nous dépensons deux fois moins que l'Allemagne pour le fonctionnement de nos tribunaux, et je ne suis pas certain non plus que cela nous assure un avantage compétitif particulier.
Nous avons donc déjà agi, et nous sommes déjà, dans beaucoup de domaines, allés à mon sens trop loin. Il est sans doute possible de continuer à réduire nos dépenses publiques en cherchant du côté des collectivités locales, mais il faudrait alors redéployer ces dépenses vers d'autres secteurs.
Notre niveau de protection sociale est très important. On peut tout à fait le réduire fortement, et c'est une logique qui trouve à s'exprimer dans le débat public depuis longtemps – elle commence d'ailleurs à s'y imposer. Nous nous sommes toujours très fermement opposés à ce mouvement : si la protection sociale cesse de concerner tout le monde pour ne plus s'adresser qu'aux plus pauvres, qu'à « ceux qui en ont vraiment besoin », alors elle deviendra inévitablement une protection sociale de pauvres. Les classes moyennes les plus aisées, ne profitant plus de l'assurance maladie, de diverses prestations sociales... mèneront une bagarre politique tout à fait compréhensible pour réduire davantage encore le niveau des prestations versées. Or, ce n'est pas le RSA qui grève très lourdement nos comptes publics...
De plus, le niveau élevé des dépenses sociales françaises joue un rôle très important dans la réduction des écarts de revenus entre les différentes régions, donc dans l'équilibre du territoire et dans la cohésion nationale. C'est l'une des grandes différences qui existent entre la France et l'Allemagne : celle-ci est un pays beaucoup plus équilibré que le nôtre, même après la réunification. Que se passe-t-il en Corrèze ou en Creuse si l'on réduit fortement les dépenses publiques ? Certains estiment que les métropoles sont handicapées par ces niveaux de transfert. Mais comment les métropoles conserveraient-elles leur compétitivité dans un pays dévasté ?
Vous posez aussi la question de l'efficacité de l'État. Dans ce domaine, le problème français est réel. Albert Hirschman, économiste américain, a distingué dans un livre célèbre trois stratégies d'actions individuelles : exit, voice et loyalty. Les consommateurs utilisent la stratégie d'exit lorsqu'ils ne sont pas contents d'un produit : ils vont voir ailleurs. Dans un contexte institutionnel, la stratégie principale est en revanche celle de la voice, celle où l'on choisit en quelque sorte de donner de la voix. Or elle est particulièrement difficile à manier dans notre État, qui a hérité des traditions monarchiste, jacobine, napoléonienne, gaullienne... Notre État s'est toujours situé très en surplomb des citoyens, et considère qu'il n'a pas de comptes à rendre à la société. C'est l'un des facteurs majeurs de son inefficacité, par comparaison par exemple avec la Scandinavie.
J'en arrive au plan Juncker. L'idée de renforcer l'investissement est effectivement acceptable politiquement, y compris par les Allemands, et elle est judicieuse pour relancer la demande dans la zone euro. Le niveau de dépenses prévu, cela a été dit, demeure extrêmement faible : à supposer même que les 315 milliards soient effectivement dépensés, c'est une somme infime par rapport au PIB de la zone euro. La question des délais se pose également. Mais cette opportunité est intéressante.
Le problème principal, c'est que nous avons besoins d'investissements, mais pas de béton supplémentaire. On en a déjà coulé énormément en Espagne... Nous avons essentiellement besoin d'investissements immatériels – en éducation, en recherche ; or, ces investissements sont le plus souvent comptabilisés comme des dépenses de fonctionnement. M. Juncker en a conscience, puisqu'il prévoit de financer aussi ce type de dépenses. Mais cela peut constituer un obstacle. L'idée que les dépenses d'investissement seraient bonnes alors que les dépenses de fonctionnement seraient mauvaises, assez répandue dans le débat public, est particulièrement fausse : l'essentiel des dépenses d'investissement publiques revêtent aujourd'hui un caractère immatériel ; ce sont pour nos différents États des dépenses de fonctionnement.
Cette initiative pourra surtout se révéler positive si elle marque la naissance d'une politique industrielle européenne. C'est un point sur lequel l'Europe a toujours échoué jusqu'à maintenant : Arianespace ou Airbus sont nés de coopérations entre États, en dehors des institutions européennes. L'Assemblée nationale devra toutefois demeurer vigilante, car il ne faudrait pas créer encore une structure intergouvernementale... Nous en avons déjà créé trop durant la crise. Le débat sur la gouvernance, je le sais, a eu lieu entre la Commission européenne et les États membres, en particulier la France.
Le financement de ce plan constitue une autre limite. Certains points ont déjà été soulevés : l'éventuel financement complémentaire des États ne doit en effet pas être compté comme déficit public supplémentaire. En revanche, il existe une solution assez simple pour financer le plan : c'est d'utiliser la BCE. Celle-ci se demande aujourd'hui comment regonfler son bilan, et elle va peut-être être amenée à agir d'une façon qui déplaira profondément aux Allemands, en achetant des titres de dette publique des États. Si nous sommes tous d'accord pour relancer l'investissement en Europe et pour mobiliser des moyens importants pour ce faire, il est facile de demander à la BCE d'agir.

Cette audition est extrêmement bienvenue dans la situation gravissime que nous connaissons : je crois en effet, comme M. Duval, que la France n'est pas l'homme malade de l'Europe. En revanche, l'Europe est le continent malade d'une économie mondiale qui est, elle, sortie de la crise. Au mois d'août, un éditorial du New York Times pointait du doigt le marasme européen, y voyant le résultat des « politiques erronées que les dirigeants européens s'obstinent à poursuivre, en dépit de toutes les preuves qu'il s'agit de mauvais remèdes ». Ces mauvais remèdes, ce sont des politiques qui sont pertinentes quand on est seul à les conduire, mais qui peuvent devenir catastrophiques quand tout le monde s'y met. Taillez dans les dépenses publiques : si vous êtes seul à le faire, cela réduira votre déficit, parce que la croissance sera soutenue par vos partenaires. Baissez le coût du travail : si vous êtes seul à le faire, cela rétablira l'équilibre de votre commerce extérieur si vos partenaires ne font pas la même chose, même si leur vie en sera compliquée. Mais, quand tout le monde taille dans les dépenses publiques et baisse le coût du travail, on perd sur tous les tableaux : l'effet dépressif est tel que l'on perd en recettes ce que l'on a cru gagner en réduction de dépenses. C'est toute l'histoire européenne de ces trois dernières années. Et, si tout le monde réduit le coût du travail, les conséquences sur la compétitivité s'annulent. Au total, les prix baissent, et c'est la déflation.
Comment sortir de cette situation que l'Europe n'a encore connu qu'une seule fois dans de telles proportions – dans les années 1930 ? Des politiques non coopératives – où chacun croit améliorer sa situation propre, sans se rendre compte qu'il complique celle des autres, pour arriver au total à des résultats qui s'annulent – ont déjà été menées, plus récemment : M. Pisani-Ferry comme M. Duval s'en souviennent certainement, cela a fait partie des débats des années 1980.
Aujourd'hui, M. Duval l'a dit : l'Europe dispose d'un excédent extérieur de 240 milliards d'euros. Les autres pays nous reprochent d'ailleurs de peser sur la croissance mondiale, par une demande intérieure trop faible, par des excédents extérieurs trop élevés. Quelle politique mener ? Bien sûr, on peut investir les 315 milliards du plan Juncker. Je rappelle toutefois que nous avions, en 2012, voté 120 milliards d'investissements dont je ne sais pas trop ce qu'ils sont devenus... En tout cas, cela paraît insuffisant.
Quel est, à votre sens, le bon rythme de réduction des déficits structurels ? On peut toujours dire que l'Europe a besoin de changer de politique, mais la France et l'Allemagne représentent déjà la moitié de la zone euro : on peut bien plaider pour que l'Europe agisse, mais elle ne fera finalement que ce que font les pays qui la composent.

Chacun s'accorde à juger le plan Juncker limité ; son impact est très incertain. Pour le mettre en oeuvre rapidement, il ne faut pas, me semble-t-il, négliger les infrastructures. M. Cameron a d'ailleurs tout de suite annoncé de grands travaux sur les autoroutes britanniques. On ne peut donc pas aujourd'hui se détourner du béton, du bitume et des voies ferrées : les nouvelles technologies sont fondamentales, mais pour aller vite, ne faut-il donner la priorité aux infrastructures lourdes ?

Cette audition de deux économistes d'orientations différentes est en effet tout à fait bienvenue.
Je voudrais vous faire de mon grand scepticisme sur la portée du plan d'investissement de M. Juncker – c'était, pour le coup, l'un des points d'accord entre nos deux intervenants, même si ce plan a été largement soutenu.
Comment croire que, dans une situation très déprimée, 21 milliards d'euros d'argent public – soit la moitié du pacte de responsabilité français – vont entraîner des investissements de 315 milliards d'euros ? Comment la Commission européenne a-t-elle imaginé un multiplicateur de 15 ? Cela paraît à tout le moins extrêmement ambitieux, surtout quand cette même Commission presse les États de poursuivre les politiques d'ajustement budgétaire. Comment allons-nous sortir de cette spirale ?
Messieurs, vous avez à juste titre souligné l'importance économique de notre pays, deuxième économie de l'Union européenne. Nous avons sauvé la zone euro ; en contrepartie, nos dirigeants ne devraient-ils pas se montrer plus fermes et obtenir que l'Union mène des politiques plus ambitieuses ?

Je voudrais revenir sur le point précis de la sélection des investissements et de son lien avec le rétablissement des comptes publics.
Les investissements sont importants, mais ils ne sont pas la panacée : l'histoire récente est là pour nous montrer que des dépenses d'investissement peuvent se solder par un accroissement de la dette et des déficits. De surcroît, les coûts externes – notamment les coûts environnementaux ou sociaux – sont rarement pris en compte. Les coûts de maintenance, d'entretien d'un bâtiment, par exemple, peuvent également se révéler très importants.
Il est donc d'autant plus important de bien choisir les investissements que nous réalisons, et je voudrais plaider pour que la priorité soit accordée aux investissements dans la transition énergétique, qui sont sans doute les seuls dont le temps de retour est connu, et sans doute les seuls également à entraîner des baisses de dépenses, notamment sur la facture énergétique. C'est d'autant plus important lorsqu'il s'agit de bâtiments publics, et donc de dépenses publiques : les investissements qui permettent d'économiser de l'énergie ou d'utiliser des énergies renouvelables contribuent à l'amélioration de la situation de nos finances publiques.
Le problème, c'est que nous aimons bien les grands travaux, les grandes infrastructures, qui coûtent des milliards et qui mettent en valeur ceux qui les ont décidés ; nous savons moins bien, nous aimons beaucoup moins financer des millions de petits travaux, infiniment moins valorisants. C'est pourtant l'enjeu essentiel. De plus, comme ce sont des travaux qui entraînent des économies, on peut en réaliser plus encore...
Je suis pour ma part opposé à l'idée de ne pas prendre en considération les investissements publics dans les déficits. Que l'on se donne plus de marge, soit ; mais les mettre sous le tapis pour les voir surgir à nouveau dans quelques années ne me paraît pas une bonne solution.

Messieurs, partagez-vous l'idée selon laquelle la priorité doit être donnée à l'amélioration de la compétitivité des entreprises françaises, alors que leur rentabilité est la plus faible d'Europe ? Dans l'affirmative, quelles doivent être les mesures prioritaires pour améliorer la compétitivité et relancer l'investissement des entreprises françaises ?

Je me réjouis moi aussi de l'organisation de cette audition, alors que la déflation nous menace.
Le plan présenté par la Commission ne représente, M. Duval l'a rappelé, qu'une part extrêmement faible du PIB de la zone euro : c'est un premier pas insuffisant, mais encourageant, puisque le levier de l'investissement était presque oublié, et aussi parce que le plan est orienté vers le numérique, la transition énergétique, la recherche.
Des questions continuent de se poser, sur le montant global bien sûr, mais aussi sur la part des ressources publiques mobilisées, sur le redéploiement éventuel de certains crédits, sur la gouvernance... On envisage de ne pas prendre en compte dans le calcul des déficits certains investissements publics : cela prouve, je le souligne, que c'est possible, comme nous sommes quelques-uns à le dire depuis une quinzaine d'années.
Le plan Juncker et la nouvelle politique de la BCE semblent montrer une amorce de réorientation de l'Union – ce que souhaitent les peuples. Cette stratégie européenne doit être menée en coordination avec les différentes stratégies nationales, car les États membres n'étant pas tous dans la même situation, ils ont besoin de mener des politiques différentes : certains ont besoin de relancer leur demande intérieure et l'investissement, d'autres – comme la France – doivent réduire leurs déficits, budgétaire et commercial tout à la fois. Il nous faut pour cela une stratégie globale de compétitivité, qui n'agisse pas seulement sur les prix mais aussi sur la montée en gamme, sur la formation... Comment articuler ces stratégies, à chaque échelle ?
Les seules règles communes évoquées par la Commission sont celles qui concernent le déficit budgétaire. D'autres existent pourtant, notamment en cas d'excédent extérieur excessif. J'aimerais entendre nos deux invités sur ce point.

La résolution des problèmes économiques que vous avez mis en évidence passe aussi par une amélioration de la gouvernance de l'Union : on le voit bien, la prise de décision politique est loin d'être optimale. Comment améliorer le fonctionnement de nos institutions ?

Les politiques menées par les États membres risquent d'engendrer un effet récessif, au moment même l'Union européenne tente de mener une politique de relance. Si le plan Juncker demeure ce qu'il est, si les investissements publics n'augmentent pas, si les investisseurs privés ne sont pas au rendez-vous, ne sera-t-il pas nécessaire de faire évoluer les politiques nationales ? Si l'Europe ne prend pas ses responsabilités, les États ne devront-ils pas reprendre les leurs ?

Je voudrais faire part de mon scepticisme sur la nature des trente-deux projets français qui ont été transmis à la Commission européenne dans le cadre du plan Juncker. On y trouve la modernisation de la ligne ferroviaire Serqueux-Gisors, des programmes de rénovation urbaine... Il s'agit pour l'essentiel de grands projets publics, où le financement européen vient se substituer au financement public national, voire à des financements privés. Ainsi, il avait toujours été dit que le financement du Charles-de-Gaulle Express serait entièrement privé. Certains projets étaient déjà lancés.
Comment ce type de projet pourrait-il avoir un effet de levier comme celui attendu par le plan Juncker ? Il me semble qu'il y a là un dévoiement de l'esprit du plan de la Commission européenne.

Je remercie à mon tour les deux intervenants. Le plan Juncker est, vous l'avez dit, très insuffisant.
Les projets mentionnés par Eva Sas me paraissent importants : le ferroviaire, notamment, constitue un enjeu très important pour la mobilité comme pour la transition énergétique.
La BCE prête déjà aux PME et aux ETI, mais nous n'utilisons aujourd'hui que la moitié des prêts disponibles. La situation de l'investissement privé est donc inquiétante.
Y aura-t-il des critères pour s'inscrire dans le plan Juncker, en termes d'emplois par exemple ?
Chers collègues socialistes, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi – CICE – et le crédit d'impôt recherche – CIR – ne pourraient-ils pas constituer un apport intéressant pour ces investissements, afin de faire progresser l'emploi, qui est finalement la seule question qui compte ?
À la différence de Guillaume Duval, j'estime que la BCE doit être exclusivement chargée de la politique monétaire. Elle s'apprête aujourd'hui à franchir le Rubicon et à acheter des titres publics. Personne ne peut contester qu'une banque centrale ne soit parfois amenée à mener des politiques non conventionnelles de ce type, mais, dans le cas de la BCE, cela provoque de fortes réticences, en particulier en Allemagne. Pour que la BCE puisse avoir les mains libres et utiliser les instruments qu'elle maîtrise, j'estime donc – pour éviter les confusions – qu'elle doit se cantonner à la politique monétaire.
La BCE doit également être rassurée sur les politiques économiques et budgétaires. C'est elle qui, paradoxalement, appelle à une meilleure coordination : les gouvernements demandent à la BCE de prendre des initiatives, et donc des risques, tout en étant incapables de dessiner la moindre perspective à moyen terme... Nous sommes à front renversé par rapport à ce qui se passait il n'y a pas si longtemps, lorsqu'il n'était question que de préserver l'indépendance de la BCE et que la coordination était considérée comme une forme de cartel des États. Cela renvoie aux questions de gouvernance.
Ce qui compte finalement, c'est que l'impulsion budgétaire globale soit neutre ou positive. Aujourd'hui, nos prévisions montrent qu'elle est à peu près neutre, mais la distribution par pays pose problème : certains pays sont poussés à mener des politiques restrictives, sans que d'autres pays, comme l'Allemagne, ne soient invités à changer d'orientation. L'Allemagne cherche aujourd'hui à obtenir un équilibre, et même un excédent, budgétaire. Ce n'est pourtant pas la politique budgétaire qui serait souhaitable, au vu de la conjoncture économique européenne. C'est là le résultat d'une pure contrainte politique – ce n'est pas une conséquence du pacte de stabilité, ni des règles constitutionnelles dont l'Allemagne s'est dotée pour la dette, qui lui laisseraient aujourd'hui une marge de manoeuvre d'un point de PIB.
Il me semble donc qu'il faut laisser à la BCE la liberté de mener la politique monétaire qu'elle croit devoir mener, tout en progressant sur l'orientation des politiques budgétaires.
S'agissant du plan Juncker, son insuffisance a été largement soulignée. Je vous rejoins entièrement, madame Sas, sur le risque de substitution de financements européens à des financements français, ce qui n'aurait aucun effet macroéconomique. Il faut néanmoins, je crois, s'inscrire dans la perspective qu'ouvre ce plan, car c'est un moyen de faire évoluer les politiques européennes. Il y a une initiative de la Commission européenne, reconnue par tous comme positive : il faut lui donner du contenu, en insistant sur la priorité à donner à l'environnement et à la transition énergétique, et l'amplifier, en apportant des financements nationaux complémentaires. Mais le résultat, je le souligne, n'est absolument pas garanti : M. Muet a raison de rappeler les 120 milliards de l'été 2012, dont nul n'a jamais su ce qu'ils étaient exactement. La capacité des institutions comme la BEI à préférer accorder des crédits peu risqués plutôt que des crédits plus risqués ne doit jamais être sous-estimée : la vigilance reste de mise.
S'agissant de l'évolution des politiques nationales, il me semble que nous avons intérêt à nous inscrire dans la discussion européenne pour trouver un consensus. Le spectacle d'un affrontement entre les États sur les questions de politique économique n'impressionnerait sans doute pas favorablement les « agents d'ambiance » qui observent l'économie européenne... Cela risquerait en outre d'intimider la BCE.
Sur la France, enfin, je ne reprendrai pas à mon compte l'expression d' » homme malade de l'Europe », mais nous souffrons, je crois, d'un problème de compétitivité : il me semble que le diagnostic porté a été correct. Je partage bien sûr l'idée qu'un excédent important comme celui que connaît la zone euro n'est pas souhaitable dans les circonstances actuelles, et d'autant moins qu'il concourt à renforcer l'euro. Mais, pendant longtemps, notre croissance a été due au développement absolument insoutenable de certains de nos partenaires : nous avons ainsi beaucoup bénéficié de l'expansion espagnole. Mais aujourd'hui, la dette extérieure de l'Espagne s'élève à 100 % de son PIB ! Même si elle se redresse, et elle se redressera, il n'y aura pas de retour à l'état antérieur.
Nous devons donc résoudre nos problèmes de compétitivité, tant sur le plan des coûts que sur le plan de la qualité. Les efforts fiscaux que vous connaissez bien ne pourront pas être reproduits. C'est pourquoi Henrik Enderlein et moi-même avons voulu souligner que le CICE ou le pacte de responsabilité ne pouvaient pas avoir pour objet de financer des hausses de salaires. C'est une tendance qui existe, et elle est inquiétante ; il faut donc émettre sur ce point, je crois, des signaux forts. Mobiliser l'argent des contribuables pour augmenter les salaires des salariés déjà en place ne me paraît pas souhaitable.
Le plan Juncker est l'opportunité de lancer une politique industrielle européenne, et il faut la saisir. Ceux qui s'y sont le plus fortement opposés jusqu'à maintenant, ce sont les Allemands, mais les temps changent : il ne faut pas sous-estimer le rôle qu'ont joué l'affaire Edward Snowden et les révélations sur l'espionnage par la National Security Agency – NSA. Les Français sont habitués à être espionnés par un État qui ne rend pas vraiment de comptes, et ils considèrent aussi souvent que les Américains sont des méchants. Mais, pour les Allemands, cette affaire a constitué un traumatisme important : ils sont sensibles aux questions d'espionnage par les États, puisqu'ils ont rencontré quelques ennuis dans le passé, et ils considéraient plutôt les Américains comme des amis et des alliés fiables. Ayant mesuré les conséquences de notre dépendance vis-à-vis des États-Unis, ils sont prêts à engager une politique industrielle dans le secteur du numérique. C'est une occasion qu'il faudrait vraiment saisir ! Mme Merkel était venue voir M. Hollande, il y a quelques mois, pour proposer la création d'un internet européen, afin d'éviter que les données échangées en Europe ne passent notamment par le Royaume-Uni et ne soient espionnées par la NSA – mais cette proposition n'a malheureusement eu aucun écho en France.
S'agissant de la transition énergétique, tout le monde est en apparence d'accord. Il faut mesurer le caractère dramatique de la situation actuelle : le pétrole pas cher, pour la transition énergétique, c'est mortel ! Si nous ne sommes pas capables de mettre beaucoup d'argent, et beaucoup d'argent public, sur la table, nous l'aurons tuée au lieu de l'accélérer. C'est un enjeu crucial : la dépendance énergétique est la principale faiblesse structurelle de l'Europe ; si nous nous laissons berner par la baisse du prix du pétrole et que nous attendons pour agir – par manque de moyens publics – nous irons dans le mur, car dès la reprise de l'économie mondiale, nous serons terriblement handicapés.
Il serait intéressant d'envisager – même si c'est sans doute trop tard politiquement – que le Fonds européen d'investissement puisse peut-être lui-même lever des fonds, ce qui n'est pas très clair aujourd'hui. Le plan Juncker pourrait ainsi servir à lancer enfin les fameux eurobonds : les financements complémentaires ne seraient ainsi pas seulement nationaux, mais aussi européens.
Il y a, je le souligne, une contradiction entre la volonté de faire démarrer les investissements rapidement – ce qui implique que les projets sont mûrs – et celle d'investir dans des projets vraiment nouveaux. J'ignore si la représentation nationale a eu connaissance des projets avant leur transmission à Bruxelles – et pour tout dire, j'estime que ce goût pour le secret constitue l'un des vrais problèmes français. Mais mes lectures m'ont montré qu'une partie de ces plans étaient transversaux, ce qui est plutôt réjouissant. Je partage en effet le souci de M. Alauzet : il faut apprendre à financer des millions de petits travaux, les petits ruisseaux faisant en l'occurrence les grandes rivières. C'est, ai-je cru comprendre, le cas.
Vous avez raison, derrière tout cela, des questions de gouvernance se posent, notamment sur les choix entre structure intergouvernementale et structure vraiment communautaire. J'avais, avec beaucoup d'autres comme Xavier Timbeau ou Thomas Piketty, signé l'an dernier un Manifeste pour une union politique de l'euro, qui appelait notamment à la création d'un parlement pour la zone euro. Ce ne serait certes pas une solution à court terme, mais cela permettrait d'amener progressivement les Allemands à sortir d'une logique de règles. La question démocratique en Europe est infiniment sérieuse pour les Allemands – l'histoire leur en a appris l'importance. C'est le caractère insuffisamment démocratique de l'Europe qui les retient de soutenir des politiques vraiment européennes. L'enjeu est donc majeur.
En matière de normes, il est exact que les Allemands dépassent, pour la deuxième année consécutive, la norme de 6 % d'excédent extérieur prévue par le six-pack – et cette norme était déjà très élevée, pour ne pas leur faire de peine. Il serait bon que la Commission européenne prenne des mesures, ou à tout le moins change d'attitude sur ce problème.
S'agissant de compétitivité enfin, je ne crois pas que les mesures prises aujourd'hui en France en matière de compétitivité-coût soient de nature à améliorer en quoi que ce soit la compétitivité de l'économie française vis-à-vis de la Roumanie, de la Pologne ou de la Chine. Nous menons en réalité une politique agressive vis-à-vis de nos voisins immédiats, en reprenant des parts de marché aux Belges, aux Italiens, aux Espagnols... En retour, ils vont eux-mêmes plus loin dans la course à l'échalote vers le moins-disant social. Cela ne résoudra pas les problèmes de compétitivité des entreprises françaises, et encore moins ceux de l'Europe dans son ensemble.

Avant de devoir s'éclipser, le président Brottes m'a glissé qu'il aurait aussi voulu vous entendre préciser – extrêmement rapidement – vos propos sur la Russie.
C'est une vaste question ! Chacun voit aujourd'hui les conséquences pour la Russie de la baisse du prix du pétrole, qui s'ajoute à tous les facteurs, eux aussi connus, qui ont entraîné des sorties de capitaux. Nous ne savons pas encore si la baisse de moitié du rouble provoquera une crise financière proche de celle de 1998. Nous ignorons tout des effets de contagion qu'une telle crise pourrait avoir.
Pour m'en tenir strictement à l'économie, la baisse du pétrole souligne, on le voit, des fragilités.
Quant à la transition énergétique, j'ajouterai aux propos de Guillaume Duval que je ne crois pas, pour ma part, qu'il faille des ressources supplémentaires ; c'est au contraire le moment pour nous de faire remonter le prix du carbone et de créer une fiscalité environnementale : maintenant, ce serait indolore ! Et c'est, sur le fond, la bonne politique.
C'est difficile à réaliser, mais il y a peu de doutes sur la voie à suivre.
La séance est levée à 13 h 05