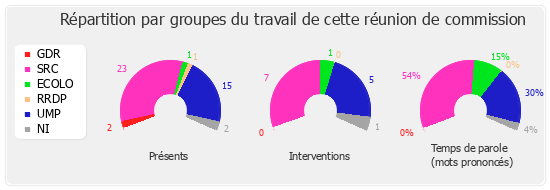Commission des affaires étrangères
Réunion du 28 janvier 2015 à 9h00
La réunion
Audition, ouverte à la presse, de M. Stéphane Lacroix, chercheur et professeur associé au CERI (Centre d'études et de recherches internationales), et de Mme Brigitte Curmi, conseillère des affaires étrangères et chargée de mission au CAPS (Centre d'analyse, de prévision et de stratégie), sur l'islamisme en Afrique du Nord et au Proche et Moyen-Orient.
La séance est ouverte à neuf heures cinquante.

Monsieur Lacroix, madame Curmi, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Islamisme, djihadisme, terrorisme : l'usage de ces termes souffre d'une grande confusion qui – on l'a vu sur l'exemple de l'État islamique ou Daech – peut nourrir les amalgames les plus dangereux. L'enjeu n'est donc pas uniquement sémantique, mais également politique.
Nous serons attentifs à votre présentation des diverses déclinaisons de l'islam contemporain, des points communs et des divergences entre les tendances. Quelle est le degré de perméabilité entre différents mouvements ? Quel est l'état des rapports de forces entre, et au sein de ces courants ? De quel type de soutiens bénéficient-ils ? En effet, il s'agit d'une bataille interne à l'islam, encouragée par certains régimes et sous-tendue par des luttes d'influence entre acteurs régionaux. Comment expliquez-vous l'attrait exercé par le djihadisme sur les jeunes, y compris européens ? Au-delà de la réponse sécuritaire – nécessaire, mais insuffisante –, comment lutter efficacement contre cette tendance ? Quel regard portez-vous sur l'évolution de l'islamisme dit politique, historiquement incarné par les Frères musulmans dont l'influence a marqué une nébuleuse de mouvements plus ou moins étroitement associés, de la Jordanie au Yémen en passant par la Tunisie ou la Palestine ? Est-il possible – et si oui, à quelles conditions – d'entamer un dialogue politique avec certains d'entre eux ? Comment expliquez-vous la capacité de quelques organisations, comme Ennahda en Tunisie ou le Parti de la justice et du développement (PJD) au Maroc, à élaborer un socle théorique original qui les a amenés à s'inscrire dans le cadre d'une démocratie élective ?
La large liberté de parole et d'analyse dont jouit le CAPS –nous sommes encouragés à produire des analyses et des recommandations qui ne sont pas toujours prises en compte– en fait un observatoire de choix du monde arabe et de ses soubresauts. Nous ne vous livrerons donc pas aujourd'hui la ligne officielle du ministère des affaires étrangères. Le CAPS est composé d'une équipe mixte de diplomates et de chercheurs qui s'intéressent aux problématiques géographiques et thématiques du monde entier ; nous recrutons également des consultants permanents, comme Stéphane Lacroix, qui nous donnent leur point de vue sur des sujets ponctuels– opportunité précieuse dans le contexte actuel.
Fin 2014, jugeant nécessaire de faire le point sur l'islamisme dans le monde arabe, nous avons délivré au ministre une note s'intitulant « Trois nuances de vert » pour clarifier les doctrines dont s'inspirent différents mouvements islamistes. Au déclenchement des printemps arabes en 2011, les médias en Orient et en Occident ont cru déceler des signes de disparition de l'islamisme. Il est vrai que les premières manifestations à Tunis comme au Caire n'étaient pas le fait d'islamistes, qui se sont investis plus tard dans la contestation. Toutefois, plus de quatre ans après la mort de Mohammed Bouazizi à Sidi Bouzid, force est de constater que les transitions en Tunisie, au Yémen et au Caire – ainsi que celle que l'on espère le plus tôt possible observer en Syrie – ont replacé la question de l'islamisme au coeur des débats. Les sociétés comme les gouvernements se définissent aujourd'hui pour ou contre l'islamisme, plaçant cette problématique au centre de la politique intérieure et des options diplomatiques des pays de la région.
Pourtant la plus grande confusion règne dans l'utilisation des termes liés à l'islamisme. Celui-ci n'étant pas une catégorie en soi, des phénomènes polymorphes et hétérogènes sont volontairement amalgamés de part et d'autre de la Méditerranée, dans une perspective d'instrumentalisation politique. Tout se passe comme si, à travers la place à donner ou non à l'islamisme, les pouvoirs politiques en quête de légitimité, ainsi que les sociétés déboussolées par les incertitudes – voire le chaos – qui accompagnent les transitions, cherchent ainsi à redéfinir les espaces politiques et les nouveaux rapports de forces.
Notre note marque le lancement d'un groupe de travail qui oeuvrera tout au long de l'année 2015 ; en effet, loin de se réduire à un débat intellectuel, la bataille des noms et des définitions représente un enjeu politique pour la France. Déconstruire le concept et en connaître les différentes déclinaisons – des moins problématiques aux plus dangereuses – constitue une étape indispensable pour décrypter le discours de nos partenaires et en tirer les conclusions qui s'imposent. Cette remarque répond déjà en partie à la question de savoir avec qui et comment nous pouvons dialoguer.
Le CAPS a fait ici le choix de se limiter à une typologie de l'islamisme sunnite, branche majoritaire de l'islam dans le monde arabe. Dans le cadre d'un groupe de travail, nous réaliserons des études de cas par pays et examinerons aussi l'expression de l'islamisme au sein de la communauté chiite. L'année dernière, nous avions mené le même type de travail sur la problématique sunnite-chiite ; nous pouvons vous communiquer l'article qui en est issu, à paraître dans le prochain Carnets du CAPS.
À nos yeux, même si bien des régimes s'en réclament, il n'existe pas dans le monde arabe de pouvoir « laïc ». L'islamisme constitue aujourd'hui l'expression d'un questionnement identitaire profond au sein de ces sociétés, qui a commencé avec le déclin de l'Empire ottoman et la disparition du Califat en 1924, puis a été réprimé ou occulté durant les périodes autoritaires pour resurgir avec force à l'occasion des printemps arabes. Longtemps évitée ou écrasée, la question se pose aujourd'hui dans toute sa complexité. L'islamisme éclot au sein de sociétés où la religion joue un rôle constitutif, y compris quand elles sont abusivement qualifiées de laïques. Tous les pays arabes – à l'exception notable du Liban, le seul à compter un président chrétien – ont inscrit l'islam comme religion d'État dans leur constitution, y compris la Tunisie de Bourguiba. Tous les dirigeants doivent attester sous une forme ou une autre de leur légitimité religieuse : le « commandeur des croyants » au Maroc, le « gardien des deux lieux saints » en Arabie Saoudite… Les médias organisent la mise en scène de la religiosité des présidents – Bouteflika, Moubarak, Assad – à travers des reportages sur leur fréquentation des mosquées, leurs pèlerinages à La Mecque ou leurs visites auprès des clercs. Aucune avancée sociétale majeure n'a pu voir le jour sans être soutenue par l'establishment religieux. Ainsi, le très réputé code de statut personnel en Tunisie, adopté au milieu des années 1950, avait dû être justifié en termes islamiques et adoubé par le clergé avant de devenir la mesure phare de Bourguiba. De même, la réforme du code de la famille (mudawana) au Maroc a été présentée aux électeurs par les autorités religieuses comme le seul choix possible. Enfin, le divorce n'a été autorisé en Égypte qu'après consultation d'Al-Azhar, pour ne citer que quelques exemples de cette prégnance du facteur religieux dans tous les aspects de la vie. Les chercheurs et observateurs relèvent que le passage des Frères musulmans en Tunisie et en Égypte a paradoxalement permis d'ouvrir sur les réseaux sociaux un débat auparavant tabou sur l'athéisme, dont il faudrait suivre le progrès avec les allers-retours de la transition.
Comme en attestent les scores des partis islamistes depuis les printemps arabes – entre 30 et 40 % des voix en Tunisie, jusqu'à 70 % en Égypte –, l'islamisme représente aujourd'hui l'une des deux grandes tendances qui dominent le champ politique de ces pays, et l'ampleur de son reflux actuel reste à mesurer. Dans notre étude, nous avons cherché à dégager trois grands courants de l'islamisme dans le monde arabe ; même si l'on peut identifier des correspondances avec l'expression du phénomène en Occident, la question s'y pose très différemment.
Les courants qui se réclament aujourd'hui de l'islamisme ont en commun la contestation de l'ordre établi et de l'islam officiel, c'est-à-dire des clercs religieux agréés par les États, dont le parangon en Égypte est l'université Al-Azhar. De même, ils ont tendance à déprécier « l'islam traditionnel » : la pratique routinière et souvent mâtinée de rites populaires comme le culte des saints, présente chez une partie importante des musulmans. Les plus rigoristes englobent dans ce rejet les adeptes du soufisme, partisans d'un islam plus mystique. Tous les islamistes partagent l'idéal d'une société dans laquelle l'islam occuperait une place centrale ; tous prônent le recours à la charia – l'ensemble de règles édictées par les textes sacrés de l'islam –, mais l'acception donnée à ce terme varie d'une tendance à l'autre et fait l'objet de débats très vifs. Les plus libéraux considèrent qu'il s'agit juste d'un cadre éthique, d'autres y voient une norme socioreligieuse, d'autres encore en font le fondement de la législation. De nombreuses nuances existent – y compris parmi ceux qui voient dans la charia un texte de loi – sur l'application plus ou moins littérale des textes religieux.
Les islamistes peuvent être classés en trois grandes catégories aux objectifs différents, voire contradictoires. Tout d'abord, la famille salafiste englobe les mouvements centrés sur un puritanisme religieux et social extrême, mais qui se désintéressent du politique. C'est aujourd'hui l'islam officiel saoudien – qualifié le plus souvent de wahhabisme, même si ses tenants rejettent ce terme –, mais également une tendance répandue dans tous les pays arabes, du Golfe jusqu'au Maghreb. La plupart des régimes autoritaires arabes ont favorisé les mouvements salafistes depuis les années 1970, y voyant un contre-feu utile face à d'autres tendances islamistes plus politisées. Hosni Moubarak en Égypte, mais aussi les régimes tunisien et algérien après les années noires ont ainsi opté pour cette stratégie.
Les adeptes de ce courant salafiste veulent appliquer l'orthodoxie sunnite dans sa version la plus stricte. Ils se concentrent sur la prédication et visent une islamisation des sociétés par le bas. En revanche, ils ne sont pas intéressés par le pouvoir et beaucoup ont longtemps rejeté la politique partisane. Ils acceptent l'autorité des États du moment que ces derniers les laissent libres dans le champ religieux. L'Arabie Saoudite constitue la version la plus aboutie de cette relation puisque le mouvement salafiste y a délégué la gestion du politique à la famille Al-Saoud depuis la fondation du Royaume, en vertu du pacte conclu en 1744 entre le théologien Mohammed Abd Al Wahhab – qui a donné son nom au wahhabisme – et le fondateur de la dynastie saoudienne Mohammed Ibn Saoud. En retour, les salafistes attendent des autorités saoudiennes qu'elles imposent une norme sociale coulée dans leur doctrine : imposition d'une police des moeurs très regardante, interdiction de la mixité et de pratiques considérées comme idolâtres.
Se posant en défenseurs de l'orthodoxie sunnite, les salafistes sont profondément hostiles au chiisme et ne tolèrent pas davantage les pratiques sunnites jugées hétérodoxes comme le culte des saints, à l'égard duquel certains vont jusqu'à recommander la destruction de mausolées nonobstant leur valeur patrimoniale. Ils tiennent ainsi les soufis pour de dangereux déviants ; ils tolèrent les chrétiens, mais leur assignent le statut discriminant de dhimmi.
Si la majorité des salafistes refuse de s'occuper de politique, une minorité d'entre eux a évolué vers une politisation partielle au cours des deux dernières décennies. Ces « salafistes activistes » estiment qu'il faut se constituer en lobby religieux lorsque la situation politique le permet pour demander encore plus de rigueur. Leur objectif n'est toujours pas de prendre le pouvoir, mais d'influencer la prise de décision politique. Ce groupe ressemble peu ou prou aux partis ultra-orthodoxes en Israël, qui sont prêts à s'allier politiquement à des partis non religieux en échange de certaines concessions. En Égypte, le parti salafiste Al-Nour – qui avait obtenu 30 % des voix aux élections de 2011, a soutenu le renversement des Frères musulmans et soutient aujourd'hui le pouvoir militaire du maréchal Al-Sissi – correspond à cette définition.
La famille politique – deuxième courant de l'islamisme – considère l'islam comme un vecteur pour parvenir au meilleur système de gouvernement possible, en conformité avec les injonctions des textes sacrés. À l'inverse des salafistes, ces islamistes s'intéressent peu aux questions théologiques stricto sensu, mais se concentrent sur l'action politique pour arriver à leurs fins. La naissance de ce courant est l'une des conséquences du large débat entre intellectuels arabes et musulmans à la chute de l'Empire ottoman et à la suppression du Califat par Atatürk en 1924. La première organisation représentant cette tendance est la Confrérie des Frères musulmans fondée en 1928 par l'instituteur égyptien Hassan Al-Banna. Ce dernier place d'emblée son action dans un cadre politique, avec l'objectif de réformer les pouvoirs existants pour les rapprocher du « modèle islamique ». Al-Banna ne précise pas les contours de ce modèle, ce qui donnera lieu à des interprétations diverses selon les époques ; pour autant, les Frères musulmans adopteront toujours le principe de la participation au système en place, afin d'être en mesure de le réformer de l'intérieur. Le mouvement s'étend dès les années 1940 à l'ensemble du monde arabe. Toute une nébuleuse de mouvements en est issue, aux liens plus ou moins étroits avec la Confrérie égyptienne. On trouve ainsi des groupes identifiés comme Frères en Jordanie et en Syrie, et des organisations liées à la Confrérie comme le Hamas en Palestine. D'autres mouvements nés de la tradition intellectuelle frériste s'en sont détachés pour produire un socle théorique distinct sur la compatibilité entre islam et démocratie. C'est le cas du mouvement Ennahda en Tunisie, du parti Al-Wasat en Égypte, et, dans une moindre mesure, du parti Al-Islah au Yémen – dont une des militantes, Tawwakul Karman, a reçu le Prix Nobel de la paix en 2011 – et du PJD au Maroc. À la différence des Frères musulmans, dont le principe d'organisation confrérique favorise le caractère autoritaire – guide élu à vie, obéissance inconditionnelle à la hiérarchie –, ces mouvements ont un mode de fonctionnement plus collégial et démocratique.
Concentrés sur leur volonté de réforme des pouvoirs en place, les Frères se sont le plus souvent adaptés aux conditions du moment. Ils ont ainsi pu se déclarer partisans d'une monarchie constitutionnelle dans les années 1930, puis adopter le langage propre au système démocratique à partir des années 1980. Alors que l'objectif premier d'Hassan Al-Banna était l'établissement d'un « État islamique » aux contours largement indéfinis, les Frères musulmans parlent aujourd'hui plus volontiers d'un « État à caractère civil mais de référence islamique ». Pourtant la déclinaison concrète du modèle du père fondateur reste floue et les clivages sont nombreux, alors que se creusent les différences générationnelles entre une vieille garde gardienne du temple et de jeunes Frères désireux de faire évoluer la Confrérie vers une plus grande modernité politique. Ces clivages opposent les « conservateurs » – plus proches d'une vision holiste et potentiellement autoritaire du pouvoir – aux « réformateurs », qui s'identifient plus aisément au modèle de l'État-nation démocratique. À titre d'exemple, le débat reste ouvert sur la nécessité d'attester de l'islamité des lois par un comité de clercs ou sur la possibilité d'élire un chrétien à la présidence de la République. Les Frères musulmans d'Égypte l'avaient cependant accepté de fait puisque la Constitution adoptée en 2012 sous Mohamed Morsi le permettait.
En tout état de cause, les islamistes politiques issus de la mouvance des Frères musulmans sont tournés vers un but avant tout politique et non vers la défense à tout crin d'une orthodoxie sunnite. On trouve ainsi des Frères musulmans proches des soufis, alors que d'autres sont plus salafisés. En d'autres termes, pour autant qu'ils le souhaitent, les Frères musulmans sont plus en mesure que la famille salafiste de composer avec la pluralité, qu'elle soit musulmane – chiite ou soufie – ou celle des « gens du Livre » – juifs et chrétiens. Ainsi, Rafic Habib, le numéro deux de Justice et liberté, parti politique des Frères musulmans égyptiens interdit en 2014, était copte – chose impensable pour un parti salafiste.
La dernière catégorie d'islamistes – la famille jihadiste – ne croit pas à la réforme des pouvoirs existants et prône leur renversement par la violence pour les remplacer par un État islamique fantasmé supposé correspondre aux premiers temps de la révélation coranique. Aujourd'hui, il s'agit aussi bien d'Al-Qaïda et de ses avatars – tels qu'Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA) ou Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) – que de Daech en Syrie et en Irak.
Le jihadisme puise sa doctrine dans les écrits de Sayyed Qotb, Frère musulman emprisonné et torturé par Nasser dans les années 1950, qui en vient à prôner une approche révolutionnaire en lieu et place de la stratégie graduelle et réformiste des débuts de la Confrérie. Profitant de la marge d'interprétation laissée par le fondateur des Frères musulmans à la notion d'État islamique, Sayyed Qotb estime qu'il s'agit d'imposer la souveraineté de Dieu sur la terre face à une société mécréante. Les écrits de Qotb seront dûment réfutés en 1969 par Hassan Hudaibi, alors guide des Frères musulmans, mais ils inspireront différents mouvements radicaux qui se constituent en marge de la Confrérie et en deviennent les enfants terribles.
Les premiers jihadistes dirigent leur violence contre les régimes arabes. C'est le cas du Gihad et de la Gamaa islamiyya en Égypte qui s'allient en 1981 pour assassiner le président égyptien Anouar el-Sadate. Ils sont aussi extrêmement virulents contre les Frères musulmans qu'ils accusent d'avoir trahi l'idéal islamique. Ainsi, le premier ouvrage d'Ayman Al-Zawahiri – ancien membre du groupe Gihad et actuel dirigeant d'Al-Qaïda – était un brûlot contre la Confrérie. Dans les années 1990, les jihadistes ajoutent l'Occident à la liste de leurs cibles terroristes et se globalisent. Au-delà du combat contre les régimes dans le monde arabe et musulman, ils estiment qu'il faut s'attaquer à l'Occident dans son ensemble, responsable selon eux du maintien en place de pouvoirs impies et corrompus dans le monde arabe. Ainsi naissent Al-Qaïda et la théorie peaufinée par Ayman Al-Zawahiri à la fin des années 1990, selon laquelle on ne peut dissocier le combat contre l'« ennemi lointain » – les États-Unis et l'Occident – et l'« ennemi proche » – les régimes arabes.
S'ils s'inspirent au départ des Frères musulmans dont ils ont radicalisé la doctrine, la plupart des djihadistes ont adhéré au fil du temps aux conceptions religieuses des salafistes, tout en rejetant le quiétisme de ces derniers. Ils reprennent à leur compte la vision manichéenne d'un islam salvateur se dressant contre un monde impie. Le concept de « l'allégeance aux vrais musulmans et [de] la rupture avec les infidèles » (al wala' wa-l-bara'), emprunté aux théories wahhabites du dix-neuvième siècle, devient central pour ces djihadistes globaux. De même, alors qu'il était quasiment absent de la matrice des Frères musulmans, l'anti-chiisme devient de plus en plus prégnant au milieu des années 2000, tant chez le fondateur d'al-Qaida en Irak Abou Mousab al-Zarqaoui dans les années 2004-2005 qu'aujourd'hui au sein de Daech. Il s'agit d'une relative nouveauté puisque Ben Laden – qui voulait peut-être éviter tactiquement l'hostilité de l'Iran – évoquait très peu la question sunnite-chiite.
Enfin, les djihadistes se divisent aussi sur le plan stratégique. Certains, comme Al-Qaïda et Jabhat Al-Nosra en Syrie, comparables aux trotskystes en leur temps, veulent faire triompher le djihad global en exportant leur vision de l'islam, de manière à inverser le rapport de forces global en leur faveur, ce qui seul permettra l'établissement d'un califat définitif et rédempteur. La lutte passe ici avant l'établissement du modèle. D'autres, comme Daech aujourd'hui, suivent une logique plus « stalinienne » en visant l'établissement du califat ici et maintenant, sur un territoire donné à partir duquel le djihad global pourra s'exporter.
Quelle est l'importance relative de ces trois courants et leur perméabilité ? Historiquement, l'islamisme politique a été – et reste – dominant. Le courant salafiste a gagné en audience ces trente dernières années ; ainsi, l'une des grandes surprises des premières élections législatives en Égypte n'est pas que les Frères musulmans arrivent premiers, avec plus de 40 % des voix, mais que les salafistes qui se constituent alors en parti politique obtiennent 25 à 30 % des voix, se classant seconds. Enfin, le courant djihadiste est minoritaire, voire ultra-minoritaire ; mais il s'agit d'une minorité active et armée qui peut profiter des situations de crise pour imposer son ordre, comme Daech le fait aujourd'hui en Syrie et en Irak.
Les divergences de vision et de stratégie entre ces mouvements – et parfois en leur sein – sont réelles ; nourries par une littérature abondante que chaque courant utilise pour réfuter avec virulence les idées de l'autre, elles sont prises très au sérieux par les acteurs eux-mêmes. Si ces rivalités limitent la perméabilité entre différents courants, celle-ci existe malgré tout. Le fait que salafistes et djihadistes partagent un même corpus de textes, même s'ils en font une lecture très différente – exclusivement religieuse pour les salafistes, politique pour les djihadistes –, peut aider au passage d'une idéologie à l'autre. De même, la répression violente des islamistes politiques – sous Nasser comme sous le maréchal Al-Sissi – est certainement de nature à pousser certains des Frères déçus dans les bras des djihadistes. Cette tendance a toutes les chances de rester marginale : tels les partis communistes de l'après-guerre en Europe, les Frères musulmans sont une organisation puissante et dotée d'une vraie cohésion, capable de contrôler sa base jusqu'à un certain point ; mais leur affaiblissement finira par profiter aux djihadistes. Ce scénario commence à se dessiner en Égypte où le courant djihadiste est en plein essor.
Décrypter les mobiles de l'amalgame sémantique permet de nuancer fortement le tableau d'une internationale islamiste et terroriste, souvent dressé par les médias peu soucieux de rigueur et par des gouvernements – notamment chez nos partenaires – souhaitant instrumentaliser l'épouvantail islamiste à leur avantage. La typologie proposée ici permet de mieux définir la ligne de partage qui doit s'imposer à la France entre islamisme et terrorisme. En clarifiant les concepts et le vocabulaire de l'islamisme, on identifie la nature du danger : très précise et imposant une lutte sans merci dans le cas du djihadisme, beaucoup plus sujette à caution dans celui des islamistes de la famille politique.
Il ne s'agit pas d'idéaliser les Frères musulmans, mais d'éviter le piège d'une logique éradicatrice contreproductive. Le monde arabe étant actuellement en proie à une véritable guerre froide autour de la Confrérie, le travail sur le vocabulaire et les concepts permet de ne pas se laisser prendre par un camp ou un autre. Du fait des ambiguïtés qui persistent dans leur discours et dans leur mode de fonctionnement, les Frères musulmans continuent légitimement de susciter des réserves. Cependant, en l'absence d'alternatives, les islamistes de la famille politique constituent,en l'absence d'alternative et parce qu'ils disposent d'une légitimité religieuse, le principal contre-modèle en mesure de s'opposer à l'autoritarisme des dernières décennies, d'où l'hostilité des régimes en place – républicains ou monarchiques – à leur égard.

Monsieur Lacroix, lorsque nous vous avons reçu le 2 décembre dernier dans le cadre de la mission d'information sur le Proche et Moyen-Orient, vous avez dit que l'échec de l'intégration des Frères musulmans dans le jeu politique égyptien, marqué par le renversement de Morsi et la politique d'éradication en cours, pouvait ouvrir la voie à Daech. Vous avez également abordé ce point aujourd'hui. Quelles sont les racines profondes du développement de Daech ? En quoi le sentiment de marginalisation – voire d'exclusion – des populations sunnites, l'échec des révolutions arabes dans la plupart des pays concernés, le conflit israélo-palestinien ou encore l'essor du salafisme ont-ils pu contribuer à son succès ?

Revenant avec Jean Glavany d'une mission en Turquie, consacrée à l'observation de la situation au Proche et Moyen-Orient, je suis très choquée, madame Curmi, de vous entendre évoquer un mouvement face à l'autoritarisme précédent. En effet, les interlocuteurs que nous avons rencontrés nous ont confirmé que Daech pouvait être le bras armé du pouvoir actuel ou d'une autre force. Il faut certes éviter les amalgames ; mais comment ne pas souligner la barbarie de Daech et d'Al-Qaïda, soigneusement mise en scène sur les réseaux sociaux ? Les images montrant des gens bien habillés et bien armés prouvent que le mouvement dispose d'énormément de moyens, ce qui ne peut manquer d'inquiéter. La crise en Syrie et en Irak peut se terminer encore plus tragiquement ; la perspective du califat et d'un islam idéalisé attire des jeunes du monde entier, particulièrement de France. S'il faut continuer à réfléchir et à enquêter en restant calme et pondéré, il ne faut pas minimiser l'impact de ces mouvements qui, au vingt-et-unième siècle et dans un monde que l'on souhaite civilisé, représentent tout sauf des solutions à envisager ! Or vos propos ne me semblent pas s'inscrire dans cette optique. Monsieur Lacroix, j'ai apprécié votre remise en perspective des différentes tendances ; mais il faut penser avant tout aux solutions à apporter à cette crise énorme qui embrase le Proche et Moyen-Orient et le monde entier. Les événements qui se sont passés il y a quinze jours en France le montrent : il s'agit d'une guerre d'un type différent et il faut de toute urgence trouver comment y répondre.

Les salafistes représentent-ils la mouvance dominante au sein de la partie non intégrée des musulmans de France ? Cela serait tout de même inquiétant !
Qui finance les différents mouvements que vous avez évoqués, en particulier le salafisme ?

En France, on observe une poussée du salafisme dans les quartiers ; or, vous l'avez dit, ce courant considère les autres religions du Livre comme devant à peine être tolérées, et les salafistes de France semblent même considérer qu'il s'agit d'un combat permanent contre ceux qu'ils appellent les mécréants. Comment évolue cette mouvance qui pose aujourd'hui un problème majeur dans nos banlieues ?

Depuis combien d'années avez-vous perçu, au ministère des affaires étrangères, la montée de l'islamisme et quelles alertes avez-vous lancées au monde politique ?
Qui finance chacune des trois familles que vous avez évoquées ?
Quelle est la gradation de l'hostilité de ces différents courants à l'encontre de l'Europe et en particulier de la France ?
Enfin, comment mesurer et comprendre la porosité de la société française à ces phénomènes, la guerre étant à la fois internationale et nationale ?

Pouvez-vous nous rappeler les cinq écoles du salafisme, des salafistes piétistes, qui s'enferment dans une vision rigoriste de la religion, aux djihadistes ?
Votre comparaison avec les trotskystes expansionnistes et les léninistes qui souhaitent construire le régime soviétique en Russie seulement m'apparaît trop simplificatrice. Il existe des allers-retours importants entre les deux tendances ; surtout, leur objectif commun est de nous faire la peau. Ne fondons donc pas trop d'espoirs sur leurs rivalités !

Les propos de certains collègues m'inquiètent : il serait dangereux et malsain pour notre pacte social d'imaginer qu'une guerre a été déclarée contre la France et l'Occident. En tant que maire, je ne suis pas d'accord avec l'idée que des groupes de salafistes seraient en train d'« évangéliser » les jeunes de nos banlieues. Je recommande à ce propos la lecture de Libération de ce matin, qui montre qu'Amédy Coulibaly n'a voyagé ni au Yémen, ni en Irak, mais en République Dominicaine, et qu'il n'habitait pas dans une banlieue, mais à la frontière d'une banlieue où l'on se bricole des identités. Les amalgames et les raccourcis sont dangereux pour la manière dont notre société va répondre aux défis qui lui sont lancés. Il y a certes des salafistes dans notre pays, mais c'est en prison qu'Amédy Coulibali s'est imprégné des idées intégristes, sous l'influence de personnes qui ont profité de son désarroi. C'est sur ce plan qu'il nous faut agir.
Les conditions d'une internationalisation du projet djihadiste sont-elles aujourd'hui réunies au Proche-Orient ? Regardons la réalité en face : on se réjouit de vendre des armes à l'Arabie Saoudite, un de nos premiers clients ; mais malgré l'échange entre le spirituel – les wahhabites – et le temporel – la famille Al Saoud –, ce pays contribue à financer le terrorisme dans notre pays. La même analyse vaut pour le Qatar. Quant à la question des dérives de l'islam, il faut aller plus loin que la caricature de la guerre ; une réflexion sur la manière dont l'islam est – on non – organisé dans notre pays devrait permettre de comprendre comment cette religion pourrait résister à ce qu'il faut désigner par le nom qu'il mérite : l'islamo-fascisme.

À l'aune de ce qui se passe en Irak, en Syrie et jusqu'à sur notre territoire, les médias et bon nombre de responsables politiques se demandent si l'islamisme radical représente une perversion ou une conséquence logique de l'islam, la réponse à cette question étant lourde de conséquences pour notre politique. Le travail de recherche académique permet au contraire, au lieu de se livrer à une réflexion théologique sur ce que dit ou ne dit pas le Coran, de s'intéresser à ce que les acteurs de l'islam radical disent de ce que le Coran dirait et aux conséquences politiques et sociales qu'ils en tirent.
Qui prête allégeance respectivement à Daech et à Al-Qaïda ? À quel point ces deux mouvements s'opposent-ils entre eux ? Leurs divisions vous semblent-elles source d'affaiblissement du mouvement djihadiste ? Existe-t-il une possibilité de jonction, malgré la différence de leurs stratégies ? Comment estimez-vous l'évolution du rapport de forces et la probabilité de voir à terme un acteur distancer l'autre ?

On accable de critiques les États dits laïques de la région, alors que leur faiblesse permet l'émergence du terrorisme et le nourrit. Ne faut-il pas réviser notre politique étrangère ? En effet, si l'on avait traité l'Algérie comme on a traité la Libye – et comme on a voulu traiter la Syrie –, ce pays ne vivrait-il pas sous un régime islamique ?
Comment la France peut-elle consolider l'Égypte, élément clé du dispositif ?

Je vous remercie pour votre exposé. Quel que soit le domaine, le temps de l'analyse – notamment universitaire – est toujours nécessaire pour comprendre les enjeux et donc mieux les traiter.
Comment pourrait-on transposer votre analyse en France ? Il est important d'estimer l'influence des différents courants que vous avez évoqués sur l'islam français pour réfléchir à partir d'éléments réels et non fantasmés. Comment construire notre relation avec cette religion pour éliminer les tendances radicales et parvenir à une véritable possibilité d'intégration et de vivre ensemble avec les musulmans ?
La France, en liaison avec ses alliés, peut-elle proposer aux différents États que vous avez mentionnés une analyse et des attitudes plus productives ? Quelle est la meilleure voie pour établir la paix, sachant que derrière le drapeau de l'islam se cachent bien des intérêts particuliers ? Tout se passe au nom de dieu, mais quelquefois pour des motifs beaucoup plus humains !

Je reste dubitatif devant toute tentative académique – la vôtre comme d'autres – d'opérer des classements à l'intérieur de l'islam et de l'islamisme. Heureusement que vous avez fait allusion à la fracture entre chiisme et sunnisme, une des données de base de l'analyse de cette religion par nature éclatée qui défie nos modèles intellectuels ! Il y a autant d'islams que d'imams, voire davantage encore ; vos classifications me paraissent donc très peu opérationnelles.
En mission au Caire il y a quelques années, Jacques Myard et moi avons reçu un cours de salafisme de quelques adeptes de ce courant ; nous avons alors découvert qu'il existait même des salafistes pacifistes ! Qualifier le salafisme de violent par essence relève donc d'un abus de raisonnement.
De quel secours cette classification nous est-elle pour comprendre ce qui habite l'esprit de nos jeunes djihadistes qui partent en Syrie en passant par la Turquie – même si je n'ai pas tiré les mêmes conclusions que Marie-Louise Fort de notre mission commune dans ce pays ? Faudrait-il les interroger à leur retour : étiez-vous wahhabite ? djihadiste de quelle tendance ? Cela représente peut-être un intérêt universitaire, mais sûrement pas un intérêt pratique !

Né dans une famille musulmane – ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'entre nous –, je souffre de voir la citoyenneté définie par une appartenance réelle ou supposée à cette culture. Mon nom ne fait pas forcément de moi un musulman ; pourquoi beaucoup de nos concitoyens, Français avant tout mais portant un nom et ayant une couleur de peau caractéristiques, sont-ils supposés appartenir à cette religion ? Cet enfermement est difficile à vivre pour la grande majorité de nos compatriotes nés en terre d'islam ou dans une famille de culture musulmane. Ainsi, face à la classification proposée, voilà que surgit la question de savoir si nos compatriotes français liés à cette histoire appartiendraient à l'une ou l'autre des catégories. Mais ils n'appartiennent à aucune d'entre elles, la réalité de leur quotidien – comme du mien – n'ayant rien à voir avec ces théorisations universitaires. Je voudrais donc nous mettre en garde collectivement. En tant qu'élu local de Toulouse, j'ai vécu l'affaire Mérah ; je ne suis pas naïf et sais ce qui se passe dans les quartiers. Néanmoins, ne plaquons pas sur notre communauté nationale des problématiques qui concernent une autre partie du globe. De même qu'il faut refuser d'importer le conflit israélo-palestinien sur notre territoire, il faut rejeter l'idée que nos compatriotes liés à la culture musulmane seraient majoritairement en proie à une dérive les amenant à adhérer à un mouvement salafiste ou djihadiste. Il faut entendre mon sentiment car les personnes ayant les mêmes origines que moi n'ont pas souvent l'occasion de s'exprimer !

Je n'attaquerai pas les chercheurs dont le travail nous permet de réfléchir, même si la recherche n'a pas pour vocation de s'appliquer telle quelle à la réalité.
Avez-vous l'impression qu'on se dirige vers une multitude de groupuscules, cette fragmentation rendant difficile de savoir à qui s'adresser, ou bien ce morcellement a toujours existé ? Faites-vous les mêmes analyses sur le chiisme ? Pensez-vous que les pays de cette zone peuvent évoluer vers des États démocratiques intégrant le pluralisme religieux, les droits individuels et la laïcité ?

Le changement de roi en Arabie Saoudite et la nomination du fils du nouveau monarque à un poste important peuvent-ils avoir des conséquences sur la relation de ce pays avec les Frères musulmans ?
C'est le mariage entre la recherche et les options diplomatiques qui caractérisent le travail du CAPS. Vos nombreuses questions doivent nous encourager à pousser plus loin notre démarche.
Madame Guittet, l'inexistence d'une hiérarchie couvrant l'ensemble du monde islamique et l'absence d'une référence et d'une autorité désignée de l'islam – comparable au Vatican pour le catholicisme – font que fleurissent, pour le meilleur et pour le pire, les tendances que nous avons schématiquement décrites ; cela rend en effet difficile de savoir avec quel interlocuteur dialoguer. Mais l'intérêt de démêler l'amalgame est de situer les lignes de fracture : notre travail est exempt de complaisance et ne minimise pas le danger ; au contraire, c'est précisément pour cerner la nature – clairement djihadiste – de ce dernier qu'il faut opérer des différenciations. En effet, tenter d'éradiquer tout ce qui pourrait, de près ou de loin, être qualifié d'islam ou d'islamisme ne constitue pas une stratégie efficace. Malgré les difficultés, l'inclusion des islamistes dans la transition tunisienne porte ses fruits ; au contraire, la tendance éradicatrice pourrait conduire à un résultat désastreux : celui de les radicaliser.
Les cinq écoles du salafisme me semblent relever d'une erreur de catégorisation ; je laisse Stéphane Lacroix répondre à cette question.
Le monde musulman arabe est majoritairement sunnite. Comme le notent les chercheurs auditionnés par notre groupe de travail, la fracture sunnite-chiite est apparue récemment, après plusieurs siècles de cohabitation pacifique. Son instrumentalisation en fait un phénomène plus politique que religieux.
Parmi les courants islamistes, nous devrions dialoguer avec ceux qui refusent la violence et acceptent le principe de l'alternance démocratique– deux principes qui doivent être inscrits dans le marbre pour permettre un échange fructueux. C'est la ligne que l'on tient dans nos ambassades et lorsque nous recevons des personnalités du monde arabe et musulman à Paris.
Pour avoir été en poste dans cette région, je sais que nos partenaires – dont l'attitude ne semble pas toujours tranchée – donnent des réponses claires lorsqu'on leur pose des questions claires, du moins hors cadre public et officiel. Je l'ai observé à chaque fois que nous avons reçu des représentants du Gouvernement ou du peuple français. Ce langage de vérité représente le pendant de notre partenariat avec ces pays qui, quels que soient les doutes qu'ils suscitent, participent aujourd'hui efficacement à la coalition anti-Daech. Pour l'instant, leur implication dans le développement de l'islamisme violent fait l'objet de beaucoup de présupposés, mais de peu de preuves tangibles.
En tant que représentants du peuple français, vous vous posez légitimement beaucoup de questions sur la France. Nous pourrons vous conseiller des personnes susceptibles d'y répondre, mais notre propre travail – conduit sous l'égide du ministère des affaires étrangères – se concentre sur le monde arabe et musulman.
Présidence de Mme Odile Saugues, vice-présidente de la Commission.
Monsieur Kader Arif, nous évoquons en effet ici l'islamisme, c'est-à-dire des musulmans qui considèrent que l'islam est aussi une expression politique – qui sont loin de représenter la majorité des musulmans français. Dans la région à laquelle on s'intéresse, en Égypte comme en Tunisie, les élections récentes ont démontré qu'une partie importante des musulmans adhérait à cette représentation. En Égypte, les islamistes au sens large – salafistes et Frères musulmans – ont remporté 70 % des suffrages. Si les élections avaient lieu aujourd'hui, le pourcentage serait certainement moindre, mais ne descendrait pas en-dessous de 40 %. Dans cette région, l'islamisme comme expression politique représente donc un facteur essentiel. C'est pourquoi nous souhaitons dissocier notre analyse de celle de la situation française où les mêmes questions se posent dans des termes très différents, même des groupes d'origine frériste y interprétant cette tradition intellectuelle autrement qu'en Égypte. Il est important de ne pas mélanger ces deux sujets : en tant que spécialiste du monde arabe, j'évite de m'exprimer sur l'islam de France afin de ne pas plaquer sur notre pays des grilles de lecture acquises ailleurs.
Je crois que cette classification est utile, même si tous les islamistes ne s'inscrivent pas nécessairement clairement dans l'une de ces trois familles. Une partie d'entre eux voient dans l'islam une expression politique, mais ne savent se situer entre le salafisme, les Frères musulmans et le djihadisme ; à l'exception des Frères musulmans – structure organisée dotée d'une hiérarchie –, on est loin des partis où l'on est encarté et auxquels on doit une loyauté inconditionnelle. Mais la classification fait apparaître la minorité active au sein des trois tendances, dont le militantisme a un effet d'entraînement sur les autres. Dans l'Égypte post-révolution, des intervenants Frères musulmans, salafistes et djihadistes venaient s'affronter dans les débats télévisuels ; on voyait alors clairement ces trois familles qui s'identifient elles-mêmes de manière distincte, portent un discours particulier, se disputent les unes avec les autres et cherchent à entraîner la masse des musulmans qui voudraient voir dans l'islam une expression politique et qui se demandent vers qui se tourner.
S'agissant des écoles du salafisme, j'en ai finalement distingué trois : le salafisme dominant, quiétiste ; un salafisme activiste, représenté par exemple par le parti Al-Nour en Égypte – quiétistes qui considèrent qu'entrer dans le débat politique peut les aider à défendre leurs intérêts comme mouvement de prédication, tout en restant concentrés sur l'islamisation des sociétés, le politique étant pour eux un moyen et non une fin ; les djihadistes, pris dans une logique révolutionnaire violente. Les sous-nuances doivent permettre d'aller jusqu'à cinq tendances, mais il s'agit d'un débat scholastique.
Dans le monde arabe, l'islamisme est une réalité que l'on est obligé de prendre en compte. On peut souhaiter que ces pays ressemblent à ce que nous voudrions qu'ils soient ; mais il faut aussi reconnaître l'existence d'un phénomène politique qui nous échappe. Les partis islamistes font des scores importants lors des élections ; toute démocratie dans le monde arabe devra donc les intégrer sous une forme ou une autre. C'est ce qui se passe – plutôt bien – en Tunisie, même s'il s'agit d'un pari fragile. Ennahda est un parti islamiste particulier qui a produit un socle théorique qui le distingue au sein même de l'islamisme politique des Frères musulmans. Les avancées qui le caractérisent ne se retrouvent pas chez les Frères musulmans d'Égypte – ce qui explique peut-être la plus grande difficulté de ces derniers à se couler dans le moule démocratique. Les islamistes doivent donc consentir un vrai effort, et le ministère des affaires étrangères, rappeler les conditions minimales de tout partenariat dans son dialogue avec des partis comme Ennahda. Cela dit, si l'on peut légitimement se demander si les Frères musulmans d'Égypte sont démocrates, la question vaut aussi pour les nassériens, sans parler des dirigeants actuels du pays ! L'Égypte connaissait ainsi une démocratie sans démocrates, le problème de la sincérité démocratique dépassant le seul camp des islamistes.
La concurrence entre Daech et Al-Qaïda – c'est-à-dire Jabhat al-Nosra en Syrie – relève d'une différence stratégique, les deux mouvances étant, comme le note monsieur Myard, dans une logique de guerre contre l'Occident. Ils se distinguent sur les moyens à adopter : établir une base permettant d'exporter la guerre ou bien mener la guerre afin d'établir une base. Ainsi, il y a deux semaines, ce n'est visiblement pas l'État islamique, mais Al-Qaïda au Yémen qui était à la manoeuvre. Cette concurrence aurait pu représenter une opportunité d'affaiblir les deux mouvements en jouant sur leurs rivalités ; en l'occurrence, elle renforce plutôt la menace puisque les deux groupes semblent se livrer à une compétition. Ainsi peut-on voir dans les événements récents l'expression d'une volonté d'Al-Qaïda de reprendre la main par rapport à un État islamique qui occupe le devant de la scène médiatique depuis six mois.
Certes, mais son lien avec Daech n'était pas étroit ; il n'avait pas voyagé et s'y est converti par internet, alors que les frères Kouachi avaient probablement rencontré des membres d'Al-Qaïda au Yémen quand ils s'étaient rendus dans ce pays. Ils étaient donc davantage inscrits dans une structure.
Cela ne veut pas dire pour autant qu'ils connaissaient toutes les subtilités de la doctrine. La radicalisation des jeunes en France – question dont nous ne sommes pas spécialistes – renvoie davantage à une forme d'extrémisme général qu'à l'adoption de principes islamiques étudiés dans les textes. C'est ce qui fait la grande différence avec la génération précédente.
Daech était au départ très marginal et suscitait l'hostilité de tous les courants de l'islamisme, y compris d'Al-Qaïda. Selon moi, dans les six derniers mois, Daech a usé de provocations pour nous pousser à intervenir, et cette intervention – dont on peut considérer qu'elle était au demeurant nécessaire – a représenté pour lui une aubaine. Pouvoir se présenter comme étant attaqué par l'Occident lui a permis de se légitimer, de gagner des soutiens qui ne lui étaient pas acquis au départ, et de recruter efficacement.
S'agissant du soutien de l'Arabie Saoudite et du Qatar à l'islamisme, le Qatar m'apparaît comme un État pragmatique, voire opportuniste. Disposant de beaucoup d'argent, il a les moyens de soutenir tout le monde, misant sur l'ensemble des chevaux. Cet État a donc soutenu plusieurs courants islamistes et non islamistes, tels que les nationalistes arabes.
Le principal centre de recherche au Qatar est dirigé par un chrétien !
…et l'un des principaux conseillers de l'émir.
Cela montre le pragmatisme – ou l'opportunisme – du Qatar. Cherchant avant tout à maximiser ses intérêts et ses soutiens dans la région, ce pays s'est persuadé après les printemps arabes que puisque les islamistes tels que les Frères musulmans allaient l'emporter, il convenait de les soutenir plus que les autres. Le fait de financer ce mouvement, en Égypte et ailleurs, relève donc d'un pari stratégique qui permet également au Qatar de marquer sa différence avec l'Arabie Saoudite.
En Syrie, ces deux pays ont au départ soutenu et financé tous les courants de l'opposition à Bachar al-Assad, y compris des groupes djihadistes. L'obsession de la menace iranienne l'emportait alors sur les autres arguments, les rendant peu regardants. Aujourd'hui, les monarchies du Golfe semblent plus prudentes ; elles n'ont du reste aucun intérêt à soutenir des djihadistes qui les vouent aux gémonies.
L'islam officiel en Arabie Saoudite est wahhabite, donc salafiste. Le pouvoir de ce pays est bicéphale, le roi et le mufti étant engagés dans un partenariat, entente mutuelle entre deux partis qui ne partagent pas nécessairement la même vision ni les mêmes intérêts. Ainsi, la plupart des princes saoudiens ne sont pas particulièrement religieux et ce n'est pas la religion qui guide leur politique. Celle-ci est souvent pragmatique et non idéologique : au moment de la sécession du Sud Yémen communiste en 1994, l'Arabie Saoudite avait par exemple soutenu les communistes car elle considérait préférable de diviser le Yémen. Cependant, l'establishment politique est pris dans son partenariat avec l'establishment religieux, essentiel pour sa légitimité, ce qui l'amène à donner chaque année à celui-ci des milliards de dollars, utilisés ensuite à des fins de prosélytisme, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Ainsi, sans forcément s'en occuper elle-même, la famille royale laisse les mains libres à l'establishment wahhabite. La cohabitation de ces deux logiques se traduit par un prosélytisme actif qui nourrit l'expansion du salafisme.

Sur le plan géopolitique, au-delà de la guerre contre l'Occident ou contre le chiisme, la mère des batailles pour les sunnites n'est-elle pas celle qu'ils se livrent entre eux, entre l'Arabie Saoudite et les partisans du califat ? N'est-ce pas le coeur de la confrontation et de la naissance de l'islamisme ?
Les sunnites du monde arabe ont accumulé la frustration depuis l'intervention en Irak et la chute de leur pouvoir à Bagdad. C'est à cette frustration que Daech répond aujourd'hui, avec la plus grande sauvagerie. Tant que ce problème majeur ne sera pas réglé en Irak, au Liban et dans tous les pays où les sunnites ne sont pas représentés au pouvoir, leur attirance pour Daech persistera. C'est pourquoi la diplomatie française doit s'employer à promouvoir l'inclusion des sunnites ; à elle seule, l'action militaire ne suffira pas.
Sans lui avoir donné naissance, cet échec le nourrit certainement. En Égypte, depuis le renversement de Morsi, une partie de la base des Frères musulmans – en particulier la jeunesse – ne croit plus au jeu démocratique et est désormais tentée par des alternatives radicales, d'autant que le nouveau pouvoir considère les Frères comme des terroristes et réprime violemment les manifestations. Ne bénéficiant aujourd'hui d'aucune porte de sortie en Égypte, certains d'entre eux viennent probablement nourrir les rangs de la mouvance djihadiste. D'ailleurs, le principal mouvement djihadiste égyptien, les Partisans de Jérusalem, a officiellement rejoint Daech et s'appelle désormais L'État islamique-Gouvernorat du Sinaï – région où se situent les bases des djihadistes égyptiens.
La France et l'Europe doivent tout faire pour faciliter l'intégration des partis islamistes prêts à jouer le jeu démocratique, qui répondent aux deux conditions évoquées par Mme Curmi. L'exemple tunisien montre que, sans constituer une solution miracle, cette intégration permet de limiter autant que possible la menace djihadiste. Des discussions ont d'ailleurs lieu actuellement entre les Européens et le régime égyptien pour pousser le maréchal Al-Sissi vers une politique de réconciliation qui permettrait de stopper la dérive d'une partie de la base de l'islamisme politique vers un islamisme djihadiste avec lequel aucun dialogue n'est possible.
Par ailleurs on ne peut pas parler de Daech sans évoquer l'Irak. Daech représente le prolongement d'Al-Qaïda en Irak qui se constitue en 2004-2005 dans le sillage de l'invasion américaine dont elle est le produit – ou l'effet pervers. Le pouvoir étant désormais accaparé par les chiites, la marginalisation des sunnites pousse ces derniers vers ce groupe qui prétend défendre leurs intérêts, tant en Irak qu'en Syrie. Cette population qui se sent mise à l'écart ne bénéficie en outre d'aucune alternative, Daech prospérant sur un vide politique. En Syrie, même si Bachar al-Assad continue à tenir la région de Damas et la région alaouite dont il est originaire, il a perdu toute légitimité auprès des sunnites et ne reprendra plus contrôle sur leurs territoires. En Irak également, même avec une vraie volonté d'intégrer les sunnites dans les gouvernements, le premier ministre aura du mal à établir son autorité dans les régions sunnites. Dans ce vide, Daech représente la seule force disponible ; une partie des sunnites en accepte le joug par absence d'alternative et non par adhésion à son idéologie qui n'est partagée que par une petite minorité active et armée.
Absolument. Je suis persuadé que Riyad a compris depuis longtemps la menace qu'il représente. Soucieux de sa stabilité intérieure qui repose sur un fonctionnement bicéphale, l'État saoudien n'est probablement pas toujours parvenu à contrôler les particuliers qui ont pu financer des organisations comme Daech ou Jabhat al-Nosra ; mais il n'a pas lui-même mené de politique de soutien actif à ces mouvements. Ses financements officiels en Syrie sont allés vers des groupes non-islamistes et islamistes, mais non djihadistes : l'Armée syrienne libre (ASL), puis le Front islamique – une organisation à composante salafiste, mais non djihadiste. Voilà ce que j'en sais en tant qu'universitaire, mais les services secrets disposent peut-être d'autres informations.
Cette menace sur l'Arabie Saoudite explique pourquoi ce pays incite le Qatar et d'autres États du Golfe à participer à la coalition anti-Daech.
La séance est levée à onze heures vingt.