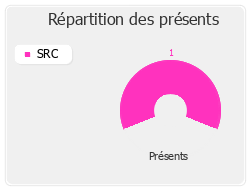Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
Réunion du 2 mars 2016 à 16h00
La réunion

Nous poursuivons les travaux de la mission avec M. Bernard Pêcheur, président de section au Conseil d'État, auteur d'un rapport sur la fonction publique qui fut remis en 2013 au Premier ministre. Notre mission s'inscrit dans le prolongement de ce travail.
Notre système de détection des personnels dans la haute fonction publique de l'État est-il adapté ? Garantit-il que ceux qui ont le plus haut potentiel sont aussi appelés aux responsabilités de plus haut niveau ? Il existe différents instituts de hautes études. J'ai eu la chance de suivre deux cycles d'études de ces instituts : le Cycle des hautes études pour le développement économique (CHEDE), organisé par l'Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE), qui dépend du ministère des finances et plus récemment un cycle de l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), directement rattaché au Premier ministre. Ces mécanismes de formation continue participent-ils à la détection des talents ?
Je vous prie tout d'abord d'excuser M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État. Je parlerai aujourd'hui en mon nom propre, non au nom du Conseil d'État, même si certaines de mes réflexions sont assurément communément partagées au sein du corps auquel j'appartiens.
Il est toujours difficile de parler de la haute fonction publique, car c'est une réalité que l'on ne cerne pas bien, puisque la notion n'existe pas en tant que telle.
S'agit-il des emplois à la décision du Gouvernement ? Il s'agirait alors d'un tout petit vivier d'emplois, dont les limites sont définies par le décret du 24 juillet 1985. Il compte environ 550 agents au total : préfets, ambassadeurs, directeurs d'administration centrale et secrétaires généraux des ministères. Mais votre réflexion porte sans doute sur un champ plus large.
Dans une deuxième définition, la haute fonction publique pourrait recouvrir le périmètre des emplois pourvus en conseil des ministres, soit en vertu de l'alinéa 3 de l'article 13 de la Constitution, soit en vertu de l'ordonnance du 28 novembre 1958. Outre les emplois que je viens d'évoquer, ce périmètre englobe les membres du Conseil d'État, de la Cour des comptes, des corps qui recrutent à la sortie de l'École nationale d'administration (ENA) ou des corps d'ingénieurs qui recrutent à la sortie de l'École polytechnique. Ce serait une façon plus exacte d'appréhender la réalité.
Peut-être la meilleure définition serait-elle cependant celle de l'encadrement supérieur, tel qu'il est défini à l'article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 et dans les décrets pris pour son application. Cette loi veille à la nomination équilibrée des hommes et des femmes dans l'encadrement supérieur. Les emplois concernés appartiennent aussi bien à la fonction publique de l'État qu'à la fonction publique hospitalière ou à la fonction publique territoriale.
De nature législative, cette définition permet sans doute une meilleure approche de la notion. Non seulement elle englobe les emplois de direction des trois fonctions publiques, mais elle s'étend également, au-delà des emplois du premier cercle – à la décision du Gouvernement – aux emplois fonctionnels de sous-directeurs, de chefs de service et de directeurs de services territoriaux de l'État. De nature fonctionnelle, elle revêt ainsi une dimension transversale par-delà les statuts d'emploi. Je ne me bornerai donc pas à parler devant vous de la fonction publique de l'État, mais évoquerai aussi la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. Encore, pour être complet, faudrait-il ajouter, à ce cercle d'emplois fonctionnels, les corps-viviers issus des grandes écoles (ENA, X, INET).
Telles sont les définitions possibles de la haute fonction publique.
D'autres existent qui me semblent cependant plus imprécises et moins opérantes. Il en est ainsi des emplois hors échelle. Les évoquer reviendrait à définir les contours de la haute fonction publique par la rémunération, en se référant à l'arrêté du 29 août 1957 et à son barème. Ces emplois hors échelle ne concernent certes qu'une petite frange des agents publics, mais incluent des emplois relevant de l'enseignement supérieur et de la recherche ; cette approche par le niveau de salaire n'a donc pas d'intérêt en soi. Sans retenir forcément cette définition par la rémunération, j'évoquerai cependant la question salariale, qui importe aux hauts fonctionnaires comme aux autres.
Souvent, la presse se focalise sur l'ENA et sur les corps qui lui sont associés. Cette approche a le défaut d'être caricaturale et inexacte. La haute fonction publique et les grands corps de l'État ne sont pas seulement constitués d'anciens élèves de l'ENA. Votre problématique de recrutement, de formation et de carrière dépasse donc ce cadre.
Demandé par le premier ministre Jean-Marc Ayrault, le rapport sur la fonction publique lui a été remis le 5 novembre 2013. Son champ était large, puisqu'il s'agissait de dresser un bilan et d'établir une évaluation de l'état des fonctions publiques, en proposant éventuellement des évolutions, des réformes, éventuellement une revalorisation. Ce rapport n'avait donc pas pour objet principal la haute fonction publique, envisagée comme l'ensemble des titulaires des emplois supérieurs des trois fonctions publiques et des corps viviers correspondants.
J'y soulignais qu'une politique salariale ne peut se limiter à un gel des salaires. Il le faut et il le fallait ; mais, s'il existe, c'est qu'une sortie au gel des salaires existe aussi. Je ne pense pas qu'un État développé comme la France doit avoir une fonction publique – ou une haute fonction publique – sous-payée et sous-rémunérée par rapport à la situation dans des pays comparables ou par rapport au secteur privé. Or, depuis août 2010, les rémunérations sont gelées.
Le moment venu – et il appartiendra au Gouvernement de définir ce moment – il faudra procéder à des revalorisations y compris dans la haute fonction publique. S'agissant des reclassements et des requalifications de carrières, le Gouvernement a discuté avec les organisations syndicales d'un protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et des rémunérations (protocole PPCR). Mme Lebranchu a décidé de le mettre en oeuvre, avec l'aval du premier ministre Manuel Valls. Mais ce protocole concerne les échelles de chiffre C, B et A, non la haute fonction publique. Il faudra donc poser la question s'agissant de cette dernière.
Je parlerai maintenant de mon expérience des dix dernières années, tant dans ses aspects positifs que négatifs.
Au sujet des recrutements dans la haute fonction publique, je soulignerai d'emblée un point positif. De 1998 à 2010, j'ai présidé l'École nationale supérieure de la police nationale. En 2006, à la demande du ministre de l'intérieur de l'époque, M. Nicolas Sarkozy, nous avons mis en oeuvre les premières classes préparatoires intégrées dans la police nationale. L'idée s'est avérée très féconde. Nous rattrapions ainsi des jeunes sortis des filières, mais satisfaisant aux conditions de diplômes, pour les préparer au concours de commissaire de police, mais aussi d'autres concours de la fonction publique et de la gendarmerie. D'emblée, des succès ont été enregistrés dans les différents concours.
À la suite de l'évaluation qui en a été faite, le principe a été généralisé pour toutes les grandes écoles administratives. C'est très positif. J'attire votre attention sur le fait qu'à l'École nationale supérieure de la police nationale, ces classes intégrées l'étaient effectivement, puisque les élèves y côtoyaient les élèves commissaires, dont ils partageaient l'internat. L'entrée ne s'y faisait pas sans une présentation individuelle au directeur et ils se trouvaient d'emblée dans le moule de la préparation au concours. Tant que ce caractère résidentiel peut être préservé, c'est une très bonne chose. Mais toutes les écoles ne disposent certes pas des mêmes capacités que l'École nationale supérieure de la police nationale à Saint- Cyr-au-Mont-d'Or.
S'agissant de l'organisation des carrières dans la haute fonction publique de l'État, la réforme territoriale de l'État a été l'occasion d'une petite révolution. Les administrations de l'État vivaient en effet sur un paradigme dépassé : aux administrations centrales revenaient prétendument les tâches nobles de conception, tandis que les « services extérieurs » n'étaient dirigés que par des cadres A nettement sous-classés par rapport à ceux qui auraient dû être leurs homologues en administration centrale, directeurs et chefs de service. La réforme territoriale a été l'occasion d'une inversion de tendance. Un décret de 2009 a institué un reclassement des directeurs territoriaux, désormais classés par groupes de responsabilité et élevés aux échelles D, C et B, échelles bien supérieures à celles qui prévalaient jusqu'alors en matière de rémunération. Cela semble tout à fait légitime vu leur niveau de responsabilité dans les territoires.

À ce stade, le reclassement a-t-il ouvert des passerelles entre les corps ou inciter plus d'agents à emprunter celles qui existaient déjà ?
Ouverts aux administrateurs civils, ces emplois dans les services déconcentrés sont plus attractifs. La réforme a également ouvert des débouchés à des corps qui n'étaient pas des corps d'administrations centrales, mais des corps techniques qui se sont trouvés valorisés. En tout cas, en termes d'image, il est important que les services territoriaux de l'État aient pu être revalorisés à cette occasion, y compris dans leurs emplois de direction. Cette très bonne réforme est passée inaperçu, mais ce n'est pas nécessairement malheureux, car il aurait sans doute fallu s'attendre sinon à des effets reconventionnels.
Par ailleurs, un décret de janvier 2012 a créé le grade d'administrateur général pour les administrateurs civils, réforme demandée de longue date. Quand ces derniers ont occupé des emplois de direction, ils continuent ainsi de dérouler une carrière sur des échelons hors échelle B et C acceptables, même s'ils n'occupent plus de tels emplois et qu'ils n'ont pas été nommés dans un corps d'inspection. Cette réforme structurelle a supprimé le décalage entre le corps des administrateurs civils et les autres corps recrutant à la sortie de l'ENA. Sans assurer une parité complète, elle a tout de même constitué une revalorisation significative.
Au cours des dix dernières années, il n'y a donc eu ni glaciation, ni big bang dans l'encadrement supérieur de l'État. Les réformes qui ont eu lieu n'ont assurément pas joué qu'à la marge. Tout n'était pas positif cependant. Les mesures qui n'étaient pas bonnes en soi ont dû trouver remède. Ainsi, un décret de janvier 2008 qui autorisait la mobilité en cabinet ministériel dès la première année après la sortie de l'ENA a été abrogé. Il était en effet contraire à l'esprit même de la mobilité, qui veut que ce mouvement ait lieu vers une autre administration et après une première affectation de trois ou quatre années.
Depuis 2010, des évolutions ont eu lieu, qui touchent à l'organisation et au positionnement des corps. Une réforme de la scolarité est engagée à l'ENA, de même qu'une fusion des grands corps techniques d'ingénieurs. Tout n'est pas resté figé au cours des dix dernières années.

Votre rapport mettait en évidence la nécessité d'un « processus de nomination qui permette de progresser dans l'anticipation des relèves et la professionnalisation des nominations à venir », formulation qui a retenu mon attention. Les meilleurs éléments sont-ils vraiment aux meilleurs postes ? A-t-on les moyens de les y placer ? Je sais que la loi organique relative aux lois de finances a modifié le contexte, en accroissant de plus en plus la transversalité et l'interministérialité de l'action étatique. Cela a-t-il fait évoluer les critères de nomination ?
Je crois que l'on a progressé dans les processus de nominations. Le législateur a d'abord contraint l'autorité de nomination à élargir le vivier du recrutement car la loi dite ANT (agents non titulaires) du 12 mars 2012, en modifiant l'article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983, lui a fixé un seuil de femmes comme objectif à atteindre en matière de parité, s'établissant d'abord à 30 %, puis aujourd'hui à 40 %. Cette contrainte, puisqu'elle a été vécue comme telle dans certains corps, a été vertueuse. Elle a conduit les administrations à chercher dans d'autres viviers qu'elle ne le faisait et à s'interroger sur le parcours type.
Qu'il s'agisse de la carrière militaire ou de la carrière civile, une carrière dans la haute fonction publique s'apparente à un parcours d'obstacles. Malheur à qui sort de la trajectoire, pour s'arrêter par exemple deux ans pour élever un enfant ! C'est, selon l'expression consacrée, « passer son tour ». Certes, cela vaut tant pour les hommes que pour les femmes, mais force est de constater que ces dernières sont plus nombreuses à le faire. Aussi les administrations ont-elles dû s'interroger sur la vision normative implicite qui était la leur et qui, conçue par des hommes et pour des hommes, aboutissait, en pratique, à un renouvellement homothétique de leur personnel. Tel fut l'effet vertueux de la loi du 12 mars 2012.
Elle a révélé que les viviers de femmes sont suffisamment larges et étoffés pour effectuer les nominations requises, à condition que les critères implicites et peu vertueux qui prévalaient jusqu'alors soient revus et ne servent plus de base à une quelconque exclusion.
À cela s'est ajoutée la circulaire du 3 mai 2013. À partir du moment où le secrétariat général du Gouvernement s'est doté d'un haut fonctionnaire chargé de la politique de l'encadrement supérieur, des travaux ont en effet été menés à ce niveau qui visait à objectiver certains processus de nomination, notamment les plus délicats d'entre eux, c'est-à-dire les processus de nomination aux emplois dits à la discrétion du Gouvernement, soit environ 550 dirigeants de l'État. Malgré la nature de ces emplois, la circulaire du 3 mai 2013 s'essaye – et je crois que le processus est assez vertueux et qu'elle est observée dans la plupart des cas – à assurer que le président de la République reçoive au moins trois propositions pour chaque nomination envisagée.
Ces propositions émanent des ministres ou du premier ministre, mais sont passées en revue par le secrétariat général du Gouvernement, qui s'interroge pour savoir si ces nominations s'inscrivent dans un processus plus ouvert que dans le passé, à partir d'un vivier lui-même plus ouvert, puisqu'il existe désormais un vivier interministériel de cadres à haut potentiel. Le secrétariat général du Gouvernement peut y puiser des candidatures visant à challenger les candidatures proposées par le ministre. Pour certains secrétariats généraux de ministères, l'on est ainsi allé plus loin que le vivier traditionnel,
Tant l'idée d'un vivier interministériel que celle des trois propositions au président de la République me semblent donc une bonne chose. N'allons toutefois pas trop loin non plus, en élargissant trop la procédure, par exemple en introduisant des comités de sélection ou en définissant des mandats, car il convient de ne pas étouffer le Gouvernement et de préserver son pouvoir discrétionnaire et son autorité sur les hauts fonctionnaires. Mais il faut assurément élargir le champ qui lui est offert.

Puisque nous parlons du vivier de cadres à haut potentiel, comment peut-on imaginer, concrètement, le cycle de formation de cadres supérieurs que le rapport préconise ? Quel doit être le rapport de l'un à l'autre ?
Ces cadres à haut potentiel, qui ont vocation à occuper les emplois laissés à la discrétion du Gouvernement, ne viennent certes pas de la lune. Bien sûr, il lui est loisible de nommer des personnalités de la société civile ou du monde économique. Soit, mais en pratique, il nomme plutôt des spécialistes de l'administration, ce qui n'est guère choquant.
Cela pose la question des politiques ministérielles de gestion de l'encadrement supérieur, comme du caractère plus ou moins interministériel de cette gestion. Sur ce point, la circulaire du 10 juin 2015 est assez courte, claire et facile à lire. Elle attire l'attention sur le fait que les premières années de carrière des cadres supérieurs doivent faire l'objet de soins accrus dans chaque ministère. Dès la première année, un tutorat doit s'exercer. Cela peut sembler une évidence, mais ce n'en est pas une, car, le plus souvent, un chef de bureau ou un administrateur tout juste issu de l'ENA se retrouvait livré à lui-même. Pour ma part, je me souviens comment, après ma sortie de l'ENA le 1er juin 1976, je me suis retrouvé à la direction du budget, dès le 1er juillet de la même année, à exercer l'intérim de mon chef de bureau, parti en vacances. Une bonne formation est assurément un atout, mais j'étais seul et j'aurais préféré avoir un tuteur.
Au Conseil d'État, nous nous efforçons de désigner des tuteurs qui prennent pour un an sous leur aile les nouveaux arrivants, conseillers d'État, maitre des requêtes ou auditeurs. L'idée est simple, voire simpliste, mais elle gagne à être mise en oeuvre et chaque ministère est prié d'élaborer un plan managérial. Peut-être cela existe-t-il, à l'Assemblée nationale, pour les administrateurs ? Ce n'est en tout cas pas une mauvaise chose.
La circulaire demande aussi la mise en place d'une formation d'adaptation au premier poste. Par-delà cette formation, des cycles d'évaluation doivent permettre une revue de cadres et futurs hauts potentiels, pilotée par le secrétariat général du Gouvernement avec les directeurs concernés. Certes, cette idée existait déjà dans le passé, mais seulement à titre informel. Il convient donc d'accorder désormais de manière formelle la plus grande attention à la première nomination à un emploi fonctionnel. Car le vivier de hauts potentiels se prépare en amont, entre la sortie des grandes écoles et l'accès aux emplois fonctionnels.
Ce qui est le plus important dans cette politique, c'est qu'elle soit à la fois clairement à la main des ministres, mais que le premier ministre et les autorités interministérielles puissent mutualiser leurs viviers pour les emplois supérieurs. Sur ce terrain, il est d'ores et déjà possible de conduire des formations. Il en existe depuis vingt ans pour les directeurs. Une fois qu'ils sont nommés, ils suivent un cycle de management, sous la houlette de l'ENA. Mais tout cela manque de souffle.
Quant à la question sensible de savoir si l'ENA est nécessaire, ou s'il n'en faut pas, ou s'il faut la supprimer, je renverrai à l'exposé des motifs de l'ordonnance du 9 octobre 1945 qui a présidé à sa création. Écrit par Michel Debré, il pose des objectifs qui sont toujours actuels et pertinents. À sa lecture, il apparaît que le centre des hautes études administratives initialement prévu a manqué. L'ordonnance s'organise en effet autour de quatre grands pôles : l'ENA, les instituts d'études politiques, la direction de la fonction publique et le centre des hautes études administratives, ou CHEA. Alors que les trois premiers pôles fonctionnent bien, même si tout est perfectible, le CHEA n'a quant à lui existé que de 1947 à 1964, et fut formellement supprimé en 2007.
Cela ne veut pas dire qu'il ne se passe rien en matière de perfectionnement ou de formation continue de la haute fonction publique ; il suffit de consulter le rapport d'activité de l'ENA pour s'en convaincre : il y a énormément d'actions de formation continue en ce domaine. Mais, inexplicablement, alors que la sécurité et la justice ont leur institut de formation continue, et qu'il existe l'IHEDN et le CHEDE, il ne subsiste rien de tel pour l'administration généraliste, ce qui existait ayant précisément été supprimé officiellement par la loi du 31 décembre 2007. À titre personnel, je le regrette.
Les actions existantes mériteraient pourtant d'être fédérées et conçues dans un cadre plus global. Il y a des actions conduites dans les ministères, des actions conduits au niveau interministériel, des actions conduites à l'ENA, mais je trouve qu'un CHEA apporterait un cadre plus prospectif et plus ambitieux. Cela pourrait d'ailleurs nous amener à réfléchir à une coopération possible entre l'ENA et l'Institut national des études territoriales (INET), voire davantage. Faut-il en effet deux institutions différentes pour former des administrateurs généralistes ? Je mets de côté la fonction publique hospitalière, car elle s'attache à des activités de production. Cela apparaîtra toujours comme une absorption de l'INET par l'ENA, mais il s'agit pourtant aujourd'hui d'une évidence, et même d'une nécessité.
Ce CHEA ressuscité ou refondé aurait pour ambition de mettre en contact, à mi-parcours, dirigeants ou futurs dirigeants de l'État et des collectivités territoriales. N'ont-ils pas, aux yeux des usagers et de nos concitoyens, la vocation commune de l'intérêt général, de l'administration générale et de la gestion des affaires publiques ?

L'idée d'un cycle de formation semblable à celui qui existe pour les militaires mérite d'être considérée. Je rappelle que les officiers généraux et supérieurs passent deux étapes de sélection, d'une part l'École de guerre, d'autre part le cycle de hautes études militaires (CHEM) couplé à l'IHEDN.
La refondation du cycle de formation civile que vous évoquez serait-elle équivalente au niveau de l'École de guerre ou à celui du cycle de hautes études militaires ?
L'École de guerre mène au commandement d'un régiment ou d'un bateau de premier rang, ce qui serait l'équivalent des emplois de sous-directeurs civils. Le premier cycle correspondrait donc à ce niveau. Le deuxième cycle mêlerait des sous-directeurs, chefs de service et administrateurs confirmés, appelés à occuper des emplois supérieurs.
Pour présider le haut comité d'évaluation de la condition militaire, je sais que les carrières civiles ne sont pas comparables en tous points aux carrières militaires. Le mouvement des emplois à la discrétion du Gouvernement, directeurs d'administration centrale et préfets, a lieu principalement sur la base de critères de loyauté, en plus des critères de compétence. Pour les militaires, depuis les suites de l'affaire Dreyfus et l'affaire des fiches, l'autorité civile exerce son pouvoir de nomination aux plus hauts emplois avec beaucoup de retenue et de modération. L'autorité militaire a donc plus aisément la possibilité de tracer le profil de celui qui commandera tel ou tel porte-avions ou tel ou tel sous-marins porteur d'engins. Chacun sait qu'il sera alors peut-être désigné plus tard chef d'état-major de la marine. Sous le contrôle de l'autorité politique, l'autogestion est beaucoup plus marquée chez les militaires que chez les civils.

Je ne peux m'empêcher de relever la multiplication des organismes de formation continue rattachés à tel ou tel ministère. Je dois dire également que ce n'est qu'à l'IHEDN que j'ai trouvé le vrai mélange des cultures, des connaissances et des personnes. La rencontre entre personnalités de haut niveau de la société civile et personnalités du monde militaire déjà estampillées comme ayant un haut potentiel d'avenir me paraît mériter d'être maintenue dans sa proportion de deux tiers et un tiers.
La qualité de la formation n'est-elle pas garantie par le fait que l'IHEDN est placé directement sous l'autorité du premier ministre ? Cela ne mériterait-il pas une réforme ambitieuse, avec une sélectivité accrue, pour créer demain un cycle de formation dont la dimension interministérielle serait plus marquée ?
Les vocations sont différentes. L'IHEDEN et le CHEM renforcent le lien entre l'armée et la nation au plus haut niveau, en mêlant les élites militaires, administratives et économiques. La chose militaire est particulièrement attractive. L'on comprend qu'un chef d'entreprise accepte de dépenser son temps en suivant un cycle à l'IHEDN, parce qu'il a un engagement citoyen.
La participation de chefs d'entreprises et de la société civile à un CHEA ne doit pas être écartée a priori, mais il aurait cependant pour première vocation d'être un vivier ou creuset interministériel et inter-fonctions publiques. Il serait appelé à être placé sous l'autorité du premier ministre et rattaché à l'ENA, comme c'était initialement le cas. Je me souviens que, lorsque j'étais à l'ENA, la plaque de marbre clouée à l'entrée de la rue des Saints-Pères portait mention à la fois de l'école elle-même et du centre de hautes études administratives.
Le chercheur, Jean-Luc Bodiguel explique pourquoi le CHEA n'a pas marché. S'agissait-il d'un manque de volonté politique ? Il s'y ajoutait alors une certaine résistance de la part des ministères. Aujourd'hui, nous ferions sans doute mieux pour fédérer les initiatives, car le cadre serait mieux pensé. Des cadres d'emploi inter-fonctions publiques existent déjà, qui sont communs aux administrateurs territoriaux et aux administrateurs civils, avec des responsabilités qui sont identiques et des carrières parallèles, ou du moins très comparables. Cela justifierait vraiment un rapprochement entre l'INET et l'ENA.

Que pensez-vous de la proposition formulée par Philippe Soubirous, secrétaire fédéral de la Fédération générale des fonctionnaires FO et membre du conseil d'administration de l'ENA, qui voudrait que le seul corps de sortie d'ENA soit celui des administrateurs civils ?
L'idée n'est pas très réaliste. L'ENA forme des diplomates, des futurs préfets, des administrateurs, des conseillers de tribunal administratifs, des conseillers de chambres régionales des comptes, des auditeurs au Conseil d'État, des auditeurs à la Cour des comptes, des inspecteurs des affaires sociales… Cette proposition reviendrait à supprimer ces corps, au profit d'un corps unique d'administrateurs, mais au détriment de la nécessaire professionnalisation des différents corps existants. Ou alors on refermerait l'ENA sur la formation des administrateurs et chaque corps recruterait à nouveau séparément, comme c'était le cas avant-guerre. Cela marquerait une régression par rapport à l'ordonnance de 1945. L'idée peut paraître séduisante, mais il s'agit à mon sens d'une mauvaise piste.
Je voudrais en terminer par un seul chiffre, relatif aux grilles de rémunération. Entre le hors échelle G et le premier degré de la catégorie C, l'écart n'est que de 1 à 4,85. Même si l'on tient compte du fait que les primes peuvent aller jusqu'à multiplier par deux le traitement de base, le système est loin d'être inégalitaire… En 1957, lorsque les échelles lettre ont été créées, cet écart allait de 1 à 13, tandis qu'il s'établissait encore à un rapport de 1 à 7 en 1987.