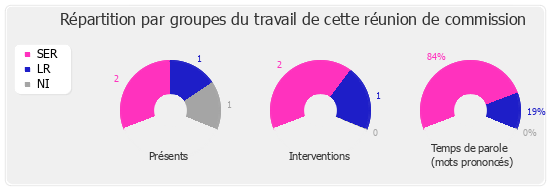Commission des affaires européennes
Réunion du 30 novembre 2016 à 8h30
La réunion
COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES
Mercredi 30 novembre 2016
Présidence de Mme Danielle Auroi, Présidente de la Commission
La séance est ouverte à 8 h 30
Audition de M. Antoine Vauchez, directeur du Centre européen de sociologie et de science politique (CNRS) sur l'avenir de l'Europe

Chers collègues, je remercie vivement M. Antoine Vauchez d'avoir accepté notre invitation. Ce cycle d'auditions sur l'avenir de l'Europe est l'occasion de prendre du recul, et de contribuer à tracer de nouvelles perspectives pour relancer l'Union. Votre regard de chercheur, monsieur, enrichira notre réflexion, entamée autour d'échanges similaires avec des personnalités aussi variées que Enrico Letta, Luuk Van Middelaar, Christian Lequesne et Jean-Claude Piris.
Je commencerai par une question un peu provocatrice : cinq mois après le référendum britannique, croyez-vous que l'on peut encore sauver l'Union ?
Comment envisager la suite de la construction européenne ? Faut-il reparler, comme le font certains, en particulier les Néerlandais, d'un « noyau dur » d'États voulant aller plus loin, d'une Europe des avant-gardes ? Il ne s'agit pas non plus d'abandonner les autres. Les derniers entrés, comme la Roumanie ou la Bulgarie, s'inquiètent de la possibilité d'une Europe à plusieurs cercles.
Vous vous intéressez en particulier à la question du « déficit démocratique européen », au coeur des questions qui se posent actuellement, au coeur de notre réflexion. Comment la nouvelle démocratie européenne pourrait-elle se développer ? Et quel rôle pour les parlements nationaux dans ce cadre ?
Dans votre dernier ouvrage Démocratiser l'Europe, vous affirmez qu'« à trop espérer voir surgir à Bruxelles une démocratie “comme chez nous”, on a renoncé à saisir la singularité du modèle politique européen ». Lorsque j'étais membre du Parlement européen – cela remonte un peu, on négociait par exemple le traité de Maastricht –, j'ai beaucoup entendu en France que l'on voulait bien l'Europe, à condition que ce fût « la France en grand ». Il semble que vous fassiez à votre tour exactement la même réflexion. Comment donc convaincre nos concitoyens que l'Europe ne peut être une « France en grand », et comment convaincre les citoyens allemands que ce ne peut être « l'Allemagne en grand » ? Comment trouver d'autres formes ? Vous dites qu'il faut d'abord démocratiser les institutions « indépendantes » que sont la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), la Banque centrale européenne (BCE) et, dans une moindre mesure, la Commission européenne, au rôle de plus en plus politique, mais comment faire ? Et comment envisager cette question au lendemain du référendum britannique ou, plus généralement, à l'heure de la multiplication des référendums ? Je songe notamment au référendum néerlandais sur l'accord d'association avec l'Ukraine.
Par ailleurs, pensez-vous souhaitable un véritable « gouvernement économique » – démocratique – de la zone euro ?
Enfin, la démocratie, c'est également le respect de l'État de droit. À cet égard, comment renforcer la prise en compte des droits fondamentaux au sein de l'Union ? Il semble que la situation ne soit pas idéale dans un certain nombre d'États à l'heure de la crise des réfugiés. Quelle appréciation portez-vous sur l'évolution de la Pologne, de la Hongrie et peut-être, demain, d'autres pays de l'Union européenne ?
N'hésitez pas à être aussi provocateur que vous le souhaitez. C'est ce qui nous aidera à réfléchir.
Madame la présidente, je vous remercie de votre invitation. J'en suis d'autant plus heureux que les travaux de sciences humaines et sociales restent souvent un peu à la marge du débat public sur l'Union européenne. Or, au moment où il faut peut-être repenser un peu, en prenant du recul, le projet européen et ouvrir des perspectives, même iconoclastes, on gagnerait à mobiliser davantage ce qui s'écrit dans les universités et dans les centres de recherche. Ce matériau offre effectivement les éléments d'un nouvel état des lieux et permet d'envisager les conditions dans lesquelles nous pourrions réorienter le projet européen.
Je partirai précisément d'un état des lieux, et des espoirs placés dans le traité de Lisbonne.
Initialement, celui-ci était conçu comme une sorte d'aboutissement, au terme de deux décennies de révision des traités européens. Le projet était finalement de construire, à l'échelon européen, un système démocratique complet. Il suffit d'en lire le texte pour s'en apercevoir. On a cherché à accroître considérablement les pouvoirs du Parlement européen, par toute une série de dispositions, on a créé des partis politiques européens, on a aussi renforcé le poids des élections européennes, pour qu'elles aient une bien plus forte influence sur la composition de la Commission européenne, notamment sur le choix du président de celle-ci.
Las ! En même temps que le traité de Lisbonne entrait en vigueur, la crise économique éclatait, et force est aujourd'hui de constater que ce projet de démocratisation par le haut inscrit dans les traités européens ne s'est pas réalisé. Pourtant, les enjeux proprement européens n'ont pas manqué, qui posaient les questions de la liberté de circulation, de l'accès aux droits sociaux, de la fraude fiscale, de l'accueil des réfugiés et des politiques d'austérité. Les promesses démocratiques du traité de Lisbonne ne me semblent donc pas avoir été tenues.
Le rôle du Parlement européen, sans doute parce que, dépourvu de l'initiative des lois, ce dernier ne peut peser sur l'agenda politique, est resté essentiellement consultatif. Le Parlement européen n'a pas participé à l'écriture des mémorandums, ni à la troïka, il est finalement demeuré dans un rôle assez secondaire. Les partis politiques européens, pour leur part, sont malheureusement restés muets face à la crise grecque et à la crise des réfugiés, renonçant à construire politiquement ces enjeux et laissant plutôt apparaître des conflits entre États, par exemple entre États créditeurs et États débiteurs. Quant au vote, la participation aux élections européennes a atteint, en 2014, des niveaux historiquement bas. Alors même que nous étions au coeur de la crise économique, les élections européennes n'ont pas constitué un scrutin à fort enjeu et n'ont pas mobilisé. Finalement, elles sont restées le scrutin de second ordre qu'elles ont malheureusement l'habitude d'être. À l'inverse, ce sont souvent des institutions indépendantes qui ont acquis une forme de leadership, notamment la BCE, à qui on a accordé en même temps qu'elle s'est arrogé une grande capacité d'influence.
Ce qui frappe aussi, c'est le rétrécissement de la base sociale et de la base politique sur lesquelles le projet européen peut s'appuyer, avec une forme de désinvestissement par rapport au projet européen. Les partis politiques ont naguère mobilisé un certain nombre de causes, comme l'Europe sociale, ou l'Union politique. Aujourd'hui, nous constatons que ces horizons mobilisateurs ont largement été abandonnés par ceux qui les soutenaient. Dans les années quatre-vingt et 90, un ensemble d'acteurs – hauts fonctionnaires, syndicats, partis politiques – portaient la cause de l'Europe sociale pour en faire une cause autonome par rapport à celle de la construction du marché ; aujourd'hui, il faut bien le dire, cette cause a été largement abandonnée. Au désinvestissement s'ajoute l'indifférence. Bien plus que l'euroscepticisme politique, sur lequel on s'arrête peut-être trop souvent, ce qui caractérise le rapport des citoyens ordinaires à l'Europe, c'est une forme d'indifférence des catégories populaires et des classes moyennes, dont je pense qu'elles sont aujourd'hui convaincues que cette histoire ne les concerne pas et, surtout, que les politiques eux-mêmes sont incapables d'orienter ce projet européen et, finalement, de produire une politique susceptible de les concerner directement. A résulté de ce désinvestissement et de cette indifférence un vide politique rapidement comblé par les partis populistes, bel et bien parvenus, eux, à imposer un agenda politique européen ou à cadrer les enjeux de la crise, en soulevant essentiellement la question de la renationalisation, par exemple par le refus, récemment, de la solidarité intra-européenne face à l'arrivée des migrants.
Après ce premier état des lieux, j'en viens aux causes. Pourquoi ces occasions manquées pour la démocratie européenne ? Nous pourrions en discuter longuement, mais je vois deux facteurs essentiels.
Premièrement, l'Europe ne parvient toujours pas à se frayer un chemin dans la politique nationale. Du moins ne se fraie-t-elle pas d'autre chemin que celui qui la fait apparaître comme un problème et la fait penser sur le mode de l'exit. Aujourd'hui, exception faite des outsiders du jeu politique, les hommes politiques, les partis politiques sont assez peu incités à se saisir de la question européenne, à entrer dans le fond des politiques publiques européennes, qui, certes, est sans doute d'accès difficile. Cela s'explique sans doute par le fait que la question européenne a toujours perturbé les clivages politiques, qu'elle a toujours été une sorte de risque pour les partis. Cela s'explique sans doute aussi par le fait que les journalistes et les éditorialistes tiennent pour acquis que le thème européen est en quelque sorte « invendable ». Sauf crise majeure, ce thème est donc tenu relativement à la marge du débat politique. Tout cela a laissé place aux appels au référendum, qui se multiplient, y compris en France, et n'offrent évidemment que des solutions nationales au problème. Cette politisation de la question européenne au niveau national ne dessine pas une alternative à l'intérieur du projet européen.
Deuxièmement, problème symétrique, la politique – j'entends par là la politique des partis – a bien du mal à entrer dans l'Union européenne, à trouver sa place à Bruxelles. Les institutions européennes – la Commission européenne, la Banque centrale, mais aussi, d'une certaine manière, et même si c'est paradoxal, le Parlement européen – sont réticentes à toute forme de politisation. C'est que la grande affaire européenne reste la construction du marché et de la zone euro, assez technique et portée par des institutions « indépendantes » : d'abord et avant tout, la Cour de justice et la Commission européenne, je veux dire la Commission européenne de la politique de la concurrence, la Commission européenne de la politique du marché unique ; plus récemment, la Banque centrale européenne. Dans une large mesure, ces institutions sont placées, historiquement, hors du champ démocratique : leur raison d'être n'est pas d'abord d'entrer dans un dialogue démocratique et politique, elle est de porter cet impératif de la construction du marché. C'est ainsi que la Commission européenne – on l'a vu dans la négociation du traité de libre-échange transatlantique – reste mal équipée pour engager un dialogue quand les discussions deviennent hautement politiques. Autre raison de cette faible politisation, le petit espace public qui a émergé à Bruxelles, à la périphérie de ces institutions, vise d'abord à peser sur ces règles du marché commun. Il s'est donc donné comme interlocuteur principal le monde des entreprises, des groupes d'intérêt et de leurs représentants, notamment les lobbyistes. Évidemment, ce petit espace public est lui aussi assez réticent à toute forme de politisation qui viendrait perturber le jeu de la construction des règles du marché du marché unique. Tout cela a aussi créé une proximité entre les institutions publiques européennes et le secteur privé, et une forme de brouillage, en partie entretenue par toute une série de réformes managériales de la fonction publique européenne dont l'effet se manifeste aussi dans un jeu de pantouflage au sommet de la commission – à la fois chez les très hauts fonctionnaires et chez les commissaires ; nous l'avons vu récemment, avec les cas de Neelie Kroes et José Manuel Barroso.
Voilà ce que j'appellerai le piège démocratique européen. D'un côté, nous avons un jeu national défensif, dont les référendums sont aujourd'hui la preuve, des référendums qui « politisent contre » le projet européen, non à l'intérieur de celui-ci. De l'autre côté de ce piège, de cet étau européen, il y a un jeu bruxellois dont la dynamique complexe reste essentiellement centrée sur l'écriture des règles du marché unique et son fonctionnement, moins sur la construction d'une offre politique susceptible d'intéresser ou de concerner les citoyens.
C'est à partir de cet entre-deux que je voudrais formuler quelques réflexions.
Premièrement, je ne crois pas que l'on puisse choisir un niveau contre un autre. Je pense par exemple, évidemment, aux réflexions qui ont suivi le Brexit. Je ne crois pas que l'on puisse renoncer à réfléchir aux moyens de faire émerger une politique européenne. Ce n'est pas en se repliant sur le national que l'on ferait disparaître cet échelon européen, que l'on ferait disparaître la force de ce qui s'est construit pendant six décennies autour de Bruxelles. Il faut accepter que la politique se loge et s'exerce quelque part entre les États membres et l'Union européenne, ni seulement d'un côté, ni seulement de l'autre.
Deuxièmement, dans le même ordre d'idées, le projet qui a précisément habité toutes ces révisions des traités, du traité de Maastricht au traité de Lisbonne, celui de construire une démocratie européenne indépendante, autonome, qui fonctionnerait à la manière de nos démocraties nationales, a, dans une certaine mesure, échoué. Les difficultés qui ont suivi l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en donnent d'une certaine manière la preuve.
Troisièmement, je ne crois pas qu'il faille réfléchir outre mesure à la question des institutions, à la réforme des traités. D'abord, nous les avons déjà beaucoup réformés. L'Europe a été un chantier institutionnel pendant vingt ans. Nous n'avons cessé de proposer un Meccano institutionnel assez sophistiqué, mais sans grand résultat il me semble. Par ailleurs, le thème de la réforme institutionnelle n'est guère mobilisateur au-delà de nos cercles en quelque sorte politiques, au-delà du cercle de l'ensemble de ceux qui s'intéressent à la politique et aux questions institutionnelles. Il ne saurait, à mon avis, permettre de reconstruire cette politique démocratique européenne.
Je terminerai en proposant trois pistes de réflexions.
Première piste, l'un des enjeux est de réinsérer ces institutions indépendantes – la CJUE, la BCE et, d'une certaine manière, la Commission européenne de la politique de la concurrence et du marché unique –, ces institutions au rôle très important, au rôle politique majeur, qui se veulent en quelque sorte les garantes du projet européen, dans un jeu démocratique qui leur permette de prendre en compte d'autres attentes sociales, d'entrer en dialogue avec d'autres intérêts sociaux. La CJUE et le directoire de la BCE pourraient ainsi être composés à la manière de la Cour constitutionnelle allemande, c'est-à-dire sur la base d'une représentation des différents courants, des différentes familles de pensée politiques, par exemple les courants et les familles de pensée représentés au Parlement européen. Il faudrait aussi renforcer considérablement le contrôle parlementaire – national ou européen – sur la BCE. Au Parlement européen, ce contrôle est pour le moins intermittent, puisqu'il ne s'exerce que sous la forme d'une audition trimestrielle. De manière assez paradoxale, ce ne sont pas les parlements qui contrôlent le plus la BCE, c'est la Cour constitutionnelle allemande, qui fait en quelque sorte figure de chambre d'appel.
Deuxième piste, il s'agit aussi de réinsuffler un esprit public aux institutions européennes. L'esprit public me semble avoir été mis à mal par des années de réforme managériale, sentiment exprimé par les fonctionnaires européens eux-mêmes, puisque certains d'entre eux, à la suite de l'annonce du pantouflage de José Manuel Barroso, ont lancé anonymement une pétition pour appeler au renforcement des règles encadrant le pantouflage, au renforcement d'un comité d'éthique aujourd'hui extrêmement faible. Cette pétition a tout de même recueilli 150 000 signatures.
Troisième et dernière piste, il faut essayer de mobiliser tous les leviers possibles pour faire émerger cette politique européenne, en se focalisant non pas sur les eurosceptiques, comme on le fait à mon avis trop souvent, mais sur les indifférents, sur l'ensemble de ceux qui, d'une certaine manière, se désintéressent aujourd'hui d'un projet européen en lequel ils ne voient pas une politique qui les concerne. Peut-être faut-il des campagnes politiques européennes concrètes, autour d'enjeux immédiats – je songe, par exemple, au travail de M. Guillaume Balas au Parlement européen sur la lutte contre le dumping social, ou à celui de votre commission, mesdames et messieurs les députés, sur le statut des travailleurs détachés. Bien sûr, dans cette politique européenne, les partis et les syndicats ont un rôle à jouer, s'ils acceptent de renouer avec ce rôle de formation qu'après tout leur financement public les engage à remplir, une formation aux questions européennes – tout le monde n'a pas fait des études de droit ou de science politique ni n'est forcément familier de la complexité des questions européennes. Les parlements nationaux doivent aussi animer, et peut-être susciter, ce débat européen – je songe au travail de votre commission autour des initiatives de « carton vert ».
La création de cette politique européenne, aujourd'hui tout à fait embryonnaire, c'est aussi, un peu, un combat culturel. Les universités et les centres de recherche ont aussi leur rôle à jouer et gagneraient à être mobilisés dans ces débats. Je vous remercie donc encore une fois de votre invitation.

Je voudrais surtout partager, en cette période extrêmement compliquée, quelques réflexions.
Nous avons finalement construit, au plan politique, une Europe quasi exclusivement coopérative, qu'on a un peu asservie juridiquement. La construction européenne s'est faite à côté du discours politique, elle s'est faite par les directives, par la mise en commun d'un espace juridique, pas d'un espace politique. L'espace politique reste fondamentalement national. Nous avons créé un poste de président du Conseil européen, et ledit président est devenu un modérateur, un négociateur, souvent de haut vol – MM. Van Rompuy et Tusk ont fait un travail remarquable –, mais ce n'est pas une voix pour l'Europe. Chaque chef d'État ou de gouvernement rentrant du Conseil européen se pose la question de ce qu'il va dire à son opinion publique nationale, de ce qu'il a envie de raconter ou d'occulter du Conseil européen. Nous sommes simplement au bout du bout de cette réalité, parce que la situation est moins euphorique que dans les années soixante-dix et qu'en période de tension nous cherchons des boucs émissaires, des responsables. D'une certaine manière, nous constatons que l'Europe politique n'a jamais existé, qu'elle était fondamentalement coopérative, qu'en fait de communauté c'était une fiction communautaire – pas tout à fait fictive, cependant, si l'on en croit le mal qu'ont les Britanniques à défaire les fils. Nous avons créé une Europe juridique, pas une Europe politique, une Europe fondamentalement coopérative parce qu'aucun des États membres, à commencer par ceux qui se prétendaient les plus européistes, en particulier la France, ne veut rien céder de sa souveraineté sur les sujets essentiels.
Vous parliez tout à l'heure d'un espace public qui avait été créé, mais il s'agissait encore d'espaces nationaux. L'Europe sociale, c'était l'Europe française. L'Europe de la défense, c'était l'Europe française – on nous donne de l'argent, et on appuie sur le bouton nucléaire. Cette ambiguïté nous apparaît aujourd'hui de manière éclatante, et elle est évidemment mortifère dans une période de souffrance des peuples et d'inquiétude face aux bouleversements du monde, alors que les populistes arment la peur et ont les outils de la peur : les référendums.
La première des fragilités sur laquelle nous devons nous interroger, c'est que, comme vous, je pense que l'on ne peut plus réformer les institutions. Ce n'est pas que ce n'est pas souhaitable, mais on ne le peut plus ; le premier qui essaye, redisjoncte. Je me demande cependant s'il ne faudrait pas un petit traité de démocratisation. Il peut très bien arriver que l'on nous demande en juin, par référendum, si nous souhaitons quitter l'Europe. Les choses peuvent aller très vite. Le Brexit n'est pas un accident de l'histoire mais résulte d'une certaine ambiance européenne. À ma grande surprise, les pays de l'Est, que j'ai beaucoup fréquentés sur la question des travailleurs détachés, sont plus européens, et plus inquiets, que nous. Pour eux, l'Europe c'est l'émancipation nationale, tandis que nous autres, vieux pays impériaux, pensons pouvoir nous suffire à nous-mêmes.
La question qui nous est aujourd'hui posée est celle de l'articulation entre les États nations et la construction européenne. Tout en étant fédéraliste, j'ai bien conscience que les nations sont susceptibles de faire disjoncter la construction européenne. Je me demande si nous ne pourrions pas avoir des procédures de ratification supranationales, telles qu'un référendum européen ou bien un Congrès associant le Parlement européen et les Parlements nationaux, avec des pondérations de voix. Cela supposerait une clarification des compétences car la procédure serait déclenchée pour les compétences exclusives. Les choses seraient ainsi relativement verrouillées par rapport aux alternances politiques.
S'agissant de l'ouverture d'un espace public, je ne suis pas entièrement d'accord avec vous : il n'y a pas que les entreprises. Le mandat de la Commission européenne porte certes sur le marché mais il faut bien reconnaître aussi qu'elle tricote ce qu'on lui a demandé de tricoter, et ce n'est pas demain la veille que cela se fera ailleurs, sauf sur les questions de sécurité et de frontières, si nous nous y prenons vite, pour reconstituer une légitimité européenne.
Mais n'oublions pas non plus les ONG : une grande partie de la politique européenne passe par elles. En France, on se bouche le nez devant les lobbies, mais c'est quand il s'agit de Total, car quand il s'agit d'Oxfam ou de Greenpeace on trouve que c'est bien, que c'est noble. Or les deux fonctionnent. Sur certains sujets, la réflexion est très avancée à Bruxelles. Sans Bruxelles, personne n'aurait travaillé sur la question des Roms, par exemple. Il faudrait réfléchir au moyen d'associer les lobbies de façon plus formelle et plus ouverte.
Cela suppose d'impliquer les syndicats. Ces derniers, aujourd'hui, n'ont aucune envie de tenir un discours européen. Alors que je m'occupe beaucoup des questions ferroviaires au Parlement, je n'entre dans aucun des dépôts de la SNCF car la CGT ne souhaite surtout pas que je dise à ses militants ce qui se passe, à savoir qu'ils sont en danger. Je pense qu'il faudrait l'effet d'entraînement que pourrait créer une nouvelle chambre, différente du Comité économique et social européen actuel ou du Conseil des communes et régions d'Europe.

S'agissant de cette Europe des nations, plus forte que l'Europe que nous souhaiterions, l'actualité appelle une remarque. L'interprétation qui est faite du référendum italien est qu'une fois qu'il aura lieu cela tombera directement entre les mains de la BCE, pour gérer la crise financière qui serait induite par ce référendum. La question institutionnelle devient immédiatement une question économique ; on court-circuite complètement l'échelon national et l'apport possible, dans le débat européen, d'une Italie dotée de nouvelles institutions, ainsi que l'échelon du Parlement européen. Comment mieux établir la jonction entre les représentations nationales et les institutions européennes ? C'est le sujet de la démocratisation : ce qu'entend le grand public à la veille du référendum italien, c'est uniquement la question économique et financière.
S'agissant des lobbies, qu'a évoqués Gilles Savary, j'ai travaillé sur la question des mobilités et de la jeunesse européenne, et les organisations de jeunesse donnent clairement une vision plus vivifiante de l'Europe. Les jeunes nous disent qu'ils en ont assez des réformes s'adressant à des publics ciblés, jeunes chômeurs, précaires, étudiants – même s'il faut s'en occuper. Ils demandent aussi une politique globale de la jeunesse. C'est là un sujet qui permettrait de réconcilier le grand public avec la politique européenne.

Je ressens un manque de leadership au niveau européen. Nous avons une Europe technocratique et, dès lors, les populismes émergent. Le Brexit devrait nous faire réfléchir : les élites ne pensaient absolument pas qu'il pouvait se produire, et nous ne sommes pas à l'abri de connaître la même chose en France ou ailleurs.
Je pense que l'Europe doit devenir plus politique mais aussi que chacun de nos pays doit se doter de leaders. On ne peut fonctionner par le biais seulement des ONG ou des syndicats. Il se trouve que je prends souvent le train avec des syndicalistes de SUD, qui viennent de Bercy et se rendent dans ma circonscription, de la CGT et d'autres, et nous en discutons. Ils sont, comme l'a souligné M. Savary, dans le déni : ils savent ce qu'ils risquent mais ne veulent pas en parler. À la limite, nous non plus : la classe politique est sous le couvert des médias, qui ont tendance à sortir des phrases de leur contexte et à en faire des moralités comme à la fin d'une fable.
Je constate par exemple, sur la politique migratoire, très d'actualité en ce moment, que nous n'avons pas été capables d'avoir une vision commune. Il faut donc se demander comment retrouver du leadership. Je suis présidente d'agglomération : dans une agglomération, les communes doivent être respectées mais il faut en même temps une direction. C'est la même chose avec l'Europe et les nations. Or les Parlements nationaux n'ont guère d'influence, à défaut même de véritable pouvoir institutionnel.

Nous sommes en train de démontrer à notre interlocuteur que, quelle que soit notre couleur politique, nous essayons de ramer dans le même sens.
Une chose à laquelle je trouve que l'on ne prête pas assez d'attention en France, c'est que les premières mesures post-Brexit prises par Mme May ont pour but de rétablir du service public en Grande-Bretagne, dans les écoles et les hôpitaux, au moment où nous voulons quant à nous finir de tuer le service public. L'Europe était donc bien vécue par les Anglais comme destructrice des services publics, même si le Brexit résulte aussi, semble-t-il, de l'appauvrissement des classes moyennes. Le fait que les classes moyennes, dans presque tous les « vieux pays », selon l'expression de Gilles Savary, de l'Union européenne se sentent fragilisées joue-t-il bien un rôle, selon vous, et est-ce à elles, en plus des classes populaires, auxquelles il faut parler ?
Il faut bien voir aussi ce qui se passe quand le Parlement européen essaye de jouer son rôle politique. Ainsi, quand il a récemment pris position sur la Turquie, le Conseil européen a répondu qu'il était scandaleux d'affirmer que la Turquie n'était pas démocratique, mais c'est en réalité parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'ils laissent entrer les réfugiés chez nous.
De même, l'histoire wallonne sur le CETA : voilà des représentants des citoyens qui se posent des questions, demandent des précisions, et l'on fait pression jusqu'à ce qu'ils cèdent, parce que le Conseil – bien plus, me semble-t-il, que la Commission européenne – a décidé de passer outre. Chaque fois que les représentants des citoyens tentent de s'exprimer, on leur coupe les ailes. D'où l'intérêt de votre idée d'une réelle représentativité politique au sein de ces institutions.
Nous sommes en train de travailler sur la lutte contre les conflits d'intérêts et la transparence au niveau européen. Je voudrais bien que le même travail soit conduit en France, y compris sur les lobbies ! Ce n'est pas ici à l'Assemblée que j'ai le plus rencontré le MEDEF. La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ayant été adoptée hier en nouvelle lecture, cela permettra de la porter au niveau européen.
Ce qui ressort de notre travail sur la transparence, c'est que, quelques cas étant désormais sur la table, on veut bien s'attaquer au problème au sein de la Commission européenne, mais le Conseil ne veut surtout pas que l'on se penche sur son manque de transparence, et le Parlement européen veut bien aussi toute la transparence souhaitable au sein de la Commission européenne mais surtout pas pour lui, alors qu'il y a justement de nombreux conflits d'intérêts en son sein. Nous avons des exemples précis, y compris d'eurodéputés français.
L'Europe a été construite sur la base d'un découplage entre un espace national conçu comme l'espace de la démocratie et du social – l'État-providence – et un espace européen pensé essentiellement comme celui de la modernisation des économies, du marché, et cela a conduit à une forme de déséquilibre. Les institutions européennes sont très bien équipées pour construire des marchés et les faire fonctionner mais très mal pour les contrôler. Par exemple, si la liberté des capitaux est une réalité, les questions fiscales se décident à l'unanimité. Ce déséquilibre devient de plus en plus intenable.
Par ailleurs, une série d'inflexions se sont produites, ces vingt dernières années, sur la manière dont le marché unique se construit. Alors qu'historiquement la méthode employée était celle de l'harmonisation, on est progressivement passé à la mise en concurrence des États, notamment au plan fiscal. En outre, alors que le projet européen était initialement indifférent au caractère privé ou public des entreprises, une préférence pour la privatisation a nettement prévalu. Les deux évolutions sont de nature à susciter des oppositions nouvelles à la construction européenne.
Le Conseil européen n'est pas exempt de problèmes. Chacun des représentants des Gouvernements sont contrôlés par leurs Parlements mais, collégialement, le Conseil reste dans un angle mort des contrôles. Le Parlement européen n'a aucune prise sur la politique conduite dans ce collège. C'est un problème car le Conseil prend certaines décisions à la majorité et certains États sont ainsi mis en minorité. De même, quand le Conseil évoque des questions à son niveau, il transfère véritablement des compétences au plan européen, car ces questions deviennent des questions de droit européen, et il est après coup bien plus difficile pour les États membres de s'engager de manière autonome dans ces domaines.
Malgré le fait que le président de la Commission européenne a été en partie choisi, en 2014, par le parti en tête, la situation n'a pas profondément changé. La politisation évoquée de la Commission Juncker est surtout de surface. La gestion est peut-être plus soucieuse des réalités politiques mais on ne peut dire que la politique de la concurrence ou du marché unique pourrait être facilement politisée. Wolfgang Schäuble a d'ailleurs averti que, si la politisation de la Commission européenne allait trop loin, l'Allemagne demanderait que la direction générale de la concurrence et la direction générale du marché intérieur en soient retirées et constituées en agence autonome.

Merci. Notre volonté ici est que l'Europe existe davantage. Vous nous avez présenté des pistes pour interpeller nos citoyens et, parmi eux, la masse croissante des indifférents.
La séance est levée à 9 h 35