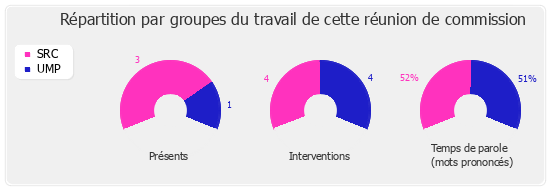Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
Réunion du 4 avril 2013 à 9h00
La réunion

Cette première audition de responsables de l'état-major des armées va nous permettre de connaître plus précisément les exigences des forces armées en matière d'équipement. À quels besoins militaires répondent les programmes d'armement menés en coopération ? La mutualisation peut-elle, au-delà des économies escomptées, renforcer l'intégration des différentes forces armées, pour une meilleure interopérabilité sur les théâtres d'opérations ? Dans quelle mesure l'état-major des armées est-il impliqué dans le pilotage de ces programmes particuliers ? Comment les armées peuvent-elles expliquer les nombreuses demandes de spécifications – demandes qui, au final, complexifient grandement la conduite de ces programmes ?
Je vous propose de commencer cette audition par un propos liminaire de quelques minutes, puis nous vous poserons des questions.
De par mes fonctions, je suis responsable de la planification et de la programmation des capacités ainsi que des aspects budgétaires liés à ces sujets. Actuellement, je consacre l'essentiel de mon temps à l'élaboration du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale et du projet de loi de programmation militaire.
Le thème retenu par votre Mission correspond à l'une des pistes suivies pour résoudre l'équation difficile qui nous est posée : construire un modèle d'armée qui réponde aux ambitions politiques du pays tout en étant moins coûteux. Dès le début de nos travaux, les notions de coopération, de mutualisation et de partage ont été très présentes. Leur approfondissement a permis de montrer à beaucoup de gens que ces démarches sont longues et complexes. Et même si elles sont sans doute génératrices d'économies, il est clair qu'elles ne pourront régler, à court terme, la question des économies à réaliser. Les processus de concertation entre les armées, les nations, les industriels, prennent du temps. On le voit, par exemple, s'agissant de la coopération bilatérale engagée en 2010 avec le Royaume-Uni.
L'Agence européenne de défense (AED) avec le concept de mutualisation et de partage capacitaire (pooling and sharing)¸ l'OTAN avec celui de « défense intelligente » (smart defence), ont eu un rôle important dans les réflexions menées en 2012. Mais, très vite, on se trouve confronté à la réalité de l'existant, des problématiques industrielles, aux programmes en cours, aux besoins de nos forces et aux ressources escomptées. Le recours d'emblée à la mutualisation pour régler les problèmes n'est pas toujours la solution : avant de pouvoir coopérer, on a besoin de garanties sur le besoin opérationnel, la cohérence des calendriers, les ressources disponibles et évidemment la réelle volonté de coopérer. Or ces discussions sont toujours délicates et faites de nombreux allers-retours.
Sous les ordres du général Morizot, je travaille à la construction d'un modèle d'armée qui réponde aux ambitions politiques et leur donnant une traduction militaire. Ma division veille à la cohérence d'un ensemble qui ne doit comporter ni lacune, ni surabondance par rapport aux besoins, tant en matière d'armement – ce n'est qu'une partie de la question – qu'en matière d'effectifs, d'entraînement, de maintien en conditions opérationnelles, etc.
Une douzaine de programmes d'armement de grande ampleur sont menés en coopération.
La France a réalisé avec l'Italie les frégates antiaériennes Horizon, ainsi qu'un programme de torpilles.
Parmi les principaux programmes en cours, on citera celui de l'A400M, conduit avec sept autres nations, et les frégates européennes multi-missions (FREMM), de nouveau en coopération avec l'Italie. Pratiquement tous les programmes d'hélicoptères se font en coopération. C'est le cas pour le NH90 d'Eurocopter, hélicoptère de manoeuvres ou de combat naval, et pour l'hélicoptère d'assaut et de combat Tigre. Le missile air-air longue distance Météor fait également l'objet d'un développement conjoint, ainsi que tous les programmes de communication par satellite et d'imagerie spatiale. Nous avions commencé à coopérer avec les Italiens à l'occasion du programme Syracuse, nous le continuerons avec les Britanniques sur le programme de remplacement des communications protégées par satellite, qui est nécessaire à nos opérations et à l'obtention d'une couverture mondiale correspondant à nos ambitions. En matière d'imagerie, le programme Hélios, servant au renseignement préalable aux opérations, avait fait l'objet d'une coopération multinationale. Nous cherchons aujourd'hui à coopérer – non sans quelques difficultés – sur le programme Musis qui lui succède.
Nous avons ouvert de nombreux autres champs de coopération avec les Britanniques : en matière de guerre des mines, tout d'abord, afin d'assurer la sécurité de nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, mais aussi de drones et de missiles.
Ces coopérations peuvent être bilatérales, multilatérales, ou s'inscrire au sein de l'OTAN ou de l'AED. Elles sont souvent pilotées par l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAr). Il n'existe pas de programme de coopération à vingt-sept. Les coopérations qui réussissent sont celles qui partent d'un noyau de deux, trois ou quatre pays.

La genèse et le suivi des programmes manquent parfois de clarté. Comment un programme en coopération naît-il ? L'état-major prend-il l'initiative de solliciter d'autres états-majors dont il suppose qu'ils ont des besoins similaires ? Les industriels proposent-ils aux états-majors tel ou tel projet ? Le Gouvernement demande-t-il à l'état-major de se rapprocher de ses homologues étrangers pour avancer sur un sujet ?

Un programme étant, pour reprendre vos termes, la traduction militaire d'ambitions politiques, comment ces ambitions se font-elles jour ? Par qui sont-elles exprimées, comment sont-elles transmises, et comment le programme en coopération qui s'ensuit se met-il en route ?

La façon dont une coopération s'engage reste en effet entourée d'un certain flou. La mutualisation des études est sans doute ce qui fonctionne le mieux. Le passage à la production est-il réalisé pour harmoniser les équipements des différentes armées ? Ouvre-t-il un champ plus important à l'exportation des matériels ? Ne conviendrait-il pas de distinguer les coopérations qui procèdent de projets industriels et celles qui correspondent à une véritable volonté des États ?
M. Cornut-Gentille a bien décrit les différentes façons de lancer une coopération. Pour être en mesure d'identifier des pistes de coopération, nous avons mis en place avec la Direction générale de l'armement (DGA), un processus de réseau de veille active visant à identifier ce qui pourrait être réalisé en partenariat. Les points de départ d'une coopération sont en effet divers : parfois une réflexion industrielle, parfois une réflexion opérationnelle, parfois un besoin capacitaire proche, souvent ce sont également des considérations de coût. Plusieurs instances et forum permettent de confronter toutes ces idées. Avec ses compétences en matière de recherche et de technologie et de politique industrielle, la DGA est à même de dégager des pistes qui débouchent sur des coopérations industrielles – mais tous ces travaux s'appuient toujours sur la réponse à des besoins des forces armées. La coopération entre l'état-major des armées et la DGA est donc étroite.
Par exemple, pour ce qui est de l'état-major des armées, nous avons depuis longtemps, dans le cadre du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité (CFADS) des groupes qui se rencontrent régulièrement pour croiser des informations sur les besoins existants, pour voir et identifier si ces besoins et les calendriers peuvent être convergents. Ce travail est à la base de la réflexion sur d'éventuelles pistes de coopération. Ce dialogue est maintenant plus formalisé avec les Britanniques dans le cadre des traités de Lancaster House, il existe également dans le cadre de l'AED et, le cas échéant, de l'OTAN.
En plus de dessiner des synergies potentielles, ce « balayage » des besoins a également pour objectif d'améliorer l'interopérabilité, ce qui est pour nous depuis longtemps une priorité.
Ensuite, les armées entrent dans la phase la plus délicate pour elles, qui consiste à converger sur un besoin commun. Selon les pays, différentes procédures sont utilisées. Le processus est en général assez long dans la mesure où l'on se trouve souvent confronté à des difficultés liées aux calendriers, aux différences de besoins militaires et ensuite à la répartition de la charge industrielle.
Pourquoi est-il si difficile de converger sur un besoin ? Parce que la définition du besoin militaire découle de la manière-même de combattre de chaque armée. Aussi, plus le matériel envisagé se rapproche des savoir-faire des armées, leur coeur de métier, c'est-à-dire les phases opérationnelles, plus les choses deviennent compliquées et les compromis difficiles à trouver. Ce n'est pas une question de traditions mais, j'insiste, de savoir-faire et de tactique : si l'expression du besoin des armées paraît parfois rigide, c'est que ceux qui les formulent se représentent des situations concrètes de combat et font appel à leur expérience. Le compromis peut s'avérer difficile à établir, même si interviennent d'autres considérations d'ordres politique ou technologique et la nécessité de réaliser des économies.
Il existe plusieurs façons de faire « germer » des programmes d'armement menés en coopération.
La première d'entre elles est consécutive aux opérations. La mission Harmattan que nous avons menée avec les Britanniques en Libye a permis de dégager des axes forts de coopération, en particulier pour la boucle de commandement et de décision. Nous nous rapprochons aujourd'hui de nos partenaires en matière d'ISR (intelligence, surveillance, renseignement) et de communications. Le fait d'avoir les mêmes ambitions politiques et la même manière de travailler facilite la mise en oeuvre de coopérations.
La coopération peut également découler d'échanges bilatéraux entre états-majors d'une même arme ou entre états-majors d'armée, ou encore provenir de la R&T (recherche et technologie) au sein de l'industrie. Les perspectives sur le successeur du Rafale et des drones de combat s'inscrivent dans ce dernier champ. Le programme nEUROn, dont vous parlera le Délégué général pour l'armement, naît aussi d'un partage de R&T très en amont. De la même manière, le partenariat avec les Britanniques en matière de drones de guerre des mines commence avec le démonstrateur.
Enfin, le projet « One MBDA », c'est-à-dire la constitution d'un champion européen en matière de missiles par rapprochement entre la partie britannique et la partie française de MBDA, nous conduit à coopérer sur différents types de missiles : missile à courte portée pour les forces terrestres, missiles ANL (anti-navire léger), pour lequel la coopération avec les Britanniques est en germe, etc.
Parallèlement, les coopérations reposant sur une réflexion systématique dans le cadre de l'AED ou dans celui de l'OTAN prennent de plus en plus d'ampleur.
L'AED a ainsi permis d'élaborer un projet pour quinze nations en matière de guerre des mines, ce qui a permis à la France et au Royaume-Uni d'engager un programme sur la base du besoin commun exprimé. Nous espérons que la Belgique et les Pays-Bas nous rejoindront.
D'autres coopérations naissent du soutien, sans être directement liées à un programme d'armement. Possédant des équipements aériens ou navals communs, les nations réfléchissent à des synergies amenant à imaginer la génération suivante. Cela a été le cas du soutien pour les frégates Horizon : la mise en commun des rechanges a créé une dynamique de coopération pour le soutien aux FREMM.
Il y a enfin des coopérations stratégiques qui s'imposent. Les Britanniques, par exemple, sont clairement venus vers nous pour partager des recherches en matière de dissuasion nucléaire.
Tous ces schémas peuvent paraître diffus. En amont, pourtant, la réflexion est de plus en plus organisée avec l'Allemagne et le Royaume-Uni et, de manière plus large, avec l'AED et l'OTAN.

Cette démarche semble plus marquée par l'opportunisme que le volontarisme. En est-il de même dans les autres pays ? Peut-être convient-il désormais, notamment pour des raisons financières, d'accélérer le mouvement. Voyez-vous une méthodologie qui permettrait d'avancer en ce sens ?
On coopère d'autant mieux que l'on fait la guerre de la même manière, avez-vous dit. Sachant que nous menons des opérations communes avec les Britanniques et que notre effort budgétaire de défense est du même ordre, ne doit-on pas considérer que la coopération franco-britannique est la priorité des priorités ? J'aimerais, à cet égard, que vous fassiez le point sur l'application des traités de Lancaster House. J'ai l'impression que l'on a clairement identifié l'axe franco-britannique comme l'axe majeur et le seul possible, mais que l'on n'en tire pas toutes les conclusions opérationnelles.

Les éléments déclencheurs et les instances de réflexion sur la coopération sont-ils formels ou informels ? Varient-ils selon la nature du programme envisagé ?
Par ailleurs, comment s'articulent les initiatives émanant de l'industrie et celles qui reposent sur des considérations opérationnelles ? Existe-t-il une primauté des unes sur les autres ? Comment s'effectue l'ajustement entre le coût inscrit au budget et le retour attendu par l'industriel – en d'autres termes, quel est le mode de formation du prix ? Estime-t-on le coût au départ et comment en suit-on l'évolution ?

Vous l'avez dit, ces coopérations sont complexes et s'inscrivent dans le long terme. Permettez-moi toutefois de remarquer que le programme FREMM a abouti à la construction de plusieurs bateaux différents, qui ne naviguent pas à la même vitesse, n'emportent pas le même nombre de marins et se retrouvent quasiment en concurrence sur le marché de l'exportation ! Et l'on pourrait prendre un autre exemple dans l'aéronautique. D'où vient cette distorsion entre la volonté de coopérer et le résultat ? Il y a là une perte de temps, d'énergie et d'argent, sans compter les problèmes d'interopérabilité qui s'ensuivent. Comment éviter ces dérapages et obtenir que les réalisations finales soient conformes aux objectifs de départ ?

Concernant les FREMM, on peut formuler l'hypothèse que les industriels et les états-majors n'avaient aucune envie de coopérer mais on a mis en exergue la coopération pour faire passer la pilule aux gouvernements.
Bref, la coopération ne sert-elle pas parfois aux industriels et aux états-majors pour mettre les gouvernements dans la seringue ?
S'agissant de la méthode, je répondrai par un exemple.
Aujourd'hui, nous travaillons avec les Britanniques – dont chacun connaît le pragmatisme – à la création d'une synergie opérationnelle avec à sa tête les deux chefs d'état-major des armées. Ce cadre commun devrait nous permettre de constituer un état-major commun ad hoc.
En outre, nous nous efforçons d'étendre la coopération aux moyens existants, qui peuvent se révéler complémentaires. Ainsi, les Britanniques disposent d'hélicoptères lourds Chinook, tandis que nous avons des hélicoptères de manoeuvre en nombre plus important que les Britanniques. Nous espérons pouvoir, le moment venu, partager ces deux ressources.
Le Royaume-Uni possède aussi des drones tactiques Watchkeeper. Nous souhaiterions en acheter à l'industrie britannique, mais en coopérant ensuite avec nos partenaires pour partager les rechanges, le soutien et la formation. Nous avons d'ores et déjà envoyé des soldats de l'armée de terre se former au maniement de ces drones auprès des Britanniques.
Sur ce terrain, donc, les résultats sont satisfaisants et l'entente est bonne.
S'agissant des capacités, le Délégué général pour l'armement et son homologue britannique mènent une coopération plus méthodique, appuyés par un groupe qui rassemble les instances de la DGA et de l'état-major français et leurs équivalents britanniques. La coopération sur des projets d'armement est plus compliquée : non seulement nous n'avons pas les mêmes calendriers, mais il y a certains sujets sur lesquels nos amis britanniques n'ont, en réalité, pas envie de coopérer.
Nous développons néanmoins une démarche méthodique visant à recenser tous les sujets capacitaires. Nous disposons en France de schémas directeurs indiquant, sur trente ans, les grands axes à suivre, de manière à établir des priorités en fonction du budget disponible. Nous sommes en train de rapprocher ces schémas directeurs de ceux de nos partenaires afin d'établir une grille de lecture permettant d'explorer toutes les coopérations en termes de faisabilité et d'économies sur le plan des achats et du soutien.
Cette méthode permet de cadrer la réflexion entre états-majors et entre directions générales pour l'armement sur des sujets qui, sans cela, n'auraient jamais été explorés. Une fois ce premier travail accompli, nous rechercherons des projets de coopérations à une échelle plus fine au sein de chaque schéma directeur, programme par programme.
Une telle démarche constitue une réelle nouveauté. Nous essaierons d'appliquer la même méthode avec les Allemands. Ce que nous avons engagé laisse entrevoir une systématisation en matière de recherche de coopération.
L'AED, pour sa part, travaille sur la R&T et sur des coopérations très en amont, ainsi que sur le rapprochement du besoin opérationnel. Ce deuxième sujet est à nos yeux la base de toute coopération. Sans besoin opérationnel commun et sans rapprochement des doctrines d'emploi, on ne peut arriver à coopérer.
La coopération au sein de l'OTAN est plus difficile en raison du spectre des financements en commun. Comme le disait M. Védrine, notre intérêt est de renforcer le pilier européen de l'OTAN pour répondre au repositionnement stratégique des États-Unis en direction du continent asiatique. Or les petits pays européens, qui ont des budgets de défense réduits, préfèrent financer en commun plutôt que d'apporter leur pierre à l'édifice. Les États-Unis les encouragent en ce sens puisque l'industrie américaine s'en trouve favorisée.
Les financements en commun permettent aux petits pays de coopérer sans s'engager. La France, dont la part dans le dispositif s'élève à environ 11 %, préférerait que cet argent soit consacré au développement de l'industrie nationale et européenne. Nous avons accepté un financement commun pour le système de commandement et de contrôle (C2) du programme OTAN de défense active multicouche contre les missiles balistiques de théâtre (ALTBMD) mais nous ne voulons pas aller plus loin.
S'agissant enfin du programme FREMM, que je connais bien pour y avoir travaillé, il faut rappeler que nous avions pour toute expérience, au départ, le montage industriel extrêmement complexe et coûteux du programme Horizon et que la France, de ce fait, voulait au départ réaliser des FREMM à très bas coût. Plutôt que de construire un bateau de guerre capable de résister à des missiles de plus en plus modernes, il s'agissait de construire, en plus grand nombre, des bateaux capables, une fois touchés, de quitter la zone d'opérations. Nous avions imaginé une architecture de combat entièrement nouvelle qui aurait permis d'économiser de l'argent. Les Italiens voulaient, au contraire, tous les perfectionnements possibles.
À ces difficultés relatives au besoin militaire et au concept du bateau est venu s'ajouter la question du retour industriel. En conséquence, nous avons dû écrire un besoin commun sur la base de ce partage. Tout un travail a été fait pour pouvoir afficher une coopération, mais le résultat est là !
Il faudrait distinguer la coopération en matière d'action militaire et en matière de programmes d'armement. Si la France coopère très bien avec le Royaume-Uni en opérations, c'est moins vrai pour ce qui est de l'armement, bien au contraire. Si l'on fait le bilan des trente dernières années – le Jaguar et le Transall étant bien antérieurs – seuls deux programmes ont donné lieu à une coopération satisfaisante : le système d'armement PAAMS (principal anti air missile system) des frégates Horizon et le missile SCALP-EG, dont la France avait payé seule les frais de développement. Du reste, alors qu'il est membre de l'OCCAr, le Royaume-Uni ne participe qu'à un nombre très réduit de programmes dans ce cadre.
Les processus conduisant à décider d'une coopération sont moins « flous », que très diversifiés selon l'époque, l'objet, les pays et les industriels concernés, et chacun possède sa rationalité propre.
Il était logique, par exemple, de coopérer avec l'Allemagne en matière d'hélicoptères puisque Eurocopter a une entité française et une entité allemande. On l'a vu avec le Tigre et le NH90. De même, il est normal que des processus de coopération avec l'Italie s'engagent en matière de torpilles, Eurotorp étant un groupe franco-italien.
Autre cas de figure, celui où l'on estime que les frais de développement d'un nouveau matériel sont trop importants pour que notre pays les assume seul. Outre l'avantage que constitue le partage de ces frais, l'effet de série propre à une production en coopération permettra de mieux faire adopter le programme par le pouvoir politique et de le rendre plus réalisable financièrement et techniquement. L'exemple type est l'A400M, que ni la France ni les pays partenaires ne pouvaient financer seuls.
Le mécanisme des coopérations s'apparente à un sablier : dans le cône du haut, on trouve plusieurs États, états-majors et industriels ; la partie étroite, au milieu, correspond au processus décisionnel commun, qui lance un programme aux caractéristiques similaires ; et, dans le cône du bas, les caractéristiques se diversifient de nouveau, au gré des différentes préoccupations et spécifications. C'est ce que l'on constate aujourd'hui : les produits résultant des programmes menés en coopération ne sont pas similaires et, partant, n'apportent pas les gains attendus en matière d'homogénéité opérationnelle et de coûts de développement et d'acquisition puisque l'effet de série ne joue pas.
Pour remédier au défaut actuel de la coopération, il faudrait donc s'attaquer à la partie basse et, si je puis dire, transformer le sablier en entonnoir et s'en tenant à un produit homogène.

Comment les états-majors perçoivent-ils le rôle de la DGA dans la discussion des programmes en coopération ? Donne-t-elle un éclairage technique susceptible de rapprocher les points de vue de chaque armée ? Les méthodes des DGA des autres pays sont-elles très différentes ? Comment voyez-vous son rôle à l'avenir ?
Les états-majors estiment-ils que certains équipements ou certaines recherches ne doivent en aucun cas faire l'objet de coopérations, tant dans la conception que dans l'élaboration industrielle ?
La question sur la DGA est difficile. La DGA a un rôle essentiel car in fine une coopération n'est vraiment concrète que lorsqu'il y a un contrat qui lance un programme d'armement. La conduite de ces programmes est toujours délicate et nous apprenons, État-major et DGA, à chaque réalisation. Nous avons par exemple beaucoup appris avec l'A400M, la DGA dans la négociation avec l'industrie via l'OCCAr, les États-majors dans l'établissement et le respect des besoins opérationnels. Chacun doit jouer sa partition.
Une bonne coopération entre nous est donc essentielle. Il peut néanmoins exister des divergences, notamment lorsque plusieurs possibilités de coopération sont envisageables. La DGA pourra par exemple soutenir une idée qui lui fait entrevoir une consolidation de la base industrielle ou un abaissement du coût d'un équipement difficile à financer seul mais sur lequel nous avons du mal à converger sur le besoin opérationnel. Dans d'autres cas, l'état-major défendra une possibilité dont il aura discuté avec ses homologues des armées étrangères par exemple de l'intérêt d'opérer sur le même matériel, alors que la DGA n'y souscrit pas pour des raisons de politique industrielle. La discussion peut alors être serrée, mais elle se déroule dans un cadre établi et le ministre rend ses arbitrages.
Nous en sommes à la deuxième génération de coopérations. Nous commettons encore probablement des erreurs mais nous travaillons déjà à les corriger pour la suite, un des enjeux étant clairement l'expression des besoins.
Les discussions autour de nEUROn, par exemple, nous amènent à réfléchir à ce que sera l'aviation de combat en 2045 et à nous poser la question de l'avion de combat européen. La démarche de R&T et de coopération industrielle peut démarrer, mais les considérations opérationnelles reviennent naturellement dans le jeu. Même si des décalages se produisent et si le processus peut paraître lourd, chacune des parties est immanquablement conduite à discuter avec les autres avant que des décisions ne soient prises.
De même, nous ne pourrions jamais, dans le contexte budgétaire actuel, financer seuls des satellites militaires. Il est donc normal d'essayer de trouver une coopération, puisque le besoin existe dans plusieurs pays. Sans drones, sans satellites, sans missiles performants, une armée moderne n'est plus capable d'accomplir les missions qui lui sont demandées. Même si l'industrie française de défense est capable de développer pratiquement tous les équipements dont nous avons besoin, nous n'avons plus la capacité de développer seuls la totalité des équipements. Nous devons nous adapter, l'industrie aussi. Le processus d'« urbanisation », comme on dit en informatique, est long mais il finira par aboutir. Nous sommes en période d'apprentissage.
Il reste néanmoins, Monsieur Bridey, des domaines qui relèvent entièrement de la souveraineté. Nous ne sommes pas prêts à partager, par exemple, la technologie de nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les autres pays ne le sont pas plus d'ailleurs. Il s'agit de savoir-faire élaborés pendant des dizaines d'années. Cette souveraineté étant parfois essentielle pour nos capacités opérationnelles.