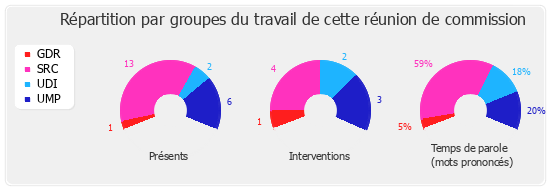Commission de la défense nationale et des forces armées
Réunion du 11 septembre 2013 à 18h30
La réunion
La séance est ouverte à dix-huit heures trente.

Je suis heureuse d'accueillir M. Éric Trappier, président-directeur général de Dassault Aviation, sur le projet de loi de programmation militaire – LPM. Nous débutons avec lui un cycle d'audition des industriels de la défense destiné à préparer l'examen de ce texte important, dans lequel le Rafale prend une place particulière. Je m'attends d'ailleurs à de nombreuses questions sur le dimensionnement de la construction financière de la LPM et sur les perspectives de vente du Rafale – un avion magnifique, sans doute le meilleur à l'heure actuelle.
Je vous remercie d'avoir organisé cette rencontre sur un sujet aussi important pour notre société qu'il l'est pour les députés. Je tenterai d'être le plus transparent possible, même si je ne pourrai entrer dans le détail des négociations en cours.
Je rappelle qu'en 2012, le chiffre d'affaires de Dassault Aviation était réalisé à 70 % dans le secteur civil et à 30 % dans le domaine militaire ; 75 % à l'exportation et 25 % en France – ce dernier marché concernant principalement le Rafale.
La société emploie un peu moins de 12 000 personnes, dont 8 000 sur le territoire national. Si l'on excepte une implantation importante aux États-Unis pour la production de Falcon, nos avions sont produits principalement en France.
La société, bâtie à l'origine pour produire des avions destinés à l'armée, a atteint un équilibre entre civil et militaire que nous souhaitons préserver. Nous voulons, en effet, à la fois vendre plus de Falcon et conserver une importante part de marché dans les avions de combat. Toutefois, nos usines sont spécialisées par type d'activité et non selon l'usage, militaire ou civil, des avions. Ainsi, l'usine de Martignas fabrique des voilures pour les deux secteurs, comme celle de Mérignac, qui assemble les appareils.
J'en viens à la future loi de programmation militaire, dont nous attendons qu'elle nous permette de maintenir la charge de notre bureau d'études – liée, dans le secteur militaire, au Rafale. Le retour d'expérience sur cet avion – l'un des meilleurs du monde, comme l'a souligné Mme la présidente – est bon : nous avons pu vérifier que ce programme était adapté aux besoins définis par les armées. Si j'en crois les militaires, l'appareil a parfaitement rempli ses missions en Libye et au Mali, et fera sans doute encore ses preuves lors d'éventuelles opérations à venir.
Pour autant, des travaux de développement restent à accomplir pour prendre en compte le retour d'expérience des opérationnels. L'avion va continuer à évoluer avec le nouveau standard, le F3R –amélioration prévue de longue date. Ce travail a débuté en 2013 et sera poursuivi dans les années à venir. Il représente une des composantes de la programmation miliaire.
En termes de développement et d'études, nous voyons également notre avenir dans les drones. S'agissant des drones de combat ou UCAV – unmanned combat air vehicle –, nous disposons d'une expérience positive avec le nEUROn : nous sommes en effet les seuls au monde, avec les Américains, à maîtriser cette technologie, grâce à une coopération entre six pays européens contributeurs. Dassault a donc également montré sa capacité à développer un modèle de coopération vertueux, au sens où, contrairement à d'autres, il n'entraîne pas d'importants surcoûts. Je rappelle que le Rafale n'a dépassé son budget initial que de 4 % ; on ne peut pas en dire autant de certains programmes développés outre-Atlantique, outre-Manche ou outre-Rhin. Une telle maîtrise des coûts, rare dans le domaine militaire, est un sujet de fierté nationale.
Selon nous, le développement des drones de combat doit s'inscrire dans le cadre du traité de Lancaster House, c'est-à-dire de la coopération franco-britannique. Une étude sur ce sujet nous a été confiée il y a un an par le ministère de la Défense. Elle s'achèvera à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, mais devrait naturellement conduire à un projet plus détaillé de développement de drones de combat, élaboré dans un cadre européen – car la coopération franco-britannique contribue à la défense de l'Europe.
En ce qui concerne les drones MALE – moyenne altitude, longue endurance –, Dassault est depuis de nombreuses années une force de proposition. À la suite de l'achat de Reaper américains, qui répondait à une certaine urgence, nous avons suggéré au ministère de la Défense un nouveau projet associant EADS et Finmeccanica. Nous attendons désormais de savoir si la France, l'Allemagne et l'Italie sont prêtes à développer, d'ici dix ans, la future génération des drones de surveillance.
Les technologies véhiculées à travers les drones MALE ne sont pas liées à la capacité du porteur, mais à celle du système, et en particulier à la capacité d'intégrer des liaisons de données fiables. L'expérience acquise avec le nEUROn et d'autres avions de combat nous rend aptes à développer un tel programme. Nous avons d'ailleurs, avec les deux autres groupes concernés, demandé aux institutions européennes – Agence européenne de défense, Commission – de soutenir les efforts de recherche et développement dans certains domaines tels que l'insertion dans le trafic aérien. La tenue, avant la fin de l'année, d'un conseil européen en matière de défense nous permettra, nous l'espérons, de progresser dans cette logique de développement de la technologie des drones – avec les Britanniques pour les engins de combat, et avec les Allemands et les Italiens pour ce qui concerne la surveillance. Cette coopération n'est toutefois pas exclusive : d'autres pays pourront s'y joindre.
Nos bureaux d'études et de développement bénéficieront également, je l'espère, de la signature du contrat pour la rénovation des Atlantique 2. La modernisation de ces avions, ou plus exactement de leur système, est une demande forte de la marine nationale, notamment pour faire face à la menace anti-sous-marine, mais aussi pour mener d'autres missions, comme on l'a vu au Mali. Cette modernisation fait travailler en coopération Dassault, Thalès et DCNS : elle sera donc également l'occasion de développer des nouvelles méthodes d'atelier système communes aux trois sociétés, avec en particulier l'utilisation intensive de l'outil PLM – product lifecycle management – développé par Dassault systèmes.
En ce qui concerne le Mirage 2000, dont nous avons compris qu'il allait encore vivre quelques années en parallèle avec le Rafale, nous avons également formulé des propositions, et nous attendons de savoir quelle suite leur sera donnée.
J'en viens à la production en série. Comme je l'ai déjà indiqué – et la direction générale de l'armement comme le ministère de la Défense l'ont confirmé –, nous avons besoin de construire un Rafale par mois, et onze par an, pour conserver la capacité de production de cet avion. Nous avons fait le pari de produire à cette cadence jusqu'en 2016 pour équiper l'armée française, ce qui laisserait à l'État et à l'industrie le temps de mettre en commun leurs efforts en vue d'obtenir un contrat à l'exportation dans un des pays où les négociations sont assez avancées. Cet objectif est important dans la mesure où il permettrait à Dassault Aviation et à ses sous-traitants de conserver un intérêt à produire pour le secteur militaire.
En effet, la sous-traitance est aujourd'hui très sollicitée par le secteur civil, économiquement bien plus intéressant, comme le montrent les exemples d'Airbus et du Falcon. Mais la production du Rafale relève aussi de l'intérêt national : il est donc important de maintenir un équilibre en faveur de nos sous-traitants et de préserver leur motivation.
Je finirai par le maintien en condition opérationnelle – MCO –, qui a fait l'objet de nombreuses discussions dans le cadre du livre blanc. Dans ce domaine, nous nous inscrivons dans les efforts permanents réalisés par les différents organismes concernés – DGA, SIMMAD, etc. – pour améliorer l'efficacité opérationnelle des matériels. Nous bénéficions de l'expérience acquise en soutenant environ un millier d'avions de combat et 2000 Falcon dans le monde.
Dans ce domaine, nous revendiquons pour l'industrie un certain rôle. Je ne parle pas d'externalisation complète, car il est nécessaire que les militaires conservent une capacité à opérer leurs avions partout dans le monde. Mais l'industrie doit être capable de soumettre des offres valables pour des périodes longues – seule condition pour que l'activité soit rentable. Nous avons commencé à le faire avec le Rafale, mais il faudra l'étendre à d'autres types d'avions.

J'ai lu avec attention le compte rendu, dans Le Monde, d'une tribune que vous avez publiée avec d'autres industriels de l'armement à la veille des universités d'été de la défense. Vous y critiquez le comportement des gouvernements précédents, soulignant qu'« aucune mandature n'a vu l'exécution dans sa totalité d'une loi de programmation militaire ». Vous plaidez pour que soit recréée « une relation de confiance qui passera par le respect des engagements pris et par une sincérité budgétaire ». J'en déduis qu'à vos yeux, cette confiance n'est pas suffisamment forte à l'heure actuelle. Pourtant, les lois de programmation militaire comprenaient des clauses de sauvegarde et ont fait l'objet de bilans. Le projet de LPM que nous allons bientôt examiner prévoit d'ailleurs une clause de rendez-vous, fixée fin 2015, afin d'actualiser certaines prévisions critiques et de vérifier la bonne adéquation entre objectifs fixés et réalisations. Cette approche vous semble-t-elle de nature à rétablir la confiance ?
Par ailleurs, lors d'une audition précédente, vous disiez ceci : « À l'heure actuelle, l'État soutient l'exportation sur les plans politique et stratégique. Il serait très difficile de passer de gros contrats avec des États qui n'entretiennent aucune relation politique avec la France. La donne politique est donc nécessaire sans être suffisante. » Quel est votre sentiment sur les conséquences que la crise syrienne pourrait avoir sur votre entreprise ? Qu'en est-il de nos relations avec le Qatar et l'Arabie saoudite, qui soutiennent la rébellion, et avec la Russie, qui appuie le gouvernement en place ? Je me souviens qu'une importante délégation russe était présente au salon du Bourget.
La tribune que j'ai publiée avec six autres chefs d'entreprise faisait suite à l'appel lancé en début d'année au Président de la République à propos de l'élaboration du budget de la défense. Elle se voulait un commentaire positif, à la veille des universités d'été de la défense. Nous nous réjouissons, en effet, à l'idée que puisse être adoptée une version plutôt optimiste de la loi de programmation militaire, contrairement à ce que laissaient entendre certains bruits de couloir. Nos inquiétudes ont visiblement été prises en compte par le Président de la République et le ministre de la Défense, mais aussi par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Nos commentaires ne s'adressaient donc pas au gouvernement actuel. Mais sous tous les gouvernements précédents, on a vu une application incomplète des lois de programmation militaire – en disant cela, je ne formule pas une critique, mais une inquiétude. Dès lors, l'introduction d'une clause de sauvegarde, afin de vérifier certaines hypothèses, de prendre en compte certains aléas après un ou deux ans d'application, est selon nous une bonne décision.
Notre remarque était motivée par la longueur de notre cycle industriel. Il ne s'agit pas de défiance à l'égard de l'État, mais les calendriers politique et industriel peuvent être différents. Dans l'industrie, nous dressons des plans sur dix ans, pour déterminer où doit être investi l'argent, quelles usines doivent se doter d'outils plus modernes, s'il faut acheter des terrains ou construire… S'agissant du monde civil, tout cela est notre affaire. Mais en matière militaire, nous devons aussi savoir où nous allons. Il faut donc établir un contrat moral – à défaut d'être écrit – et de long terme avec l'État. Cette préoccupation est bien entendu indépendante de la couleur politique, la défense étant un secteur trop important pour pouvoir subir des changements au gré des alternances. Ce n'est d'ailleurs pas le cas : la continuité est réelle.
Il est vrai que des aléas surviennent. Il en est ainsi sur le plan budgétaire : nous ne nions pas la nécessité de désendetter la France. Mais la pratique du « pompage » – comme on dit dans le jargon aéronautique – coûte cher et entre en contradiction avec les intérêts à long terme de l'industrie. Telle est la raison de la tribune publiée par les industriels de la défense : nous avons été entendus dans un contexte budgétaire difficile, mais nous resterons vigilants lors de l'exécution de la LPM. Si elle n'est pas appliquée complètement, en effet, certains programmes pourraient couler. Cela ne signifie pas que des sociétés vont disparaître, mais celles qui produisent à la fois pour les mondes civil et militaire devront sans doute réorienter leurs activités.
Or nous devons être vigilants, car les compétences mobilisées ne sont pas les mêmes pour les deux secteurs – même si nous tentons d'établir une synergie maximale entre eux. Par exemple, la furtivité n'est d'aucune utilité pour des avions civils. Si ces compétences ne sont pas mises à contribution dans le cadre de contrats passés avec le ministère de la Défense, il faut les consacrer à d'autres domaines, ne serait-ce que pour préserver la motivation des ingénieurs.
Plus généralement, nous sommes confrontés à un problème dont nous avons commencé à parler au sein du groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales : alors qu'il y a une dizaine d'années, le militaire attirait encore les meilleures compétences, aujourd'hui, les jeunes qui entrent dans l'industrie préfèrent le civil, où de nouveaux programmes sont lancés tous les jours. C'est d'autant plus vrai que la fin du service national a rendu la société civile moins sensible aux questions de défense.
C'est d'ailleurs aussi l'intérêt du nEUROn, un véritable challenge d'ingénieur. Nous sommes les seuls au monde, en dehors des Américains, à savoir faire voler un avion furtif et sans pilote de la taille d'un Mirage 2000. Dans un tel programme, on peut placer les meilleurs, d'autant que le résultat est tangible – ça vole. C'est donc mobilisateur. De même, la coopération avec les Britanniques permettrait de motiver les jeunes. Mais il en va autrement si on tergiverse ou si les projets sont modifiés en cours d'exécution. Le projet de LPM, dans la mesure où il prend en compte les besoins des bureaux d'études, me semble donc positif en ce sens.
J'en viens à la crise syrienne, dont je ne pense pas qu'elle puisse avoir à court terme des retombées, positives ou négatives, sur l'exportation du Rafale. Je prendrai l'exemple de nos deux prospects principaux, l'Inde et le Qatar. En Inde, le besoin de rénovation de sa flotte de combat est réel. Après une compétition dure entre six candidats, un choix a été opéré, sur le plan opérationnel tout d'abord, budgétaire ensuite : le Rafale a été déclaré gagnant, et nous sommes entrés dans la phase de négociation commerciale. Dans un tel contexte, la position de la France s'agissant de la Syrie n'a pas, à ma connaissance, de conséquence.
En ce qui concerne le Qatar, les Émirats ou l'Arabie saoudite, je n'ai pas suffisamment connaissance de l'état précis de nos relations avec ces pays – c'est l'affaire des politiques – pour évaluer l'impact de la crise syrienne. De toute façon, même si Dassault vend des Falcon à l'Arabie saoudite, notre société y a perdu le marché des avions de combat – face au Tornado.
En revanche, les opérations au Mali ont eu un impact sur le Qatar et les EAU. La capacité de la France à intervenir en premier, avec des matériels capables de traiter les cibles de manière précise – bien plus qu'en envoyant une centaine de Tomahawk dans la nature –, et d'y effectuer des missions longues – directement entre Saint-Dizier et le Mali – a été appréciée. Non seulement elle l'a été sur le plan politique – car n'importe quel pays n'a pas une telle capacité d'intervention –, mais elle l'a été aussi sur le plan des moyens matériels et de la faculté à opérer parfaitement les manoeuvres. Cela s'est vu un peu partout dans le monde. L'opération au Mali a donc eu une influence positive sur l'image du Rafale, comme avant celle effectuée en Libye.

Soyez assuré que la Commission suivra de près l'application, en 2015, de la clause de revoyure.

Je ne suis pas d'accord avec une de vos affirmations : le Rafale n'est pas un des meilleurs avions du monde, c'est le meilleur !
Je disais cela par modestie…

Le problème, en revanche, c'est qu'il n'est pas notre meilleur produit d'exportation.
Il est prévu de livrer 26 Rafale à l'armée française. Or, vos prédécesseurs ont toujours affirmé qu'ils avaient l'obligation de produire onze avions par an, et vous avez confirmé que cette cadence ne pouvait pas être réduite. Si la société n'obtient pas de contrats à l'export, notre armée devra donc les acheter.
Nous espérons tous que ces contrats vont être signés : il y va de l'intérêt national, mais aussi de notre intérêt financier, car l'absence de contrats déséquilibrerait fortement le financement de la loi de programmation budgétaire. Ce point fera sans doute l'objet de la clause de revoyure.
Voyons les choses de manière positive et supposons que l'export fonctionne très bien. Peut-on imaginer, dans une telle hypothèse, de livrer moins d'avions à nos armées pour dégager des marges budgétaires ? Au fond, l'essentiel pour vous est de vendre des avions, quel que soit le client.
Plus nous vendrons d'avions à l'export, mieux cela vaudra. Mon seul impératif est d'en produire un par mois : c'est la condition de sa viabilité industrielle. Mais nous serions très favorables à l'idée d'augmenter la cadence.
Cela étant, les 26 avions que nous devons livrer en 2016 sont en cours de construction. Or la transformation d'un avion destiné à la France en version exportable demande une adaptation qui n'a rien de simple.
En outre, le programme Rafale a été lancé pour répondre à un besoin, et ce besoin existe toujours, quelles que soient les contraintes budgétaires. La marine doit obtenir ces avions rapidement pour équiper son porte-avions, en raison du retrait de service des Super étendard en 2015. Quant à l'armée de l'air, elle est prête à faire durer plus longtemps ses Mirage 2000, mais seulement dans l'attente de la livraison des Rafale. D'ailleurs, quand elle doit opérer à la demande du chef de l'État, c'est à cet avion qu'elle recourt en premier. Il appartient donc au ministère de la Défense de déterminer exactement quels sont les besoins.
Nous avons donc la possibilité de nous adapter, mais il y a un timing à respecter. La production du Rafale n'est pas seulement liée à l'équation budgétaire : elle répond à un besoin opérationnel.

Ma question porte également sur le Rafale. La commande de 26 appareils est destinée à atteindre l'objectif de 225 avions de combat en 2020, mais elle ne suffira pas à soutenir une production de 11 exemplaires par an : la différence représente 40 avions. Que se passerait-il si les pistes d'exportation ne menaient nulle part ? L'État devrait financer cette différence : quel est le coût d'un Rafale ?
En réalité, la commande portait sur 180 Rafale, et nous en avons déjà livré 120. La question porte sur la livraison et le paiement des 60 restants : quelles sont les préférences de l'État en la matière, compte tenu du contexte budgétaire compliqué que nous traversons ? Par ailleurs, rien n'exclut la commande d'une nouvelle tranche pour atteindre le format de 225 appareils visé par le livre blanc et les LPM successives, compte tenu du retrait de service des Super étendard – en 2015 – puis des Mirage 2000 – vers 2020. Je ne pense pas que l'on puisse envisager dans ces délais de trouver un successeur au Rafale. J'y serais favorable, mais cela demanderait un tout autre effort budgétaire. Il faudra donc faire vivre cet avion sur une longue durée.
La LPM représente donc, pour l'État et l'industrie, un pari. Sous réserve d'obtenir des contrats à l'export, que nous avons bon espoir de finaliser dans les délais – même si les discussions sont longues et compliquées –, le pari sera gagné. Dans le cas contraire, nous en discuterons dans le cadre de la clause de rendez-vous.
Quant au coût d'un Rafale, seule la DGA le connaît. Je connais le coût de la partie construite par Dassault, mais l'État achète directement le radar ou le moteur, par exemple.

Dans l'hypothèse où le contrat avec l'Inde serait signé fin 2013, vous avez déjà annoncé que la commande ne pourrait être livrée qu'en 2016 ou 2017, et que les appareils concernés ne pourraient être prélevés directement sur les chaînes françaises, car ils doivent être adaptés aux conditions indiennes. Pouvez-vous nous préciser la nature des demandes de l'armée indienne ? Quelles conséquences la nécessité d'une adaptation pourrait-elle avoir sur les plans de charge des usines de Mérignac et de Martignas ?
Je ne peux pas, dans une réunion ouverte à la presse, entrer dans le détail des demandes particulières de l'armée indienne en termes de définitions techniques, car ces informations sont confidentielles.
Si nous parvenons à obtenir un contrat dans des conditions compatibles avec une livraison en 2017-2018, tout ira bien. Dans le cas contraire – et rappelons qu'il est difficile de signer de tels contrats –, l'alternative, pour l'État, est la suivante : soit il arrête le programme, soit il le maintient à hauteur d'un Rafale produit par mois. Dans ce cas, la question du financement devra être abordée en 2015.
Quant à l'impact sur l'emploi de l'arrêt du programme, il serait important, car la charge de travail liée à la construction d'un Rafale est le triple de celle d'un Falcon. Mais la conséquence, ce serait surtout une révision de notre modèle industriel au détriment de la fabrication d'avions de combat. Cela étant, je ne m'inscris pas, pour l'instant, dans une perspective aussi négative, même si un industriel se doit de faire face à toutes les hypothèses.

Pouvez-vous dresser un rapide panorama de l'offre concurrente au Rafale ? J'ai eu l'occasion de visiter, au Texas, la chaîne de montage des F-35 de Lockheed Martin : de toute évidence, ce modèle constitue un rival redoutable au vu du rythme de production. Mais c'est surtout à propos des avions proposés par des nations émergentes ou des pays comme la Russie que je souhaitais connaître votre avis. Nous avons assisté à l'impressionnante démonstration du Sukhoï SU-35, au Bourget, et nous savons qu'un T-50 est en cours de développement. Ce fabricant est-il un dangereux concurrent, en général et sur vos propres prospects ?
Pour l'instant, les Russes sont des concurrents sur le plan général, mais on les voit peu sur nos marchés, qui concernent des pays avec lesquels la France entretient une relation politique fondée sur une compréhension particulière et s'inscrivant dans un cadre stratégique. L'Inde – où 90 % de la flotte est d'origine russe, le reste étant fourni par la France – fait figure d'exception. Mais ce pays a fait le choix de maintenir une double source d'approvisionnement : elle a acheté des Sukhoï SU-30 et réfléchit au développement avec les Russes d'un nouvel avion de combat, mais elle se prépare aussi à acheter des Rafale, s'inscrivant ainsi dans une longue tradition d'achat à la France, de l'Ouragan jusqu'au Mirage 2000. Nous ne sommes donc pas vraiment en concurrence, même si le Mig 35 faisait partie de la dernière compétition – il a été éliminé dès le premier tour.
Dans les autres pays, les Russes ne sont pas nos concurrents : ils ont été écartés de la compétition au Brésil, au Moyen Orient, en Malaisie. Les pays dans lesquels ils sont présents font partie de leur sphère traditionnelle d'influence.
Nos concurrents sont d'abord les Américains, qui bénéficient de l'effet de masse que représentent les milliards de dollars investis par l'État fédéral. En termes de dépenses budgétaires, le F-35 n'a en effet rien à voir avec le Rafale : la force des Américains est d'avoir commencé par évoquer un avion à bas prix utilisable par les trois armes, pour finir par présenter un appareil dont la conception aura coûté très cher au contribuable. Cela fait partie de la politique économique des États-Unis : en matière d'avions de combat, plus ils en dépensent, mieux c'est pour l'économie américaine, quels que soient les dérapages en termes de coût. Il faut bien comprendre que l'industrie de la défense n'est pas qu'un consommateur de crédits. Elle a un effet vertueux, puisqu'elle permet de développer des technologies utiles dans d'autres domaines. En outre, elle recourt peu à l'externalisation : en France chaque euro dépensé l'est sur le territoire national. Enfin, lorsque l'on parvient à conclure des contrats à l'export, elle contribue favorablement à l'équilibre de la balance commerciale.
Les Américains ont bien compris cela : un rapport de la Maison blanche souligne qu'un avion de combat met en jeu 17 technologies stratégiques sur les 22 qui concourent au développement d'un pays. C'est pourquoi ils n'hésitent pas à dépenser beaucoup en ce domaine, même s'ils ont réduit légèrement leur budget, ce qui les rend encore plus agressifs d'un point de vue commercial.
À l'export, ils bénéficient de nombreux avantages. Tout d'abord, nous parlons des États-Unis d'Amérique : pas un amiral, pas un général ne visite un pays sans dire « Achetez nos avions ! ». C'est un véritable rouleau compresseur. Même en Inde, où ils ont perdu la compétition, il ne se passe pas une semaine sans qu'un officier américain ne délivre un tel message. Aucun refus ne les arrête.
Par ailleurs, ils se font payer en dollars. Or, quelles que soient les difficultés économiques rencontrées en Europe, l'euro reste fort, ce qui leur donne un avantage concurrentiel.
De plus, les coûts de main-d'oeuvre n'y sont pas du tout les mêmes. Je vois la différence entre l'usine que Dassault détient aux États-Unis, et qui emploie 2 500 personnes, et celle située dans la région de Bordeaux.
Enfin, le format des séries est bien plus élevé aux États-Unis, d'autant qu'en France, il a plutôt tendance à baisser. Et ce n'est pas parce que l'on nous avait promis une commande de 320 appareils il y a vingt ans que nous pouvons envoyer une facture à l'État lorsque ce dernier nous annonce qu'il n'en achètera – peut-être – que 225 ! Tout cela se fait à budget identique.
S'agissant de la concurrence européenne, nous battons systématiquement l'Eurofighter Typhoon lorsque nous sommes en compétition, soit en finale – en Inde, par exemple –, soit en demi-finale – en Corée, ou à Singapour. Quant au Gripen, les Suisses, en l'achetant, admettent eux-mêmes qu'ils se déclassent en division d'honneur. Leur choix stratégique est de faire semblant d'avoir une aviation de combat tout en achetant le modèle le moins cher. Tant que l'on ne fait pas la guerre, ce n'est pas très grave.

Vingt-six appareils commandés, à raison de 11 appareils par an, cela nous mène à la mi-2016. Dans ces conditions, une « revoyure » en 2015 ne serait-elle pas trop tardive ?
Par ailleurs, la nécessité de fabriquer des Rafale de différentes versions est-elle facilement conciliable avec une cadence de production assez modeste ?
Les premiers modèles de Rafale ont été produits il y a longtemps et doivent être modernisés. Pour que ces premiers avions soient à la hauteur de ceux qui sortent aujourd'hui des chaînes de montage, la part d'équipements fabriquée par Dassault a-t-elle besoin d'une sérieuse remise à niveau ?
En ce qui concerne la partie fabriquée par Dassault, il y a peu de modifications à apporter. Nous nous contentons d'améliorer les process de production des tôles de carbone. En revanche, pour tout ce qui est fabriqué par notre réseau d'industriels sous-traitants, des obsolescences doivent être traitées. Et en cas de changement du type de radar ou des contre-mesures, il est nécessaire de vérifier que tout fonctionne, ce qui implique un certain nombre de travaux. Mais ce n'est pas un sujet déterminant.
Pour répondre à la première question, le délai est en effet un peu court entre 2015 et la fin du carnet de commande. Une discussion est en cours avec le ministère de la Défense de façon à concilier l'inconciliable.

Dans l'hypothèse où aucun marché ne serait remporté à l'export, quelles seront les conséquences industrielles ? Quelles mesures avez-vous prévu pour moderniser les Rafale déjà en service ? S'agissant de la génération 5, les études liées au nEUROn peuvent-elles profiter au développement, dans un futur plus lointain, d'un remplaçant au Rafale ?
Faute d'export, les armées françaises exprimeront, par l'intermédiaire du ministère de la Défense, leurs besoins en appareils, et nous serons en mesure de les leur fournir, sous réserve que le seuil d'un avion par mois soit respecté. En cas de rupture, il nous appartiendra de reconditionner nos capacités de production.
Quant à la modernisation des Rafale, elle concerne le bureau d'études. Dans ce domaine, les prévisions de la LPM résisteraient, me semble-t-il, à l'absence de solution à l'export. Les contrats liés au retour d'expérience permettent de proposer des améliorations et de définir des standards successifs que les militaires choisiront ou non d'appliquer aux appareils déjà en fonction. Sous réserve que le projet de LPM soit maintenu en l'état, je n'ai donc pas d'inquiétude : les bureaux d'études de Dassault, Thalès et d'autres entreprises pourront continuer à travailler à l'amélioration du Rafale.
Le nEUROn est différent du Rafale, mais son développement nous apprend différentes choses, comme la maîtrise de la furtivité. Une telle expérience pourra nous servir un jour ou l'autre, mais pas dans l'immédiat.

Vous avez évoqué l'engagement d'un projet de drone avec EADS et Finmeccanica. On entend dire que le modèle économique d'un drone MALE européen ne serait pas soutenable, compte tenu des faibles quantités qui pourraient être écoulées. Quel est votre sentiment à ce sujet ?
Le nEUROn, développé en coopération, est un succès. Comment envisagez-vous la suite ? Avec cet avion furtif et sans pilote, nous entrons dans la génération suivante des avions de combat. Or nous sommes très attachés à ce que l'industrie française et européenne conserve des compétences dans ce domaine.
S'agissant du Rafale, une chose est de fabriquer des avions en France pour l'armée française, et une autre de les fabriquer pour l'Inde, voire en Inde. Cela signifie une nouvelle organisation, une structuration de la supply chain, voire le déplacement des sous-traitants. Nous vous faisons confiance pour maintenir en France les éléments de technologie les plus critiques, mais qu'en est-il du reste ?
En matière militaire, la notion de modèle économique n'a pas grand sens. On peut se comparer à d'autres, mais il n'existe pas vraiment de business plan. Nous connaissons maintenant les conditions de développement d'un drone MALE ; les questions sont plutôt de savoir s'il faut réaliser seulement ce drone, s'il faut prévoir un nouveau radar, ou adapter au drone les radars utilisés pour la surveillance maritime, etc.
Certes, on ne peut pas envisager la construction de centaines de drones MALE. Il en allait de même, d'ailleurs, lorsque le programme Reaper a été lancé, même s'il a depuis bénéficié de la puissance américaine. De la même façon, les Israéliens, en développant leur filière de drone, n'ont pas recherché la quantité, mais la réponse à un besoin opérationnel. Cela étant, si un programme militaire vise à développer une capacité à opérer, il relève aussi de la politique industrielle.
En tout état de cause, nous avons les compétences pour réaliser un drone MALE en Europe. Le développement du porteur n'est pas la partie la plus difficile. La fabrication et l'intégration des liaisons sont plus compliquées, s'agissant d'une machine devant opérer à distance : il faut éviter que le drone soit intercepté par la force adverse, ce qui met en jeu une problématique de cybersécurité. Enfin, si l'appareil emporte des armes – pour un tir d'opportunité dans le cas du drone de surveillance –, il faut s'assurer de pouvoir bien tirer. Mais toutes ces exigences sont indépendantes d'un modèle économique.
La question est donc de savoir si la France, l'Allemagne et l'Italie ont la volonté de lancer ce programme. Nous sommes en tout cas demandeurs, car nous en avons besoin pour maintenir et développer nos compétences. Alors que l'Europe est déjà très en retard en matière de drones, nous ne devons pas manquer cette opportunité, au risque de devoir s'en remettre exclusivement aux Américains.
Il est vrai que du seul point de vue économique, il ne serait pas injustifié de s'adresser aux États-Unis, voire, demain, à la Chine. C'est ce que j'avais dit à un Britannique qui se targuait d'acheter « sur étagère » en choisissant le modèle le moins cher : dans ces conditions, autant acheter Chinois ! « Ce n'est pas possible, m'a-t-il répondu : la Chine est notre ennemi. » Cela prouve que les critères économiques ne sont pas les seuls en jeu lors de l'achat d'une arme. Il convient de savoir qui la fabrique et qui la tient. Une Europe qui se veut puissance militaire doit donc s'organiser afin de produire ses propres armements. Et les Américains, si soucieux de se désengager de leur flanc est, devraient nous y encourager plutôt que de chercher à nous concurrencer. Quoi qu'il en soit, les industriels sont prêts à s'organiser et à faire des propositions.
S'agissant du nEUROn, nous avons validé un concept technologique, mais aussi un mode de coopération, ce qui n'est pas rien. Le but est en effet de parvenir à coopérer efficacement pour multiplier les financements sans que le surcoût, par rapport à un programme développé par un seul industriel, ne soit supérieur à un certain coefficient. Rappelons que dans le cas de l'Eurofighter, chaque État a fini par payer plus cher son avion de combat que s'il l'avait développé tout seul. L'efficacité, en ce domaine, passe par le respect d'un certain nombre de règles, telles que le choix d'un sous-traitant pour ses compétences et non pour des raisons politiques, par exemple.
La suite, selon nous, réside dans la coopération franco-britannique. En effet, seuls deux pays ont la capacité de développer un tel programme et ont la volonté d'y consacrer un certain budget. L'Allemagne n'en a pas fortement les compétences, et manque de toute façon d'allant. Il convient donc de démarrer avec ces deux pays, quitte à ce que d'autres les rejoignent plus tard.
En ce qui concerne la supply chain pour la livraison de Rafale en Inde, je prendrai votre question dans l'autre sens. De nombreux sous-traitants me disent : « si nous emportons le marché en Inde, ne pourriez-vous pas faire tout fabriquer là-bas, de façon à nous débarrasser de la production de Rafale ? ». C'est vous dire à quel point la sous-traitance est démotivée. En effet, alors qu'à l'origine on lui a parlé de 320 avions, elle voit, tous les quatre ou cinq ans, les décisions systématiquement remises en question. De son côté, Airbus produit entre 50 et 100 avions par mois ! C'est un problème d'intérêt national : voulons-nous garder notre capacité à produire le Rafale ? J'y suis prêt, mais je ne suis pas tout seul : il faut également proposer des perspectives de long terme à la sous-traitance.
Quoi qu'il en soit, les contrats français m'imposent de fabriquer en France les Rafale, pour des raisons liées à la sécurité nationale. Si, demain, j'ai l'autorisation de la DGA de fabriquer tout en Inde, y compris les appareils destinés à l'armée française, je le ferai : je n'ai pas d'états d'âme. Mais tous les sous-traitants n'en feront pas autant.
Nous avons donc besoin d'une plus grande visibilité, car elle est aujourd'hui trop limitée. J'espère en tout cas que nous obtiendrons des résultats à l'export : cela remontra le moral de tout le monde.

Vous avez déjà répondu à la question que je souhaitais poser à propos de l'Inde. Je me contenterai donc de souligner que les exportations françaises d'armement, avec un total de 4,9 milliards d'euros, représentent un élément important de notre balance commerciale. Dans un contexte difficile, l'industrie de défense est une des rares à pouvoir se targuer d'obtenir de tels chiffres.
Merci de m'avoir écouté, et longue vie au Rafale !
La séance est levée à dix-neuf heures trente.