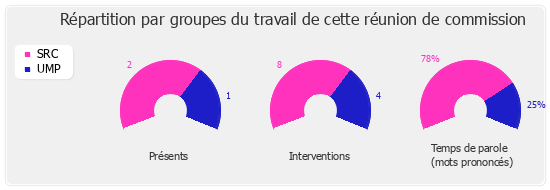Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
Réunion du 25 avril 2013 à 9h00
La réunion

En l'absence du président Alain Claeys, il me revient de présider cette séance, tout en assumant la fonction de rapporteur qui m'a été confiée – aux côtés de mes collègues François Cornut-Gentille, membre comme moi de la commission des finances, et Jean-Jacques Bridey, membre de la commission de la défense nationale et des forces armées – pour cette mission consacrée à la conduite des programmes d'armement en coopération. Nous sommes accompagnés par deux magistrats de la Cour des comptes, M. Stéphane Jourdan, ici présent, et M. Bruno Rémond, qui est absent ce matin.
Nous entendons aujourd'hui les dirigeants du groupe EADS, pour évoquer plus particulièrement les programmes A400M et NH90. Nous accueillons donc M. Marwan Lahoud, directeur général délégué d'EADS, président d'EADS France, qui est accompagné de M. Philippe Coq, directeur adjoint des affaires publiques d'EADS France, et du général Philippe Tilly, conseiller défense du président d'EADS, M. Dominique Maudet, directeur général exécutif d'Eurocopter, accompagné du général Georges Ladevèze, conseiller du président d'Eurocopter, M. Cédric Gautier, directeur du programme A400M, président d'Airbus Military France, et Mme Annick Perrimond du Breuil, directrice des relations avec le Parlement.
La coopération en matière d'armement suit la construction de l'Europe de la défense ou en est l'un des moteurs – si tant est que cette ambition soit portée par les États membres. Or, depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, la dynamique qui s'était créée autour de la coopération a connu un certain ralentissement, des réticences, voire des retours en arrière. Une entreprise comme EADS, conçue dans toutes ses composantes, y compris civiles, autour de programmes en coopération, ne peut que le déplorer.
Il s'agit là d'une question politique. Chaque fois que notre pays a été confronté à une urgence opérationnelle ou à une menace – que ce soit, pendant la guerre froide, sur le territoire national ou, par la suite, sur un théâtre d'opérations extérieures –, il s'est tourné vers ses alliés européens. Pour l'intervention au Mali elle-même, opération pourtant purement française à l'origine, il a très vite été conduit à les solliciter. On constate donc un décalage entre la coopération opérationnelle, l'intégration de l'industrie à l'autre bout de la chaîne de la coopération, et, entre les deux, la disparition de toute volonté de coopérer. Lorsque j'ai commencé ma carrière à la Direction générale de l'armement (DGA), il y a plus de vingt ans, la coopération était pourtant inscrite dans les manuels scolaires de tous les jeunes et futurs ingénieurs de l'armement ou responsables de programme. Ce n'est plus le cas.
Il faut envisager la dimension économique de la coopération. Les programmes en coopération, dit-on, sont coûteux, mais il convient de distinguer la complexité d'exécution – ou les erreurs d'exécution, dont nous sommes prêts à parler dans la plus grande transparence – de ce que j'appellerais le surcoût structurel.
En ce qui concerne les erreurs d'exécution, EADS a acquis une certaine expertise qui lui permet de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je me permettrai donc deux recommandations.
Un programme en coopération, tel l'A400M, marche beaucoup mieux lorsqu'une agence exécutive contractante est dotée de tous les pouvoirs. Dans le cas du programme Meteor de MBDA, les six pays participants ont délégué l'exécution à l'un d'entre eux : l'agence contractante est l'Agence britannique d'achat de défense (British defense procurement agency). La joint-venture représente un cas de figure particulièrement mauvais, avec la création d'un nouveau bureau de programme qui a toutes les apparences de l'agence exécutive, mais n'est qu'une agence « Canada Dry », puisqu'il faut demander l'autorisation de chacun des mandants pour traiter la moindre question.
Ce qui vaut pour les agences contractantes ou pour les agences exécutives vaut pour les maîtres d'oeuvre. Mieux vaut avoir un maître d'oeuvre industriel établi plutôt qu'une joint-venture, un organisme ad hoc que l'on fabrique – car ce sont alors trois personnes, et non plus deux, qu'il faut mettre d'accord. La complexité s'en trouve accrue.
Quant aux surcoûts structurels, ils sont notamment liés au fait que faire à plusieurs signifie souvent faire un peu plus que lorsque l'on est seul. Dans mon manuel de jeune ingénieur de l'armement, j'ai aussi appris que la somme des coûts individuels restait malgré tout inférieure au coût pour une nation qui ferait cavalier seul. Lorsque ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une erreur d'exécution.

Je vous remercie du caractère direct et franc – voire sévère – de votre propos. « La coopération en matière d'armement suit la construction de l'Europe de la défense ou en est l'un des moteurs – si tant est que cette ambition soit portée par les États membres », avez-vous dit, avant d'estimer que cette dynamique était aujourd'hui ralentie. Ce constat renvoie à la responsabilité du portage. Ce portage est-il politique ou militaire ? En somme, qui commande – et qui paye ?
S'agissant du montage des opérations, les programmes bilatéraux fonctionnent-ils mieux ? C'est en tout cas une thèse que nous avons entendue.
Quant à la question des coûts, qui renvoie à celle de la décision et du portage politique, permet-elle d'envisager un avenir pour ce type d'opérations ?
Les programmes bilatéraux ou multilatéraux avec un petit nombre d'acteurs fonctionnent de manière plus efficace. Lorsque je parle de la construction européenne, je ne m'inscris dans aucun processus multilatéral institutionnel. Mon commentaire est beaucoup plus sévère, puisque même la coopération bilatérale n'a plus la cote. Cela tient à la résurgence des nationalismes que l'on observe un peu partout en Europe. Le personnel politique n'est pas suffisamment convaincu de la nécessité de la coopération pour en être un moteur. Certes, il y a des exceptions, mais, en règle générale, la volonté ardente de faire quelque chose ensemble ne s'exprime plus. Lorsque j'étais jeune ingénieur de l'armement, on nous apprenait que la première question à se poser après avoir défini ce que l'on voulait faire était de savoir avec qui – ou plus exactement avec quel Européen – coopérer. Ce n'était pas seulement une exigence dans la formation des ingénieurs de l'armement, mais une volonté politique.
Il existe une autre explication à la résurgence des nationalismes. L'expérience a montré qu'il n'est pas souhaitable de créer de nouveaux bureaux de programme, entités qui entrent en contradiction avec leur maison-mère, et que, plutôt que des joint-ventures, il vaut mieux procéder à des fusions, c'est-à-dire à des abandons de souveraineté ou d'autorité. Cela suscite un certain repli sur soi, cette fois au niveau des agences exécutives : la DGA n'a bien sûr aucune envie de céder ses prérogatives à un organisme international. C'est un réflexe qui est de l'ordre de l'inconscient. Il peut être surmonté, mais n'en contribue pas moins à remettre la coopération en question.
J'en viens à la question budgétaire. Pour avoir eu la chance de diriger quelques programmes en coopération qui ont très bien marché lorsque j'étais à la tête de MBDA, je suis convaincu que nous n'aurions pas de missiles de croisière, ni d'Aster, si nous n'avions pas coopéré. Ces programmes ont eu leur lot de difficultés. Un programme est un paquet de mauvaises nouvelles, et le bon directeur de programme est celui qui se révèle capable de retourner une situation et de trouver les bonnes nouvelles qui viendront compenser les mauvaises. Notre ambition est de développer un métier qui consiste à gérer les programmes, donc à transformer les mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles.

Vous dites qu'il n'y a plus d'incitation politique à la coopération. Comment cette incitation s'exprimait-elle dans la période précédente ? Le ministre de la défense était-il plus présent, exerçait-il une pression plus forte sur la DGA ? Ou bien celle-ci agissait-elle spontanément en ce sens ? Et comment concevoir cette pression politique ? Nous en avons un exemple avec la coopération franco-britannique, qui ne semble pas vraiment produire tous les résultats espérés.
Je ne parle pas de grandes envolées lyriques, mais de choses très terre à terre. En 1995 a été lancé un programme de drones tactiques. Deux options étaient envisageables, une option nationale et une option en coopération. Leurs qualités étaient équivalentes, mais il n'y a pas eu l'ombre d'un doute : c'est la seconde qui a été retenue. Il en allait de même pour de tout petits volumes. S'il existait une possibilité de conduire une étude en coopération plutôt qu'à l'échelle nationale, elle était systématiquement privilégiée. La coopération était donc le sésame qui permettait de déclencher le lancement d'un programme. Dans ces conditions, il n'était nul besoin d'incitations. Philippe Coq, qui a vécu ce basculement d'une période à l'autre, peut en témoigner.
La consigne était en effet de faire en coopération, sauf dans les domaines relevant pleinement de la souveraineté, tels que la dissuasion ou le renseignement. Nous avons constaté un retournement qui s'est exacerbé dans les six ou sept dernières années. Il y a pourtant de moins en moins d'argent ; les programmes importants ne peuvent plus être menés seuls. Nous sommes donc contraints de partager, à moins de préférer des achats « sur étagère » aux États-Unis ou en Israël – donc de renoncer à toute production de valeur ajoutée sur le territoire national.
Le Livre blanc sur la défense de 1994 a été le premier à théoriser la coopération, en distinguant trois cercles : les équipements de souveraineté, qui doivent être faits en national, un certain nombre de produits qui peuvent être achetés « sur étagère », et le reste, qui doit être fait en coopération.
En effet, puisque le volume d'activités conduites en coopération n'a cessé de diminuer depuis cette date.

Le manque de volonté politique que vous déplorez affecte-t-il notre pays ? Iriez-vous jusqu'à dire qu'il y a vingt ou vingt-cinq ans, votre groupe n'aurait pas été encouragé ?
Notre groupe n'existerait pas s'il n'y avait eu une très forte volonté de coopération entre 1970 et 2000. Pour prendre une image sans doute maladroite, la création d'un groupe comme le nôtre s'apparente à un mariage après un long concubinage. Il faut avoir travaillé ensemble sur des projets, et en avoir en commun, pour créer une coentreprise de l'importance de la nôtre. Eurocopter a ainsi été créé sur la base de deux grands projets, le Tigre et le NH90, sur lesquels les deux entreprises – la division hélicoptères d'Aerospatiale et Messerschmitt-Bölkow-Blohm – MBB – travaillaient depuis longtemps, puisque les premiers travaux relatifs au Tigre remontaient à 1977. Le NH90, lancé en 1992, est le projet commun autour duquel on mobilise Eurocopter. Airbus a démarré en 1970 ; pendant trente ans, il a donné lieu à un travail en commun entre British Aerospace (BAE), DASA, Aerospatiale et Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima (CASA), avant que toutes ces entités ne se fondent dans une même entreprise. Sans volonté de coopération, EADS ne serait pas. De même, MBDA s'est construit autour du Système de croisière conventionnel autonome à longue portée (SCALP).
Bien qu'il soit plus fort dans d'autres pays européens, le repli sur soi est visible en France. Ce qui a fait la dynamique de coopération durant trente ans, c'est une forte volonté française et l'écoute qu'elle a rencontrée chez certains de nos partenaires. La France a joué un rôle moteur dans la coopération franco-allemande en matière de défense et d'armement, comme dans la coopération franco-britannique récente. Nous sommes certes plus enclins que d'autres à coopérer, mais nous sommes désormais en dessous du seuil critique qui est nécessaire pour entraîner les autres.

La théorie des trois cercles était-elle une bonne idée qui n'a pas été exploitée ? Ce type de stratégie est-il encore d'actualité ?
L'évolution du capital d'EADS, telle qu'elle se dessine aujourd'hui, permettra-t-elle d'aller plus loin ? Le retrait des États est-il une opportunité, ou présente-t-il des risques ?
La théorie des trois cercles mériterait de rester d'actualité. Encore faudrait-il la mettre en application, avec une nuance : il y a beaucoup moins de programmes aujourd'hui qu'il n'y en avait en 1994. Cela n'enlève bien sûr rien à sa pertinence.
J'en viens à la baisse de la part des États dans le capital de notre entreprise. Le Livre blanc de 1994 avait défendu une autre théorie, celle de la séparation des rôles de l'État. Dans une industrie comme la nôtre, l'État joue plusieurs rôles : il est à la fois régulateur, client et parfois actionnaire. En pratique, aucun de ces trois rôles ne dépend de l'autre. Les évolutions récentes chez EADS montrent que les États exercent leur influence sur un groupe comme le nôtre par d'autres moyens que l'actionnariat. Il ne me semble donc pas que nous assistions à une disparition programmée des États. Dire les choses sans se cacher derrière des artifices est au contraire de nature à renforcer leur rôle au sein de l'industrie. Même si l'Agence des participations de l'État (APE) ne détenait aucune part du capital, les États auraient un pouvoir sur l'industrie de défense du seul fait de sa nature. C'est bien plus efficace que de dériver son influence via un pacte d'actionnaires où ils se cacheraient derrière des actionnaires privés. Aucune entreprise privée ne peut en effet se prévaloir d'incarner le pouvoir régalien.

Vous dites que, pour certains pays, il est plus facile d'acheter « sur étagère » que de s'engager dans une coopération. L'industrie française d'armement n'est-elle pas davantage tournée vers la coopération que vers la production de produits pouvant se vendre « sur étagère » ? Si tel est le cas, comment parvenir à un changement ?
Permettez-moi de donner quelques chiffres qui dissiperont cette impression. Si l'on tient compte des programmes réalisés en coopération européenne, l'industrie de défense française fait 42 % à 43 % de son chiffre d'affaires en France. Le reste – soit plus de 55 % – correspond donc à l'export, c'est-à-dire à l'achat « sur étagère » de nos produits par d'autres États. Les caractéristiques de cette industrie font néanmoins qu'un client étranger n'achète un produit français « sur étagère » que s'il est en service dans l'armée française – ou conçu pour pouvoir l'être. Il ne peut donc y avoir de substitution exclusive. Autrement dit, si l'on peut concevoir une complémentarité, l'export venant combler le manque à gagner sur le marché domestique, on ne peut remplacer le produit domestique par un autre destiné à l'export. Ce n'est pas seulement une vue de l'esprit : nous l'avons expérimenté, notamment avec Dominique Maudet chez MBDA. Nous avions développé un produit pour l'exportation, le Merlin, qui ne s'est jamais vendu, alors même qu'il était rustique, peu onéreux et disponible « sur étagère ». La première question que posent nos interlocuteurs est en effet de savoir si le produit est en service dans nos armées. Si la réponse est négative, il n'a aucune chance de les intéresser.
Sans coopération, EADS n'existerait peut-être pas ; Eurocopter, certainement pas. Mais que nous a apporté la coopération pour ces deux grands programmes que sont le Tigre et le NH90 ? Il y a vingt ans, les Américains détenaient une position dominante dans le domaine des hélicoptères : Boeing, Sikorsky et Bell écrasaient le marché – notamment à l'exportation. Depuis une dizaine d'années, Eurocopter est devenu le numéro un mondial. Les quatre « grands » du secteur sont désormais Eurocopter, avec 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, Sikorsky, avec 5 milliards, AgustaWestland et Bell – Boeing est un peu marginalisé. Cette position nous procure des devises, puisque 75 % de notre chiffre d'affaires est réalisé à l'exportation. La moitié de notre production est assurée en France, non seulement par Eurocopter, mais par toute la filière aéronautique, qu'il s'agisse des moteurs, de l'avionique, des équipements électroniques. Cela représente aussi des emplois.
Il y a une cohérence dans tout cela. Notre pays jouit d'une certaine position internationale. Nos armées sont visibles : elles se déploient et ont un rôle dans le positionnement des grandes problématiques géopolitiques – avec le matériel, l'industrie et les exportations qui vont avec. Bref, il s'agit d'un dispositif global. Peut-être sommes-nous les seuls dans ce cas en Europe – ce qui constitue une difficulté supplémentaire pour la coopération européenne.
J'en viens maintenant au NH90. Deux exigences s'imposent pour le bon déroulement de ce type de programme : il faut d'une part une harmonisation des exigences des États en amont du programme, et d'autre part la création d'une véritable structure décisionnelle. S'agissant du NH90, nous avons une structure compliquée, notamment en raison de la présence d'un de nos concurrents – AgustaWestland – dans le consortium industriel. Il y a vingt ans, le Tigre a fait Eurocopter. Il s'agit à l'origine d'un projet franco-allemand, qui a été rejoint par les Espagnols, puis par les Australiens. Le NH90 associe encore davantage de pays, puisque sont venus s'ajouter aux précédents l'Italie et les Pays-Bas. Sans doute espérions-nous à l'époque fabriquer un Airbus des hélicoptères, avec les Britanniques et les Italiens ; cela ne s'est pas fait. De fait, nous sommes aujourd'hui en coopération sur un programme avec l'un de nos principaux concurrents sur le territoire européen, ce qui constitue une difficulté notable.
On évoque souvent les retards du programme NH90. Je ne reviendrai pas sur la théorie des coûts, qu'a évoquée M. Lahoud. Ce programme a deux composantes, navale et terrestre. La seconde est à l'heure. Bien que la commande française ait été passée très tard, en 2007, elle a été livrée en 2011. Quant à la composante navale, elle correspond à un appareil beaucoup plus compliqué, pour lequel nous dépendons bien plus de notre partenaire AgustaWestland qui assure la maîtrise d'oeuvre de cette version, tandis que nous assurons celle de la composante terrestre. Les hélicoptères sont néanmoins opérationnels à ce jour pour les missions de sauvetage en mer et de contre-piraterie maritime.
En termes d'exportations, nous en sommes à 529 hélicoptères vendus – pour soixante et un commandés par la France. C'est bien le fait d'avoir développé un hélicoptère « sur étagère » dans un contexte européen, c'est-à-dire en regroupant les besoins de plusieurs pays, qui nous assure une certaine force à l'international. Ce succès a permis à Eurocopter d'atteindre une certaine taille et de passer à une dimension supérieure du point de vue technique et technologique, par exemple en termes de composite ou de commandes de vol électriques – nous sommes les premiers au monde à les avoir implantés sur un hélicoptère de cette gamme. Au-delà de l'aspect chiffre d'affaires, volume d'activité et emplois, nous avons franchi une marche technologique qui nous permet de mieux aborder le domaine commercial.
M. Lahoud a insisté sur la nécessité d'avoir des agences opérationnelles et décisionnelles, qui s'applique parfaitement à nos programmes – en particulier au NH90, qui est bien plus compliqué à cet égard que le Tigre, géré par l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAr).
À l'origine, nous n'avions pas de standards, ce qui est une erreur. Des programmes aussi compliqués que le Rafale, l'A400M ou le NH90 imposent en effet de passer par un mode de montée en puissance, c'est-à-dire de commencer par des versions simples avant de « monter en grade » vers des versions plus compliquées, intégrant notamment des systèmes d'armes. Tous les grands programmes – en particulier en coopération – devraient prévoir cette montée en puissance échelonnée d'un point de vue contractuel – ceci afin d'éviter les renégociations de contrats.
Le NH90 est un projet de grande ampleur – 16 milliards d'euros, sachant que le chiffre d'affaires d'Eurocopter s'élevait auparavant à 3 ou 4 milliards. L'enjeu est donc de taille, y compris en termes de risque.
Pour les États, les retards sont bien sûr problématiques du point de vue de la disponibilité et de la capacité. Ce n'est pas le cas du point de vue du coût, puisque les contrats Tigre et NH90 sont des contrats à prix fixe, dans lesquels les dérives de calendrier et de coût sont supportées par l'industriel. Cela explique d'ailleurs qu'ils ne soient pas aussi rentables que d'autres pour Eurocopter. Pour l'État client, le surcoût est tout à fait acceptable.
S'agissant du report de l'affermissement de la commande française de trente-quatre NH90 transport tactique (TTH) supplémentaires – ou deuxième tranche de la version terrestre – au-delà de la date limite prévue par le contrat en vigueur, il nous appartient de faire preuve de compréhension à l'égard de notre principal client et de ses contraintes budgétaires. Nous avons donc repoussé de deux mois la date limite de passation de la commande. J'en profite pour rappeler qu'un dédit contractuel d'environ 35 millions d'euros est prévu au cas où celle-ci ne serait pas passée.
L'aspect de partage industriel est bien sûr fondamental. Le partage de ce qui est fait en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie est fondé sur les quantités pour lesquelles les États se sont engagés. Le pays qui ne respecterait pas ses engagements s'exposerait à une demande de transfert d'activité industrielle vers les autres. Cela signifierait pour nous un transfert d'activité de Marignane vers l'Italie et les Pays-Bas. Le prix des appareils est également lié à la quantité qu'il a été convenu d'acheter. Au cas où la commande d'un certain nombre d'hélicoptères – bien supérieur aux trente-quatre dont nous avons parlé – ne serait pas passée d'ici à 2020, les prix pourraient être revus à la hausse.
L'Allemagne a récemment revu ses quantités, mais elle l'a fait à budget constant, en réduisant la quantité des appareils terrestres au profit d'appareils navals qu'elle n'avait pas achetés. Elle a en quelque sorte économisé le coût d'un programme naval – qu'elle avait identifié – pour le financer sur le programme terrestre. Mais, comme le programme naval n'existait pas, il ne figurait pas dans les commandes prévues. Nous avons donc procédé à une redéfinition du périmètre des hélicoptères, à budget constant, sans impact sur l'aspect industriel. Cette renégociation a été fort bien menée par notre partenaire.
À ce jour, 141 des 529 hélicoptères vendus ont été livrés. Quasiment tous les pays volent avec le NH90. Quelques contrats – notamment avec la Nouvelle-Zélande et Oman – arrivent à échéance dès l'année prochaine. C'est d'ailleurs problématique pour le site de Marignane, qui n'aura plus d'activité – en dehors de deux hélicoptères navals – à partir de 2016. Sans la commande française des trente-quatre NH90 TTH, la chaîne de production devrait donc s'arrêter.

Les prix dépendent aussi de la complexité des programmes. En dehors de l'exemple – ou du contre-exemple – de l'Allemagne que vous venez de citer, vous souhaitez éviter les renégociations de contrats. Les spécifications techniques demandées par les États sont-elles nombreuses ? Qui en prend l'initiative ? Sont-elles justifiées en termes de rapport coût-efficacité, l'efficacité dépendant de la capacité opérationnelle des appareils livrés, ou relèvent-elles du simple caprice ?
Je dirais qu'il y a un peu de tout. Le NH90 est un mauvais exemple, puisqu'il en existe plus de vingt versions. Cela étant, nous sommes tous un peu responsables. Cela a commencé très en amont : les états-majors auraient dû s'accorder sur un certain nombre de configurations. Il n'y tout de même pas trente-six façons de transporter dix-neuf commandos dans un hélicoptère ! Vous savez d'autre part que les Tigre français et allemands ne sont pas identiques.
Pour reparler du partage industriel, on pourrait penser que chacun doit réaliser ce qu'il sait le mieux faire. Or il est rare que cela se passe ainsi : en général, on profite plutôt d'un programme en coopération pour se lancer dans un domaine que l'on ne connaissait pas et rattraper ses concurrents. C'est une erreur fondamentale, contre laquelle il faut lutter.
J'en viens au « juste retour ». Si les Pays-Bas achètent des hélicoptères sans avoir une industrie, il faut quand même qu'il y ait un retour. Selon moi, il faut globaliser les retours sur plusieurs programmes, et sans doute, à terme, instaurer une spécialisation. Si j'ai dit que nous étions tous responsables, c'est aussi parce que chacun fait du lobbying pour être présent sur les hélicoptères, et que les industriels vont aussi faire tout ce qu'ils peuvent dans leur pays pour avoir leur place. C'est un sujet à traiter si l'on veut réduire les coûts et les risques.
C'est pour régler ce genre de problèmes que j'ai insisté sur la nécessité d'avoir un maître d'oeuvre industriel. Le cas que vient d'évoquer Dominique Maudet – à savoir celui des pays qui font ce qu'ils ne savent pas faire – se produit lorsqu'il y a plusieurs industriels autour de la table, mais pas de chef d'orchestre pour répartir le travail.

En l'absence de chef d'orchestre, n'est-ce pas à la DGA de modérer les ardeurs des états-majors sur les spécifications et de rendre des arbitrages ? Elle est, semble-t-il, la seule en mesure de le faire, et son expertise pourrait ici être utilement sollicitée.
C'est à l'agence exécutive de programme qu'il revient de jouer ce rôle de filtre. Mais c'est aussi une question de processus et de méthode. L'instruction ministérielle sur les programmes est inspirée de ce qui s'est fait pour le développement de la force de frappe. La méthode est le fameux « V du développement » : l'objectif d'état-major est transformé en fiche de caractéristiques militaires, elle-même traduite en spécifications techniques adressées à l'industrie, qui remontent ensuite sous forme d'une offre technique. Entre l'utilisateur et l'officier d'état-major qui transforme l'objectif en fiche de caractéristiques militaires, il y a déjà un premier décalage. Celui-ci ne fera que s'accentuer : à chaque étape, chacun ajoute sa marge. Il faut rechercher un changement d'attitude et de méthode pour tâcher d'avoir des boucles courtes entre l'utilisateur et l'industriel. Cela ne signifie pas qu'il est inutile de réunir tous les acteurs autour de la table, mais que la méthode doit davantage relever du travail de plateau que de la chaîne. Tant que l'on sera dans une chaîne, chacun ira de sa précaution supplémentaire, et le produit qui sortira répondra certes à l'objectif d'état-major, mais d'une manière compliquée.
La naissance de l'A400M a été difficile, mais le premier avion de série français est enfin prêt. Il a déjà volé et subi avec succès tous les essais industriels. Les équipages français ont été formés et sont qualifiés. Nous sommes donc en train de négocier avec l'OCCAr et la DGA le démarrage du processus de livraison dans les prochains jours, afin que l'A400M puisse être présent sous les couleurs françaises au Salon du Bourget.
De par ses caractéristiques, l'A400M marque une rupture par rapport aux autres avions de ce type. En effet, il est à la fois stratégique et tactique : stratégique, car il est doté de capacités de projection, d'altitude, et d'une vitesse qui lui permettent de projeter des moyens, de la charge utile et des forces loin et vite ; tactique, car il permet d'intervenir sur un théâtre d'opérations en milieu hostile. C'est un avion polyvalent, unique en son genre, ce qui fera sa force à l'export, mais aussi sa complexité. Enfin, il peut ravitailler et être ravitaillé en vol.
Les pays qui, depuis son lancement, participent au programme avec la France sont l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Belgique, le Luxembourg et la Turquie. Nous avons déjà un premier client à l'export, la Malaisie, qui a commandé quatre avions.
Sur le plan de la coopération industrielle, il s'agit bien d'un Airbus, et la fabrication des systèmes et structures est distribuée comme pour un avion civil : la voilure est réalisée au Royaume-Uni, le fuselage en Allemagne, la pointe avant, le système électrique et les commandes de vol en France. La base industrielle est donc connue et maîtrisée.
L'histoire du programme – avec notamment les difficultés de 2009 et 2010 – est connue. On distingue deux grandes étapes contractuelles : le contrat signé en 2003, et son amendement dit 38, signé en 2011, qui a redessiné les échéances et la structure du programme afin de le rendre faisable.
L'A400M est aussi un programme de rupture technologique très ambitieux, qui a été sous-estimé par l'industriel. Il est le fruit d'une coopération internationale étendue. L'avion est certifié civil et militaire – là encore, c'est une première, qui a ses avantages et ses contraintes. Il innove en matière de technologie, avec la première voilure tout carbone, le moteur le plus puissant jamais construit dans le monde occidental et des systèmes de gestion de vol – flight management systems (FMS) – ou de gestion moteur – full authority digital engine control (FADEC) – d'une complexité très supérieure à ceux de l'A380 ou du Rafale.
Par rapport à Eurocopter, nous avons l'avantage d'avoir une organisation structurée, du côté des clients, par l'OCCAr – qui agit véritablement au nom des nations – et, du côté des industriels, par un maître d'oeuvre – la société AMSL (Airbus Military Sociedad Limitada), contrôlée à 90 % par EADS. Nous mesurons tous les jours les avantages d'avoir une agence commune. Il faut toutefois qu'elle soit dotée d'un réel pouvoir et qu'elle ne soit pas, pour reprendre l'expression de M. Lahoud, une agence « Canada Dry » – auquel cas elle ne fait que ralentir les processus. Un accord trouvé avec l'agence peut être désavoué le lendemain par l'une des sept nations, ce qui nous contraint alors à reprendre tout le processus de décision. J'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises dans les derniers mois. Tant que nous ne serons pas arrivés à une certaine maturité dans l'organisation, nous ne parviendrons pas à l'efficacité attendue dans l'exécution des programmes.
Un autre avantage du programme A400M par rapport au NH90 est que nous avons une seule et unique certification et qualification, quel que soit le pays. Il y a donc un seul standard, sur lequel peuvent bien sûr se greffer des options. Le principe est semblable à ce qui se fait dans l'industrie automobile : une version de base, à laquelle on peut ajouter telle ou telle option. C'est un point fort du programme A400M.
Autre facteur d'efficacité, il y a une seule chaîne d'assemblage ; il n'y a pas de duplication au niveau des structures.
C'est le fait d'avoir un maître d'oeuvre qui permet d'obtenir ce résultat.
Un programme en coopération présente un avantage certain au niveau du partage des coûts non récurrents (NRC). Le coût global de développement sera certes structurellement supérieur à celui d'un programme national, mais le coût pour un pays restera toujours plus faible que s'il devait l'assumer seul. C'est le cas pour l'A400M, dont la France finance 28 % du développement.
Le deuxième avantage est que le coût unitaire d'un avion commandé à 170 exemplaires sera nécessairement très inférieur à celui d'un avion commandé à cinquante exemplaires par une seule nation.
Parmi les inconvénients, il faut noter la complexité structurelle liée au fait que l'on travaille à plusieurs. Pour pallier cet inconvénient, il faut éviter que, dans les fiches de spécifications, le produit ne devienne l'enveloppe de toutes les demandes nationales. À un moment donné, chacun des clients doit accepter que toutes ses contraintes nationales ne soient pas couvertes, sans quoi le cahier des charges est irréalisable. Cela a été le cas pour l'A400M ; c'est la raison pour laquelle quelques options maximalistes ont été retirées lors de la renégociation du contrat en 2011.
Je ne reviens pas sur les règles du retour géographique. C'est toujours une contrainte, même si, dans notre cas, le fait d'avoir un seul maître d'oeuvre industriel permet d'assurer une régulation. On ne peut cependant faire abstraction du fait qu'une nation qui commande un certain nombre d'avions doit, d'une manière ou d'une autre, voir un retour. Ce sont les contraintes intrinsèques des programmes en coopération, mais j'ai la faiblesse de croire que leurs avantages l'emportent sur les inconvénients.
En ce qui concerne les coûts, le programme a été revu en 2011, pour un montant total d'un peu plus d'une vingtaine de milliards d'euros. Il n'y a pas de montants par tranche, mais un prix de l'avion de base et un prix des options, avec une formule de révision de prix – qui devra tôt ou tard être revue, car elle est complètement déconnectée de la réalité des évolutions de prix dans le secteur de l'aéronautique.
Le prix est bien sûr lié à la fois aux quantités commandées et aux cadences. Comme pour le NH90, le contrat prévoit que, si une nation réduit ses commandes, un dédit est dû, puisque l'économie du programme s'en trouve profondément modifiée.

Je me demandais si, lorsqu'elle doit assurer le suivi technique, financier et industriel du programme, l'OCCAr est vraiment facilitatrice, utile et indispensable. Mais M. Gautier et M. Lahoud y ont amplement répondu.

Pouvez-vous développer votre réponse sur les coûts ? Où en est-on ? Comment s'amorcent les discussions ? Les perspectives à l'export sont-elles encourageantes ?
Le contrat qui a été renégocié en 2011 redéfinit clairement les objectifs du programme, avec un échelonnement progressif des standards militaires et une nouvelle planification, ainsi qu'une augmentation d'une dizaine de centiles de la contribution des nations. Les coûts pour l'industriel sont malheureusement très élevés : nous avons provisionné plus de 4 milliards d'euros de pertes sur ce programme. Nous avons la ferme volonté de l'exécuter sans dépasser cette enveloppe.

À quel niveau d'exportations faut-il parvenir pour stabiliser la situation et éviter le gouffre ?
Il faut découpler le contrat de lancement, sur lequel nous avons en effet passé des provisions, et notre objectif de remporter des contrats profitables à l'export. Nous avons une farouche volonté de développer ce programme à l'export. Nous n'en avons guère fait état jusqu'à présent, car nous devions concentrer nos efforts sur le développement – cinq avions d'essai volent quasiment jour et nuit dans le cadre du programme d'essais. Nous approchons d'importantes échéances et allons entrer dans une phase commerciale active. C'est pourquoi il est capital que l'A400M soit présent – sous les couleurs françaises – au Salon du Bourget. Comme l'a expliqué M. Lahoud, il ne pourra se vendre que s'il est en service dans nos armées.
La question de M. Cornut-Gentille est inspirée par une illusion que les industriels, la DGA et les agences exécutives ont entretenue pendant des années : le programme A400M aurait été comparable à un programme civil. Or il s'agit bien d'un programme militaire. M. Gautier a décrit le modèle d'affaires des programmes militaires : d'abord le lancement, puis le développement initial pour les marchés domestiques, enfin l'exportation pour réaliser un profit et sans laquelle le modèle ne serait pas tenable. Les problèmes rencontrés en 2009 et 2010 ont dissipé l'illusion : les marchés domestiques nous permettent de développer nos produits, mais c'est à l'export que nous réalisons des profits.
Vous avez évoqué les limites de l'OCCAr. En tant qu'industriels, estimez-vous qu'il est préférable de travailler avec l'OCCAr ou avec une DGA qui serait l'agence unique pour l'ensemble des partenaires ?
Par ailleurs, le fait d'être en coopération est-il un avantage pour développer l'exportation, ou cela a-t-il au contraire des inconvénients ?
Je ne parlerai pas de « limites de l'OCCAr », car il suffirait d'appliquer les statuts à la lettre pour que la situation s'améliore. Il y a en effet un écart entre les attributions de l'OCCAr et la liberté dont elle jouit dans la réalité. Mieux vaudrait la laisser exercer la plénitude de ses pouvoirs. Certes, on observe un certain abandon d'autorité des agences nationales, mais ce serait, je crois, un gage d'efficacité pour la conduite des programmes.
Nous pouvons trouver tous les modèles dans les programmes en coopération. J'ai évoqué tout à l'heure le programme Meteor, dont l'agence exécutive est la British Defense Procurement Agency. Si ses statuts étaient pleinement appliqués, l'OCCAr aurait un réel pouvoir. Quant à savoir s'il aurait été préférable d'avoir la DGA comme agence exécutive pour le programme A400M, c'est difficile à dire. Ce qui est certain, c'est qu'il y aurait eu une agence exécutive détenant tous les pouvoirs. C'est finalement cela qui importe.
Nombreux sont les exemples qui témoignent, pour Eurocopter, de l'intérêt de la coopération européenne, car le monde regarde davantage l'Europe que nous ne le faisons nous-mêmes. Je me rends la semaine prochaine en Australie : un hélicoptère qui a été choisi par la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie a toutes les chances de l'être par ce pays. S'ils sont conçus par les seuls Français, le Tigre et le NH90 ne peuvent l'emporter contre l'Apache ou le Black Hawk américains.
Un autre exemple illustre l'intérêt de la complémentarité franco-allemande. Il y a une dizaine d'années, Eurocopter a remporté un contrat de 350 hélicoptères aux États-Unis. Compte tenu de l'état des relations franco-américaines à l'époque, nous n'aurions jamais pu l'espérer si nous n'avions pas été aussi allemands. Nous avons d'ailleurs mis cette qualité en avant pour remporter le contrat.

Permettez-moi, pour finir, d'aborder une question qui ne touche pas directement au sujet, monsieur Lahoud. Ayant eu la chance de visiter la semaine dernière l'unité de Casablanca d'EADS Sogerma, je souhaitais vous interroger sur la stratégie d'EADS en termes de localisation et d'emplois. Les difficultés évoquées dans le cadre de la Mission d'évaluation et de contrôle sur la conduite des programmes d'armement en coopération pèsent-elles sur vos choix en la matière ?
Quatre-vingt-quinze pour cent de nos effectifs sont implantés dans nos quatre pays domestiques – la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni. Outre l'usine de Sogerma au Maroc, nous avons une chaîne d'assemblage en Chine ; nous en lançons actuellement une autre aux États-Unis. Jusqu'à présent, notre stratégie de localisation correspondait à une approche d'ouverture de marchés. Ce n'est pas le cas pour Sogerma au Maroc, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Le poids de notre présence en Europe, en particulier dans l'hypothèse d'un renforcement de l'euro, nous conduit néanmoins de plus en plus à nous interroger sur notre localisation. Notre activité est en forte croissance : nous n'allons donc pas supprimer des postes en Europe pour en créer ailleurs. Sur les cinq dernières années, nous avons d'ailleurs créé plus d'emplois en Europe qu'en dehors de l'Europe. Ce rapport est-il appelé à s'inverser ? C'est une question qui est désormais posée. Le principal critère pour y répondre sera le coût du travail et des facteurs de production en général en Europe et ailleurs. Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Nous avons eu l'occasion d'en parler avec les autorités françaises et allemandes. Contrairement à d'autres industries, nous n'avons pas une approche agressive de la question. Nous sommes très attachés à notre enracinement européen, qui fait notre force. Il reste que l'évolution du coût des facteurs de production ne joue pas en faveur de la France.
Notre ancien patron a fait des propositions en matière de compétitivité, mais les décisions prises ne vont pas assez loin pour être intéressantes pour EADS. Nous sommes une industrie de personnels qualifiés. Or le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) ne concerne guère plus de 2 % de nos salariés. Son impact sera donc limité à une vingtaine de millions d'euros pour 2013. Ce n'est certes pas négligeable, mais, à l'échelle du groupe, on ne peut qualifier cela de choc de compétitivité, d'autant que le changement de législation en matière de fiscalité des participations nous coûtera 24 à 25 millions d'euros. Je m'en suis ouvert à Louis Gallois, qui m'a expliqué qu'il aurait voulu aller plus loin et fixer le plafond des salaires concernés à 4, voire à 5 SMIC au lieu des 2,5 qui ont été retenus. Le coût des facteurs de production commence en tout cas à nous poser de sérieux problèmes.
J'ai dirigé Sogerma et j'ai été président d'EADS Maroc Aviation. Il faut se méfier du mot « délocalisation ». Nous ne sommes pas dans le secteur textile, où l'on délocalise massivement. Pour notre part, nous avons identifié pour chacun des work packages de Sogerma les activités à faible et à forte valeur ajoutée. Nous avons envoyé le bas de la chaîne de valeur à Maroc Aviation. C'est dans ce sens que j'ai développé cette entreprise. Cela nous a permis de gagner des appels d'offres supplémentaires, Sogerma étant fortement orientée vers l'export. Paradoxalement, et comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer en Poitou-Charentes, plus nous avons envoyé de charge à Maroc Aviation et plus nous en avons créé à Bordeaux et à Rochefort, car cela nous permettait d'être compétitifs sur l'ensemble du work package. La vision superficielle de la délocalisation véhiculée par les médias ne permet pas de rendre compte de ce phénomène, qui est une force dans le domaine de l'aéronautique.

Vous noterez que je n'ai pas parlé de « délocalisation », mais de « localisation ». Votre successeur à Casablanca nous a d'ailleurs bien expliqué comment fonctionnait le renvoi de charge en France. La question méritait néanmoins d'être posée à l'heure où l'on parle de retour de l'emploi en France. Quant au concept de « co-localisation », je le fais volontiers mien.
C'est un sujet stratégique pour la maison EADS. Nous savons bien gagner des marchés en transférant de la production. Mais cette question se pose désormais avec acuité. Nous avons créé plusieurs milliers d'emplois par an en France pendant les quelques années écoulées ; nous comptons continuer. J'espère néanmoins que le choc de compétitivité n'est qu'une première étape et que le Gouvernement ira un peu plus loin dans cette direction. Certes, cela représente un coût pour l'État, mais c'est bon pour l'industrie et pour l'emploi.