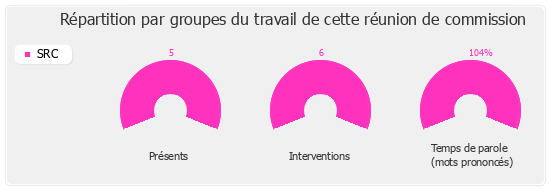Délégation de l'assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
Réunion du 8 mars 2016 à 16h00
La réunion
La séance est ouverte à 16 heures 35.
Présidence de Mme Catherine Coutelle, présidente.
La Délégation procède à l'audition de M. Michel Miné, professeur de droit du travail au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), membre du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP), ancien inspecteur du travail, et de Mme Rachel Silvera, économiste, maîtresse de conférence à l'université Paris Ouest - Nanterre - La Défense, sous-directrice du groupe de recherche « Marché du travail et genre » (MAGE) et membre du CSEP, sur l'égalité professionnelle et sur l'avant-projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs.

Avant de commencer nos travaux, je souhaite rendre hommage à notre collègue Sophie Dessus, membre de la délégation, brutalement décédée des suites d'une longue maladie dont nous avons été informés tardivement. Sophie était une femme souriante, pétulante et agréable ; au nom de notre délégation, j'exprime à ses proches toutes nos condoléances.
En ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, nous souhaitions entamer un cycle d'auditions portant sur l'avant-projet de la loi devant être soutenue par Myriam El Khomri, et qui ambitionne de « refonder le droit du travail et donner plus de poids à la négociation collective ». Nous aurions voulu, dans un premier temps, entendre les syndicats, car le texte devait être présenté demain au Conseil des ministres. Cette présentation ayant été reportée, nous ne disposons aujourd'hui que d'un avant-projet ; de ce fait, beaucoup de gens s'expriment à son sujet, alors qu'une incertitude plane sur le contenu réel du texte.
En ce jour, nous recevons donc M. Michel Miné, professeur de droit du travail au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), que la délégation a déjà entendu en d'autres occasions, et Mme Rachel Silvera, économiste, maîtresse de conférence à l'université Paris Ouest-Nanterre-la Défense, sous-directrice du groupe de recherche « Marché du travail et genre » (MAGE) ; tous deux sont d'éminents connaisseurs du droit du travail et de l'égalité professionnelle. Cela sera l'occasion de les interroger sur les perspectives du texte du Gouvernement, mais aussi de faire le point sur des mesures que nous avons adoptées, je pense notamment au minimum hebdomadaire de 24 heures – fruit de notre long combat sur les temps partiels –, à la redéfinition des métiers et qualifications ou encore à la médecine du travail. Ces dispositions sont réparties dans divers textes de loi ou accords, tels l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 sur la compétitivité et la sécurisation de l'emploi et la loi du 14 juin 2013, la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, ou la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, dite « loi Rebsamen ».
Le rapport de situation comparée (RSC) nous a beaucoup préoccupés. Je rappelle qu'il n'a pas disparu : moins visible aujourd'hui, il a été fondu dans la base de données économiques et sociales (BDES), également appelée base de données unique (BDU) et dont la mise en place était prévue par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. Les acteurs sociaux se sont-ils emparés de cet instrument ? Certains directeurs des ressources humaines (DRH) m'ont fait part de la relative complexité du dispositif.
Enfin, nous nous demandons si les accords pour l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (EP-QTV) produisent leurs effets, et comment les négociations se déroulent au sein des entreprises ?
Il est toujours agréable de pouvoir alimenter la réflexion des élus ; au regard des perspectives ouvertes par le projet de loi à venir, la date est fort bien choisie pour cette rencontre. Les questions que vous m'avez adressées sont de deux ordres : les premières portent sur l'effectivité des mesures législatives relatives à l'égalité professionnelle, les secondes sur les éléments du projet de loi réformant le code du travail qui concernent les droits des femmes – quand bien même le texte définitif ne sera connu que le 24 mars.
La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi prévoyait une durée de travail hebdomadaire minimale de 24 heures pour les temps partiels. La mesure comportait un certain nombre de dérogations individuelles ou résultant d'accords signés dans le cadre de conventions collectives. Un premier bilan des accords passés dans les branches professionnelles en matière de travail à temps partiel a été dressé : on ne peut qu'être alarmé par leur contenu. Dans la plupart des cas, en effet des dispositions dérogatoires sont adoptées, qui de fait conduiront à priver les femmes du bénéfice de cette durée minimale de 24 heures.
Nombre d'accords fixent une durée minimale de 16 heures, et certains d'entre eux vont bien au-delà des dérogations permises par la loi, si bien que, pour certains métiers, la durée minimale se trouve réduite à 2 heures hebdomadaires. Une étude plus approfondie serait nécessaire pour examiner chacune des conventions collectives et les professions concernées ainsi que la pertinence des dérogations ; en tout état de cause, de nombreuses situations ne sont pas satisfaisantes sur le plan du droit. Il est donc d'autant plus surprenant que certains de ces accords aient fait l'objet d'un arrêté d'extension pris par le ministre du travail sans qu'aucune réserve soit émise. Le ministre du travail a en effet la possibilité de prendre un arrêté dont l'effet est de rendre obligatoire un accord de branche pour toutes les entreprises du secteur professionnel concerné, même non adhérentes de l'organisation patronale signataire. Depuis 1982, les accords dérogatoires en matière de temps de travail se sont développés, et la procédure de l'arrêté d'extension permet au ministre de vérifier la légalité du contenu des accords collectifs : c'est là sa deuxième fonction.
En définitive, on constate que, pour la majorité des salariés à temps partiel, la durée minimale de 24 heures ne sera pas appliquée dans les secteurs d'activité concernés. La loi n'a donc pas atteint son objectif.
En outre, la loi a prévu d'autoriser des compléments d'heures par avenant. Ainsi, des accords de branche offrent à l'employeur la possibilité de proposer au salarié de signer un avenant le conduisant à effectuer des heures complémentaires dérogeant au droit commun qui régit les heures complémentaires. Il faut garder présent à l'esprit le fait que, depuis la loi du 14 juin 2013, les heures complémentaires sont majorées : de 10 % jusqu'à un certain niveau, de 25 % ensuite. Or, dans certains accords de branche, il est possible que ces heures complémentaires ne soient pas majorées. Cette pratique est contraire au droit européen car, la majorité des employés à temps partiel étant des femmes, elle n'est pas neutre en termes de genre : elle défavorise les femmes et pourrait être attaquée devant le juge du contrat pour discrimination indirecte. À ce titre, les accords collectifs concernés pourraient être attaqués devant le tribunal de grande instance.
Je ne prétends pas que les parties signataires de ces accords soient animés d'intentions malignes mais, du fait même de cette discrimination indirecte – que le droit européen est susceptible de qualifier comme telle – certains salariés ne sont pas remplis de leurs droits et, d'autre part, des entreprises se trouvent en situation d'insécurité juridique.
L'analyse juridique est la même pour le forfait jours, mais ce ne sont pas les mêmes populations qui sont concernées. Si les salariés à temps partiel connaissent mal leurs droits, ceux qui sont au forfait jours sont souvent des cadres disposant de ressources culturelles, voire économiques, les rendant à même de saisir le juge, ce dont témoigne le volume du contentieux relatif au forfait jours.
Je ne suis pas juriste, mais chercheuse en économie et en sociologie du travail. Devant le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP), la ministre chargée du travail a indiqué qu'il existait soixante accords de branche dérogatoires. La loi du 13 juin 2013 a beau prévoir des contreparties pour les salariés qui relèvent d'accords dérogatoires conduisant à des durées de travail très inférieures à 24 heures, ces contreparties semblent minimes. Je ne dispose pas d'études systématiques, mais il m'a été rapporté qu'un repos compensatoire a été attribué dans quelques cas. Bien souvent, la coupure maximale de deux heures dans la journée n'est pas observée dans le travail à temps partiel, et cette situation est entérinée par certains accords collectifs ! Au regard de la précarité dans laquelle se trouvent les femmes travaillant à temps partiel, le bilan de l'application de la durée minimale de 24 heures de travail est négatif.

Soixante branches sur sept cents ont donc conclu des accords dérogeant à la règle des 24 heures hebdomadaires ; les autres négocieront – ou non. Dans les métiers comme le magasinage, la manutention, le gardiennage de navires, garde maritime, certains de nos interlocuteurs ont évoqué une durée de dix-sept heures et demie ; sur quelles bases une telle durée peut-elle être fondée ?
Ce type d'accords est le résultat de compromis discutés entre les acteurs sociaux. En l'espèce, il s'agit de la moitié de 35 heures ; à cet égard, la lecture de la convention pour la branche de la propreté, qui emploie beaucoup de salariés à temps partiel et recourt massivement aux dérogations, est riche d'enseignements.
La loi du 17 août 2015 a intégré dans la BDES les informations auparavant contenues dans le rapport de situation comparée (RSC). Cependant, le décret d'application d'un article de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, qui devait notamment prévoir des indicateurs de santé et de sécurité au travail ainsi que de déroulement des carrières, n'a toujours pas été publié. La situation est pour le moins singulière, puisque des textes viennent modifier des disposions législatives pour lesquelles les décrets d'application sont encore attendus ! Dans ces conditions, il est impossible d'établir des bilans de l'application des dispositions concernées.
Il s'agit là d'une question technique, à laquelle on peut penser que le Gouvernement apportera prochainement une solution, mais les acteurs sociaux, organisations syndicales ou DRH, travaillent aujourd'hui à partir de textes incomplets. Cette situation est cause d'insécurité juridique pour l'ensemble des acteurs.
La loi du 17 août 2015 a remis en cause un nombre non négligeable de règles organisant le processus de négociation. C'est là un sujet d'actualité, qui concerne le futur projet de loi que vous allez examiner prochainement.
Un droit des accords collectifs a vu le jour en France, des dispositions déterminent ce sur quoi peuvent porter ces accords, ou comment deux accords peuvent s'articuler ensemble – accord d'entreprise et accord de branche, par exemple. En revanche, le droit n'a pas précisé le processus de négociation, alors que certains de nos voisins l'ont fait ; or, le contenu de l'accord qui sera signé in fine dépend évidemment des modalités de la négociation collective. Les rares dispositions existant dans ce domaine proviennent des lois dites « Auroux », ou plus précisément de la loi du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective et au règlement des conflits collectifs du travail, et concernent le lieu de négociation, le nombre de réunions devant être tenues ainsi que les informations à communiquer. Au fil du temps, ce droit a été construit par la jurisprudence, les acteurs sociaux ayant, au cours de certaines négociations, saisi le juge afin d'obtenir des précisions.
Ce qui n'est pas satisfaisant, c'est que la loi du 17 août 2015 est revenue sur un certain nombre de progrès du droit réalisés dans le domaine du processus de négociation ; j'en donnerai deux exemples. La jurisprudence avait établi que, lorsqu'une négociation a lieu entre l'employeur et les organisations syndicales, les élus du personnel – le comité d'entreprise (CE) notamment – devaient être consultés afin de pouvoir participer à la discussion. Il avait également été décidé que le CE devait être consulté en cas de dénonciation d'un accord précédemment conclu. Dans ces deux cas, la loi a supprimé sa consultation. Le processus de la négociation d'entreprise s'en trouve amoindri, et les parties les plus faibles fragilisées ; cela va à l'encontre de la loyauté de la négociation.
De son côté, la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes comportait des dispositions permettant aux négociateurs de demander et d'obtenir des informations complémentaires portant sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. La loi du 17 août 2015 a supprimé cette mesure.
En 1981, l'Organisation internationale du travail (OIT) a adopté la convention n° 154 concernant la promotion de la négociation collective, dont l'une des recommandations prévoit que les négociateurs ont accès aux informations leur permettant de négocier en toute connaissance de cause. Il serait bon que la France ratifie ce document.

J'avoue ma surprise, car je me souviens avoir débattu sur ce sujet à l'occasion de l'examen de la loi du 17 août 2015. Notre délégation avait demandé l'association d'experts aux négociations pour lesquelles il est recouru aux informations contenues dans la BDES ; cette mesure a-t-elle été supprimée ?
Je vous rassure, elle figure bien dans la loi. La difficulté provient du fait que les négociateurs avaient la capacité de demander des informations complémentaires sans nécessairement recourir aux services d'un expert. Certaines des dispositions favorisant une plus grande élaboration de la négociation ont été supprimées ; il ne s'agit pas à proprement parler d'une interdiction, mais une base légale utile a disparu. Ces éléments, dont la consultation du comité d'entreprise, figuraient dans la loi du 13 novembre 1982 et n'ont pas été repris dans la loi du 17 août 2015.
La situation sur laquelle je souhaite appeler votre attention est rarement évoquée. Il s'agit d'un domaine du droit très peu développé en France, et qui concerne le processus de négociation. Si nous souhaitons que le droit du travail procède de plus en plus de la négociation collective – sujet sur lequel les opinions peuvent diverger –, nous devons doter celle-ci d'un véritable régime juridique. Ce droit ne doit pas simplement être celui des accords collectifs : le législateur doit poser des règles propres à favoriser la loyauté de la négociation, à faire que les armes soient égales pour tous et que la consultation soit authentique. Il ne faudrait pas tomber dans une situation où un acteur informerait l'autre de ses projets et où le second acteur n'aurait qu'une faible marge de manoeuvre. Cette question est très importante pour la démocratie sociale.
L'avant-projet de loi traite de la loyauté de la négociation ; ce terme est repris du code civil, car le juge a été conduit à considérer que la négociation doit être de bonne foi. Il s'agit certes d'une collaboration conflictuelle, impliquant des divergences d'intérêt, mais où tous les acteurs veulent aboutir à un accord ; la loi doit préciser ce qui, dans le cadre de cette loyauté, est permis ou non. Il nous revient à tous de bâtir un droit de la négociation collective. Jusqu'à présent, le juge pouvait frapper de nullité un accord résultant d'une concertation déloyale, quand bien même son contenu serait conforme à la loi ; c'est là l'application de règles relevant du droit civil.
Le titre II de l'avant-projet de loi, « Favoriser une culture du dialogue et de la négociation », peut recueillir l'assentiment ; des dispositions relatives à la loyauté ainsi qu'à divers éléments de la concertation y sont d'ailleurs présentes. Malheureusement, il est également prévu que, nonobstant l'absence de certaines d'entre eux, l'accord sera valable. Il serait choquant que la loi elle-même vienne limiter la loyauté de la négociation ; si le législateur veut sous-traiter aux acteurs sociaux la production du droit, la moindre des choses est qu'il garantisse la loyauté de la négociation.
La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, si elle permet toujours le recours à une expertise pour épauler le comité d'entreprise, conditionne cette intervention à l'accord de l'employeur.

Lors de l'examen de la loi du 17 août 2015, nous avions prévu, au bénéfice du comité d'entreprise, le financement d'une expertise équivalente à celle dont dispose l'employeur dans le domaine des documents comptables. Nous sommes à l'origine de cette disposition, qui, à ma connaissance, n'est pas facultative.
En tout état de cause, les accords à venir seront placés sous le double sceau de l'égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail. Il y a là menace d'une certaine dilution de l'égalité professionnelle, au moment même où cette notion commençait à être reconnue comme obligatoire par les partenaires sociaux ; j'ai déjà évoqué ce fait devant l'Assemblée nationale. J'observe par ailleurs que l'égalité professionnelle a été le parent pauvre de l'ANI du 11 janvier 2013.

C'est bien la loi du 17 août 2015 qui a supprimé, aux fins de simplification de la procédure de concertation, la négociation spécifique sur l'égalité professionnelle. Nous l'avons réintroduite dans les trois temps de la négociation de façon à ce que le sujet soit bien abordé à chaque fois.
Trop souvent, les négociations souffrent de l'absence d'un diagnostic de départ établissant l'état des lieux. Ainsi les partenaires discutent de bonne foi, mais en ignorant à quoi ils s'attaquent ; or, une négociation pertinente sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes nécessite une évaluation préalable de la situation. Je conçois qu'une entreprise ne puisse pas régler une telle question d'une année sur l'autre, mais il est toujours possible de dresser un bilan approfondi portant sur une question donnée. Il pourrait ainsi être décidé d'un commun accord que les partenaires sociaux étudient la situation des salariés employés à temps partiel au sein de l'entreprise, car la question aurait été identifiée. Pour des raisons similaires, le même exercice pourrait concerner la formation professionnelle qualifiante. L'absence d'évaluation préalable conduit à l'adoption d'accords dont le contenu est faible : j'ai pu constater qu'un certain nombre d'entre eux, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, n'étaient qu'un catalogue de bonnes intentions ou la reprise, sous une autre formulation, d'articles du code du travail.
D'autres accords ont une réelle consistance, je pourrais citer l'accord d'entreprise conclu au journal Le Figaro. Il comporte des dispositions portant sur la réduction des écarts de salaire entre femmes et hommes : les données sont chiffrées, correspondent à des situations concrètes, et des délais d'application sont mentionnés.
Il est prévu que les entreprises établissent désormais une synthèse de l'accord d'entreprise ou du plan d'action et la publient sur leur site internet. La consultation de ces documents montre la relative vacuité de certains d'entre eux. On peut toutefois rester optimiste et considérer qu'il s'agit là d'une première étape : une concertation a eu lieu, un plan d'action décidé, les partenaires se sont rencontrés pour débattre d'une question précise. Cependant, il faut pouvoir aller plus loin et, à cette fin, un processus plus contraignant doit être déterminé.

Si j'entends bien votre propos, des dérogations non autorisées par la loi ont été adoptées, et, de surcroît, des arrêtés d'extension les ont rendues obligatoires dans des entreprises qui n'étaient pas parties à la négociation.

Cette pratique reviendrait à inverser le contrôle de légalité, en étendant à des entreprises des dispositions dérogatoires à la loi.
Une entreprise qui n'est pas adhérente à une organisation syndicale patronale, et qui n'a donc pas participé à la négociation, peut appliquer cette dérogation ; cela ne signifie pas pour autant que l'arrêté d'extension incite ces entreprises à des pratiques illégales. Un accord de branche étendu est de double nature : à la fois conventionnelle, car son contenu a été négocié par les partenaires sociaux, et réglementaire, car un texte de droit public le rend obligatoire pour l'ensemble des entreprises du secteur d'activité visé par le texte. Bien entendu, cela ne se limite pas au champ de l'égalité entre les femmes et les hommes.

C'est précisément parce que les négociations portant sur l'égalité professionnelle ou les plans d'action étaient laborieuses qu'il a été jugé utile de doter les comités d'entreprise d'une capacité d'expertise financée par l'employeur. Certains de nos interlocuteurs ont considéré que beaucoup restait à faire. Ainsi avons-nous dû livrer bataille pour que la publicité des synthèses des accords collectifs soit maintenue dans le texte.
Une des analyses de l'avant-projet de loi considère que l'accès aux données sera supprimé, alors que nous avions fait en sorte que toutes les informations figurant dans le rapport de situation comparée soient reportées dans la BDU et rendues accessibles à des acteurs qui, jusque-là, n'avaient pas cette possibilité – des membres du CE qui ne sont pas représentants syndicaux, par exemple. Cette ouverture, avec un accès plus large aux données, n'est-elle pas de nature à inciter des entreprises à établir des comparaisons diachroniques ? Par ailleurs, l'abolition par la loi du 17 août 2015 du monopole d'accès détenu par certains acteurs sur ces informations vous paraît-elle susceptible d'améliorer la prise en compte de la question de l'égalité professionnelle ?
Je partage pleinement votre analyse. La possibilité ouverte au comité d'entreprise de recourir à une expertise constitue une avancée positive, particulièrement en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ouverture de l'accès aux données de la BDU à tous les élus quel que soit leur mandat, ainsi qu'aux délégués syndicaux, est très positive.
Les discussions relatives à des sujets comme l'égalité professionnelle se heurtent toujours à des pesanteurs sociologiques ainsi qu'à des stéréotypes. Lorsque les acteurs n'utilisent pas tous les outils mis à leur disposition, cela révèle un manque de formation. Nous le constatons, Rachel Silvera et moi-même, dans nos enseignements respectifs : un partenaire social non formé au droit de la négociation sur la question de l'égalité professionnelle passera à côté du sujet. Beaucoup, par exemple, considèrent qu'en matière de rémunération la règle applicable est : « à travail égal, salaire égal entre femmes et hommes ». Or la règle véritable, qui date de 1919, est : « à travail de valeur égale, rémunération égale ». L'article 427 du traité de Versailles du 28 juin 1919, qui a – entre autres – fondé l'OIT, a été rédigé avec la conviction que la misère des peuples était cause des guerres, et que l'une des causes de cette misère était la trop faible rémunération du travail des femmes. Cela résonne de façon assez tragique lorsque l'on observe la réalité d'aujourd'hui.
Il faut donc garantir l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes lorsqu'ils effectuent un « travail de valeur égale ». Lorsque les partenaires sociaux abordent la négociation, ils commencent par regarder quels sont les emplois identiques occupés par des femmes et par des hommes, et se limitent à cette question. En général, un écart de 4 % est constaté, et la négociation se fonde sur cette base, alors que, comme pourra vous le confirmer Rachel Silvera, cet écart est beaucoup plus élevé.
La question de la motivation des acteurs peut aussi se poser. Il faut que les partenaires sociaux réalisent que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit constituer une préoccupation de premier plan, et non un « supplément d'âme » auquel on se consacrera lorsque l'on en aura le temps.

Dans l'avant-projet de loi, plusieurs sujets concernent particulièrement les femmes : la flexibilité qui semble devoir être étendue, les durées maximales, les repos fractionnés, les astreintes, les heures complémentaires. Une autre question est celle de la durée de vie des accords collectifs, qui serait de cinq ans, ainsi que celle de la périodicité de négociations qui pourrait passer à trois ans : cela est-il favorable ou défavorable aux femmes ?
Dans le domaine de l'égalité, il est singulièrement difficile de faire bouger les lignes, ce que peu de gens sont prêts à admettre. L'une de mes connaissances vient de rendre un rapport sur le conseil général de son département : il en ressort qu'un différentiel de traitement de 15 % demeure dans la fonction publique, et personne ne comprend pourquoi, puisque cela n'avait jamais été mis en évidence.
J'en viens à la question des principes essentiels. Selon la terminologie du rapport remis au mois de janvier dernier par M. Badinter, les principes essentiels du droit du travail sont visés par certaines dispositions de l'avant-projet de loi. Des discussions très techniques vont se dérouler, qui auront trait à ces notions fondamentales : l'articulation entre l'accord d'entreprise, l'accord de branche et la loi, etc. Il n'est dès lors pas superflu de s'interroger sur les fonctions du droit du travail : à quoi sert un code du travail dans la France du XXIe siècle ?
Ces principes essentiels apportent des éléments de réponse, ils donnent des repères, alors qu'un courant de pensée voudrait que le droit du travail soit toujours plus négocié. Dans ces conditions, il est impérieux de donner un cadre, donc des limites, aux acteurs de la négociation ; ces principes essentiels sont inspirés par les fondamentaux du droit du travail, qui, eux-mêmes, prennent leur source dans la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. Ils doivent déterminer les contours de la relation de travail, et être déclinés par les négociateurs, car ils n'ont pas une vocation simplement décorative : ils doivent avoir une existence concrète. Ce sera la tâche de la Commission supérieure de codification, mais aussi celle du législateur et, in fine, des partenaires à la négociation.
Ces principes sont aujourd'hui malmenés par un certain nombre de contraintes figurant dans la lettre de mission adressée aux rédacteurs, à qui on a demandé une rédaction de principes à droit constant – ce qui signifie que leur capacité d'initiative a été bridée. Ces rédacteurs ont été contraints d'avaliser des régressions intervenues au cours des dernières années dans le droit du travail ; il leur a encore été demandé d'ignorer les principes internationaux. Si, avec raison, ils se sont partiellement affranchis de ce carcan, il me semble toutefois que les formulations relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes pourraient être améliorées tout en conservant leur substance ; à cet égard, il faut relever que les délais impartis ont été extrêmement courts. Le législateur ne doit pas hésiter à s'emparer de ce travail réalisé par des experts de haut niveau afin de l'améliorer.
Dans le champ de l'égalité entre les femmes et les hommes, les articles 4 et 5 présentent quelques difficultés. Ainsi, l'article 4 figurant dans le préambule relatif aux principes essentiels du droit du droit du travail, définis à l'article 1er du projet de loi, dispose : « Le principe d'égalité s'applique dans l'entreprise. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit y être respectée », et l'article 5 : « Les discriminations sont interdites dans toute relation de travail. » La difficulté réside dans la complexité de notre droit du travail, qui comporte deux régimes d'égalité : celui de l'égalité entre tous les salariés – fondé sur le principe « à travail égal, salaire égal », qui concerne tous les individus sans qu'il soit fait appel à quelque référence que ce soit – et celui constitué par les règles de non-discrimination. La chose est certes difficile à admettre, mais ces deux régimes juridiques obéissent à des règles différentes : ils n'ont pas les mêmes ambitions en termes d'exigence et de réparation, et ne prévoient pas le même processus pour leur application.
Aussi, le régime juridique de la non-discrimination est plus fort que celui de l'égalité. Le régime de l'égalité étant une déclinaison du principe républicain d'égalité, on pourrait l'imaginer très puissant, mais, dans les faits, c'est simplement le principe de l'égalité entre tous les salariés qui s'applique. L'article 4 devrait plutôt mentionner l'égalité de traitement, qui est applicable à toutes les personnes, sans références particulières à une quelconque caractéristique, et l'article 5, les règles de non-discrimination, dont celle de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Ce discours n'est pas purement académique, car lorsque des entreprises sont poursuivies pour atteinte à l'égalité professionnelle, elles le sont sur le terrain de la discrimination, mais leurs avocats – qui font bien leur travail – cherchent à amener le magistrat sur le terrain de l'égalité de traitement, bien moins protecteur des salariés que celui de la non-discrimination. Aussi la rédaction de l'avant-projet peut-elle être source de confusion, car l'article 4 vise à la fois la règle de l'égalité de traitement entre tous les salariés et celle de l'égalité professionnelle, c'est-à-dire de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
L'article 5 dispose que les discriminations sont interdites dans toute relation de travail. Cela signifie que la non-discrimination n'est pas limitée aux relations de travail salarié ; il s'agit d'une question importante car l'avant-projet de loi, par endroits, vise des relations de travail qui ne sont pas strictement salariées. Déplacer la mention de l'égalité professionnelle à l'article 5 permettrait de fixer la règle d'égalité professionnelle dans toute relation de travail même si, au sens strict, elle n'est pas salariée.
L'article 7 pose un problème comparable. Il dispose en effet que « Le harcèlement moral ou sexuel est interdit et la victime protégée ». Il ne paraît pas pertinent de placer au sein du même article le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Une fois encore, deux régimes juridiques distincts se côtoient : le harcèlement moral est un régime juridique particulier ne faisant aucune référence à la caractéristique des personnes, alors que le harcèlement discriminatoire peut, pour sa part, être qualifié de discrimination par harcèlement. Ce dernier régime comprend le harcèlement sexuel et se trouve être beaucoup plus fort que le harcèlement moral : une nouvelle fois, il y a un risque de confusion. Aussi cet article me semble-t-il incomplet, car ne visant pas les autres formes de harcèlement susceptibles d'être liées à la race, l'ethnie, l'âge ou la couleur de la peau, etc., pourtant mentionnées dans la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Ces remarques portant sur les principes essentiels fondamentaux prétendent concourir à l'amélioration des rédactions : la suite de l'avant-projet donne d'ailleurs l'impression que ces notions ont été simplement plaquées en tête du texte, sans conséquence sur le contenu des articles suivants. Ces principes essentiels sont pourtant destinés à être déclinés dans des règles ; à cet égard, le législateur doit faire preuve de pédagogie.
Une autre difficulté va se faire jour au sujet du temps de travail. Les choses étant, il est vrai, complexes, certains acteurs de la négociation confondent ce qui existe déjà dans le code du travail, et que l'avant-projet de loi reprend, avec ce qu'il apporte de nouveau dans ce domaine. Cela rend le débat confus puisque ce texte est critiqué, à juste titre, sur certains points, mais que toutes les observations formulées ne sont pas pertinentes. Ainsi, le code du travail dispose depuis des années qu'un accord d'entreprise permet le passage de la journée de travail de 10 à 12 heures ; à cet égard, l'avant-projet de loi n'innove en rien. Les exemples de ce genre pourraient être multipliés à l'envi.
Inversement, un certain nombre de critiques portant sur le droit actuel peuvent être appliquées à l'avant-projet de loi. À ce titre, la question du forfait jours se pose, car deux pôles concentrent les difficultés dans le temps de travail des femmes : le temps partiel et les durées de travail excessives. Pour des raisons sociologiques bien connues, tenant en particulier à la répartition des tâches ménagères au sein du couple, le forfait jours a des incidences négatives sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce régime a été critiqué par le Comité européen des droits sociaux (CEDS) ; le droit français n'est donc pas conforme à la Charte sociale européenne, ce qui a donné lieu à des contentieux, et la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que les dispositions d'au moins douze conventions collectives ne garantissaient pas le respect de la santé, notamment du fait de cette non-conformité.
Cette situation est très insatisfaisante pour les salariés puisque, dans certains cas, les dérogations concernées peuvent aboutir à des durées de travail excessives. Ainsi peuvent-ils être conduits à travailler légalement jusqu'à 76 heures par semaine sans percevoir la moindre majoration de rémunération pour heures supplémentaires ! Les femmes sont en outre susceptibles d'être victimes de discrimination indirecte puisque, dans un même service, des salariés peuvent travailler sans limites alors que d'autres, du fait de contraintes personnelles, n'ont pas cette possibilité. L'employeur confiera fatalement les tâches et les dossiers les plus intéressants à ceux qui n'ont pas de limites horaires.
Par ailleurs, le forfait jours peut mettre les employeurs dans une situation d'insécurité juridique : alors qu'ils appliquent, au titre du code du travail, des conventions de branche et des accords d'entreprise qui leur sont conformes, ils peuvent néanmoins être condamnés au titre de l'absence de rémunération des heures supplémentaires ainsi que de durée du travail excessive. Loin d'améliorer leur sécurité juridique, l'avant-projet de loi autorise, qui plus est, l'extension du forfait jours aux entreprises de moins de 50 salariés où n'a été conclu aucun accord collectif. En d'autres termes, l'insécurité juridique se voit étendue, et j'insiste sur le fait qu'elle concerne les salariés comme les employeurs.
La situation est la même pour les salariés lorsqu'ils sont en astreinte sur leur temps de repos ; une fois de plus, le droit français n'est pas conforme au droit européen. La situation va même être aggravée, puisqu'est prévu le fractionnement du droit au repos de onze heures, ce qui est contraire à la directive européenne.
Le régime juridique des heures d'équivalences permet de comptabiliser de façon très particulière le temps de présence par rapport au temps de travail effectif. De fait, le premier doit être plus important que le second ; dans certaines branches, il était acquis que 39 heures de présence équivalaient à 35 heures de travail effectif. À l'occasion d'une affaire française, il a été considéré que ce régime des heures d'équivalence était contraire au droit européen ; malgré cela, il est toujours prévu par notre code du travail. Une fois encore, la situation n'est satisfaisante ni pour le salarié, ni pour l'employeur. Il serait d'ailleurs intéressant d'étudier la sociologie de l'action judiciaire, car le volume du contentieux est très variable selon les professions considérées.
Le régime des congés payés français, s'il ne regarde pas directement la question de l'égalité professionnelle entre femmes et hommes, n'est pas non plus conforme en ce qui concerne les salariés ayant pris des arrêts de travail pour cause de maladie. Dans certaines limites, le droit européen considère que ces salariés ne doivent pas subir de réduction de leurs droits à congés payés : la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) l'a signifié par son arrêt du 20 janvier 2009. De son côté, la chambre sociale de la Cour de cassation, à l'occasion de son rapport annuel, est parfois conduite à demander au législateur de mettre le droit national en conformité avec le droit européen. L'examen prochain du projet de loi présenté par le Gouvernement pourrait constituer l'occasion de régulariser la situation du droit du travail français sur un certain nombre de points.
Votre délégation nous a demandé si certaines autres dispositions de l'avant-projet de loi appelaient des réserves de notre part : c'est effectivement le cas en ce qui concerne les informations partagées par les négociateurs. La loyauté de la négociation est ici en cause, car l'information doit être partagée le plus largement possible ; il est singulier que l'une des parties soit conduite à devoir argumenter pour obtenir une information afin d'être à même de négocier en toute connaissance de cause. Dans un certain nombre de cas, la rédaction de l'avant-projet de loi est de nature à provoquer des crispations entre les partenaires sociaux ; il n'organise pas un climat de négociation confiant.
Vous nous avez aussi interrogés sur les dispositions en vigueur en matière de sanctions financières applicables à l'encontre des entreprises non couvertes par un accord ou un plan d'action d'égalité professionnelle. Nous sommes au début d'un processus, et les entreprises sanctionnées sont celles qui refusent absolument la négociation et dans lesquelles la situation est bloquée. Par la suite, il sera nécessaire de rechercher la faute en prenant pour base des critères plus qualitatifs, par l'évaluation du contenu des accords et plans d'action.
J'appelle l'attention de la délégation sur le fait que l'intensité de l'engagement des services de l'État est variable selon les régions concernées, ce que montrent les statistiques. Il faudrait s'interroger sur les politiques suivies et l'origine de ce phénomène : je m'interroge par exemple sur la manière dont les préfets se sont saisis de la question.
Ces données proviennent de la direction générale du travail (DGT) et sont régulièrement présentées au CSEP ; j'ai en ma possession celles publiées à la fin de l'année 2015.

Ces statistiques sont établies par régions ; nous n'avons pas obtenu du ministère la liste des sociétés pénalisées.
Il faut rappeler que la pénalité financière ne sanctionne pas le fait que l'entreprise n'appliquerait pas l'égalité professionnelle entre femmes et hommes, mais le fait qu'elle n'a pas négocié un accord conformément à la loi dans ce domaine. L'ordonnance du 10 décembre 2015 prévoit qu'une entreprise pourra demander auprès de l'administration un rescrit social actant de sa situation de conformité avec la loi. Toutefois, ce rescrit portera sur l'existence d'un accord, non sur la suppression de toute discrimination à l'égard des femmes, ce qui ne manquera pas d'être source de contentieux.
L'article 30 de l'avant-projet de loi prévoit un barème contraignant, limitant les indemnités fixées par le juge des prud'hommes en cas de licenciement injustifié. Cette disposition contrecarre les règles de droit civil organisant la réparation intégrale du préjudice ; en d'autres termes, le droit du travail dérogerait au droit commun, en faisant du salarié un justiciable de second ordre. Cela reviendrait, de façon paradoxale, à garantir la sécurité juridique d'un licenciement illégal, l'auteur de la faute sachant par avance ce qu'il risque ! L'article s'appliquerait aussi aux procédures de licenciement économique annulées par le juge, ainsi qu'aux licenciements motivés par une inaptitude consécutive à un accident du travail lorsque l'obligation de reclassement n'a pas été respectée.
Ces dispositions, éminemment critiquables, seront au demeurant source d'insécurité juridique pour les employeurs, car il faudra prévoir des dérogations, notamment en matière de discrimination, puisque le droit européen proscrit le plafonnement des indemnisations. Cela signifie un abondant contentieux fondé sur la discrimination ou le non-respect des droits fondamentaux ; pourrait en outre être invoqué, à l'occasion de bien des licenciements, le droit constitutionnel à l'emploi. Cet article est donc insatisfaisant sur le fond comme dans sa rédaction.

Je vous remercie une nouvelle fois, monsieur Miné pour votre excellent travail et votre dévouement à la cause des femmes.
Michel Miné et moi avons présenté nos avis sur l'avant-projet de loi au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP) ; j'ignore ce qu'il en est de leur publication.

Nous avons déjà pris connaissance de l'avis d'un syndicat qui l'a rendu public. Vos analyses sont toujours bienvenues, et le CSEP nous avait déjà beaucoup aidées lors de l'examen de la loi relative au dialogue social et à l'emploi.
Cet avant-projet de loi porte une contradiction : il affiche en préambule l'objectif d'égalité professionnelle, mais le sujet n'y est jamais abordé de façon transversale, alors même que bien des dispositions législatives ont été adoptées dans ce domaine. Il me semblait que, conformément à des approches européennes relativement bien intégrées par le droit français, l'idée de transversalité, de gender mainstreaming, était devenue centrale.
Ma première interrogation porte sur la place des accords de branche vis-à-vis de la loi. Il est courant d'entendre évoquer une inversion de la hiérarchie des normes ; au-delà des conséquences d'ordre général, ce ne sera pas sans conséquence sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il est notoire que les emplois les plus souvent occupés par des femmes constituent le maillon faible de la négociation collective et de la protection syndicale. Cette situation se vérifie le plus souvent au sein des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que de certains secteurs d'activité comme l'aide à domicile ou, dans une moindre mesure, le commerce, la restauration, etc. Les chiffres ne sont malheureusement pas disponibles, mais nous savons que la couverture conventionnelle concerne surtout les grandes entreprises.
Les femmes étant plus présentes dans les TPE et PME, elles sont, de façon indirecte, plus fragilisées ; en l'absence de suivi et de contrepartie, cette situation est dommageable.
Par ailleurs, l'avant-projet de loi risque de dégrader encore plus les conditions relatives au temps de travail en favorisant des durées maximales élevées, entérinées par des accords d'entreprise et de branche. Il est prévu, je le rappelle, qu'elles puissent être atteintes durant seize semaines au lieu de douze, et que le temps de travail puisse être calculé sur trois ans au lieu d'un an. Les femmes travaillant à temps partiel ne pourront pas allonger celui-ci, ce qui ne leur permettra pas de connaître une réelle autonomie financière. Par ailleurs, les allongements du temps de travail – le forfait jours étant le cas extrême – dégradent la situation des femmes, particulièrement de celles qui sont cadres, car ce sont toujours les femmes qui subissent les contraintes familiales : elles consacrent une heure et demie de plus que les hommes, en moyenne, aux tâches quotidiennes. Leur temps contraint, c'est-à-dire le temps de travail plus le temps domestique, est plus important, dans notre pays, que celui des hommes. La situation est différente dans les pays nordiques.
Les annonces faites à propos de ce projet de loi promettaient plus de sécurité pour les femmes dans un contexte de « flexisécurité », avec le compte personnel d'activité (CPA) et le droit à la déconnexion, mais le texte ne va pas assez loin. Il est sibyllin au sujet du CPA ; le transfert et la conservation des droits à la formation est une bonne mesure, mais elle devrait être étendue aux autres droits, qui mériteraient d'être accrus, tel le compte épargne-temps. Le volet sécurité de l'avant-projet de loi, dans la version dont j'ai eu connaissance, n'est pas suffisant.
Par ailleurs, rien, dans le texte, ne garantit le respect par l'employeur du droit à la déconnexion ; il semble même qu'une contrainte supplémentaire serait susceptible de peser sur le salarié.
Les dispositions de l'avant-projet de loi, en l'état, ne pourront que conduire à une aggravation de la discrimination indirecte qui frappera tant les femmes cadres que celles occupant des emplois à temps partiel ou précaires.
Depuis longtemps, je m'intéresse tout particulièrement au bilan des accords collectifs ; avec Jacqueline Laufer, nous avions analysé les quarante premiers accords passés au titre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. On peut constater un très net progrès car, depuis, plus de 10 000 de ces accords ont été signés. La loi du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, dite « loi Roudy », avait abouti à une quarantaine de plans d'égalité. D'après la DGT, le taux de couverture par des accords sur l'égalité est d'environ 38 %, avec des variations considérables en fonction de la taille des entreprises puisque 83 % des entreprises de plus de 1 000 salariés sont couvertes, pour 33 % des entreprises de moins de 300 salariés.
Le nombre des mises en demeure s'élève aujourd'hui à plus de 2 045 et celui des sanctions à 81, ce qui tend à prouver l'efficacité de ce régime applicable en l'absence d'accord. La situation est moins satisfaisante dans le domaine de l'égalité des rémunérations, mais les chiffres eux-mêmes doivent être examinés avec la plus grande circonspection, puisque, selon le mode de calcul retenu – choix des indicateurs, prise en compte ou non des primes, par exemple – l'écart observé peut varier entre 4 % seulement et le niveau communément reconnu, c'est-à-dire 25 %. Il est donc difficile de progresser en toute connaissance de cause, même si l'on constate une érosion des écarts de salaire.
Ainsi que l'a indiqué Michel Miné, le contenu de bien des accords est pauvre et ne fait que rappeler les principes posés par la loi. La direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) a commandé à une équipe de l'École normale supérieure (ENS), pilotée par Sophie Pochic, du Centre Maurice-Halbwachs, une étude qui portera sur le contenu des accords collectifs d'entreprise et des plans d'action unilatéraux sur l'égalité professionnelle ainsi que sur leur mise en oeuvre. Ce travail sera fondé sur une analyse statistique globale des accords sur l'égalité professionnelle, puis d'un suivi qualitatif d'un certain nombre de ceux-ci à partir d'un échantillon raisonné.
Dans mon analyse des quarante premiers accords collectifs sur l'égalité professionnelle, j'avais distingué quatre degrés croissants d'engagement : le simple rappel des principes ; la mise en place d'outils statistiques pertinents permettant de poser un diagnostic partagé ; l'évolution de la proportionnalité au moment du recrutement, en étant attentif au nombre de femmes candidates ainsi qu'à leurs qualifications ; l'engagement d'actions positives visant à corriger les inégalités sur la base de mesures chiffrées, avec une évaluation à terme.

Le conseil général de l'Essonne avait mis en oeuvre le curriculum vitae (CV) anonyme, et l'enquête conduite pendant six mois a mis en évidence une nette augmentation des entretiens d'embauches, non seulement pour les personnes d'origine étrangère, mais également pour les femmes. Pensez-vous qu'il serait judicieux d'inscrire cette pratique du CV anonyme dans la loi ?
Il me semble que les avis sont très partagés sur le CV anonyme, qui aujourd'hui n'est plus qu'optionnel. Je suis assez réservée quant à son utilisation en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : les accords d'entreprise les plus probants que j'ai évoqués identifiaient et favorisaient en effet le sexe sous-représenté. L'accord conclu à Aéroports de Paris prévoyait ainsi – ce qui n'est plus le cas – qu'à compétences égales, le recrutement favoriserait le sexe sous-représenté. La loi permet en effet de le faire de façon provisoire, mais cette pratique est l'exact contraire du CV anonyme ! Au reste, tout dépend du champ concerné et des méthodes de recrutement de l'employeur au regard de ses méthodes de recrutement ; s'il est vrai que, dans les entreprises où règne une forte discrimination, le CV anonyme peut être une solution, d'autres outils pertinents existent néanmoins.
Il s'agit d'un chantier très complexe dont les évolutions sont très lentes. Il y a quelques années, avec Séverine Lemière, j'ai piloté une étude pour le Défenseur des droits et rédigé un guide favorisant la réflexion relative aux discriminations véhiculées par les classifications professionnelles. Au nom du principe précédemment rappelé par Michel Miné, « à travail de valeur égal, salaire égal », les classifications professionnelles peuvent constituer un outil de revalorisation des emplois à prédominance féminine.
À l'instar de pays ou de territoires comme le Québec, l'égalité doit être favorisée dans les classifications professionnelles, qui ne sont pas à considérer comme neutres : selon les méthodes et critères utilisés, la « pesée » des emplois peut différer selon qu'il s'agit d'emplois à prédominance masculine ou féminine. Nous avons toujours cherché à associer les partenaires sociaux à cette démarche, mais nous n'avons pas eu gain de cause, ni fait l'unanimité. Toutefois, l'article 19 de l'ANI prévoyait la constitution d'un groupe paritaire chargé de réfléchir à une méthodologie propre à inciter les branches à intégrer l'égalité dans la négociation des classifications professionnelles. Ce groupe s'est réuni pendant un an et a publié une note méthodologique qui a été présentée au CSEP en décembre dernier.
Le processus est lent, mais la note a le mérite d'exister ; je ne suis pas sûre que, comme ils devaient s'y engager, les partenaires sociaux l'aient utilisée et diffusée... Le CSEP a, depuis, constitué son propre groupe de travail, qui réunit des représentants de la DGT, des partenaires sociaux ainsi que des personnalités qualifiées, dont moi-même. Ce groupe de travail procède à des auditions, et quelques branches professionnelles ont été retenues afin d'approfondir l'analyse. À terme, une session de sensibilisation et, peut-être, de formation des négociateurs de branche est envisagée.
En fait, nous sommes en train de refaire tout le travail accompli pour le Défenseur des droits, mais, cette fois, avec l'ensemble des partenaires sociaux ; nous avançons, certes lentement, mais nous avançons. Une hypothèque pèse toutefois sur le Conseil, dont l'effectif se résume à sa secrétaire générale et à une personne chargée de l'ensemble des dossiers – et qui est actuellement très mobilisée par l'avis sur l'avant-projet de loi, ce qui a conduit à ajourner une fois de plus la réunion du groupe de travail.

Vous avez indiqué qu'Aéroports de Paris avait renoncé à ses dispositions de positive action en matière de recrutement.
Je n'ai malheureusement pas eu d'information supplémentaire. Je n'ai pu que constater la disparition de ces principes dans les accords portant sur l'égalité professionnelle des femmes et des hommes. Il me semble que, lorsque l'on adopte ce type de dispositions, on s'engage dans le but d'aboutir à une amélioration ; j'imagine que les résultats n'ont pas été au rendez-vous. Il est probable que le chiffrage qui avait été retenu, avec des quotas, s'est révélé impossible à respecter : un échéancier beaucoup plus souple serait nécessaire.
Je rappelle enfin que la périodicité des accords collectifs, notamment sur l'égalité, constitue un réel sujet : les négociations sur les salaires risquent de devenir triennales, il faut donc rester vigilant sur ces échéances susceptibles d'influer sur l'égalité professionnelle.
La séance est levée à 18 heures 10.