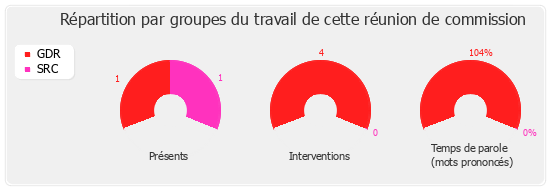Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
Réunion du 22 mars 2016 à 17h00
La réunion

Nous poursuivons les travaux de la Mission d'évaluation et de contrôle (MEC) sur la transparence et la gestion de la dette publique, et avons le plaisir de recevoir M. Dominique Plihon, porte-parole de l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne (Attac).
Je vous remercie de m'avoir convié à m'exprimer devant vous. J'enseigne à l'université Paris-Nord, je suis porte-parole d'Attac et membre du groupe des Économistes atterrés, dont vous avez reçu l'un des membres, M. Henri Sterdyniak.
La question de la dette s'avère, plus que jamais, essentielle. La dette publique, même en dehors des périodes de crise, représente un élément majeur du fonctionnement de l'État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale, et plus largement de l'ensemble de l'économie.
À partir de 2007 et de 2008, s'est développée une crise qui est devenue celle des dettes souveraines, la France n'étant pas le seul pays concerné. Les pays de la zone euro ont été très touchés et davantage que les États-Unis ou le Royaume-Uni – le Japon se trouvant dans un cas particulier puisqu'il connaît une déflation et une situation particulière depuis plus de dix ans ; il y a d'ailleurs probablement des enseignements à tirer pour la France et l'Europe de l'expérience japonaise.
Pour gérer au mieux la question de la dette publique, il faut d'abord établir le bon diagnostic. Les Économistes atterrés et Attac sont en désaccord avec le discours habituel sur les causes de l'endettement et les mesures à mettre en oeuvre. Une vingtaine d'organisations - partis politiques, syndicats, associations et organisations non gouvernementales (ONG) – se sont regroupées dans un collectif pour réaliser un audit citoyen de la dette publique de la France (CAC), qui a été publié en 2015. Les conclusions du CAC diffèrent grandement du diagnostic et des solutions présentés habituellement.
Un changement radical de politique économique s'est opéré au tournant des années 1980 dans tous les pays avancés, à commencer par les États-Unis. La Réserve fédérale américaine (Fed) et son président, M. Paul Volcker, ont impulsé une politique monétaire conduisant à la montée violente des taux d'intérêt dans le monde. Cette décision a eu des conséquences considérables. Avant les années 1980, le rapport de la dette publique sur le produit intérieur brut (PIB) demeurait relativement stable ; depuis trente-cinq ans, ce ratio n'a cessé de croître, en France comme dans les pays voisins. La dette publique représentait un peu plus de 20 % du PIB en 1980 et 63,4 % en 2007, à la veille de la crise ; depuis 2007, le poids de la dette a explosé puisqu'il représente aujourd'hui près de 100 % du PIB français.
Le discours dominant voit dans la dérive des dépenses publiques la cause principale de la hausse de l'endettement, alors que le CAC a constaté que le ratio des dépenses publiques sur le PIB était resté constant, voire en léger repli. Le CAC estime que c'est l'évolution des recettes qui explique principalement celui de l'endettement. Les recettes de l'État ont baissé sur la période de deux points de PIB. De 1980 à 2007, la moitié de la hausse de l'endettement public s'explique par la baisse des recettes publiques, notamment fiscales.
On peut distinguer trois types d'explications à cette baisse. Il y a d'abord la croissance des dépenses fiscales. La Cour des comptes ne cesse de dénoncer la multiplication des niches fiscales ; on en recense près de 400 dans notre pays. Le crédit impôt recherche (CIR) représentait la dépense fiscale la plus élevée avec 5 milliards d'euros par an, jusqu'à la création du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), qui coûte 20 milliards d'euros par an au budget de l'État. Deuxièmement, la concurrence fiscale – voulue par les entreprises et par ceux qui souhaitent que s'exerce une pression à la baisse sur les impôts – s'est traduite par une diminution du taux d'imposition. Le taux de l'impôt sur les sociétés (IS) est ainsi passé de 45 à 33 % en France, de même que l'on a supprimé les tranches supérieures de l'impôt sur le revenu (IR), ce qui a réduit la progressivité de cet impôt et le niveau des recettes. Enfin, l'évasion fiscale représente, d'après les évaluations de la Cour des comptes, 60 milliards d'euros par an de manque pour le Trésor public.
L'effet « boule de neige » a également nourri la croissance de la dette : lorsque le taux de croissance devient inférieur au taux d'intérêt du remboursement de la dette, celle-ci augmente même en l'absence d'un déficit budgétaire primaire – hors intérêts. De 1980 à 2007, on a constaté presque sans interruption cet effet « boule de neige », que le rapport de M. Gilles Carrez avait décrit dès 2010. Le choc de 1979 sur les taux d'intérêt, découlant d'une politique monétaire très restrictive conduite par la Fed, a donné un coup d'arrêt à la croissance économique. Depuis le début des années 1980, le taux de croissance est passé de 4 à presque 0 %, même si cette contraction ne fut pas linéaire. Les taux d'intérêt ont donc été supérieurs aux taux de croissance en moyenne, cette situation nourrissant la progression de l'endettement. Cet effet explique l'autre moitié de l'augmentation de la dette publique rapportée au PIB entre 1980 et 2007.
Entre 2007 et 2012, la dette française est passée de 63,4 % du PIB à plus de 90 %, ce ratio atteignant près de 100 % aujourd'hui. La violence de l'accélération de l'augmentation de la dette est largement due à la crise, et non à une mauvaise gestion ayant conduit à une progression irraisonnée des dépenses publiques. Des rapports de la Cour des comptes, de l'Assemblée nationale et de divers organismes ont étudié les effets de la crise sur la dette ; tout d'abord, le sauvetage des banques a représenté un coût important – et non nul comme le proclament certains banquiers. Le sauvetage de la banque Dexia a coûté 6 milliards d'euros et l'achat d'actions préférentielles par l'État entre 2008 et 2010 a entraîné, d'après la Cour des comptes, une perte financière pour le Trésor public car ces actions ont été revendues à un cours déprécié. Le renflouement des banques a, au minimum, coûté 12 milliards d'euros. Ce montant fut bien supérieur au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Dans les premières années de la crise, la France a, comme de nombreux autres pays, déployé des plans de relance visant à soutenir l'activité, cette politique ayant entraîné une charge pour les finances publiques, alors même que les recettes se contractaient du fait du ralentissement économique. Il s'agit d'un effet indirect de la crise financière sur le déficit et la dette publics, même si ces mesures ont permis d'amortir la récession. La majorité des pays de la zone euro ont connu une trajectoire similaire à celle de la France au cours de ces années.
Notre constat diffère donc de celui des gouvernements successifs et se trouve partagé par un certain nombre d'élus, qui m'apparaissent néanmoins minoritaires.
Les règles de fonctionnement de la zone euro ont amplifié la crise des dettes souveraines, puisqu'elles ont imposé un ajustement budgétaire bien plus contraignant qu'ailleurs, notamment aux États-Unis. La Banque d'Angleterre (BoE), la Fed et la banque centrale du Japon ont conduit des politiques monétaires différentes de celle de la BCE. Ainsi la BoE n'a pas hésité à racheter massivement de la dette publique sur le marché primaire, ce qui a réduit le coût de la dette en exerçant une pression à la baisse sur les taux d'intérêt et a également contribué à stabiliser les marchés en limitant la spéculation. La BCE, fort contrainte par ses statuts, a choisi une autre orientation. Elle n'est pas intervenue dans un premier temps, puis n'a agi que sur le marché secondaire. La zone euro avance donc dans ce domaine avec un boulet aux pieds que n'ont pas d'autres pays.
En tant qu'Européen convaincu, la clause de non-renflouement – no bail-out – me choque profondément car elle empêche la solidarité entre les États-membres de la zone euro dans le domaine de la dette. Les économistes libéraux justifient cette clause pour éviter l'aléa moral, qui, en garantissant leur sauvetage, inciterait les États à ne pas bien gérer leurs finances publiques. L'expérience de la crise a montré l'inanité de cette clause, la situation étant telle que les Européens durent aider la Grèce, l'Irlande, l'Espagne et le Portugal. Cette liberté par rapport à la clause de non-renflouement s'est accompagnée de mesures violemment restrictives – regroupées dans des plans d'ajustement dits structurels – qui se sont avérées contreproductives, la dette ayant progressé dans ces pays, notamment en Grèce. Le corset des règles de la zone euro a empêché d'innover et de mettre en place rapidement des dispositions exceptionnelles de solidarité.

Notre mission cherche à déterminer le poids de la dette sur les décisions publiques, le problème étant d'ordre politique, et non financier comme on voudrait nous le faire croire.
Jugez-vous illégitime une partie de la dette ?
Dans les années 1980 et 1990, l'effet boule de neige s'est puissamment développé et la détention de titres de la dette est devenue une source importante de prospérité. En revanche, depuis quelques années, les taux d'intérêt sont très faibles et même proches de zéro : comment expliquez-vous cette situation ? Existe-t-il un risque de retournement des taux ? Le quantitative easing (QE) permet-il de juguler ce risque ? La BCE n'intervenant que sur le marché secondaire, certains acteurs profitent mécaniquement de la différence des prix entre les marchés primaire et secondaire.
Rembourserons-nous la totalité de la dette publique ? Est-ce légitime de la rembourser ? Est-ce faisable ? Est-ce souhaitable ?

Comment jugez-vous les décisions de baisse des recettes fiscales ? Quelle est leur part dans la situation de dette publique élevée ? Convient-il de diminuer les dépenses publiques ? Comment devons-nous procéder en la matière ? La réduction des dépenses publiques mise en oeuvre par le Gouvernement actuel vous paraît-elle suffisante ? Si la dette profite à quelqu'un, à qui ?
Le CAC qualifie d'illégitime la dette qui résulte de dépenses qui n'ont pas été effectuées dans l'intérêt général. Parmi les 400 niches fiscales, on trouve des exonérations d'impôt pour les plus-values réalisées par les éleveurs de chevaux de course ou pour les fabricants de pipes à Saint-Claude ; la liste de ces dépenses fiscales contient des mesures qui, même si elles n'entraînent pas les préjudices les plus importants pour les finances publiques, sont prises dans un unique but de clientélisme électoral.
Je fais partie des économistes qui dénoncent depuis trente-cinq ans le tournant monétaire opéré au début des années 1980 qui a renversé le rapport de force entre les créanciers et les débiteurs ; avant 1980, les emprunteurs parvenaient à imposer des taux d'intérêt relativement bas et des taux d'inflation plus élevés qui érodaient le poids de la dette. Des dirigeants comme Ronald Reagan, Margaret Thatcher ou Jacques Delors ont cherché à redonner au capital financier le pouvoir qu'il avait perdu ; ils ont ainsi libéralisé la circulation du capital, la mobilité de celui-ci conférant un pouvoir énorme à ses détenteurs, qui ont pu délocaliser et relocaliser les activités économiques à leur guise.
Cette politique a entraîné une montée des taux d'intérêt dans le monde, et d'abord aux États-Unis où ils ont doublé, passant de 10 à 20 %. Les pays latino-américains, fortement endettés en dollars, se sont retrouvés au bord de la faillite dans les années 1990. L'augmentation des taux a entraîné une croissance du poids de la dette, cette hausse possédant un caractère illégitime puisqu'elle était contraire aux intérêts de la majorité des acteurs et ne bénéficiait qu'aux détenteurs de titres de la dette.
Le concept de soutenabilité de la dette s'avère au moins aussi intéressant que celui de sa légitimité. On considère qu'une dette est insoutenable lorsque son évolution et son niveau sont tels que son remboursement induit l'appauvrissement du pays. La Grèce fournit l'exemple d'une dette insoutenable : à la veille de la crise, l'endettement public atteignait 100 % du PIB alors qu'il dépasse 200 % aujourd'hui. L'effet boule de neige et l'évasion fiscale ont joué un rôle prépondérant ; les Grecs paient des taux d'intérêt très élevés et ont connu six à sept années de récession. On impose un remède de cheval à un pays dont on sait pertinemment qu'il ne pourra pas le guérir. Il existe des raisons politiques à cet acharnement qui, sur le plan du raisonnement économique, s'avère absurde.
La dette de la France n'est pas insoutenable, et notre pays pourrait retrouver une situation satisfaisante s'il appliquait certaines mesures et si la crise économique ne durait pas trop longtemps. Le remboursement de la dette apparaît tout à fait possible sans que la population française ne s'appauvrisse. La dette est constituée d'un flux et d'un stock, ce dernier correspondant à l'endettement contracté dans le passé. Certains bons du Trésor sont émis à des taux nuls voire négatifs aujourd'hui, mais ils ne concernent que les nouveaux emprunts. Le stock de la dette recouvre des prêts consentis à des taux d'intérêt bien plus élevés, pouvant atteindre 4 ou 5 %, ce niveau se révélant bien supérieur au taux de croissance de l'économie, compris entre 0 et 1 %. Le taux d'intérêt sur l'encours de la dette étant supérieur à celui de la croissance, l'effet boule de neige existe. Sans être critique, la situation des finances publiques françaises est moins bonne que celle de certains de ses voisins dont l'Allemagne, mais notre pays emprunte à des taux négatifs. Pourquoi ? Les marchés financiers, notamment obligataires, évoluent dans un climat de grande incertitude dans lequel les dettes publiques des grands pays, et notamment celle de la France, représentent une sécurité recherchée. Les investisseurs acceptent donc de payer une prime de risque négative. En outre, l'État français est solide ; malgré l'importance de l'évasion fiscale, le système de recouvrement des impôts fonctionne efficacement, contrairement à celui de la Grèce.
L'Agence France Trésor (AFT) emprunte pour restructurer la dette, c'est-à-dire qu'elle utilise les taux bas pour rembourser plus rapidement, dans la mesure du possible, une dette qui lui coûte cher ; elle cherche à faire tourner la dette – phénomène du roll over – pour diminuer le taux moyen pesant sur la dette. Cette politique rencontre néanmoins des limites, et le coût moyen du stock de dette reste élevé.

On ne rembourse pas plus que 7 à 8 % du stock de dette actuellement, ce qui n'est pas très important.
En effet, et on ne peut que marginalement réaménager la structure de la dette.
Il existe un risque de retournement des taux d'intérêt. Les banques centrales ont baissé les taux jusqu'à 0 %, certains taux étant même négatifs ; elles ont massivement injecté des liquidités pour aider les banques et soutenir l'activité. Les perspectives de redémarrage de l'investissement, de l'emploi et de l'économie étant meilleures aux États-Unis qu'en Europe, la Fed s'engagera dans une politique de remontée des taux en 2016. Elle se montre néanmoins extrêmement prudente à cause du risque de krach obligataire ; en effet, si les marchés anticipaient une montée rapide des taux, ils s'attendraient à une baisse des cours obligataires qui pourrait précipiter une panique contagieuse. La dette obligataire s'avère très élevée dans le monde, elle concerne aussi bien les entreprises privées que les États et représente le plus gros compartiment des marchés financiers. Si le marché obligataire décrochait, les conséquences sur l'économie réelle seraient considérables, car les entreprises et les États se trouveraient contraints de diminuer leurs dépenses. Même si M. Mario Draghi a récemment annoncé la poursuite de la baisse des taux, il faut néanmoins prévoir leur hausse à terme. L'effondrement obligataire n'est pas certain, mais on ne peut pas l'exclure. Mon collègue M. Patrick Artus estime très probable la survenue d'un krach obligataire, alors que je suis moins affirmatif car les banques centrales me semblent disposer des moyens de l'éviter.

Les banques centrales ont injecté beaucoup de liquidités – sans grand effet sur l'économie réelle, d'ailleurs : convient-il d'approfondir cette politique en utilisant la « monnaie hélicoptère » ? Le QE n'empêche pas la dette d'augmenter, et on ne souhaite pas revenir à un circuit du Trésor européen, qui assurerait la solidarité dans la zone euro, le ratio de la dette publique par rapport au PIB pouvant être calculé à son échelle. Que pensez-vous de cette doctrine, qui ne se trouve pas dans les traités européens ?
Je comprends les raisons de l'utilisation de l'instrument du QE, mais nous sommes allés trop loin dans cette voie. Les banques centrales ont injecté trop de liquidités, si bien qu'une trappe à liquidité s'est formée, empêchant l'argent de financer l'économie réelle et alimentant des bulles spéculatives sur les marchés financiers. Les liquidités des banques centrales contribuent à nourrir la bulle obligataire, qui pourrait éclater si elles décidaient d'augmenter les taux d'intérêt.
La monnaie hélicoptère consiste à jeter de la monnaie dans l'économie de manière aveugle et ne constitue pas l'instrument le plus efficace pour stimuler l'activité économique, puisque des agents ne manquant pas d'argent et n'ayant donc pas une forte propension à consommer du revenu supplémentaire bénéficieraient comme les autres d'une telle mesure. Il serait plus opportun que la BCE accepte de financer davantage la dette publique sur le marché primaire et que l'État s'engage à utiliser cette marge de manoeuvre pour financer des projets prioritaires, comme des actions sociales pour les populations les plus défavorisées et des investissements de long terme pour financer la transition écologique.
La Grèce ne remboursera pas sa dette car elle est insoutenable. La plupart des pays européens seront amenés à restructurer leur dette. Nous sommes plusieurs économistes à souhaiter l'organisation d'une conférence européenne sur les dettes publiques pour discuter de l'état, contrasté, de l'endettement des pays de la zone euro. L'objectif est d'alléger le fardeau de la dette pour permettre à certaines économies de redémarrer grâce, notamment, à des investissements publics de long terme. Il faut envisager une restructuration des dettes, celle-ci pouvant prendre un contour différent selon les pays. Les mesures de restructuration vont de l'annulation – qui concernera la Grèce, une partie de sa dette ayant d'ailleurs déjà été annulée –, au rééchelonnement pour allonger les échéances et à la négociation des taux d'intérêt. Les pays de la zone euro pourraient obtenir une restructuration, mais nous n'en sommes pas là aujourd'hui.
Tous les emprunts publics européens relèvent d'une clause d'action collective ; si un pays se trouve en difficulté et souhaite restructurer sa dette, et que la majorité de ses créanciers acceptent la négociation, alors la minorité ne peut pas la bloquer. Des fonds vautours, ne détenant que 1 % de la dette argentine, ont obligé ce pays à passer sous leurs fourches caudines à cause de l'absence de clause d'action collective pour la dette passée, alors que la majorité des créanciers aimeraient renégocier la dette.

J'approuve votre proposition, mais elle nécessite de connaître l'identité des créanciers. Comment fait-on pour savoir qui détient la dette sur le marché secondaire ?
Si vous demandez une renégociation de la dette, les créanciers vont se déclarer, surtout s'ils craignent de perdre de l'argent. L'opacité sur la détention de la dette constitue en effet un vrai problème, mais il n'est pas impossible pour le Trésor de connaître une partie des créanciers. On sait déjà que deux tiers de la dette sont détenus par des investisseurs non-résidents.
Je ne suis pas opposé à l'utilisation de la fiscalité comme instrument d'incitation. Il est utile de prévoir des exonérations fiscales pour favoriser tel investissement ou telle opération. En revanche, les dépenses fiscales servant les intérêts particuliers m'apparaissent illégitimes.
L'évaluation des dépenses publiques, y compris fiscales, se révèle insuffisante en France. Le CIR, dont l'idée est bonne car il faut cibler la recherche, coûte entre 5 et 8 milliards d'euros par an au budget de l'État, et des rapports, rédigés par l'Assemblée nationale et par la Cour des comptes, ont montré qu'une partie du CIR était utilisée à des fins d'évasion fiscale par les entreprises transnationales. L'absence de réforme de ce dispositif apparaît donc incompréhensible ; on mesure le poids des lobbys, mais les élus et le Gouvernement doivent étudier régulièrement l'efficacité des dépenses fiscales, notamment les plus importantes. Or la France est l'un des pays avancés où les dépenses de recherche privée rapportées à la valeur ajoutée sont les plus basses ; le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Japon bénéficient d'investissements privés dans la recherche bien plus dynamiques. Notre dispositif, coûteux, vise à stimuler les dépenses de recherche des entreprises, mais, au bout de plusieurs années, notre pays ne comble pas son retard sur ses concurrents européens en matière d'innovation technologique. La France n'a donc peut-être pas l'instrument approprié de stimulation de la recherche, et nous avons besoin d'un débat public régulier sur les dépenses fiscales.
Une dépense d'investissement de l'État ou d'une entreprise représente une dépense pour l'avenir. Il faut sanctuariser les dépenses d'investissement que l'on considère porteuses d'avenir. La recherche entre dans cette catégorie, de même que l'éducation, les infrastructures ou la transition énergétique. Assainir les dépenses implique de les différencier, de protéger certaines d'entre elles et de régulièrement les passer au crible.
Une personne possédant de hauts revenus et détenant des titres de la dette française bénéficie à la fois de la rémunération de sa créance et d'exonérations fiscales très avantageuses. On doit débattre de ce sujet crucial sur la place publique.
La dette publique s'avère nécessaire et inévitable dans un grand pays moderne comme la France. L'une des missions de l'État consiste à assurer la cohérence intergénérationnelle de la société. Il est normal et sain que le coût de la construction d'un hôpital, d'une route ou d'une école que trois générations utiliseront pendant soixante ans ne soit pas totalement supporté dans le présent ; toutes les générations profitant de l'infrastructure doivent participer à son financement, et l'endettement permet ce transfert intergénérationnel. Cela est fondamental pour la pérennité d'une société, si bien que le discours psalmodiant l'inopportunité de transmettre de la dette à nos enfants ne prend pas en compte l'utilisation de la dépense publique. Le poids des actifs de la France est bien supérieur à celui de sa dette, et notre pays fait partie de ceux ayant les actifs nets publics les plus élevés.
En outre, là où il y a des marchés financiers, on a besoin de la dette publique comme instrument de référence, car il s'agit du placement le moins risqué. Les agents opérant sur les marchés financiers ont besoin de ces taux de référence pour décider d'investir, de prêter ou d'emprunter. Au pied de la courbe des taux d'intérêt, on trouve les taux sans risque, généralement ceux des titres publics. J'ai effectué plusieurs missions dans des pays en voie de développement souhaitant développer leur système financier, notamment obligataire ; je leur conseillais de prendre leur temps, d'attendre d'avoir suffisamment d'émissions pour rendre leur marché liquide et de gérer leur dette publique de façon à ce que ses titres jouent l'indispensable rôle de référence pour l'ensemble du système financier.
Si une crise obligataire profonde atteignait demain les dettes privées et publiques, le système financier entrerait dans une situation très grave car les acteurs risqueraient de perdre le point de référence du taux d'intérêt appliqué à la dette publique. Je ne suis pas un fanatique du développement à outrance des marchés financiers – nous empruntons d'ailleurs trop sur le marché obligataire et pas assez auprès des banques, ces dernières devant être réformées –, mais il faut disposer d'un marché obligataire, celui-ci ayant besoin de la dette publique pour bien fonctionner.

Une harmonisation fiscale dans l'Union européenne (UE) ne permettrait-elle pas de régler en partie la dette française ? La suppression des nombreuses niches fiscales ne contribuerait-elle pas à réduire la dette ?

La part de dette publique détenue par des non-résidents est-elle trop élevée ? Doit-on réinternaliser une partie de la dette ? Doit-on recréer un circuit du Trésor européen afin de diluer le risque – même si le taux restait identique ? Il y a beaucoup d'épargne en France, et l'on pourrait mobiliser cette ressource pour la dette publique.
Il est anormal qu'existent des écarts de fiscalité sur les titres obligataires entre les pays européens ; M. Jean-Claude Juncker et M. Jonathan Hill tentent de nous vendre leur projet d'union des marchés de capitaux (UMC), auquel je suis très opposé. Ils mentionnent à peine la question de l'harmonisation fiscale, alors qu'il s'agit de la première mesure à adopter. Les distorsions pèsent sur les pays ayant une fiscalité élevée comme la France.
Au Japon, l'essentiel de la dette publique est détenu par les résidents, et nous devrions nous inspirer de ce modèle en renationalisant notre dette. Des mesures réglementaires pourraient contraindre les banques et les investisseurs à détenir davantage de dette publique – bien que les banques en aient déjà beaucoup puisque ces titres étant réputés sans risque, leur détention améliore les ratios prudentiels. Sans aller jusqu'au plancher de possession de bons du Trésor imposé aux banques dans les années 1950, on pourrait imaginer une réglementation plus coercitive – ou plus incitative – visant à ce que les banques aient davantage de dette publique. Le système japonais se révèle assez autoritaire : les investisseurs comme les caisses d'épargne et de retraite doivent détenir une partie importante de la dette publique. On pourrait s'inspirer de cet exemple.
Les Français épargnent, en moyenne, une part importante – 16 % – de leur revenu, quand les Américains affichent un taux d'épargne presque nul. On pourrait dire aux Français d'épargner pour financer des projets français. La caisse des dépôts et consignations (CDC) a financé le logement social et les collectivités territoriales grâce au livret A. Il serait opportun de réhabiliter – en la modernisant – cette procédure, afin que l'argent des Français soit utilisé à des fins auxquelles ils adhèrent. Lorsque l'on laisse son argent à la banque ou le place dans un contrat d'assurance-vie, on ignore son utilisation. Attac défend l'idée, encore minoritaire, de création de coopératives et d'institutions publiques ou privées chargées d'utiliser l'épargne pour des actions recueillant l'assentiment de ses détenteurs, comme la création de crèches, d'écoles ou l'aide à la réinsertion. Il faut développer cette épargne solidaire – qui permettrait de renationaliser une partie de l'épargne –, la France accusant un retard en la matière par rapport à l'Italie ou à l'Espagne. L'État devrait s'engager dans cette voie qui correspond à l'intérêt général et l'Assemblée nationale devrait impulser une dynamique en ce sens. Il ne s'agit pas d'instituer une économie dirigiste, mais de favoriser des investissements éthiques qui correspondent à ce que les citoyens souhaitent pour eux, pour leurs enfants et pour leurs collectivités territoriales.
Toutes les banques locales françaises ont disparu ou été rachetées par de grands groupes. L'utilisation des fonds par les banques françaises est totalement opaque. Le législateur pourrait contraindre les banques à rendre des comptes sur l'usage des fonds déposés dans leurs caisses. Dans le cadre de cet assainissement, on pourrait mieux défendre l'utilité du financement de l'État, qui permet à la France de bénéficier d'un système de santé et d'une école publics.
La loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a opportunément obligé les banques à publier les activités, les effectifs et les résultats de leurs filiales étrangères, y compris celles opérant dans les paradis fiscaux. La plateforme des paradis fiscaux et judiciaires, à laquelle participe Attac, vient de publier un rapport pointant les comportements des banques dans ces endroits.
Il conviendrait d'amender la loi de 2013 pour que l'information sur l'activité des banques, et notamment celle de leurs filières étrangères, soit davantage détaillée, cette mesure devant être étendue à l'ensemble des entreprises multinationales. Enfin, l'Assemblée nationale a refusé, lors d'une séance de nuit au cours de laquelle peu de députés étaient présents, de rendre publique la communication de données – ou reporting – portant sur l'activité des banques. Cela est regrettable, car on aurait créé là un fort moyen de pression sur les acteurs financiers.

Je suis d'accord avec vous, mais c'est à l'UE de mettre en oeuvre le reporting, car mettre seuls en oeuvre cette mesure exposerait nos banques et nos entreprises.
Oui, mais le Gouvernement se bat-il au sein de l'UE pour faire avancer ce projet ?

Je l'espère et je pense qu'il agit. Je suis optimiste quant au fait que les choses vont avancer sur ce front.
Nous vous remercions, monsieur Plihon, d'être venu devant notre mission et de nous avoir fourni toutes ces explications.