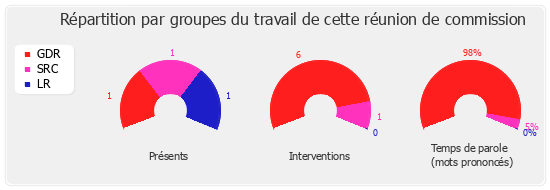Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
Réunion du 29 mars 2016 à 17h00
La réunion

Merci, madame, d'avoir répondu à notre sollicitation.
Merci de donner de la valeur à mes analyses en me recevant. Je commencerai, avant d'insister sur quelques faits saillants, par deux remarques liminaires.
Votre mission s'intéresse à la transparence de la dette publique : celle-ci indispensable, ne peut être complète sans la transparence des finances publiques elles-mêmes, des déficits, des flux de trésorerie… – et cela à tous les niveaux, c'est-à-dire jusqu'au niveau des collectivités territoriales. Ceci est indispensable tant pour l'analyse économique que pour la perception que peuvent en avoir les citoyens et les marchés. Ces données devraient idéalement être disponibles de façon plus fréquente qu'aujourd'hui, et moins décalée dans le temps : cela nous permettrait de mieux comprendre la dynamique de la dette publique. Elles devraient, de plus, couvrir aussi ce que l'on appelle le « passif contingent » de la sphère publique, notamment les garanties. Celles-ci, peu coûteuses en termes maastrichtiens, peuvent en effet devenir des charges très lourdes à long terme. Il ne faut pas non plus oublier les créances et les prêts non performants envers le secteur du Gouvernement, ainsi que les participations et la dette des entreprises publiques – et sur ce dernier point, la France n'est pas mal placée. On parle peu aujourd'hui de cette « para-dette », mais elle pourrait devenir un sujet brûlant, notamment dans le cadre de discussions sur une éventuelle mutualisation des dettes publiques et des engagements des entités publiques au sein de la zone euro.
D'autre part, la transparence de la dette publique implique l'indépendance de plusieurs institutions. Je pense d'abord aux hauts conseils des finances publiques, dont la composition diffère beaucoup selon les pays de la zone euro. Pour que nos partenaires acceptent d'aller plus loin dans la construction de la zone euro, il est indispensable que le Haut Conseil des finances publiques français comprenne des experts vraiment indépendants du ministère de l'économie et des finances comme du monde politique. Je pense à certaines des propositions du rapport des cinq présidents ou à d'autres initiatives institutionnelles majeures qui pourraient concrétiser une véritable Europe budgétaire. Le Haut Conseil doit également disposer d'un accès illimité aux données.
Sont également concernées les institutions nationaux de statistiques comme, en France, l'INSEE, qui devrait être indépendant du ministère de l'économie et des finances, de jure comme de facto. Il faudrait également prévoir une obligation de publication des données concernant notamment les finances des collectivités territoriales, sous un format exploitable – cela peut apparaître comme un détail, mais ce n'en est pas un.

Nous reviendrons sans doute sur la question de l'indépendance, réelle ou supposée – personne n'est jamais vraiment indépendant… Mais je ne comprends pas bien vos remarques sur la transparence des finances des collectivités locales : les données existent, elles sont publiées par la direction générale des collectivités locales (DGCL). Je sais aussi que Jean-Pierre Gorges ne manquera pas d'insister sur le fait que les comptes des collectivités territoriales sont par construction à l'équilibre, et qu'elles remboursent leurs dettes.
Je pensais plutôt, en l'occurrence, à l'harmonisation et à la centralisation de ces données à l'échelle européenne. Certains exemples – celui de l'Autriche, notamment, avec les déboires financiers de la Carinthie – ont montré que les données agrégées au niveau national ne suffisaient pas toujours à analyser la situation de la dette publique dans un pays donné. L'harmonisation et la disponibilité effective de données aussi fines que possible sont indispensables.
Nous reviendrons certainement sur le rôle des collectivités territoriales et l'effort budgétaire de plusieurs milliards par an qui leur est demandé : elles sont dans une situation difficile qui implique une réflexion d'ensemble sur les dépenses publiques mais c'est un autre sujet.
J'en viens aux faits qui me paraissent importants.
La durée de vie moyenne de la dette française est aujourd'hui de 7 ans et 35 jours. Cela me paraît une bonne chose ; la stratégie d'allongement de cette durée a bien fonctionné. Le taux moyen pondéré est historiquement bas, la courbe des taux comportant même une large section de taux négatifs.
Une part non négligeable de la dette est détenue par des non-résidents, ce qui a des inconvénients mais aussi, il faut le souligner, des avantages.
Le marché de la dette d'État française – avec un stock d'environ 1 600 milliards – est l'un des plus gros du monde. La dette française est très liquide, et le marché très profond. C'est un point essentiel, et l'une des responsabilités de l'État dans sa gestion de la dette publique est de préserver ces caractéristiques : elles sont très appréciées des investisseurs, ce qui nous apporte une stabilité financière essentielle qui est même, de mon point de vue, de l'ordre du bien public.
S'agissant de la situation budgétaire de la France, le déficit se réduit mais il demeure important depuis 2009 – année certes exceptionnelle. Nous avons du mal à revenir à des niveaux de déficit qui permettraient de ne pas faire exploser la dette. La crise de 2009 est arrivée après une période plutôt heureuse de consolidation de la dette publique : de 2006 à 2008. L'inertie de la dépense publique est forte – je le dis de façon non normative : c'est inévitable. Il y a dès lors aussi beaucoup d'inertie dans les déséquilibres des comptes publics.
En ce qui concerne la politique fiscale, elle a été marquée par des allégements ciblés sur les entreprises – crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), deuxième étape du pacte de responsabilité, plan d'investissement pour les TPE et PME… Cela a permis de stabiliser – on pourrait dire diminuer, mais on reste dans l'épaisseur du trait – le taux de prélèvements obligatoires. Il demeure élevé, mais il était important de ne pas aller encore au-delà notamment en raison des classements qui nous comparent à nos partenaires de l'OCDE.
Il est un peu plus difficile de parler des dépenses publiques : bien que leur hausse ralentisse depuis 2012, elles continuent de croître. Nous souffrons d'un effet de niveau assez défavorable, puisque le taux de croissance des dépenses publiques entre 2007 et 2009 était élevé ; cela rend la consolidation plus compliquée.

La dette française est très liquide et le marché très profond, c'est entendu, mais n'est-ce pas là seulement l'effet de la politique d'assouplissement monétaire quantitatif (Quantitative Easing, QE) de la Banque centrale européenne ? L'Autriche a récemment rencontré des difficultés pour placer sa dette ; elle n'est pourtant pas dans une situation plus délicate que nous. La BCE nous aveugle-t-elle ?
La BCE aveugle, oui, et le réveil sera extrêmement difficile – même s'il ne se produira pas tout de suite, mais peut-être dans quelques années. La formation des prix sur le marché obligataire, et en particulier le marché des dettes souveraines de la zone euro, est aujourd'hui une anomalie.
La liquidité de la dette française, préexistait à la mise en place du QE. Des pays comme l'Autriche ou l'Allemagne dont les émissions nettes sont moins importantes que les nôtres, peuvent voir se produire un phénomène de raréfaction de leurs titres de dette sur le marché : la demande est forte, mais l'offre très limitée – d'autant qu'il y a une forte rétention de titres. Il y a donc un assèchement de la liquidité, provoqué en partie par les achats massifs de la BCE. Ce n'est pas le cas de la France, en tout cas pas encore : le système européen des banques centrales trouve encore suffisamment de papier français pour mettre en oeuvre le QE tel qu'il a été conçu.
La BCE réfléchit, sans que je puisse dire si elle s'approche d'une décision, à un rééquilibrage des proportions de ses achats de dettes, souveraines et non souveraines – elle achète en effet 88 % de papier souverain mais aussi 12 % de papier para-souverain, c'est-à-dire émis par des agences, par la Caisse des dépôts, par des banques multilatérales… Il s'agit de répondre à ce problème de liquidité dû à l'intervention de la BCE, que vous soulevez très justement : la BCE achèterait alors moins de dette allemande et autrichienne. Il serait néanmoins difficile d'acheter moins de dette à l'Allemagne sans en acheter moins à la France : les quantités sont importantes, et la répartition du capital de la BCE dépend grosso modo du PIB des États membres.
À mon sens, il serait logique d'en arriver à une telle solution : la BCE pourrait se retirer un peu du marché des dettes du monde germanique, l'offre étant moins importante, et elle se retirerait alors aussi quelque peu du marché français. Placer notre dette serait sans doute plus compliqué, mais je ne pense pas que cela provoquerait une forte augmentation des spreads français. C'est un élément à garder à l'esprit, car la situation n'ira pas en s'améliorant au fur et à mesure que la BCE continue sa politique d'achat de titres.

Pourquoi les emprunteurs achètent-ils des obligations dont les taux sont négatifs ? C'est un phénomène aussi nouveau que mystérieux, même pour nos interlocuteurs venus du monde de la finance. Une telle situation peut-elle être durable ?
Pouvez-vous revenir sur le lien entre l'inflation et la dette publique ? Les Américains réussissent à faire repartir l'inflation, mais ce n'est pas notre cas. Ce que l'on aimerait, c'est plutôt la combinaison de taux faibles et d'un petit fond d'inflation…
La question des taux négatifs est en effet complexe, y compris juridiquement. Je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui chez les investisseurs de stratégie d'allocations d'actifs spécifiquement liée aux taux négatifs. Il faut souligner l'importance des anticipations de taux : un investisseur obligataire pense à son coupon, mais aussi à l'évolution de la valorisation du titre, de son prix de marché. Or les investisseurs qui anticipent une baisse des taux – indépendamment du fait qu'ils soient positifs, nuls ou déjà négatifs – considèrent qu'en achetant aujourd'hui, ils auront fait un gain en capital. Dans la gestion d'actifs, ce sont les anticipations qui comptent : tant que les investisseurs s'attendent à voir les taux diminuer, ils accepteront des obligations à des taux négatifs, en raison de ces gains hypothétiques en capital.
Combien de temps dureront ces anticipations négatives ? Nous sommes déjà en territoire très fortement négatif : allons-nous atteindre un plancher ? Le jour où un retournement se produit, les investisseurs auront la perspective non seulement d'un taux négatif, mais aussi d'une perte en capital. Nous nous en rapprochons inévitablement : les investisseurs feront alors un raisonnement différent de celui qu'ils font aujourd'hui et arbitreront différemment entre les possibilités qui s'offrent à eux.
Il faut aussi noter qu'il n'y a plus aujourd'hui – du fait du QE – d'arbitrage entre les différentes dettes souveraines, voire entre les dettes souveraines et celles des entreprises. Toutes les primes de risque ont été écrasées. On pensait que les taux négatifs seraient l'euthanasie du rentier : cela ne s'est pas produit ; le rentier s'en sort très bien, grâce aux anticipations de taux. Mais cela pourrait changer.
Enfin, les contraintes prudentielles sont extrêmement fortes : les gestionnaires d'actifs raisonnent dans une sphère très contrainte.
S'agissant des relations que l'on peut établir entre l'inflation et la dette publique : l'inflation réduit la dette publique et la dette publique peut créer de l'inflation. On aurait alors un cercle que je n'ose pas appeler vertueux – les macro-économistes n'aiment pas l'hyperinflation. Dans le contexte actuel, l'inflation est bien l'instrument le plus efficace pour gérer, à moyen et long terme, notre stock de dette publique : un taux de 3 %, voire 4 % nous aiderait vraiment beaucoup.
Les dynamiques d'inflation et de dette publique ont fait l'objet de nombreux travaux académiques. Aux États-Unis, le ratio de dette publique par rapport au PIB, qui dépassait largement les 100 % du PIB en 1946, a chuté de 40 % en une décennie. Grâce à la croissance, et donc aux recettes qu'elle engendre, les déséquilibres des comptes publics s'ajustent bien plus facilement : il y a bien un rôle favorable de l'inflation. A contrario, dans les phases où l'on doute du potentiel de croissance à long terme, il est difficile de sortir de la dette par la dynamique macroéconomique classique, croissance et inflation. Sommes-nous dans une stagnation séculaire ? Le débat est en cours.
Le chiffre important, c'est bien celui du ratio entre la dette et le PIB nominal : si le second croît plus vite que la première – grâce à l'inflation ou grâce à la croissance réelle –, tout va bien ; la dette se réduit.

La dette se réduit alors en proportion du PIB, mais pas en valeur ! Si les dépenses publiques continuent d'augmenter, le déficit est toujours là, et la dette galope… La clé, c'est le retour à l'équilibre des comptes publics.
Absolument. Depuis que nous avons supprimé les avances au Trésor, seul le marché nous permet d'assurer que les recettes couvrent les dépenses… Le raisonnement que je tenais est valable ceteris paribus, pour un scénario de dépenses publiques donné. Si les dépenses publiques dérapent, on revient à la case départ.

Vous avez, ai-je cru comprendre, mis en cause tout à l'heure l'indépendance de l'INSEE. Comment comprenez-vous son rôle aujourd'hui ?
Il ne faut voir dans mes propos aucun sous-entendu sur les influences possibles de Bercy sur les chiffres données par l'INSEE.
Formellement, il y a un rattachement organique. Or, dans un souci d'objectivité, dans une vision d'audit, c'est une situation qui n'est pas idéale. J'aime faire le parallèle avec les banques centrales, dont l'indépendance a été essentielle pour lancer la zone euro, et aussi avec le Royaume-Uni. Cette indépendance doit être comprise de façon large, non seulement juridique, mais aussi financière.
De façon générale, il serait essentiel pour leur crédibilité vis-à-vis des investisseurs de tous ordres du monde entier que les États émetteurs d'instruments souverains sur les marchés – et pas seulement la France – disposent d'organismes statistiques parfaitement indépendants.
Il existe des moyens simples et efficaces – notamment en termes de séparation organique – de prévoir une indépendance totale.

L'indépendance de la BCE est toute relative, en tout cas en termes de positionnement idéologique… Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que veut dire, en l'occurrence, l'indépendance. De la même façon, le Haut Conseil des finances publiques n'a rien d'indépendant. Pourquoi les universitaires seraient-ils plus indépendants que les politiques ? Le savoir n'est pas détaché des engagements de chacun – qui peuvent différer, même chez les économistes, et c'est bien normal. Cette question de l'indépendance me paraît donc un peu vaporeuse.
On parle, en France, de la dette comme d'une catastrophe ; on nous impose beaucoup de choses au nom de la dette. Or celle-ci est élevée, certes, mais elle est peu ou prou au même niveau que celle des pays comparables, même ceux dont les politiques publiques n'ont rien à voir. Les États-Unis n'ont pas de sécurité sociale, et pourtant ils ont une dette publique bien plus élevée que nous ; la dette du Japon est extrêmement importante. Pourquoi alors une telle pression en France, et plus généralement dans la zone euro ? La BCE – qui n'est ni la Fed, ni la Banque d'Angleterre – est-elle en cause, ou bien sommes-nous effectivement fragiles ?
Je ne suis pas sûr pour ma part que la dette soit uniquement une accumulation de déficits passés. Jean-Pierre Gorges reparlera sûrement des 35 heures, et votre serviteur des niches fiscales diverses et variées… Mais la principale question n'est-elle pas celle d'un déséquilibre macroéconomique ?
La question de la dette publique revêt aujourd'hui une double dimension. D'une part, il y a la question de l'héritage des politiques passées, qu'il faut gérer aujourd'hui : c'est une proportion du PIB, donc finalement une capacité à rembourser. D'autre part, il y a la façon dont cette dette peut, ou pas, se traduire en croissance et plus généralement en bien-être dans le futur.
L'analyse par les uns et les autres – je parle ici de façon très générale – de la situation de chaque pays se fonde, de façon plus ou moins objective et plus ou moins intuitive, sur la perception du respect, ou non, de la contrainte budgétaire intertemporelle. Un État, en fonction des trajectoires de ses dépenses et de ses recettes, des politiques publiques, de la structure de l'économie, peut-il rembourser sa dette aujourd'hui, mais aussi dans dix, trente, voire cinquante ans s'il émet des obligations pour de telles maturités ? Si tout le monde pense que oui, alors il n'y a pas de raisons de s'inquiéter. La dette en soi, vous avez raison, n'est pas un problème ; ce qui peut le devenir, c'est la dette non soutenable.
Il ne faut pas faire table rase du passé, mais il faut partir de la situation actuelle : comment ces conditions initiales nous permettront-elles d'avoir une croissance soutenable et de stabiliser la trajectoire de notre dette, donc de respecter notre contrainte budgétaire intertemporelle ?
Les dynamiques de dette des dix ou vingt dernières années ont été explosives, en France, en zone euro ou aux États-Unis – il y a quinze ans, notre ratio de dette sur PIB était de 40 % inférieur à ce qu'il est aujourd'hui ! Il y a eu une accélération – explicable, notamment par la crise mais le fait est qu'aujourd'hui, les ratios de dette sur PIB sont bien plus élevés qu'hier.
Ne faudrait-il pas lever le tabou qui pèse sur le traitement de la dette héritée du passé, ce que les Anglais appellent la legacy debt ? Ne pourrions-nous pas calculer les ratios de dette qui nous permettraient de respirer, de mener des politiques publiques, d'avoir une croissance soutenable et, en fonction du résultat – 60, 70, 80 % – trouver un mécanisme qui permette de réajuster les compteurs et de repartir avec une dynamique de croissance ? C'est un premier ensemble de questions. Je ne comprends pas que l'on puisse faire semblant de faire l'économie d'une réflexion sur la BCE de ce point de vue. Certains pays de la zone euro ont des ratios de dette sur PIB qui empêchent, on le sait, tout remboursement de la dette, quel que soit le scénario macroéconomique. C'est la question de la dette héritée du passé.
Sur la façon dont la dette s'est composée, et de la dépense excessive qui en est à l'origine, je suis entièrement d'accord avec vous. Quant à la stabilité et au respect de la contrainte budgétaire intertemporelle, les observateurs estiment qu'ils dépendent de nombreux facteurs – priorités des gouvernements mais aussi pressions de marché que la France a eu la chance de ne pas connaître, au contraire de l'Italie par exemple.
Plus de 60 % de la dette est détenue par des non-résidents : c'est un avantage si l'on utilise l'inflation pour réduire sa valeur réelle, puisque ce sont les détenteurs étrangers qui en souffriront le plus ; mais c'est un inconvénient parce que cela nous expose à une certaine volatilité des flux de capitaux.
Les investisseurs considèrent qu'ils pourront continuer à prêter à la France si les dépenses publiques sont faites à bon escient, si elles servent à la construction des institutions – et celles de la France ne sont pas si mauvaises – et à mener de bonnes politiques publiques, notamment en matière de services publics, d'éducation et de santé. Tous ces facteurs, qui définissent un pays comme avancé, non seulement économiquement mais aussi socialement, sont pris en considération par les investisseurs : ce sont ces éléments, à la fois structurels et économiques, qui peuvent rendre soutenable une trajectoire de dette donnée.
Certains pays de la zone euro rencontrent des problèmes de gouvernance, des problèmes institutionnels qui feront que pour un même niveau de dette et une même perspective de croissance, une trajectoire de dette donnée ne sera pas soutenable alors qu'elle le serait dans un autre pays mieux géré. La France, je crois, n'est pas si mal placée que cela. Ce doit être une priorité de préserver ces qualités et cet environnement construit par les générations et les gouvernements successifs.

C'est une discussion sans fin : quelle partie de la dette est due à des dépenses de fonctionnement ? Nous ne sommes pas un pays qui investit beaucoup, 80 % de notre déficit est dû à du fonctionnement.
Vous dites que nos services publics sont bons : cet avis n'est pas partagé par tous, notamment quant aux fonctions régaliennes – la justice ou la police. Mais on est là dans des domaines en partie subjectifs.
Mais qu'est-ce que les Français sont prêts à accepter pour payer cet équilibre ? On parlait des collectivités territoriales, mais elles ont une fiscalité propre : l'eau, les transports, le traitement des ordures sont payés par l'usager… Il y a quelqu'un qui paye ; leurs comptes sont équilibrés car la loi nous y oblige.
Nicolas Sansu et moi avons tous les deux raison : une commission d'enquête a chiffré le coût des 35 heures à 300 milliards, et la retraite à 60 ans a coûté cher, mais les niches fiscales de l'impôt sur le revenu nous coûtent 86 milliards, et il y a aussi les exonérations de TVA, par exemple… Nos dépenses fiscales sont donc très importantes et personne n'ose assurer la cohérence de notre système. Le problème est essentiellement politique, puisque l'on pourrait calculer facilement le montant de TVA qui nous mettrait à l'équilibre – une étude soulignait récemment que l'une des particularités de la France est de ne pas utiliser la TVA comme un instrument d'équilibre budgétaire.
En 1981, le passage de 40 à 39 heures a coûté cher, mais on jouait avec l'inflation et la dévaluation… L'avènement de l'euro a cassé ces outils traditionnels ; à partir de 2002, l'Allemagne amène de la flexibilité et nous apportons de la rigidité.
Aujourd'hui, il y a plusieurs scénarios : certains pensent que la croissance va revenir, mais personne ne sait comment, puisque l'on ne veut ni rogner sur des avantages, ni augmenter l'impôt ; aux extrêmes, certains disent qu'il ne sert à rien de rembourser la dette, que notre argent est bien dépensé et que rechercher l'équilibre budgétaire, c'est inutile ! Ma question porte sur un scénario plus brutal, sur lequel je n'ai pas entendu les journalistes interroger le Front national : sortir de l'euro nous permettrait à nouveau de jouer avec la monnaie ; mécaniquement, cela créera de l'inflation et la dette s'amenuisera.
Quelles seraient selon vous les conséquences pour notre dette d'une sortie de l'euro en 2017 ?
En matière de comptes publics, les arbitrages, en l'absence de la possibilité de dévaluer la monnaie, sont bien sûr plus douloureux. Je suis assez d'accord avec ce que vous disiez sur la composition de notre déficit. Je veux surtout insister sur le fait qu'on aurait tort de croire que malgré le désinvestissement, ou le ralentissement de l'investissement public, nous continuerons d'avoir un stock de capital public performant. C'est une erreur majeure que nous avons faite, que nous faisons encore et qu'il faudrait cesser de faire.
Faut-il alors réduire d'autres dépenses ? Je suis portée à le penser. Mais une vraie stratégie d'investissement public est quoi qu'il en soit nécessaire, au niveau national comme au niveau européen. Nous disposons pour ce faire d'outils budgétaires, mais aussi de la Caisse des dépôts, par exemple.

Vous avez déclaré récemment que le plan Juncker était une réussite, ce qui nous paraît étrange. Un rapport sur les PIA vient d'en souligner les limites et une mission d'évaluation et de contrôle de notre Commission sur les PIA relatifs à la transition énergétique va, sans doute, dans le même sens.
Le Gouvernement se targue d'avoir réduit le déficit de 6 milliards de plus que les prévisions, mais les investissements des collectivités locales ont diminué de 4,7 milliards. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose…
Nous sommes entièrement d'accord. Le diagnostic est unanime : c'est une erreur séculaire, surtout quand les taux d'intérêt sont si bas ; nous aurions les moyens de faire autrement.

On a coupé au mauvais endroit ! Et maintenant, dans les négociations des contrats de plan entre l'État et les régions : on nous demande de lancer tous les projets engagés… Mais c'est trop tard.
Quant au plan Juncker, il est très jeune : les institutions sont en place depuis quelques mois à peine. Plus de 50 milliards ont été engagés depuis mai 2015, et la montée en puissance se fait.
Ce plan comporte des éléments très concrets : il ne faut pas prêter attention seulement au volume des investissements, mais aussi à leur composition. Il y a des prises de risque nouvelles de la Banque européenne d'investissement (BEI) et de ses co-investisseurs, et cela devrait donner des résultats intéressants. Certes, 315 milliards à l'échelle européenne, ce n'est pas très important, mais c'est mieux que rien. La BEI finance ainsi une laiterie coopérative dans le Cotentin qui pourra exporter du lait en Chine, une usine de retraitement du titanium en Auvergne… Ce sont des choses concrètes. Il faut être inventif et réussir à faire financer de tels projets. La machine du plan Juncker semble lourde de l'extérieur mais les résultats, j'en suis persuadée, seront intéressants.

Revenons à l'euro, car je crois que le débat sur une éventuelle sortie de l'euro sera essentiel pour les élections de 2017.
La dette publique est détenue à 60 % par des non-résidents, mais le reste de l'économie se finance aussi hors de notre territoire. Sur la qualité de la signature française et sa résilience, il ne faut pas pécher par orgueil même si aujourd'hui, tout se passe très bien.
Que se passerait-il si la zone euro disparaissait ? La réponse à l'échelle de la zone euro est sans doute moins clémente que la réponse pour la France, ce qui apporte de l'eau au moulin des positions des extrêmes sur ce sujet. Les pays de la zone euro bénéficient aujourd'hui d'une compression de leurs coûts de financement et de l'externalité positive de la stabilité de l'Allemagne sur les marchés internationaux : la disparition de ces facteurs provoquerait des ajustements de change et d'inflation, mais aussi des modifications dans l'accès des uns et des autres au marché.
Si un État ne peut plus se financer sur les marchés extérieurs, il est asphyxié – on l'a vu en Grèce, mais la Grèce est finalement demeurée dans la zone euro. La France serait peut-être moins asphyxiée que d'autres pays, notamment de la zone euro, mais elle en ressentirait les effets ; il faudrait alors aller chercher l'épargne des Français pour financer l'économie. En vase clos, avec une monnaie qui se déprécie et une inflation qui déprécie la valeur des dettes, la question de l'allocation de l'épargne des Français, donc de la planification des flux de dépenses et de revenus sur le cycle d'une vie, en particulier du financement de leurs retraites, deviendrait vite très compliquée. Cette instabilité pourrait être très déstructurante pour la société française, qui souffre déjà de clivages intergénérationnels très forts comme le montrent les discussions sur les réformes des retraites ou en ce moment celles sur la loi travail, mais aussi la simple observation de la répartition intergénérationnelle des richesses.
Dans un environnement où la monnaie cesserait d'être stable, où nous cesserions d'appartenir à une zone monétaire stable, nous aurions peut-être quelques mois d'euphorie mais les lendemains seraient très douloureux.
La France n'est pas le pays dont le déséquilibre de la balance commerciale est le plus grand ; nous sommes dans la moyenne, donc nous ne subirions sans doute pas l'ajustement le plus fort, l'inflation la plus importante, mais le raisonnement demeure le même.

Une réinternalisation de la dette pourrait-elle être utile ? La BCE le fait à l'échelle européenne. Serait-il intéressant de recréer un circuit du Trésor européen ?
Tout dépend de notre ambition. Dans le cadre d'une ambition européenne, il est très difficile de réinstaurer une gestion de la trésorerie de l'État par un équivalent des avances au Trésor. L'une des pierres d'angle du traité de Maastricht est justement la prohibition du financement monétaire des États.
Absolument. Aujourd'hui, le miracle, c'est que nous faisons du financement monétaire à grande échelle ! La BCE a déjà racheté plus de 110 milliards de dette française, et en rachète tous les mois 10 milliards supplémentaires. La dette va être ainsi transférée vers le bilan de la Banque centrale européenne ce qui laisse toutes les options sur la table. Nous disposons là d'un outil bien plus puissant que n'étaient les avances au Trésor.
Les Allemands sont d'accord pour transférer sur le bilan du système européen des banques centrales, de l'émetteur monétaire, des points entiers de PIB… Nous sommes dans la situation où les dettes souveraines excessives de la zone euro, mutualisation ou pas, pourraient être absorbées par la banque centrale de la zone euro – doucement, par l'inflation, ou plus brutalement par un ajustement de la valeur nominale de ces dettes. Ceci est beaucoup plus efficace que le circuit du Trésor.

Autrement dit, même avec un ratio de dette par rapport au PIB de 95 %, on désensibilise la dette de manière considérable.
Je ne plaidais pas pour une monétisation de la dette. J'insistais seulement sur la nécessité du pragmatisme et de la clairvoyance sur ce qui est en train d'être fait. Je suis pour ma part plutôt réticente à la monétisation et à un effacement de la dette sans réflexion. Agissant ainsi, la BCE n'incite pas des pays comme le nôtre à changer leurs habitudes et à cesser de laisser filer leur dette.
Mais les faits sont là : la politique monétaire actuelle de la zone euro est immensément plus puissante que toutes les petites recettes que nous pourrions inventer. Si l'on se retire de la logique de marché, on retire la logique budgétaire de la gestion des dépenses publiques et on en revient malgré tout à des contraintes beaucoup moins intertemporelles. Si nous avons l'intelligence de traiter la situation avec raison en France et avec pragmatisme en Allemagne, nous pourrons peut-être améliorer la situation – même si je ne peux qu'être d'accord sur le fait que les débats seront difficiles en 2017.
La réponse pourrait être très longue, mais nous sommes en plein dedans, je crois. Les stocks de dette, publique ou privée, sont extrêmement élevés. Les niveaux d'endettement, dans la sphère publique dans les pays avancés et dans la sphère privée dans les pays émergents, sont sans précédent. C'est une situation nouvelle.
Parce que nous sommes dans un environnement monétaire où la liquidité est très marquée dans les principales zones monétaires du monde – États-Unis, Japon, zone euro, Royaume-Uni –, les rendements obligataires n'ont plus beaucoup de sens ; le lien avec la croissance, notamment, est perdu. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons tant de mal à estimer la croissance potentielle.
Il y a aussi une bulle obligataire au sens où les primes de risque sont totalement écrasées. Cela rend l'allocation d'actifs très délicate. Les bilans en train d'être construits sont extrêmement vulnérables au moindre retournement des niveaux de taux et des valorisations de ces stocks monumentaux.