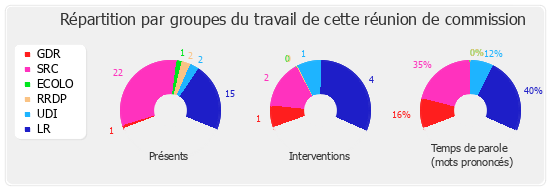Commission des affaires étrangères
Réunion du 4 mai 2016 à 9h30
La réunion
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Je vous remercie vivement, monsieur l'ambassadeur, de votre présence avec nous ce matin. Vous avez été nommé envoyé spécial du ministre des affaires étrangères pour la préparation de la conférence internationale de relance du processus de paix au Proche-Orient.
Le ministre des affaires étrangères réunira à Paris, le 30 mai prochain, une réunion préparatoire à cette conférence internationale. J'en rappelle les objectifs : réaffirmer l'attachement de la communauté internationale à la solution des deux États ; réfléchir à un ensemble de garanties et de mesures incitatives que la prochaine conférence internationale pourrait présenter – vous nous donnerez, je l'espère, des précisions sur ce point ; établir une méthode et un calendrier pour cette conférence. Pouvez-vous nous préciser quels pays ont été invités à cette réunion du 30 mai ?
Le Quartet n'a guère fait la preuve de son efficacité dans le règlement du conflit, pour ne pas dire qu'il a beaucoup déçu. Il a été chargé de rédiger un rapport. Comment évaluez-vous son implication dans la définition des garanties et des mesures incitatives ?
Dans la mesure où l'initiative française vise aussi à promouvoir un changement de méthode, comment l'Union européenne se prépare-t-elle à jouer un rôle dans le processus de paix ? Sentez-vous une volonté politique forte du côté des responsables de l'Union européenne, en particulier de la haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, mais aussi des États membres qui sont principalement impliqués dans ce dossier ?
Quel est le degré de mobilisation des autres partenaires ? Quel est, notamment, l'état d'esprit des pays arabes qui participeront à la conférence ? Le soutien des États de la région est, évidemment, crucial. Qu'en est-il du côté américain ? L'administration américaine a fait savoir qu'elle ne prendrait aucune initiative sur le processus de paix avant la fin du mandat du président Obama.
Deux visites des autorités françaises, celle du ministre des affaires étrangères Jean-Marc Ayrault, puis celle du Premier ministre Manuel Valls, sont programmées en mai en Israël et en Palestine. Notre commission a reçu hier l'ambassadrice d'Israël à Paris, qui nous a confirmé les réactions de son pays à l'initiative française. Sans y opposer une fin de non-recevoir, le premier ministre Benyamin Netanyahou a déclaré que « la meilleure voie pour parvenir à une solution du conflit passe par des négociations directes et bilatérales ». C'est une évidence et cela n'empêche pas, de notre point de vue, la tenue d'une conférence internationale. Du côté palestinien, la délicate succession de Mahmoud Abbas et l'impasse dans laquelle se trouve la réconciliation interpalestinienne ne facilitent pas les discussions. Tel est le cadre général.
Merci, madame la présidente, de m'avoir invité. Je vais essayer de vous expliquer en quelques mots l'objectif de cette initiative, son calendrier et la manière dont nous espérons procéder.
Cette initiative repose sur un double constat, que partagent d'ailleurs tous nos partenaires, y compris nos partenaires israéliens, ce qui est déjà, en soi, une bonne chose. Premièrement, la situation sur le terrain se détériore de plus en plus, la violence grandit et, si la communauté internationale ne donne pas le sentiment qu'elle souhaite se saisir de ce dossier, il y a un risque d'escalade et de glissement vers davantage de violence encore. Deuxièmement, pour toutes les raisons que l'on connaît, le processus de paix est, pour le moment, enlisé. Plus grave encore peut-être : par-delà les efforts menés par les Américains ou par d'autres, avec tout ce qui se passe sur le terrain, notamment la progression de la colonisation israélienne, tous ceux qui s'occupent de ce dossier ont le sentiment que la solution des deux États est en train de reculer, voire de s'évanouir. Or, en réalité, en dépit de tout ce que l'on peut raconter ici ou là, il n'y a pas d'autre option : la solution d'un État unique paraît très peu réaliste ; la plupart de nos partenaires n'y croient guère, même du côté israélien. Dès lors, tout le sens de l'initiative française, c'est de redonner à la solution des deux États une dynamique propre qui semble aujourd'hui manquer.
En termes de procédure, ainsi que vous l'avez indiqué, madame la présidente, notre idée est de travailler en deux étapes : une réunion initiale le 30 mai autour d'un certain nombre de ministres que M. Ayrault a invités, puis, sur cette base, un processus avec des groupes de travail qui seront probablement mis en place après le 30 mai, lequel déboucherait sur une conférence finale avant la fin de l'année, à l'occasion de laquelle on dégagerait une sorte de consensus entre les participants.
Nous commençons avec un groupe de pays que nous ne souhaitons pas trop nombreux, car nous voulons que cette conférence soit efficace. Nous avons lancé une vingtaine d'invitations, tout d'abord aux quatre autres membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi qu'aux membres du comité de la Ligue arabe chargé de s'occuper plus directement du processus de paix, à savoir l'Égypte, le Maroc et la Jordanie, auxquels nous avons associé l'Arabie saoudite compte tenu du rôle qu'elle avait joué en 2002 dans le lancement de l'initiative de paix arabe ou « plan de Beyrouth ». Nous avons aussi convié un certain nombre d'autres pays : le Japon, qui exerce actuellement la présidence du G7 ; l'Indonésie, qui vient d'accueillir un sommet de l'Organisation de la coopération islamique sur le problème israélo-palestinien ; la Norvège, qui joue un rôle important en matière d'assistance économique et qui copréside le comité de liaison ad hoc chargé de coordonner l'aide à la population palestinienne. Nous avons ajouté quelques pays européens en raison du rôle qu'ils jouent : l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Suède, ainsi que la Pologne, compte tenu de la position prise par le groupe de Visegrád. Inutile de vous dire que d'autres pays européens ont immédiatement demandé à participer. Nous sommes en train de voir si nous pouvons élargir un peu le format, mais nous voulons, encore une fois, lui conserver un caractère relativement restreint.
Par la suite, nous entendons, d'une part, ouvrir le processus à tous ceux qui souhaiteront participer, que ce soit aux réunions des groupes de travail ou à la conférence finale, et, d'autre part, bien sûr, faire participer les deux parties prenantes, Israël et l'Autorité palestinienne. Pour la réunion initiale, nous avons souhaité réunir les représentants de la communauté internationale sans les deux parties. Celles-ci ont d'ailleurs assez facilement accepté ce principe.
Comment nos différents partenaires ont-ils réagi ?
Commençons par les deux parties concernées, Israël et l'Autorité palestinienne. Mahmoud Abbas et toute son équipe soutiennent très fortement notre initiative. Ils ont déclaré eux-mêmes qu'ils voulaient travailler en bonne entente et se coordonner avec nous. De ce fait, ils ont décidé de reporter à plus tard l'examen du projet de résolution condamnant la colonisation israélienne qu'ils ont déposé au Conseil de sécurité et qui rencontrait une assez forte résistance d'un certain nombre de partenaires. Ils se détermineront à la lumière des progrès de l'initiative française.
Pour leur part, les Israéliens ont, à ce stade, une position d'attente. On ne peut pas dire qu'ils manifestent un immense enthousiasme à l'égard de notre initiative. Ainsi que vous l'avez indiqué, madame la présidente, ils sont soucieux de préserver la négociation bilatérale directe avec l'Autorité palestinienne. Ils craignent que, à travers notre initiative, nous ne réintroduisions une dimension multilatérale qui les préoccupe. Nous leur avons fait valoir qu'il y a déjà eu, dans le passé, des interventions multilatérales, ne serait-ce qu'à travers toutes les résolutions qui ont été adoptées par le Conseil de sécurité depuis la résolution 242 de 1967, et que notre objectif était non pas d'empêcher les négociations directes – même l'Autorité palestinienne estime qu'elles sont nécessaires pour entrer dans un certain nombre de détails de ce que pourrait être le statut final –, mais de réaffirmer les grands termes de référence d'un accord de paix. Il s'agissait pour la communauté internationale de se rendre utile et de remettre en selle l'ensemble du processus de paix et la solution des deux États, à travers un ensemble d'actions – assistance économique, garanties de sécurité, mesures de désescalade – qui rétabliraient un début de confiance sur le terrain et redonneraient un caractère opérationnel à l'initiative de paix arabe de 2002. Pour le moment, les Israéliens attendent de voir quelles vont être les réponses de nos partenaires et comment le processus va s'engager avant de nous donner davantage d'indications sur leur position.
Les représentants du Quartet étaient un peu méfiants à l'égard de notre initiative, car ils avaient le sentiment que nous allions, en quelque sorte, les marginaliser. Nous avons indiqué que notre intention n'était pas du tout celle-là, mais, au contraire, de tirer parti du rapport qu'ils doivent en principe fournir avant la fin du mois. Nous avons donc souligné qu'il pouvait y avoir un enchaînement assez naturel entre leur rapport et notre propre réunion de la fin du mois : nous pourrions reprendre un certain nombre des recommandations qu'ils pourraient faire et voir, à partir de ce moment-là, comment avancer tous ensemble.
Les partenaires européens soutiennent notre initiative, avec des degrés variés d'enthousiasme. Il y a quelques semaines, le ministre s'est exprimé sur ce sujet au Conseil des affaires étrangères et a obtenu un accord de principe de tous les partenaires. Nous allons donc de l'avant, en les tenant informés. Pour ma part, je suis intervenu à Bruxelles devant le Comité politique et de sécurité (COPS). Ainsi, nous parlons avec tous ceux qui souhaitent nous entendre.
Nous parlons aussi beaucoup avec les Russes, que nous sommes allés voir. En tant que membre du Quartet, statut important à ses yeux, la Russie était, elle aussi, un peu inquiète. Nos efforts pour dissiper tout malentendu ont été, je crois, utiles. Comme beaucoup d'autres, les Russes attendent la réaction des Américains.
Le problème est en effet de savoir ce que ceux-ci vont faire avec le processus de paix pendant les derniers mois de l'administration Obama : prendront-ils une nouvelle initiative ? Vous avez rappelé, madame la présidente, que le président Obama lui-même avait émis quelques doutes à ce sujet. Lors des discussions que nous avons avec eux, nous sentons néanmoins une certaine frustration, les efforts de John Kerry n'ayant pas pu aboutir, et une volonté de voir si, à travers notre initiative, il peut y avoir une manière, au minimum, de laisser un testament, voire de favoriser un consensus de la communauté internationale autour d'une nouvelle ligne d'action possible. Nous en saurons davantage à l'occasion de la visite de John Kerry lundi prochain à Paris. Nous allons essayer de leur donner un peu de confiance dans notre initiative et voir comment nous pouvons travailler ensemble.

Vous venez d'évoquer le positionnement des Américains dans ce dossier : dans le contexte préélectoral qui est le leur, ils sont un peu en stand-by. Comment analysez-vous cette situation ? Est-ce un avantage pour d'autres initiatives telles que celle de la France ou bien est-ce, au contraire, une difficulté majeure qui va nous empêcher d'avancer dans le cadre de notre initiative ?
Quelle est l'influence de la situation au Liban sur le problème israélo-palestinien ? On sait toute la fragilité de ce pays, le poids des réfugiés qu'il accueille, l'influence déterminante du Hezbollah, qui provoque, par ricochet, un durcissement de la position israélienne.

Quels sont les points de blocage majeurs dans ce dossier ? Est-ce la question des réfugiés ou bien celle des colonies ?
La reconnaissance de l'État palestinien par la communauté internationale ne serait-elle pas de nature à faire avancer les choses ?
Pourquoi associez-vous autant d'États dans toutes ces démarches ? Quelle sera la cohérence de la « communauté internationale » ?

Vous avez indiqué que la solution des deux États paraissait reculer. C'est un doux euphémisme : depuis plusieurs années, on sent bien que l'on se dirige irrémédiablement vers une non-solution. Ma question rejoint celle de M. Myard : quels sont les points durs du point de vue des Palestiniens et de celui des Israéliens ?
Y a-t-il un changement de doctrine dans la diplomatie française ? M. Fabius avait indiqué que l'on donnerait une dernière chance à la négociation et que, si elle n'était pas saisie par les deux parties, le Gouvernement français reconnaîtrait l'État palestinien. D'après les dernières déclarations de M. Ayrault, il semble que cette possibilité ne soit plus envisagée. Qu'en est-il ?

La solution des deux États est, avez-vous dit, en train de s'éloigner. Selon l'ambassadrice d'Israël, que nous avons reçue hier, la faute en incombe à Mahmoud Abbas, qui refuse de se mettre autour de la table. Est-ce vrai ? Pouvez-vous nous le confirmer ? Ou bien pensez-vous qu'un dialogue direct entre Israël et Mahmoud Abbas est possible ?
Quel est votre sentiment, d'une part, sur la question des colonies – que les Israéliens qualifient d' « implantations » – et, d'autre part, sur le problème du mur de séparation ?

Ma question rejoint celle de M. Asensi. Le précédent ministre des affaires étrangères, M. Laurent Fabius, avait imaginé une chronologie qui consistait à organiser une conférence internationale en espérant qu'elle débouche sur une solution, mais en ayant annoncé au préalable que, en cas d'échec de la conférence, la France reconnaîtrait l'État de Palestine. Cette démarche présentait l'intérêt d'encourager les parties, notamment les Israéliens, à prendre l'initiative de la France au sérieux. J'aimerais obtenir une clarification : la France dit-elle toujours qu'elle reconnaîtra l'État de Palestine si la conférence échoue ou si elle n'est pas organisée ? Ce point est-il mis en avant aujourd'hui par la diplomatie française, par votre voix ou par tout autre canal ?

Nous nous posons tous la même question : cela va-t-il être une conférence pour rien ? Chaque fois que l'on est proche d'une solution, l'une ou l'autre partie fait que l'on n'aboutit pas. La question se pose en effet d'avoir, à un moment ou à un autre, une discussion bilatérale. Monsieur l'ambassadeur, vous travaillez dans le domaine des affaires étrangères depuis trente-neuf ans ; j'espère que l'on pourra avancer sérieusement sur ce dossier avant que vous ne terminiez votre carrière ! (Sourires.)

Monsieur l'ambassadeur, je crains que, malgré vos efforts, cette conférence n'aboutisse à rien. Je ne vois pas comment quoi que ce soit pourrait avancer tant qu'il n'y aura pas un semblant d'unité entre le Fatah et le Hamas. Toute initiative diplomatique ne devrait-elle pas commencer par là ?

Nous avons tous le sentiment que, si cela peut réussir, c'est grâce à vous, monsieur l'ambassadeur !
Je suis de nouveau en piste, mais, paradoxalement, ma carrière est déjà terminée. En tout cas, j'essaierai de faire de mon mieux.
Vous avez raison, monsieur Baumel : les États-Unis sont en stand-by. Ils nous disent d'ailleurs volontiers que, dans la période précédant la désignation des deux candidats et l'élection proprement dite au début du mois de novembre, il leur est difficile de prendre des initiatives publiques spectaculaires. En revanche, contrairement à ce que l'on croit parfois, entre l'élection elle-même et la fin du mandat du président sortant au mois de janvier, il y a deux mois qui peuvent être très utiles, y compris sur ce dossier : c'est au cours de cette période que le président Clinton a annoncé publiquement les paramètres qui portent son nom, lesquels constituent toujours une base de référence précieuse. Plus intéressant encore : c'est aussi à cette époque de l'année, en 1988, que le président Reagan a reconnu l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), après quoi James Baker a déployé une diplomatie très active qui a débouché sur la conférence de Madrid en 1991. Certes, les choses ont sans doute été facilitées par le fait qu'une administration républicaine succédait à une autre, le président Reagan passant le témoin à son vice-président, George Bush père.
Vous avez posé une question fondamentale : les Américains trouvent-ils ou non une utilité ou un intérêt à notre initiative ? Je dois vous avouer qu'il est difficile d'y répondre pour le moment. Nous y verrons un peu plus clair à la faveur des discussions que nous aurons avec eux. Je crois qu'ils sont vraiment dans une phase de réflexion – brainstorming. Encore une fois, ils se demandent surtout s'il y a encore une marge de manoeuvre avant la fin de la présidence Obama et si, avec notre initiative, il est possible de réussir ce qu'ils n'ont pas réussi à l'époque, c'est-à-dire de dégager une forme de consensus de la communauté internationale autour de la solution des deux États. Il y a déjà de nombreux éléments ; il faut simplement les actualiser et, surtout, leur donner une nouvelle dynamique. À la différence de la médiation menée par John Kerry, qui était purement américaine, l'initiative française peut rassembler les pays arabes, l'Asie, l'Europe et d'autres partenaires encore. Tel est son intérêt et ce qui peut faire sa valeur ajoutée aux yeux des Américains. Encore une fois, nous allons continuer à discuter avec eux et nous verrons où nous allons.
Le Liban est un partenaire important. Il demande à être associé étroitement à notre processus. Nous n'avons pas pensé inviter le Liban pour le moment, car il ne fait pas partie du comité de la Ligue arabe qui s'occupe de ce dossier. Mais nous sommes bien évidemment en contact avec les Libanais et nous les associons.
Au-delà même du processus de paix, la question plus générale qui va se poser à terme est celle de la sécurité de toute la région : de la Syrie, de l'Irak, du Liban, du Yémen et d'autres pays encore. Cette question revient en permanence, et tous nos partenaires arabes la mettent sur la table assez naturellement. Nous faisons face, au fond, à un problème général de sécurité dans la région, de confrontation avec l'Iran pour certains de ces pays, de sécurité intérieure dans beaucoup de ces pays et de radicalisation des sociétés dans tous ces pays. Ce problème extrêmement délicat doit être traité à travers une grande conférence et des relations de pays à pays.
Vous m'avez interrogé, messieurs Myard et Asensi, sur les points durs. Si l'on considère le processus de paix avec un peu de recul historique, il y a cinq ou six points fondamentaux pour le statut final, en particulier le droit des réfugiés, la sécurité, le statut de Jérusalem, les frontières, auxquels le premier ministre israélien a ajouté la nature de l'État d'Israël, en posant la question de son caractère juif – Jewish state. Si l'on prend ces questions une par une, on constate, de manière frappante, qu'il y a eu énormément de progrès au cours des quinze ou vingt dernières années : le président Mahmoud Abbas a déjà dit des choses sur le droit des réfugiés ; un travail considérable a été fait sur le statut de Jérusalem. En réalité, on n'est pas très loin du but. Mais on n'a jamais réussi à aboutir à une solution sur aucun de ces points car, bien évidemment, chacun est lié à l'autre, et on ne pourra les régler que dans le cadre d'un accord global. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans la plupart des négociations diplomatiques.
Malgré tous ces progrès, le manque de confiance entre les deux parties n'a pas permis de traiter le problème dans sa totalité et de déboucher sur un accord. Les « paramètres Clinton », que j'ai mentionnés précédemment, avaient représenté un effort impressionnant en ce sens. Le problème, c'est que la négociation n'a pas pu aller plus loin que la définition de ces paramètres. John Kerry a essayé de reprendre le processus en proposant ses propres paramètres aux deux parties, mais il n'a pas été davantage possible de déboucher sur quoi que ce soit.
L'année dernière, la diplomatie française a essayé de remettre sur la table, au Conseil de sécurité, un projet de résolution sur les paramètres, mais nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout, là non plus. D'une part, la période n'était pas très favorable : nos amis américains, qui étaient en pleine discussion avec le Congrès sur l'accord nucléaire iranien, nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas essayer de faire passer simultanément auprès de celui-ci un deuxième dossier aussi lourd. Nous avons donc laissé tomber cette initiative, en tout cas pour le moment. D'autre part, il était très difficile de trouver un accord sur ces paramètres entre toutes les parties, y compris avec nos partenaires palestiniens, qui trouvaient que nous lâchions trop de lest et faisions trop de concessions pour obtenir un consensus ; en fin de compte, ils avaient eux-mêmes des difficultés à aller de l'avant sur notre projet de résolution.
Si nous essayons de reprendre ce travail autour des termes de référence et des paramètres, nous allons probablement rencontrer les mêmes difficultés. Mais nous allons voir ce que nous pouvons faire, avec le soutien de tous.
À certains égards, on peut en effet penser qu'il y a trop d'États autour de la table, monsieur Myard. Cependant, si nous voulons disposer, à l'issue du processus, d'un « paquet » substantiel, avec des mesures politiques, économiques et en matière de sécurité, ainsi que la relance du plan arabe de 2002, nous avons besoin de tous ces partenaires différents autour de la table. C'est cette « masse critique » qui peut, peut-être, faire la différence. C'est aussi en cela que consiste le changement de méthode : plutôt que de laisser tel ou tel membre de la communauté internationale se lancer dans une nouvelle initiative, nous essayons d'agir de manière solidaire avec d'autres, pour qu'on ait vraiment le sentiment que la communauté internationale prend ce problème à bras-le-corps.
Messieurs Asensi et Hamon, l'idée de Laurent Fabius était en effet d'utiliser la reconnaissance de l'État palestinien comme un levier. Toutefois, nous avons rencontré immédiatement une difficulté : en annonçant que, si cette initiative devait échouer – j'insiste sur ce point –, la suite logique serait la reconnaissance de l'État palestinien, nous perdions de nombreux partenaires qui étaient prêts à « monter à bord », notamment plusieurs pays européens. Compte tenu de ces réticences, nous avons préféré dire deux choses, ainsi que l'a fait récemment le ministre Jean-Marc Ayrault. Premièrement, que la question de la reconnaissance restait entière du point de vue du Gouvernement français – tout le monde est parfaitement conscient que votre assemblée a adopté une résolution sur ce point, mais il nous semble qu'il appartient au Gouvernement de prendre cette décision, souverainement, en fonction de ses mérites propres. Deuxièmement, que nous envisagions le lien entre notre initiative et la reconnaissance de l'État palestinien plutôt de manière positive, c'est-à-dire que, si notre initiative devait, par bonheur, relancer le processus de paix et aboutir à un accord, la reconnaissance de l'État palestinien en serait l'issue naturelle. Elle figure d'ailleurs parmi les points essentiels du plan de paix arabe – que nous voulons remettre à l'honneur –, avec la reconnaissance des frontières, le droit des réfugiés et la cessation de l'occupation des territoires palestiniens. Il nous a semblé plus logique de remettre les choses dans ce sens-là.
Vous soulignez, monsieur Rochebloine, que la solution des deux États s'éloigne. Telle est bien la réalité, en raison notamment – mais pas uniquement – de la politique de colonisation israélienne, avec des colonies qui, désormais, essaiment parfois de manière discontinue, ce qui rend les échanges de territoires et la solution dans son ensemble de plus en plus compliqués. Quand l'État israélien avait décidé de quitter Gaza, il lui avait fallu ramener 6 000 à 8 000 colons à l'intérieur des frontières d'Israël. Lorsque se posera, à l'approche d'un éventuel accord final, la question de l'évacuation d'un certain nombre de colonies de Cisjordanie, en tenant compte du fait que certaines d'entre elles pourraient demeurer en l'état tandis que d'autres devraient être démantelées, le nombre de colons à rapatrier serait supérieur à 100 000, voire à 150 000, selon les estimations faites par les meilleurs spécialistes. Ce travail sera donc extraordinairement difficile. Néanmoins, il faut continuer à avancer dans cette direction, la communauté internationale ayant toujours rappelé de manière unanime que la colonisation était illégale au regard du droit international. Il n'est donc pas question d'abandonner ce principe, lequel fait bien partie des termes de référence dans le cadre desquels nous entendons travailler.
Vous demandez, monsieur Cochet, si cela ne sera pas, une fois de plus, « une conférence pour rien ». Si nous prenons un peu de recul par rapport à l'ensemble du processus de paix, n'oublions pas que certaines conférences ont été des réussites, notamment la conférence de Madrid, que j'ai mentionnée, et les négociations d'Oslo. Certes, les résultats de ces conférences n'ont peut-être pas tous été mis en oeuvre. Notre intention est d'ailleurs de reprendre certaines décisions d'Oslo qui n'ont pas été appliquées et de les pousser plus loin, notamment en ce qui concerne la situation à Jérusalem-Est et l'évolution des trois zones A, B et C. Encore une fois, notre conférence vise à relancer tout ce qui a déjà pu être fait, et bien fait. Nous ne cherchons pas à tout prix à déboucher immédiatement sur un accord de paix. Nous savons que cela prendra plus de temps, car il faut arriver à convaincre les deux parties de se remettre autour de la table, ce qui n'est pas le cas actuellement. Notre objectif est plutôt, ainsi que je l'ai indiqué à plusieurs reprises, de permettre à la communauté internationale de manifester sa volonté de reprendre ce dossier en mains et de proposer des actions extrêmement concrètes pour relancer une dynamique. Si cela encourage les deux parties à se remettre autour de la table, ce sera une bonne chose. Les parties et les partenaires décideront du suivi qui pourra être donné à notre initiative. Encore une fois, nous souhaitons reprendre le problème et avancer étape par étape, un peu de la même manière que dans le cadre des processus de Madrid et d'Oslo, qui avaient prévu d'abord une autorité intérimaire, puis un statut final avec la reconnaissance de l'État palestinien. Instruits par l'expérience, nous savons que, à vouloir trop, on risque de n'aboutir à rien.
Vous avez raison, monsieur Poniatowski : la réconciliation interpalestinienne est un problème essentiel. Il est important de le garder à l'esprit, ne serait-ce que parce que Gaza concentre 40 % de la population palestinienne, constitue un poumon essentiel pour la future économie palestinienne et offre au futur État palestinien un accès à la mer dont il aura grandement besoin. Il y a actuellement des contacts informels et discrets entre le Fatah et le Hamas : d'une part, des discussions directes à Doha ; d'autre part, des contacts plus indirects par l'intermédiaire de l'Égypte, qui négocie avec le Hamas pour essayer de ramener la stabilité dans la zone du Sinaï et de régler le problème de sa frontière avec Gaza. Ces négociations sont difficiles – personne ne fait preuve d'un optimisme démesuré –, mais ont enregistré quelques progrès.
D'autre part, compte tenu du problème général de sécurité dans la région que j'ai évoqué tout à l'heure, d'autres partenaires arabes font pression sur le Hamas et le Fatah pour les ramener autour de la table et les pousser à un accord en vue de former un gouvernement d'union nationale. Nous sommes en contact avec toutes les parties qui négocient directement et suivons cela de très près. Bien sûr, si nous pouvions nous-mêmes aboutir à une réconciliation entre Palestiniens, le cas échéant à travers notre initiative, nous serions les premiers satisfaits. Mais, pour le moment, nous laissons les parties discuter entre elles et les médiateurs qui se sont proposés pour jouer ce rôle continuer leur travail.

Hier, l'ambassadrice d'Israël à Paris a beaucoup insisté non seulement sur la sécurité d'Israël – qui est également l'une de nos préoccupations –, mais aussi, ce qui nous a frappés, sur le fait que les accords d'Oslo ne seraient plus applicables aujourd'hui car les circonstances avaient changé, notamment la nature de la menace. Elle a d'ailleurs complètement minoré la menace que représente Daech, alors que celui-ci risque de s'implanter à Gaza, mais peut-être pas seulement là. En tout cas, on sent un durcissement de la partie israélienne quant à une reprise des discussions.
Du côté palestinien, c'est le découragement. Notre commission auditionnera la semaine prochaine le représentant de l'Autorité palestinienne à Paris. Pouvez-vous nous en dire plus sur le projet de résolution déposé par l'Autorité palestinienne au Conseil de sécurité ? Il pourrait interférer avec notre initiative.
Pouvez-vous nous donner des précisions sur l'attitude la Russie ? Mahmoud Abbas s'est rendu à Moscou le 18 avril dernier.
Dans la période récente, on a eu l'impression que les pays arabes eux-mêmes ne croyaient plus à leur propre initiative de paix, alors que nous fondions beaucoup d'espoir sur celle-ci. Il est d'ailleurs bien dommage qu'on ne l'ait pas reprise au bond lorsqu'elle a été formulée, au début des années 2000.
Vous avez raison de le souligner, madame la présidente : la sécurité d'Israël a toujours été un point essentiel pour le gouvernement israélien, et le devient de plus en plus, avec la question de la reconnaissance de l'État hébreu, ainsi que nous avons pu l'observer dans toutes les négociations récentes, notamment à l'occasion des efforts de médiation de John Kerry.
La nature de la menace a-t-elle vraiment changé ? Oui et non. Sur le terrain, on assiste à une violence de plus en plus individuelle et, donc, de moins en moins contrôlable. Ainsi que certains l'ont fait remarquer, les deux mouvements d'intifada que nous avons connus dans le passé avaient une forme d'organisation, un caractère quelque peu collectif. Aujourd'hui, il s'agit d'individus qui décident, tout d'un coup, d'aller frapper leur voisin ou d'attaquer le premier passant qu'ils rencontrent dans la rue. Cette violence est particulièrement préoccupante, car il est très difficile aux autorités palestiniennes de la contrôler, ainsi qu'elles le soulignent elles-mêmes : elles ne peuvent pas être derrière chacun de leurs citoyens. Elle illustre le profond découragement et la profonde frustration que vous avez relevés, madame la présidente : ces gestes individuels sont commis par des personnes qui disent ouvertement – elles laissent souvent des témoignages derrière elles – qu'elles n'ont plus d'espoir dans le processus de paix et qu'elles ont le sentiment d'être abandonnées de tous, y compris de l'Autorité palestinienne. Ce sont, en quelque sorte, des gestes de désespoir. Cette forme d'insécurité est, en effet, nouvelle.
Quant à l'autre forme de menace que vous avez mentionnée, à savoir le risque de radicalisation et de présence de groupes de plus en plus radicalisés, elle est aussi réelle. Si nos partenaires israéliens tendent à la minimiser, les pays arabes, au contraire, soulignent que ce phénomène existe, tant dans leur propre société que dans les territoires occupés, à Gaza comme en Cisjordanie. Il faudra réagir face à ce phénomène, en ayant le courage de se poser un certain nombre de questions.
Le projet de résolution palestinien condamnant le processus de colonisation – ou « d'implantation » comme le disent les autorités israéliennes – est rédigé en des termes assez habituels, mais le gouvernement et les diplomates américains ont très vite fait savoir aux Palestiniens et aux pays qui appuient leur démarche qu'il serait très difficile pour eux de le soutenir dans le contexte électoral actuel. Dès lors, nous nous retrouvons dans une situation diplomatique assez classique : soit on va de l'avant avec le texte en l'état au risque d'être confronté à un veto américain qui créera encore plus de frustration et de désespoir sur le terrain, soit on essaie de modifier le texte pour le rendre acceptable pour la partie américaine, mais les Palestiniens trouveront alors qu'il n'a plus grand intérêt. C'est pourquoi nous avons, de même que d'autres, incité nos partenaires palestiniens à attendre, à laisser ses chances à l'initiative française et à voir comment elle se développe, avant, éventuellement, de rediscuter ensemble de ce projet de résolution.
Ainsi que je l'ai indiqué, la principale préoccupation russe était que le Quartet ne soit pas marginalisé, que son rôle ne soit pas remis en cause. Il reste un peu de cette inquiétude : si notre initiative allait de l'avant et débouchait sur un suivi ou sur telle ou telle méthode de travail, elle pourrait de nouveau, du point de vue russe, porter atteinte à la légitimité du Quartet. Nous leur avons dit que nous ne ferions rien sans en avoir discuté avec eux et avec tous nos autres partenaires, que la question du suivi était pour plus tard et que l'important était d'abord de réussir la réunion du mois de mai et la conférence finale avant la fin de l'année.
Autre motif éventuel de perplexité à Moscou : les Russes ayant eux-mêmes essayé de réunir une conférence internationale et n'ayant pas pu le faire, ils ont un peu le sentiment que nous marchons sur leurs brisées ; ils se demandent pourquoi nous réussirions là où ils ont échoué. Il faudra prendre en compte cette sensibilité.
S'agissant des pays arabes, il nous semblait que leurs priorités actuelles étaient ailleurs : la Syrie, le Yémen, la Libye, le Liban, les relations avec l'Iran, la sécurité à l'intérieur de leur propre territoire. Or, lors des contacts que nous avons eus avec eux, ils nous ont tous dit – et je crois que ce n'était pas purement du discours diplomatique ou de la langue de bois – que le processus de paix restait un dossier tout à fait essentiel à leurs yeux. Nous allons voir au cours des prochaines semaines si ces paroles se traduisent en actes, mais j'ai le sentiment qu'ils étaient assez sérieux lorsqu'ils soulignaient leur volonté de nous aider, qu'il s'agisse de l'Égypte, de l'Arabie saoudite ou de la Jordanie. Nous allons avoir encore de nombreux contacts avec ces pays ainsi qu'avec d'autres, notamment le Maroc, le Liban et des États du Golfe.

Vous avez évoqué la nécessité d'un changement de méthode pour relancer le processus de paix. Pour sa part, l'ambassadrice d'Israël a insisté hier sur le souhait de son pays de mener un dialogue direct avec l'Autorité palestinienne. D'autre part, elle a laissé entendre que certains pays arabes pouvaient être considérés comme modérés et pourraient apparaître – mais cette partie du message était un peu subliminale – comme des alliés potentiels d'Israël. Ce point de vue vous semble-t-il correspondre à une réalité diplomatique ?

La question de la viabilité économique du futur État palestinien fait-elle partie des points qui sont examinés ?
Il faut bien comprendre notre démarche : personne, et certainement pas les autorités françaises dans le cadre de leur initiative, ne remet en cause le principe et la nécessité d'une négociation directe entre les deux parties, pour la bonne raison que les deux parties elles-mêmes souhaitent mener une telle négociation, y compris les Palestiniens. Ceux-ci sont les premiers à dire qu'il faut une discussion directe avec les Israéliens sur toute une série de sujets, en particulier sur les échanges de territoires, point sur lequel des progrès considérables avaient d'ailleurs été enregistrés grâce au dialogue entre le premier ministre Ehud Olmert et le président Mahmoud Abbas entre 2006 et 2009.
Ce que nous essayons de faire, c'est de créer un cadre politique assez précis avec des termes de référence, à l'intérieur duquel ces négociations bilatérales pourraient se tenir. C'est aussi ce qu'avaient essayé de faire les Américains, mais à titre individuel. Pour notre part, nous cherchons à obtenir l'engagement d'un nombre aussi important que possible de partenaires au sein de la communauté internationale autour de ce cadre. Ce n'est pas une nouveauté : telle est la méthode qui avait été suivie à Madrid, plutôt avec succès. Nous la reprenons afin d'amener les deux parties à travailler ensemble.
Il y a en effet aujourd'hui des contacts entre Israël et certains pays arabes. Les Israéliens s'en prévalent, et nos partenaires arabes ne le cachent pas. Ces contacts tiennent en particulier à l'inquiétude que suscite, chez beaucoup de pays arabes, l'émergence de l'Iran comme nouvel acteur dans la région. Certains d'entre eux nous l'ont dit. Cependant, on note une différence d'appréciation entre les autorités palestiniennes et nos partenaires arabes : si les premières accordent une grande importance à ces contacts avec Israël, les seconds tendent à minimiser leur portée.
Vous avez tout à fait raison, monsieur Destot, de soulever la question de la viabilité économique du futur État palestinien. Dans le paquet de mesures et dans l'accord que nous souhaiterions obtenir, nous voudrions pousser aussi loin que possible le volet relatif à l'assistance économique. Notre idée est notamment de proposer une relation nouvelle et privilégiée de l'Union européenne tant avec Israël qu'avec les Palestiniens, à travers, entre autres, des accords commerciaux, une assistance économique et un partenariat en matière de recherche et d'innovation. Nous réfléchissons aussi à d'éventuels prêts de la Banque européenne d'investissement (BEI) pour aider à la mise en place d'infrastructures entre Gaza et la Cisjordanie, afin de rendre le futur État palestinien aussi viable que possible, ainsi qu'à une aide permettant de créer ce qu'on appelle les « capacités » d'un État de droit, etc. Les Japonais, qui sont déjà actifs en la matière, sont très désireux de nous aider. La Norvège réfléchit à un plan d'aide économique à l'Autorité palestinienne sur deux ans.
Soyons honnêtes : tout cela est possible – nous le faisons avec d'autres pays, certes de taille plus réduite que le futur État palestinien –, mais, pour que cela marche, il faut un accord de paix. Car on aura beau créer des débuts d'infrastructures, des entités économiques et des entreprises nouvelles, s'il y a, tous les quatre ou cinq ans, un nouveau conflit ouvert qui détruit tout, tel que celui qui vient d'avoir lieu à Gaza, on ne s'en sortira jamais : notre oeuvre sera une sorte de toile de Pénélope, perpétuellement recommencée et jamais achevée. Il faut donc un contexte et un environnement propices au développement d'un État viable. Deux éléments sont indispensables à cet égard : la paix et un engagement de la communauté internationale.

Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour votre intervention devant notre commission et pour vos efforts. Il faut vraiment souhaiter le succès de cette initiative.
La séance est levée à dix heures trente.