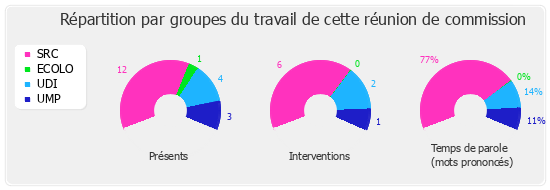Commission des affaires européennes
Réunion du 20 février 2013 à 8h30
La réunion
Audition de M. Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque centrale européenne, gouverneur honoraire de la Banque de France
COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES
Mercredi 20 février 2013
Présidence de Mme Danielle Auroi, Présidente de la Commission des affaires européennes,
La séance est ouverte à 8 h 30
Audition de M. Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque centrale européenne, gouverneur honoraire de la Banque de France

Nous sommes heureux, Monsieur le Président, de vous accueillir aujourd'hui. Votre longue expérience en matière économique et financière donne un intérêt particulier à ce que vous pourrez nous dire sur les récentes évolutions de l'union économique et monétaire et sur les perspectives nécessaires.
Votre gestion de la monnaie unique, à la tête de la BCE, au moment de la crise, a fortement contribué à la sauvegarde de l'euro. La semaine dernière, au cours de la table ronde sur l'approfondissement démocratique de l'Union et l'intégration solidaire qui s'est déroulée en nos murs, l'action de la BCE a été en particulier saluée.
J'évoquerai rapidement les sujets sur lesquels il serait intéressant que vous nous donniez votre sentiment. Il y a, en premier lieu, les récentes étapes franchies par l'Union pour approfondir l'union économique et monétaire, avec les propositions du rapport Van Rompuy au Conseil européen et celles de la Commission européenne ; je pense en particulier aux propositions visant à la mutualisation de la dette et au projet de budget de la zone euro. Un budget de la zone euro vous semble-t-il nécessaire ? Quelles mesures vous sembleraient propres à assurer un véritable gouvernement économique de l'Union, en particulier de la zone euro ?
Notre commission entendrait aussi avec intérêt votre avis sur l'approfondissement démocratique de l'Union, dans le contexte de cette intégration économique et budgétaire accrue. La question du rôle que pourraient jouer les parlements nationaux, de manière complémentaire au Parlement européen, nous paraît essentielle et vous savez combien nous est cher le projet de Conférence budgétaire prévue à l'article 13 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG). M. Christophe Caresche, qui est notre rapporteur sur ce sujet avec M. Michel Herbillon, ne manquera pas de vous interroger à ce sujet.
Quelle est votre opinion sur les décisions du Conseil européen de décembre relatives à la supervision bancaire unique, et notamment sur le rôle prévu dans ce cadre pour la BCE ? Quelle analyse faites-vous des propositions du rapport Liikanen sur la réforme de la structure des banques ? Pensez-vous nécessaire de renforcer la responsabilité pénale des dirigeants des banques, et la transparence ? Peut-on imaginer s'inspirer de la proposition allemande de création d'un délit de mise en danger d'une entreprise du secteur financier ?
Je vous remercie d'avoir mentionné le rôle joué par la Banque centrale européenne, qui a en effet été conduite à prendre dès le mois d'août 2007 des décisions extrêmement importantes, et notamment de donner de la liquidité de manière illimitée pour maintenir la cohésion de la zone euro. Après quoi, toutes les grandes banques centrales européennes ont pris à leur tour des décisions extraordinaires, qui ne figuraient dans aucun manuel, mais qui étaient à la hauteur des défis que devaient relever les pays avancés.
C'est que nous connaissons la plus grave crise d'adaptation structurelle depuis la fin de la seconde guerre mondiale. L'Europe en est l'épicentre parce que la crise financière s'est transformée en crise des risques souverains, puis en crise budgétaire, ce pourquoi aucune complaisance n'est permise, mais la crise est mondiale et tous les pays avancés doivent aussi prendre garde à la valeur de leur signature et à leurs grands équilibres.
Dans ce contexte, il est normal que les Européens se soient interrogés sur leur propre gouvernance - budgétaire et, plus largement, économique. Le plus important est que toutes les décisions aient été prises d'une part pour renforcer le pacte de stabilité et de croissance, d'autre part pour instituer la procédure, jusqu'alors inexistante, des déséquilibres excessifs. C'est le suivi, pour chaque pays, de l'évolution de ses coûts, de ses revenus et de l'inflation domestique nominale, et de leurs conséquences sur le déficit externe et sur la balance des paiements courants.
La France connaît bien cette procédure, puisqu'au cours des années 1980 et 1990 elle avait suivi, pour préparer le passage à l'euro, une stratégie pluri-partisane, très attentive, de suivi de l'évolution des revenus et des coûts, qui a été gagnante. Mais depuis la création de l'euro, il n'y avait pas de règle collective à ce sujet ; elle a été introduite à l'occasion de la crise. Dans mon esprit, l'absence de contrôle de ces évolutions en Grèce, en Irlande et dans d'autres pays a été presque plus importante que le drame budgétaire. Dans une zone de monnaie unique, le suivi de l'évolution des indicateurs de compétitivité est indispensable, sous peine de perdre, année après année, cette compétitivité, que l'on aura ensuite le plus grand mal à rattraper.
La crise a montré aussi qu'il convenait d'en venir à l'union bancaire. Elle a révélé qu'en raison de la fragilité du système financier, les gouvernements et les contribuables étaient malheureusement les seuls capables d'éviter l'effondrement du système financier ; il existe de ce fait une corrélation très étroite entre la qualité de la signature d'un État et celle de l'ensemble des institutions financières de la place. Ce phénomène a été observé aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. Cependant, dans la zone euro, cela conduit à un grand écart entre, d'une part, des États dont le manque de crédibilité atteint par contagion le système bancaire, cette faiblesse aggravant à son tour la vulnérabilité des pays considérés et, d'autre part, des États qui participent d'un cercle vertueux par lequel signature publique et signatures privées se renforcent mutuellement. Cet écart complique considérablement les problèmes nés des défauts de gestion budgétaire et de compétitivité.
C'est pourquoi il faut créer l'union bancaire le plus vite possible. Une décision importante a été prise avec la création d'un organe de supervision européen très proche de la BCE, ce qui est une bonne chose. Mais de vastes chantiers restent à mener, ceux de l'organisation de la résolution des crises et de l'harmonisation des garanties de dépôts.
Je souhaite que l'on parvienne à progresser, comme cela a été décidé, dans ces trois domaines : la coordination budgétaire au niveau européen, la surveillance stratégique lucide des indicateurs de compétitivité et des grands déséquilibres, l'union bancaire enfin. À mesure que l'on avance, il faut renforcer les procédures démocratiques correspondantes.
Je considère aussi que, dans un second temps, il faudra aller nettement plus loin. Cela suppose que nos démocraties politiques y soient prêtes, la nôtre comme toutes les autres, ce qui rend les choses assez compliquées.
S'agissant de l'approfondissement de la démocratie au sein de l'Union européenne, un des éléments nouveaux est la création de la Conférence mentionnée à l'article 13 du TSCG. Je sais les avantages et les inconvénients d'un tel organe, et que certains députés européens la perçoivent comme signalant la réduction de l'influence et de l'autorité du Parlement européen par une instance très étendue dont il sera difficile d'empêcher que les réunions se transforment en grands-messes. C'est incontestable. Cependant, mon point de vue d'ancien responsable « central » m'a permis de constater combien il est important que chacun comprenne bien ce qui se passe au niveau d'un continent entier, et combien il est difficile de parvenir à cette compréhension dans chaque capitale. Aussi, à la réflexion, l'idée de la Conférence me semble très bonne, mais il faudra être attentif à ne pas confondre les responsabilités inaliénables des parlements nationaux et celles du Parlement européen, qui devront encore progresser. Tout bien pesé, il peut y avoir des effets très positifs à la confrontation des points de vue entre les vingt-cinq signataires du traité.
Que je sois conduit à parler du Traité à Vingt-Cinq dit par ailleurs que le concept pertinent, quand on parle de renforcer la gouvernance de la zone euro, est bien celui des « Vingt-Sept moins » et non des Dix-Sept : que l'on s'en tienne aux dix-sept pays de la zone euro ne correspond pas au souhait de ceux de nos partenaires qui, parce qu'ils la rejoindront demain ou après-demain, considèrent avoir toute légitimité à être associés aux discussions.
S'agissant du statut des banques, je constate un certain paradoxe. Si trois rapports ont été publiés - ceux de M. Vickers au Royaume-Uni, de M. Volcker aux États-Unis et de M. Liikanen en Europe -, les Américains et les Britanniques n'envisagent de modifier leur législation qu'à partir de 2017 ou de 2019 ; les rapports Vickers et Volcker ne sont donc que des pré-rapports de beaucoup antérieurs à ce qui sera fait. Et, au sein de l'Union européenne, la France est la première à se lancer, ce qui nous oblige à décider dès maintenant ce que nous allons faire pendant qu'ailleurs en Europe, on réfléchit encore.
Le texte présenté par le ministre des finances m'est apparu bien conçu. Il fallait en effet prendre en considération tous les éléments du dossier et notamment permettre à notre secteur financier de continuer à financer notre économie. J'appelle l'attention sur le fait que la structure du financement des entreprises diffère singulièrement selon les pays : aux États-Unis, plus de 80 % de l'économie est financée par le marché financier et 20 % seulement par les banques. En France, c'est l'exact inverse, le financement bancaire dominant de loin. On peut penser que les entreprises françaises auront davantage accès au marché à l'avenir. Cela signifie que le marché doit fonctionner correctement et c'est à quoi s'est attelé le Parlement français - car si le market making n'est pas efficace, nous risquons de ne pouvoir financer aussi complètement que possible l'économie française et, plus largement, l'économie européenne.

J'aimerais connaître votre opinion sur le rôle que devrait jouer la BCE quant à la valorisation de l'euro. Le taux de change est actuellement de 1,35 dollar pour un euro, ce qui traduit une appréciation de 12 % depuis l'été 2012. Or, un euro trop élevé est considéré comme l'un des principaux coupables du déficit commercial de la France. Le rapport de M. Louis Gallois sur la compétitivité dans l'industrie fixe expressément la fourchette du taux de change souhaitable entre 1,15 et 1,20 dollar pour un euro, jugeant qu'au-delà la compétitivité de nos entreprises est mise en péril. Le Président de la République a réclamé devant le Parlement européen une politique de change, que pourrait mettre en oeuvre la BCE. Il s'agirait d'engager une réforme du système monétaire international visant à ce que les efforts de compétitivité réalisés par un pays de la zone euro ne soient pas annihilés par la valorisation de sa monnaie. L'un des objectifs de la politique de la BCE devrait-il être le taux de change de l'euro ?

En votre qualité de gouverneur de la Banque de France, puis de président de la BCE, vous avez multiplié les arguments en faveur du franc fort puis de l'euro fort. Cette « obsession » de la monnaie forte, même si l'économie était faible, par le maintien de taux élevés, a été souvent contestée ; n'a-t-elle pas été l'une des causes importantes de l'effondrement de pans entiers de certaines économies européennes, dont la nôtre ? La BCE a une autre obsession presque maladive : la lutte contre l'inflation – c'est son péché originel –, au motif que ce serait la meilleure manière de lutter contre le chômage. Alors que la politique menée par les États-Unis a montré que l'on peut être un peu plus souple, la BCE doit-elle continuer de nourrir cette obsession ?

Les statuts et les missions de la BCE sont d'inspiration friedmanienne, ce que traduit une très forte indépendance de la Banque à l'égard de tout pilotage politique. Vous avez pris la responsabilité de passer du rôle « diabolique » que vous incarniez à celui de sauveur de l'euro, mais il s'est agi d'une décision individuelle qui ne répondait à aucune régulation politique. Le diagnostic étant aujourd'hui posé des limites des politiques monétaristes extrêmement rigoureuses, n'est-il pas temps de donner aux statuts de la Banque une orientation nouvelle de défense de la croissance et de la monnaie, en privilégiant une approche qui ne soit pas uniquement restrictive ? Par ailleurs, la compétitivité des économies réelles européennes n'est-elle pas divergente au point que le pilotage monétaire soit voué à d'autres difficultés et que l'euro reste en danger ?

Le poste d'observation exceptionnel qui était le vôtre au moment où l'euro était menacé de disparaître, vous permettra sans doute de nous dire quelle est, selon vous, la capacité de l'Allemagne à accompagner un processus positif pour toute l'Union et pour toute la zone euro alors que plusieurs décisions prises par la BCE, dont la dernière, l'ont été avec l'opposition du représentant allemand. Je rejoins par ailleurs mon collègue Gilles Savary pour vous demander si les écarts de compétitivité entre les pays de la zone euro ne sont pas tels qu'ils rendront la convergence difficile sans transferts importants. Enfin, des décisions positives ont été prises au sujet de l'union bancaire ; mais, à voir la manière dont les discussions s'orientent – des problèmes que l'on pensait tranchés étant à présent remis sur la table, précisément par l'Allemagne –, ne risque-t-on pas l'enlisement ?

Le magazine Le Nouvel Économiste évoquait récemment une étude relative au taux de change de l'euro vis-à-vis du dollar que peuvent supporter l'économie allemande et l'économie française pour rester compétitives ; l'écart est considérable. Je fais donc mienne la question de Gilles Savary. Mais la compétition entre les pays tient aussi aux marchés vers lesquels ils sont tournés – on peut difficilement s'attendre que le tourisme ait la même part dans l'économie de Hambourg que dans celle de la Grèce – et des secteurs économiques. Comment mener une politique monétaire harmonisée avec une telle hétérogénéité, au sein de la zone euro, entre les pays du Nord et du Sud ? S'agissant enfin de la relation entre politique monétaire et économie réelle, où est l'oeuf et où la poule ?

La BCE, forte de la stabilisation des marchés financiers et de l'économie dans la zone euro, devrait, selon les analystes, laisser son taux directeur inchangé. Mais la stabilisation économique ne signifie pas la reprise ; selon l'Office européen des statistiques, la zone euro s'est d'ailleurs enfoncée dans la récession au quatrième trimestre 2012, avec un produit intérieur brut en recul de 0,6 % alors que la plupart des prévisionnistes tablait sur un repli de 0,4 %. Par ailleurs, en six mois, l'euro s'est apprécié de 11 % face au dollar. Dans ce contexte, certains considèrent que la zone euro court un risque si la BCE persiste à ne pas réagir face à cette perte de compétitivité. La zone euro a-t-elle matière à craindre la surévaluation de sa monnaie ? Dans un autre domaine, quelles leçons tirez-vous de la crise grecque et de la manière dont elle a été gérée au sein de l'Union européenne ?
L'un des thèmes abordés de manière récurrente est celui du change. Il n'est facile ni pour les banquiers centraux, ni pour les économies réelles, ni pour les entrepreneurs, ni pour les ouvriers, ni pour les employés de vivre dans un monde de change flottant. Dans ce monde, qui est celui où nous sommes depuis presque un demi-siècle, les fluctuations peuvent être très importantes. Mais permettez-moi de rappeler que, sous la présidence Carter, le taux de change du dollar a été, à son plus bas, d'un peu moins de quatre francs français, et que le dollar a atteint le pic de sa valeur à l'époque de Ronald Reagan : il valait alors plus de onze francs français. La fluctuation a donc été de 1 à 3 et cela, bien avant l'euro. Ce qui valait pour le franc valait aussi, bien entendu, pour le deutsche mark, le florin et les autres monnaies européennes. Ces fluctuations considérables posent d'énormes problèmes à tous car nous sommes dans un univers de très grandes incertitudes.
Depuis l'entrée en vigueur de l'euro, les mouvements de change significatifs ont été les suivants : lors de sa création, un euro valait 1,17 dollar américain ; au plus bas, il a valu 0,83 dollar et 1,59 au plus haut. L'écart est donc plutôt de 1 à 2. C'est bien trop, je le concède, mais bien moins qu'à l'époque du franc. J'ajoute que, depuis l'introduction de la monnaie unique, il n'y a plus aucune fluctuation sur un très vaste marché antérieur, alors qu'elles pouvaient être considérables, entre les monnaies européennes, auparavant.
La stratégie gagnante, celle que l'Allemagne a conduite depuis la fin de la seconde guerre mondiale, est d'avoir une monnaie nominalement forte et réellement compétitive - c'est-à-dire, en réalité, faible. On y parvient en étant très attentif à l'évolution nominale, aux augmentations de coûts – particulièrement des coûts unitaires de production – et en s'efforçant de réaliser le plus de progrès de productivité possible, de manière que l'ensemble des entreprises et notamment les entreprises exportatrices soient compétitives. C'est la stratégie pluripartisane qu'a poursuivi la France au cours des années 1980 et 1990 sous le nom de « désinflation compétitive ». Elle consistait à contrôler l'inflation nationale et os coûts, et nous avions pris l'engagement de ne pas réaligner le franc au sein du mécanisme de change. Cette stratégie a réussi : lors de l'introduction de l'euro, la France connaissait un excédent de la balance de ses paiements courants, contrairement à l'Allemagne qui accusait un déficit pour avoir dû faire face au défi d'une réunification qui avait provoqué une hausse des coûts rendant son économie non compétitive.
Le paradoxe de la situation tient à ce que, après l'introduction de l'euro, les Allemands ont contenu attentivement leurs coûts unitaires de production, regagnant année après année en compétitivité - grâce, aussi, à des réformes structurelles. Nous-mêmes avons considéré que l'objectif central, la stabilité monétaire grâce à l'euro, était atteint, et nous avons un peu perdu de vue le fait que même dans une zone à monnaie unique, il faut toujours faire très attention à sa compétitivité. Le fait est que la législation secondaire du traité de Maastricht ne comprenait pas d'indicateurs de suivi des indicateurs de compétitivité ; ils existent désormais, car ce manque est l'une des grandes leçons de la crise.
S'il existe une grande distance entre la compétitivité des différents pays, c'est que la valeur implicite des monnaies est elle-même assez différente ; la zone euro a une monnaie nominale unique, mais elle n'a pas une monnaie réelle unique. Voilà pourquoi l'Allemagne, dont la monnaie réelle est très compétitive, a des excédents colossaux cependant que nous avons plus de problèmes. Cela se traduit dans l'évolution comparée des coûts unitaires de production. Il en résulte que tous les pays de la zone euro doivent s'engager dans une stratégie de stabilité compétitive pour être sûrs de regagner, année après année, une compétitivité réelle. L'idée d'un « choc de compétitivité » est excellente, mais il faut l'envisager, en quelque sorte, comme le coup de talon nécessaire, puis se remettre à agir comme nous l'avons fait au cours des années 1980 et 1990. En réalité, nous avons une monnaie unique depuis janvier 1987, date du dernier réalignement des taux pivots au sein du système monétaire européen.
Toute la question est de savoir si la perspective, en termes de change, est acceptable pour les 333 millions d'habitants de la zone euro. Cette question doit s'apprécier collectivement, sinon tel pays se dira satisfait et tel autre pas du tout, ce qui aurait un effet troublant pour l'extérieur puisque l'euro ne peut évidemment avoir qu'une seule valeur face au dollar ou au yen. Une réforme du système monétaire international serait probablement souhaitable. C'est une thèse constante de la France, qui a la nostalgie d'un système fixe – lequel n'est pas sans contraintes comme le montre celui dans lequel nous sommes. Mais peut-être ne les avions-nous pas bien perçues.
Vous savez quel ardent partisan j'ai été de la désinflation compétitive, c'est-à-dire d'une monnaie qui soit réellement compétitive, et non, seulement, nominalement forte. J'ai plaidé en permanence pour les deux : une inflation faible et une monnaie réellement compétitive.
La Banque centrale européenne n'est pas « obsédée » par l'inflation. Elle fait ce que les démocraties européennes lui ont demandé de faire. J'observe d'ailleurs que, lorsqu'ils sont interrogés sur ce point, nos concitoyens se prononcent à une majorité écrasante en faveur de la stabilité des prix. Plus, même : ils critiquent la BCE, comme ils critiquaient auparavant la Banque de France, de ne pas suffisamment l'assurer. Ce sentiment est partagé, en France comme en Allemagne.
Est-ce que être obsédé par la stabilité des prix provoque le chômage ? Observons nos voisins. L'Allemagne, comme le Pays-Bas et d'autres, est quasiment en train de vaincre le chômage de masse. Se dit-on, dans ces pays, « plus il y a d'inflation et mieux cela vaut » ? Non. En Allemagne, l'inflation est un peu plus faible que la nôtre parce que le pays a contenu attentivement ses coûts, si bien que son inflation nationale est, année après année, inférieure à la moyenne européenne. Je ne veux pas faire l'éloge d'un seul pays, et je pourrais d'ailleurs en mentionner d'autres. Je souhaite souligner d'une part que c'est une erreur de penser que nos concitoyens n'approuvent pas la stabilité des prix ; d'autre part que, lorsque l'on prend garde à contenir les coûts, cette stabilité n'est pas un inconvénient mais un avantage dans la lutte contre le chômage. Bien entendu, je me garderai de tout simplisme : il faut aussi faire la part de bien d'autres éléments, dont la créativité, l'innovation et l'ensemble de la compétitivité hors coûts.
S'agissant de l'indépendance de la BCE, je le redis, nous sommes entre les mains des démocraties européennes. Les peuples d'Europe ont défini la charte de la Banque, une charte qui la dit indépendante, chargée d'assurer la stabilité des prix et, sous cette réserve, d'accompagner les autres politiques, et de prendre les décisions appropriées dans les périodes difficiles. Je suis fier qu'au cours de la crise, en dépit de toutes les crispations, y compris en son sein, la BCE ait constamment pris les décisions extrêmement audacieuses requises par les circonstances. Lorsqu'elle a éclaté, la crise a été imputée, peut-être à juste titre pour une part, au laxisme de certaines politiques menées précédemment. J'ai d'ailleurs constaté un retournement d'opinion en France, certains de ceux qui étaient très favorables au laxisme budgétaire et monétaire plaidant alors en faveur de la stabilité et d'une politique économique plus prudente.
L'opposition que manifeste l'Allemagne en certains domaines mérite une analyse. Pendant huit ans, à Francfort, j'ai observé un consensus multipartisan sur la nécessité de regagner la compétitivité perdue et de créer des emplois par un suivi très attentif des coûts. L'opinion allemande est sous l'influence dominante des ouvriers, employés et cadres du secteur exportateur, qui font un lien direct entre leur compétitivité et la création d'emploi. Dans d'autres pays, l'influence dominante est plutôt celle du secteur non exportateur, du secteur public au sens large. Dans ce cas, on ne fait pas le lien entre sa propre compétitivité et l'emploi puisque l'on n'est pas soumis à compétition, et il est important d'expliquer que si l'économie tout entière perd en compétitivité, une crise s'ensuivra que l'on payera cher. C'est ce qui justifie l'introduction des indicateurs européens de suivi de la compétitivité. Ils ne sont pas vraiment utiles pour les pays qui, tels les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche ou la Finlande sont très ouverts sur l'extérieur et dont la culture est spontanément exportatrice, mais ils peuvent être extrêmement utiles en Grèce ou au Portugal. Ils devraient permettre d'éviter des écarts de compétitivité monumentaux qui constitueraient la réelle menace pour la cohésion de l'Union européenne, vos questions l'ont souligné.
L'opposition n'est pas tant, au sein de la zone euro, entre les pays du Nord et les pays du Sud qu'entre les pays à l'économie ouverte ou très ouverte et ceux dont l'économie est assez fermée. C'est ce qui conduit à des décisions, à une appréhension des problèmes et à des négociations entre les partenaires sociaux assez différentes.
Il va de soi que si l'Europe n'était pas à l'épicentre de la crise mondiale des risques souverains, notre économie irait mieux. Le problème est que nous sommes en voie d'ajustement. Cet ajustement, heureusement, se fait : si l'on considère l'ensemble constitué par les pays qui ont été attaqués par l'environnement financier international - l'Espagne, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Portugal –, on constate que le déficit de la balance de paiements courants, qui était de 8 % du PIB, est passé à 1,2 ou 1,3 % du PIB sur les douze derniers mois. Pour certains coûts unitaires de production, l'Espagne a regagné une compétitivité remarquable, et l'Irlande presque toute celle qu'elle avait perdue au pire de son dérapage incontrôlé ; le Portugal fait d'importants efforts également. Ce qui est lamentable, c'est que cet ajustement ait lieu lors d'une crise très grave dont la zone euro est le centre mondial. Pour éviter à tout prix de nous retrouver dans pareille situation, nous devons mettre en oeuvre rigoureusement les dispositifs élaborés à la lumière de l'expérience tirée de la crise.
À propos de la politique de la BCE, j'appelle l'attention sur le fait que, comme nous donnons des liquidités de manière illimitée et à un taux fixe très bas, il y a en a en abondance, si bien que le niveau des taux observés sur le marché monétaire est lui-même extrêmement bas. C'est ainsi que se traduit l'accompagnement de la BCE à l'économie européenne. C'est la décision du Conseil des gouverneurs, et la Banque a montré être capable, en temps de crise, de prendre des décisions non conventionnelles, tout en donnant aux 333 millions d'Européens la stabilité des prix en moyenne - ce qui a été fait depuis la création de l'euro. Le mandat premier donné par les démocraties à la BCE, et confirmé par toutes les enquêtes d'opinion, a été respecté.

Jugez-vous correct le retard avec lequel l'Union européenne a traité les difficultés de la Grèce ? Quel est votre sentiment sur la mutualisation des dettes ? Vous avez dit considérer qu'il faut aller plus loin en matière d'union économique et monétaire ; qu'entendez-vous par là ?
En Grèce, les choses ont été rendues très complexes par la négligence qui a caractérisé la période qui s'est écoulée entre la création de l'euro et le début de la crise des risques souverains. En raison de très graves défauts d'enregistrement statistique – qui devaient être absolument corrigés pour rétablir la crédibilité et de la Grèce et de l'Union –, les données budgétaires présentées par la Grèce n'étaient pas inquiétantes, mais la BCE et les ministres des finances avaient sous les yeux, mois après mois, certains indicateurs de compétitivité qui montraient une évolution extrêmement dangereuse. Malgré cela, une négligence coupable a prévalu, et les marchés eux-mêmes ne signalaient pas que le risque grec les inquiétait. Ensuite est survenue la crise, et un problème doctrinal s'est posé. Lors de la création de la monnaie unique, les « meilleurs Européens » avaient spécifié que l'on fusionnait les monnaies mais qu'il était hors de question de fusionner les budgets, chaque pays membre de la zone euro demeurant responsable du sien. Cette promesse politique allait au-delà du Traité, qui précise qu'il ne doit y avoir ni transferts ni subventionnements par d'autres pays – c'est la clause dite du « no bailing out » – mais qui n'interdit pas les prêts avec intérêts à un pays. La promesse avait été : « Pas un centime, même sous forme de prêt », et l'opinion était sur cette ligne dans plusieurs pays.
Par ailleurs, il était assez difficile à certains pays de se dire qu'ils étaient réputés riches alors que les augmentations de salaires y avaient été très inférieures à la moyenne de la zone euro et que, parce que réputés riches, il leur faudrait paradoxalement aider des pays réputés pauvres mais où les augmentations de salaires avaient été de quatre à cinq fois supérieures aux leurs, voire davantage. La France aurait pu avoir la même réaction mais ce n'a pas été le cas parce que nous avons un côté compassionnel : nous avons jugé qu'il fallait aider des gens dans la difficulté.
Certains pays ont donc éprouvé une réelle difficulté à comprendre l'aide qui leur était demandée, et cette réaction a été partagée par les parlementaires et par l'homme de la rue. Je me suis trouvé devant le Bundestag pour expliquer que nous connaissions un problème très grave, qui devait être traité comme tel. Mais comment faire comprendre qu'un pays incroyablement mal géré, qui s'était en quelque sorte distribué de l'euro sans mesure, puisse tendre la sébile à d'autres Européens qui, eux, avaient été très économes pendant une décennie ? Il y avait là une difficulté extrême, qui explique que les choses se soient déployées lentement, beaucoup trop lentement de mon point de vue, au regard de la rapidité des marchés financiers mondiaux. Nous avons payé cette lenteur assez cher. Finalement, des décisions ont été prises, y compris par ceux des pays qui avaient une conception très ferme du « no bailing out ». Et c'est ainsi qu'a été adopté le Traité créant le mécanisme européen de stabilisation, instrument de gestion de la crise qui est un exemple de mutualisation. Dans le même ordre d'idée, les project bonds, obligations destinées à financer de grands projets, sont considérées comme acceptables par l'ensemble des Européens.
Cela étant, il faut mesurer exactement ce que mutualisation veut dire : si un pays prend en charge les dépenses d'un autre pays, il doit aussi en contrôler les dépenses. La conséquence de la mutualisation serait que le Parlement français ne déciderait plus les dépenses. Une extrême prudence s'impose donc sur ce point, mais il faut considérer qu'une forme de mutualisation existe fort heureusement déjà et qu'une autre est acceptée par tous, sur la base de projets européens. On pourrait imaginer, pour aller plus loin, un embryon de budget de la zone euro, à condition qu'il ne soit pas conçu pour permettre des transferts mais pour absorber les chocs asymétriques, de manière à lisser les cycles économiques. À ce stade, il n'y a pas de consensus sur des transferts permanents lesquels, d'ailleurs ne sont pas sains parce qu'ils supposent que certains pays ne sont pas capables d'être compétitifs, ce qui est faux : il suffit d'ajuster son niveau de vie à son niveau de productivité.
J'ai une autre idée, très audacieuse, qui donnerait de la substance à l'idée d'une fédération budgétaire et économique. À ce jour, les sanctions prévues dans les textes sont des amendes. Ce système, qui n'a jamais été appliqué, ne fonctionne pas : que signifie imposer des amendes, en période de crise, à un pays qui se gère très mal ? On ne peut rien attendre de pratique de cette disposition.
Voyons ce qui s'est passé en Grèce. En ne respectant pas les règles et en refusant, soit par mauvaise volonté, soit par incapacité, de rétablir l'équilibre budgétaire, de 10 à 15 millions d'habitants créent de graves problèmes à 320 millions d'autres Européens. Au lieu d'envisager une amende, on pourrait décider d'activer une procédure au niveau central. La Commission européenne proposerait par exemple une augmentation de la TVA et le gel de certaines dépenses publiques ; après que le Conseil, agissant comme une sorte de « super Sénat » européen, aurait avalisé cette proposition, elle serait soumise au Parlement européen, en liaison, éventuellement, avec les parlements nationaux – mais c'est bien au Parlement européen qu'il reviendrait de prendre la décision ultime et non à la Conférence. Une architecture de cette sorte garantirait la démocratie, la légitimité puisque tous les Européens concernés par le problème seraient consultés, et le principe de subsidiarité enfin, puisque l'on ne retirerait leurs prérogatives aux pays considérés qu'en cas de menace grave et immédiate pour l'ensemble de la zone euro. Cette procédure - l'activation d'une fédération économique et budgétaire par exception - n'aurait lieu que pour éviter la déstabilisation de la zone euro dans son ensemble.
Je sais l'objection qui va m'être faite : c'est une atteinte à la souveraineté d'un pays. C'est vrai, mais c'en est une aussi d'imposer une amende lorsqu'on n'est pas satisfait de la décision prise par un parlement national.

Je note qu'il s'agit à nouveau d'une procédure de sanction. Mais que fait l'Union en amont ? Je ne saurais dire si la Grèce a provoqué la crise ou si elle a été attaquée car elle était le maillon le plus faible. Quoi qu'il en soit, qu'a-t-on fait avant ? Rien ! On a laissé filer, sans processus d'intervention ou d'accompagnement obligatoire. Faut-il en rester là sur ce point, et se limiter à un nouveau système de sanction ?
M. Christophe Caresche remplace Mme Danielle Auroi à la présidence.

Toutes les décisions prises actuellement font péricliter la voie originelle de l'Union européenne, c'est-à-dire la voie communautaire - Parlement européen compris. Dans la voie, plausible, que vous tracez, à quoi servira le budget européen ? Comment revenir devant le Parlement européen, dans une quête de légitimité, alors qu'on affaiblit le germe fédéral en multipliant les structures confédérales réglementaires hétéroclites ? Ce porte-à-faux est permanent ces derniers temps. Ne serait-il pas préférable de créer l'équivalent d'un « euro-CFA » pour les pays en difficulté ? Ils seraient alors face à eux-mêmes, sans qu'une supranationalité trop violente leur soit imposée. Le problème des sanctions, c'est l'appréciation de leur légitimité politique, de ce que le peuple fera dans la rue en cas de sanctions fortes imposées unilatéralement par la Commission européenne.

Vous aviez aussi proposé la nomination d'un ministre européen des finances ; ce pourrait être une piste de solution institutionnelle.
La bonne configuration pour faire progresser la zone euro sans lâcher la rampe des autres pays membres de l'Union, ce sont les Vingt-Sept. Le TSCG a été signé par tous, à l'exception de la République tchèque et du Royaume-Uni. Le pacte de stabilité et de croissance s'applique aux Vingt-Sept, mais les sanctions aux seuls membres de la zone euro ; il en va de même pour le noyau central du suivi des indicateurs de compétitivité. Je partage votre opinion, il faut prendre garde à l'articulation entre tous les pays de l'Union. Les membres de la zone euro ont opté pour un destin commun, comme la crise l'a montré, qui a conduit au partage des difficultés. Certes, la Grèce était de loin le pays le plus vulnérable. Ensuite venaient l'Irlande, le Portugal et l'Espagne, car les signatures, publiques et privées, sont toujours classées par le marché financier dans un ordre décroissant de vulnérabilité. Cela ne signifie pas que les pays qui, en se signalant comme les plus vulnérables, ont servi de détonateurs de la crise, n'ont pas de responsabilité.
Vous avez parlé d'« euro-CFA ». Deux pays baltes sont dans cette situation : ils ne sont pas encore membres de la zone euro mais ils adopté l'euro comme monnaie de référence, ce que les a contraints, pendant la crise, à des ajustements. Les Européens se sont accordés pour dire que le périmètre de la zone euro devait pour l'instant demeurer inchangé. La question de savoir si et comment gérer un élargissement potentiel est délicate. Avant toute chose, nous devons être absolument sûrs que notre gouvernance interne fonctionne bien et permet d'éviter toute nouvelle faiblesse majeure. Certains pays, tels la Pologne, sont très désireux, et ils ont raison, de rejoindre la zone euro le moment venu. Si celle-ci veut préserver sa cohérence et sa visibilité internationale, elle doit être une entité solide, ce qu'elle a prouvé être en traversant la crise économique et financière la plus grave connue depuis la fin de la seconde guerre mondiale en préservant son unité. Mais tout n'est pas gagné et aucune complaisance n'est permise. Or, le risque est que lorsque la crise s'estompe, on perde en ardeur politique alors qu'il faut rester déterminé.
J'ai esquissé devant vous une architecture d'exception dans laquelle la Commission européenne devient un gouvernement, le Conseil une Chambre haute européenne et le Parlement européen reste ce qu'il est, la Chambre basse qui a le dernier mot. Avoir un commissaire européen qui concentrerait une très large part des responsabilités opérationnelles de la zone euro serait à mon sens très utile. Il surveillerait, avec l'ensemble du Conseil, les questions relatives au suivi du pacte de stabilité et de croissance, aux grands déséquilibres, aux indicateurs de compétitivité, et serait le gestionnaire du mécanisme de stabilisation européen. Il serait bon de rassembler toutes ces responsabilités ; on éviterait la dualité actuelle, personnifiée par le président de l'Eurogroupe et le commissaire chargé des finances. Cela contribuerait à simplifier l'articulation complexe des institutions européennes.

Considérez-vous que les cours des comptes doivent intervenir dans l'activation d'une fédération économique et budgétaire « par exception » ?
Toutes les institutions nationales exerçant ce type de surveillance ont un rôle préventif extraordinairement utile, précisément pour éviter qu'un pays se trouve dans la situation relevant de l'activation de ce mécanisme. Mais si la procédure est activée, elle conduira à une décision « centrale ».
La séance est levée à 9 h 55