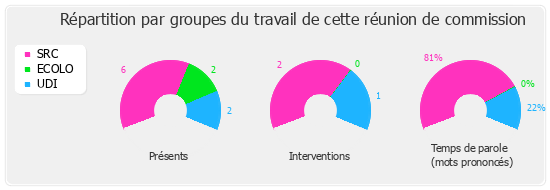Commission des affaires européennes
Réunion du 2 février 2016 à 14h00
La réunion
COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES
Mardi 2 février 2016
Présidence de Mme Danielle Auroi,
La séance est ouverte à 14 heures
Audition de Mme Mireille Delmas-Marty, professeure au Collège de France, sur la déchéance de nationalité dans le contexte européen

L'Assemblée nationale a entamé mercredi dernier, en commission des lois, l'examen du projet de loi de protection de la Nation que nous examinerons à partir de vendredi en séance publique. L'article 1er du texte porte sur la constitutionnalisation de l'état d'urgence et son article 2 sur la déchéance de la nationalité.
Hier, le Conseil de l'Europe s'est dit « préoccupé » par la prolongation de l'état d'urgence en France. Son secrétaire général a écrit au président de la République pour souligner « les risques pouvant résulter des prérogatives conférées à l'exécutif durant l'état d'urgence », se référant notamment « aux conditions des perquisitions administratives ou assignations à résidence ».
Mais c'est principalement sur le deuxième point, la déchéance de nationalité, que j'ai souhaité que nous replacions le débat sur cette mesure dans son contexte européen, et l'audition de la spécialiste du droit pénal comparé et du droit européen que vous êtes, madame, s'est imposée comme une évidence.
Modifié à la fin de la semaine dernière par le Gouvernement, le projet de loi constitutionnelle devrait prévoir que la loi fixe les règles concernant « la nationalité, y compris les conditions dans lesquelles une personne peut être déchue de la nationalité française ou des droits attachés à celle-ci lorsqu'elle est condamnée pour un crime ou un délit constituant une atteinte grave à la vie de la nation ».
Nous nous interrogeons sur l'articulation de cette révision constitutionnelle avec les valeurs de l'Union européenne gravées dans les traités que sont le respect de la dignité humaine et des droits de l'homme, l'égalité et la non-discrimination.
Par ailleurs, déchoir un individu de sa nationalité française conduira également, si sa deuxième nationalité est celle d'un pays non membre de l'Union européenne, à lui retirer la citoyenneté européenne et tous les droits qui s'y attachent – je pense notamment à la liberté de circulation et aux droits des membres de sa famille. Selon vous, comment cette mesure s'articulera-t-elle, si elle est adoptée, avec le droit de l'Union européenne ? La Cour de justice sera-t-elle compétente pour juger de cette question ? Que pourrait décider la Cour à propos de l'extension de la déchéance de nationalité aux auteurs de délits ? Cela pourrait-il constituer une atteinte au principe de proportionnalité ?
La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, juridiquement contraignante depuis l'adoption du traité de Lisbonne, dispose en son article 19 que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitement inhumains et dégradants ». L'expulsion des terroristes déchus de la nationalité française ne risque-t-elle pas d'aller à l'encontre de ce principe ?
Le droit européen n'est pas seulement le droit de l'Union européenne : c'est également le droit de la Convention européenne des droits de l'homme. La mesure proposée dans le projet de loi vous semble-t-elle compatible avec cette Convention ? La France pourrait-elle être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) ? Quelles seraient les conséquences d'une telle condamnation ?
Enfin, de telles mesures existent-elles dans d'autres États membres ?
Je n'évoquerai donc que très brièvement l'état d'urgence, pour rappeler que les perquisitions et les assignations à résidence sont des restrictions et des privations de liberté au sens de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Lorsqu'un État invoque l'article 15 de la Convention, c'est-à-dire les circonstances exceptionnelles, dont l'état d'urgence, – et la France a fait une déclaration à ce sujet au Conseil de l'Europe – la Convention admet des dérogations, y compris à l'article 5. Ce qu'elle n'admet pas, c'est une atteinte aux droits indérogeables, c'est-à-dire essentiellement au droit au respect de la dignité de la personne. Encore faut-il, pour invoquer l'article 15, que les dérogations se situent dans la stricte mesure où la situation l'exige. Cela peut donc poser un problème de durée. D'autre part, les conséquences de l'état d'urgence ne doivent pas être en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international et notamment avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
J'en viens à la déchéance de nationalité. J'observe que la rédaction du projet de loi a évolué une première fois après que le Conseil d'État a rendu son avis, puis une seconde fois, avec le dépôt, au dernier moment, d'un amendement gouvernemental.
La Conseil d'État avait exprimé des réserves sur la version initiale du texte, qui prévoyait la déchéance de la nationalité française « des binationaux condamnés définitivement pour un crime ou un délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ». Le Conseil d'État estimait qu'il serait inopportun d'introduire le terme « terrorisme » dans la Constitution, et qu'il serait préférable de prévoir que la déchéance ne pourrait être infligée qu'aux personnes condamnées pour un crime – et non, donc, pour un délit.
Le Gouvernement a tenu compte de ces observations dans la deuxième version du projet. Mais, le 28 janvier, il a déposé un amendement tendant à réécrire le troisième alinéa de l'article 34 de la Constitution pour préciser que la loi fixe les règles concernant la nationalité, « y compris les conditions dans lesquelles une personne peut être déchue de la nationalité française ou des droits attachés à celle-ci lorsqu'elle est condamnée pour un crime ou un délit constituant une atteinte grave à la vie de la Nation ». Ce faisant, le Gouvernement réintroduit la notion de délit qui avait été supprimée dans la seconde version du texte.
En apparence, l'amendement met fin à la controverse relative aux binationaux, puisque le terme n'apparaît pas dans la formulation proposée. En réalité, le texte n'a pas de signification pour les personnes naturalisées, déjà visées par l'article 25 du code civil, mais seulement pour les personnes nées en France. C'est d'ailleurs ce qu'indique l'exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle : le projet de loi ordinaire qui en découlera unifiera les régimes de déchéance applicables aux personnes condamnées, qu'elles soient naturalisées ou nées en France. De deux choses l'une : soit la loi ordinaire aura vocation à s'appliquer à tous les Français et se pose la question de l'apatridie, soit elle ne vise que les binationaux, ce qui nous ramène au débat précédent.
En outre, le projet tel qu'amendé par le Gouvernement élargit la mesure en introduisant à côté de la déchéance de la nationalité une peine de déchéance des droits attachés à celle-ci. Surtout, en revenant à la version qui avait été abandonnée après que le Conseil d'État eut critiqué la référence aux délits, le Gouvernement a adopté une rédaction – « une personne peut être déchue de la nationalité française ou des droits attachés à celle-ci lorsqu'elle est condamnée pour un crime ou un délit constituant une atteinte grave à la vie de la nation » – extrêmement large. Par « délit constituant une atteinte grave à la vie de la nation », on peut entendre toutes sortes de délits, y compris des délits d'opinion ou des critiques, surtout quand le pays est en état d'urgence ou d'exception. C'est pourquoi je suis personnellement très réservée sur cet amendement. Je rejoins ce qu'a écrit mon collègue Olivier Beaud sur le rôle de la Constitution, dans une tribune publiée dans la presse. Dans un État de droit, la Constitution a pour objet de garantir les droits fondamentaux et la séparation des pouvoirs en encadrant les pouvoirs de l'exécutif. Au contraire, par sa formulation beaucoup trop large, l'amendement gouvernemental élargit les pouvoirs de l'exécutif et ouvre une brèche dans laquelle tout gouvernement autoritaire pourrait s'engouffrer pour sanctionner tous les dissidents, voire de simples adversaires politiques.
J'en viens aux questions que vous m'avez posées sur le droit de l'Union européenne et sur le droit du Conseil de l'Europe. Ces deux dispositifs étaient d'ailleurs évoqués dans l'avis du Conseil d'État, qui manifestait la crainte de certaines incompatibilités avec le texte proposé par le Gouvernement.
Deux aspects du droit de l'Union européenne peuvent être invoqués. Il y a d'abord la Charte des droits fondamentaux qui, depuis le traité de Lisbonne, a une valeur complète et non plus seulement déclarative. Peut poser problème l'article 20 de la Charte, qui établit que « toutes les personnes sont égales en droit ». Peuvent surtout poser problème l'article 2, qui interdit toute discrimination fondée notamment sur la naissance, et singulièrement son alinéa 2, ainsi rédigé : « Dans le domaine d'application des traités et sans préjudice de leurs dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite ».
À cela s'ajoute une autre difficulté, liée à la citoyenneté européenne. En effet, l'article 9 du Traité sur l'Union européenne est ainsi rédigé : « Dans toutes ses activités, l'Union respecte le principe de l'égalité de ses citoyens, qui bénéficient d'une égale attention de ses institutions, organes et organismes. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. » Quant au deuxième alinéa de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), il se lit ainsi : « Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités ». Ainsi, la remise en cause de la citoyenneté d'un État membre constituerait une remise en cause de la citoyenneté européenne des individus.
À propos de la citoyenneté européenne, j'appelle votre attention sur l'arrêt rendu en 2010 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) à propos de l'affaire Rottmann, bien qu'il ne corresponde pas exactement au sujet dont nous traitons aujourd'hui. M. Rottmann, né autrichien, avait acquis la nationalité allemande. Le droit autrichien n'admettant pas la bi-nationalité, cette naturalisation avait eu pour effet de lui faire perdre la nationalité autrichienne. Par la suite, le Land de Bavière a décidé de retirer à M. Rottmann la nationalité allemande au motif qu'il l'avait obtenue frauduleusement, et ce retrait n'a pas pour effet qu'il retrouve automatiquement la nationalité autrichienne. La Cour de justice, interrogée sur le point de savoir si l'article 20 du TFUE admet qu'une décision de retrait de naturalisation puisse avoir pour conséquence la perte de la citoyenneté de l'Union pour la personne concernée, a rendu un arrêt assez nuancé.
La Cour a confirmé que le droit de l'Union européenne ne s'oppose pas à ce qu'un État membre retire la nationalité acquise par voie de naturalisation lorsque celui-ci l'a obtenue de manière frauduleuse. Mais, et ce point est celui qui nous intéresse plus directement, la Cour a précisé que la décision de retrait doit respecter le principe de proportionnalité. On note que la Cour a jugé que le fait pour un État de retirer sa nationalité obtenue par une manoeuvre frauduleuse correspond à un motif d'intérêt général, mais qu'elle ne limite pas la notion d'intérêt général à ces manoeuvres : elle pourrait s'appliquer au retrait de la nationalité à une personne « ayant commis un crime portant atteinte à la vie de la nation ». La Cour juge en effet qu' » il est légitime pour un État membre de vouloir protéger le rapport particulier de solidarité et de loyauté entre lui-même et ses ressortissants ainsi que la réciprocité de droits et de devoirs, qui sont le fondement du lien de nationalité ».
Une telle considération sur la légitimité, dans son principe, d'une décision de retrait de la naturalisation reste, semble-t-il, valable lorsqu'un tel retrait a pour conséquence que la personne concernée perd, outre la nationalité de l'État membre, la citoyenneté de l'Union. Toutefois, le statut de citoyen de l'Union européenne ayant vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres, il appartient à la juridiction nationale, dit la Cour, de vérifier si, conformément au droit européen, la décision de retrait respecte le principe de proportionnalité en tenant compte des conséquences que cette décision emporte pour l'intéressé. À ce sujet, la Cour fixe les critères de la proportionnalité. « Il convient, lors de l'examen d'une décision de retrait de la naturalisation, de tenir compte des conséquences éventuelles que cette décision emporte pour l'intéressé et, le cas échéant, pour les membres de sa famille en ce qui concerne la perte des droits dont jouit tout citoyen de l'Union ». Il faut notamment vérifier, dit la Cour, si cette perte est justifiée par rapport à la gravité de l'infraction commise – ce qui fait s'interroger sur ce qu'il serait si l'on étendait la déchéance de la nationalité française à la commission de délits –, au temps écoulé entre la décision de naturalisation et la décision de retrait ainsi qu'à la possibilité pour l'intéressé de recouvrer sa nationalité d'origine.
On notera que la Cour suprême britannique a invoqué l'arrêt Rottmann dans sa décision rendue le 25 mars 2015 dans l'affaire Pham. M. Pham, né au Vietnam, a été naturalisé au Royaume-Uni en 1995. Sa nationalité britannique lui est retirée en 2011 en raison de son implication supposée dans un groupe terroriste. Il conteste la légalité d'une décision qui a pour effet, dit-il, de le rendre apatride, ce que prohibe l'article 40 du British Nationality Act. Dans un premier temps, la Commission spéciale d'appel en matière d'immigration lui donne raison mais la Cour d'appel et la Cour suprême renversent ce jugement. Dans un deuxième temps, M. Pham a argumenté sur le fait que le retrait de sa nationalité britannique aurait pour effet de le priver de sa citoyenneté européenne, invoquant le respect du principe de proportionnalité dont fait état l'arrêt Rottmann. La Cour suprême britannique s'est écartée de la position de la CJUE : jugeant que le statut de citoyen européen n'est que subsidiaire à la nationalité britannique, elle a estimé qu'elle n'avait pas à appliquer strictement la jurisprudence de la CJUE. Mais la Common law lui imposant de procéder à un contrôle de proportionnalité la Cour suprême fait en réalité le même travail que la CJUE. Cette affaire n'est donc pas directement transposable en France.
Le droit du Conseil de l'Europe en cette matière, c'est d'abord la Convention européenne sur la nationalité de 1997 – que, je le rappelle pour mémoire, la France a signée mais n'a pas ratifiée. La Convention impose que les règles nationales relatives à la nationalité soient en accord « avec les conventions internationales applicables, le droit international coutumier et les principes de droit généralement reconnus en matière de nationalité » Cette rédaction amène à rechercher les règles du droit international et non seulement européen. La Convention interdit l'apatridie en son article 4 et en son article 7, § 3. La France aurait-elle ratifié ce texte que cela créerait des difficultés si l'on envisageait d'appliquer la déchéance de nationalité à des Français non binationaux.
Mais les dispositions les plus directement gênantes pour l'application du projet de loi constitutionnelle sont contenues dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. On peut penser à l'article 3, relatif à l'interdiction de la torture ; à l'article 8, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale ; à l'article 13 relatif au droit de recours en cas d'atteinte à un droit fondamental ; à l'article 14, qui interdit la discrimination.
La déchéance de nationalité est-elle susceptible de constituer une ingérence excessive de l'autorité publique au regard du droit au respect de la vie privée et familiale, et donc une violation de l'article 8 de la Convention ? Trois décisions de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) peuvent être signalées à ce sujet.
Une lecture rapide de la Convention peut faire dire qu'aucun droit à la nationalité n'est mentionné en tant que tel. Mais le 11 octobre 2011, dans l'affaire Genovese contre Malte, la Cour a jugé que la nationalité est un élément de l'identité sociale de la personne, protégée, à ce titre, par l'article 8 de la Convention. En l'espèce, la Cour a jugé que le refus d'accorder la nationalité britannique à un enfant résidant au Royaume-Uni au motif qu'il était issu de l'union hors mariage d'une ressortissante britannique et d'un Maltais constituait une atteinte à la vie privée et une discrimination, et donc une violation de l'article 8 et de l'article 14 de la Convention.
Par ailleurs, le 26 juin 2012, la grande Chambre de la CEDH, concluant à la violation des articles 8, 13 et 14 de la Convention, a condamné la Slovénie dans le contentieux des « effacés de Slovénie », des Serbes qui avaient été privés de la nationalité slovène à la suite de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie alors que leurs familles vivaient en Slovénie depuis plusieurs générations, sans que leur soit proposée une autre nationalité.
Enfin, dans l'arrêt Mennesson contre France du 26 juin 2014, la CEDH a condamné la France pour violation de l'article 8 de la Convention pour avoir refusé la retranscription d'actes d'état civil pour des enfants nés par gestation pour autrui.
Un dernier exemple portera sur l'article 3 de la Convention et le lien qui peut être fait entre le retrait de la nationalité et l'interdiction de traitements inhumains et dégradants. La CEDH avait rendu une première décision en février 2008 dans l'affaire Saadi contre Italie. Elle concernait l'expulsion d'un ressortissant tunisien soupçonné de terrorisme vers la Tunisie, avec le risque qu'il soit soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Le 3 décembre 2009, la Cour a renvoyé à cet arrêt dans l'affaire Daoudi contre France, qui nous intéresse plus directement.
M. Daoudi, Algérien arrivé sur le sol français en 1979, alors âgé de 5 ans, fut arrêté quelques jours après les attentats du 11 septembre 2001 dans le cadre d'une opération visant à déjouer un attentat-suicide prévu contre l'ambassade des États-Unis à Paris. Fouillant son passé, les enquêteurs avaient découvert qu'il avait suivi une formation paramilitaire de plusieurs mois en Afghanistan ; il fut condamné à une peine de six ans d'emprisonnement pour sa participation à une association en vue de commettre des actes terroristes, condamnation assortie d'une interdiction définitive du territoire français. Au terme de sa peine, il fit l'objet d'une procédure d'expulsion vers l'Algérie. Ses recours échouèrent et sa demande d'asile fut rejetée. Il a alors saisi la CEDH d'une requête demandant le sursis à l'expulsion, démontrant dans son dossier qu'il risquait de subir en Algérie des traitements inhumains ou dégradants, ou même la torture. La Cour a ordonné le sursis à l'expulsion, avec deux arguments qui s'équilibrent. Les juges européens ont d'abord rappelé « le caractère absolu de la prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains et dégradants prévue par l'article 3 de la Convention, quels que soient les agissements de la personne concernée, aussi indésirables et dangereux soient-ils » ainsi que « l'impossibilité de mettre en balance le risque de mauvais traitements et les motifs invoqués pour l'expulsion ». Ainsi, à la différence de ce que nous avons vu avec le droit de l'Union européenne, le principe de proportionnalité ne s'applique pas : l'interdiction du risque de traitement inhumain et dégradant ou de torture est un butoir absolu.
Cela étant, la Cour précise que « ces considérations ne s'opposent évidemment pas au constat des difficultés considérables que les États rencontrent pour protéger leur population de la violence terroriste, [...] de l'ampleur du danger que représente le terrorisme pour la collectivité et, par conséquent, de l'importance des enjeux de la lutte antiterroriste. Devant une telle menace, la Cour considère qu'il est légitime que les États contractants fassent preuve d'une grande fermeté à l'égard de ceux qui contribuent à des actes de terrorisme, qu'elle ne saurait en aucun cas cautionner ».
C'est une des grandes différences entre le droit européen et le droit des États-Unis d'Amérique. En Europe, l'interdiction du risque de soumission à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants est un droit auquel on ne peut déroger. Ce qui importe évidemment est la fiabilité des faits rapportés. Pour ce que concerne M. Daoudi, le risque de torture était largement établi, par des rapports d'organisations non gouvernementales telles qu'Amnesty international, Human Rights Watch, par le Comité contre la torture et le Comité des droits de l'homme des Nations Unies et par un rapport du ministère de l'Intérieur britannique sur l'Algérie.
Je suis frappée par l'évolution en cours dans les pays européens en faveur de certaines déchéances de nationalité. À ce jour, la déchéance est admise pour les personnes naturalisées dans quinze pays membres de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe ; son extension, plus récente, aux binationaux par naissance ne concerne que le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas.
Au Royaume-Uni, ces questions sont régies par le British Nationality Act. Adopté en 1980, il a été modifié en 2006 pour élargir les cas possibles de déchéance de nationalité. C'est ce qui a permis de prononcer, en raison de son appartenance supposée à un groupe terroriste, la déchéance de nationalité de M. Pham, né Vietnamien et naturalisé britannique ; cette décision, je vous l'ai dit, avait été contestée au motif qu'elle rendait l'intéressé apatride. Le droit britannique ne permettait pas directement l'apatridie, mais il a été modifié en 2014, depuis l'affaire Pham, et l'article 56 de l'Immigration Act permet désormais, si le texte est appliqué, de déchoir de leur nationalité les personnes qui possèdent uniquement la nationalité britannique, même si cela aurait pour effet de les rendre apatrides.
Le droit a également évolué en Belgique. La loi de 2012 permettait de déchoir de la nationalité belge les personnes qui ne sont pas nées d'un parent belge et les binationaux condamnés à des peines d'emprisonnement ou de réclusion supérieures à cinq ans pour les infractions terroristes les plus graves, dans les dix ans suivant l'acquisition de la nationalité belge. Après les attentats commis en janvier 2015 en France, dont il est apparu que l'organisation avait des ramifications en Belgique, une loi « visant à renforcer la lutte contre le terrorisme » a été adoptée le 20 juillet 2015, qui modifie le code de la nationalité belge par l'introduction d'un article 232 en vertu duquel la déchéance de la nationalité belge peut être prononcée « à l'égard de Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur ou adoptant belge au jour de leur naissance et des Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité, s'ils ont été condamnés, comme auteur, coauteur ou complice, à une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans sans sursis pour une infraction visée au livre II, titre Ier ter, du code pénal ». Il est précisé que « le juge ne prononce pas la déchéance au cas où celle-ci aurait pour effet de rendre l'intéressé apatride, à moins que la nationalité n'ait été acquise à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses informations ou par dissimulation d'un fait pertinent. Dans ce cas, même si l'intéressé n'a pas réussi à recouvrer sa nationalité d'origine, la déchéance de nationalité ne sera prononcée qu'à l'expiration d'un délai raisonnable accordé par le juge à l'intéressé afin de lui permettre d'essayer de recouvrer sa nationalité d'origine. »
En Allemagne, la bi-nationalité est possible depuis l'an 2000, mais seulement pour les personnes ayant pour autre nationalité celle d'un pays membre de l'Union européenne ou la nationalité suisse. En 2014, une loi a été adoptée qui concerne les enfants immigrés ou ayant vécu huit ans en Allemagne : ils peuvent obtenir la nationalité allemande et garder celle des parents. En novembre 2015, l'Union chrétienne-démocrate (CDU) a adopté une motion proposant de retirer la nationalité allemande aux personnes ayant combattu dans un groupe terroriste à l'étranger et détenant la double nationalité ; cela n'a pas abouti à ce jour. Enfin, un accord politique a été trouvé le mois dernier qui vise à limiter les possibilités de regroupement familial de ceux des demandeurs d'asile qui ne bénéficient pas du statut de réfugié mais seulement de la protection subsidiaire.
Quelques mots, pour terminer, sur le droit international. Il est important de rappeler que la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme que « Tout individu a droit à une nationalité », et aussi que la Convention de 1961 des Nations Unies sur la réduction des cas d'apatridie prévoit en son article 8 que « Les États contractants ne priveront de leur nationalité aucun individu si cette privation doit le rendre apatride. » La France, qui a signé la Convention mais ne l'a ni ratifiée ni transcrite en droit interne, avait exprimé des réserves au moment de la signature, prévoyant d'écarter de son champ d'application tout individu qui apporte son concours à un autre État ou qui a un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de l'État.
Enfin, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que la France a signé et ratifié, établit comme un droit fondamental auquel il ne peut être dérogé, même en cas de danger public exceptionnel menaçant un État, le droit de toute personne à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. Cette notion pourrait englober la nationalité, d'autant que le Comité du pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques a reconnu le concept de « nationalité de fait » pour un Autrichien qui avait vécu en Australie un certain nombre d'années.
En conclusion, on peut se préoccuper de cette évolution du droit français et de certains droits européens. Qu'adviendra-t-il des personnes privées de statut ? Vers quels pays ces apatrides seront-ils expulsés ? Dans Les Origines du totalitarisme, Hannah Arendt écrivait avec force : « Être déchu de sa citoyenneté, c'est être privé de son appartenance au monde, c'est comme revenir à l'état sauvage, à l'état d'homme des cavernes… Un homme réduit à cette seule condition d'homme perd jusqu'aux qualités qui permettent aux autres de le reconnaître comme un des leurs… Il peut vivre et mourir sans laisser de trace, sans apporter la moindre contribution au monde commun ». Que se passera-t-il si l'on fabrique ainsi de plus en plus d'individus privés de droits ? Faudra-t-il, comme s'en effraye Mme Taubira, ouvrir des « déchetteries humaines » pour les entreposer et protéger les autres citoyens, ceux qui ont une nationalité ?

Je vous remercie, madame, pour la référence par laquelle vous avez clos votre propos. Ma question porte sur l'identité européenne.
La construction d'un projet européen autre qu'économique et monétaire doit nécessairement s'adosser à une identité commune. Le principe d'une citoyenneté européenne, instituée par le traité de Maastricht pour consolider l'émergence d'une identité européenne, est donc central et, étant donné la résurgence des nationalismes et de la xénophobie, prioritaire. Par la suite, la Convention du Conseil de l'Europe du 6 novembre 1997, complétant celle de Strasbourg du 6 mai 1963, laissait envisager l'harmonisation européenne des politiques d'acquisition de la nationalité. Ce texte établit plusieurs principes auxquels souscrivent les États signataires. La prévention de l'apatridie en est un, le respect des droits des personnes résidant habituellement sur les territoires concernés en est un autre ; tous se fondent sur le principe de la non-discrimination entre les ressortissants d'un État, « qu'ils soient ressortissants à la naissance ou aient acquis sa nationalité ultérieurement ».
Mais, contrairement à d'autres pays qui ont ratifié et appliqué la Convention, la France l'a seulement signée, le 4 juillet 2000. Pourtant, en matière de droit de la nationalité, du séjour des étrangers sur notre territoire ou de l'accueil des réfugiés, nous nous appuyons sur un corpus juridique et réglementaire issu des traités et conventions internationales, plus particulièrement européens.
Dès lors, le débat porté au sein du Parlement français sur le principe d'une déchéance de nationalité fait s'interroger. En premier lieu, c'est une nouvelle manifestation d'une course à la création de droits d'exception : les circonstances exceptionnelles ou l'urgence sont de plus en plus fréquemment invoquées et tendent à commander des modifications profondes de pans entiers de notre droit ; j'aimerais connaître votre sentiment sur ce point. Ensuite, le processus de construction européenne fait que le cadre des États-nations n'est plus le seul qui permet de définir des identités ; les clivages nationaux cèdent progressivement au profit d'une identité européenne plurinationale. Comment, alors, envisager une possible déchéance de nationalité sans s'interroger sur son sens politique et sa cohérence dans le cadre d'un espace européen légitime ?

La notion de déchéance de nationalité ne remet-elle pas en cause le droit du sol ? On naît Français ou d'une autre nationalité ; ce n'est ni acquis, ni construit. Un parricide ne demeure-t-il pas le fils de celui qu'il a tué ? De même, celui qui récuse un État n'est-il pas toujours, en dépit de cela, ressortissant du pays qui lui a donné sa nationalité quand il est né ? N'y a-t-il pas quelque chose d'absurde dans la notion de déchéance nationale, et ne serait-il pas de meilleure pratique de faire référence à la peine d'indignité nationale, qui prive les coupables de leurs droits ? En résumé, puisque la proposition de révision constitutionnelle qui nous est faite est plus encore absurde qu'elle n'est choquante, comment la rendre insignifiante ?

Vingt-deux pays européens ont adopté le principe d'une déchéance de nationalité pour des motifs divers, dont la trahison et le terrorisme – et l'on peut même être déchu de sa nationalité en Slovénie si l'on ne se soumet pas à « ses devoirs de citoyen ». La disposition est-elle, pour chacun, inscrite dans leur Constitution ou dans une loi simple ? D'autre part, quelles dispositions pourrait faire valoir le citoyen qui souhaiterait faire recours contre une déchéance de nationalité qui le priverait de ses droits familiaux, sociaux et civiques ? Les attributs liés à la nationalité pourraient-ils faire l'objet d'un texte ?
Vous avez évoqué à juste titre, madame Bruneau, la nécessité d'une cohérence d'ensemble. De fait, l'Union européenne n'a pas de sens si l'on n'admet pas un statut commun. La citoyenneté européenne en est l'amorce, et il est en effet absurde de concevoir des législations nationales différentes en matière de déchéance de nationalité. La nécessaire cohérence européenne appellerait, bien que la nationalité ne relève pas de la compétence des institutions communautaires, une reconnaissance à l'échelle européenne. Il ne faut s'enfermer dans trop de juridisme, car la nationalité touche au lien politique, à l'appartenance non seulement à la nation mais aussi, maintenant, à l'Europe.
M. Piron, considérant que la nationalité est un lien si fort avec la nation qu'il ne peut être détruit, tient l'idée de déchéance de nationalité pour une absurdité en soi. Cela va dans le sens des propos essentiels d'Hannah Arendt. La notion même de déchéance de nationalité pourrait en effet être mise en cause. Surtout, le débat à ce sujet se déroule dans un cadre très éloigné de la réalité, celle d'un monde interdépendant. On continue à raisonner en fonction du modèle archaïque de l'État souverain faisant ce qu'il veut sur son territoire et avec ses nationaux, mais la configuration n'est plus celle-là. Ce discours daté doit être dépassé, puisque tous les problèmes auxquels les États font face sont européens et mondiaux.
Comme je l'ai indiqué, monsieur Pueyo, le raisonnement juridique sur les questions de déchéance de nationalité est fondé sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, principalement son article 8, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, et aussi son article 3, relatif à l'interdiction de la torture. Je ne saurais vous dire précisément si le principe de la déchéance de nationalité est inscrit dans la Constitution ou dans la loi ordinaire de chacun des pays européens qui l'ont adopté, mais je constate que le durcissement des droits nationaux en cette matière récemment intervenu en Belgique et au Royaume-Uni a été adopté par le biais de lois ordinaires. On ne voit pas de raison majeure de passer au niveau constitutionnel, d'autant que les Constitutions ne sont pas faites pour cela : elles ont pour objet de garantir les droits fondamentaux et non de les limiter, d'assurer la séparation des pouvoirs et non leur confusion. C'est pourquoi la question même de la constitutionnalisation est posée pour la déchéance de la nationalité, comme elle l'est à propos du recours à l'état d'urgence – auquel il faut des limites plus précises et des conditions beaucoup plus strictes pour qu'il ait sa place dans la Constitution ; sinon, on a le sentiment que l'on constitutionnalise une situation qui est plutôt dérogatoire aux droits fondamentaux et au principe de séparation des pouvoirs.
Nous nous rejoignons donc sur la nécessité d'une cohérence d'ensemble et d'une prise de conscience de l'interdépendance accrue des États. On ne peut faire comme s'ils n'étaient pas tenus à la solidarité – inscrite dans les textes européens mais pas encore dans les textes internationaux, et il le faudrait – pour résoudre les grands problèmes qu'il leur faut affronter, qu'il s'agisse du terrorisme ou de l'immigration. On ne résoudra pas ces problèmes par des révisions constitutionnelles, aussi ambitieuses soient-elles, mais par un renforcement de la solidarité aux niveaux européen et mondial. Procéder autrement ne serait qu'une fuite en avant. Si l'on inscrit les mesures proposées par le Gouvernement dans la Constitution et que, par malheur, un nouvel attentat se produit en France, que fera-t-on ?

Je vous remercie, madame, d'avoir aussi utilement nourri notre réflexion à la veille du débat qui va s'ouvrir.
La séance est levée à 15 heures