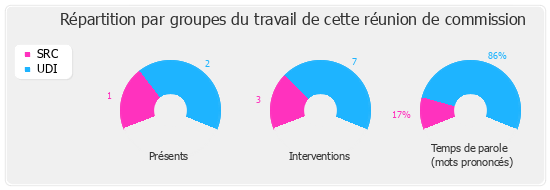Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
Réunion du 16 mars 2016 à 16h00
La réunion

La Mission d'évaluation et de contrôle poursuit ses travaux en recevant les directeurs de nos deux plus prestigieuses écoles. Permettez-moi d'emblée une question générale : estimez-vous que les modalités de recrutement, de formation et d'affectation des hauts fonctionnaires permettent à l'État de disposer de toutes les compétences utiles – ou des plus utiles aux meilleurs moments – à la réussite des politiques publiques ?
Cette question est au coeur du travail de l'ENA, dont les missions, fixées dans l'ordonnance de 1945, avaient été alors définies pour assurer le recrutement démocratisé et la formation professionnalisée de hauts fonctionnaires. Si leur philosophie n'a pas changé depuis plus de soixante-dix ans, ces missions ont été revues et étendues au fil de l'histoire de l'École : au-delà de la formation initiale de hauts fonctionnaires français, l'ENA est également chargée de la formation continue de fonctionnaires français et étrangers, ainsi que d'actions de coopération européenne et internationale et d'actions dans le domaine de la recherche et des publications.
Votre question, monsieur le président, m'a été posée lorsque j'ai pris mes fonctions en 2012 : la feuille de route qui m'a alors été confiée, et qui s'est traduite dans le contrat d'objectifs et de performance de l'École pour la période 2013-2015, prévoyait notamment la refonte des concours d'entrée et la rénovation de la scolarité en formation initiale. Pour poursuivre ces deux objectifs désormais atteints, nous avons tâché de recruter au mieux et de la manière la plus diversifiée qui soit les hauts fonctionnaires de demain pour qu'ils correspondent aux besoins des employeurs publics.
Se poser cette question à ce moment précis de notre histoire a ceci de particulier que les métiers de l'action publique sont en pleine transformation, comme l'ensemble des métiers de nos sociétés. Nous devons relever le défi consistant à former nos élèves à des métiers que nous ne connaissons pas encore vraiment. Loin d'être un obstacle, c'est plutôt une incitation à l'innovation tant dans les contenus de nos programmes que dans les méthodes pédagogiques de nos écoles – je crois en effet de ce point de vue pouvoir parler au nom de nombreuses écoles de management public et privé qui, en France comme à l'étranger, sont toutes confrontées au même défi. Je précise à cet égard que l'ENA a noué des partenariats avec 126 écoles et instituts d'administration publique dans le monde entier. Nous utilisons ces partenariats pour faire rayonner l'influence de la France, mais aussi pour nourrir notre propre réflexion sur ce que doivent être le recrutement et la formation des hauts fonctionnaires.
À la question que vous posez, monsieur le président, j'espère que l'ENA répond au mieux. Les réformes que nous avons conçues et que nous déployons après leur adoption par le Gouvernement visent à mettre à jour le recrutement et la formation des hauts fonctionnaires en fonction des besoins connus et prévisibles des employeurs publics. La réforme de la scolarité, par exemple, est la quinzième réforme mise en oeuvre depuis la création de l'École – ce qui, selon moi, est un signe de bonne santé pour une institution de formation. Il convient en effet d'adapter à chaque fois que c'est nécessaire et possible nos méthodes et nos contenus aux attentes de nos employeurs.
C'est précisément ce que nous avons voulu faire avec la réforme des concours et celle de la scolarité. Par la réforme des concours, nous avons voulu nous assurer que les hauts fonctionnaires possèdent des connaissances suffisantes pour que nous puissions les approfondir pendant les deux années de formation à l'École, et qu'ils possèdent les compétences et les aptitudes propres aux carrières auxquelles ils aspirent. Nous avons cherché – et réussi, je l'espère – à introduire une dimension de recrutement plus assumée qu'auparavant dans les concours d'entrée de l'ENA, en particulier lors des épreuves orales d'admission où le parcours, la motivation et le potentiel des candidats constituent les éléments centraux de l'évaluation que font nos jurys.
Par la réforme de la scolarité, nous avons là encore fait le choix assumé, à la demande du Gouvernement, d'être en priorité une école supérieure de management public - tous les mots de cette expression ayant leur importance. En effet, l'ENA n'est pas une business school et n'a pas vocation à faire ce que d'autres font déjà très bien ; un certain nombre de nos élèves nous rejoignent d'ailleurs en ayant déjà étudié dans une école de commerce. D'autre part, l'ENA forme au management public, c'est-à-dire à la conduite d'équipes, de projets et de réformes dans l'action publique, en tenant compte de ses spécificités et de ses objectifs, et de la nature même de ses missions et de ses contraintes. Le management public est donc le fil rouge de la scolarité telle qu'elle a été revue. L'éthique et la déontologie de l'action publique en constituent une dimension importante, de même que la conduite d'équipes, de projets et du changement, mais aussi la transmission de savoir-faire. En effet, préparer un budget, rédiger un texte normatif et passer un marché public ne s'improvisent pas. Ajoutons-y une ouverture volontariste en direction de l'innovation en matière de conception, de mise en oeuvre et d'évaluation des politiques publiques, ainsi qu'une vision de l'action publique à tous les niveaux – national, local, européen et international – et un important volet relatif à l'administration comparée.
Voici, à grands traits, comment a évolué la scolarité à l'ENA. Je rappelle qu'elle dure vingt-quatre mois, dont une année entière consacrée à des stages sur le terrain, que ce soit à l'étranger, en entreprise ou dans les territoires ; la deuxième année est consacrée aux enseignements dont j'ai tracé les grandes lignes. De plus, tous les élèves ont désormais – c'est une nouveauté – l'obligation de souscrire un engagement associatif de leur choix et à leur initiative pendant la durée de leur scolarité, la seule consigne étant qu'ils se mettent au service des populations les plus vulnérables.

M. Philippe Soubirous, secrétaire fédéral de la Fédération générale des fonctionnaires FO, qui siège au conseil d'administration de l'ENA, émet l'idée que le seul corps de sortie de l'ENA soit celui des administrateurs civils ; qu'en pensez-vous ?
D'autre part, nous avons souvent évoqué, au fil de nos auditions, la nécessité de travailler à l'échelle interministérielle. Que représente pour vous – qui êtes diplomate de carrière – cette dimension interministérielle dans le parcours et dans la formation continue de vos élèves ?
La réponse la plus rapide à faire à la suggestion de M. Soubirous serait celle-ci : ce sont les employeurs publics et le Gouvernement qui décident des affectations à la sortie de l'École. Sans me défausser, je rappelle que nous préparons des élèves au recrutement par les employeurs publics qui les demandent. Depuis longtemps et jusqu'à aujourd'hui, les employeurs publics qui recrutent à la sortie de l'ENA sont des administrations qui offrent des emplois d'administrateur civil, mais pas exclusivement : il s'agit également de corps d'inspection et de contrôle – Conseil d'État, Cour des comptes, Inspection des finances ou encore Inspection générale des affaires sociales et Inspection générale de l'administration – ainsi que de tribunaux administratifs, de chambres régionales des comptes, mais aussi de la Ville de Paris et, depuis une date plus récente, de la direction générale de la sécurité extérieure, qui recrute une fois tous les deux ans.
Tout indique dans l'arbitrage rendu chaque année par le Premier ministre concernant les postes de fin de scolarité qu'aucun employeur public ne souhaite cesser son recrutement en sortie de l'École. Lorsque j'ai pris mes fonctions et que j'ai travaillé, avec les équipes de l'École, à la refonte des concours et de la scolarité, j'ai contacté l'ensemble des employeurs publics pour m'enquérir de leur degré de satisfaction concernant les compétences acquises par les élèves sortis de l'École, ce dont nous avons tenu compte dans la rénovation de la scolarité. Tous ces employeurs ont d'emblée annoncé qu'ils souhaitaient recruter davantage d'élèves sortis de l'ENA. Le choix final est un choix politique : il ne me revient pas de juger s'il convient d'affecter les élèves dans l'ensemble de ces administrations, mais de recruter et de former des élèves en fonction des demandes qui me sont faites aujourd'hui, dont je constate qu'elles sont croissantes – ce qui a conduit le Gouvernement à décider de porter le nombre d'élèves en formation initiale de 80 à 90 par promotion. Chaque année, en effet, nous nous trouvions très en deçà des attentes des administrations et des corps de sortie. Une promotion de 90 élèves français reste d'un volume modeste ; s'y ajoutent les trente élèves étrangers qui étudient en formation initiale aux côtés de leurs camarades français.
J'en viens à la question de l'interministérialité. J'ai en effet eu le plaisir et l'honneur d'être diplomate et de servir de nombreuses années en poste à l'étranger ; à cette mobilité géographique s'est ajouté l'honneur de représenter à l'étranger non pas seulement un ministère, mais l'ensemble des administrations publiques. Les diplomates ont cette particularité d'avoir une vocation interministérielle par nature. Enfin, je me suis appliquée à moi-même le principe de mobilité en prenant la direction d'un établissement public dépendant du Premier ministre.
L'ENA n'a jamais eu vocation à former tous les hauts fonctionnaires, mais à former des agents possédant une aisance particulière à l'échelle interministérielle. En médecine, les généralistes sont tout aussi nécessaires que les spécialistes ; de même, la fonction publique a besoin de généralistes maîtrisant pleinement l'interministérialité mais a besoin aussi d'autres profils – loin de moi l'idée de prétendre au monopole de l'ENA dans les postes de la haute fonction publique. Ce sont des compétences à caractère interministériel que la formation dispensée à l'ENA vise à transmettre, ce qui explique qu'il n'y existe pas de filières, chaque élève étant tenu de maîtriser un certain nombre de compétences transversales. Puis, à la sortie de l'École, les élèves signent un engagement à servir l'État pendant dix années au moins et, s'ils souhaitent que leur carrière progresse, ont l'obligation d'effectuer une véritable mobilité statutaire – qui me semble salutaire – pour acquérir d'autres cultures professionnelles et une vision plus large. Cette éventuelle réorientation des carrières est un atout pour les administrations avant même d'être une chance pour les fonctionnaires eux-mêmes.
Permettez-moi, monsieur le président, d'aborder dans l'ordre les trois volets de votre question : recrutement, formation, affectation.
En matière de recrutement, posons-nous d'abord la question suivante : l'État a-t-il besoin de cadres scientifiques ? La réponse tient à la nature des politiques publiques. L'énergie et le développement durable, la ville de demain, le lien entre numérisation et sécurité, l'alimentation ne sont quelques-uns des domaines couverts par les politiques publiques qui, à l'évidence, possèdent une forte dimension scientifique. L'École Polytechnique a également la conviction qu'il se produit des ruptures techniques, scientifiques et technologiques qui produiront de profonds effets sur le développement de demain mais aussi sur le monde dans lequel nous vivons – et, par conséquent, sur les politiques publiques.
L'État peut-il donc se passer de cadres scientifiques ? Non, assurément. Ces cadres scientifiques peuvent-ils n'être que des contractuels recrutés par l'État au fil de l'eau selon ses besoins ? La question a déjà été analysée, et j'en retiens le fait suivant : l'État, compte tenu de ses règles statutaires et de ses échelles de rémunération, n'est sans doute pas en mesure – sauf exception – de recruter de façon viable ses cadres scientifiques en fonction des besoins, à moins de se réformer profondément. J'ai donc la conviction qu'il doit être capable de recruter des cadres scientifiques dans les grands corps techniques de l'État.
Le recrutement tel qu'il se fait actuellement à l'École Polytechnique est-il opportun ? Ne faudrait-il pas organiser un recrutement spécifique, voire consacrer une école à part aux cadres scientifiques de l'État ? En effet, à la différence de l'ENA, l'École Polytechnique forme des élèves qui, en majorité, effectuent leur carrière dans l'industrie ou dans les services, la fonction publique demeurant minoritaire. Il me semble pourtant que cette formule est pertinente pour l'État. D'une part, elle lui permet d'accéder à un vivier de très bons élèves dont bon nombre, parmi les meilleurs, choisissent d'entrer au service de l'État – et dont je ne suis pas certain qu'ils auraient suivi la même voie s'ils n'étaient pas passés par l'École. D'autre part, cette formule nous oblige à nous placer résolument dans le cadre de la compétition internationale d'excellence en matière de qualité de formation, car les étudiants venus du monde entier comparent les formations que nous pouvons leur offrir. Nous sommes ainsi encouragés à élever nos formations au meilleur niveau mondial.
J'en viens à la formation et, tout d'abord, aux valeurs qui la sous-tendent. L'École Polytechnique dispense une formation scientifique pluridisciplinaire qui englobe notamment l'économie, les humanités et les sciences sociales – peu nombreuses en effet sont les écoles d'ingénieurs qui, comme la nôtre, emploient un professeur de philosophie. Autre valeur qui constitue l'ADN de l'École : le sens du collectif et de l'intérêt public. Pendant leurs années de scolarité, les élèves de l'École Polytechnique, avec leurs particularités et leur diversité, sont tous placés dans un environnement qui les encourage à adopter cette valeur. Enfin, nous sommes très attachés à l'engagement des élèves, à leur volonté d'agir, à leur audace, à leur capacité de conduire des projets.
Ces trois dimensions – pluridisciplinarité, sens du collectif et de l'intérêt public, et volonté de s'engager – constituent le socle de la formation que nous dispensons. Elles ne suffisent naturellement pas : ceux de nos élèves qui entrent dans les grands corps de l'État doivent suivre des formations complémentaires au sein de leur corps.
De ce point de vue, je tiens à souligner combien l'État doit veiller à ne pas négliger la formation tout au long de la vie. Nous vivons de profondes transformations. Le maniement des grandes bases de données et les flux d'informations sont au coeur de cette vaste transformation, qui touche à d'autres domaines comme l'énergie, par exemple. Le monde dans lequel nous avons été éduqués n'est pas celui dans lequel vivront les prochaines générations. Les fonctionnaires ne peuvent plus rester à l'écart de ce mouvement au cours de leurs carrières.
La notion d'affectation, enfin, est double : s'agissant des affectations immédiates à la sortie de l'École, une réflexion est en cours sur le maintien du classement de sortie comme clef de l'entrée dans les corps et sur ses modalités. Cette notion dépasse toutefois la seule question du premier poste et touche à la gestion des carrières tout au long de la vie. L'État adopte vis-à-vis des fonctionnaires une logique d'employeur à vie, mais il me semble que de nombreuses directions des ressources humaines de l'État sont au fond moins préoccupées de l'employabilité à long terme de leurs cadres à haut potentiel que ne le sont les entreprises privées.

L'un des objectifs de notre mission vise précisément à étudier comment sont détectés les agents à haut potentiel et comment leur proposer une progression de carrière permettant de les retenir dans la fonction publique – et, ce faisant, veiller à ce que l'État soit administré par les meilleurs agents qui soient dans toutes les situations et à tous les postes. C'est d'autant plus important que le monde change vite, comme vous l'avez dit. Dans quelle mesure vos grandes écoles peuvent-elles proposer des enseignements de formation continue ? La gestion des ressources humaines de l'État est sans doute plus complexe encore que celle des entreprises privées : comment permettre aux fonctionnaires de progresser dans des carrières transversales afin de conserver les meilleurs potentiels ?
Il est indispensable de consentir un vaste effort de formation tout au long de la vie des fonctionnaires à haut potentiel, et nous sommes naturellement prêts à y participer selon nos capacités. L'État doit néanmoins, en premier lieu, exprimer ses besoins. Nous avons eu l'occasion d'aborder ces questions avec telle et telle administration comme la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP). Il est vrai que l'État n'est pas encore doté d'une véritable direction des ressources humaines et la politique de formation continue n'est pas unifiée ; chacun des employeurs publics garde la main dans son champ de compétences.

L'ENA connaît-elle la part de ses anciens élèves qui se trouvent dans le vivier des hauts potentiels ? Quelle est la part de femmes dans ce même vivier, et pour quelles raisons les femmes sont-elles relativement sous-représentées au sein de la haute fonction publique de l'État ?
L'ENA offre, sous différentes formes, des actions de formation continue à la demande d'employeurs publics et intervient à diverses étapes de la carrière des hauts fonctionnaires – qu'il s'agisse de la prise de poste d'un chef de service, d'un sous-directeur ou d'un directeur d'administration centrale, ou des formations proposées aux membres du vivier des hauts potentiels susceptibles de devenir cadres dirigeants. Nous pilotons notamment le cycle interministériel de management de l'État.
L'École n'effectue pas de statistiques concernant la carrière de ses anciens élèves, puisque cette mission incombe tout à la fois à la DGAFP et à l'association des anciens élèves de l'ENA. Les cohortes du cycle interministériel de management de l'État – soixante élèves par an ces dernières années et même une centaine d'élèves pour la dernière cohorte, fin 2015 – sont d'origines variées : anciens élèves de l'ENA, recrutement spécialisé de certaines administrations, corps techniques et, le cas échéant, contractuels de haut niveau recrutés dans la haute fonction publique. Ce vivier est divers tant en termes de parcours qu'en termes d'âge – une situation qui témoigne du fait que chaque corps possède sa propre définition des hauts potentiels.
La parité entre les sexes dans la fonction publique n'est ni pire ni meilleure que dans le secteur privé. La concordance des chiffres est frappante, en effet : dans le secteur privé comme dans le secteur public, les femmes représentent 12 % des cadres dirigeants. Pourtant, 60 % des diplômés de l'enseignement supérieur au niveau du master sont des femmes ; une telle sous-représentation des femmes parmi les cadres dirigeants signifie que nous laissons filer entre nos doigts des personnes de talent. L'administration ne saurait se satisfaire d'un tel gâchis.
La parité n'est pas non plus respectée au stade du recrutement à l'ENA, même si nous avons atteint un nouveau record lors d'une promotion récente, il y a deux ans, avec 45 % de femmes. C'est un taux supérieur à la part des femmes parmi les candidats, qui ne dépasse jamais 40 %. Il est vrai que l'ENA constitue une étape tardive dans un système scolaire et universitaire qui, manifestement, discrimine lui-même entre hommes et femmes, mais aussi entre origines sociales. La quasi-totalité de nos élèves ont un niveau bac + 5 ; or, ce vivier n'est pas représentatif de la société française. Cela étant, avec 40 % de candidates, l'ENA a atteint ce qui n'est encore qu'un objectif dans d'autres écoles… Nous veillons en outre à ce que le concours lui-même ne soit pas discriminant. De plus, nous sommes certains que la scolarité ne l'est pas : les résultats des femmes sont au moins aussi bons que ceux des hommes et leurs scolarités identiques. La moitié des vingt premiers élèves au classement de sortie sont des femmes, et les majors des deux dernières promotions sont des femmes, la première issue du troisième concours et la seconde du concours interne – et j'ajoute, pour couper court à tout cliché, que l'une et l'autre sont mères de famille. Autrement dit, lorsque le talent existe, il est valorisé.
En revanche, le déroulement des carrières dans la fonction publique demeure problématique puisque le recrutement est plus diversifié que l'accès aux plus hautes fonctions. De ce point de vue, la loi Sauvadet de 2012 nous a permis de franchir un certain nombre d'étapes : l'obligation de nommer 30 % de femmes cette année parmi les primo-nominations à des emplois de cadres dirigeants a été respectée ; l'an prochain, cette part sera portée à 40 %, un objectif qui suscite une certaine inquiétude. C'est à tous les échelons de la chaîne qu'il nous faut travailler, notamment à celui de l'encadrement intermédiaire et à celui de la création, de l'accompagnement et de la formation d'un vivier. L'ENA a pris l'initiative de proposer parmi ses formations sur catalogue des formations spécifiques pour les femmes qui souhaitent progresser dans leur carrière, afin de contribuer à briser le plafond de verre qui existe encore aujourd'hui.
En matière de parité, il va sans dire que la situation de l'École Polytechnique ne nous satisfait pas : les filles ne représentent que 18 % de nos élèves. Cet état de fait n'est pas lié au concours : les épreuves écrites sont anonymes, et aucun déséquilibre ne se produit entre les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission.
Notre résultat demeure faible, pourtant. Nous payons pour partie le fait qu'à notre grand regret, de nombreuses filles se détournent des études scientifiques : en classe de terminale, les filles sont davantage tentées par des études de médecine et les garçons par des études d'ingénieurs. Nous participons à de nombreuses initiatives de communication dans les lycées pour expliquer que les métiers d'ingénieurs ne sont ni déprimants ni enfermés et qu'ils ne consistent pas seulement en un long tête-à-tête avec des modèles informatiques ; au contraire, ce sont des métiers très divers qui peuvent être passionnants pour les filles. Notre message se heurte néanmoins à toute une culture.
Pour améliorer la diversité de notre recrutement, nous ouvrirons dès l'année prochaine un recrutement dans la filière biologie des classes préparatoires, où les filles sont beaucoup plus nombreuses que les garçons. Nous espérons ainsi faire progresser la part des filles dans les élèves de l'École.

Quelles pistes peut-on explorer pour améliorer la diversité des origines des élèves, sachant qu'il s'agit d'un effort de longue haleine ?
Nous avons beaucoup travaillé sur cette question, en commençant par analyser le concours d'entrée. J'étais prêt, le cas échéant, à supprimer l'épreuve d'anglais, mais c'était une idée fausse : si la part de boursiers passe de 30 % parmi les candidats à 20 % parmi les admis, ce n'est en raison ni des épreuves orales, ni des épreuves de français, ni des épreuves de langue, mais au stade des épreuves écrites anonymes de mathématiques et de physique. Pour analyser davantage ce phénomène, nous avons consulté des sociologues, lesquels ont confirmé que les candidats bien préparés ont plus de chances de succès – ce qui semble aller de soi mais vaut la peine d'être dit. Nous recrutons principalement des élèves sortant des classes préparatoires ; or, certaines préparent mieux à l'entrée à l'École Polytechnique que d'autres.

Il va sans dire, en effet, qu'il vaut mieux faire ses classes préparatoires au lycée Henri-IV ou au lycée Louis-le-Grand qu'à celui de Reims…
Tout à fait. Cela étant, la mobilité nationale s'est beaucoup renforcée avec la mise en place du portail Admissions Post-bac ; les grands lycées parisiens et provinciaux ont désormais un bassin de recrutement qui dépasse la seule échelle locale pour s'étendre à l'échelle nationale – sauf pour les boursiers. Les statistiques attestent en effet de la mobilité des élèves non boursiers, tandis que les jeunes boursiers sont beaucoup moins mobiles et ont plutôt tendance à rester dans la classe préparatoire de l'établissement de leur région. Nous voulons lutter contre ce phénomène en permettant à ces élèves d'accéder à un internat d'excellence.
L'École ne le créera pas seule, car il suppose de s'appuyer sur les compétences, l'expérience et les savoir-faire de classes préparatoires partenaires. Nous pourrions convenir d'un accord avec le lycée Blaise-Pascal d'Orsay, un excellent lycée qui a l'avantage de se trouver à proximité immédiate de l'École.
Tel qu'il est conçu à ce stade, ce projet consiste plutôt à augmenter le nombre de classes préparatoires au lycée d'Orsay qui, étant très proche, éviterait aux élèves de perdre leur temps dans les transports. Des élèves boursiers provenant de toute la France pourraient ainsi y être accueillis ; nous devons cependant nous garder de créer un « ghetto » à boursiers. C'est pourquoi il convient d'augmenter le nombre et la diversité des classes préparatoires de ce lycée.

Pourquoi ne pas instaurer un système de quotas dans les meilleures classes préparatoires comme Sainte-Geneviève Ginette, Louis-le-Grand, Henri-IV ou le lycée du Parc à Lyon, les obligeant à accueillir une certaine part d'élèves boursiers afin qu'ils puissent être préparés comme les autres ? En effet, les taux de succès varient profondément selon les établissements.
Les études montrent que la faible diversité d'origine des élèves des grandes écoles, qu'il s'agisse de l'École Polytechnique ou plus encore de l'ENA, où l'on rentre plus tard dans la scolarité, tient à l'espace culturel de la famille. Certains enfants très doués n'osent pas se présenter aux concours des grandes écoles, qu'ils estiment réservés aux enfants privilégiés. C'est à ces élèves brillants qu'il faut proposer dès la classe de terminale de faire une classe préparatoire dans les meilleurs lycées en bénéficiant d'une bourse substantielle, et non pas des modiques bourses actuelles. À titre d'exemple, il y a dans ma circonscription un garçon extrêmement doué qui souhaite se préparer au concours d'entrée à l'École normale supérieure à Reims ; je plaide auprès de ses parents – de grands exploitants agricoles qui ont des moyens financiers – pour qu'il entre plutôt dans une grande classe préparatoire parisienne. Autrement dit, c'est l'idée même de monter à Paris qui effraie certains élèves contraints par les limites de leur espace culturel.
Vous faites par ces propos, monsieur le député, le lien avec l'autre volet de notre action en la matière, qui consiste – toutes proportions gardées – à tenir le rôle que tenaient autrefois les instituteurs de la Troisième République. Les élèves de l'École Polytechnique commencent tous leur scolarité par un semestre de stage, dont nous souhaitons qu'il soit un stage d'ouverture. Nombreux sont ceux qui l'effectuent dans des lycées ou en zone d'éducation prioritaire, où ils peuvent saisir cette occasion pour détecter les élèves à très fort potentiel qu'il conviendrait de suivre au lycée afin de leur donner toutes les chances d'atteindre le meilleur niveau et d'accéder aux meilleures classes préparatoires.
S'y ajoute la réalité des lycées français : certains couvrent le programme et préparent leurs élèves à réussir le baccalauréat, d'autres s'attaquent dès le début de la classe de terminale au programme post-baccalauréat. C'est un facteur de rupture de l'égalité des chances pour les jeunes qui, lors du baccalauréat, se trouvent moins bien préparés pour enchaîner en classe préparatoire. C'est pourquoi nous souhaitons confier à nos élèves en stage dans toute la France la mission de repérer, en lien avec les lycées, un vivier de très bons élèves qui méritent d'être accompagnés, afin de leur proposer des stages à l'École pendant les vacances pour leur permettre d'améliorer leur compétitivité en fin de terminale par rapport à leurs camarades sortant des meilleurs lycées.

Pourquoi ne pas obliger les meilleurs lycées à accueillir un certain pourcentage de boursiers, dont les frais d'études seraient intégralement pris en charge ? On permettrait ainsi à de très bons élèves de surmonter leur peur de Paris et l'on éviterait ce faisant un important gâchis.
J'ignore s'il faut formuler le problème en termes de quotas. Les classes préparatoires avaient pour objectif d'accueillir une moyenne de 30 % d'élèves boursiers. Pour en avoir parlé avec plusieurs proviseurs, je constate qu'ils font un très bon accueil à notre projet de servir de poisson-pilote pour détecter les très bons élèves, encourager leur ambition et participer à leur mise à niveau.

Vos élèves en stage viendront-ils au lycée de Vitry-le-François ou dans d'autres lycées modestes ?
Plus de la moitié des 400 élèves français que nous formons chaque année effectuent leur stage dans les forces ; plus d'une centaine peuvent le faire dans des lycées répartis sur tout le territoire, l'idée étant précisément qu'ils aillent là où ils sont utiles, et non pas seulement dans les grands lycées – bien au contraire.

Venons-en au lien entre l'accès aux cabinets ministériels et l'avancement de carrière, sur lequel s'interroge notre mission.
Les anciens élèves de l'ENA représentent 25 % des membres des cabinets ministériels – lesquels ne sont donc pas « pleins d'énarques », comme on l'entend parfois. C'est une part certes significative, mais pas monopolistique.

À quel stade de leur carrière les anciens élèves intègrent-ils les cabinets ministériels ?
C'est très variable. À titre personnel, j'estime qu'il faut raison garder et constater que notre système n'a pas d'équivalents au-delà de nos frontières. Des cabinets ministériels aussi fournis, notamment par de jeunes fonctionnaires, constituent une exception française. Certaines exceptions sont positives, peuvent susciter notre fierté et doivent être sauvegardées à tout prix ; je m'interroge toutefois sur le poids qu'exercent les cabinets sur le fonctionnement de nos administrations. J'envie parfois nos collègues britanniques car, au Royaume-Uni, chaque ministre est le patron de sa propre administration et travaille avec ses directeurs, ainsi qu'avec une poignée de conseillers dont le rôle et la légitimité sont politiques. Je dis ceci avec sans aigreur aucune, puisque j'ai moi-même été membre d'un cabinet ministériel.
Certains anciens élèves sont recrutés dans les cabinets ministériels après cinq, dix voire vingt ans de carrière ; d'autres le sont beaucoup plus tôt. De jeunes anciens élèves à qui l'on a proposé un poste en cabinet m'accordent la confiance de me demander conseil sur la décision à prendre, et j'ai plutôt tendance à les en décourager. J'estime en effet que lorsque l'on manque d'expérience, on manque aussi d'utilité et d'autorité pour exercer une telle fonction.
En revanche, l'impact d'un passage en cabinet ministériel sur le déroulement ultérieur des carrières est manifeste. À titre personnel, là encore, le bon fonctionnement de l'État gagnerait à ce qu'une durée minimale de service soit imposée avant d'entrer dans un cabinet. Longtemps, cette durée fut fixée à quatre années ; ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il me semble également qu'un certain nombre de conditions devraient être respectées avant d'exercer des responsabilités d'encadrement élevées après un passage en cabinet. Ainsi, je m'étonne parfois qu'un passage en cabinet soit comptabilisé comme une mobilité, ce qui n'était pas le cas lorsque j'étais directrice des ressources humaines. Cette pente pourrait se révéler dangereuse pour les intéressés eux-mêmes, car les responsabilités de direction d'un établissement public ou au sein d'une administration les exposent à des devoirs et à des attentes ; pour y satisfaire, il faut selon moi avoir préalablement acquis un certain nombre d'expériences.

Contrairement à ce que croient la droite et la gauche populiste, tous les fonctionnaires n'ont pas l'ambition d'exercer dans un cabinet ministériel. De fait, les bons et loyaux serviteurs de l'État sont alors défavorisés. Au fond, la motivation des candidats qui se présentent aux trois concours d'entrée à l'ENA a beaucoup changé. La rigueur nous obligerait à fixer un délai de quatre années d'exercice avant d'effectuer une mobilité, laquelle serait obligatoire pendant deux ans, et à interdire tout passage en cabinet ministériel avant six années d'ancienneté. Je connais d'excellents élèves que l'action politique n'intéresse pas et qui ne souhaitent pas entrer à l'ENA, convaincus qu'elle les conduirait à accomplir une carrière erratique et embouteillée par ceux que l'on récompense de leurs bons, et parfois déloyaux services, en les propulsant à un poste de sous-directeur après avoir doublé leurs camarades de promotion qui, eux, sont de bons et loyaux serviteurs de l'État. Comment gérer les cadres supérieurs de la fonction publique avec de telles pratiques ?
Il faut donc selon moi aller plus loin encore que ce que propose Mme la directrice en interdisant les passages en cabinet ministériel avant six années d'exercice. Si nous étions réformistes, nous adopterions même le modèle britannique, qui éviterait les grands ménages que font tous les gouvernements. Que conseillent des conseillers sans expérience ? Ce mécanisme n'est dans l'intérêt ni de la République, ni des gouvernements successifs, ni de la bonne gestion de la haute fonction publique.
Au-delà de la question des cabinets ministériels, j'ai animé à l'automne dernier un groupe de travail sur les relations entre l'École Polytechnique et l'État ; l'un de ses principaux messages a porté sur la respiration entre le secteur public et le secteur privé et le respect des règles de déontologie. Ces règles permettent par exemple à tout fonctionnaire ayant contribué aux politiques publiques relevant d'un secteur donné de travailler dans ce même secteur à l'étranger mais pas en France. Chaque abus se traduit certes par une tendance naturelle à durcir les règles, ce qui est compréhensible mais entrave parfois les mouvements dans un sens comme dans l'autre. Or, la perspective que de tels mouvements soient difficiles pourrait à terme dissuader certaines personnes d'entrer dans la fonction publique par crainte d'y rester enfermées. Cela nuirait fondamentalement aux intérêts de l'État en tant qu'employeur, qui doit pouvoir respirer en attirant des compétences venues de l'extérieur et, inversement, en permettant à certains de ces ingénieurs de poursuivre une partie de leur carrière ailleurs.

La notion de respiration suppose des allers et des retours. Or, les retours sont très rares et ne se produisent guère qu'en cas d'échec de carrière dans le privé. Cela s'explique en premier lieu par l'écart de rémunération, parfois du simple au triple voire au quadruple, qui dissuade les intéressés de retourner dans la fonction publique. Une autre raison tient à la déontologie : le départ d'un cadre supérieur dans un secteur dont il a eu connaissance par ses fonctions dans l'administration n'est pas soumis à une consultation obligatoire. Au contraire, ne faudrait-il pas exiger un avis conforme ? Il n'est pas admissible, en effet, que des fonctionnaires de la direction du Trésor ou d'autres directions de la fonction publique partent exercer dans le secteur privé en conservant le même champ de compétences. En somme, rien n'a changé en matière de respiration – une question dont nous débattions pourtant déjà il y a plus de trente ans.