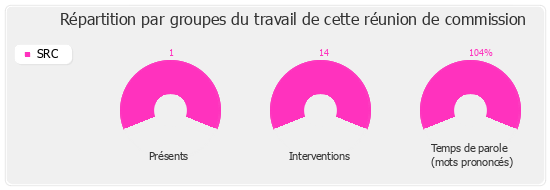Délégation de l'assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
Réunion du 23 mars 2016 à 16h00
La réunion
La séance est ouverte à 16 heures 15.
Présidence de Mme Catherine Coutelle, présidente.
La Délégation procède à l'audition de Mme Suzy Rojtman, porte-parole du Collectif national pour les droits des femmes (CNDF), de Mme Marilyn Baldeck, déléguée générale de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), de Mme Sandra Gidon, directrice de l'Association d'accompagnement global contre l'exclusion (ADAGE), et de Mme Élise Moison, déléguée générale de l'association Force Femmes, sur l'égalité professionnelle et l'avant-projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs.

Le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs sera présenté demain en conseil des ministres. Plusieurs modifications ont déjà été apportées à l'avant-projet de loi par rapport à la première version transmise au Conseil d'État.
Certaines des associations que vous représentez m'ont alertée sur l'impact de dispositions prévues par ce texte sur les femmes et l'égalité dans le monde du travail. Nous souhaiterions donc vous entendre sur ces sujets et recueillir vos observations sur l'avant-projet de loi – au moins sur le texte initial et, si possible, sur la version modifiée de celui-ci – ainsi que sur les améliorations que proposez. Ainsi, nous pourrons regarder ensuite si elles ont été prises en compte dans le projet de loi qui sera présenté demain et, dans le cas contraire, s'il convient de modifier celui-ci par voie d'amendements. Il nous faut en effet travailler, dans des délais resserrés, sur une version non encore stabilisée de ce texte.
Je précise tout d'abord que mon propos porte sur l'avant-projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs et que nous avons essayé de prendre en compte les dernières annonces du Premier ministre. Si ce texte constitue une entreprise de précarisation générale pour tous les salariés de droit privé, certaines dispositions auront des conséquences particulières pour les femmes, parce qu'elles sont plus souvent concernées que les hommes par les emplois précaires, les temps partiels et les salaires les plus bas, et parce que ce sont aussi elles qui constituent, avec leurs enfants, la grande majorité des familles monoparentales.
Il est d'ailleurs révélateur que le rapport du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP) n'ait pas été rendu public. Il n'y a pas non plus d'étude sur l'impact de ces dispositions sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
L'inversion de la hiérarchie des normes constitue l'un des axes de ce projet de loi, en proposant de faire primer les accords d'entreprise sur les accords de branche ou la loi. Or les femmes sont surtout présentes dans les entreprises sous-traitantes et dans les très petites, petites et moyennes entreprises (TPE-PME), par exemple dans le commerce et l'aide à domicile, où il y a moins d'implantation syndicale, et donc moins de possibilité de négocier et de se mobiliser. Faire primer les accords d'entreprise entraînera donc une baisse des droits et des garanties dans les secteurs à prédominance féminine. S'agissant de la négociation sur l'égalité professionnelle, la durée de vie des accords serait limitée à cinq ans, sans garantie de maintien des avantages acquis en l'absence de nouvel accord.
L'avant-projet de loi multiplie aussi les dérogations aux règles relatives au temps de travail : les temps d'astreinte pourraient ainsi être décomptés des temps de repos ; par ailleurs, des accords d'entreprise pourraient déroger à la durée maximale de travail de quarante-quatre heures, pour la porter à quarante-six heures sur douze semaines. Or ce sont les femmes qui prennent très majoritairement en charge les tâches domestiques, l'éducation des enfants et l'accompagnement des personnes dépendantes : si ces mesures sont adoptées, elles devront donc concilier ces contraintes personnelles avec une durée de travail plus importante. Il y a des femmes qui travaillent trop et d'autres pas assez. L'extension du forfait jours, prévue par l'avant-projet de loi dans les entreprises de moins de 50 salariés, risque d'instaurer comme norme le présentéisme, qui concourt au plafond de verre. Or cette norme se fait au détriment des femmes qui, en raison des contraintes familiales qui leur incombent, ne peuvent être présentes aussi longtemps que les hommes sur leur lieu de travail. Et cela pourra se faire d'ailleurs avec le simple accord d'un salarié mandaté, et l'on connaît la fragilité de ce dispositif : il peut s'agir par exemple de la secrétaire de l'employeur.
Concernant les temps partiels, les dispositions sur la durée minimale de vingt-quatre heures, prévues par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, avec toutefois plusieurs possibilités de dérogation, notamment par un accord de branche, seraient de fait assouplies puisque l'avant-projet de loi prévoit que cette durée minimale serait désormais fixée par les accords de branche. Ce n'est qu'en l'absence d'accord que cette durée minimale serait de vingt-quatre heures. En outre, nous craignons que le taux de majoration des heures complémentaires soit de 10 %, et non de 25 % à partir d'un dixième des heures prévues dans le contrat, comme c'est le cas actuellement. Par ailleurs, les changements d'horaires seraient possibles avec un délai de prévenance de trois jours, alors que dans l'état actuel du droit, ce délai est de sept jours, sauf si un accord de branche ou d'entreprise prévoit une durée inférieure.
De même, les femmes seront davantage affectées par la disposition du projet de loi prévoyant que la durée minimale de congés légaux sera déterminée par un accord d'entreprise ou de branche. C'est le cas du congé de solidarité familiale, qui est accordé en cas de pathologie grave d'un membre de sa famille, et ce congé pour accompagner un proche en fin de vie est pris très majoritairement par les femmes. Un accord d'entreprise ou, à défaut, de branche, pourrait déterminer la durée maximale de ce congé et le nombre de renouvellements possibles, alors qu'actuellement ce congé est d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il en va de même pour le congé de proche aidant, qui permet d'accompagner une personne âgée dépendante ou un proche en situation de handicap. En outre, alors qu'un employeur ne peut changer aujourd'hui les dates de congés payés d'un de ses salariés un mois avant leur commencement, l'avant-projet de loi permet qu'un accord collectif, dans l'entreprise ou dans le secteur, réduise ce délai.
Ce texte accroît par ailleurs la flexibilité du travail en permettant une modulation du temps de travail sur une période allant jusqu'à trois ans actuellement, au lieu d'un an actuellement. En l'absence d'accord, elle ne pourra dépasser un mois, comme c'est le cas aujourd'hui, sauf dans les entreprises de moins de 50 salariés, qui pourront aller jusqu'à seize semaines sous réserve d'un accord validé par un salarié mandaté. Là encore, les femmes, qui doivent très souvent concilier leur vie professionnelle avec des impératifs familiaux, par exemple aller chercher les enfants à l'école, ne seront donc plus en mesure de maîtriser leurs horaires.
Si le Gouvernement a renoncé au fractionnement du repos quotidien de onze heures, l'article 26 du projet de loi prévoit qu'une concertation sera engagée avant le 1er octobre 2016 « sur le développement du télétravail et du travail à distance » et qu'elle portera également sur « l'évaluation de la charge de travail des salariés en forfait jours, la prise en compte des pratiques liées aux outils numériques pour mieux articuler la vie personnelle et la vie professionnelle, ainsi que sur l'opportunité et, le cas échéant, les modalités du fractionnement du repos quotidien ou hebdomadaire de ces salariés ». La réforme du repos quotidien est donc encore envisagée.
L'avant-projet de loi prévoit aussi de réformer la médecine du travail. Il propose de supprimer la visite d'aptitude obligatoire et de centrer le suivi médical sur les salariés dits à risques. Or les risques et la pénibilité des métiers à prédominance féminine sont sous-évalués : c'est le cas par exemple de professions comme les caissières de supermarché ou les aides à domicile. On mesure donc l'impact d'une telle réforme sur la santé de ces salariées.
Cet avant-projet de loi, qui répond aux volontés du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), part du principe que pour créer des emplois, il faut faciliter les licenciements, ce que nous trouvons aberrant. C'est pourquoi nous ne pouvons que le combattre et exiger son retrait, et nous serons dans la rue le 31 mars pour porter cette revendication.

Je donne à présent la parole à Mme Sandra Gidon, directrice de l'association ADAGE, qui accompagne des publics fragilisés en matière d'insertion sociale et professionnelle.
Je vous remercie tout d'abord de m'avoir invitée, Mme la présidente, à un moment où nous avons certaines inquiétudes en matière d'égalité professionnelle, concernant en particulier le non-remplacement à la préfecture de région d'Île-de-France de la chargée de mission qui s'occupait de l'égalité professionnelle, dont la mission va être intégrée dans les attributions de la personne chargée de l'accès aux droits et des violences, ainsi que la transformation, à la mairie de Paris, de la mission « égalité femmes-hommes » en un poste de chargé de mission « égalité, insertion et inclusion ».
Je souhaite ici évoquer notre expérience de terrain : ADAGE est une jeune association, même si nous avions travaillé auparavant dans le domaine de l'insertion, qui accueille environ trois cents femmes par an, et nous salarions environ quinze personnes dans notre chantier d'insertion.
En 2012, nous avons été stupéfaits de constater que, pour la première fois, une femme salariée par notre association avait été contrainte de dormir dehors avec son fils. De fait, l'emploi ne protège plus de la pauvreté. Par ailleurs, en voyant revenir des femmes plus fréquemment, nous avons décidé de mener une étude, en 2014 et 2015, sur une cohorte de cent trente femmes, et ces données chiffrées sont très préoccupantes. Ainsi, sur environ 60 % de sorties positives en emploi, on observe une diminution de l'ordre de 50 % des embauches en contrat à durée indéterminée (CDI), tandis que le nombre de contrats à durée déterminée (CDD) de moins de six mois était environ 2,5 fois plus élevé.
Des femmes sont donc en CDD de trois ou quatre mois, et cette précarité les expose à des difficultés particulières en termes de logement et à des temps de transports importants. Pourtant, ces femmes sont prêtes à faire de grands sacrifices pour travailler. Je peux citer l'exemple de cette femme ingénieure des eaux et forêts qui a un trajet de deux heures et demie pour aller travailler. En outre, le renouvellement des papiers constitue un obstacle au maintien dans l'emploi, et il devient par ailleurs de plus en plus difficile de maintenir des droits entre deux CDD.
Dans le projet de loi présenté par Mme Myriam El Khomri, j'ai vu qu'il était beaucoup question du temps de travail, mais le temps des femmes en situation de précarité est occupé par les temps de transports, les démarches administratives et la santé, notamment. Avant, un emploi permettait de sortir de la pauvreté et de sécuriser un parcours, en permettant la mobilité sociale, l'accès à un logement, aux droits, à la santé, etc., mais aujourd'hui, le travail est source d'insécurité. Actuellement, beaucoup de femmes ont des plannings à la semaine, par exemple dans le domaine de la distribution et des services à la personne, où il y a aussi du travail au noir : comment organiser sa vie familiale quand on ne connait pas son planning au-delà d'une semaine ? Une aide-comptable me disait par exemple récemment qu'elle avait espéré que son CDD serait transformé en CDI et qu'elle avait tout fait pour s'insérer dans une entreprise, mais que son contrat ne serait malheureusement pas renouvelé et qu'elle craignait de ce fait de ne pas pouvoir payer les frais de scolarité de son fils à la rentrée. Par ailleurs, les droits changent entre deux CDD, et comme ailleurs les aides à l'emploi sont concentrées sur les bas salaires, ces personnes sont souvent rémunérées au SMIC.
Sur les cent trente femmes que nous avons suivies, 12 % ne savent pas lire et un tiers ont au moins le baccalauréat et jusqu'à bac +5 – et lorsque l'on voit le type de postes auxquels elles accèdent ensuite, il y a clairement une déqualification : autrement dit, les femmes acceptent le premier emploi pour sortir de la misère, et cela nous inquiète beaucoup. Par ailleurs, de plus en plus d'employeurs proposent à des femmes de travailler avec le statut d'auto-entrepreneur. Autrement dit, il n'y a plus de garanties et, plus généralement, trouver en emploi n'est plus automatiquement synonyme d'amélioration des conditions de vie.
Par ailleurs, la réforme de la formation professionnelle n'est pas bénéfique pour nos publics qui ont besoin d'une formation, qui ne soit pas forcément qualifiante ou très spécialisée. Ainsi, la préparation aux concours d'aide-soignante et d'auxiliaire de puériculture n'est pas considérée comme une formation qualifiante et n'est pas prise en charge financièrement par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).
Un mot également sur la réforme de l'économie sociale et solidaire, qui a favorisé les grosses structures alors que nous sommes une petite structure, et nous tenons à le rester. Il nous est ainsi souvent proposé de développer plusieurs chantiers d'insertion, alors que nous souhaitons n'en avoir qu'un seul.

Les grosses structures sont-elles favorisées par la loi ou par sa mise en oeuvre par des collectivités locales ou des acteurs de terrain ? Pourquoi vous est-il demandé de vous développer ?
Parce que nous obtenons de bons résultats, parce que c'est la tendance actuelle et qu'il n'y a plus ainsi qu'un interlocuteur... La loi réformant le secteur de l'économie sociale et solidaire a en effet favorisé les grosses structures. L'insertion par l'activité économique est l'un de nos outils, et nous sommes confrontés à des difficultés, comme c'est le cas pour plusieurs chantiers d'insertion.
Il convient par ailleurs de souligner l'importance des enjeux liés à la fracture numérique en termes d'accès à l'emploi et de maintien dans l'emploi. Quand des femmes sont hébergées à l'hôtel ou dans des conditions indignes, elles n'ont pas d'ordinateur ni de tablette, et elles n'ont pas forcément accès à internet, or il est aujourd'hui important de maîtriser les compétences numériques dans l'emploi. Pour les personnes précaires, c'est une réelle difficulté. Plus généralement, les femmes que nous accueillons veulent travailler, elles sont formidables de dignité et de courage, et nous vous invitons d'ailleurs à venir les rencontrer,

Merci de cette proposition. Je comprends que l'association est implantée uniquement à Paris ?
L'idée est plutôt de rester une petite structure qui accueille peu de gens, mais à taille humaine, et d'essaimer nos pratiques, à travers la formation des professionnels notamment. Par exemple dans le cadre de notre chantier d'insertion, nous avons accueilli des personnes venant de Lille ou du Sud de la France. A contrario, la fusion ANPE – Assedic a suscité des inquiétudes, et certains craignent d'ailleurs aujourd'hui une privatisation. En tout état de cause, quand il n'y a plus que de très grandes agences, et qu'il est difficile de joindre par téléphone un conseiller de Pôle Emploi, cela pose des difficultés pour les personnes en situation de précarité.

Merci de ce témoignage très intéressant sur ces femmes qui cherchent à travailler et doivent surmonter un certain nombre de difficultés– logement, transports, enfants, etc. – outre la recherche d'emploi.
Mais c'est aussi la dégradation des conditions de travail qui nous préoccupe : c'est terrible d'aider une femme à retravailler, alors que ses conditions de vie ne s'améliorent pas, et cela conduit nécessairement à réinterroger notre travail.

Il est vrai que notre société comprend différents types de travailleurs, et notamment des personnes en contrat en CDI et à temps plein, tandis que les femmes beaucoup plus précarisées et à temps partiel, avec des difficultés pour accéder au CDI ou au temps plein. Et pour certaines personnes, le travail est déjà très flexible, pour d'autres beaucoup moins – c'est toujours le problème dans l'écriture de la loi qui s'applique à tous. Pour les femmes, et du moins certaines d'entre elles, on constate déjà une grande flexibilité dans le travail mais aussi que ce sont les moins flexibles dans le domaine personnel, du fait des contraintes horaires liées à l'école, la crèche, etc. : c'est le problème, bien connu, de la « double journée ». Cependant, une partie de cette journée ne peut se moduler aisément.
À cet égard, je précise que nous avons 30 % de CDI et 70 % de CDD. Ces problématiques touchent tout le monde.

La jeunesse est très sensible à la loi, même si rien ne la concerne spécifiquement et directement, mais aujourd'hui on sait que les jeunes n'entrent sur le marché du travail qu'en CDD, avec des contrats courts renouvelés, des stages, etc., et il est difficile dans ces conditions de louer un appartement et de se stabiliser.
Il me semble que cela touche également les parents de ces jeunes qui sont dans la rue. En tout cas, dans les quartiers, on ressent un grand désespoir des jeunes et il peut être difficile de voir des parents qui ont beaucoup travaillé être malmenés sur le plan professionnel après cinquante ans.

Il est vrai que cela inquiète les parents, en particulier lorsqu'ils ont eu confiance dans la formation initiale et les diplômes, alors que cela ne débouche pas nécessairement aujourd'hui sur un emploi stable en CDI.
L'association Force femmes accompagne les femmes de plus de 45 ans au chômage, et qui sont donc confrontées à une double discrimination, de l'âge et du genre, qui peut être très violente. En moyenne, les femmes suivies par l'association ont 52 ans et sont au chômage depuis un an ; il s'agit donc globalement des parents de ces enfants que vous évoquiez. Par ailleurs, la plupart d'entre elles sont seules. La question du partage des tâches ne se pose donc pas, car il leur incombe de les assumer intégralement. Par ailleurs, trop souvent, il s'agit de femmes seules avec des enfants à charge qui ne reçoivent pas de pensions alimentaires notamment. Des questions juridiques se cumulent alors avec le « mille-feuille » de problématiques auxquelles elles peuvent être confrontées en lien avec l'emploi, la garde d'enfants, la mobilité professionnelle ou géographique ou encore les problèmes de santé, ce qui n'est pas chose rare chez une femme de 52 ans en moyenne.
Certes les enfants sont plus grands, mais il faut tout d'abord souligner que l'âge de 52 ans est une moyenne et nous avons quand même une fois tous les deux mois environ une femme accompagnée d'un enfant qui attend dans la salle d'attente, parce qu'il est âgé de cinq ou six ans seulement. Par ailleurs, même si les enfants sont plus grands, ils sont toujours présents et coûtent toujours chers – je pense par exemple à la situation d'une personne seule avec trois adolescents à charge.
Depuis dix ans, nous accompagnons vers l'emploi les femmes plus de 45 ans. Concernant la question des diplômes et du niveau académique– même si, pour ce public, on parle plutôt d'expériences et de compétences –, il s'agit d'une population qui a quand même un niveau de bac + 2 en moyenne. Je précise que l'association a accueilli environ 20 000 femmes dans les dix villes où nous sommes présents. En Île-de-France, qui représente environ 50 % de notre activité, c'est même un niveau bac + 4 ou bac + 5. Cette question du niveau académique est donc devenue un non-sujet.
Ces femmes ont notamment pour atouts l'expérience, la capacité de recul, l'organisation et l'autonomie, mais leur profil est associé à d'importants stéréotypes : en caricaturant à peine, elles peuvent envoyer 400 curriculum vitae pour recevoir finalement deux réponses négatives. C'est donc très démobilisant, avec aussi un risque d'isolement et de perte de confiance en soi, voire de perte de repères, avec une définition parfois floue du projet professionnel. Des jeunes peuvent avoir des difficultés à compléter leur CV pour ce qui concerne leurs expériences, mais pour nous, une difficulté importante tient à la prise en compte de vingt, vingt-cinq ou trente d'expériences professionnelles sur une page de CV. Et lorsqu'elles se présentent à Force femmes – ou dans d'autres associations qui proposent un accompagnement vers l'emploi, même si elles sont encore trop peu nombreuses – ces femmes nous disent que personne ne les a jamais vraiment aidées et qu'elles ont seulement reçu un SMS de Pôle Emploi six mois auparavant…
Il y a donc un besoin important d'accompagnement pour la définition du projet professionnel et la connaissance du marché de l'emploi, mais aussi leur apporter un appui concernant les passerelles et les formations. Par exemple, que faire lorsque tel métier n'existe plus ou que le secteur d'activité est bouché ? Environ la moitié des femmes que nous accompagnons ont été licenciées. Environ un quart des femmes sont accueillies suite à une fin de mission, mais les trois quarts sont là suite à un licenciement pour motifs économiques. Par ailleurs, contrairement à ce que certains peuvent penser, seulement 2 % des femmes environ que nous accompagnons n'ont jamais travaillé.
En direction de ces femmes qui se retrouvent au chômage, l'association est centrée sur l'accompagnement vers l'emploi – nous ne sommes pas un chantier d'insertion – mais on voit à quel point le millefeuille des problématiques connexes vient compliquer la recherche d'emplois. Il peut s'agir de problèmes de logement, de surendettement, voire malheureusement de prostitution, ou encore de santé et d'addictions. La question des violences doit toutefois être mise à part, car elles ne surviennent pas dans le cadre de cette perte d'emplois.
Nous proposons un accompagnement intensif de recherche d'emploi, et nous avons ainsi suivi 20 000 femmes en dix ans dans une dizaine de villes en France. Force Femmes s'appuie sur un réseau de 600 bénévoles, qui sont des spécialistes des ressources humaines, car nous sommes partis du principe qu'il s'agit de compétences et d'une expertise bien précises, avec la volonté d'être utiles au plus vite, notamment parce qu'il s'agit de ce que nous appelons une « génération sandwich », au sens où elles ont à la fois des enfants et des parents à charge. On voit ainsi de plus en plus de femmes qui nous disent qu'elles ne pourront plus venir à l'association car elles doivent s'occuper d'un ascendant. Il s'agit là d'une question importante.
Une autre problématique tient à la mobilité géographique : en raison des charges familiales, les déplacements sont compliqués. J'insiste sur le fait que ces femmes sont globalement prêtes à faire beaucoup de concessions pour retrouver un emploi mais, contrairement à un ou une jeune, elles doivent assumer la charge d'enfants et de parents. La précarité financière n'est peut-être pas si importante dans l'absolu, mais le salaire perçu doit permettre de nourrir toute une famille. D'après l'enquête que nous avons menée auprès de 1 200 femmes, 95 % d'entre elles sont prêtes à faire des concessions pour retrouver un emploi – 62 % sur la durée de contrat et 68 % sur le salaire et parmi elles, 60 % sont prêtes à réduire leur salaire de 10 % et jusqu'à 40 %. Par ailleurs, 55 % sont prêtes à reprendre une formation courte et 36 % une formation longue. Cependant, l'accès à l'information pose problème ; on observe une perte de repères par rapport aux circuits d'information et de financement de ces formations.
Pour conclure, nous souhaitons alerter sur l'émergence de nouvelles situations précaires : on voit de plus en plus, comme cela a été évoqué précédemment, des personnes retrouver un emploi, puis revenir à l'association parce qu'elles l'ont perdu, des ruptures conventionnelles, des personnes embauchées en CDI, mais auxquelles il est mis fin au contrat de travail à la fin de la période d'essai, car cela coûte moins cher qu'un CDD avec une prime de précarité.
La période d'essai peut être de huit mois pour un cadre, avec un renouvellement. Par ailleurs, nous voyons de plus en plus de femmes à la retraite qui viennent nous voir et, après réflexion, nous avons décidé de les accompagner – les deux critères généraux fixés par l'association sont d'être inscrite à Pôle Emploi et d'être âgée de plus de 45 ans. Il y a là une nouvelle forme de précarité, avec des personnes qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, en raison du faible montant de leur retraite, et doivent donc retrouver un emploi.

Concernant les pensions alimentaires, je tiens à rappeler que nous avons mis en place une garantie contre les impayés de pensions alimentaires (GIPA), qui va être généralisée cette année : il s'agit d'un fonds de garantie chargé de verser une aide, avec ainsi une forme d'assurance pour qu'un minimum de pension alimentaire soit versé à la personne, et de récupérer ensuite auprès de la personne concernée une pension non versée.
Il faudrait cependant communiquer sur ce dispositif.

La généralisation a été annoncée récemment ; la caisse d'allocations familiales (CAF) prendra en charge ce dispositif et un complément d'environ 100 euros sera versé, avec récupération auprès du mauvais payeur. La ministre souhaite d'ailleurs créer une agence de recouvrement des pensions.

Les femmes devraient ainsi être assurées de percevoir une pension alimentaire, quelle que soit leur situation ou la mauvaise volonté de l'ancien conjoint.
Je donne à présent la parole à la déléguée générale de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT). Je serais d'ailleurs intéressée de connaître votre analyse sur la mise en oeuvre des dispositions introduites dans le cadre de loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, dite « loi Rebsamen ».
L'AVFT est spécialisée sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en milieu professionnel. Pour faire le lien avec ce qui a été dit précédemment, parmi les femmes qui s'adressent à ces associations, il y en a certainement qui ont été exclues de l'emploi parce qu'elles ont été victimes de violences au travail. Concernant le projet de loi Travail, l'AVFT souscrit globalement aux critiques qui ont été émises sur ce texte, depuis qu'il a été rendu public, en particulier sur la philosophie générale du projet au regard des droits des salariés.
Dans mon intervention, je vais cependant mettre l'accent sur les dispositions les plus problématiques comme l'indemnisation des licenciements illégaux. Nous travaillons en effet depuis plusieurs années sur l'indemnisation des femmes victimes de harcèlement sexuel et les licenciements illégaux, sur le plan civil, pénal et social. Le rapport à l'argent est difficile pour les associations et les victimes, et ce que celle-ci veulent d'abord obtenir, c'est la condamnation de leur agresseur. Néanmoins, l'argent est nécessaire pour se reconstruire et se projeter dans l'avenir.
Dans la première version du projet de loi, un plafonnement des indemnités était prévu sauf en cas de licenciements discriminatoires. Cela ne signifie pas pour autant que cette première version ne posait pas de difficultés, dans la mesure où le juge avait la possibilité, et non l'obligation, d'aller au-delà des plafonds, alors même que les licenciements discriminatoires sont considérés comme les plus attentatoires aux libertés fondamentales, et qu'ils doivent donc être particulièrement bien réparés par le juge.
Certes, les plafonds ont disparu pour tous les licenciements dans la version modifiée du texte mais le plancher n'est pas revenu. La suppression du minimum légal d'indemnisation équivalent à six mois de salaires pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse pose problème et, par ailleurs, le Gouvernement n'a pas réintroduit les dispositions prévoyant un plancher d'indemnisation spécifique de douze mois de salaires pour les licenciements nuls, et plus particulièrement les licenciements discriminatoires.
Il convient à cet égard d'abord de rappeler que, dans le droit actuel, il y a deux types de licenciements illégaux : les licenciements sans cause réelle et sérieuse et les licenciements nuls. Les premiers sont de droit commun, et concernant les salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté et qui travaillent dans les entreprises de moins de 11 salariés, aucun minimum d'indemnisation n'est prévu par le code du travail : il appartient donc au juge d'apprécier la réalité du préjudice subi et d'indemniser en fonction la personne. En revanche, si le salarié a plus de deux ans d'ancienneté ou s'il travaille dans une entreprise de plus de 11 salariés, l'indemnisation ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Ce plancher est une garantie de l'effectivité des droits des salariés, mais les victimes de harcèlement sexuel ne sont pas concernés par exemple, non plus que les salariés qui ont pu témoigner en leur faveur. Et si j'évoque dans mon intervention le harcèlement sexuel, l'analyse peut être étendue aux victimes de licenciements discriminatoires, puisque le principe est le même. J'en viens donc aux licenciements nuls, pour lesquels la loi ne dit rien : il n'y a pas de plancher d'indemnisation.
C'est la chambre sociale de la Cour de Cassation qui a pallié ce manque en fixant un plancher égal aux six derniers mois de salaires, si la personne ne réintègre pas l'entreprise suite à un licenciement nul, et cette garantie s'applique quelle que soit l'ancienneté de la personne et quel que soit le nombre de salariés dans l'entreprise. Cette jurisprudence constante a ainsi institué une protection plus importante pour les victimes d'un licenciement discriminatoire, et c'est parfaitement logique car ce sont les licenciements qui sont considérés comme les plus graves et les plus attentatoires à l'ordre public. D'une certaine manière, la chambre sociale a mis en place une ébauche de dommages et intérêts que l'on pourrait qualifier de « punitifs », même si cette notion est étrangère au droit français, en matière de licenciement discriminatoire ou attentatoire à une liberté fondamentale. Ainsi, selon cette jurisprudence, même un salarié qui aurait moins de six mois d'ancienneté et qui seraient victimes d'un licenciement discriminatoire, requalifié en licenciement nul, devait être indemnisé à hauteur d'au moins six mois de salaire. Cela a par exemple été le cas d'un salarié victime d'un licenciement discriminatoire lié à son état de santé, et qui avait un mois et demi d'ancienneté, sur lequel la Cour de Cassation a été conduite à se prononcer.
La raison de cette jurisprudence est que ces licenciements sont des violations d'une particulière gravité. La jurisprudence a même précisé que, si la personne ne souhaitait pas être réintégrée dans l'entreprise suite à un licenciement discriminatoire, l'employeur devait verser les salaires qu'elle aurait dû percevoir si elle n'avait pas quitté l'entreprise, à partir de la rupture du contrat de travail jusqu'à la décision de justice, et que les juridictions n'avaient pas le droit de soustraire à ces sommes les revenus de remplacements, y compris les nouveaux salaires qu'elle aurait pu percevoir dans un nouvel emploi. J'insiste sur ces exemples pour souligner qu'il s'agit là d'un droit dérogatoire par rapport au droit commun.
Le droit du travail procède d'une codification régulière de la jurisprudence de la Cour de cassation pour garantir les droits, et c'est bien cela que nous attendons du législateur aujourd'hui. C'est cette logique qui avait conduit au dépôt en 2014 d'un amendement au projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, à l'adoption duquel vous aviez grandement contribué Mme la présidente, et le législateur avait considéré que six mois n'était même pas assez et porté le plancher d'indemnisation à douze mois de salaires, et introduit par ailleurs des dispositions visant à prévoir le remboursement par l'employeur condamné des salaires qui auraient étés perçus en l'absence de licenciement.
Notre expérience à l'association nous montre que ce minimum légal de six mois de salaires, qui est remis en cause par le projet de loi, n'est pas assez dissuasif pour contraindre les entreprises à mettre en place la prévention du harcèlement sexuel dans l'entreprise, alors qu'il s'agit d'une obligation légale. Nous avons d'ailleurs du mal à donner des exemples d'entreprises vertueuses en la matière. De fait, le procès devant les conseils de prud'hommes ne leur coûte pas assez cher. Pour changer la donne, la seule solution est de veiller à ce que les entreprises encourent le risque d'être condamnées à des dommages et intérêts dissuasifs, avec une sanction ainsi dotée d'un pouvoir normatif. On ne peut pas compter uniquement sur l'évolution des comportements et le développement d'actions de sensibilisation pour attendre, encore des dizaines d'années, que les choses changent et que les femmes soient rétablies dans leurs droits. En outre, le minimum de six mois ne répare pas le cataclysme entraîné par les violences sexuelles au travail pour les victimes, les atteintes à la santé, l'impact sur la vie de famille, la perte de chance de retrouver un emploi, voire une forte désocialisation.
L'amendement que vous aviez soutenu, Mme la présidente, a été abrogé par le Conseil constitutionnel, mais uniquement pour pour méconnaissance de la procédure législative. Il pourrait donc être réintroduit à la faveur de ce projet de loi. Plusieurs engagements avaient d'ailleurs été pris pour réintroduire ces dispositions dès qu'un véhicule législatif s'y prêterait – la loi Rebsamen, notamment, aurait pu être amendée en ce sens – mais cela n'a pas été le cas. Mme Pascale Boistard avait pourtant indiqué que le sujet n'était pas de savoir s'ils seront réexaminés, mais quand.
Concernant ce projet de loi, s'agissant des licenciements discriminatoires et des licenciements prononcés dans un contexte de harcèlement sexuel, on ne passe donc pas d'un plancher de six mois à zéro, mais en fait de douze mois de salaires à zéro. Or l'incitation au développement d'une politique de prévention n'est crédible que s'il y a des sanctions. Je rappelle par ailleurs que ce projet de loi, dans son article 1er, pose le principe général selon lequel « Le harcèlement moral ou sexuel est interdit et la victime protégée ».

En matière de harcèlements, disposez-vous de données concernant les cas ayant fait l'objet de condamnations, et suite notamment aux dispositions introduites par le législateur ?
Nous n'avons pas connaissance d'un recensement des procédures sociales. Il en va différemment en matière pénale, avec l'annuaire statistique de la justice qui décompte les procédures. Néanmoins, je peux vous indiquer que l'AVFT est de plus en plus saisie par des victimes, qui vont de plus en plus devant les prud'hommes, et pour plusieurs raisons sans doute. L'agenda législatif et médiatique, avec l'affaire Dominique Strauss-Kahn en 2011 et la loi de 2012 sur le harcèlement sexuel, a pu contribuer à mieux identifier ces questions. Cependant, notre association peut répondre à toutes les demandes tout au long de l'année. Nous intervenons auprès des salariés avec des résultats satisfaisants en termes de condamnation de l'employeur, mais pas sur l'indemnisation. Or ce qui nous intéresse, c'est l'effet démultiplicateur de notre action, autrement dit l'effet collectif et politique. Encore une fois, ça ne coûte pas assez cher à l'employeur, et ce n'est pas assez dangereux pour lui, pour qu'on puisse observer un réel changement de regard, sinon de paradigme, sur ces questions.

J'ai eu connaissance de cas où des femmes qui avaient engagées des poursuites aux prud'hommes avaient eu beaucoup de mal à établir la preuve des faits contre leur employeur, et cela m'avait laissé penser qu'il était très compliqué d'arriver au terme de ce type de procédures, mais je note avec intérêt, en vous écoutant, que des condamnations ont pu intervenir donc dans ce domaine.
C'est précisément la question de la preuve que je souhaitais évoquer ensuite, mais je vais d'abord répondre sur les nouvelles dispositions législatives. La principale amélioration apportée a trait à l'instauration dans le code du travail d'une obligation de sanction des salariés auteurs d'harcèlement sexuel, ce qui est une première dans le code du travail. Pour nous c'est une disposition particulièrement intéressante mais nous n'avons pas encore eu l'occasion de l'utiliser devant un conseil de prud'homme. Nous n'avons pas encore fait la demande d'indemnisation spécifique à un employeur pour ne pas avoir sanctionné le harceleur, mais ça va venir. Pensiez-vous à d'autres dispositions de la loi Rebsamen ?

Comment les femmes qui poursuivent pour harcèlement arrivent à fournir assez de preuves ? Porter plainte peut parfois être très difficile pour elles.
Il faut bien distinguer deux choses : d'une part, la preuve en matière de harcèlement sexuel devant le tribunal correctionnel, dans le cadre d'une procédure où la partie visée est le harceleur, et, d'autre part, le harcèlement sexuel devant le conseil de prud'homme, car les règles applicables dans les deux cas sont complètement différentes. Concernant le harcèlement sexuel en matière pénale, la preuve de l'infraction repose sur l'accusation, et donc en bonne sur la victime qui porte plainte, et ce n'est donc pas la chose la plus aisée. Néanmoins quand les magistrats se donnent la peine de faire un travail en profondeur, en analysant un faisceau d'indices concordants et ne s'arrêtent pas à l'absence de témoignage direct, on arrive à avoir des décisions qui sont intéressantes, mais il est évident qu'elles sont assez rares.
Il en va différemment en matière de droit du travail. Sous l'influence du droit européen, le droit français a prévu des règles de preuves qui sont plus souples pour les salariés, et que l'on désigne par le terme d'aménagement de la charge de la preuve. Il s'agit d'une certaine manière d'organiser un partage de la preuve entre la salariée, qui allègue des agissements de harcèlement sexuel, et l'employeur.
Néanmoins, c'est justement la formulation juridique dans le code du travail de cette règle de preuve qui pose problème, parce qu'elle est moins favorable que la règle de preuve qui existe pour toutes les discriminations. Pour celles-ci, l'article L. 1134-1 du code du travail dispose en effet que « Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ». C'est au vu de ces éléments qu'il incombe à de la défense, en l'occurrence l'employeur, de prouver que sa décision, généralement de licenciement, est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Ce dispositif est destiné aux discriminations lié à l'orientation sexuelle, au handicap, à l'état de santé, à l'appartenance à une ethnie, etc.
Les dispositions du code du travail relatives aux règles de preuve en matière de harcèlement sexuel et de harcèlement moral sont sensiblement différentes. En lisant rapidement, on peut avoir l'impression que ces dispositions sont analogues : le code du travail prévoit ainsi que dans ce type de cas, la personne « établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement». Cependant, entre « établir des faits » et « présenter des éléments de faits », il existe une différence sensible quant aux règles de preuves. Il est d'ailleurs de plus en plus fréquent que des avocats de l'employeur jouent sur cette différence pour rejeter les éléments que nous apportons dans les procédures. Là où les victimes d'autres discriminations n'auraient à établir qu'un faisceau de présomption de preuves indirectes, il existe pour les victimes de harcèlement sexuel une exigence probatoire accrue. Or cela va à l'encontre du droit européen qui prévoit que les victimes n'aient pas à apporter une preuve complète. On va donc se retrouver avec des employeurs qui vont dire « on n'a pas de témoin direct », « on n'a pas de caméra de surveillance » ou autre, alors que l'intention du législateur européen était de faciliter le recours des victimes.
On peut d'ailleurs se demander d'où vient cette différence de régime entre discrimination et harcèlement. En procédant à des recherches sur ce point, nous nous sommes rendus compte que la loi du 9 novembre 2001 relative à la charge de la preuve en cas de discriminations – loi qui transposait une directive européenne de 1997 – a introduit une disposition dans le code du travail qui prévoit que la victime d'une discrimination doit présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination. Il s'agit du régime le plus favorable. A ensuite été adoptée la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, qui a créé le délit de harcèlement moral et qui doit préciser le régime de preuve applicable en la matière. Jusqu'ici, le régime est le même pour le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et les discriminations, donc tout va bien. Mais en janvier 2003 le législateur, dans le cadre de la loi portant sur la négociation collective en matière de licenciement, décide de renforcer le régime de preuve uniquement pour les victimes de harcèlement moral et sexuel. La différence ainsi introduire est non seulement scandaleuse mais aussi illégale, et pour deux raisons.
Premièrement, elle viole le principe d'équivalence issu du droit européen. En vertu de celui-ci, les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l'Union européenne doivent être encadrées par le principe dit d'équivalence, qui impose que ces modalités ne soient pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne. Il faut alors se demander si les recours en matière de discrimination et les recours en matière de harcèlement moral ou sexuel sont similaires. Pour nous, ils sont identiques puisque le harcèlement sexuel fait partie du champ des discriminations dans le droit européen. Il en est de même en droit interne, dans la mesure où la loi du 27 mai 2008 intègre dans le champ des discriminations des agissements à connotation sexuelle. D'un point de vue juridique, les notions de harcèlement sexuel et de discrimination se recouvrent : il existe donc une violation du principe d'équivalence. Le législateur français n'avait pas le droit en 2003 d'instituer une notion de différence de traitement juridique entre les deux charges de la preuve. Nous pourrions même considérer que c'est une discrimination indirecte puisqu'en prévoyant des règles de preuves moins favorables pour le harcèlement sexuel, ce sont massivement les femmes qui en sont lésées.
Le principe de non régression a également été méconnu. En droit interne, le législateur ne peut revenir sur le dispositif applicable pour introduire une disposition moins favorable : or, pendant un an, le droit de la preuve du harcèlement sexuel a été calqué sur celui des discriminations, et le législateur n'avait donc pas le droit de revenir dessus.
En outre, la situation des personnes salariées du secteur privé victimes de harcèlement sexuel diffère de celle des agents de la fonction publique. Le droit applicable à ces derniers est bien équivalent aux discriminations. Le Conseil d'État a ainsi rappelé, dans un arrêt du 11 juillet 2011, qu'il appartient à l'agent public de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il n'y a donc aucune raison qu'il existe des régimes de preuves différents pour les salariés du privé et pour les agents de la fonction publique. Pour l'ensemble de ces raisons, il nous semble donc important d'aligner les règles de preuve en matière de harcèlement sexuel et de discrimination.
Par ailleurs, l'article L. 1132-1 du code du travail relatif à l'interdiction des discriminations doit s'articuler avec la loi du 27 mai 2008, qui est aussi une loi de lutte contre les discriminations. Le choix du législateur a été de faire du bricolage, puisque l'article précité du code du travail renvoie à la loi du 27 mai 2008 plutôt que de reprendre, en les codifiant, ces dispositions. Le résultat est surprenant puisque, pour que la discrimination soit constituée en application de cet article, il faut que les agissements à connotation sexuelle subis par une personne, et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant, soient également reconnus comme des agissements à motivation sexiste. La combinaison des deux dispositions a créé une bizarrerie juridique, liée au fait que l'on a procédé par renvoi : autrement dit, il s'agit d'une discrimination encore plus discriminatoire, qui s'apparente à un harcèlement sexuel à raison du sexe. Cette situation fait porter sur la victime une charge de la preuve plus compliquée, puisqu'elle est tenu de présenter des éléments sur, non pas un, mais deux éléments discriminatoires, relatifs aux faits du harcèlement sexuel et au caractère sexiste de celui-ci. Or ni le droit européen, ni la loi du 27 mai 2008 ne posait cette exigence. Il nous semble donc nécessaire de clarifier ces dispositions.
Pour conclure, j'ai participé hier à la réunion du groupe de dialogue au ministère du travail sur le projet de loi concernant recours collectif en matière de discrimination, qui correspond me semble-t-il au projet de loi pour une justice de XXIe siècle, dont l'intitulé a été modifié. L'une des interrogations au centre des débats portait sur les structures qui ont un droit d'agir pour représenter un groupe discriminé devant le juge. Tous les débats se focalisaient sur la question de savoir s'il devait s'agir d'une prérogative syndicale ou s'il devait être ouvert à des associations et, le cas échéant, lesquelles et dans quelles conditions.
L'arbitrage qui a été rendu nous inquiète. Dans le projet de loi initial, les syndicats étaient les seuls susceptibles de représenter des groupes discriminés. Compte tenu du peu d'intérêt porté par les syndicats sur les questions relatives au sexisme, nous nous sommes dit que les femmes n'allaient jamais être représentées dans les groupes discriminés et que de fait, il leur sera impossible de faire valoir leur droit par le biais d'un recours collectif. Le droit d'agir des associations a été introduit mais limité aux discriminations à l'embauche, ce qui revient à ne nous donner aucun droit, puisque nous ne sommes pas saisies pour les discriminations à l'embauche. Mais même cette toute petite chose a été supprimée lors de l'examen de ce texte en première lecture au Sénat. Il en résulte qu'actuellement la possibilité de représenter des groupes discriminés est limitée organisations syndicales. Cette décision est aussi le reflet du groupe de travail, qui s'est réuni pendant presque deux ans au ministère du travail, dans la mesure où aucune association de défense des droits des femmes n'a été invitée. Si l'AVFT a néanmoins pu être présente, grâce à une sorte de « coup d'État » qui n'a pas été simple, les associations ont de fait été écartées du projet.

Merci pour ces informations, j'avoue que nous n'arrivons pas toujours à suivre toutes les évolutions, en particulier concernant le dernier point que vous évoquez, et j'entends votre inquiétude. Je vous remercie toutes pour votre engagement et vos interventions.
La séance est levée à 17 heures 45