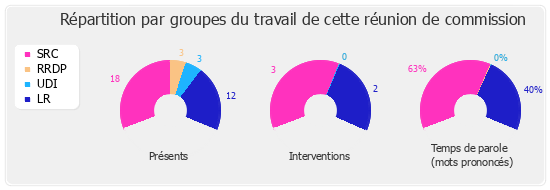Commission de la défense nationale et des forces armées
Réunion du 4 mai 2016 à 9h30
La réunion
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Je suis heureux d'accueillir Mme Nicole Gnesotto, présidente du conseil d'administration de l'Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN) et professeur au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), pour une audition consacrée à la stratégie de sécurité de l'Union européenne. Je dois d'abord excuser notre présidente, Mme Patricia Adam, qui n'a pu être là ce matin et m'a prié de la suppléer.
La stratégie européenne de sécurité, adoptée en 2003, ne correspond plus aux défis de la sécurité de l'Europe, tant le contexte a changé. La Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité est chargée d'élaborer une stratégie globale de l'Union européenne en matière de politique étrangère et de sécurité, dans la perspective du Conseil européen de juin 2016.
Compte tenu de cette échéance et au vu d'une note que vous avez rédigée pour le centre d'analyse, de prévision et de stratégie du ministère des Affaires étrangères, la présidente Patricia Adam a souhaité que notre commission puisse vous entendre, afin de connaître le point de vue éclairé d'une universitaire reconnue, qui ne pourra qu'enrichir nos débats.
Je suis ravie de voir que les notes du centre d'analyse, de prévision et de stratégie du ministère des Affaires étrangères ont circulé. Lorsque j'y occupais la position de chef adjoint, et qu'il était dirigé par Jean-Marie Guéhenno, il était difficile d'aller au-delà d'une diffusion à l'administration entendue au sens strict. Je constate un progrès.
Dans ma note, je suis partie de l'idée que nous nous trouvons devant un énorme paradoxe. Le contexte de sécurité change à une vitesse sidérante, tant dans l'Union européenne que hors d'elle, alors que la continuité institutionnelle et bureaucratique reste totale s'agissant de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), de ses mécanismes, mais aussi du fonctionnement du Conseil européen. Autrement dit, plus le monde change, moins les institutions de l'Union européenne s'adaptent. Jamais l'Europe n'a été aussi menacée et jamais elle n'a été aussi atone sur les questions de sécurité. Ces menaces viennent de l'extérieur – éventuellement de la Russie –, et de l'intérieur, notamment du terrorisme, mais elles sont aussi plus fondamentales. Lorsque, en 2013, j'étais membre de la commission du Livre blanc de la sécurité et de la défense française, nous comptions alors au nombre des éléments propres à garantir la sécurité de l'Europe la stabilité des institutions démocratiques. Aujourd'hui, en Autriche, en Pologne, en Hongrie et au Danemark, cette stabilité même est remise en cause. Bien qu'il ne s'agisse pas de problèmes militaires, je n'hésite pas à y voir une atteinte à la sécurité de l'Union européenne.
Dans ma note, je me suis exprimée de manière très critique au sujet du document en préparation au niveau européen. Mais je veux rendre hommage à Federica Mogherini comme à Nathalie Tocci, universitaire qui travaille depuis un an à la rédaction d'une stratégie européenne de sécurité et vient d'être nommée à la tête de l'Institut des affaires internationales (IAI) établi à Rome. Car mes critiques portent principalement sur l'atonie et la paresse intellectuelle des États, y compris parfois le nôtre, dont les ambitions en matière de défense européenne sont nettement moins affichées qu'autrefois.
La première stratégie européenne de sécurité remonte à 2003. Comme Federica Mogherini aujourd'hui, Javier Solana ne voulait pas à l'époque de négociations intergouvernementales sur ce sujet. Aussi avait-il chargé une équipe constituée de seulement trois ou quatre personnes de rédiger un texte qui est ensuite montré aux États. La méthode suivie aujourd'hui est la même, puisque Nathalie Tocci s'attelle même seule à la question. A contrario, s'en remettre à des négociations intergouvernementales aurait pu durer de quatre à cinq ans.
Sur le fond, la situation est cependant différente de celle de 2003 à trois égards. Premièrement, au temps de Javier Solana, le texte adopté était court, une dizaine de pages tout au plus. Il se concentrait sur la stratégie de sécurité, en fournissant une sorte de mode d'emploi, de cadre global où les opérations de l'Union européenne puissent s'inscrire. Aujourd'hui, il s'agit de brosser une grande vision de la politique étrangère, de défense et de sécurité, de définir plus largement une stratégie d'action extérieure.
Deuxièmement, en 2003, les États européens étaient divisés quant à la conduite à tenir sur la guerre en Irak. La stratégie d'alors avait été conçue comme un instrument de réconciliation, notamment entre le Royaume-Uni et la France, ce qu'elle fut en effet. Au contraire, aujourd'hui, les États partagent le même constat sur les questions de sécurité, vis-à-vis de la Russie, de Daech ou du terrorisme… mais ils ne savent pas quoi faire. Ce consensus absolu se nourrit d'abord de leurs interrogations, de sorte que les États se retrouvent sur ce qu'il faut bien appeler une unité dans l'impuissance stratégique.
Troisièmement, les États-Unis étaient opposés, en 2003, à la montée en puissance d'une Europe de sécurité et de la défense. L'administration Bush avait orchestré une campagne négative et véhémente contre le projet. Aujourd'hui, le président Obama est très apprécié partout en Europe et rassemble plutôt les Européens. Mais il est demandeur d'un engagement plus fort des Européens en faveur de leur propre défense. J'en veux pour preuve le discours qu'il a encore tenu à Berlin la semaine dernière ; il y exprimait ses attentes vis-à-vis des Européens, tant dans le domaine économique que dans le domaine de la défense. Mais nous voyons bien que la réponse européenne peine à se concrétiser.
J'en viens au contexte stratégique immédiat. En face de certains points durs, les instruments créés depuis 1999 au service de la PSDC se révèlent dépassés et obsolètes. Certes, la PSDC a été un très grand succès au cours de ses dix premières années d'existence. Elle a servi de cadre à vingt-huit opérations sur trois continents, au cours desquels 10 000 hommes et 5 000 policiers ont été mobilisés sous mandat, jusqu'à il y a quatre ou cinq ans. Aujourd'hui, de tels instruments sont cependant inutilisables ou très peu utilisables, car le contexte dans lequel ils ont été créés n'est plus le nôtre.
La politique de défense européenne commune a en effet été conçue pour la gestion des crises des autres, par exemple en Afrique, dans les Balkans, en Géorgie, au Moyen-Orient ou même à Aceh en Indonésie. Elle a permis des opérations à Rafah, en Palestine, ou encore au Soudan ou contre la piraterie. L'objectif essentiel, défini dès 1999, était en effet l'exportation à l'extérieur de l'Union européenne d'un minimum de moyens militaires et civils capables de stabiliser une zone de crise ; il ne s'agissait ni de la protection ni de la défense des citoyens de l'Union européenne. À cette époque, il était entendu qu'il revienne à l'OTAN de s'occuper de la défense européenne ; la France participait à ce consensus, à juste titre, me semble-t-il. Dans ce cadre, la PSDC visait plutôt à la stabilisation des crises en périphérie de l'Union européenne.
Ainsi furent mis en place de bons instruments : un comité militaire, des états-majors, une agence européenne de l'armement, des forces telles que le corps européen et les groupements tactiques, en quelque sorte une première capacité de décision et de prise de risque, appuyée par un embryon de renseignement européen. Les principaux théâtres d'opérations envisagés étaient les Balkans et l'Afrique.
La nouveauté réside aujourd'hui dans le fait que nous nous trouvons devant des menaces simultanées, durables, complexes et dénuées de solutions. La Russie continuera de maintenir par exemple, vis-à-vis de l'Ukraine comme d'autres pays voisins, une ambiguïté stratégique et un niveau de menace latent sur l'ordre européen devant lequel l'Union européenne n'a pas de réponse. Le phénomène de Daech, la décomposition à l'oeuvre en Irak et en Syrie fournissent l'exemple de situations où les solutions envisagées, cessez-le-feu ou transition politique, n'en sont pas vraiment, puisque Bachar el-Assad doit notamment être le pivot de la prétendue transition politique en Syrie. En Irak, personne ne trouve depuis 2003 de solution qui satisfasse l'ensemble des composantes de ce pays. Quant au terrorisme intérieur, aucune solution immédiate n'apparaît non plus.
Or il est difficile de voir ce que pourrait faire la défense européenne contre la Russie. Il n'est pas question qu'elle prenne en charge une gestion de la crise en Ukraine, car cela constituerait un casus belli aux yeux des Russes que de se mêler, en usant de moyens militaires, de territoires situés sur leur ancienne zone satellitaire. Si une solution se dessine, ce ne peut être qu'à travers l'OTAN, ne serait-ce que parce que seule cette organisation est à même de rassurer les pays d'Europe centrale et orientale ainsi que les pays baltes. La PSDC n'entre pas en ligne de compte sur ce terrain.
Quant à la menace de Daech et à la Syrie, la PSDC ne peut rien non plus pour gérer la situation créée par la lutte entre le régime d'el-Assad et les rebelles syriens. La coalition ad hoc dirigée par les États-Unis apparaît comme la moins mauvaise solution.
L'Afrique est le dernier continent où l'Union européenne peut organiser des opérations de gestion de crise, en s'efforçant de séparer les combattants et d'entamer des processus de négociation, comme elle l'a fait au Mali ou en Centrafrique, mais aussi au Sahel. Les trois opérations extérieures de ces dernières années, opérations de soutien de l'Union européenne à des interventions françaises, ont montré que la PSDC, censée en 2003 autoriser des projections de force partout dans le monde, reste confinée à un seul théâtre d'opérations, le seul où les Occidentaux peuvent encore intervenir, du moins tant que les exigences liées à la menace terroriste le leur permettent.
Tel est le premier changement majeur à souligner. Les instruments de la PSDC ne sont pas à la hauteur des crises dures auxquelles l'Union européenne fait face à l'heure présente.
Deuxième changement majeur : la sécurité est devenue une demande politique, comme l'atteste l'évolution des sondages Eurobaromètre. Depuis 2015, le chômage est passé en seconde position dans la liste des principales préoccupations des Européens, après la sécurité. Alors que la question paraissait technique et était réservée depuis quinze ans au monde de la défense et de la sécurité, elle est devenue aujourd'hui une préoccupation essentielle de nos concitoyens. Cela change la donne.
Or, pour y répondre, la PSDC propose des moyens institutionnels et bureaucratiques qui sont décalés. Pour ma part, je plaide en faveur d'une gestion politique des questions de sécurité, où le Conseil européen s'érigerait en conseil européen de sécurité, en fournissant un travail analogue à celui qu'il a produit sur la crise grecque. Les chefs d'État et de gouvernement y prendraient à bras-le-corps, une fois par an, les questions relatives à la Russie, à Daech, à l'Afrique ou à la sécurité intérieure – et l'opinion publique pourrait s'en rendre compte. À la politisation de la demande doit en effet répondre une politisation de l'offre de sécurité.
Ce n'est pas ce que propose le texte de Federica Mogherini. Certes, il est bien fait, mais il n'aura pas la valeur d'une déclaration politique des chefs d'État et de gouvernement ; ce n'était du moins pas à l'ordre du jour il y a dix jours encore. S'il leur était soumis, il ne serait d'ailleurs sans doute pas adopté en l'état. En tout état de cause, il fait une trentaine de pages. Pour l'heure, il est encore prévu que les chefs d'État et de gouvernement « se félicitent » seulement de sa parution. Les moyens bureaucratiques qui sont employés aujourd'hui ne politisent donc pas la réponse à la demande démocratique qui s'exprime en faveur de la sécurité.
Le troisième changement à prendre en compte est le continuum qui apparaît désormais entre la sécurité intérieure et la sécurité extérieure. Il s'agit d'un fait nouveau au niveau européen, même s'il était déjà présent dans le Livre blanc sur la défense adopté en France en 2013. Les actions terroristes et l'afflux de réfugiés ne sont que les manifestations intérieures de crises extérieures non résolues, en particulier au Moyen-Orient. Ce continuum constitue un défi majeur. Plus on intervient au Moyen-Orient, plus le terrorisme frappe ; moins on intervient, plus les réfugiés sont nombreux, sans que cela exclue toutefois le terrorisme. Dans un cas comme dans l'autre, un cercle vicieux s'établit entre la menace intérieure et la menace extérieure.
En face de ces problèmes, l'Union européenne ne dispose pas d'instruments adéquats, puisque ceux qui existent reposent sur l'idée qu'ils ne servent pas à la sécurité de l'Union européenne elle-même. Dans cette perspective, comme je le disais tout à l'heure, ils doivent être employés à des opérations de gestion des crises extérieures, l'OTAN – ou les nations pour ce qui les concerne – assurant de préférence la sécurité de l'Union européenne. Là encore, nous sommes totalement décalés par rapport à la réalité de la menace.
Ma conclusion serait donc de dire que l'Union européenne n'a pas besoin d'une stratégie globale de sécurité où tous les sujets sont abordés : commerce, aide humanitaire, affaires étrangères… À l'inverse, elle a besoin d'une stratégie unique en vue d'assurer une sécurité globale, en abordant la sécurité dans toutes ses dimensions.
C'est pourquoi j'en appelle au Conseil européen, qui devrait être l'instance politique suprême de gestion des crises pour qu'il adopte une politique unique fondée sur trois dimensions : la sécurité intérieure, les frontières et la sécurité extérieure. Cela tranchera la question de savoir qui, de la Commission ou du Conseil de l'Union, est compétent sur les données des dossiers passagers (Passenger Name Record ou PNR) ou en matière de garde-côtes ou de garde-frontières. Les controverses s'arrêteraient et chacun pourrait travailler dans le sens de cette politique unique en faisant usage de ses propres instruments.
Dans le domaine de la sécurité intérieure, il convient d'accélérer l'adoption du PNR et de s'entendre sur un partage minimal de renseignements, par exemple un échange de fichiers S entre polices, peut-être pour commencer entre trois pays. Quant aux frontières, un droit d'asile européen commun éviterait le dumping qui aboutit à ce que tous les réfugiés se dirigent vers la Suède, vers l'Italie ou vers l'Allemagne, plutôt qu'en France par exemple, où il est plus difficile d'obtenir le statut de réfugié.
S'agissant de la sécurité extérieure, il faudrait continuer de déployer des moyens militaires en Afrique, notamment pour stabiliser le Sahel, mais aussi faire davantage usage des moyens diplomatiques, alors que l'Union européenne ne s'est pas du tout, ou s'est très peu, impliquée dans la résolution du conflit en Syrie et n'a pris aucune initiative pour une conférence régionale sur le Levant.
En Tunisie, je n'hésite pas à dire qu'il faudrait un « plan Marshall » – ou un « plan Delors » si l'on préfère – pour qu'un partenariat stratégique réaliste avec ce pays de petite taille le préserve du péril islamiste qui le guette, en l'ancrant davantage dans la famille ou la sphère européenne, à défaut d'une adhésion à l'Union. Cela vaudrait mieux que de déplorer sans cesse la dérive qui s'observe et les attentats qui se succèdent sur place tous les six mois.
En Égypte, notre politique est une catastrophe, puisque nous y soutenons une dictature militaire qui a renversé un gouvernement régulièrement élu. Cela entame notre crédibilité. Federica Mogherini consacre la première partie de son texte aux valeurs de l'Union européenne. Nous devrions pourtant les proclamer de manière moins tonitruante si notre politique est en contradiction avec elles.
Comme j'ai eu l'occasion de le dire devant la commission des Affaires étrangères et de la défense du Sénat, je propose une politisation de l'offre de sécurité. Comme pour le marché unique de 1986, il faudrait une seule politique de sécurité qui connaisse plusieurs déclinaisons. Les institutions européennes y retrouveraient leur rôle, ce qui garantirait leur plus grande efficacité et leur plus grande visibilité. Ce serait un moyen plus efficace qu'on ne le croit de réconcilier le citoyen, sinon avec l'Europe, du moins avec l'idée qu'elle peut être plus efficace qu'on le dit.
Ces résultats ne peuvent être obtenus qu'au prix de réformes telles que l'adoption du PNR, une première discussion sur les divergences entre les droits d'asile nationaux ou le déploiement de garde-frontières européens qui soulageraient Malte et la Grèce et préserveraient l'espace Schengen. Par ce biais, il serait de nouveau reconnu que l'échelon européen peut être l'échelon efficace.
Car, ne nous leurrons pas, les citoyens ne croient plus à l'Europe et les gouvernements la démantèlent. Les gouvernements d'extrême droite ou de droite extrême accentuent ce risque de déconstruction, fait d'absence de solidarité, de rétablissement des frontières et de retour du protectionnisme. Il faut au contraire aller dans le sens d'une coordination et d'une solidarité accrues.
Plutôt que d'être unis dans la diversité, comme le voudrait la devise européenne inscrite dans le préambule du traité de Lisbonne, les Européens sont aujourd'hui plutôt unis dans la vulnérabilité. Il faut recréer une adhésion minimale au projet européen. Si c'est ce que j'appelle de mes voeux, ce n'est pas, cependant, ce à quoi je m'attends le 26 juin prochain. Car cette date sera immédiatement précédée par le référendum sur le maintien ou sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, consultation prévue le 23 juin.
À l'origine, il était prévu que le Conseil européen se tienne ce jour-là, mais David Cameron a jugé que c'était la seule date possible pour organiser le référendum : le Conseil européen a donc été déplacé. C'est dire combien les Britanniques mènent la danse. Sur la stratégie de sécurité en préparation, ils jouent leur jeu habituel, en prétextant que la mention du mot « défense » pourrait apporter de l'eau au moulin des partisans d'une sortie de l'Union européenne, comme si les électeurs se déterminaient là-dessus… Curieusement, ce chantage a cependant marché, puisque beaucoup de choses ont déjà été gommées dans la version initiale, pour éviter d'affaiblir la position de David Cameron.
En tout état de cause, le Conseil européen ne sera pas le même si le référendum donne la victoire au camp du maintien ou au camp de la sortie de l'Union européenne. Federica Mogherini réfléchit à la manière dont le Conseil européen pourra trouver, dans ce dernier cas, une stratégie d'urgence. Dans ces circonstances, poussera-t-elle à l'adoption de sa stratégie, trois jours après l'abandon de l'Union européenne par le Royaume-Uni ? J'y serais pour ma part favorable. Si l'on ne fait rien au motif que le Royaume-Uni vient de sortir, alors autant tout arrêter…

Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que parler de sécurité globale peut être un moyen de réconcilier les citoyens avec le projet européen, alors que ce n'est pas aujourd'hui la première manière d'aborder l'Union européenne qui vienne à l'esprit.

Je suis d'accord avec vous au sujet de la Tunisie, mais non de l'Égypte. Dans le domaine des affaires internationales, il faut savoir définir des priorités, par exemple en faveur des États structurés et vertébrés. Il ne sert à rien de défendre obligatoirement les droits de l'homme dans les pays qui n'en sont pas à ce stade. Dans des pays délités et dépourvus de structures comme la Syrie et la Libye, les droits de l'homme n'ont plus beaucoup d'importance. La priorité doit aller à des États structurés.
Tout le monde ici souhaite une Europe de la défense, mais rien ne vient : que ce soit en matière de synergies, de coopérations structurées ou d'institutions à mettre en place, nous n'avançons pas. Cela ne tient certes pas à la personnalité de Mme Mogherini, pour laquelle j'ai beaucoup de respect et qui était mon homologue à la tête de la délégation italienne, à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Mais, dans ses fonctions actuelles, elle est cantonnée à un rôle de représentation. Elle n'a pas les moyens d'avancer vers une perspective européenne en matière de défense.
Nous savons que nombre d'États européens ont les yeux de Chimène à l'OTAN. Pour beaucoup d'entre eux, l'Union européenne est un OVNI en matière de défense ! De votre côté, s'agissant de la défense de l'Europe, comment soupesez-vous l'alternative entre un pilier européen de l'OTAN et l'Europe de la défense ?

Merci, madame la présidente, pour votre présentation fort intéressante. Je vous rejoins quand vous affirmez que c'est aux chefs d'État de tenir un discours clair sur les problèmes de sécurité, qui constituent des enjeux majeurs pour l'Europe et les pays qui la constituent. Si, aujourd'hui, nos concitoyens se sentent si éloignés des politiques européennes, c'est qu'ils ont l'impression qu'elles sont synonymes de contraintes et de réglementations et qu'elles ne portent pas sur des sujets essentiels. Vous remettez au coeur de l'Europe une préoccupation forte.
Par ailleurs, j'aimerais que vous nous précisiez pourquoi vous dites que notre pays n'est pas exempt de responsabilités ou de faiblesses.
Monsieur Le Bris, mieux vaut, en effet, des États structurés et vertébrés. Mais est-ce un critère suffisant ? Pourquoi soutenir l'Égypte et pas la Syrie puisque Bachar el-Assad s'appuie sur un État structuré et vertébré ? Retenir ce principe me semble ajouter des contradictions à nos contradictions. Cette profonde confusion qui règne dans nos valeurs contribue à ce que nos concitoyens se sentent perdus dans les orientations de notre politique étrangère et de défense. Je le dis pour souligner que les choses sont beaucoup plus compliquées, et je m'exprime en toute modestie, car je n'ai pas de responsabilités politiques – il est beaucoup plus facile de critiquer que de prendre des décisions.
J'en viens à votre question sur l'Europe de la défense et l'OTAN. Pour défendre l'Europe contre une menace directe pesant sur ses territoires et ses populations – dont on ne voit guère d'où elle pourrait venir, si ce n'est d'une Russie encore plus poutinienne qu'elle ne l'est aujourd'hui, si cela est possible –, la solution reposerait bien évidemment sur l'OTAN : les États-Unis, dans le cadre de l'Alliance, prendraient le leadership d'une opération de défense. C'est la base même du traité de Washington dont nous sommes signataires. Jusqu'à plus amples informations, M. Obama pas plus que Mme Clinton – pour M. Trump, je ne sais pas – ne remettent en cause l'engagement des États-Unis dans la défense de l'Europe au titre de l'article 5 de ce traité. En revanche, les Américains remettent depuis longtemps en cause l'engagement systématique de leur pays en Europe pour des questions de sécurité qui ne revêtent pas un caractère vital pour eux.
Il s'agit d'une modification profonde de l'Alliance atlantique : pendant soixante ans a prévalu une automaticité – si nous mourions, ils mourraient aussi –, qui faisait que nous concédions aux Américains le leadership, malgré quelques manifestations de mauvaise humeur du côté français. Aujourd'hui, les Américains le disent, l'écrivent noir sur blanc : l'Amérique ne veut pas s'engager dans une guerre qui n'est pas la sienne, pour reprendre une formule employée par le général de Gaulle en 1963. Ils se désintéressent donc des questions de sécurité qui n'ont pas de caractère stratégique pour eux, qu'il s'agisse de l'Ukraine, de la Crimée, peut-être un jour de la Géorgie ou du Haut-Karabagh, et pour une part du Moyen-Orient. Le seul enjeu encore stratégique pour eux dans les conflits au Moyen-Orient, c'est la sécurité d'Israël. Pour le reste, ils s'inscrivent dans une profonde révision de leur politique extérieure. Barack Obama a été un grand visionnaire, ce qui lui a permis de se placer déjà dans le XXIIe siècle avec sa politique du pivot asiatique et son insistance sur le renforcement des technologies de l'information – il ne correspond pas à l'Amérique d'aujourd'hui, raison pour laquelle il est peu populaire dans son pays.
L'OTAN n'est donc plus un cadre rassurant pour la défense de l'Europe si celle-ci n'est pas directement menacée par un déferlement massif de chars. Elle n'est plus la mieux placée pour assurer la sécurité des Européens.
Si l'on ne peut pas empêcher les Américains d'évoluer – ils n'ont plus que 50 000 militaires en Europe contre 300 000 à la fin de la Guerre froide –, pourquoi ne pas refonder l'OTAN en créant un pilier européen en son sein, autrement dit un commandement européen ? C'est une évolution que certains appellent de leurs voeux, mais les Américains le souhaitent-ils ? Ce pilier européen ne serait pas indépendant du commandant suprême des forces alliées en Europe – le SACEUR – et, si les Européens étaient confrontés à un échec, les États-Unis se verraient obligés d'intervenir dans des conflits qu'ils n'estiment plus les leurs. Cela créerait une contrainte d'engagement pour eux par le biais de l'OTAN. Or ce qu'a voulu casser Bush Junior, de manière très brutale, puis Obama, dans une moindre mesure, c'est l'automaticité de l'engagement des Américains dans des crises périphériques. Du reste, si certains pays européens sont si favorables au pilier européen, c'est qu'ils veulent continuer à pouvoir retenir les États-Unis en Europe.
En outre, pourquoi se lancer dans cette politique de pilier européen de l'OTAN puisqu'il existe déjà un pilier européen à travers l'Union européenne et qu'il suffirait de conclure un accord de partenariat militaire avec la Turquie pour disposer de l'ensemble des structures nécessaires ?
Pour des raisons politiques, je ne crois donc pas une seconde au pilier européen de l'OTAN. Seule la bureaucratie de l'OTAN peut se montrer enthousiaste. Nous le savons, une organisation militaire a toujours besoin de faire des choses. On le voit bien dans l'attitude du secrétaire général Jens Stoltenberg. Alors que les actions de l'OTAN en Afghanistan ne sont pas une très grande réussite, il évoque une intervention en Libye, ce qui irait à l'encontre de tout bon sens : d'abord, parce que ce serait un chiffon rouge pour les populations arabes ; ensuite, parce que ce serait incohérent après le refus d'intervention de 2011.
La solution est ailleurs : il faut que les Européens s'accordent davantage. Quand je dis les Européens, ce ne seraient pas les Vingt-Huit. Cela n'a pas de sens de demander la même chose à chacun des membres de l'Union. Si la Croatie consacre 2 % de son PIB à son budget de défense, cela ne changera pas la face de la défense européenne. En revanche, si la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne font cet effort, cela aura une incidence. Et cette action commune doit se faire en bonne intelligence avec les Américains, en totale transparence avec l'OTAN.
Cela me paraît assez simple à réaliser. Les principales difficultés résident, d'une part, dans la bataille idéologique entre l'Union européenne et l'OTAN que les diplomates adorent et, d'autre part, dans les réticences des Européens à prendre des risques seuls. Si ces derniers aiment tant l'OTAN, c'est que cette structure leur a permis de déléguer la gestion des risques aux États-Unis pendant soixante ans. Après une telle déresponsabilisation stratégique, ils ne veulent pas être confrontés à des crises sans bénéficier de la protection américaine.
Je crois que la crise atlantique est devant nous. Il y aura un jour une explication de la part des Américains qui nous diront qu'ils ne veulent plus payer pour des opérations que les Européens peuvent prendre en charge tous seuls. Barack Obama a déjà commencé à aller dans ce sens. Et si M. Trump gagne les élections – ce qui, dans le monde irraisonnable dans lequel nous vivons, n'a rien d'impensable, le rappel à l'ordre sera sévère.
Monsieur Marty, si les chefs d'État doivent tenir un discours clair sur les problèmes de sécurité, c'est pour des raisons non seulement politiques, mais aussi juridiques. Ils y sont obligés par l'article 222, paragraphe 7, du traité de Lisbonne qui prévoit que le Conseil européen fait régulièrement l'état des menaces et décide les politiques à prendre en conséquence.
La France a des responsabilités dans la baisse de l'enthousiasme en matière d'Europe de la défense, lequel n'a jamais été très élevé. Traditionnellement, c'est notre pays qui a été l'un des plus ardents défenseurs d'une ambition stratégique pour l'Europe, quels que soient les gouvernements. Depuis quelques années, force est de constater qu'il fait preuve de moins de conviction. Nous l'avons d'abord observé sous la présidence de M. Sarkozy. La réintégration dans l'OTAN – dans la « famille atlantique » selon ses termes – a été perçue par nos partenaires comme le signe d'une moindre ambition à l'égard de la défense européenne. Avec l'arrivée de M. Hollande au pouvoir, un peu d'élan a été retrouvé : notre ministre de la Défense est un véritable moteur au niveau européen. Toutefois les Français semblent déçus et fatigués. Ils ont tellement oeuvré pour rassembler qu'ils ont développé une certaine amertume. Il n'est qu'à penser aux difficultés auxquelles ils sont confrontés pour obtenir ne serait-ce que trois hélicoptères pour une opération au Mali. Toutefois, il ne faut surtout pas qu'ils renoncent. S'ils cessent de soutenir l'Europe de la défense, plus personne ne le fera !

Je voudrais à mon tour vous remercier, madame la présidente, pour la qualité de votre exposé, dont la clarté repose sur une solide argumentation.
Vous avez évoqué les crises durables qui marquent le Moyen-Orient et l'arc sahélien. S'agit-il d'une juxtaposition de crises ou des diverses manifestations d'une seule crise provoquée par la révolution islamiste ? Au-delà de la vision d'un Daech sanguinaire, les valeurs d'un certain islam, porteur d'une morale sociale, peuvent être reçues de manière très positive par la population musulmane, y compris en Europe. Ne serait-ce pas le fond du problème ?

Pensez-vous qu'au-delà des raisons politiques, les questions budgétaires ont eu un impact sur le retard pris en matière d'organisation de l'Europe de la défense ?

Merci, madame la présidente, pour votre présentation très claire des enjeux de sécurité au niveau européen. Pourriez-vous nous donner des précisions sur le concept-clef de sécurité globale ?
Par ailleurs, auriez-vous quelques pistes concernant le noyau dur du renseignement européen, dont la constitution touche à la souveraineté nationale ?

Sur ce dernier point, faites-vous une différence entre, d'une part, la lutte contre le terrorisme et le nécessaire partage des informations qu'elle implique, et, d'autre part, la politique du renseignement en général et la protection des données, enjeu de souveraineté nationale ?
Monsieur Lamblin, votre question est difficile. Les crises durables que j'évoquais ne se situent pas toutes au Moyen-Orient. Pensons à la Russie. La remise en cause par les Russes de l'ordre européen porte sur la démocratie comme destin de l'Europe. Ce qui a irrité profondément M. Poutine, ce n'est pas tant que l'Ukraine et la Géorgie puissent entrer dans l'OTAN, mais que la démocratie soit susceptible de devenir le système institutionnel de ces pays, et donc peut-être un jour de la Russie. C'est une question majeure qui n'a rien à voir avec l'islamisme, même si, en Russie, les revendications liées à l'islam radical ont été fortes, en Tchétchénie notamment, et sont loin d'être apaisées. Certains expliquent même l'intervention de M. Poutine en Syrie, au mois de septembre dernier, par sa volonté de mater directement les djihadistes susceptibles de venir dans son pays.
Par ailleurs, la déconstruction du Sahel relève d'autres phénomènes que ceux qui sont à l'oeuvre au Moyen-Orient. Boko Haram ne repose pas du tout sur la même idéologie que Daech, même s'il y a des collaborations logistiques et des relations d'allégeance. Les causes de ces crises africaines sont à chercher ailleurs que dans une idéologie anti occidentale.
Votre question demeure : les crises qui secouent le Moyen-Orient – en Irak, en Égypte, en Syrie, en Érythrée, au Yémen – sont-elles juxtaposées ou relèvent-elles d'une même cause, la révolution islamiste ? Je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions. Vous savez que deux thèses s'opposent en ce domaine, celle de Gilles Kepel et celle d'Olivier Roy. Ce que je crois, c'est que ces crises sont le révélateur d'un échec de la mondialisation. Si l'on excepte le Qatar et les Émirats arabes unis, toute la zone du Moyen-Orient, qui regroupe 500 000 millions d'habitants, se situe en dehors de la dynamique de modernisation économique portée la mondialisation, même si l'on a cru un temps que l'Égypte pourrait s'insérer dans ce processus. L'idéologie de l'islamisme radical se nourrit d'abord d'une énorme frustration économique et sociale, qui se traduit par une haine de l'Occident, une haine d'Israël, une haine des mauvais musulmans – n'oublions pas que plus de 60 % des victimes du terrorisme de Daech sont des musulmans. Et si cette analyse est juste, c'est avant tout aux États de cette zone d'en tirer les conséquences. Il y a de la part de l'État islamique une volonté de créer un discours unificateur sur la responsabilité des Occidentaux dans l'exploitation du Moyen-Orient afin de masquer la responsabilité des gouvernements arabes dans l'échec de la mondialisation dans cette région.
En Afrique, l'ensemble des clignotants sont au rouge, excepté en Afrique du Sud. Je ne crois pas aux statistiques de la Banque mondiale qui laissent penser que l'Afrique serait un nouvel Eldorado de la mondialisation, la Chine de demain. Je vois plutôt des États qui se décomposent, des sociétés qui se paupérisent, une corruption qui étend son emprise. Et tout le monde sait – c'est un phénomène très ancien – que, lorsque les États s'affaiblissent, ce sont les mafieux qui prospèrent. Malgré tout, l'Afrique connaît des embryons de société civile. Les décolonisations anglaise et française ont laissé des traces. On ne peut pas dire que les Africains ne réussiront pas le pari de la modernisation économique.
Dans les pays du Moyen-Orient, il n'y a pas un développement suffisant de la classe moyenne. On observe une fuite des capitaux et un exode des plus éduqués, sauf en Iran. C'est la raison pour laquelle ce pays fera partie, avec la Turquie et Israël, des piliers de notre politique dans cette région, en remplacement des monarchies arabes qui se sont montrées si peu fiables.
Madame Nieson, les raisons financières ont sans aucun doute pesé dans la constitution de l'Europe de la défense. En période de crise économique, les gouvernements préfèrent se consacrer aux dépenses sociales plutôt qu'aux interventions extérieures. Seulement, le désinvestissement des États européens des questions de défense est bien antérieur à la crise de 2008. Dès 1991, avec la fin de la guerre froide, ils se sont mis à opérer des coupes sévères dans leur budget de défense. La France en a fait de même, jusqu'à ce que, récemment, le président de la République décide de maintenir les crédits alloués au ministère de la Défense. Ce sont donc avant tout des raisons politiques qui jouent en ce domaine. La peur pousse beaucoup de pays européens à augmenter à nouveau leur budget de défense. C'est le cas en particulier de la Pologne, voisine de la Russie, qui tient à montrer aux Américains qu'elle est une bonne alliée afin d'éviter qu'ils ne la laissent tomber.
Le concept de sécurité globale, Monsieur Comet, implique qu'il y ait une seule politique au niveau de l'Union européenne alors qu'aujourd'hui une multiplicité de politiques prévaut : la politique de sécurité intérieure est gérée en grande partie par la Commission pour ce qui concerne notamment la défense des infrastructures critiques – c'est le cas, par exemple, du port de Rotterdam – ; la lutte contre le terrorisme relève des États ; la question des réfugiés dépend à la fois de la Commission et un peu du Conseil, car les accords de Schengen sont du ressort de ces deux institutions. La mise en place d'une politique de sécurité globale, déclinée selon plusieurs dimensions, empêcherait que des politiques parcellisées n'entrent en contradiction comme c'est parfois le cas aujourd'hui.
Comment concilier le renseignement européen avec la souveraineté des nations ? m'avez-vous encore demandé. Je vais vous dire très franchement que je ne vois pas en quoi la souveraineté de la France pourrait être mise en cause si elle acceptait de partager ses fiches S avec la Belgique et l'Allemagne, et dans une moindre mesure avec l'Italie, l'Espagne et le Maroc.

Je me suis mal exprimé. Nous considérons tous que partager l'ensemble des renseignements en matière de lutte contre le terrorisme est parfaitement légitime, mais il est des domaines du renseignement où un tel partage n'est pas souhaitable. Où mettre la limite ?
Votre question est inquiétante, si je puis me permettre. De quelle limite parlez-vous ? Y a-t-il une frontière entre la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la criminalité ? Non, justement. Ce que montrent les attentats perpétrés à Bruxelles, c'est la porosité entre la criminalité et le terrorisme : ces tueurs sont des criminels qui se sont radicalisés en quelques mois, phénomène en soi vertigineux. De quoi faudrait-il séparer les renseignements portant sur les terroristes ? Des informations à propos des casseurs et des anarchistes ? Est-ce vraiment pertinent ? Olivier Roy, partant du fait que 52 % des candidats au djihad en France sont issus de familles d'origine chrétienne, a élaboré la thèse selon laquelle nous assistons non pas à une radicalisation des musulmans, mais à une islamisation des radicaux. Autrement dit, des personnes qui, en d'autres temps, auraient été des anarchistes prêts à commettre des attentats suicides adhèrent aujourd'hui à l'idéologie de l'islam radical.
Si l'on ne sait pas faire de différences dans le caractère partageable des renseignements, c'est qu'il y a un loup. Nos institutions ne sont pas claires et nos lois ne sont peut-être pas aussi protectrices pour le citoyen qu'elles devraient l'être.
Mais le partage peut aussi porter sur le renseignement économique. Si les pays européens parvenaient à collaborer pour remonter les filières de financement des réseaux terroristes, sans doute feraient-ils oeuvre utile.
Je conçois qu'en dehors de cela il y ait des domaines à protéger, notamment en matière de stratégie nucléaire.
Reste qu'il est nécessaire d'échanger avec les Allemands et les Belges des fiches comportant des photos et des empreintes, des listes recensant le nom des personnes revenant de Syrie, ou encore des données sur les billets d'avion. Mettre en place une CIA à vingt-huit comme l'ont proposé certains ne me semble pas possible, mais créer un noyau dur de quelques pays est souhaitable. Il serait important d'afficher un discours commun, d'abord pour des raisons de dissuasion. Si vous invoquez la défense de la souveraineté nationale pour réduire le partage, nos concitoyens se demanderont où est l'intérêt d'une telle démarche si elle aboutit à affaiblir leur sécurité.
Et je crois même qu'il est plus facile de partager des renseignements entre Français, Allemands et Belges que de le faire entre Français et Français !
Je le sais, mais nous avons quand même vu apparaître des failles avec les attentats de novembre en France.

Les fiches S font l'objet d'un partage. Maintenant, il faut savoir où l'on met la frontière entre ce qui est utile à la lutte contre le terrorisme et ce qui est nécessaire à la lutte contre le pillage technologique. La France peut se trouver dans une situation paradoxale où elle serait obligée de partager des renseignements visant à lutter contre le terrorisme avec un pays qui fait l'objet d'opérations de contre-ingérence dans le domaine du renseignement économique. Ces problèmes ne sont pas réglés aujourd'hui.
Et ils ne le seront jamais !

L'important est de parvenir à un partage efficace.
Je vous remercie, madame Gnesotto, pour votre intervention très éclairante.
La séance est levée à dix heures trente.