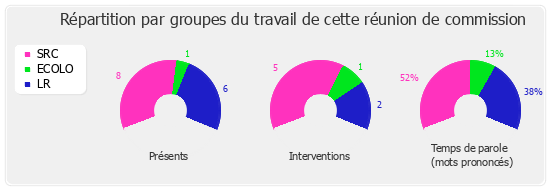Commission d'enquête relative aux moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier
Réunion du 11 mai 2016 à 17h45
La réunion
La séance est ouverte à dix-huit heures cinq.
Présidence de M. Georges Fenech.
Table ronde, ouverte à la presse, réunissant des spécialistes du Moyen-Orient : M. Pierre-Jean Luizard, historien, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; M. Béligh Nabli, directeur de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) ; M. Wassim Nasr, journaliste à France 24 ; M. Pierre Razoux, directeur de recherche à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire (IRSEM).

Nous vous remercions, messieurs, d'avoir répondu à notre demande d'audition. Nous allons nous intéresser avec vous aux aspects politiques, diplomatiques et militaires de la situation au Levant et approfondir notre réflexion sur des questions dont nous mesurons, bien entendu, la complexité.
Cette table ronde est ouverte à la presse et fait l'objet d'une retransmission en direct sur le site internet de l'Assemblée nationale. Son enregistrement sera également disponible pendant quelques mois sur le portail vidéo de l'Assemblée, et la commission pourra décider de citer dans son rapport tout ou partie du compte rendu qui sera fait de cette audition.
Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relatif aux commissions d'enquête, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
M. Pierre-Jean Luizard, M. Béligh Nabli, M. Wassim Nasr et M. Pierre Razoux prêtent successivement serment.
Quels phénomènes ou événements expliquent, selon vous, l'émergence et la progression de Daech en Irak, et de Daech et Jabhat al-Nosra en Syrie ?
Quels sont les soutiens extérieurs dont pourraient bénéficier ces deux organisations ?
Comment le nombre de combattants étrangers qui y sont intégrés a-t-il évolué au cours de l'année écoulée ?
Dans quelle mesure les deux organisations bénéficient-elles du soutien des populations locales dans les territoires qu'elles contrôlent ? Y a-t-il eu des soulèvements populaires contre leurs combattants ?
Quel est votre point de vue sur l'action de la coalition mondiale contre Daech, formée en septembre 2014, notamment sur la place de la France en son sein ?
Que pensez-vous de la position du gouvernement français vis-à-vis du régime de Bachar el-Assad ? Le départ de celui-ci vous apparaît-il comme une condition préalable à la reconstruction politique du pays ?
Que pensez-vous du soutien apporté par la France au régime irakien ?
Quel est votre point de vue sur les résultats militaires des frappes aériennes en Irak et en Syrie ? Quel a été l'effet de l'intensification des frappes françaises à compter de septembre 2015 ?
Les frappes aériennes en Irak et en Syrie ont-elles des conséquences sur l'attractivité de Daech et, si oui, lesquelles ?
Les frappes aériennes en Irak et en Syrie ont-elles un effet sur la capacité de Daech à organiser et à mettre à exécution des attaques terroristes au Moyen-Orient et en Europe ?
Les récents revers militaires subis par Daech et la contraction des territoires qu'elle contrôle sont-ils susceptibles d'entraîner la multiplication d'actions de guerre asymétrique, c'est-à-dire d'attaques terroristes en guise de « représailles » ?
La guerre contre Daech peut-elle, selon vous, être remportée sans intervention de troupes au sol ?
Quel est votre point de vue sur le rôle joué par la Turquie dans la lutte contre Daech et contre le retour des djihadistes en Europe ?
Comment jugez-vous la situation en Libye et au Yémen ? Quel est l'état des forces de Daech dans ces deux pays ?
Enfin, quel est l'état de la menace que représente, pour la France et les intérêts français à l'étranger, Al-Qaida en général et Jabhat al-Nosra en particulier ?
Sur ces nombreuses questions, nous aimerions avoir l'éclairage des spécialistes reconnus que vous êtes.
Merci beaucoup de votre invitation.
On entend très souvent parler de la manière de lutter contre le terrorisme ou de déradicalisation, et ces questions sont certainement légitimes, mais elles relèvent souvent d'une vision « psychologisante » du djihadisme, qui fait de celui-ci une maladie ou une déviance que l'on pourrait traiter à la façon d'une addiction. Or, si cette dimension psychologique a son importance dans chaque cas individuel, elle ne saurait occulter les enjeux politiques et historiques du chaos auquel le Moyen-Orient est aujourd'hui en proie et dont est né un vaste mouvement qui nous touche jusque dans nos pays, puisqu'il existe désormais un volet occidental, sinon dans la stratégie de Jabhat al-Nosra, du moins dans celle de l'État islamique qui vise un djihad globalisé.
L'origine du conflit se situe, à mon avis, en Irak. La faillite et l'échec de la reconstruction politique de l'État irakien par les Américains à la suite de leur intervention en 2003 – qui n'avait elle-même fait que porter les derniers coups, après de nombreuses crises et guerres, à l'État irakien fondé en 1920 par la puissance mandataire britannique – ont entraîné dans leur sillage la crise et la déliquescence d'autres États. L'État syrien est la première victime de la guerre en Irak. La division du territoire irakien en trois entités – kurde, chiite, sunnite – à prétention étatique pose directement le problème de l'avenir de l'État irakien dans ses frontières actuelles et de la communauté arabe sunnite en Irak, qui représente 20 % de la population et qui ne se reconnaît plus dans l'État irakien, dont elle a eu le monopole pendant plus de quatre-vingts ans, entre 1920 et 2003. On voit aujourd'hui – j'étais à Bagdad il y a quelques jours – les limites de ce système politique, avec l'intrusion de milliers de manifestants dans un Parlement totalement paralysé par les allégeances communautaires. Mais ce système n'est pas réformable, car il entrave le développement des institutions publiques et d'un espace public minimal, et il empêche l'État de répondre sur une base citoyenne à des revendications fondamentales de la société civile, telles que l'accès à l'électricité. Les coupures d'électricité sont ainsi monnaie courante à Bassora, ce qui paraît d'autant plus scandaleux qu'il s'agit d'une ville riche, car située au milieu d'une zone pétrolière.
On assiste aujourd'hui à une remise en cause généralisée de certains États arabes au Moyen-Orient, dont trois – l'Irak, la Syrie, le Liban – qui ont en commun leur genèse mandataire. Les crises propres à chacun de ces trois États interagissent entre elles. La crise dont l'origine se situe en Irak, berceau de l'État islamique, s'est déplacée en Syrie par un jeu de dominos, et l'on n'imagine pas que l'effondrement de l'État syrien puisse laisser l'État libanais indemne.
Ce volet oriental pose à nos diplomaties une question grave : devons-nous oeuvrer à restaurer les États en crise et en faillite ou, au contraire, devancer, ce qui a fait la force de l'État islamique, la mort programmée d'institutions politiques qui ne sont pas réformables et qui sont incapables de répondre aux revendications basiques de la société civile ? C'est un grand défi, dans la mesure où les diplomaties ont pour fonction de reconnaître les États et les frontières en place. Mais c'est une question qui se pose dès lors que le système étatique et frontalier est remis à plat au point que des acteurs interviennent sur le territoire d'un pays depuis le pays voisin comme s'il n'y avait plus de frontières entre eux. Nous anticipons, d'une certaine façon, cette évolution lorsque les autorités françaises traitent directement avec les autorités kurdes pour leur livrer de l'armement et leur apporter une aide militaire, sans en référer au ministère compétent à Bagdad.
Voilà pour ce qui concerne le volet oriental de l'origine du terrorisme qui s'est ensuite emparé de certains pays occidentaux. Le volet occidental de l'État islamique est très différent, car le passé colonial et mandataire ainsi que le contexte confessionnel en sont absents. Mais d'autres facteurs y sont habilement exploités par ceux qui appellent au djihad.
D'abord, une histoire coloniale au cours de laquelle les principes républicains ont été systématiquement mis en contradiction avec eux-mêmes, spécifiquement en France. Ainsi, par le décret Crémieux, des élites laïques et républicaines ont accordé aux juifs d'Algérie, sur une base confessionnelle, la citoyenneté française qu'ils refusaient aux musulmans et qu'ils ont ensuite octroyée en Algérie aux Européens d'obédience catholique. De même, la loi de 1905 n'a pas été appliquée aux musulmans d'Algérie. De manière générale, les idéaux républicains ont été perçus par les populations colonisées comme une légitimation du fait colonial – à juste titre, comme le montre le discours de Jules Ferry sur la colonisation. Même Clemenceau qui, de l'intérieur du camp républicain, avait critiqué cet a priori pro-colonial a à son tour justifié, une fois au pouvoir, le protectorat au Maroc.
Si cette histoire n'est évidemment pas connue des apprentis djihadistes qui partent de nos pays pour faire la guerre en Syrie et en Irak, elle alimente un grand récit dans lequel les musulmans se présentent comme les adeptes de la religion du colonisé, un discours très confus et très vague mais qui, dans le contexte français en particulier, fait mouche. En effet, nous vivons aujourd'hui une crise identitaire dont témoignent notamment les impasses de notre laïcité, dont ni la laïcité stricte de notre Premier ministre ni celle du président de l'Observatoire de la laïcité ne permet de sortir. La laïcité, qui fut une religion civile pour la France pendant plus d'un siècle, est aujourd'hui remise en cause et ne suffit plus à poser les fondements du vivre-ensemble. Pour vivre ensemble, il faut un minimum d'identité, et la demande d'identité se renforce à mesure que l'on descend l'échelle sociale. Ce sont très probablement ces no man's land identitaires, joints à la perception confuse d'un passé colonial où l'islam a joué le rôle que j'ai décrit, qui expliquent que des jeunes qui ont de l'islam une notion vague et de l'histoire coloniale une notion encore plus vague s'engagent sur la foi d'un discours idéologique dans lequel ils trouvent des raisons d'espérer. Pourquoi un tel discours donne-t-il de l'espoir alors que les idéaux républicains semblent y avoir échoué, en tout cas pour une fraction de notre jeunesse ? C'est sans doute sur ce point que nous devons réfléchir.

Vous insistez surtout sur la désagrégation de l'État irakien. Qu'en est-il de la question syrienne ?
Ce qu'a dit M. Luizard à propos de l'État irakien s'applique tout à fait à l'État syrien. Il faut tenter de sortir du point de vue occidental sur cette région pour considérer ses dynamiques internes selon lesquelles, à chaque fois, les communautés passent du statut d'opprimé à celui d'oppresseur. Ainsi, ce qui se passe en Syrie n'est ni plus ni moins qu'une guerre de survie pour les deux communautés qui s'affrontent – car c'est bien de cela qu'il s'agit : ne nous voilons pas la face. Les alaouites comme les sunnites s'estiment en danger de mort dans le cas où ils perdraient la guerre. Ce n'est pas la première fois que les sunnites se rebellent : il y a eu des précédents, notamment à Hama en 1982. On ne peut pas remettre en question l'oppression en Syrie, qui a touché toutes les communautés sans exception – chrétienne, druze, chiite,… L'expérience libanaise en atteste également.
En raison du vide étatique et du fait que les populations ne se sentent pas représentées par leur État, l'État est l'enjeu d'un combat pour la survie et la domination de la part des chiites en Irak, des alaouites en Syrie. En Occident, nous portons sur cette situation un regard laïc et rationnel qui n'est pas toujours pertinent.
L'État islamique se nourrit donc des dynamiques locales – l'oppression des sunnites, en Irak comme en Syrie –, mais il incarne également une révolution, comme je l'écris dans mon livre État islamique, le fait accompli, et propose un nouveau système, en rébellion contre les États corrompus et sectaires, mais aussi contre les sociétés traditionnelles, contre l'islam coutumier et contre le pouvoir des clans, en Irak et en Syrie. En Irak, au motif que les chefs de clan corrompus qui ont accepté le deal avec les Américains n'ont pas tenu leurs promesses, une frange de la jeunesse sunnite s'est retrouvée de facto dans les rangs de l'État islamique. En Syrie, après cinq ans de guerre, beaucoup de jeunes ont rejoint cette révolution, de manière civile ou militaire – quoi qu'il en soit, elle s'est militarisée très vite, dès le début 2012. Certains ont gagné les rangs de l'État islamique faute de mieux, parce que l'organisation représente une révolution contre les systèmes établis : contre les États de la région, et même contre le capitalisme et le système mondial.
L'État islamique a gagné en aura avec l'instauration du califat, imaginé et rêvé par une frange de la population musulmane dans le monde depuis la fin du califat en 1924. Ce qui attire les jeunes – du moins occidentaux – vers l'État islamique plus que vers Al-Qaida, c'est cette dimension historique et mystique de la Syrie et de l'Irak, et le fait que l'organisation ait réussi à installer un proto-État avec des institutions, des mécanismes de redistribution, des bureaux des plaintes pour les consommateurs, un système éducatif, des écoles anglophones – au grand dam des francophones !
Avec la guerre en cours, ce système ne va peut-être pas perdurer. Mais l'État islamique aura mis en oeuvre ce qu'il faut bien appeler, abstraction faite de tout jugement de valeur, un projet politique. Il y a dans l'histoire humaine des projets politiques horribles et, au risque que cette comparaison vaille un point Godwin, le nazisme était un projet politique. Ce que je répète depuis quatre ans, c'est qu'il faut prendre ces personnes au sérieux et estimer leur action à sa juste valeur. Si on la minimise, si on considère l'État islamique comme une secte et ses membres comme des paumés, des drogués, on ne mesure pas le danger qu'il représente matériellement et dans l'imaginaire de bien des gens, faute d'alternative.
Je développe aussi dans mon livre l'idée que l'on ne peut pas dire que « ce n'est pas l'islam ». De même, on ne saurait soutenir que les croisés n'étaient pas chrétiens. Simplement, les croisés, qui ont assiégé Constantinople et massacré d'autres chrétiens, ne représentaient pas toute la chrétienté. Les conquistadores étaient chrétiens, mais ils ont décimé des peuples aborigènes. De même, les combattants de l'État islamique font partie de l'islam, ce sont des musulmans, mais ils ne représentent pas tous les musulmans du monde. En revanche, ils constituent un véritable pôle d'attraction pour de vastes franges de la population.
Vous nous avez interrogés sur le rôle joué par les États de la région. Ces États, l'Arabie Saoudite à leur tête, sont aujourd'hui en danger de mort à cause de l'État islamique et de sa dimension révolutionnaire. Il est en révolution contre la monarchie saoudienne qu'il estime corrompue. Tous les djihadistes saoudiens avec lesquels j'ai pu discuter répètent qu'ils reviendront en conquérants détrôner ces corrompus de Saoud. Car l'État islamique se veut une théocratie pure, alors que l'Arabie Saoudite est une monarchie.
Quant aux Turcs, ils ont essayé de contrebalancer le danger du PKK – et non des Kurdes, car il existe des Kurdes pro-Erdogan, des Kurdes pro-iraniens, des Kurdes communistes comme les adeptes du PKK – par l'État islamique, mais ils n'ont pas réussi. Toutefois, il faut se souvenir que la fameuse prise de Kobané n'aurait pas été possible sans l'aide des Turcs. Ceux-ci ont certes fermé la porte au PKK et à sa branche syrienne YPG, mais ils ont permis l'acheminement des peshmergas depuis le Kurdistan irakien pour venir en aide aux Kurdes de Kobané.
Les États de la région sont donc en première ligne, surtout l'Arabie Saoudite qui voit un État révolutionnaire se construire à ses portes. Lénine, qui allait créer l'Union soviétique, n'a-t-il pas été accueilli comme réfugié en Suisse et aidé par l'Empire allemand ? Les impérialistes de l'Empire allemand pouvaient-ils deviner que l'Union soviétique allait naître et qu'elle deviendrait un danger imminent pour toute l'Europe pendant soixante-dix ans ? Il en va toujours ainsi des constructions historiques, fondées sur des convergences et des divergences d'intérêts.
Cet État islamique révolutionnaire, très attirant pour une bonne partie de la population du monde arabe, l'est aussi pour des Occidentaux qui reviennent frapper les pays dont ils sont ressortissants, ce qui est inédit. Les raisons en sont multiples. À celles qu'a citées M. Luizard s'ajoutent les interventions des pays occidentaux à l'étranger. La France est engagée dans des guerres contre des mouvements djihadistes sur plusieurs territoires, depuis des décennies. La nouveauté, c'est que l'État islamique parvient à recruter des Occidentaux pour commettre des attentats chez eux. Ceux qui ont frappé à Paris et à Bruxelles sont des Belges et des Français ; c'est ici qu'ils ont monté des équipes, fabriqué les explosifs, acheté des armes et frappé.
Est-ce parce que l'État islamique est en recul qu'il frappe ? Je ne le pense pas. Le terrorisme est un mode opératoire, non une fin en soi. L'État islamique a démontré sa capacité d'anticipation dès qu'il a commencé à kidnapper des journalistes occidentaux, alors que le califat n'était pas encore proclamé et que l'État islamique en Irak et au Levant était encore au stade embryonnaire : il savait pertinemment que les pays occidentaux allaient réagir. Les djihadistes avaient alors les otages sous la main. Heureusement, les otages français – je connais certains d'entre eux personnellement – ont été libérés à temps, mais les autres n'ont pas tardé à être exécutés. Quand l'État islamique a commencé à envoyer en France des équipes ou des personnes chargées de tâter le terrain, comme Mehdi Nemmouche, il n'était pas du tout en recul. C'est dès l'été 2014, au début des frappes, qu'il a envoyé en Libye l'Irakien Al-Anbari, émir opérationnel très proche de Baghdadi. On ne peut donc pas dire que la Libye fasse partie d'un plan de retrait : elle était dans le viseur de l'État islamique dès le début de l'année 2013.
L'État islamique a donc un vrai projet, si condamnable soit-il, qui risque d'être viable et doit être estimé à sa juste valeur. Il ne s'agit ni d'une secte, ni d'une déviance, ni d'une maladie.

Nous sommes très heureux d'avoir de vrais experts autour de la table et de pouvoir tirer profit de leur expertise.
On comprend en vous écoutant que le problème est notamment né du démantèlement des États-nations qu'étaient l'Irak et la Syrie. Au vu de la situation actuelle sur place, en particulier en Syrie, ce problème peut-il avoir, selon vous, une solution politique ? Jusqu'à présent, on s'en tient aux bombardements aériens, ne voulant pas intervenir au sol au motif que cela ne résoudrait pas durablement le conflit et pour ne pas créer un Irak bis. Si une solution politique est possible, de quelle manière ? Croyez-vous à une intervention au sol ? Je n'ai pas dit de qui. Quelle pourrait en être la suite ?
J'aimerais formuler quelques remarques liminaires sur le phénomène djihadiste avant de dire quelques mots de la donne géopolitique.
Il est intéressant d'avoir organisé cette table ronde autour de l'idée de contexte régional, dans la mesure où le phénomène djihadiste, caractérisé par sa dimension transnationale et sa tendance à la dématérialisation, voire à la déterritorialisation, est difficile à encadrer en termes territoriaux. Toutefois, en analysant le jeu transnational et le jeu des puissances étatiques elles-mêmes, qu'elles soient internationales ou régionales, il faut aussi garder à l'esprit la donne locale. On a tendance à l'ignorer ou à la minimiser alors que c'est elle qui nourrit, sinon le phénomène, du moins le succès de l'offre politique que représente l'État islamique.
En deuxième lieu, le phénomène djihadiste s'inscrit dans un cadre historique, géopolitique et idéologique : il serait naïf ou simpliste de le réduire à un phénomène religieux. Cependant, le projet de l'État islamique est à la fois politique, car il vise à créer un État, et religieux : c'est le prisme de la religion qui permet de qualifier cet État et la religion y est un facteur de mobilisation idéologique. Il y a là une imbrication du fait politique et du fait religieux qui rend cette créature difficile à identifier et complexe à analyser. Mais c'est aussi cette double dimension qui explique son succès.
Troisièmement, s'agissant des grilles de lecture en vogue, celle qui consiste à réduire la géopolitique contemporaine à un choc des civilisations est simpliste : nous assistons non à une confrontation entre civilisations ou entre religions, mais à des conflits au sein même de communautés relevant a priori d'une même religion. Cet état de fait échappe à la lecture binaire qui nous a été proposée et qui continue de connaître une certaine fortune. D'où, je le répète, l'importance de l'infranational ou du local lorsqu'il s'agit d'expliquer ces phénomènes régionaux, voire globaux, mais dotés d'un ancrage parfois purement local.
J'en viens au contexte régional et à la géopolitique. Il est difficile de délimiter le territoire pertinent. À cet égard, votre réflexe est juste : bien que le Bataclan soit très loin de la Syrie, nous savons tous que ce qui s'y est passé est intimement lié à la situation syrienne. En même temps, peut-on vraiment circonscrire les frontières à l'intérieur desquelles s'inscrirait la « guerre contre le terrorisme » dont on nous parle ? J'en doute, comme je doute du concept même de guerre contre le terrorisme – j'aurai l'occasion d'y revenir. Il me semble néanmoins que le Bassin méditerranéen est incontestablement au coeur des enjeux stratégiques qui sont directement ou indirectement liés au phénomène djihadiste. Sa rive sud, sa rive est, mais aussi, aujourd'hui, sa rive nord – l'Europe – subissent les effets de la montée en puissance du djihadisme. Il y a donc une réflexion stratégique à mener sur notre rapport à la Méditerranée comme espace géopolitique pertinent. Ainsi, l'analyse du djihadisme me semble donner un intérêt particulier à la question, classique chez les géopoliticiens, de savoir si la Méditerranée existe comme espace cohérent, géopolitique.
Pour étayer cette hypothèse, soulignons le cadre général et structurel plus large dans lequel s'inscrit le phénomène djihadiste. Ces dernières années, une série d'événements majeurs a bouleversé la donne géopolitique en Méditerranée : les soulèvements populaires sur ses rives sud et est, la dislocation et la faillite d'un certain nombre d'États, voire d'États-nations, ainsi que des faits insuffisamment soulignés comme la découverte d'hydrocarbures en Méditerranée orientale, qui pourrait représenter une source de tensions à moyen terme.
S'y ajoute le rôle contrasté joué par les deux grandes puissances mondiales que sont les États-Unis et la Russie. D'un côté, sous les deux mandats de Barack Obama, on a assisté à la définition et à la mise en pratique d'une doctrine prudentielle, qui s'est concrétisée au Moyen-Orient par un retrait au moins apparent ; de l'autre, au contraire, la Russie a adopté une stratégie diplomatique et, désormais, militaire relativement agressive. Ce contraste assez saisissant doit lui aussi nourrir notre réflexion géopolitique.
Par ailleurs, le Moyen-Orient est aujourd'hui en proie à deux types de guerre : une guerre froide et une série de guerres chaudes, locales, qui sont autant de guerres par procuration que se livrent les deux protagonistes de la guerre froide, à savoir l'Iran et l'Arabie Saoudite. Là encore, la grille de lecture purement confessionnelle ne saurait suffire à expliquer les sources de cette confrontation, qui a abouti notamment à la rupture des relations diplomatiques entre les deux puissances régionales. Il y a là, à mon avis, une configuration beaucoup plus classique, celle d'une confrontation pour l'exercice d'un leadership, sur fond d'un jeu assez trouble de la part des États-Unis.

Vous vous dites sceptique quant à la notion de guerre contre le terrorisme, à laquelle font régulièrement référence le chef de l'État et le Premier ministre. Pourquoi ? N'est-ce pas une guerre que nous livrons au terrorisme ?
Lutter contre les actes terroristes, y compris de manière préventive, et, naturellement, de manière répressive, va de soi. Il ne s'agit pas de discuter le fait que l'on consacre à cet objectif tous les moyens qui sont à la disposition de l'État. En revanche, il est très problématique de basculer dans une rhétorique guerrière s'agissant du fait terroriste, en particulier de Daech et du djihadisme. Car on aurait alors affaire à une guerre sans fin, puisque le principal facteur de mobilisation du djihadisme est d'ordre immatériel : il est idéologique. Si nous pouvons vaincre militairement l'État islamique, l'assécher financièrement, casser ses infrastructures et sa capacité à répondre à des besoins sociaux qui relèvent de ce que nous appelons les services publics, si nous pouvons remettre en cause les fondements du système qu'il tente d'instaurer, cette victoire – qui ne serait pas une victoire à la Pyrrhus – ne suffira pas à éradiquer le mal, pour parler en termes plus moraux. Ses racines, en effet, sont aussi idéologiques et l'État islamique incarne une offre politique dont il faut tenir compte.
Vous avez évoqué la possibilité de reconstituer un État-nation véritable en Syrie, mais aussi en Irak : c'est l'une des solutions que l'on pourrait envisager. D'autres suggèrent de créer un État proprement sunnite en Irak, ce qui signifierait la fin de l'Irak comme État-nation – à supposer que celui-ci ait véritablement existé un jour.
C'est effectivement une autre hypothèse. Quoi qu'il en soit, là est l'enjeu : notre réponse politique, voire – je songe aux jeunes djihadistes européens – notre offre spirituelle ou quasi spirituelle. Car je doute que faire la guerre au sens militaire du terme suffise à retenir nos jeunes.
Pour ma part, n'étant spécialiste ni du terrorisme ni du djihadisme, je vous parlerai de géopolitique – c'est mon métier, que je pratique au quotidien.
Quels sont nos intérêts sur place ? Quel est le jeu des acteurs régionaux et globaux dans la région ?
Si le Moyen-Orient demeure aussi crucial pour nous autres Occidentaux, ce n'est plus du tout à cause du pétrole ou du gaz, contrairement à ce que l'on croit, mais pour des raisons commerciales. L'essentiel de notre production industrielle, les échanges commerciaux entre l'Europe, l'Asie et une partie du monde passent par la route maritime qui part d'Asie et chemine par l'océan Indien, le détroit de Bab el-Mandeb, puis par la mer Rouge, le canal de Suez et la Méditerranée, pour aboutir dans les grands ports européens. Dans un sens, on achète des matières premières, des pièces de rechange ; dans l'autre, on réexpédie des biens de consommation. Si l'on coupe cette artère vitale, on met à genoux une partie de nos industriels, non seulement français mais européens.
D'autres options existent. D'abord emprunter la route du Cap, comme on l'a fait par le passé. Le problème est que cette route est de 25 % plus longue et de 20 à 22 % plus chère. Dans ce monde très compétitif, nos industriels seraient-ils capables de payer le surcoût ? On pourrait également passer par la voie du Nord, mais pas tout de suite, peut-être dans dix à vingt ans. Il y a aussi la nouvelle route de la soie que les Chinois tentent de nous proposer ; mais elle se résume à une voie ferrée et deux autoroutes, de sorte qu'elle ne pourrait drainer qu'une part marginale du trafic, 20 à 25 % tout au plus, alors que le trafic maritime mondial devrait doubler d'ici à quinze à vingt ans.
Cette route cruciale qui passe par le Moyen-Orient et par la Méditerranée, nous sommes donc condamnés à la défendre si nous voulons défendre notre économie.
Elle possède une sorte de goulet d'étranglement : la mer Rouge, avec une porte d'entrée et une porte de sortie qui sont alternativement le canal de Suez et le détroit de Bab el-Mandeb. Celui-ci est, pour nous autres Européens, infiniment plus important que le détroit d'Ormouz, lequel ne sert qu'au passage du pétrole et concerne essentiellement les pays d'Asie qui achètent leur pétrole au Moyen-Orient. C'est parce que le détroit de Bab el-Mandeb est crucial que tout le monde est aujourd'hui présent à Djibouti : les Français et les Américains – c'est bien connu –, mais aussi l'Union européenne, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, la Chine, l'Arabie Saoudite et bientôt les Émirats arabes unis, sans compter l'Inde et la Russie qui frappent à la porte.
L'accès à cet espace de la mer Rouge est facile à interdire. Ainsi, Al-Qaida dans la péninsule Arabique (AQPA) peut assez rapidement menacer le détroit de Bab el-Mandeb, et Daech pourrait être tenté, en cas de fragmentation de l'Arabie Saoudite, de fondre sur la mer Rouge depuis la Syrie et l'Irak, mettant ainsi en péril l'axe d'approvisionnement commercial vital de nos démocraties européennes. Je n'insiste pas sur le canal de Suez, absolument essentiel puisqu'il sert, je l'ai dit, de porte d'entrée et de sortie.
Comme le disait fort justement Béligh Nabli, une nouvelle donnée géopolitique est en train d'apparaître : les très grandes réserves de gaz naturel offshore qui sont découvertes toutes les semaines, tous les mois et qui représentent un véritable eldorado gazier. Israël et l'Égypte exploitent déjà ce gaz ; le Liban rêve de le faire mais, empêtré dans ses problèmes politiques, il n'y parvient pas encore ; Chypre, la Syrie et l'Autorité palestinienne voudraient aussi leur part du gâteau. Cette région de Méditerranée orientale, qui couvre l'entrée du canal de Suez, devient ainsi une zone de turbulences et de conflits potentiels, mais pourrait aussi apporter l'apaisement à moyen, voire à long terme : si la raison prévalait, tous s'assiéraient autour de la table pour tenter de se répartir la manne.
J'aimerais enfin vous présenter ce que sont, pour le géopoliticien que je suis, les défis sécuritaires en Méditerranée et en Afrique du Nord. De ce point de vue, où faire passer la frontière sud de nos intérêts européens pour lutter le plus efficacement possible contre le djihadisme et éviter l'unification des fronts djihadistes ? Ces derniers sont au nombre de cinq : en Irak et en Syrie, bien sûr ; dans la péninsule du Sinaï ; dans la zone côtière libyenne, que je qualifie de « chaos libyen », soit toute la moitié nord et côtière de la Libye, la frontière égyptienne, le sud de la Tunisie et une petite partie de l'Est algérien ; dans l'immense bande sahélo-saharienne ; au Yémen. Notre intérêt vital est de tout faire pour que les mouvements djihadistes aient le moins possible accès à la Méditerranée et à la mer Rouge, afin de défendre à tout prix notre sécurité maritime et commerciale ainsi que les navires de tourisme, et d'éviter absolument que ces cinq foyers se réunissent, ce qui signifierait que nous aurions perdu le contrôle de la région.
La stratégie la plus efficace pour compartimenter les fronts djihadistes consiste à projeter notre ligne de défense sécuritaire le plus au sud possible, de manière à séparer le front libyen, la bande sahélo-saharienne et la péninsule du Sinaï. En d'autres termes, il me semble que se fourvoient tous ceux qui, en Europe, disent en substance que nous devrions, si vous me permettez l'expression, laisser les Arabes se débrouiller entre eux et nous concentrer sur la défense de l'Europe par des opérations maritimes, en établissant, comme à la Renaissance, une grande ligne de défense face à l'Empire ottoman, passant par Chypre, la Crète, Malte, la Sicile et Gibraltar. Car si nous en arrivions là, c'est sur notre dernière ligne de défense que nous serions : en d'autres termes, nous aurions déjà perdu. Nous devons construire une défense de l'avant, le plus en amont possible.
Pour la France, le sujet de préoccupation prioritaire est la Libye. Daech n'a pas encore accès à la Méditerranée – ni face à la Syrie ni dans la péninsule du Sinaï. Mais les mouvements djihadistes présents dans le « chaos libyen » sont actifs et menacent directement nos intérêts.
Un pays est décisif, car situé à l'intersection de trois fronts djihadistes, voire quatre : l'Égypte. Nous avons donc intérêt à le soutenir. Je ne parle pas de morale, mais de géopolitique. Nous pourrons ainsi sécuriser plus facilement la Méditerranée orientale, la mer Rouge et le canal de Suez, le but étant de maintenir la « ligne de front » le plus loin possible de la ligne de communication maritime.
Que veulent les États-Unis ? On dit souvent qu'ils se sont désengagés ou qu'ils se désengagent du Moyen-Orient. Ce n'est absolument pas le cas ; simplement, ils se regroupent pour pouvoir intervenir de manière aussi décisive que par le passé, mais non plus à tout bout de champ, face à toute crise : conformément à la doctrine d'Obama et de son administration, uniquement si leurs intérêts stratégiques sont menacés. Ces intérêts sont la liberté de navigation – ils convergent sur ce point avec les nôtres –, la sécurité des citoyens américains répartis le long de l'axe de communication, la sécurité d'Israël et le contrôle de l'énergie en partance vers l'Asie. Celle-ci représente 75 % du pétrole et du gaz produits au Moyen-Orient, et en représentera 85 % après-demain. Aujourd'hui, les plus gros consommateurs de pétrole local sont les pays asiatiques – la Chine en tête, mais aussi le Japon et la Corée du Sud.

Je me permets de vous interrompre, monsieur Razoux. Votre présentation des enjeux économiques et géostratégiques du Moyen-Orient est fort intéressante, mais elle dépasse un peu le cadre de notre commission d'enquête. M. le rapporteur a posé une question à laquelle il n'a pas encore été apporté de réponse. Dans l'hypothèse où les groupes terroristes, en particulier de Daech et Jabhat al-Nosra, seraient éradiqués, comment envisagez-vous la reconstruction d'États viables ?
Tout d'abord, une intervention au sol, notamment en Syrie, est un piège absolu. Ce que souhaite Daech, c'est précisément que les Occidentaux s'engagent massivement au sol dans la région, pour pouvoir dénoncer le retour des croisades et la volonté des Occidentaux, non pas de libérer, mais de conquérir les deux sièges du califat historique, Bagdad et Damas.

Cet argument revient systématiquement lorsque nous posons la question de l'opportunité d'une intervention au sol. Mais existe-t-il une réelle différence de perception entre des frappes aériennes et l'envoi de troupes au sol ?
Les bombardements sont, en fait, une mesure conservatoire. Chacun comprend que la solution sera politique et militaire. Dans son aspect militaire, cette solution ne pourra être, au sol, que le fait de pays musulmans. En attendant que les gens de la région s'entendent sur ce qu'il faut faire, cela permet de gagner un peu de temps.

Permettez-moi de réagir à votre dernière phrase. Ce que vous dites, c'est que, dans l'attente d'une solution politique, il faut bombarder Daech pour le faire reculer un peu, mais sans chercher à l'éradiquer parce qu'on ne saurait que faire une fois qu'il aura été vaincu et que l'on ne veut pas se retrouver dans la même situation que les Américains en Irak. Mais quelle solution devons-nous attendre et combien de temps ?
N'oublions pas l'enjeu de l'opinion publique. Le soir du 13 novembre, nous avons été très durement frappés sur notre territoire national. L'état d'urgence a été décrété, les frappes aériennes se sont intensifiées en Syrie. Quelle est l'étape suivante ? On sait que la France sera de nouveau frappée, et probablement encore plus durement. Faut-il attendre deux ou trois autres Bataclan pour se décider à éradiquer Daech sans attendre une solution géopolitique ?
Dans votre manière de présenter le champ des possibles, vous raisonnez un peu trop en termes strictement militaires. La réponse ne peut pas être exclusivement militaire, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de notre réaction à une attaque terroriste. C'est pourquoi je remets en question l'idée de guerre contre le terrorisme. Les principaux moyens que nous devons utiliser relèvent, me semble-t-il, des services de renseignement, des services de police et des enquêtes judiciaires. Peut-être faudrait-il se doter, dans ce domaine, de moyens d'une autre nature puisqu'il semble qu'il y ait eu des dysfonctionnements. Si ceux-ci sont avérés – mais je ne suis pas spécialiste de la question –, peut-être devrait-on privilégier ces priorités-là. De fait, la France n'a pas les moyens de répondre seule à l'enjeu militaire et, en tout état de cause, la solution, à terme, est forcément d'ordre politique. Mais elle est complexe et, surtout, elle est dans les mains des protagonistes locaux.
Or, en Irak, l'état de corruption des élites, quelles que soient les communautés concernées, provoque un blocage politique qui ne permet pas que se dessine un système institutionnel susceptible de donner une consistance à un État nation irakien souverain. Quant à la Syrie, on peut se demander comment il serait possible d'y reconstituer un État nation au terme d'une guerre civile menée par celui qui est à la fois le chef de l'État et le chef d'une communauté. Néanmoins, les protagonistes du conflit sont les seuls à même de définir les termes du compromis à venir, et les puissances internationales et régionales doivent se mettre au service de cette négociation.

On a le sentiment, en vous écoutant, qu'il est urgent d'attendre. Bien entendu, je partage votre point de vue selon lequel la solution militaire ne peut être la seule. Mais nous sommes engagés militairement depuis septembre 2014 en Irak et depuis septembre 2015 en Syrie. Pourquoi n'allons-nous pas jusqu'au bout ? Vous réfutez la notion de guerre au terrorisme, et je respecte votre opinion, mais si nous nous disons en guerre, si la France est frappée sur son territoire, pourquoi ne cherchons-nous pas à éradiquer Daech ? Combien de temps cela prendra-t-il si l'on se contente de frappes aériennes ?
Vous raisonnez toujours dans un cadre strictement militaire.

On essaie de trouver une solution politique, mais de qui peut-elle venir ? Pas de Bachar el-Assad. De l'Iran ? De l'Arabie saoudite ?

Vous comprenez bien, messieurs, les interrogations de notre commission d'enquête. Nous avons posé la même question au chef d'état-major. Nous savons bien que la solution militaire n'est pas un but en soi – les dimensions politique, géopolitique, religieuse et régionale sont importantes –, mais elle est tout de même, selon nous, une étape nécessaire.
Peut-être l'urgence est-elle d'une autre nature : essayons d'abord de remédier aux défaillances qui ont été constatées et de nous prémunir contre de futures attaques. Si nous parvenons à les éviter, ce sera déjà une victoire. Elle ne serait pas d'ordre militaire, certes, mais ce serait une victoire contre le terrorisme.
Comme je vous l'ai dit dans mon exposé liminaire, il faut s'efforcer d'appréhender le terrorisme actuel à travers une nouvelle grille de lecture. Le terrorisme qui a menacé l'Occident au cours du XXe siècle, qu'il soit le fait des factions palestiniennes, du Hezbollah ou des Brigades rouges, était toujours un terrorisme d'État ; la négociation était donc possible. Par ailleurs, les terroristes venaient d'au-delà des mers. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas : frapper en Irak et en Syrie ne change rien à la capacité de nuisance terroriste de groupes comme Al-Qaida ou l'État islamique. Lorsque l'on a commencé à annoncer que l'État islamique reculait, un avion de ligne russe a été descendu au-dessus du Sinaï, à l'aide – peut-être ne le savez-vous pas – d'une canette de boisson piégée. On a annoncé une nouvelle fois son recul, et on a eu le 13-novembre. Plus tard, on a encore évoqué son recul, et on a eu des attaques à Bruxelles et en Tunisie. À chaque fois, les acteurs des attentats étaient des nationaux. Les équipes qui ont frappé en France et en Belgique étaient composées en partie de personnes qui revenaient de Syrie mais aussi de personnes qui n'y étaient jamais allées. Les armes ne leur ont pas été fournies par un acteur obscur ; elles ont été achetées sur le marché noir. Le TATP, un explosif très volatil, était « fait maison ».
D'une manière très diffuse. On leur a donné un « Go ! », ils sont venus avec les réfugiés – c'est une réalité –, mais ils ont réussi à monter leurs équipes ici, avec très peu de moyens. Rappelez-vous, le lendemain des premières frappes en Syrie, un citoyen français a été égorgé en Algérie par des Algériens se revendiquant de l'État islamique. Voilà ce qu'il faut comprendre : la nature de la menace terroriste a muté.
On dénie à l'État islamique la qualité d'État, mais on le frappe comme un État, en visant ses infrastructures, sa logistique. On essaie de frapper là où ça fait mal dans l'espoir que la population se retourne. Mais il faut tenir compte des dynamiques locales : cela pourrait fonctionner en Syrie, beaucoup moins en Irak. Toujours est-il qu'en Europe, la menace est le fait de ressortissants européens, qui agissent avec des moyens trouvés sur place et des financements très faibles. Dès lors, je ne sais pas si frapper en Syrie et en Irak contribuera à sécuriser l'Europe.
Je crois que nous nous accordons tous à dire que, pour vaincre les mouvements djihadistes, qu'il s'agisse de l'État islamique, de Jabhat al-Nosra ou d'autres mouvements actifs dans la région, il faut coupler la force militaire et la solution politique. Mais l'on n'y parvient pas parce que nous n'avons toujours pas pris de décision politique : nous ne savons pas sur qui nous reposer localement pour combattre. Dans la mesure où nous ne voulons pas nous engager militairement, nous déléguons, au sol, à des forces qui ne font qu'aggraver le conflit parce qu'elles en sont parties prenantes. Mossoul ne sera libérée ni par les Kurdes ni par l'armée irakienne, qui est considérée comme une armée ennemie par une très grande majorité de la population de la ville.
Là est le grand défi : la crise est telle, dans ses dimensions politique et historique, que la solution ne peut pas passer par les États en place. Nous ne pouvons nous reposer ni sur le régime de Bachar el-Assad, ni sur l'armée irakienne, qui est une armée, non plus nationale, mais confessionnelle, comme en témoignent les exactions commises contre les populations sunnites lors de la reprise de Tikrit.
Ce défi exige que nous prenions des décisions qui ne relèvent pas de la pure politique dans la mesure où de ces décisions dépendra le fait de savoir si nous devons intervenir ou déléguer au sol, et à qui. Selon moi, la délégation au sol est la pire des solutions, car elle ne fait qu'aggraver le conflit. On l'a vu avec l'intervention russe, qui a condamné toute solution politique dans le cadre de l'État syrien puisque les Russes ont pris fait et cause pour la communauté chiite, avec le soutien de l'Iran, du gouvernement de Bagdad, du Hezbollah et du gouvernement de Damas. Pourquoi soutenir une communauté contre une autre, si nous voulons la paix ? Car tel est bien notre but, en définitive : rétablir une forme de stabilité pour assurer notre propre protection.
Cette stabilité, les États en place ne sont plus à même de nous l'apporter. Cela signifie que nous devons nous pencher sur la question de l'avenir des Arabes sunnites d'Irak. En effet, bombarder ne sert à rien si l'on ne propose pas une solution politique à ces populations qui ont accueilli l'État islamique comme des libérateurs. Or, dans le cadre du système politique actuel tel que nous le reconnaissons, puisque nous avons une ambassade à Bagdad, les Arabes sunnites d'Irak sont condamnés à une situation que, très majoritairement, ils refusent. Se pose donc la question de l'avenir de l'État irakien et éventuellement celle du rattachement des régions sunnites à une Syrie majoritairement sunnite, ce qui suppose une remise à plat du système frontalier et étatique.

On a le sentiment, en vous écoutant, les uns et les autres, que les frappes ne servent à rien, que l'intervention au sol est un piège.
Je pense, au contraire, que nous n'échapperons pas à une intervention au sol lorsque nous reconnaîtrons que nous reposer sur l'armée irakienne, les Peshmergas et l'armée syrienne ne fait qu'aggraver la situation.
J'ai appris, par des contacts que j'ai encore à Mossoul, que, pour beaucoup de ses habitants, le scénario cauchemardesque serait un retour de l'armée irakienne. En revanche, il leur paraîtrait acceptable qu'elle soit occupée par une force internationale, même à dominante américaine.
Ou turque. Mais le problème des pays voisins, c'est qu'ils sont impliqués dans le conflit. Lorsque je parle d'une intervention au sol, je parle d'une intervention qui exclurait, après un accord politique, l'armée turque, l'armée iranienne et les armées arabes qui sont parties prenantes d'un conflit confessionnel. Nous n'avons aucun intérêt à prendre parti pour une confession contre une autre. On ne fera pas le coup des « conseils de réveil » aux Arabes sunnites, qui a plus ou moins fonctionné dans les années 2000, une seconde fois. La question cruciale est bien celle de savoir sur qui nous devons nous reposer. Il ne peut s'agir en aucun cas d'États qui sont, non pas une partie de la solution, mais le problème essentiel auquel nous devons penser.
Je vais préciser ma pensée : en l'état actuel des choses, les frappes ne changent rien à la menace terroriste en Europe.

Je retiens de vos interventions que la stabilité n'est, hélas ! pas pour demain. Dans son livre passionnant, M. Luizard explique bien que le conflit actuel est l'héritage de l'éclatement de l'empire ottoman et de la création d'États artificiels, la Syrie et l'Irak, auxquels les peuples eux-mêmes n'adhèrent pas. Dès lors, même si nous parvenons à réduire l'importance du prétendu califat, la solution ne consiste-t-elle pas, pour nous, à rétablir en Europe des frontières extérieures dignes de ce nom ?
Certes, ce type de mesures semble d'un autre temps, comme en témoigne la réaction outrée exprimée par les opinions publiques lorsque certains pays situés aux frontières extérieures de l'Union européenne ont décidé d'ériger des murs ou de dérouler des fils barbelés. Pourtant, les Américains eux-mêmes ont été contraints de construire un tel mur à la frontière mexicaine pour maîtriser les flux migratoires, et ce, indépendamment de toute menace terroriste. Sachant ce que vous savez de l'instabilité de cette région, pensez-vous que nous pourrons faire l'économie de frontières hermétiques à l'est de l'Europe ?
Je ne suis pas du tout expert en terrorisme, mais il me semble que des frontières hermétiques n'empêcheront pas les attentats. La plupart des membres des groupes qui ont agi en Europe ont été recrutés sur place. Quant à ceux d'entre eux qui viennent de Syrie ou d'Irak, ils pourront emprunter un autre chemin.
La solution, selon moi, est fondamentalement géopolitique. Pour résoudre la crise irakienne et syrienne, une triple entente est nécessaire : entre l'Iran et l'Arabie saoudite, qui doivent comprendre que leurs intérêts vitaux sont menacés et négocier afin de lutter contre Daech et faire monter les prix du pétrole ; entre les États-Unis et la Russie, qui s'entendent déjà car, de fait, M. Kerry et M. Lavrov se sont partagés le Moyen-Orient ; enfin, entre la Turquie et l'Union européenne, pour les raisons qui viennent d'être évoquées.
Mais, comme le disait Pierre-Jean Luizard, la question-clé est fondamentalement politique : c'est celle du territoire des sunnites irakiens et syriens et de leur avenir. Vous pouvez multiplier les bombardements ou envoyer au sol trois divisions blindées, cela ne changera rien ! Tant que les acteurs locaux et régionaux ne se seront pas mis d'accord sur ce point, rien n'avancera. Telle est, en tout cas, ma conviction profonde.

La France et d'autres pays européens entretenaient avec certains États des relations particulières dans le domaine du renseignement en matière de terrorisme, ce qui permettait de créer une sorte de zone tampon. De nombreux débats portent sur le rôle de la Turquie. Pensez-vous que ce pays lutte effectivement contre le terrorisme, en particulier contre Daech ?
Par ailleurs, il n'a pas du tout été question dans vos interventions du salafisme, notamment de ses liens avec l'Arabie saoudite – ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a que des terroristes en Arabie saoudite. Ce courant religieux a-t-il, selon vous, des rapports avec le terrorisme et, si oui, lesquels ?

On ne peut qu'être inquiets en vous écoutant, car vous confirmez que les difficultés actuelles, intérieures et extérieures, vont perdurer encore de nombreuses années et que nous ne sommes donc pas à l'abri de nouveaux attentats en France et en Europe.
Pensez-vous que certains pays jouent un double jeu et financent officieusement le terrorisme islamiste en Europe ?
Est-il possible aujourd'hui de nouer, en France, un dialogue avec des représentants d'un islam modéré, au sens littéral du terme ? Peut-on envisager la création d'un islam de France, doté d'un « clergé », ou bien l'existence de nombreux courants religieux au sein de l'islam rend-elle impossible la constitution d'un clergé qui pourrait lutter en interne contre l'islamisme ?
Monsieur Marleix, une sacralisation des frontières est une fiction, en particulier au regard d'un phénomène tel que le djihadisme, qui s'appuie sur des vecteurs de diffusion dématérialisés. L'un des principaux moyens de mobilisation et de recrutement des djihadistes, notamment européens, c'est internet. Cela souligne, non seulement la dimension transnationale du phénomène djihadiste, mais aussi et surtout les limites de l'action de l'État contre des organisations qui savent utiliser des moyens modernes bien que leur discours soit présenté comme archaïque. Pour l'instant, l'État n'est pas encore parvenu à apporter une réponse efficace à ce problème.
Je tiens à répéter que le terrorisme est un mode opératoire que ni l'État islamique ni Al-Qaida n'ont inventé. Il a été utilisé par de nombreux autres groupes au cours de l'histoire : les anarchistes, les communistes… Il faut donc appréhender l'idéologie djihadiste, qui a des ressorts religieux et sociopolitiques, comme on appréhenderait celle d'un autre mouvement. Le communisme révolutionnaire violent a profité de la dissolution des États européens après la Première Guerre mondiale ; aujourd'hui, l'idéologie djihadiste profite de la dissolution des États nations au Moyen-Orient.
Existe-t-il des États complices ? Certains États ont fermé les yeux au début de la révolution syrienne, pour diverses raisons. Mais, aujourd'hui, l'État islamique est un électron libre qui représente un danger imminent pour les Turcs, les Saoudiens et les autres États de la région. Sa dangerosité a d'ailleurs été perçue par les décideurs occidentaux dès 2014. C'est ainsi que certaines brigades rebelles syriennes ont été incitées à combattre l'État islamique bien avant que les frappes n'interviennent. Cette idéologie transnationale et transethnique est apparue comme un véritable danger pour la région et, éventuellement, pour les pays occidentaux, ce qui s'est confirmé par la suite. Les dynamiques locales sont bien réelles, mais cette idéologie attire des djihadistes de plus d'une centaine de pays différents.
Par ailleurs, existe-t-il des interlocuteurs dans le monde musulman ? Encore une fois, l'État islamique traduit une révolte. Les responsables musulmans reconnus, qu'il s'agisse d'al-Azhar, des responsables saoudiens ou des Frères musulmans, voire de certains idéologues d'Al-Qaida, sont honnis par les djihadistes de l'État islamique, qui les considèrent comme des apostats. Il s'agit d'une véritable idéologie révolutionnaire qui est en train de bouleverser le Moyen-Orient et le monde, tout en s'inscrivant dans des dynamiques locales. La réponse devrait venir, ne peut venir même, que de ces sociétés.
L'époque actuelle se caractérise par un certain vide idéologique, si bien que beaucoup de gens sont attirés par cette idéologie. Le panarabisme et le panafricanisme n'existent plus, non plus que les luttes ouvrières communistes qui ont pu, par le passé, conduire de jeunes Européens à aller se battre en Espagne ou à rejoindre l'Union soviétique pour construire un nouvel État. Or nombreux sont ceux qui ne se reconnaissent pas dans la société de consommation ; beaucoup, dans le monde arabe ou le tiers-monde, savent qu'ils n'auront jamais le chien, la voiture et le boulot qui va avec. Ils cherchent donc un autre modèle de société, et cela passe par cette violence à outrance et par cette rébellion contre tout, y compris contre leurs anciens mentors d'Al-Qaida. C'est cela que l'on devrait prendre en considération.
Encore une fois, je ne crois pas qu'ils soient aidés par certains États, car ils représentent un danger imminent. Les prisons saoudiennes sont remplies de djihadistes ! On a beaucoup parlé du chef religieux chiite exécuté par les Saoudiens, il y a quelques mois, mais personne n'a évoqué les quarante-deux chefs djihadistes sunnites qui ont subi le même sort. Les Saoudiens se sentent en danger, aujourd'hui. Quant au gouvernement turc, il a essayé de se préserver, car il sait pertinemment que se trouvent, au sein même de la société turque, des partisans du djihad. N'oublions pas que les premiers djihadistes en Irak étaient kurdes et que l'on compte des émirs kurdes dans les rangs de l'État islamique. Je rappelle qu'après les attentats des frères Kouachi, leurs funérailles imaginaires ont été organisées dans l'une des plus grandes mosquées d'Istanbul. Il faut prendre ces faits en considération lorsqu'on pense à la Turquie ou à l'Arabie saoudite, qui fournit un important contingent de djihadistes. Elle a mis sur pied un programme de déradicalisation – je n'aime pas ce terme – complètement lunaire, auquel elle a consacré des moyens importants, y compris la torture, et qui n'a pas fonctionné. Certains djihadistes saoudiens ont rejoint la Syrie en chaise roulante !
Cette idéologie a des ressorts religieux, mais elle transcende l'idée que l'on se fait de l'islam traditionnel, car ses adeptes se révoltent contre celui-ci. Croyez-vous que ceux qui ont rejoint les brigades communistes en leur temps ou les Vietcongs qui se faisaient exploser face aux chars français connaissaient Karl Marx par coeur ? Bien sûr que non ! On dit que les djihadistes ne connaissent pas l'islam et n'ont jamais lu le Coran. Et alors ? Ce n'est pas le sujet. Ce ne sont pas leurs penseurs ou des étudiants altermondialistes comme le jeune Roy – que j'ai suivi – que l'on envoie commettre des attentats en France, mais les délinquants, car eux savent où acheter des armes et des munitions, où trouver des points de chute. Lorsqu'ils ont envoyé un étudiant algérien, il s'est tiré une balle dans le pied et il a appelé une ambulance…
Cela est passé inaperçu, mais les printemps arabes et l'échec des islamistes qui ont été élus notamment en Égypte et en Tunisie ont provoqué un basculement très important au sein de la scène islamique mondiale. La mouvance salafiste, piétiste et quiétiste depuis environ un siècle, était opposée à ceux que l'on a appelés, à tort, les « islamistes » – je pense notamment aux Frères musulmans et à Ennahdha en Tunisie – et qui étaient prêts à jouer le jeu des élections, du parlementarisme et du système constitutionnel. Or le coup d'État du maréchal Sissi – avalisé, il faut le dire, par les puissances démocratiques – a semblé donner raison à ceux qui mettaient en garde les musulmans en leur disant : « Nos ennemis ne croient pas à leurs propres règles puisque, si le résultat des élections ne leur plaît pas, ils organisent un coup d'État ». Cet échec a effectivement permis à la mouvance salafiste de sortir de l'apolitisme militant et a signé l'arrêt de mort, programmé je crois, des partis islamistes, qui sont aujourd'hui en perte de vitesse au profit de l'État islamique ou de Jabhat al-Nosra, qui refusent quant à eux les règles de la représentation politique telle que nous l'envisageons. L'État islamique ne croit pas aux élections, ni à la règle majoritaire, au système constitutionnel ou au parlementarisme.
De fait, les printemps arabes ont libéré des segments multiformes des sociétés civiles, parmi lesquels ces partis islamistes qui avaient été très longtemps réprimés chacun dans son pays, et dont on voit aujourd'hui que très peu ont réussi, à l'exception, il faut le dire, de l'AKP en Turquie. Mais celui-ci a remporté les élections dans un contexte extrêmement conflictuel, puisque l'identité turque telle qu'elle a été recréée par Mustapha Kemal sur les ruines de l'empire ottoman s'est bâtie sur la fiction selon laquelle tout le monde est turc parce que musulman. Or, on le voit, parmi les musulmans, il y a aussi les Kurdes, et tous les musulmans ne sont pas sunnites. Le cancer de la communautarisation confessionnelle, qui vient du Moyen-Orient arabe, menace aujourd'hui directement la Turquie, qui voit les bases de son identité sapée notamment par la « kurdité » qui refait surface. Par ailleurs, nombre d'intellectuels turcs redécouvrent leurs ancêtres arméniens, bessarabiens ou tcherkesses, pour mettre à distance l'identité totalisante turque qui a permis à la Turquie de fonctionner jusqu'à aujourd'hui. Enfin, la communauté alévie turque a des revendications multiples, mais elle veut être reconnue. Or elle ne le sera jamais dans le cadre de l'islam turc, car elle serait considérée comme une communauté hérétique.
La mouvance salafiste, issue de ces mouvements historiques, inspire aujourd'hui directement les mouvements djihadistes et se pose en ennemi irréductible des États en place, considérés comme illégitimes. Ainsi, comme l'a dit Wassim Nasr, les mouvements djihadistes se proclament héritiers des printemps arabes, car ils estiment être ceux qui portent les espoirs des musulmans trahis par les régimes en place et – on commémorera demain le centième anniversaire des accords Sykes-Picot – par les promesses non tenues des puissances occidentales.

À vous entendre, messieurs, nous n'avons guère de raisons d'être optimistes. La situation est d'une telle complexité que, si je vous ai bien compris, nous en avons encore pour quelques années.

Pas de solution militaire, pas de solution religieuse, pas de solution politique, pas de solution diplomatique, pas de frontières !
Le djihadisme peut, à mon humble avis, représenter le même bouleversement que celui qu'ont provoqué, en leur temps, le communisme, le fascisme ou l'idée d'État nation.

Certes, vous n'êtes pas là pour nous rassurer, mais le constat des experts que vous êtes n'est pas d'un optimisme extraordinaire.
On parle peu d'Al-Qaida, mais il s'agit d'un mouvement plus subtil et tout aussi puissant que l'État islamique : avec AQMI, AQPA, leur présence en Somalie et leur branche indienne, ils sont très forts. Quant au Front al-Nosra, il est aujourd'hui profondément ancré dans la rébellion syrienne. C'est un élément à prendre en considération, car ils ont, comme le prouve la manière dont ils ont négocié la libération des otages, une expérience politique que n'a pas l'État islamique.
De fait, l'échec des révolutions arabes a joué un rôle. Ainsi Al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaida, a déclaré qu'ils incarnaient désormais l'espoir né des révolutions arabes. Lorsque Morsi, le président égyptien, a été emprisonné, des affiches ont été diffusées sur les réseaux djihadistes qui montraient côte à côte, d'une part, Morsi derrière les barreaux avec, à ses pieds, une urne – une caisse d'élection, en arabe – et, d'autre part, al-Baghdadi avec, à ses pieds, une caisse de munitions, en train de prêcher à Mossoul. Sur Morsi était dessiné un « X » rouge, sur al-Baghdadi un « Juste » vert.
Au Sinaï, Ansar Baït al-Maqdis, l'un des plus grands groupes djihadistes, bien qu'étant égyptien comme Al-Zawahiri, n'a pas fait allégeance à Al-Qaida mais à l'État islamique, avec armes et bagages. C'est un groupe très fort qui monte en puissance depuis plusieurs années. Ils sont en Libye, dans le fief de Kadhafi, car ils ont capitalisé sur le fait que le clan de ce dernier a été exclu de la solution politique. Idem pour les sunnites en Irak et en Syrie. Aujourd'hui, ils attirent au-delà de leurs frontières, dans des pays comme l'Indonésie.
La Tunisie fournit le contingent le plus important. Il ne faut pas regarder ce pays à travers le prisme de la société civile de Tunis. Les kamikazes qui se font exploser en Libye sont tunisiens, alors que la Tunisie nie cette réalité, en prétendant que ces djihadistes viennent de l'étranger. Lors des opérations à Ben Gardane, l'État islamique avait un plan A et un plan B : ils ont tué le chef des renseignements local et ont tenu le centre-ville pendant plusieurs heures en établissant des check points. Ils étaient soixante ; l'opération était bien préparée. Certes, ils ont ensuite été écartés par l'armée, mais ils ont marqué un point.
Aujourd'hui, l'idée du djihad militaire transcende les calculs géopolitiques rationnels. Ses adeptes veulent construire un nouveau système, comme d'autres avant eux. Cela n'a rien d'exceptionnel, mais on a parfois la mémoire courte et, dans nos sociétés laïques, on a tendance à nier que la religion puisse être le moteur d'un mouvement politique. Pourtant, le Président américain jure sur la Bible, le Patriarche Kirill a béni les avions russes qui survolent la Syrie. Le ressort religieux peut motiver des populations.
Je serai, pour ma part, un peu plus optimiste. Au-delà de l'aspect irrationnel, il faut compter avec des facteurs rationnels, notamment le prix du baril de pétrole. Je ne crois pas du tout que la guerre durera des décennies. Pour qu'une solution émerge, il faut que l'Iran et l'Arabie saoudite s'entendent sur la manière dont ils peuvent se partager à nouveau la région et sur le sort qu'il faut réserver aux sunnites irakiens et syriens. Admettons qu'ils s'entendent. Si cette solution est acceptable par les États-Unis, la Russie et la Turquie, cela peut aller relativement vite. Or les Iraniens et les Saoudiens seront acculés à la négociation lorsqu'ils n'auront plus d'argent. C'est pourquoi le prix du baril du pétrole est un élément crucial, de même que le nombre d'années de réserve dont chacun dispose.

Messieurs, merci pour cette intéressante contribution à nos travaux, qui fera l'objet d'un compte rendu publié dans notre rapport.
La séance est levée à dix-neuf heures quarante.