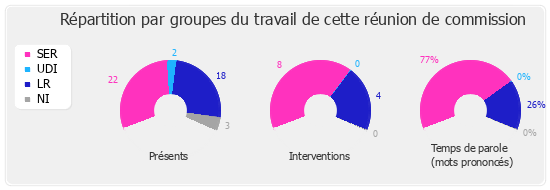Commission des affaires étrangères
Réunion du 22 février 2017 à 18h30
La réunion
La séance est ouverte à neuf heures quarante-cinq.

Mes chers collègues,
Mme Elisabeth Guigou, qui accompagne le Premier ministre dans un voyage officiel en Chine, m'a demandé de présider cette réunion de la commission des affaires étrangères, qui est la dernière de la législature, sous réserve naturellement que l'actualité internationale nous conduise à nous réunir d'ici la fin de la législature. Elle m'a chargée de l'excuser et de vous faire part du plaisir qu'elle avait eu à travailler avec vous et, pour ma part, j'ai beaucoup appris au contact de mes collègues dans cette commission. La commission publiera prochainement un bilan qui témoignera de l'intensité et de la diversité de nos travaux.
Pour notre 468ème réunion, nous allons devoir examiner deux rapports d'information ; je vous invite par conséquent à la concision.
L'ordre du jour appelle l'examen, ouvert à la presse, du rapport de la mission d'information sur les Balkans dont les co-rapporteurs sont M. Pierre-Yves Le Borgn' et M. Jean-Claude Mignon.

Nous souhaitions Pierre-Yves Le Borgn' et moi-même, depuis le début de la législature, que notre commission se penche sur la situation des six pays des Balkans occidentaux que sont l'Albanie, la Serbie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo et l'Ancienne République yougoslave de Macédoine.
Il nous semblait en effet que, parce qu'il n'y avait plus de guerre ouverte, la France s'était détournée et faisait à cet égard preuve d'une grande négligence à l'égard de pays fragiles qui ont vocation à intégrer l'Union européenne. Cette mission aura eu pour ambition de conduire une analyse approfondie de la situation des six pays et de démontrer la nécessité d'une inflexion stratégique de notre diplomatie.
Nous disposions de quelques mois pour examiner une région complexe, hétérogène et traversée de dynamiques multiples. Nous appuyant sur notre connaissance de la région et sur nos travaux au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, que j'ai eu la chance de présider, nous avons décidé de structurer nos travaux autour d'un axe principal : l'État de droit. Pourquoi ?
Les Balkans ont vocation à intégrer l'Union européenne, comme cela été confirmé au sommet de Thessalonique en 2003 et sans cesse réaffirmé depuis. Cette perspective requiert l'établissement de véritables États de droit, apaisés et fonctionnels. Indépendamment du processus d'adhésion, la mise en place d'un environnement normatif et politique libéral, c'est-à-dire contribuant à l'exercice des libertés individuelles et collectives et producteur de paix, constitue un objectif en soi. En outre, c'est une condition du développement économique, parce que cela influe entre autres sur le climat des affaires, la croissance et le fonctionnement de l'ascenseur social.
S'intéresser à l'État de droit dans les Balkans nous met face à nos responsabilités. Le soutien populaire à l'adhésion à l'Union européenne a d'abord été celui de citoyens désireux de rompre avec des schémas antérieurs, de basculer dans un environnement plus ouvert. L'Union européenne était une promesse d'avenir et sa crédibilité se joue aussi dans les pays des Balkans : crédibilité du processus d'élargissement, enrayé, crédibilité aussi de l'Union européenne quant à sa capacité à donner corps au projet qu'elle porte.
Nous avons, ces dernières semaines, entendus trente personnes à Paris, notamment les six ambassadeurs des Balkans, des diplomates, des personnalités qualifiées du Conseil de l'Europe et beaucoup d'experts, gouvernementaux ou non gouvernementaux. Nous nous sommes également rendus en Serbie et en Bosnie-Herzégovine. Le choix de ces deux pays tient compte des déplacements que nous avions pu faire chacun de notre côté, mais il a aussi été guidé par ce qui nous a semblé indispensable.
Il nous semblait indispensable de disposer d'une vision réactualisée de la situation en Bosnie-Herzégovine, toujours engluée dans ce que nous avons nommé dans le rapport l'horizon indépassable des accords de Dayton. Nous nous sommes rendus à Sarajevo, Banja Luka et Mostar et nous en sommes revenus avec le sentiment d'une paralysie dont il faut trouver les moyens de sortir.
Il nous semblait tout aussi indispensable de nous rendre en Serbie qui doit être le point d'entrée de notre diplomatie dans la région. Au-delà de notre relation très forte avec ce pays, la Serbie est au coeur de la dynamique régionale. Ce qui s'y passe conditionne de manière prégnante les évolutions de toute la région. Poids économique, population qui représente environ 40 % du total de celle des six pays, importance des minorités serbes dans les autres pays de la région, implication dans les conflits qui ont endeuillé la région au cours des années 1990, carrefour géostratégique ; autant de facteurs qui expliquent le rôle de la Serbie dans les processus régionaux.
Or, alors que la situation économique s'améliore et pourrait jouer un effet d'entrainement vertueux, on constate en Serbie une forme de raidissement très révélatrice des tendances observables dans toute la région, et qui trouvent en partie leur source dans la faiblesse de l'Union européenne. Quelles sont ces tendances ?
Ce qui nous a semblé utile de mettre en exergue dans ce rapport, c'est que les Balkans occidentaux sont dans une situation très singulière et en même temps très similaire à celle du reste de l'Europe. La catégorie de Balkans occidentaux que l'Union européenne a créée a des effets très ambigus : elle sert d'appui à des processus d'intégration régionale, dont nous avons examiné l'efficacité, mais nie, à la fois l'extrême hétérogénéité des six pays, et leur participation à des processus européens communs.
La singularité est marquée particulièrement dans les pays issus de l'ex-Yougoslavie qui sont des Etats-nations inachevés dans un temps post-communiste et post-conflits. Cela explique la grande difficulté à appréhender la réalité des évolutions en matière d'État de droit et de réconciliation mémorielle. La mécanique de l'élargissement a peu de prise sur des processus longs et sur une réalité du pouvoir très informelle. Pierre-Yves Le Borgn' en parlera, je n'y insiste pas.
Les Balkans sont aussi singuliers dans leurs rapports aux grandes puissances extérieures à l'Union européenne pour des raisons historiques et culturelles, elles-mêmes liées à une réalité géographique. L'histoire est vivace et même réactivée par le choix d'intégrer une Union européenne qui se définit de plus en plus à l'intérieur d'une frontière qui la sépare, d'un côté de la Russie, de l'autre de la Turquie.
Or, l'incapacité du processus d'élargissement à améliorer la situation économique et sociale, sa lenteur, le sentiment d'indifférence de la Commission européenne fragilisent les choix effectués et créent un vide jouant en faveur de modèles alternatifs. Jusqu'à présent, la présence américaine et son crédit dans la région ont ralenti cette évolution, mais le retrait américain devrait s'accentuer. L'autonomisation des Balkans par rapport aux puissances extérieures est un défi stratégique.
Il était intéressant de relever au cours des différentes auditions les points de vue très différents des interlocuteurs sur le poids de la Russie dans les Balkans. La Russie dispose de levier d'influence économiques et religieux non négligeables. Il faut cependant relativiser son influence, compte tenu des mésaventures des projets énergétiques, notamment Southstream, et du soutien finalement assez faible de la Russie à la Serbie, au-delà de l'imaginaire symbolique et des déclarations intempestives. Souvenons-nous ainsi de la reconnaissance par la Russie de l'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Nord.
Republica Srpska mise à part, il n'est pas certain que la Russie apparaisse comme un partenaire fiable et une alternative crédible dans les Balkans, malgré les liens historiques étroits. Il n'en demeure pas moins que des points de vulnérabilité existent, sources d'instabilité potentielle.
La Turquie dispose d'une influence grandissante dans les Balkans. Istanbul a longtemps fait figure de métropole de la région, sur le plan humain et économique ; c'est la ville où l'on partait faire ses études, faire affaire, travailler, indépendamment de sa religion. C'est d'ailleurs le cas de nombre d'hommes politiques des Balkans. Le volume des échanges entre les Balkans et la Turquie est passé de 2,9 milliards de dollars en 2000 à 17,05 milliards en 2012. La Turquie est aujourd'hui le premier bailleur de fonds de la région et a engagé des investissements structurants, par exemple, en Serbie, pour l'aéroport de Kraljevo et les routes du Sandjak ou au Monténégro dans le secteur de la sidérurgie. La diplomatie turque est très active et le régime se présente comme garant de la stabilité.
Les relations de la Turquie avec l'Union européenne subissant des soubresauts, il n'est pas impossible qu'elle tente de renforcer encore son influence avec les Balkans. On assiste déjà au retour d'un certain islamo-nationalisme sous influence turque. Depuis 2001, les liens religieux ont également fortement augmenté, avec la Diyanet (la Direction des affaires religieuses turque) et avec les réseaux de Fethullah Gülen, ce qui d'ailleurs pose aujourd'hui un problème.
Toutes ces analyses géopolitiques concourent à souligner que les Balkans sont une caisse de résonance des grandes aires d'influence régionale et mondiales. Le rapport est évidemment bien plus développé à ce sujet que les quelques remarques que je viens de formuler. Cette donnée géostratégique et géoéconomique revêt une importance fondamentale pour les pays européens et, à défaut d'une diplomatie européenne forte, la France ne peut pas rester passive.
À côté des dynamiques propres aux Balkans occidentaux, les six États sont face aux mêmes défis que connaît l'Union européenne, défis qui d'ailleurs font vaciller l'État de droit au sein de l'Union. Ils appartiennent de facto à notre espace européen commun.
Les grands défis de sécurité intérieure et de gestion des frontières de l'Europe impliquent les Balkans. La route des migrations a fait des Balkans une enclave au sein de l'espace de l'Union européenne. Ils ont subi l'incapacité à gérer cette crise et la décision de certains Etats membres de s'affranchir des règles de droit pour fermer leurs frontières. Il faut saluer la manière dont les six pays sont parvenus à gérer aussi humainement que possible les flots de population qui ont transité par leur territoire puis qui s'y sont trouvés bloqués. Entre septembre 2015 et mars 2016, le HCR estime que 700 000 migrants sont entrés sur le territoire de la Macédoine, de la Serbie, de la Croatie et de la Slovénie. Par ailleurs, les dangers que ferait courir un nouvel afflux sur la stabilité des Etats, notamment de la Macédoine, ne doivent pas être sous-estimés.
Concernant la sécurité intérieure, les Balkans sont, notamment à la faveur de pratiques de corruption ancienne, une zone de trafics, notamment de drogue, d'armes, de prostitution et d'organes qui constituent des menaces pour l'ensemble de l'Europe et des atteintes à la dignité humaine. Le Conseil de l'Europe est très mobilisé sur ces sujets. Le phénomène de radicalisation de l'islam est également préoccupant, s'appuie sur ces réseaux et utilise les flux de migrants, dans les deux cas pour faire transiter des hommes, des marchandises, des armes, pour procéder à des infiltrations etc.... On a observé des départs de djihadistes depuis les Balkans et au sein des diasporas, notamment kosovares et bosniaques résidant dans les autres pays de l'Union. Dans ce domaine également, une politique européenne se doit d'inclure les pays des Balkans.
Enfin, parmi ces défis communs, figurent la crise économique et sociale et la montée des nationalismes et des autoritarismes. Appréhender ces phénomènes qui existent dans les Balkans comme le pur produit de leur histoire propre est une erreur. Il y a aussi une crise du modèle européen. Dans ce sens aussi, la crédibilité de l'Union européenne se joue aussi dans les Balkans occidentaux, comme elle se joue en Grèce, en Croatie, en Pologne, en Hongrie ou en France.
L'articulation entre conscience des enjeux spécifiques et dynamique européenne commune appelle une révision de notre politique à l'égard des Balkans. Leurs vulnérabilités propres produisent des effets sur le reste de l'Europe. Les défis communs y ont des répercussions spécifiques. C'est cette dialectique permanente qui est aujourd'hui mal appréhendée.
Le discours sur la spécificité des Balkans, la poudrière, le confetti multiconfessionnel etc., sans être inexact restitue une vision très incomplète de la région et fait de la stabilité un prisme. L'Union européenne étant elle-même dysfonctionnelle, elle n'offre plus qu'une perspective d'adhésion, à un horizon de plus en plus lointain, perspective qu'il faut maintenir à tout prix pour garantir la stabilité dans ce que l'on continue à considérer comme les marges de l'Union européenne. L'attention se focalise sur l'examen formel des modifications de législation, avec les réserves d'usage, et la conditionnalité devient de plus en plus théorique.
Or, la recherche de la stabilité pour la stabilité, sans effort massif et réel en faveur de l'intégration européenne, sans avancées concrètes en matière de développement et d'État de droit, n'offre aucune perspective et produit de l'instabilité. L'Union européenne n'est-elle qu'un miroir aux alouettes ? On peut imaginer l'effet du doute sur des pays qui ne sont pas membres de l'Union et qui en ont fait leur principal objectif de politique étrangère comme de politique intérieure. Ce point est essentiel. Un sentiment de vide européen s'installe, porteur de tous les dangers et a minima d'un risque net que les populations se détournent de l'Union européenne.
La classe dirigeante qui a rallié la cause européenne souvent pour des raisons d'opportunité plus que de conviction ne perçoit plus vraiment de pression politique mais beaucoup d'indifférence. Reste une base nationaliste aisément mobilisable à des fins de légitimation dont le poids augmente mécaniquement sous l'effet de la désertification des Balkans, les jeunes émigrant en masse.
Une analyse critique du processus d'élargissement est donc plus que jamais nécessaire pour conférer force et pertinence au cap poursuivi. Cette ambition impose de réaffirmer l'objectif central de mise sur pied d'États de droit incluant une dimension de réconciliation et de conduire une diplomatie bilatérale qui catalyse le changement. Je cède la parole à Pierre-Yves le Borgn' pour présenter l'analyse critique et les orientations que nous proposons.

À l'orée du XXIème siècle, la perspective européenne semblait s'ouvrir en grand pour des Balkans enfin sortis de la guerre. Le sommet de Thessalonique, en 2003, officialisait cette vocation européenne : le chemin serait long et difficile, mais au terme d'une décennie, les six pays des Balkans occidentaux seraient membres de l'Union européenne.
En réalité, cette décennie, en dépit des immenses progrès réalisés par les Balkans, fut à certains égards une décennie perdue : au nom de la paix retrouvée, l'Union s'est parfois contentée d'une adhésion discursive des dirigeants balkaniques au processus européen, sans chercher à savoir si elles s'accompagnaient d'une réelle évolution des pratiques du pouvoir, et d'une progression de l'Etat de droit.
Des pas importants ont été faits dans le cadre des processus de rapprochement entre l'Union européenne et chacun des six pays des Balkans occidentaux, afin d'intégrer l'acquis communautaire, sur les plans matériel, institutionnel et normatif, malgré les difficultés politiques et économiques. Le processus d'adhésion a été enrichi. Il s'est doté d'instruments juridiques et opérationnels robustes, ainsi que de moyens conséquents, même si les moyens n'atteignent pas le niveau des financements accordés aux pays d'Europe centrale et orientale dans leur chemin d'adhésion à l'Union européenne.
Néanmoins, ce processus rencontre des limites. Celles-ci tiennent à des caractéristiques propres aux six pays et à la région, mais aussi à l'incapacité de l'Union européenne à exercer pleinement un rôle de catalyseur des changements auxquels aspire pourtant une grande partie de la population des Balkans.
Le processus d'élargissement aux Balkans est certes progressivement devenu le prisme structurant des politiques gouvernementales de chacun des six pays, mais cette situation n'est pas a priori acquise. L'intégration européenne n'est pas l'oeuvre de démocrates libéraux pro-européens au sens où nous pourrions les connaître chez nous avec le centre-droit, le PSE, le PPE. Elle est le fait de nationalistes assagis et devenus euro-compatibles davantage qu'euro-militants. Les héritiers politiques de Franjo Tudjman en Croatie ont été les premiers à ouvrir la voie et tous les autres ont suivi. Cela s'explique notamment par le fort soutien populaire dont bénéficie l'intégration européenne, et la reconduction récente du Premier ministre Serbe Aleksandr Vučić en est le meilleur exemple.
Il faut que nous soyons attentifs à la montée de l'euroscepticisme dans la population, et en particulier au sein de la jeunesse, qui s'impatiente de ne voir aucune amélioration aucun changement dans son quotidien. Dans un contexte où les conditions socio-économiques ne cessent de se dégrader, où d'autres modèles, russe ou turc, s'imposent et concurrencent, le positionnement politique des dirigeants des Balkans occidentaux peut toujours basculer. Nous avons pu en ressentir une forme de prémices au cours de notre déplacement en Bosnie Herzégovine il y a deux semaines.
Dès lors, la question posée par notre rapport est donc la suivante : comment continuer d'arrimer cette région stratégique à une Union européenne elle-même frappée par une crise sans précédent ? La stratégie des petits pas de l'Union européenne, qui a fait le choix de se concentrer sur le renforcement de l'Etat de droit, est-elle pertinente ?
Quel est le bilan de la décennie ? Une situation socio-économique dégradée et des risques de résurgence des nationalismes. En 1999 avait été lancé à Sarajevo le « Pacte de stabilité », en lien avec le FMI et la Banque mondiale, dont l'objectif principal était d'accompagner la transition des économies balkaniques. Contrairement aux pays d'Europe centrale et orientale, dont le rattrapage économique avait été fulgurant dans la perspective de leur intégration européenne, après une courte décennie de rattrapage économique, entre 2000 et 2008, les économies balkaniques ont été touchées de plein fouet par la crise financière et peinent depuis à sortir de la récession.
Tous les pays de la zone ont des balances commerciales déficitaires de 20 % en moyenne et leurs exportations représentent moins de la moitié du PIB, la concentration des investissements dans des secteurs non productifs, notamment bancaire, a eu pour effet d'accélérer la désindustrialisation. S'y ajoutent le chômage endémique, en moyenne de 50 % pour les jeunes de 16 à 25 ans, avec un chiffre qui peut atteindre près de 70 % dans certains pays, la faiblesse du taux d'emploi, qui est inférieur à 50 %, et une économie souterraine surdimensionnée pesant entre le quart et un tiers du produit intérieur brut.
Face à la dégradation des conditions de vie, la colère de la population s'amplifie, se communique et nous l'avons entendue lors de notre mission. Elle trouve trois principaux canaux d'expression. Le premier symptôme du mal-être est le nombre et l'intensité des mouvements sociaux que l'on relève au cours des années passées et qui ont touché la quasi-totalité des pays des Balkans depuis 2010, au point que certains commentateurs ont pu prédire un « printemps des Balkans », qui en réalité n'est jamais advenu, faute de traduction politique des mouvements populaires.
Le second symptôme, très préoccupant, est l'exode massif de la jeunesse balkanique. D'ici quelques décennies, des pays comme la Bosnie-Herzégovine pourraient perdre la moitié de leurs forces vives, qui sont pourtant l'avenir de ces pays et les premiers partisans du projet d'intégration à l'Union européenne. Ainsi que le résumait un interlocuteur de la mission, il ne restera bientôt plus dans les Balkans que des « personnes âgées et des nationalistes », ce qui réduit l'hypothèse de conflits armés certes, mais fragilise beaucoup l'orientation européenne des pays et leur développement économique.
Car, c'est là le dernier mode d'expression d'une fatigue vis-à-vis du processus européen, le maintien des Balkans dans une situation de sous-développement est propice par nature à la résurgence des nationalismes. En l'absence d'amélioration économique, les thèmes nationalistes demeurent les plus mobilisateurs au plan électoral. Il faut donc accorder la plus grande attention à l'évolution future des nouveaux régimes arrivés au pouvoir à partir de 2010, qualifiés par de nombreux observateurs d'« autoritaires pro-européens. L'absence de réaction européenne, des institutions européennes, à l'envoi par Belgrade vers Pristina d'un train couvert de slogans nationalistes ou bien à l'organisation d'un référendum de quasi pré auto-détermination, est à ce titre un mauvais signal adressé à nos partenaires balkaniques.
C'est dans ce contexte que la Commission européenne a fait le choix de faire de la progression de l'Etat de droit la pierre angulaire de l'intégration à l'Union européenne, avec des résultats en demi-teinte.
La lecture des rapports annuels de suivi de la Commission permet de constater la très grande hétérogénéité de la situation des six États. Certains distinguent les bons élèves, en particulier l'Albanie, ceux qui comme la Serbie sont plus proches de l'intégration mais ont encore du chemin à parcourir, ou encore des pays comme la Bosnie Herzégovine, dont la paralysie institutionnelle demeure un obstacle majeur, rédhibitoire même, à l'intégration européenne. Cette « approche au mérite » garantit les mêmes conditions pour tous au départ, mais elle ne présage pas de la date d'arrivée. Les travaux de notre mission ont mis en exergue plusieurs difficultés dans ce processus.
La première de ces difficultés procède d'obstacles intrinsèques aux Balkans, avec deux États en situation de grande fragilité juridique.
La Bosnie Herzégovine tout d'abord, et l'horizon qui semble pour elle indépassable des accords de Dayton dont l'annexe IV fait office de constitution du pays. Pensés pour être provisoires, ils enferment le pays dans des clivages qui sont hérités de la guerre, font peser des menaces de sécessions sur le pays, qu'elles soient serbe ou croate, maintiennent nationalisme et partant le clientélisme, qui vont main dans la main. Comme l'a souligné un interlocuteur de la mission, avant d'adhérer à l'Union européenne, les Bosniens gagneraient d'abord à adhérer à leur propre pays.
Il y a ensuite l'épineuse question du Kosovo, que seuls 23 des 28 Etats membres de l'Union européenne ont reconnu. Le fait que l'accord d'association ait été conclu par la seule Commission européenne et non pas dans le cadre d'un accord ratifié par les États-membres constitue un obstacle à une politique européenne homogène à l'égard du Kosovo. La ligne est cependant difficile à trouver : il nous faut à la fois être cohérent avec nous-mêmes, puisque la France a fait le choix de reconnaître le Kosovo, sans pour autant faire de cette question le point unique des négociations avec la Serbie, au risque d'aliéner l'intégralité du dialogue politique.
Les difficultés sont aussi structurelles du côté, et de l'Union européenne, et des États balkaniques.
La nouvelle approche développée par la Commission européenne est bienvenue en ce qu'elle place l'État de droit et les libertés au centre de l'examen des réformes pour prévenir les difficultés rencontrées lors des précédents élargissements. Néanmoins, en la matière, le bilan est en demi-teinte. Les réformes en effet se limitent trop souvent à la mise en place des instruments juridiques et peinent à modifier concrètement, dans la réalité des faits, des modes de fonctionnement et des pratiques bien enracinés.
Le fossé est grand entre la production législative conforme aux standards européens, et la mise en oeuvre réelle des réformes. Il en est ainsi des réformes de la justice : les lois sur la nomination des juges ou l'indépendance de la justice abondent, mais tardent à être appliquées ou les moyens et compétences du système judiciaire ne permettent pas leur mise en oeuvre effective. Citons aussi le cas de la liberté de la presse, théoriquement garantie en particulier par la Convention européenne des droits de l'Homme, mais qui connaît une grave régression dans la quasi-totalité des pays de la région. Citons également la corruption et les trafics, plus généralement le clientélisme, qui se nourrissent de la récession économique. Ou bien enfin, le respect défaillant d'un débat public libre.
Ici, la mission estime qu'il faut faire preuve d'une réelle fermeté avec nos partenaires balkaniques sans tomber dans une posture moralisatrice. Car le processus vers l'adhésion et les réformes structurelles qui l'accompagnent sont aussi importantes que l'objectif final et l'adhésion en elle-même, ce qui implique que les États se l'approprient. Mais appropriation ne veut pas dire « régime d'exception » et les pays des Balkans, s'ils veulent entrer dans l'Union européenne, vont devoir accepter ce changement de paradigme politique. Il en va de la crédibilité de la « nouvelle approche », censée précisément permettre l'établissement d'États de droit apaisés et fonctionnels.
Enfin, l'Union européenne, embourbée dans ses crises, n'est plus en capacité ni sans doute en volonté d'assumer un processus politique. Il en résulte une inquiétante re-nationalisation de la politique européenne à l'égard des Balkans : il est frappant par exemple que ce soit une initiative germano-britannique qui en 2014 ait proposé, sans y associer la France au demeurant, une relance du dialogue de la Bosnie Herzégovine avec Bruxelles. Le refus du Conseil de suivre l'avis de la Commission sur l'ouverture des négociations d'adhésion avec la Macédoine illustre également combien les intérêts nationaux, grecs et bulgares en l'occurrence, pèsent sur la poursuite (et la crédibilité) du processus d'élargissement. Le véto croate sur l'ouverture du chapitre de négociation 26 illustre lui aussi les risque d'instrumentalisation du processus d'élargissement pour le règlement de différends bilatéraux.
Que peut faire la France dans ce contexte ? La présence française s'est matérialisée au cours des années 1990 et 2000 par une participation intense et reconnue au sein des missions internationales. Je cite par exemple notre engagement dans la FORPRONU en Bosnie-Herzégovine, qui a coûté la vie à 84 soldats français. Jean-Claude et moi avons d'ailleurs tenu à déposer une gerbe à la mémoire de nos soldats lors de notre visite devant le monument qui se trouve juste en face de l'ambassade de France. Je pense aussi au contingent de militaires au titre de l'opération EUFOR-Althéa, au rôle actif dans la Mission de police de l'UE, au Kosovo, où trois Français furent à la tête de la KFOR et deux à celle d'EULEX, en Macédoine, au rôle actif joué dans le règlement de la crise de 2001, en particulier dans la négociation de l'Accord-cadre d'Ohrid, et à la réforme constitutionnelle conduite par notre ancien collègue sénateur Robert Badinter.
Mais avec son retrait militaire, la France n'a pas développé son implantation diplomatique et économique, laissant le soin à l'Union européenne de conduire une politique d'intégration régionale et de rapprochement dont l'on vient de voir les limites.
En 2013, le président de la République a été invité au sommet de Brdo-Brioni, signe du souhait des pays des Balkans occidentaux d'un retour de la France. La prise de conscience de la nécessité de reprendre pied dans les Balkans occidentaux, dans le contexte d'affaiblissement de l'Union européenne et d'enrayement du processus d'élargissement, a alors eu lieu.
Plusieurs signes ont été donnés : le réinvestissement des enceintes internationales, la nomination d'un représentant spécial chargé de développer nos relations économiques dans la région, notre collègue sénateur Alain Richard, le mandat donné en décembre 2016 à l'AFD de lancer une prospection pour déterminer la pertinence d'y développer ses activités, la décision concomitante d'adhérer au cadre d'investissement pour les Balkans occidentaux avec un versement d'1 million d'euros, l'inscription des Balkans occidentaux parmi les régions prioritaires dans le nouveau COM de l'Institut français.
L'organisation le 4 juillet 2016 à Paris du Sommet des Balkans est la manifestation la plus nette de ce retour politique. Il est important de souligner que ce Sommet ne s'est pas réduit à des déclarations incantatoires mais a permis d'avancer sur deux volets importants : la dimension Jeunesse, avec l'Office balkanique pour la Jeunesse, connu sous l'acronyme anglophone de RYCO, avec le rôle fondamental qu'a joué à cet égard l'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) ; la dimension économique avec l'appui aux projets d'interconnexion et un Forum d'affaires qui a permis plus de 120 rendez-vous individuels avec les experts et entreprises de la zone pour les 70 entreprises françaises participantes du forum et les 20 entreprises publiques et privées venues des Balkans.
Peut-on pour autant y voir une véritable inflexion stratégique ? Notre réponse est non. L'inflexion si elle existe est largement insuffisante et il nous faut passer à la vitesse supérieure. La présence française demeure aujourd'hui sous-dimensionnée et manque singulièrement de cohérence globale.
En termes d'implantations, le dimensionnement des postes diplomatiques français est réduit. Notre ambassade au Monténégro est devenue un poste de présence diplomatique à format très allégé, alors même que le Monténégro joue un rôle pivot dans la région et que 40.000 Français y transitent chaque année. Les dotations du réseau culturel totalisent sur les six pays moins de 3 millions d'euros, sachant que les capacités d'autofinancement sont faibles). Il n'y a pas d'outils publics de diplomatie économique : Business France n'y a aucun bureau et le service économique régional est basé à Sofia en Bulgarie.
Pour parvenir à avoir une présence marquée et une action cohérente et efficace, sous contrainte budgétaire, il faut changer la donne et jouer avec toute la palette des leviers, tirer parti de la mutualisation des moyens et cibler précisément des domaines d'intervention prioritaires.
S'agissant des moyens, il est nécessaire de consolider l'articulation entre approche régionale et coopérations bilatérales.
En termes d'organisation d'abord, nos ambassades travaillent bien en réseau à l'échelle de la région et particulièrement dans l'action d'accompagnement à l'établissement d'États de droit. Elles peuvent s'appuyer en matière culturelle sur le réseau européen EUNIC, réseau d'instituts culturels nationaux, dont en pratique nos Instituts français pilotent les projets dans les cinq pays où ils existent. Le service économique basé à Sofia s'organise également par contractualisation avec les chambres de commerce, sous la houlette du représentant spécial Alain Richard.
Certaines structures implantées dans la région pourraient servir d'appui à des coopérations. Par exemple, la France dispose d'une conseillère chargée de la lutte contre la traite des êtres humains auprès de la Représentation permanente à Vienne, d'une ambassadrice en charge des menaces criminelles transnationales basée à Paris et d'un pôle régional de lutte contre la criminalité dans les Balkans basé à Belgrade. Ce pôle peut venir en appui des structures régionales et des mécanismes de coordination des ministères de l'Intérieur et de la justice. La France doit de manière générale mieux investir les enceintes régionales. Par exemple, elle est membre observateur du SELEC (Southeast European Law Enforcement center) ; elle gagnerait à devenir un partenaire opérationnel comme l'Italie.
Sur le plan des financements, les enveloppes multilatérales sont conséquentes : crédits de l'Instrument de pré-adhésion (IPA), 1,5 milliard d'euros à travers la BERD, fonds du FMI et de la Banque Mondiale… La France accuse un retard certain par rapport à l'Allemagne, l'Autriche ou l'Italie pour ne citer qu'eux, tant dans la présence de nos ressortissants dans ces enceintes que dans la captation des fonds.
S'agissant du contenu de la coopération, qui manque à ce jour de substance, deux axes complémentaires sont à poursuivre. Le premier est le renforcement des États de droit, de l'efficacité opérationnelle des structures administratives ou judiciaires pour lesquels la France dispose de capacité d'expertise reconnues. Le second est le développement d'actions bilatérales dans le domaine de la diplomatie d'influence, en utilisant tous les canaux, avec le souci de répondre prioritairement aux besoins des sociétés des Balkans : développement économique, actions en direction de la jeunesse, soutien aux sociétés civiles.
Six cadres nous semblent pertinents.
Le premier est l'assistance technique, particulièrement le développement des jumelages et l'envoi d'experts techniques avec deux axes :
- une approche de diplomatie économique par le soutien technique aux exécutifs, à l'image de la coopération en matière de développement rural en Serbie ;
- une coopération en direction des professionnels du droit, qu'il s'agisse des magistrats, des avocats, des procureurs, dans les domaines pénal, administratif ou commercial. La France dispose d'une expérience, au sein notamment du Conseil supérieur de la magistrature, de l'Autorité de la Concurrence, des barreaux, du Conseil supérieur du notariat, qui pourrait être utilement mise à profit ;
Le deuxième cadre est la mobilisation des collectivités territoriales pour développer la coopération décentralisée, sur le modèle de celle qui existe entre la Macédoine et la Normandie ou l'Europe du Sud-Est et l'Auvergne. Les collectivités des Balkans tireraient profit de l'expertise des exécutifs locaux français, que ce soit pour le développement du tourisme, de la protection du patrimoine, de la gestion de l'eau.
Le troisième cadre est la coopération en matière de sécurité et de défense. Outre le SELEC, les coopérations bilatérales mériteraient d'être renforcées (police, douane, justice). Les initiatives en la matière fonctionnent, les pays sont demandeurs. Les accords conclus en septembre et octobre 2016 avec la Serbie le montrent, notamment sur le renseignement criminel. Nous avons une coopération sécuritaire qui s'est développée avec le Kosovo sur la formation contre le terrorisme et la cybercriminalité. Nous avons des coopérations sectorielles conduites par notre attaché de sécurité intérieure à Skopje, notamment dans la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et l'immigration clandestine.
Le quatrième cadre est la mobilisation des acteurs économiques, à conforter après le Forum France-Balkans de 2016. Les échanges et les investissements français sont très en dessous de leur potentiel, mais l'environnement est assez concurrentiel. Il convient donc d'avoir une approche coordonnée et bien organisée, en accordant la priorité notamment aux filières de la ville durable, du tourisme et de l'agro-alimentaire.
Cinquième cadre, il convient de répondre aux aspirations de la jeunesse en contribuant à sa formation. La place de la langue française est en recul et nos coopérations universitaires sont très limitées. Une nouvelle impulsion doit être donnée, en mettant l'accent sur l'excellence éducative, au travers notamment du développement des filières bilingues et de l'octroi du label Francéducation.
Enfin, nous devons soutenir les sociétés civiles, particulièrement dans trois directions : le travail de réconciliation et de mémoire, qui est bien loin d'être terminé dans la région, l'ouverture culturelle et le soutien à la professionnalisation du secteur des médias. Ce sont des domaines dans lesquelles la France possède des compétences reconnues et qui sont essentiels dans l'accompagnement politique de ces pays.
C'est la raison pour laquelle l'Office balkanique pour la jeunesse (RYCO), établi à Tirana, a aujourd'hui tant d'importance. La confiance n'est pas encore établie, notamment avec les ONG présentes, la désignation d'un secrétaire général serbe est refusée par les Kosovars. Il faut une action diplomatique forte pour permettre à ce Forum, avec le soutien de l'OFAJ, de devenir le ferment d'une nouvelle histoire pour les Balkans.
Voilà madame la Présidente les conclusions et propositions résumées de notre rapport. Je tiens à saluer Jean-Claude Mignon, collègue et ami avec qui j'ai pris un immense plaisir à accomplir cette mission. En ce jour de fin de notre législature, je retire de ce travail dans les Balkans et de cette session partagée au Conseil de l'Europe, qu'il est possible dans le respect de nos différences politiques et partisanes de nous rassembler pour le meilleur autour de causes communes, et nous avions à l'évidence Jean-Claude et moi la même passion pour les Balkans occidentaux, ce coin d'Europe où se mêlent la volonté, la générosité et également les drames les plus terribles de l'Histoire.

Les accords de Dayton ont été une manière de sortir de la guerre en 1995, mais comment dépasser les obstacles constitutionnels qui en résultent ? Peut-on se contenter, comme le fait l'UE, de poser des principes voire d'adresser des injonctions ? On peut craindre que les autres pays de l'ex-Yougoslavie parviennent à franchir les étapes les conduisant à l'intégration européenne, mais pas la Bosnie-Herzégovine. Quelles initiatives ou quels changements dans la démarche recommandez-vous pour aider à sortir de l'impasse ?

Je tiens à vous féliciter pour l'excellence de votre analyse. Vos conclusions, en revanche, sont assez convenues, un peu « Quai d'Orsay ». Elles ne sont pas à la hauteur du diagnostic, très sévère et réaliste, que vous posez. C'est une région que je connais un peu, pour avoir commencé à beaucoup l'explorer et à travailler dessus dès 1991, au moment de l'explosion de l'ex-Yougoslavie.
Cet État avait été inventé de toutes pièces par la diplomatie britannique lors des accords de Versailles et de Sèvres. La Yougoslavie, l'Etat des Slaves du Nord, a explosé sur des bases ethniques et religieuses, comme aujourd'hui le Moyen-Orient, les mêmes diplomates ayant agi de même à l'époque. Sur les sept Etats qui en sont issus, deux s'en sortent : la Croatie et la Slovénie, que l'Allemagne avait pris sous son aile dès 1991 et qui sont religieusement et ethniquement homogènes. Ce sont des Etats chrétiens. Avec les autres, on entre dans un autre monde, celui de la macédoine religieuse et ethnique des Balkans, un monde qui est encore ouvert.
Comme d'habitude, la France a brillé par l'excellence de ses soldats. Je suis allé me recueillir sur place, moi aussi, et j'ai beaucoup pensé à ceux qui y sont morts, notamment sur la piste de l'aéroport de Sarajevo, où ils étaient tirés comme des lapins alors qu'ils essayaient d'approvisionner une population qui mourait de faim. Nous avons eu 86 morts et plusieurs centaines de blessés. Au final, on a fait le travail sur le plan militaire, mais nous n'avons suivi ni au niveau diplomatique ni au niveau économique. C'est malheureusement une constante ces dernières années. Il faut se poser la question : voulons-nous qu'il y ait une politique française dans les Balkans ? Ce n'est pas avec 10 millions d'euros divisés en six pays que l'on fera quoi que ce soit de sérieux.
L'Europe mène une non-politique, à grand renfort d'argent et de consultants. C'est même une politique du mensonge. On n'intégrera pas ces pays, contrairement à ce qu'on leur dit, pas plus qu'on n'intégrera la Turquie. Le peuple français, qu'il faudra interroger conformément à l'article 88.5 de la Constitution, ne laissera jamais entrer la Bosnie ou le Kosovo dans l'Union européenne. Alors qu'elle est dans un moment de crise absolue, on continue des politiques de pré-adhésion qui coûtent des milliards d'euros et ne marchent pas. Elles maintiennent au pouvoir des classes politiques parfaitement corrompues. La Bosnie en est un magnifique exemple avec ses trois Premiers ministres et ses 400 ministres – et je ne vous parle même pas de la Republika Srpska… Tout ça, excusez le mot, est totalement foireux et c'est potentiellement la source de beaucoup de déconvenues, de nationalisme et de trafics en tout genre.
Ce que nous faisons est à la fois une non politique en France, parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut, et en Europe. C'est pourquoi les conclusions de votre rapport auraient pu être beaucoup plus percutantes. Au lieu de s'inscrire dans la continuité, il faudrait essayer d'ouvrir le débat.

La lancinante question des Balkans ne cesse de revenir depuis un siècle et même davantage. L'Histoire nous ressert le même plat.
Je doute fort que ces Etats rejoignent l'Union européenne et je m'interroge donc sur le titre du II.B de votre rapport : « Faire de la France un partenaire complet sur la voie de l'adhésion ». C'est une erreur : il n'y aura pas d'adhésion, c'est évident. Cela ne veut pas dire, comme vous le soulignez, que la France n'a pas à être extrêmement présente et réactive sur le plan multi et bi-latéral, mais il faut se garder de poursuivre des chimères.
Je ne connais pas aussi bien que vous l'ensemble de ces Etats, mais je voudrais vous signaler qu'il y a trois drapeaux au ministère des affaires étrangères de la Roumanie, qui n'est pas très loin dans la région : ceux de l'OTAN, de l'Union européenne et de la Roumanie elle-même. Elle a d'abord rejoint l'OTAN, sous la pression américaine, et elle est pour l'adhésion de la Turquie. Tous ces Etats font la politique de leur géographie. Ils viennent chercher un peu d'argent à Bruxelles pour se développer, mais c'est possible sans adhésion.
Je crains fort une certaine euro-béatitude chez notre rapporteur. Elle consiste à penser que l'Europe a pour vocation de s'élargir à l'ensemble du continent, ce qui n'est pas sérieux. C'est même contreproductif car cela conduit l'Union européenne à une déliquescence totale. Il y a un moment où il faut regarder la géostratégie telle qu'elle est. Ces Etats n'ont pas vocation à rentrer dans l'Union européenne. Que l'on conclue des accords pour les aider à se développer, très bien, mais gardons-nous d'un idéal qui n'existe pas.

Une fois n'est pas coutume, je suis en désaccord total avec Jacques Myard. Je crois au contraire que les conclusions de nos deux collègues sont dictées par une évidence : la géographie a toujours fait l'histoire. Il y a la Grèce d'un côté, et l'Autriche et la Hongrie de l'autre. Tout n'est pas rose ou clair dans ce qui constituait autrefois la Yougoslavie. Je suis de ceux qui n'ont jamais compris cette prédilection pour le Kosovo qui a animé pendant des années la diplomatie française et ce droit-de-l'hommisme qui s'est développé. Je soutiens totalement l'analyse et les propositions de ce rapport.

Tout d'abord, merci à tous pour vos appréciations positives sur le travail de la mission. Je ne peux qu'aller dans le sens de ce qui a été exprimé par un certain nombre d'entre vous sur le gâchis qui caractérise la fin de l'ex-Yougoslavie. La France a malheureusement été trop absente, tandis que l'Allemagne, beaucoup plus présente, a favorisé l'intégration européenne de la Slovénie et de la Croatie. La France n'a pas été capable d'imposer sa vision. Alors qu'il fallait une solution globale, cette intégration de la Slovénie puis de la Croatie a été acceptée tout en se désintéressant complètement des autres composantes de l'ex-Yougoslavie. Pourtant, on pouvait prévoir que les choses iraient mal en Bosnie pour de très nombreuses raisons, dont certaines sont encore vivace. De plus, la France s'est désintéressée de la Serbie, malgré les liens historiques dont atteste encore aujourd'hui le monument élevé aux soldats français qui ont combattu sur le front d'Orient pendant la Première guerre mondiale. Heureusement, les Serbes ne sont pas rancuniers. Enfin, je partage aussi les appréciations portées sur l'espèce de frénésie diplomatique qui s'est développée autour du Kosovo sans régler la question. L'Union européenne a pêché par précipitation alors que certains problèmes devaient être préalablement réglés. La France a fait le travail militairement et on s'est arrêté là quand d'autres ont pris des positions, y compris la Chine dont nous n'avons pas parlé.
La Bosnie-Herzégovine était le seul pays de la région que je n'avais pas visité parmi les 47 Etats-membres du Conseil de l'Europe. Nous nous y sommes rendus. La situation y est ahurissante, que ce soit à Mostar ou à Banja Luka, avec cette Republika Srpska qui contrôle 49 % du territoire et je ne sais pas comment on va s'en sortir. Il est clair de mon point de vue que les accords de Dayton sont complètement dépassés.
Je ne pratique pas l'« euro-béatitude », pour reprendre l'expression de Jacques Myard ; je suis membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Je dis simplement que l'Union européenne aurait dû s'intéresser davantage aux travaux du Conseil de l'Europe, lequel fait depuis longtemps un monitoring précis sur les pays des Balkans qui ont rejoint le Conseil de l'Europe dans les années 1990. Nous avons toujours été conscients, au Conseil de l'Europe, que certains pays n'étaient pas prêts pour adhérer à l'Union européenne aussi rapidement, cela valant d'ailleurs pour des pays qui y ont cependant adhéré. Nous devons prendre en compte nos erreurs pour les corriger ; nous ne pouvons pas ignorer les réalités de la région. J'ai été frappé pour ma part de l'absence de la France. 70 % des jeunes de Bosnie-Herzégovine veulent aujourd'hui quitter leur pays. Cela devrait nous faire réfléchir. La présence française reste très insuffisante, par rapport notamment à la présence allemande, bien ancrée. Il n'y a par exemple aucune banque française présente en Bosnie, ce qui constitue un handicap terrible pour les chefs d'entreprises françaises rencontrés sur place.

Jean-René Marsac a évoqué les accords de Dayton. Ceux-ci ont permis de mettre fin à la guerre, mais ils n'ont pas construit l'avenir. Ils ont figé la situation d'un pays qui était déjà une mosaïque et l'est devenu encore davantage par des mouvements de population. Je crois que pour les dépasser, il faut une volonté européenne et de l'Union européenne en particulier. On peut s'interroger, cela a été notre cas, sur la finalité à terme de la présence d'un Haut représentant de la communauté internationale à Sarajevo dans le cadre des pouvoirs dits de Bonn. N'est-ce pas plutôt à l'Union européenne de s'emparer du sujet en lien avec l'ensemble des composantes de la Bosnie-Herzégovine pour essayer d'imaginer ce que peut être l'avenir ?
Nous connaissons bien avec Jean-Claude Mignon un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui est très significatif. C'est l'arrêt Sejdić et Finci, par lequel la Bosnie-Herzégovine a été condamnée pour avoir refusé la candidature à la présidence de la république de deux de ses citoyens, l'un d'origine rom, l'autre d'origine juive, car ils ne se reconnaissaient dans aucune des entités constitutives et étaient à ce titre empêchés de se présenter. On a là le symbole du blocage dont il faut sortir.
Jean-Claude Mignon a évoqué notre déplacement à Mostar. Ce moment était le résumé de nos trois mois de travail. Voilà une ville de 120 000 habitants où il n'y ni maire ni conseil municipal depuis des années. La dernière élection municipale date de 2008 et qui n'a donc plus d'autorités locales élues. C'est une ville sous perfusion qui ne se maintient que grâce à la communauté internationale et à la diaspora. Mostar, c'est le meilleur, avec ce symbole que représentent le célèbre pont, détruit et reconstruit, les clochers et les minarets qui cohabitent. Mais c'est aussi le pire, quand un représentant local nous a expliqué que finalement cela ne fonctionnait pas si mal sans élections. Si c'est ça le chemin de l'Union européenne… Nous l'avons rappelé à nos interlocuteurs – et c'est le titre d'un article écrit par notre ambassadrice en Bosnie : le chemin de la Bosnie passe par Mostar. Il faudrait une médiation européenne pour essayer de résoudre le problème de Mostar, assurée par un ancien maire ou le secrétaire général du Conseil de l'Europe, pour trouver une solution, car derrière Mostar c'est l'existence-même de la Bosnie-Herzégovine qui est posée. Les Croates commencent à avancer l'idée de la création d'une troisième entité, qui leur serait propre, à l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine.
Pierre Lellouche a évoqué le destin différent des entités issues de l'ex-Yougoslavie et en particulier la manière dont la Slovénie et la Croatie ont mieux réussi. Il a également évoqué le rôle fondamental de nos soldats, en rappelant la présence des soldats français sur la piste de l'aéroport de Sarajevo, symbole de ce que nous avons accompli dans la peine et la douleur pour sauver ce pays. Je suis d'accord avec tout cela. Et le fait est qu'après la France a été largement absente, qu'avec notre retrait militaire nous soyons passés à plus rien du tout, quand nos partenaires – mais également concurrents – ont pris la place sur le plan économique, regardant l'avenir concret de ces pays nonobstant la faiblesse de l'État de droit et en particulier de la justice commerciale dans la zone. C'est ainsi que les Allemands, les Autrichiens, les Italiens et récemment les Turcs ont pris de solides positions.
Mais pour l'avenir, pouvons-nous dire à ces pays qu'ils n'ont pas une perspective d'adhésion à l'Union européenne, pour tout un tas de raisons y compris notre constitution ? Que pourrait-on leur proposer en retour ? Je ne crois pas qu'on puisse dire à ces pays et en particulier aux jeunes qu'ils n'ont pas vocation à intégrer l'Union européenne, car ce sont des peuples européens, ce sont des jeunesses européennes, qui sont au contact de notre vie, ne serait-ce que parce qu'ils voyagent pour une partie d'entre eux. Si nous ne leur donnons pas de perspective européenne, cela voudra dire que leur salut est ailleurs. Moi je préfère dire que leur salut est avec nous, plutôt qu'avec la Russie ou la Turquie. Et ce sont aussi des choses à dire.
François Loncle a raison : la géographie fait l'histoire ; cette carte nous le montre.
S'agissant enfin du trafic d'organes, abordé par Odile Saugues, il est vivement combattu dans la région.
Je voudrais conclure sur un sujet dont on a très allusivement parlé : le devoir de mémoire. Alors que nous commémorons actuellement le centenaire de la Première guerre mondiale, nous ne devons pas oublier le front d'Orient, dont on parle peu. Depuis que je suis député des Français établis dans les Balkans, j'ai visité tous les cimetières où reposent nos soldats tombés sur ce front et je me suis fait un devoir d'y déposer une gerbe. J'ai été particulièrement marqué par deux endroits. Le premier est le cimetière de Bitola en Macédoine, où reposent plus de 15 000 soldats français, soit plus que de soldats américains au cimetière de Colleville-sur-Mer des prénoms qui évoquent la France de ce siècle et des âges qui témoignent de la jeunesse fauchée. J'ai également été marqué par ma visite à Korça, dans le sud de l'Albanie, ville qui a été la capitale d'une république autonome établie avec l'aide de l'armée française en 1916 – le cimetière local abrite d'ailleurs les dépouilles de 700 de nos soldats. Il y a existé un lycée français avec une filière bilingue, survivance de ce que fut le lycée français de Korça et qui nous montre que la France est attendue. Il est bouleversant d'y entendre tous ces enfants, ces adolescents qui ne sont jamais venus en France parler français sans aucun accent. C'est aussi ça la France.
Comme la mémoire de Napoléon a été invoquée dans le débat, j'évoquerai enfin Herceg-Novi, petite ville du Monténégro proche de la frontière croate, où il y a aussi un cimetière français de la Première guerre mondiale dans lequel on trouve un petit monument érigé par les Poilus à la mémoire des soldats de l'Empire tombés au même endroit en 1806. Cela montre le lien entre les batailles, d'Histoire à Histoire, aussi la présence et le courage français dans une région où notre pays doit reprendre pied, et telle est la conclusion du rapport que nous avons, avec Jean-Claude Mignon, voulu porter devant vous.
La commission autorise la publication du rapport d'information à l'unanimité.

L'ordre du jour appelle maintenant l'examen du rapport de la mission d'information sur la situation migratoire en Europe, présidée par M. Jean-Jacques Guillet et dont le rapporteur est M. Jean-Marc Germain.

Cette mission d'information, consacrée à la situation migratoire en Europe, porte sur un sujet complexe et compliqué, mais aussi parfois un peu caricaturé. Nous avons en effet connu au cours de l'année 2015 une crise aiguë qui a provoqué un peu plus qu'une émotion au sein de l'Union européenne. Le sujet est également un peu caricaturé par rapport à ce que les chiffres montrent : le problème migratoire est un peu moins important que ce que l'on imagine parfois. Néanmoins, notre rapport insiste aussi sur le fait que le problème est largement devant nous, plutôt que derrière nous. Les difficultés dans notre voisinage immédiat ou dans des pays plus lointains, notamment en Afrique, sont telles que la situation migratoire pourrait se détériorer dans les prochaines années.
Selon les derniers chiffres d'Eurostat, il y avait 3,8 millions de migrants dans l'Union européenne en 2014, dont 1,9 million de ressortissants de pays tiers, hors Union européenne, et 1,8 million de citoyens européens ayant migré d'un Etat membre à un autre, ce qui n'entre pas dans la réflexion de cette mission d'information. Il y a des doubles comptes car cela inclut les migrations d'un Etat membre à un autre à l'intérieur de l'Union européenne. Par ailleurs, il y avait 2,8 millions de départs la même année. En « stock », on comptait au 1erjanvier 2015 19,8 millions de citoyens de pays tiers, soit 3,9 % de la population de l'Union européenne. Ce sont des chiffres importants, qu'il faut prendre comme des ordres de grandeur compte tenu des imprécisions, plutôt que comme des réalités absolues, mais ils ne sont pas nécessairement considérables au regard de ce qui pourrait se passer à l'avenir.
Il faut aussi tenir compte du fait que l'Europe, politiquement et psychologiquement, ne s'est jamais vraiment considérée comme une terre d'immigration. Elle a été une terre d'émigration, en particulier au XIXe siècle et au début du XXe siècle, mais elle n'a pas connu de grandes migrations depuis le Xe siècle et l'arrivée des Hongrois. Lorsque les Ottomans sont arrivés dans les Balkans, la population turque qui s'est installée était très limitée. Les musulmans, en particulier les Bosniaques, que nous évoquions tout à l'heure, sont généralement des populations locales converties à l'islam. Il y avait très peu de minorités turques dans les Balkans, même à l'époque de l'empire ottoman.
Nous avons adopté une démarche qui ne pouvait évidemment pas être exhaustive, mais nous nous sommes efforcés qu'elle soit aussi complète que possible. Cela nous a conduits à suivre le chemin des migrants et des réfugiés, en nous intéressant d'abord aux principaux pays d'origine. En 2016, 10 pays représentaient 75 % des arrivées irrégulières en Europe : la Syrie (23 % des arrivées), l'Afghanistan (12 %) – même si les ressortissants de ce pays sont moins présents dans les esprits, on en a compté beaucoup à Calais et à la frontière entre l'Italie et la France – le Nigéria (10 %), l'Irak (8 %), l'Erythrée (6 %), la Guinée (4 %), la Côte d'Ivoire (4 %) – alors qu'il s'agit aussi d'un pays d'accueil –, la Gambie (4 %), le Pakistan (3 %) et le Sénégal (3 %).
Notre rapport examine ensuite la situation dans les principaux pays de premier accueil des réfugiés syriens, hors Union européenne. La Turquie abrite aujourd'hui 2,7 millions de réfugiés, soit davantage que tout autre pays au monde. Le Liban en accueille encore plus en proportion, puisque le million de réfugiés syriens enregistrés par le HCR représente environ 20 % de la population. Selon les chiffres publiés par le HCR, il y aurait 655 000 réfugiés syriens en Jordanie, soit environ 9 % de la population, mais les autorités jordaniennes estiment que les Syriens sont en réalité deux fois plus nombreux, car tous ne sont pas enregistrés comme réfugiés. Il faut aussi rappeler que l'Irak abrite environ 230 000 réfugiés syriens et l'Egypte environ 115 000.
Nous abordons ensuite la question des principaux pays de transit. Il s'agit d'abord de la Libye, sur ce qu'il est convenu d'appeler la « route de la Méditerranée centrale », qui débouche en Italie. Sur cette même route migratoire, l'Egypte représentait 7 % des arrivées sur les côtes italiennes en 2016. C'est un pays de transit, mais aussi de départ, pour une faible partie de la population. Nous avons aussi travaillé sur la situation en Turquie, qui se trouve en revanche sur la route de la « Méditerranée orientale », avec un débouché en Grèce et un prolongement sur la route des Balkans occidentaux. La troisième route principale, la « Méditerranée occidentale », constituait une importante voie d'accès au milieu des années 2000, mais l'Espagne a mis en place une politique bilatérale avec le Maroc, la Mauritanie ou encore le Sénégal, qui a porté ses fruits et le flot s'est progressivement tari. Cela tient à la réponse espagnole que nous présentons dans le rapport. Il y a eu environ 7 000 arrivées en 2006 par la voie maritime, essentiellement dans les Canaries et en Andalousie, et environ 3 000 entrées maritimes. Les événements qui ont eu lieu ces derniers temps à Ceuta sont en quelque sorte un épiphénomène. Il est d'ailleurs possible que le Maroc ait un peu laissé entrer ces migrants de manière à peser sur l'Union européenne dans les discussions sur le Sahara occidental.
Nous consacrons par ailleurs des développements à la question du trafic de migrants. Selon tous les éléments disponibles, ce trafic a pris une ampleur croissante et il a joué un rôle important dans l'accélération des flux vers l'Europe sur la période récente. Europol estime que 90 % des arrivées irrégulières de l'année 2015 ont fait appel à des passeurs. Le chiffre d'affaires lié au trafic de migrants était alors estimé entre 3 et 6 milliards d'euros. C'est un trafic à la fois plus sûr et plus lucratif que celui de la drogue ou celui des armes, bien qu'ils soient parfois liés. C'est particulièrement vrai dans le cas libyen, que le rapport aborde de manière précise.
Au-delà des passeurs et de leurs complices, une véritable « économie de la migration » se met en place dans certains territoires. Lorsque nous sommes allés à Agadez, au Niger, nous avons d'ailleurs été accueillis à l'aéroport par ce qu'on peut appeler le « syndicat des transporteurs ». Ils venaient protester car on leur interdit désormais de faire passer les migrants, la législation nigérienne étant devenue assez coercitive. Il faut souligner que les mêmes acteurs faisaient il y a dix ans du transport de touristes.
Enfin, nous avons examiné les répercussions des récents flux migratoires sur la situation au sein de l'Union européenne, en procédant Etat membre par Etat membre, ainsi que les réponses qui se mettent en place au plan communautaire avec plus ou moins de bonheur. La réaction européenne a été extrêmement lente et peu préparée, avec en outre un certain manque de coopération entre les services concernés à Bruxelles. Les réponses sont désormais plus structurelles et le problème a été davantage contenu à partir du moment où l'Union européenne a réagi réellement. Je crois que mon collègue Jean-Marc Germain reviendra sur cette question.
Voilà pour la démarche que nous avons suivie afin de dresser l'état des lieux. S'agissant de nos travaux, nous avons pu nous rendre successivement en Turquie et en Jordanie au mois de décembre dernier, puis à Bruxelles et au Niger au cours du mois de janvier. Nous avons auditionné de très nombreux responsables, le Défenseur des droits, Jacques Toubon, mais aussi Pierre Vimont, qui a notamment été chargé d'organiser la conférence de la Valette entre l'UE et les pays africains en novembre 2015, qui est un succès, même s'il est encore relatif, ainsi que des représentants d'ONG, des chercheurs et des universitaires.
Quel est aujourd'hui l'état de la situation ? Nous sommes entrés dans une phase moins aiguë de ce que l'on appelle généralement la « crise migratoire ».
L'agence européenne Frontex avait détecté 1,8 million de franchissements irréguliers des frontières extérieures en 2015, représentant environ 1 million de personnes, compte tenu des doubles comptes. On peut être enregistré une première fois quand on entre en Grèce et une seconde fois quand on repasse la frontière hongroise. L'accélération des flux migratoires était alors très nette par rapport à 2014, qui avait été marquée par environ 283 000 passages, et par rapport à 2013 et 2012, avec respectivement 107 000 et 72 000 passages. En 2015, les arrivées s'étaient maintenues à un niveau à peu près comparable à celui de l'année 2014 en Méditerranée centrale, mais elles avaient pour ainsi dire « explosé » en Méditerranée orientale à compter de l'été.
En 2016, on a observé une réduction globale des flux, avec environ 510 000 passages détectés par Frontex. Cette évolution résulte néanmoins de situations très différentes selon les routes migratoires. Il y a eu un tarissement sur la route de la Méditerranée orientale, puisqu'on a détecté 180 000 entrées dont environ 150 000 avant l'entrée en application de la déclaration UE-Turquie du mois de mars 2016, qui est globalement une réussite. De façon générale, la Turquie joue le jeu. Les flux restent très dynamiques en Méditerranée centrale, avec 182 000 arrivées maritimes. C'est évidemment là que le problème est le plus difficile à régler. En Méditerranée orientale, les entrées sont passées en dessous de 100 par jour en moyenne, alors que l'on a connu des pics de 3 000 arrivées quotidiennes.
Ces arrivées en Europe sont très significatives et elles ont eu des répercussions importantes sur les politiques d'asile et d'immigration. On peut penser, par exemple, à l'adoption de la « loi sur les bijoux » au Danemark en janvier 2016 : elle autorise la confiscation de tout objet de valeur ou argent liquide appartenant aux demandeurs d'asile au-delà d'environ 1 340 euros, officiellement pour financer leur accueil. Dans un certain nombre d'Etats membres, la législation sur l'asile a globalement évolué dans un sens plus restrictif, mais il faut souligner que ce n'est pas le cas en France. Nous sommes beaucoup plus « libéraux » sur cette question, avec tous les guillemets nécessaires, que la plupart des autres pays européens.
Il faut bien voir aussi que les flux vers l'Europe ne représentent qu'une fraction limitée des mouvements de population dans le monde. A la fin de l'année 2015, le nombre de « déplacés forcés », c'est-à-dire les réfugiés et les déplacés internes, s'élevait à 65,3 millions de personnes. Contrairement à ce que l'on peut penser, parfois, la très grande majorité des réfugiés ne se dirigent pas vers les pays développés. Fin 2015, les dix premiers pays d'accueil, représentant 60 % de la population sous le mandat du HCR, étaient tous des pays en développement, dont 5 situés en Afrique : la Turquie, le Pakistan, le Liban, l'Iran, l'Ethiopie, la Jordanie, le Kenya, l'Ouganda, la République démocratique du Congo et le Tchad. Si l'on considère maintenant, de manière plus globale, les migrations internationales, on comptait en 2015 un « stock » de 244 millions de migrants internationaux, au sens où l'entendent les Nations Unies. La majorité d'entre eux, soit 140 millions de personnes, se trouve au Nord, mais les déplacements Sud-Sud sont désormais supérieurs aux mouvements Sud-Nord. Depuis 2010, le nombre de migrants internationaux augmente plus vite au Sud.
J'en viens à la question des perspectives pour les flux migratoires vers l'Union européenne.
A court terme, une grande partie des évolutions dépendra de la situation en Turquie, notamment la pérennité de la déclaration de mars 2016 entre l'Union européenne et la Turquie. Le scénario d'une rupture de l'accord ne doit pas être exclu, par principe, mais cela ne nous paraît pas le plus probable dans l'immédiat. Il est vrai que les clauses de l'accord sont mises en oeuvre de manière très inégales. Les entrées en Grèce se sont significativement réduites, comme je l'ai indiqué, mais le nombre de retours vers la Turquie reste très faible, de même que celui des réinstallations dans l'Union européenne de réfugiés syriens depuis la Turquie. Elle a parfois une attitude un peu ambiguë, préférant garder chez elle les réfugiés appartenant aux CSP+, pour schématiser. La perspective est plutôt de les intégrer à la société turque. La mise en oeuvre de la facilité financière pour la Turquie, de 6 milliards d'euros au total, avance à bon rythme même si nous avons pu constater que les autorités turques s'en plaignent. Cela tient d'ailleurs en partie aux mécanismes de l'Union européenne. Mais c'est surtout le blocage de la libéralisation des visas pour les ressortissants turcs qui constitue « l'irritant » le plus fort.
Sur ce dernier point, on est en partie dans le domaine de la posture du côté turc, car il y a en circulation de très nombreux passeports de service ou « passeports verts », dont les détenteurs sont exemptés de visas de court séjour. Il y en aurait certes moins depuis le coup d'État de l'été dernier, mais ils étaient jusque-là attribués très libéralement, par exemple à des instituteurs au bout de 20 ans de service. En revanche, le nombre de passeports ordinaires est assez limité, puisqu'il y en aurait environ 10 millions pour une population de 80 millions d'habitants, et ils coûtent très chers, jusqu'à 200 euros.
Malgré des déclarations publiques assez virulentes du côté turc et des relations assez compliquées entre l'Union européenne et la Turquie, de manière générale, il nous semble que ces deux acteurs veulent que l'accord fonctionne, au moins a minima. C'est une évidence pour l'Union européenne, mais les Turcs ont aussi des raisons d'oeuvrer pour que l'accord tienne bon. L'UE s'est engagée à mobiliser une assistance financière conséquente pour la prise en charge des réfugiés syriens sur le territoire turc et, avec cet accord, Ankara dispose aussi d'un levier permanent sur l'UE, qu'elle souhaite évidemment conserver. Enfin, les autorités turques n'ont probablement pas intérêt à ce qu'un appel d'air se reconstitue sur leur territoire avec la reprise de départs massifs vers les côtes européennes. Il faut signaler que les Turcs ont largement bloqué la frontière avec la Syrie. Il n'y a pas eu d'arrivées de réfugiés syriens à la chute d'Alep et on ne pense pas qu'il y aura d'Irakiens venant de Mossoul sur le territoire turc dans les prochaines semaines.
L'évolution de la Libye constitue évidemment un second facteur déterminant pour l'évolution des flux vers l'Europe à court et moyen terme.L'absence de gouvernement exerçant une autorité réelle sur le pays est la principale cause des difficultés constatées en Libye : des frontières poreuses au Sud ; des réseaux puissants qui font du trafic de migrants et d'êtres humains à grande échelle et même de manière « industrielle » selon certains de nos interlocuteurs ; des migrants exposés à des situations épouvantables, dont nous avons eu le récit au Niger en rencontrant des migrants sur le chemin du retour ; des arrivées irrégulières massives sur les côtes italiennes, avec bien souvent des complicités entre les garde-côtes libyens et les trafiquants ; des possibilités de coopération et d'action très limitées pour l'Union européenne, faute d'interlocuteurs efficaces sur le terrain. Le « verrou libyen » a en quelque sorte sauté à la chute de Kadhafi, avec la déliquescence de ce qui tenait lieu d'Etat jusqu'alors et le pays n'absorbe plus les flux comme c'était le cas auparavant.
On estime qu'il y a environ un million de migrants présents sur le sol libyen, pour une population de six millions d'habitants. Beaucoup venaient en Libye pour travailler, mais ils souhaitent maintenant en partir. Certains sont arrivés plus récemment, eux aussi pour travailler, parce qu'ils ne se rendaient pas forcément compte de la situation. Nous avons rencontré au Niger des Africains qui se rendaient en Libye pensant que la Méditerranée est un fleuve. En 2016, les arrivées sur les côtes italiennes venaient à 89 % de Libye. Il s'agissait à 93 % de migrants africains, venant principalement de pays d'Afrique subsaharienne, en particulier le Nigéria, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali et le Ghana, mais aussi de la Corne de l'Afrique, notamment l'Erythrée, la Somalie et l'Ethiopie. Le Premier ministre libyen, M. Fayez el-Sarraj, serait très conscient des enjeux posés par les migrations. Cela ferait partie de ses priorités, mais il n'a aucune autorité pour régler la question.
Outre la Turquie et la Libye, il faudra bien sûr porter la plus grande attention à l'évolution d'autres pays situés dans notre voisinage, en particulier l'Egypte.C'est un important pays d'accueil dans la région, mais aussi désormais le deuxième pays de départ vers l'Europe par la Méditerranée centrale, derrière la Libye. C'est un phénomène assez nouveau. On estime que 9,8 % des migrants interceptés sur cette route migratoire avaient embarqué en Egypte en 2014, 6,5 % en 2015 et 7 % en 2016. L'Egypte est aussi devenue un pays d'origine. On l'a bien vu en septembre 2016 avec le naufrage, au large de Rosette, d'une embarcation qui transportait des centaines de candidats à l'émigration illégale vers les côtes italiennes, dont de très nombreux Egyptiens, ce qui a d'ailleurs suscité une vive émotion et un débat dans le pays. Les autorités égyptiennes ont réagi, car il y a un Etat qui fonctionne. Un certain nombre de mesures ont été adoptées pour mieux contrôler les flux, mais il est important de consolider le dialogue et la coopération avec l'Egypte sur ces questions migratoires.
Je n'insiste pas sur la situation dans les pays du Maghreb, qui a fait l'objet d'un rapport récent de nos collègues Guy Teissier et Jean Glavany. Il y a évidemment une question à suivre sur le plan migratoire, notamment en Algérie. Elle devient petit à petit un pays de départ et la situation politique peut évoluer dans les années qui viennent. Il faudra aussi continuer à regarder de très près ce qui se passe en Tunisie, en particulier lors du retour des djihadistes, qui peut déstabiliser ce pays situé à proximité de la Libye et qui en subit la situation.
A moyen et long termes, il y a surtout la question du développement et de la démographie sur le continent africain. La population d'Afrique subsaharienne est passée d'environ 180 millions de personnes en 1950 à près d'un milliard aujourd'hui. La transition démographique a commencé, mais elle reste lente. Le nombre d'enfants par femme a été ramené de 6,5 à environ 5 aujourd'hui. Au Niger, le taux de fécondité s'élève à 7,6 enfants par femme et il augmentait encore récemment. Malgré les efforts du gouvernement nigérien, il reste compliqué de résoudre ce problème compte tenu des freins culturels qui existent. Selon les dernières prévisions des Nations Unies, en date de 2015, le scénario moyen est d'1,4 milliard d'habitants en Afrique subsaharienne en 2030 et de 2,1 milliards en 2050.
Autre facteur à prendre en compte, les études empiriques montrent que le développement tend à stimuler la migration dans un premier temps, en augmentant les attentes des populations et en améliorant la capacité des individus à migrer. Ce n'est qu'au-delà de 7 000 ou 8000 dollars par habitant que l'on observe une nette relation négative entre le revenu et l'émigration.
A l'heure actuelle, les flux migratoires africains ne se dirigent pas en priorité vers l'Europe. En Afrique subsaharienne, on estime que 75 % des migrations internationales sont internes au continent africain. De manière générale, on se dirige surtout vers d'autres pays économiquement attractifs de la même région, en particulier ceux du Golfe de Guinée pour l'Afrique de l'Ouest – c'est vrai notamment du Nigéria, de la Côte-d'Ivoire et du Ghana, bien qu'ils soient eux-mêmes des pays de départ – ou bien les pays du Maghreb. C'est par exemple le cas de Nigériens qui s'arrêtent en Algérie quand ils ne sont pas refoulés par les autorités de ce pays.
Se pose aussi la question de l'impact du changement climatique sur les phénomènes migratoires. Il est évident qu'il jouera un rôle amplificateur, mais je n'insiste pas sur ce point. Dans le voisinage de l'Europe, on peut penser que c'est principalement du Sahel que les déplacés environnementaux partiraient. L'instabilité climatique pourrait s'accentuer rapidement, avec des conséquences négatives pour l'agriculture, alors que la population continue à augmenter en parallèle à un rythme soutenu. A ce stade, l'Europe n'est pas la principale destination des Sahéliens, mais tout dépendra de l'ampleur des évolutions à venir et des capacités d'absorption des territoires intermédiaires sur les routes migratoires vers l'Europe. Plus loin de nous, des pays d'Asie du Sud-Est seront probablement très affectés par la montée des eaux, notamment le Bangladesh. Ce pays est depuis longtemps une importante terre d'émigration, où les projections démographiques sont par ailleurs préoccupantes. L'immigration économique irrégulière vers l'UE est déjà en forte croissance.
Pour conclure, nous sommes certes entrés dans une phase moins aiguë de la crise migratoire en Europe, mais j'y insiste : le défi est plutôt devant nous que derrière nous, compte tenu des quelques éléments de prospective que je viens d'évoquer.

Je suis heureux, au moment où la session ordinaire s'achève, que nous consacrions un moment à ce sujet essentiel. Je remercie Jean-Jacques Guillet qui a présidé cette mission, ainsi que les collègues qui ont participé activement à nos travaux. Outre les déplacements évoqués tout à l'heure, je me suis rendu dans l'ensemble des pays limitrophes de la Syrie, ainsi qu'en Grèce et en Italie, qui sont les principaux points d'entrée, et en Afrique.
On ne peut pas réfléchir à cette question et envisager des solutions sans garder en tête qu'il s'agit avant tout de drames humains absolument épouvantables, notamment dans le cas des déplacements forcés. Nous avons longuement discuté avec des migrants à Agadez, dans un cadre qui était d'ailleurs assez ouvert. Nous avons entendu des récits de viols, de trafics en vue de la prostitution ou de meurtres pour du trafic d'organes et l'on pourrait allonger encore cette liste. Ceux que l'on rencontre sont des survivants, souvent complètement détruits par les situations qu'ils ont vécues.
Je voudrais aussi redire l'ampleur du phénomène : il y plus de 65 millions de déplacements forcés dans le monde. L'équivalent de la population de la France vit les situations que je viens d'évoquer. C'est un enjeu considérable, non pas tant au regard du nombre d'entrées sur le territoire européen et de leurs conséquences, mais pour ces femmes et ces hommes. Nous avons le devoir de trouver des solutions, particulièrement en France compte tenu des valeurs qu'elle porte historiquement et qui en font un pays admiré, regardé et attendu. C'est le sens du travail d'analyse que nous avons réalisé et des propositions que je vais vous présenter.
Sans être bien sûr exhaustif, le rapport est assez complet puisque nous avons voulu retracer le parcours des migrants depuis les pays d'origine jusqu'à leur arrivée en Europe, en examinant aussi leurs trajets et les conditions qu'ils subissent en chemin. Notre conviction, quels que soient les débats que l'on peut avoir sur le nombre de personnes à accueillir dans les différents pays européens, est qu'il faut une approche globale afin de traiter l'ensemble du parcours.
Le nombre des arrivées, qui était très élevé en 2015, s'est beaucoup réduit depuis le printemps 2016. Même si cela ne correspond pas à une prévision officielle, j'estime que nous sommes actuellement sur un rythme de 200 000 à 250 000 arrivées annuelles en Europe, c'est-à-dire moins qu'en 2014 – on ne parlait pas alors d'asile et de migrants comme on le fait aujourd'hui – et à peu près deux fois le rythme des trois années précédentes. Je rejoins donc le président de la mission : la phase aigüe est derrière nous, mais le problème structurel persiste. Par son niveau, il n'est pas problématique à l'échelle de l'Europe, mais il l'est pour ceux qui sont contraints de quitter leur pays d'origine.
Je commencerai par la Syrie, car les grands mouvements de 2015, qui ont fait que l'on parle tant de cette question dans les pays européens, concernaient d'abord des ressortissants syriens. On estime qu'il y a aujourd'hui 6,3 millions de déplacés internes en Syrie et 4,8 millions de réfugiés, avec une augmentation très importante dans le temps. Il y avait 500 000 réfugiés en 2012, un million en mars 2013 et deux millions en septembre suivant.
Le rapport n'avait pas pour vocation de se prononcer sur les conditions de la paix en Syrie, ni sur l'accord parrainé par la Russie, la Turquie et l'Iran, et nous n'entrons pas dans le débat sur l'avenir de Bachar al-Assad, mais nous insistons sur la nécessité absolue d'une solution politique, en soulignant qu'elle doit intégrer l'ensemble des Syriens dans leur diversité et qu'elle doit se faire sous l'égide de l'ONU.
Le rapport prend parti, en revanche, sur la reconstruction du pays. Nous estimons que la France et l'Europe ne doivent pas conditionner la préparation d'un plan de reconstruction en Syrie à l'aboutissement de la solution politique. L'existence d'un plan Marshall pour la Syrie est absolument essentielle. Les destructions d'infrastructures, de logements et d'entreprises sont estimées à 90 milliards de dollars. Il ne faut pas attendre un règlement politique pour se préparer. L'existence d'un plan européen à la hauteur des destructions peut d'ailleurs être un facteur de paix ou du moins cela peut peser dans la résolution du conflit. Certains affirment que c'est à la Russie et à l'Iran de financer la reconstruction, mais je suis en total désaccord avec cette approche. Au demeurant, il y a déjà une action de l'Union européenne là où c'est possible en Syrie.
J'en viens aux pays voisins, où nous avons sans doute connu notre plus grande faillite collective. Les réfugiés syriens sont partis dans un premier temps en Turquie, au Liban, en Jordanie et au Kurdistan irakien, que l'on oublie trop souvent alors que la région de Dohuk accueille un million de réfugiés pour environ un million d'habitants. La communauté internationale n'a pas du tout été à la hauteur, qu'il s'agisse des abris à fournir ou de l'aide alimentaire, qui a parfois manqué. Les mouvements vers l'Europe de 2015 s'expliquent en partie parce que le Programme alimentaire mondial s'est trouvé à court de moyens. Outre la question de l'intégrité physique, ces femmes et ces hommes ont aussi besoin d'avoir une vie sociale. On n'y pense pas assez quand on met en place des camps de réfugiés. Je pense en particulier à l'éducation des enfants. Beaucoup nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas laisser leurs enfants sans accès à l'éducation pendant des années. Pour vivre, on a aussi besoin d'échanger et de commercer, ce que ne permettent pas l'interdiction de travailler et l'absence de ressources propres. Si nous avions été à la hauteur sur ces différents sujets, beaucoup de ceux qui ont pris la route seraient restés là où ils avaient trouvé refuge dans un premier temps. Si nous avons un plan de reconstruction en Syrie, ils pourront ensuite retourner chez eux, comme ils y aspirent.
Dans l'immédiat, nous proposons d'augmenter très sensiblement l'aide pour le Liban et la Jordanie. Ce sont des pays qui ont des structures étatiques mais qui demeurent fragiles et qui ont été bousculés par les arrivées de réfugiés. Mais n'oublions pas non plus le Kurdistan irakien. Nous demandons que l'on aligne l'aide européenne pour ces pays sur celle qui est destinée à la Turquie. Elle s'élève au total à 6 milliards d'euros, alors qu'on ne dépasse pas deux milliards quand on cumule l'aide versée au Liban et à la Jordanie. Il faut aller vite, car même si nous avons pu constater des conditions d'accueil correctes, il y a des facteurs de déstabilisation.
Le rapport ne se prononce pas sur la légalité de la déclaration Union européenne – Turquie de mars 2016. Elle existe et nous comprenons qu'elle a été discutée principalement entre la Turquie, l'Allemagne et la Grèce avant d'être validée au plan européen. De toute évidence, l'idée que la Turquie est un pays sûr ne peut pas être partagée par tous, mais nous avons constaté des efforts réels en ce qui concerne l'accueil des réfugiés syriens. Nous avons visité le camp de Nizip à la frontière avec la Syrie, qui n'est pas très loin d'Alep : l'accueil y est de bonne qualité. Notre inquiétude concerne les non-Syriens, auxquels les ONG et la communauté internationale ont du mal à accéder et pour qui nous n'avons pas de garanties quant au respect des droits des réfugiés. Quel que soit l'avenir de la déclaration UE-Turquie, la France et l'Europe ont le devoir de peser pour que le respect de ces droits soit réel.
L'accueil commence à se structurer de manière très correcte dans les camps de réfugiés, notamment avec la distribution de cartes de débit permettant de choisir sa propre consommation et avec la scolarisation des enfants, qui a beaucoup tardé mais progresse en dépit de certaines rigidités. Il faut tenir compte des différences de culture et de langue. Il y a des difficultés sur ce plan dans les pays de premier accueil des réfugiés syriens, mais la question s'était aussi posée à Calais. On doit créer des sas pour faciliter l'accès au système éducatif de droit commun et s'appuyer sur ceux qui, parmi les réfugiés, sont des enseignants. Il faut parvenir à les intégrer dans le système. En dehors des camps, la situation reste en revanche très difficile pour les réfugiés. Des familles entières s'entassent dans des logements dépourvus d'accès à l'eau, à l'électricité et au chauffage, souvent dans des zones éloignées des grandes agglomérations urbaines, ce qui pose des problèmes d'accès pour les ONG.
Les six milliards d'euros d'aide prévus pour la Turquie nous paraissent correspondre à des besoins réels en termes d'accueil de réfugiés, notamment pour la construction d'écoles, le recrutement d'enseignants et la capacité du système de soins. Le coût est au moins égal à 6 milliards d'euros.
S'agissant de la Libye, qui a fait l'objet de nombreux travaux de la commission, nous avons entendu des avis divergents sur l'évolution potentielle de la situation. La communauté internationale s'efforce d'aider à la stabilisation politique, mais un immense chaos continue de régner. Le pouvoir politique réel et la force demeurent très dispersés. Une économie de la migration très puissante s'est mise en place, même si nous n'avons pas été en mesure de la chiffrer précisément. Les arrivées actuelles en Europe sont principalement dues à l'ouverture d'une voie en Libye et à la mise en place de toute une économie qui facilite le passage. Les embarcations sont des zodiacs allongés qui peuvent accueillir 150 personnes. Si chaque migrant paie entre 2 000 et 3 000 euros, cela peut représenter environ 450 000 euros par départ de bateau, pour un coût très faible.
Nous n'avons pas décelé de méta-réseau qui organiserait les trafics. Il nous semble que l'on a plutôt affaire à une succession de réseaux très organisés et assez liés aux pays traversés. Il y en a en Libye, au Niger et sans doute aussi dans le Sud de l'Algérie et au Tchad. Ces réseaux assurent chacun une partie du trajet en prélevant à chaque fois entre 1 000 et 2 000 euros, ce qui peut porter le coût du trajet jusqu'au territoire italien à 5 000 ou 6 000 euros pour les migrants. De nombreux acteurs sont impliqués, mais ce sont souvent des pions du système qu'on fait tomber quand on dit démanteler des réseaux.
Que fait la communauté internationale en Libye ? Des forces navales européennes, des bateaux de Frontex et des navires d'ONG, jusqu'à 12 selon les périodes, ont avancé jusqu'à la limite des eaux territoriales libyennes. En pratique, leur principale action consiste à recueillir les migrants et à les transporter jusqu'en Europe. Nous n'avons pas repris l'idée abominable selon laquelle il faudrait reculer les navires parce que leur présence faciliterait la traversée des migrants. On sait bien que d'autres routes se créent lorsqu'on ferme le passage quelque part. Quand les conditions se durcissent du côté de la Turquie, il y a des trajets beaucoup plus éloignés qui se mettent lentement en place. Au-delà de la Libye, il y a des départs depuis l'Égypte et, de manière beaucoup plus limitée, depuis l'Algérie. Il y a aussi des arrivées en Espagne, même si elles sont très faibles jusqu'à présent. Le recul des bateaux européens au large de la Libye provoquerait des drames épouvantables, car les embarcations utilisées par les passeurs ne sont pas capables d'aller très au-delà des eaux libyennes. Le nombre de morts et de disparus en Méditerranée ne s'est d'ailleurs pas réduit en 2016, car les bateaux sont de plus en plus frêles et les conditions de plus en plus difficiles pour les migrants. Il n'est pas rare qu'il y ait déjà des morts quand on leur porte secours en mer.
L'Europe doit rester présente et ses bateaux doivent secourir les réfugiés. Un travail a été engagé pour former les garde-côtes libyens dans le cadre de l'opération « Sophia ». Dans l'immédiat, nous ne préconisons pas la conclusion d'un accord migratoire entre l'Union européenne et la Libye. La situation sécuritaire et humanitaire l'interdit absolument. En revanche, comme s'y emploient déjà l'Union européenne et le HCR, il faut impérativement améliorer les conditions de vie des réfugiés et des migrants en Libye. La situation est très dure dans des camps auxquels la communauté internationale n'a pas accès. Là aussi, nous avons entendu à Agadez des récits de femmes et d'hommes qui avaient rebroussé chemin, comprenant ce qui les attendait. Même si la situation sécuritaire est très difficile, il faut mettre des moyens importants. MSF, qui fait partie des seules organisations présentes sur le terrain, de manière très courageuse car elle déploie encore des personnels européens, a clairement insisté sur cette nécessité. Il y aurait jusqu'à un million de réfugiés et de migrants en Libye.
La situation en Afrique, sur laquelle nous avons beaucoup travaillé tout au long de la législature, constitue un élément très important dans la problématique d'ensemble. Il y a en effet trois foyers principaux de départs vers l'Europe : la Syrie et le Moyen-Orient, l'Afghanistan, la Corne de l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest, avec des problématiques très différentes selon les pays. Notre rapport accorde une large place à la question du développement, sous réserve de ce qu'a dit le président de la mission sur l'augmentation des départs que l'on observe dans un premier temps. Il faut également souligner que les déplacements sont d'abord internes et intra-africains. Sur les 65 millions de déplacés forcés, on compte plus de 40 millions de déplacés internes et les mouvements Sud-Sud sont par ailleurs très importants, comme nous avons pu le constater au Niger.
Le développement est une priorité absolue pour des raisons migratoires, bien sûr, mais aussi de manière plus générale. En termes de priorités, nous considérons que la France et l'Union européenne doivent investir massivement au Sahel, sans que cela se fasse au détriment d'autres zones. Il faut augmenter globalement les moyens de l'aide au développement, notamment en dons. Même si des progrès ont été faits, notamment avec la création d'un fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique lors du sommet de la Valette, il faut continuer à augmenter le volume global de l'aide au développement. Par ailleurs, si la mise en place de ce fonds fiduciaire a été rapide au regard des standards européens, les traductions sur le terrain sont lentes. Nous l'avons vu à Agadez, où il n'y a toujours pas d'Occidentaux, à l'exception d'une mission européenne qui aide au renforcement des capacités des forces de sécurité. Les responsables internationaux que nous avons croisés dans la capitale n'ont généralement jamais mis les pieds à Agadez. Localement, un conseil régional a vu le jour, mais sa structuration est encore très faible. Il doit compter environ vingt fonctionnaires pour l'ensemble de la région. Les responsables locaux nous disent de nous appuyer sur eux, mais leurs capacités restent peu développées. Pour notre part, nous devons renforcer nos moyens d'intervention. Serge Michailof, que nous avons auditionné, propose ainsi que la France prenne l'initiative de créer un fonds fiduciaire pour le Sahel, au-delà de celui qui a été instauré par l'Union européenne pour l'Afrique.
Le Niger est un pays clef. Sa stabilité et ses capacités étatiques sont réelles, mais c'est aussi le pays le plus pauvre et celui dont la progression démographique est la plus forte. Le Niger n'a pas la possibilité de faire face seul à ses propres difficultés. Il y a une vraie prise de conscience sur la question du contrôle de la démographie et même un discours politique, ce qui est assez unique en Afrique et peu populaire. La volonté est forte, comme nous avons pu le constater en rencontrant la ministre de la population, mais les capacités restent limitées. Il faudrait recruter afin de pouvoir déployer l'action sur l'ensemble du territoire du Niger, mais le pays est sous le contrôle du FMI qui interdit le recrutement de fonctionnaires. Il faut donc se contenter d'un redéploiement de moyens au sein d'un Etat pourtant faiblement doté. Compte tenu de la volonté politique du Niger et du résultat absurde auquel on aboutit en l'état, il me semble que le FMI pourrait consentir quelques exceptions.
Il nous semble aussi qu'il faut concentrer l'aide sur les secteurs les plus névralgiques. Les grands projets de développement public-privé sont nécessaires pour construire des infrastructures et ils n'auront sans doute pas de rentabilité à court ou à moyen terme, ce qui nécessite des prêts de longue durée et à des conditions très privilégiées, mais il faut aussi des ressources en dons, qui doivent être concentrées dans un premier temps sur le développement agricole et rural, sur le renforcement de l'appareil régalien, sur la sécurité et sur la gouvernance. Les spécialistes du développement ont bien montré à quel point il est fondamental de construire un appareil régalien en parallèle du développement économique et l'Europe commence à s'y intéresser sous l'angle des questions sécuritaires et migratoires.
Notre rapport insiste aussi sur le rôle des diasporas, qui ont un rôle important à jouer mais dont on a souvent du mal à appréhender les traductions en termes d'action publique. Leurs envois de fonds dans les pays d'origine représentaient plus de 600 milliards de dollars en 2016, dont 442 milliards vers les pays en développement. L'articulation entre l'aide internationale et cette manne financière très puissance constitue un axe de progrès à explorer.
Sur la question des campagnes d'information, beaucoup de femmes et d'hommes souhaitent partir parce qu'ils ont des projets de vie, mais de nombreux départs ont également lieu sur la base d'informations qui ne correspondent pas à la réalité de ce que peut apporter la migration. Malgré les moyens de communication et d'information, la méconnaissance de ce qui attend réellement les migrants est très forte. Les réfugiés syriens ont tous des téléphones portables et il y a d'ailleurs des prises pour les recharger et des bornes Wifi dans les camps. Leur trajet ont une rationalité : s'ils veulent aller en Allemagne, c'est parce qu'ils y ont des proches. Mais cela n'est pas vrai dans certaines parties de l'Afrique. Il y a un travail très important à faire sur l'information, afin que les migrations soient fondées sur du réel et non sur du rêvé. Il faut développer les efforts qui ont été engagés sous l'égide de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Sur ce plan, le Niger est aussi un pays essentiel car il se situe au carrefour de tous les trajets en Afrique de l'Ouest. Des migrants disent avoir entendu que la Méditerranée n'est qu'un fleuve à traverser. Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai ou si on leur a simplement dit que la traversée de la Méditerranée n'est pas l'étape la plus dure à franchir, une fois qu'on est arrivé en Libye. Cela dit, il y a manifestement une désinformation qui est organisée par les passeurs. Tout est d'ailleurs très structuré et très localisé : on ne part pas du Mali en général, mais de telle région au Mali vers telle région en Europe. Cela peut s'expliquer par des raisons personnelles et familiales, mais il y a aussi l'action des réseaux de passeurs qui délivrent des informations dévoyées et trompeuses.
Je terminerai avec les réponses apportées par l'Union européenne. De nos déplacements et de nos contacts avec des responsables à la Commission européenne, il ressort que l'Europe, comme toujours, a beaucoup tardé à réagir mais que ses réponses contiennent finalement beaucoup d'éléments très sensés.
Les réponses adoptées dans un premier temps, dans l'urgence, ont consisté à renforcer les opérations coordonnées par Frontex en Italie et en Grèce, qui sont très importantes, à créer un mécanisme temporaire de répartition des demandeurs d'asile au sein de l'Europe, la « relocalisation », qui est limitée à la fois en nombre et sur le plan de la mise en oeuvre concrète, la France étant le pays le plus en pointe, à créer un mécanisme de réinstallation de réfugiés depuis des pays tiers – j'y reviendrai car je souhaite que l'on développe les voies légales d'accès à l'Europe, qui se mettent en place et qui fonctionnent depuis le Liban ou la Turquie vers la France –, à mettre en place des « hotspots », avec des hésitations du côté européen sur leur statut précis – s'agit-il en effet de centres d'accueil et d'orientation pour réfugiés, comme en Italie, ou bien de centres fermés en vue d'un retour, comme en Grèce à la suite de l'accord UE-Turquie – et enfin à mettre en place une aide d'urgence pour la Grèce, alors que l'aide humanitaire était jusque-là destinée à des pays hors Union européenne. Des moyens très importants ont été dégagés, avec un fort impact sur la qualité de l'accueil qui s'est améliorée en Grèce.
Parmi les propositions du rapport, il y a bien sûr la nécessité d'assurer une bonne gestion des frontières. Je ne souhaite pas que l'on érige des barrières aux frontières de l'Union européenne, mais les conditions de leur franchissement doivent obéir à des règles permettant d'assurer des entrées avec un statut clair. La pagaille qui a régné a conduit à de mauvaises conditions d'accueil en dehors des pays très organisés tels que l'Allemagne. Frontex a été transformée en une véritable agence européenne de garde-côtes et de garde-frontières, ce qui est positif. Il reste des progrès à faire en termes de moyens humains, même s'ils ont été accrus de manière notable dans le cadre des mises à disposition par les États membres, et en matière de coordination. J'ai pu le constater lors d'une mission que j'ai effectuée avec la Marine nationale dans le cadre de l'opération européenne « Sophia ». Tout est très concerté quand il s'agit d'un navire ou d'un avion militaire, puisque la question de l'interopérabilité a été résolue depuis longtemps dans le cadre de l'OTAN, mais c'est plus difficile quand un avion de Frontex décolle pour surveiller les côtes ou repérer des embarcations de migrants en détresse. Il n'y a pas de liaison structurée avec les appareils qui pourraient être mobilisés par d'autres États membres. La question de la coordination est fondamentale. Si les capacités d'action de l'Agence Frontex ont été considérablement augmentées, y compris pour des projections aux frontières, on continue en effet à se reposer essentiellement sur des moyens étatiques.
Nous préconisons aussi de développer considérablement les coopérations avec les pays d'origine et de transit. Le fonds fiduciaire pour l'Afrique, qui a été monté très rapidement, constitue un progrès, mais il faut renforcer ses moyens et surtout il est nécessaire que cela se traduise rapidement en projets dans les secteurs cruciaux que j'évoquais tout à l'heure. Ce n'est pas facile pour l'Union européenne car elle n'a pas de capacités d'action propres sur le terrain. Des « pactes migratoires » concernent par ailleurs cinq pays prioritaires, l'Éthiopie, le Mali, le Niger, le Nigéria et le Sénégal. Ils ne doivent pas reposer sur un chantage à l'aide au développement autour des questions migratoires, mais sur un renforcement des capacités étatiques et de développement. C'est d'ailleurs l'esprit du sommet du Valette et de ce que défend la France. On fera ainsi oeuvre utile pour la stabilité et le développement des pays concernés.
Sur le régime d'asile européen commun, une révision a eu lieu avant les mouvements migratoires de 2015, mais elle n'a pas été conçue dans la perspective d'afflux massifs de migrants et de demandeurs d'asile. Dans le cadre des débats en cours au plan européen, nous préconisons notamment une révision du règlement de Dublin. Que les pays d'entrée soient les principaux responsables de la gestion de leur frontière paraît normal en temps ordinaire, mais on ne peut pas demander à la Grèce et l'Italie d'examiner seules les demandes d'asile quand il y a 1,8 millions d'arrivées dans l'année.
Il faut aboutir à des mécanismes permettant à chaque pays européen d'assumer sa part dans l'accueil, en fonction de sa taille démographique et de ses capacités économiques, voire de la situation sur le marché de l'emploi, puisque la question est de permettre à ces femmes et à ces hommes de s'intégrer ensuite. Ce que défend la France dans ces négociations me paraît une position acceptable a minima. On peut garder le règlement de Dublin pour les situations standards, mais il faut accentuer notamment le volet relatif aux liens familiaux, qui ne sont pas réellement pris en compte alors que ce critère vient avant celui du pays de première entrée. C'est du reste un débat que nous avons avec les Britanniques sur le règlement de la situation à Calais et les Italiens disent parfois qu'il faudrait commencer par appliquer réellement Dublin sur cette question. Dans le cadre des relocalisations, c'est aussi l'intérêt de l'Europe et celui des migrants que chacun se sente au mieux dans le pays où il va. En cas d'afflux massif, qu'il faut traiter dans des conditions fidèles à notre tradition d'accueil, nous avons par ailleurs besoin d'un mécanisme de répartition, sans qu'il soit entièrement automatique même si je le souhaite à titre personnel. J'espère que l'on pourra aboutir au plan européen, sachant que beaucoup d'Etats membres sont totalement fermés sur ce point. Les pays du groupe de Visegrád bloquent les décisions européennes alors qu'ils sont très peu concernés par les arrivées de migrants.
J'ajoute qu'il n'y avait pas de débat sur les questions d'asile il y a deux ans. On considérait qu'il y avait un devoir d'accueil et que le règlement de Dublin avait réglé le problème au plan européen. C'est devenu une question politique, à tel point d'ailleurs que certains responsables déclarent qu'il ne faudrait plus accueillir de réfugiés en Europe. Quelles que soient les convictions des uns et des autres, je crois qu'on arrivera d'autant mieux à régler cette question politique si l'on fixe des règles au plan européen qui soient conformes aux engagements internationaux de la France et de l'Europe.
Je propose aussi le renforcement des voies légales et sûres d'accès à l'Union européenne. Il faut pouvoir demander l'asile sans avoir à risquer sa vie pour rejoindre le sol européen. Cela implique de développer des capacités dans nos ambassades ou dans les représentations de l'Union européenne à proximité des pays en crise. Des outils existent et ils sont d'ailleurs assez développés en France. Je pense aux visas pour l'asile, qui restent encore peu délivrés en dehors de quelques pays, et à l'examen des demandes d'asile dans nos ambassades, même si cela pose d'autres questions, notamment au regard du droit international et de l'indépendance par rapport au pouvoir exécutif. Sur le sol français, c'est l'OFPRA qui décide en toute indépendance, mais on peut imaginer son déploiement dans des pays limitrophes des crises, par exemple au Liban, en Jordanie ou en Turquie, afin que les décisions soient prises dans nos ambassades, en ayant bien sûr à l'esprit qu'il faudrait être capable de gérer l'afflux de personnes que cela pourrait provoquer.

Merci pour ce rapport d'information très complet et merci à Jean-Marc Germain d'avoir d'abord parlé de catastrophe humaine. On parle beaucoup de chiffres en oubliant généralement qu'il s'agit avant tout de drames humains. Je suis chargée d'un rapport d'information pour le réseau des femmes au sein de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie qui porte sur les violences subies par les femmes pendant leur migration.
Il ne faut absolument pas que l'Europe donne 230 millions d'euros à la Libye en l'état actuel des choses. Toutes les auditions que j'ai organisées, de médecins ou d'ONG, montrent que les centres en Libye sont quasiment des camps d'internement où ont lieu des violences inimaginables.
Les femmes étant très vulnérables pendant leur parcours migratoire et à leur arrivée, il faudrait peut-être prévoir un système de visas humanitaires afin qu'elles n'aient pas à emprunter des routes où elles sont exposées à des violences. En Syrie, par exemple, il y aurait une recrudescence du mariage précoce, alors que cette pratique avait quasiment disparu. Les femmes préfèrent être accompagnées par des hommes, n'importe lesquels, afin d'être protégées.
Dans les camps, il faudrait prévoir, comme l'a fait Anne Hidalgo à Paris, des séparations pour les femmes et pour les familles mais aussi de l'éclairage, notamment dans les toilettes. Cela paraît très simple, mais cela apporte un peu de protection aux femmes. Ces questions sont importantes car le droit des femmes est en train d'être bafoué sur toutes ces routes.
Concernant l'éducation et la baisse de la démographie dans certains pays, comme le Niger, il faut lutter contre ce que fait Donald Trump, qui veut remettre en place le bâillon mondial interdisant aux ONG de financer tout ce qui touche à l'éducation sexuelle des femmes à l'étranger. Cela va poser beaucoup de problèmes car il n'y aura plus de moyens pour aider les femmes à conquérir des droits, à s'éduquer et avoir la maîtrise de leur corps.

Merci pour ce rapport qui aura permis de relativiser la perception habituelle des phénomènes migratoires, puisque vous insistez notamment sur l'importance des migrations Sud-Sud. Avez-vous étudié le cas des régions ultrapériphériques ? Elles sont à la fois des territoires d'accueil et de départ, avec toutes les situations dramatiques que vous avez évoquées dans les pays qui peuvent être identifiés comme étant en développement.

Pour répondre à Chantal Guittet, il est en effet nécessaire de développer les visas humanitaires, en allant bien au-delà des personnes vulnérables même si elles doivent être prioritaires. D'ailleurs, nos consulats prêtent déjà une attention particulière aux situations de vulnérabilité dans ce cadre.
S'agissant du contrôle de la croissance démographique, le concept utilisé au Niger est celui de « dividende démographique » plutôt que de « contrôle des naissances ». Mais l'objectif est ambitieux puisqu'il consiste à ramener très rapidement le nombre d'enfants par femme de huit à cinq. Cela passe par l'éducation, ce qui est compliqué dans un pays qui n'a pas encore les structures nécessaires, par l'information, par l'accès aux moyens de contraception, même si on ne le formule pas toujours de manière aussi claire, c'est-à-dire par des dispensaires où les femmes peuvent accéder à des moyens de contrôle des naissances.
Dans le cas du Niger, on a un pays qui veut agir de manière très nette, qui assume un discours politique et qui a une vision claire des outils à mettre en place. La question percute bien sûr celle de l'islam et nous avons entendu sur place des propos un peu contradictoires quant à la réceptivité des responsables religieux.
On ne peut pas féliciter les responsables nigériens pour leur courage tout en leur refusant les moyens d'action nécessaires, pour des raisons liées à l'assistance du FMI et à ses conditions. Cela fait partie des investissements totalement stratégiques. Si un pays africain assume cette politique et réussit, ce dont le Niger est capable, il pourrait y avoir des répercussions fortes sur l'ensemble du continent.
Nous avons manqué de temps pour étudier spécifiquement la question des régions ultrapériphériques, sur laquelle Boinali Saïd m'avait sollicité au début de nos travaux. Notre diagnostic et nos conclusions mériteraient sans doute d'être déclinés plus précisément sur ce point, ce qui pourrait faire l'objet d'une mission d'information ultérieure, mais je crois qu'ils valent aussi pour les régions ultrapériphériques, qu'il s'agisse du caractère aigu du problème, des drames humains, qui sont les mêmes, et de la nécessité pour l'Europe et d'autres grands pays tels que le Canada, qui a une politique très affirmée et très organisée – je n'ose pas parler des États-Unis depuis que M. Trump est au pouvoir – d'organiser l'accueil de ceux qui viennent de plus loin quand c'est nécessaire, utile et demandé.
La commission autorise la publication du rapport d'information à l'unanimité.
La séance est levée à douze heures vingt-cinq