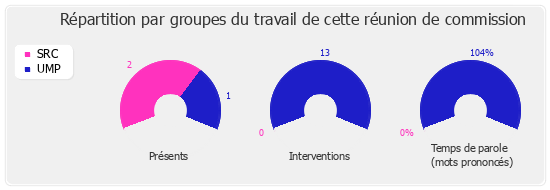Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
Réunion du 29 avril 2014 à 8h45
La réunion
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
MISSION D'ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Mardi 29 avril 2014
La séance est ouverte à neuf heures trente.
(Présidence de M. Pierre Morange, coprésident de la mission)
La Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) procède d'abord à l'audition, ouverte à la presse, de M. Didier Eyssartier, auteur du rapport « Rénovation du modèle économique pour le transport sanitaire terrestre » remis au ministère de la santé et des sports en septembre 2010.

Monsieur Didier Eyssartier, soyez le bienvenu. Les membres de la MECSS vous prient de bien vouloir excuser leur absence, due à un agenda parlementaire chargé.
Le transport de patients a récemment été mis au coeur de l'actualité par un rapport de la Cour des comptes ; l'enveloppe qui lui est dédiée – 3,8 milliards d'euros en 2012, soit 2,1 % des dépenses totales d'assurance-maladie – connaît une progression soutenue, de 63 % entre 2001 et 2010, contre 39 % en moyenne pour les autres postes de dépenses intégrés dans l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM). Quatre facteurs sont généralement mis en avant pour expliquer cette progression : le vieillissement de la population, l'augmentation du nombre de patients atteints d'affections de longue durée (ALD), la restructuration de l'offre – regroupement des plateaux techniques et développement des alternatives à l'hospitalisation lourde – et l'augmentation de l'offre de transports, qui n'incite pas à privilégier les solutions de proximité ou les moins coûteuses.
Au-delà de ces constats, qui font consensus, nous aimerions connaître vos préconisations, qu'il s'agisse du non-respect des référentiels de prescription, d'une réforme de la garde ambulancière, du renforcement des contrôles pour lutter contre la fraude ou du contingentement de l'offre.
Je vous remercie de votre invitation, et vous prie par avance de bien vouloir excuser mes éventuels oublis ou lacunes, car mes travaux sur le sujet sont assez anciens.
La dynamique des dépenses que vous avez rappelée, Monsieur le coprésident, doit être prise en compte sans jeter l'anathème sur tel ou tel acteur, car le sujet est complexe. Cette dynamique tient notamment au vieillissement de la population ainsi qu'à une évolution, dont il faut se réjouir, de la prise en charge de certaines pathologies. Seuls 8 % des assurés ont recours au transport et, parmi eux, 85 % sont en ALD ; il est donc logique que les dépenses augmentent davantage dans ce secteur qu'ailleurs.

La progression représente 5 millions de patients supplémentaires, pour 65 millions de transports.
En effet ; et puisque le recours aux transports est habituel pour les patients concernés, ce chiffre n'ira pas en diminuant. Il faut toujours avoir cette réalité à l'esprit lorsque l'on parle de la progression des dépenses, même si rien n'interdit de réfléchir à la bonne application, voire à la révision du référentiel de prescription du 23 décembre 2006, ou à l'évolution des taux de prise en charge. Le transport de patients étant une activité de masse, on peut, en exceptant le transport d'urgence, essayer d'en réduire les coûts, en commençant par réduire ceux des transporteurs eux-mêmes. Une réflexion sur les prescriptions ordonnées par les établissements hospitaliers, qui restent les premiers demandeurs, est également utile, d'autant que l'hospitalisation de jour tend à se développer.

Les demandes des professionnels de santé et des établissements hospitaliers représentent 63 % des prescriptions.
Et ce chiffre va croissant. Dans ce contexte, l'organisation de la demande est aussi un problème logistique ; elle doit prendre en compte les modes de tarification des transports, mais aussi, par exemple, les temps d'attente devant les établissements, afin de les réduire autant qu'il est possible. La jonction entre les soins et le transport peut donc relever de l'organisation interne des établissements ; on sait aussi qu'une rotation régulière et programmée des transports est à la fois plus facile à mettre en oeuvre et moins coûteuse.

Puisque vous développez une approche horizontale, pleine de bon sens, que pensez-vous de la proposition d'inclure le transport de patients dans le budget des hôpitaux ? Quelques expérimentations ont été lancées en ce sens, mais le moins qu'on puisse dire est qu'elles n'ont pas prospéré.
S'agissant d'un transport de masse intéressant un nombre réduit de prescripteurs, ne pourrait-on envisager des appels d'offres qui rendraient le système plus efficace et moins coûteux ?
Comme je l'explique dans mon rapport, il y aurait une logique à cibler le financement vers ceux qui formulent et organisent la demande. Le transport de patients, au demeurant, concourt aux soins ; dans le cas contraire, on se contenterait de rembourser les trajets en transport en commun.
Un tel ciblage n'implique cependant pas une autonomie immédiate pour les établissements : la réorganisation prendrait du temps, comme l'acquisition des capacités à rédiger des appels d'offres permettant d'acheter au meilleur prix.

Toute réforme structurelle ne génère des économies, dans le meilleur des cas, que dans un délai de trois à cinq ans. On voit donc mal quelles peuvent être les marges de manoeuvre à court terme, en dehors de la réduction des taux de remboursement.
Les référentiels n'ont pas encore eu le temps d' « infuser » dans la communauté des prescripteurs. L'inclusion des transports dans le budget des établissements hospitaliers nécessite une pédagogie plus systématique, qui aurait un effet de masse. Il faut tenir compte des contraintes budgétaires tout en veillant, bien entendu, à préserver les conditions de soins de nos concitoyens, dont participent les transports, comme vous l'avez à juste titre souligné.
Faire des économies suppose de rationaliser l'organisation, pour les transports comme pour le reste. Au-delà de la demande et de l'organisation des transports, l'appréciation du coût de l'ensemble des soins suppose une comptabilité interne, à partir de laquelle un dialogue puisse s'instaurer au sein de l'établissement, en vue d'une meilleure efficience.

Seul un établissement sur trois est doté d'une comptabilité analytique de type 2. Cette cruelle insuffisance est soulignée dans un rapport sur le fonctionnement interne de l'hôpital sous la mandature précédente.
L'organisation des sorties est aussi un vieux serpent de mer. Bref, c'est l'ensemble de ces éléments qui devraient permettre d'améliorer l'efficience du système.
Compte tenu du nombre relativement faible d'acteurs, des expérimentations me semblent toutefois possibles, dès à présent, sur des actes bien identifiés, comme la dialyse, l'un des cinq actes les plus consommateurs de transport, y compris en termes de transports annuels.

Depuis qu'elle existe, c'est-à-dire depuis 2004, la MECSS a maintes fois fait le constat de la complexité de notre système de protection sociale. On est en droit de se demander, à cet égard, pourquoi certaines mesures n'ont pas été mises en oeuvre, qu'elles concernent le parcours de soins, la coordination des acteurs pour les traitements ambulatoires ou la gouvernance entre les agences régionales de santé (ARS), qui délivrent les agréments, et les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM). Résultat : l'offre est mal ajustée aux besoins des patients et à nos capacités budgétaires, et les prescripteurs ne suivent qu'insuffisamment les référentiels. Peut-être est-ce l'ampleur même du dispositif qui empêche la mise en oeuvre de ces mesures, alors que le constat, je le répète, fait consensus. Sur l'enveloppe de 3,8 milliards d'euros, ce sont environ 450 millions, soit 15 %, qui pourraient être économisés à en croire la Cour des comptes, qui évalue le coût du non-respect du référentiel de prescription de 2006 à 220 millions, celui de l'inadaptation de la garde ambulancière – doublons, conventions confuses et contrôle de légalité aléatoire par les autorités de la concurrence ou les comités départementaux de lutte contre la fraude – à 100 millions d'euros et celui des lacunes de la politique de contrôle et de liquidation de factures à quelque 120 millions d'euros.
L'expérimentation inscrite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) de 2013 permettant aux hôpitaux de passer des appels d'offres n'a pas encore été lancée, et ne le sera peut-être pas ; une nouvelle expérimentation est prévue en 2014.
Le secteur de la santé est très éclaté, à l'échelon national comme à l'échelon régional. S'agissant des transports, deux acteurs coexistent au niveau régional alors que des synergies sont possibles, sinon, pour certaines actions, la limitation à un seul acteur : on conçoit, dans la logique du système actuel, que les caisses primaires pilotent les négociations tarifaires avec les transporteurs mais, dans l'absolu, on aurait pu confier une partie de cette tâche aux ARS.
Au niveau national, on ne compte pas moins de trois directions – direction générale de l'offre de soins (DGOS), direction de la sécurité sociale (DSS) et assurance maladie –, ce qui induit, pour le petit secteur dont nous parlons, des coûts de coordination très élevés car tout accord requiert du temps – sans compter qu'il faut parfois se mettre d'accord avec d'autres ministères. J'ai d'ailleurs constaté avec plaisir que l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) se penchait désormais, dans le cadre de ses travaux annuels, sur les questions de transport de patients ; la suggestion que j'avais faite en ce sens, à l'époque, avait essuyé une fin de non-recevoir.
Dans les ministères sociaux, à chaque sujet comme l'emploi, le sport, la jeunesse ou le travail correspond à peu près une direction. Pour la santé, ce sont, je le répète, trois directions qui coexistent.

La complexité du système génère son inertie : sur ce point, vous prêchez des convertis. On déplore à juste titre l'éclatement des centres de décision ou les informations qui ne circulent pas entre les ARS et les caisses primaires, si bien que les données pour établir une politique tarifaire font défaut. Un rapport d'information sur le financement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) de MM. Georges Ginesta, Bernard Derosier et Thierry Mariani, dans le cadre de la mission d'évaluation et de contrôle (MEC), alors présidée par M. Georges Tron et M. David Habib, avait pointé, en juillet 2009, le coût de ces services. Comment rationaliser le système de la garde ambulancière, qu'évoque aussi le rapport de la Cour des comptes ? Le budget des SDIS, il faut le rappeler, avoisine les 4,5 milliards d'euros ; or leur mission d'origine – la lutte contre les sinistres et les incendies – ne représente plus que 15 % de leur activité, contre 60 % à 65 % pour le secours aux personnes, lequel recoupe partiellement le transport des patients.
La convention sur la garde ambulancière a établi un forfait de 350 euros pour les gardes de nuit, le coût paraît élevé au regard du faible nombre de déplacements : les sommes en jeu sont modestes par rapport à l'ensemble des crédits affectés au transport des patients, mais elles illustrent l'insuffisante rationalisation des moyens.
La réponse doit être adaptée à chaque territoire ; c'est d'ailleurs le sens des missions des ARS.

Encore faudrait-il une coordination entre les services d'aide médicale urgente (SAMU) et les SDIS : sauf erreur de ma part, seuls une quinzaine de départements sont dotés de plateformes téléphoniques communes. C'est un peu étonnant, pour ne pas dire irritant.
Ce sujet a été traité par de nombreux rapports, et l'est encore par un autre, actuellement en préparation.

Mme Catherine Lemorton, présidente de la commission des affaires sociales, mène en effet une mission sur la permanence des soins ; les transports font bien entendu partie de sa réflexion.
L'organisation est loin d'être optimale ; et la complexité s'accroît encore si l'on y ajoute la question de la permanence des soins. L'urgence avérée n'est pas forcément l'urgence perçue, si bien que le sujet dépasse la seule coordination entre SAMU et SDIS.
S'agissant du transport urgent, il n'y a pas de réponse univoque. Je laisse de côté le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), car il appartient au SAMU d'en assurer la régulation ; par ailleurs, les plateformes communes doivent permettre une coordination entre SAMU et SDIS. En tout état de cause, le référentiel du 9 avril 2009 de la réponse ambulancière à l'urgence pré-hospitalière paraît pertinent pour ce qui touche à la répartition entre SDIS et transporteurs sanitaires, même s'il est toujours possible de l'ajuster ; cependant, il faut s'interroger sur sa mise en oeuvre dans de bonnes conditions. Dans les zones qui ne sont pas desservies par d'autres transports sanitaires efficients, on peut toujours faire appel aux SDIS, mais je rappelle que leur coût est plus élevé, chacun des transports qu'ils assurent impliquant jusqu'à quatre personnes.

Ce coût, selon les chiffres de l'Association des départements de France, varie entre 230 euros et 1 100 euros. Chaque véhicule est mieux « armé », avec en effet quatre personnes à bord, capables de traiter les transports de patient comme les urgences. Peut-être pourrait-on alléger l'armement en fonction de la mission…
Cela peut en effet être une piste, là où le recours aux SDIS est nécessaire. Un service public – celui du transport urgent, en l'occurrence – peut faire appel à des moyens publics ou privés, pourvu que ces moyens soient adaptés aux besoins.
Réduire le coût du transport des patients suppose, disais-je, de réduire les coûts assumés par le transporteur ; mais il ne faudrait pas se priver de la possibilité de mobiliser des véhicules la nuit. Dans les zones denses, le recours à des transporteurs privés me semble justifié, d'autant que leur formation s'est consolidée. Gardons-nous de les écarter au profit des SDIS, sauf en dessous d'un certain seuil.
Une garde ambulancière généralisée n'a, par ailleurs, pas de sens aujourd'hui. La garde peut être organisée au niveau régional, mais il faut l'adapter en fonction des secteurs, conformément aux objectifs initiaux du service public du transport d'urgence. Cela suppose de trouver les meilleurs acteurs, c'est-à-dire des acteurs efficients et responsabilisés.

L'offre de transport des patients est très développée, et la logique des plafonds du parc des véhicules fixés pour chaque territoire peut sembler discutable. On pourrait, de ce point de vue, imaginer un plafond global mieux affiné, quitte à le dédoubler, pour les ambulances, le transport assis professionnalisé (TAP) qu'assurent majoritairement les taxis – pour des raisons entre autres tarifaires – et les véhicules sanitaires légers (VSL). Le système de vases communicants entre les ambulances et les VSL obéit à des considérations économiques davantage que sanitaires, ce qui est inacceptable ; d'où la nécessité de rationaliser cette offre mal adaptée aux besoins des patients.
Les ARS sont tout désignées pour cela, qu'il s'agisse de l'échange d'informations avec les caisses primaires ou de la sélection des entreprises de transport, qui doit se faire dans le respect des règles de concurrence. Pour la garde ambulancière, notamment de nuit, les conventions signées sous l'autorité du préfet, de l'ARS et des caisses confient à certaines sociétés le soin d'assurer la ventilation des transports ; si bien que lesdites sociétés fixent elles-mêmes les standards. Cette situation vous paraît-elle satisfaisante, au regard de la transparence et de l'équité ?
Le fait que ces plateformes téléphoniques – qui d'ailleurs peuvent être voisines de plateformes de jour – assurent une seconde régulation après celle du SAMU ne me semble pas poser de problème, dès lors que les règles sont connues et les appels tracés par un intervenant indépendant, en l'occurrence le SAMU ou le SDIS ; au besoin, les standards peuvent être définis via des appels d'offres, et les retours d'expérience discutés dans le cadre de tel ou tel comité.

Les parquets ont reçu des plaintes, avec à la clé des débours qui se chiffrent en millions d'euros. Le système n'est donc pas forcément adapté aux besoins des patients, non plus qu'aux exigences de bonne gestion des deniers publics.
Il incombe à l'ARS et au SAMU de vérifier que la société qui assure la ventilation, tâche normalement dévolue au SAMU, le fait en respectant la convention ; faute de quoi les dérives peuvent évidemment prospérer. En l'espèce, il s'agirait plutôt de comprendre, par exemple à travers une enquête administrative, pourquoi le système a pu dériver. Il arrive que l'on crée les conditions de la fraude…

Les conventions sont signées par le préfet ou le directeur général de l'ARS : cela élève donc le niveau de responsabilité.
Comment surmonter la possible contradiction entre, d'une part, la liberté de choix du patient et, de l'autre, l'exigence, fixée par la loi, de privilégier le mode de transport le moins coûteux et l'établissement le plus proche ?
La loi impose, en principe, d'opter pour le mode de transport le moins onéreux. À ce titre, la prescription de transport doit préciser la nature de la prestation : remboursement d'un trajet en transport en commun, d'un trajet avec son véhicule personnel ou prise en charge technique – dans laquelle j'inclus les taxis.

Les chauffeurs de taxi sont tenus à une formation aux premiers secours ; pour eux, le transport de patients représente d'ailleurs un revenu qui, selon la Cour des comptes, peut représenter quelque 30 000 euros par an.
Quant à la liberté de choix, le fait est que la collectivité autorise différents types de prestataires ; à mon sens, il faudrait d'ailleurs tendre à un système de prix unique pour des prestations identiques.

Pour les TAP, on constate en effet une différence de tarification entre les VSL et les taxis. Cela nous renvoie aux politiques des ARS et des caisses primaires en matière d'agréments et de conventionnements. Le plafonnement global du parc de transport permet une libre répartition entre les différents types de véhicules, si bien que la cession des autorisations de transport délivrées aux ambulances peut se monnayer autour de 250 000 euros ! Cette valeur est déterminée par la rareté de l'agrément ; mais le fait que des acteurs privés tirent profit d'une mission définie par des autorités publiques a de quoi laisser perplexe.
On peut en effet en discuter.
Quant au libre choix du patient, il ne doit porter, en principe, que sur l'entreprise de transport, les écarts de coût, variables selon les territoires, étant normalement acceptables pour la collectivité. À l'époque où j'ai rédigé mon rapport, les tarifs des VSL étaient clairement inadaptés ; mais, depuis, ils ont été réévalués. Quoi qu'il en soit, il est logique que les patients aient la possibilité de choisir en fonction de l'offre disponible, voire qu'une relation de confiance s'installe avec tel ou tel prestataire privé.
Il importe néanmoins que la collectivité soit en mesure de proposer des services de qualité, afin d'inciter les patients à aller vers le moins coûteux, comme les transports partagés quand c'est possible. Il est pour le moins désolant, y compris sur le plan écologique, de voir des files de véhicules attendant devant les établissements de santé.

Comme je l'indiquais, la politique d'agrément et de conventionnement détermine, du fait du contingentement de l'offre, des prix de cession dont le niveau laisse perplexe. Quel est votre sentiment sur ce point ?
Le phénomène que vous avez décrit s'observe dans beaucoup d'autres secteurs.

À la différence qu'ici, les opérateurs privés, matériellement libres, coexistent avec un secteur très socialisé par son financement.
Oui, mais les médecins ou les pharmaciens vendaient naguère leur patientèle… La logique me semble être la même ; elle ne me choque pas, même si l'on peut réévaluer certains plafonds ou critères. Desserrer l'offre permettrait de réduire les coûts, qui se répercutent sur le prix de la prestation.

L'inadéquation entre l'offre et la demande se traduit en effet dans les coûts. Cela met en évidence une organisation insuffisante de la prestation au regard des besoins des patients.
Tout à fait. Un dernier mot sur le TAP, pour lequel l'ensemble des acteurs devraient être soumis aux mêmes contraintes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Merci, monsieur Didier Eyssartier. N'hésitez pas à nous faire part de tout élément de réflexion qui revêtirait un caractère opérationnel, sur le plan réglementaire ou législatif.
La Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) entend ensuite M. Thomas Fatome, directeur de la sécurité sociale (DSS) au ministère des affaires sociales, accompagné de Mme Laure-Marie Issanchou, cheffe du bureau des établissements de santé et des établissements médico-sociaux.

Nous accueillons maintenant M. Thomas Fatome, directeur de la sécurité sociale (DSS) au ministère des affaires sociales, et Mme Laure-Marie Issanchou, cheffe du bureau des établissements de santé et des établissements médico-sociaux.
En 2012, 3,8 milliards d'euros ont été affectés au transport de patients. Cette dépense représente 2,1 % de la totalité des dépenses d'assurance maladie et sa progression dans l'ONDAM, pour la période 2001-2010, est deux fois plus élevée que celle des autres dépenses.
La Cour des comptes a estimé les économies potentielles qui pourraient être réalisées. Ainsi, le respect du référentiel de prescription permettrait d'économiser 220 millions d'euros, la réforme du système de garde ambulancière, une centaine de millions d'euros et un meilleur contrôle de la liquidation des factures, 120 millions d'euros. Ces 450 millions d'euros d'économies, qui représentent 15 % des 3,8 milliards d'euros que coûte l'ensemble des dépenses de transport de patients, sont une marge de manoeuvre conséquente qui pourrait produire des effets substantiels, ce qui, compte tenu des contraintes budgétaires actuelles, donne une acuité particulière aux travaux de la MECSS.
À partir des constats que vous avez dressés, j'évoquerai les difficultés que nous rencontrons dans la régulation des dépenses de transport, les initiatives prises au cours des dernières années et les voies de progrès que nous avons identifiées.
Les dépenses de transport représentent un peu moins de 4 milliards d'euros en 2012 et leur progression reste plus dynamique, en dépit d'un léger ralentissement au cours des dernières années, que celle de l'ONDAM, dont la progression devrait être fixée autour de 2 % pour les trois prochaines années.
Cette dynamique des dépenses de transport s'explique en partie par des évolutions épidémiologiques et la transformation de l'organisation du système de soins. Il est certain que la réorganisation hospitalière et le développement des prises en charge ambulatoires impliquent pour les patients des déplacements vers des centres hospitaliers plus éloignés et des sorties précoces dans des conditions qui justifient un transport sanitaire.
Cette dynamique est donc justifiée. Si l'équilibre économique global nécessite que nous réalisions des économies, en allégeant les prises en charge hospitalières ou en regroupant les plateaux techniques, il nous faut parallèlement investir dans une prise en charge pertinente des transports de patients. Nous avons, sur cette question, engagé un dialogue avec l'assurance maladie et nous essayons de convaincre les professionnels transporteurs ; il ne faut pas se contenter de critiquer cette dynamique mais aller plus loin.
Pour autant, nous notons d'importantes disparités de prise en charge. Quelques chiffres : le coût par patient transporté varie de un à deux selon les départements, le pourcentage de patients transportés une fois en ambulance, qui se situe à 53 % au niveau national, varie de 22 % dans les Hautes-Alpes à 76 % dans le Val-de-Marne. Pour certaines pathologies comme l'IRC – insuffisance rénale chronique –, le recours à l'ambulance pour les patients dialysés va de un à deux, voire de un à trois. Ces disparités ne semblent pas reposer sur une analyse objective du besoin des patients.
Plusieurs éléments permettent d'expliquer cette situation.
Tout d'abord, les comportements de prescription, en ville et à l'hôpital, sont très variables et trop déconnectés des règles, des dispositifs réglementaires et des référentiels de prise en charge.
Ensuite, l'hétérogénéité de la tarification du service de transports, qui regroupe les ambulances et les véhicules sanitaires légers (VSL) – dont les tarifs sont fixés par l'assurance maladie dans le cadre de la négociation conventionnelle – et les taxis, dont la tarification est prévue par une autre autorité, suscite des stratégies d'optimisation, ce qui bloque l'instauration d'une régulation globale.
Cette situation est également due à l'organisation même des acteurs du transport de patients, qui souvent cumulent une offre de taxi, de VSL et d'ambulance. Les différentes tentatives de rationalisation de l'organisation hospitalière se heurtent à un marché très éclaté, fait de petites entreprises qui craignent qu'une réorganisation hospitalière soit de nature à les écarter de leur activité de transport.
Enfin, le secteur a fait l'objet, au fil du temps, d'outils de contrôle et de maîtrise médicalisée imparfaits ou insuffisamment développés.
Quelles sont les actions envisagées par la direction de la sécurité sociale ?
Il convient avant tout de rappeler que la DSS n'est que l'un des trois principaux acteurs publics concernés, aux côtés de la direction générale de l'offre de soins (DGOS), qui a compétence en matière d'organisation des soins, de négociations conventionnelles et de pilotage des opérations de maîtrise médicalisée et de lutte contre la fraude, et de l'assurance maladie.
Il s'agit tout d'abord d'agir sur l'offre de véhicules, qui se caractérise par un parc abondant, voire surabondant. C'est pourquoi le décret du 29 août 2012 renforce le pouvoir des directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS) en matière d'agrément et d'autorisation des véhicules de transport sanitaire, qui leur permet de refuser les demandes de transformation d'un VSL en ambulance et leur donne un pouvoir d'appréciation sur l'opportunité des demandes de transfert d'autorisation suite à la cession ou à la modification de l'implantation géographique et de la catégorie du véhicule.
La réalité est complexe car le parc de véhicules se situe d'ores et déjà au-delà des normes fixées. Sauf à prendre des mesures radicales, qui pourraient d'ailleurs être critiquées pour leurs conséquences en matière d'emploi et d'activité économique, il nous apparaît pertinent de placer les directeurs généraux d'ARS en capacité d'adapter l'offre à la réalité des besoins et de faire évoluer le parc afin de limiter l'utilisation inadaptée des véhicules.

Avez-vous le sentiment que le décret est appliqué ? Vous le savez comme moi, nous avons souvent, en France, le sentiment qu'un problème est résolu dès lors que nous l'avons couché sur le papier… J'ai la faiblesse de croire, pour ma part, qu'il n'est résolu que quand il a trouvé une solution opérationnelle sur le terrain.
Les directeurs généraux des ARS ne souhaitent-ils pas reconduire l'existant en évitant certes que la surabondance ne se renforce ? Ont-ils la volonté suffisante de remettre de l'ordre dans cette offre anarchique ? Qu'en pensez-vous ? Sachant que plus de 60 % des dépenses de transport des patients sont prescrites par les seuls professionnels de santé des établissements de soins, pourquoi ne pas tout simplement leur demander, par le biais des référentiels de prescription, de respecter une méthodologie et l'équité de traitement ? Il n'est pas normal que le transport d'un patient atteint d'IRC s'effectue un jour en VSL et le lendemain en ambulance, sachant que la tarification va du simple au double.
Quel est votre sentiment sur l'intégration du poste « transport de patients » dans le budget hospitalier ?
En ce qui concerne le décret, la stratégie consistait à éviter une trop grande augmentation du parc d'ambulances et de permettre aux ARS de le maîtriser, mais nous n'avons pas à ce jour le recul suffisant pour juger de ses résultats. Il est clair qu'il s'agit d'une question difficile…

Elle l'est en effet, du fait de certaines postures monopolistiques et de pressions exercées par certains syndicats ou corporations qui polluent le débat.
Nous avons essayé au cours des dernières années de responsabiliser davantage l'hôpital et de lui confier l'organisation du transport. Certains sont allés jusqu'à parler d'« achat » de transport…
Sur le plan de la rationalité économique, je pense que cette piste a un sens, mais le principe de réalité m'amène à considérer, compte tenu de la diversité des acteurs du secteur, qu'elle n'est pas praticable. Les transporteurs sanitaires et les entreprises de taxi considèrent que toute logique qui donnerait aux hôpitaux le droit de lancer des appels d'offres ou de grouper leurs achats placerait les petites entreprises de taxi en situation d'infériorité. C'est ce qui a amené un certain nombre d'entre elles à bloquer la mise en oeuvre de l'expérimentation prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Je préfère pour ma part réfléchir à des solutions praticables, susceptibles de nous permettre d'atteindre des objectifs réalistes sans nous heurter aux mêmes obstacles.

Nous comprenons l'argument en faveur de la pérennisation du dispositif existant, même s'il n'est pas satisfaisant, mais une politique tarifaire claire et équitable nous permettrait sans doute de trouver une solution plus efficiente.
En ce qui concerne le transport assis professionnalisé (TAP), ne peut-on exiger, en dehors de critères médicaux très spécifiques qui pourraient l'interdire, le recours à des transports groupés de patients dans des minibus ? Ce covoiturage, au-delà de son intérêt en termes de bilan carbone, allégerait aussi le bilan financier sans nuire au bon fonctionnement des petites entreprises.
Bien que certains dispositifs se heurtent à des résistances importantes, nous ne restons pas inactifs. Quatre régions – Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon – expérimentent de nouveaux modes d'organisation des transports. Dans ces régions, un partenariat entre les acteurs du transport de patients et l'hôpital a été mis en place en vue notamment de développer le transport partagé, de coordonner les heures de sortie des patients…
Elle a été mise en place au début de l'année 2012 et devrait, nous l'espérons, donner des résultats satisfaisants.
Nous développons par ailleurs des outils de maîtrise médicalisée par le biais de la contractualisation entre les ARS et les établissements hospitaliers, en particulier les contrats d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins (CAQOS) et les contrats d'amélioration de la qualité et de la coordination des soins (CAQCS) qui visent à cibler les établissements dont les progressions de dépenses de transport sont très élevées.
Il s'agit d'un outil relativement lourd que nous avons simplifié dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.

Comment, en matière de transport des patients, articuler le secteur sanitaire et le secteur médico-social, notamment avec le handicap et la dépendance ?
Nous allons y venir.
En mars 2011, nous avons pris un décret spécifiant que la prise en charge du transport des personnes souffrant d'une ALD n'était pas systématique mais liée à l'état de chaque patient. Il s'agissait de mieux adapter la prise en charge aux besoins de chaque patient. Nous ne sommes pas en mesure de fournir une évaluation précise de l'impact de ce décret, faute de pouvoir appréhender l'évolution des volumes globaux de transport des personnes souffrant d'une ALD, mais il semble que ces volumes diminuent, ce qui signifie que son impact n'est pas nul.
L'assurance maladie déploie des programmes de maîtrise médicalisée et de lutte contre la fraude : accompagnement des prescripteurs en ville et à l'hôpital, développement de la communication sur le respect des référentiels et lutte contre la fraude par le contrôle régulier d'entreprises de transport de patients. Au cours du premier trimestre 2013 a été lancé un programme visant à vérifier auprès de 450 entreprises de transport la réalité des facturations et le respect des règles de prise en charge. Le bilan de ce programme nous sera transmis dans quelques semaines.

Nous serons très attentifs à ses résultats.
La récupération marginale d'un indu peut s'apparenter au détournement de fonds publics à vocation sanitaire et sociale, ce qui est particulièrement scandaleux. La seule récupération, sans pénalités, d'une partie des sommes engagées, en l'absence d'une sanction pénale, me semble relativement peu dissuasive et surtout n'a aucune vertu pédagogique.
Je partage totalement votre diagnostic, mais l'opération en cours a permis aux organismes de notifier 20 pénalités financières, pour un montant de 45 000 euros, et de déposer 15 plaintes pénales. Il s'agit bien, non seulement, de récupérer l'argent issu de remboursements non justifiés, mais aussi de prendre des sanctions administratives et financières à l'encontre des transporteurs de patients concernés.

Mon propos ne sera pas électoraliste, mais nous sommes à la MECSS : les pénalités administratives sont d'un montant trop limité pour avoir une valeur pédagogique. Nous avons des exemples très précis de pénalités administratives totalement dérisoires par rapport aux volumes financiers détournés, notamment dans des affaires dans lesquelles le détournement systématique, pendant plusieurs années, pour un montant de un million d'euros par an, n'a été sanctionné que par la récupération de l'indu d'un montant de 30 000 euros et sans poursuites pénales !
Cette affaire est regrettable. Nous veillons, tant dans la branche maladie que dans les autres branches, à utiliser l'outil des pénalités financières de façon plus systématique…

D'autant que dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, des comités départementaux de lutte ont été mis en place, sous l'égide du préfet et du procureur. Il est d'ailleurs étonnant qu'ils aient à la fois la responsabilité de la lutte contre la fraude et une responsabilité pénale liée à l'organisation du transport de patients au travers des conventionnements placés sous la triple égide de l'ARS, de la CPAM et du préfet. Quoi qu'il en soit, les chiffres de la Cour des comptes sont éloquents : sur les 4 milliards d'euros que représentent les dépenses de transport, près de un demi-milliard est mal utilisé. Nous devons donc faire cesser au plus vite des pratiques qui perdurent au détriment de celles et ceux qui sont frappés par les aléas de la vie.
Nous partageons cet objectif de poursuivre et de renforcer les programmes de lutte contre la fraude. Le contrôle de 450 entreprises, qui a abouti à 15 plaintes et 20 pénalités financières, ne me semble pas anecdotique et démontre la mobilisation des caisses sur ces sujets.

Je ne conteste pas la mobilisation d'un certain nombre de caisses et je ne doute pas de votre volonté de lutter contre la fraude…
Le ministère a demandé à l'assurance maladie de renforcer ses contrôles et c'est ce qu'elle a fait en ciblant au niveau national les établissements qui semblaient justifier un contrôle.
Non, car le programme de contrôle a été initié en avril 2013. Mais je vous ferai parvenir un compte rendu détaillé de ces suites.

Je souhaite qu'il soit exhaustif, région par région, caisse primaire par caisse primaire et qu'il mentionne les volumes financiers en jeu.
Comme vous le savez, le processus pénal est assez long. Quoi qu'il en soit, dans la plupart des cas, c'est bien un contrôle de la caisse primaire qui a donné lieu à l'engagement d'une procédure pénale.

En effet, la plainte a été engagée par la caisse primaire d'assurance maladie qui s'est totalement investie, avec beaucoup d'efficacité, mais le sujet a été classé sans suite au parquet.
En lien avec la Délégation nationale de lutte contre la fraude (DNLF) et le ministère de la justice, nous assurons l'information et la sensibilisation des parquets sur ces questions pour que ces affaires débouchent plus souvent sur l'engagement de poursuites pénales.
J'en viens à la garde ambulancière, même si cette question relève plus de l'organisation des soins, qui est traitée par la DGOS. Nous partageons le diagnostic de la Cour sur les montants trop élevés des dépenses et la difficulté d'organiser une garde ambulancière efficiente entre les ambulanciers et les sapeurs-pompiers. Cette question éminemment sensible sur le plan local a donné lieu à des expérimentations. L'article 66 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 offre à dix agences régionales la possibilité d'ajuster les modes d'organisation et de financement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et des ambulanciers. Certains départements, notamment dans la région Pays de la Loire, ont commencé à expérimenter des modes d'organisation prometteurs. Mais sur une dépense de 300 millions d'euros, 280 millions correspondent aux rémunérations, or celles-ci sont un élément non négligeable de l'équilibre économique des transporteurs concernés. Nous souhaitons vivement avancer en la matière, reste à trouver l'organisation qui permettra aux uns et aux autres de s'organiser.

Un rapport d'information de juillet 2009 de MM. Georges Ginesta, Bernard Derosier et Thierry Mariani sur le financement des SDIS mentionnait déjà la mauvaise articulation historique entre le SAMU et les SDIS. La plateforme téléphonique commune n'est pas présente dans la totalité des départements et dans certains territoires, soucieux d'optimiser l'existant, les coûts induits par le recours au SDIS sont très élevés. La convention fixe à 350 euros la garde de vingt-quatre heures, à laquelle s'ajoute le forfait attribué pour chaque déplacement. Or plus de 60 % de l'activité des sapeurs-pompiers est consacrée au secours aux personnes, contre seulement 15 % aux sinistres.
Vous avez individualisé les départements se trouvant dans ce cas de figure. Les 280 millions d'euros font-ils référence à ces situations particulières ou correspondent-ils à une enveloppe globale ? Une meilleure rationalisation permettrait-elle d'en retrancher une partie ?
Le montant de 280 millions d'euros correspond à l'enveloppe globale destinée aux transporteurs sanitaires, et 20 millions d'euros sont affectés aux SDIS en cas de carence.

Quel est le montant que nous pourrions économiser grâce à une meilleure organisation de la garde ambulancière ? La Cour des comptes parle de 100 millions d'euros.
Je laisse à la Cour la responsabilité de son chiffrage… Je préfère que nous fixions des objectifs que nous pourrons atteindre. Si nous parvenons demain à réaliser 100 millions d'euros d'économies sur ce poste, ce sera une perte de revenus pour les transporteurs de patients, et je sais d'expérience que ce sera compliqué. Si nous proposons une réforme de la garde ambulancière affichant une économie de 100 millions d'euros, nous ne les atteindrons pas et nous risquons même de ne faire aucune économie. Je préfère poser la question en termes d'organisation de la garde et de mobilisation efficiente des moyens.

Nous n'y arriverons pas à cause des pressions qu'exercera la corporation des transporteurs ?
Oui, parce que dans ce secteur, plus encore que dans d'autres, il est plus judicieux de proposer aux professionnels une organisation dans laquelle ils peuvent voir une évolution structurelle plutôt que de raisonner de façon purement comptable. Depuis cinq ou six ans, nous proposons des modifications législatives qui se heurtent à un certain nombre de résistances. Nous devons en tenir compte.
Quand je regarde les contraintes qui pèsent sur l'ONDAM et l'importance de la dépense, ma première réaction est de vouloir rendre l'organisation plus efficiente. Dans le domaine de la permanence des soins ambulatoires, nous avons fait progressivement évoluer les choses en donnant davantage d'autonomies aux ARS qui peuvent désormais organiser les secteurs et rémunérer les professionnels. Cela va dans le bon sens. De la même manière, nous devons donner davantage d'autonomie aux ARS pour qu'elles puissent, en concertation avec les professionnels des transports, rationaliser l'organisation et éviter les situations qui nous amènent à payer à la fois de l'astreinte, de la sortie de véhicules privés et l'utilisation du SDIS, ce qui, dans l'état actuel de nos finances publiques, n'est pas raisonnable.
Je ne peux vous dire si l'objectif de 100 millions d'euros est raisonnable, mais il est à l'évidence très élevé par rapport à l'assiette de dépenses.
Dès lors que l'expérimentation aura montré son efficience…

En France, nous adorons les expérimentations mais nous ne passons pas souvent au stade de leur généralisation. Sur cette question, la conjoncture semble très favorable pour le faire dans le prochain PLFSS…
C'est un peu rapide... Le temps des expérimentations est peut-être long mais il est celui du dialogue entre le niveau national et les ARS, et entre celles-ci et les acteurs locaux.

Je ne suis pas certain que la situation budgétaire du pays nous laisse beaucoup de temps... Ce dont nous débattons aujourd'hui figure dans différents rapports depuis de nombreuses années et les expérimentations ne manquent pas.
Le défi pour les prochaines années est de nous montrer rapides et efficaces pour rendre « absorbable » la contrainte financière dans les ONDAM actuels et futurs.
En matière de politique tarifaire, l'assurance maladie, en plein accord avec le ministère, a développé une stratégie consistant à adapter les règles de tarification afin de rendre le VSL plus attractif et limiter ainsi le recours à l'ambulance. Cette stratégie, mise en oeuvre depuis quelques années, a un coût – elle suppose des revalorisations régulières – mais elle reste un objectif structurel pertinent. L'assurance maladie organise par ailleurs en direction des prescripteurs, en ville et à l'hôpital, des actions efficaces sur le thème du respect de la juste prescription. Certes, cette stratégie produit encore peu d'effets, néanmoins depuis cinq ans la dynamique globale de la dépense est ralentie. Il faut poursuivre dans cette voie, même si elle complique la négociation avec les acteurs.

Préconisez-vous le double contingentement, valable pour les ambulances et les VSL, ou le contingentement global sur un territoire ?
Dans le domaine du transport assis professionnalisé, des quotas théoriques sont appliqués aux transporteurs sanitaires, ce qui inclut les ambulances et les véhicules sanitaires légers, mais les autres acteurs du TAP que sont les taxis conventionnés par l'assurance maladie ne se voient appliquer aucun contingentement effectif, à l'exception de celui lié au fait d'être titulaires de l'autorisation de stationner dans la commune depuis au moins deux ans.

L'offre privilégie désormais les taxis, qui occupent près de 40 % du marché, contre 32 % pour les VSL.
L'un des enjeux principaux en matière de structuration de l'offre, pour l'assurance maladie et les agences régionales de santé, est de pouvoir disposer d'une vision partagée et globale du parc incluant les taxis conventionnés, soit près de 25 000 véhicules, à comparer aux 15 000 VSL.
Il est certain que les modalités de calcul des quotas théoriques définies par l'arrêté du 5 octobre 1995 fixant l'autorisation de mise en service des véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres sont aujourd'hui largement dépassées. Nous réfléchissons aujourd'hui à la possibilité de laisser aux caisses la capacité de ne pas conventionner de nouvelles entreprises de taxi dans la mesure où la réponse aux besoins est assurée par le parc commun de VSL et de taxis déjà en service.
Pas encore.
Le récent rapport du député Thomas Thévenoud sur les taxis et les véhicules de tourisme avec chauffeur contient des éléments de réflexion sur l'adaptation des autorisations des taxis à la satisfaction des besoins de transport sur le territoire. Nous allons instruire ces propositions afin de les traduire par des mesures complémentaires dans le prochain PLFSS ou en prenant des mesures réglementaires.
La législation différencie les personnes en perte d'autonomie et les personnes âgées ou handicapées, pour lesquelles une part des dépenses de transport est prise en charge par le budget de l'établissement médico-social – c'est notamment le cas pour les enfants handicapés – à l'exception des prises en charge ambulatoires.
Le transport des adultes handicapés a fait l'objet d'évolutions dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale. Ainsi, les dépenses de transport des personnes en accueil de jour sont désormais intégrées dans les budgets des établissements, de même que celles liées au transport des personnes âgées. Ces transports sont donc financés par l'ONDAM médico-social et non plus remboursés individuellement au titre des soins de ville. L'Agence nationale de l'appui à la performance (ANAP) travaille sur ce sujet.
La loi de financement de la sécurité sociale de 2012 prévoit la rédaction d'un décret portant sur la prise en charge du transport pour les enfants et jeunes adolescents qui fréquentent des centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP) et les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) afin de faciliter le dépistage, le diagnostic et l'accompagnement précoce du handicap. Ce décret devrait paraître prochainement.

Eu égard au parallélisme des formes, ne serait-il pas légitime d'intégrer le transport des patients dans le budget des hôpitaux ?
Je vous rappelle simplement que les séjours à l'hôpital sont généralement moins longs que les consultations dans les centres médico-sociaux.
Il serait logique de mieux relier le responsable de la prescription avec celui qui en supporte le financement, mais nous ne sommes jamais allés au bout de cette logique. Nous n'y sommes pas opposés, tout en sachant qu'elle nous confronterait aux mêmes difficultés. Si j'étais gestionnaire hospitalier et que l'on m'accordait un budget global pour financer les transports, je serais tenté d'organiser ou d'acheter du transport de patients, donc de structurer le marché dans des conditions que le secteur ne sait pas gérer et que certaines entreprises, en particulier celles de taxis, ne peuvent assumer.
Je crois qu'entre cette hypothèse très ambitieuse et ce qui est train de se déployer sur le terrain, il existe une marge qu'il convient d'exploiter en optimisant l'organisation du transport. Les transports itératifs, pour les personnes qui se rendent à l'hôpital à une heure prédéfinie, nous offrent des marges de manoeuvre substantielles.

Entre le recours au mode de transport le moins coûteux et le principe de liberté qui implique le choix par le patient de son transporteur, où vous situez-vous ?
Le patient n'a pas le choix de son mode de transport mais, aux termes d'une disposition réglementaire, ce transport doit être effectué dans le respect du libre choix du patient. Les organisations professionnelles nous opposent parfois cette règle, croyant qu'elle est de nature législative et immuable, mais elle n'est que réglementaire. Je ne suis pas saisi d'une demande de modification de cette règle, mais ce pourrait être une piste de réflexion.

En effet, d'autant que les contrôles effectués par le service du contrôle médical de l'assurance maladie sont assez limités notamment pour les déplacements inférieurs à 150 km.
Nous sommes attentifs à toute proposition opérationnelle, qu'elle soit de nature réglementaire ou législative. Monsieur le directeur, madame, nous vous remercions.
La MECSS auditionne enfin M. Antoine Durrleman, président de la sixième chambre de la Cour des comptes, et M. Christophe Colin de Verdière, conseiller référendaire.

Bienvenue à l'Assemblée nationale, messieurs.
Je tiens au préalable à vous informer du fait que le rapport sur le financement de la branche famille a été adopté par la MECSS ce matin. Le coprésident Jean-Marc Germain et notre rapporteur Jérôme Guedj ont voté pour. De mon côté, je me suis abstenu, non sans préciser ma conviction personnelle sur le sujet, dans l'esprit de réflexion collégiale qui a présidé à nos travaux. Dans ce même esprit, nous avons unanimement salué la contribution que la Cour des comptes a bien voulu nous apporter à ce sujet.
Les enjeux financiers sont moindres s'agissant du transport de patients, autre préoccupation d'actualité. Toutefois, si les dépenses prises en charge à ce titre représentaient en 2012 quelque 3,8 milliards d'euros, soit environ 2,1 % de l'enveloppe totale de l'assurance maladie, elles ont augmenté de 63 % entre 2001 et 2010 au sein de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM), contre 39 % pour les autres dépenses. En 2010, le nombre de trajets effectués a ainsi atteint 65 millions, pour cinq millions de bénéficiaires. Dans la précieuse contribution que vous avez consacrée au sujet en septembre 2012, vous rappelez ces chiffres et les grandes tendances susceptibles d'expliquer le dynamisme de cette progression : vieillissement de la population, développement des affections de longue durée, regroupement de l'offre de soins, restructuration des plateaux techniques, développement de l'hospitalisation à domicile et de la chirurgie ambulatoire.
Certes, ces dernières évolutions sont destinées à améliorer le parcours de soins. Vous constatez pourtant que l'offre reste insuffisamment construite – pour rester courtois. Vous préconisez donc de la rationaliser afin de dégager des marges de manoeuvre financières. Premièrement, en respectant plus strictement le référentiel de prescription, ce qui permettrait selon vous d'économiser quelque 220 millions d'euros. Deuxièmement, en réformant le système de garde ambulancière, ce qui représenterait une économie potentielle de 100 millions d'euros environ. Troisièmement, en contrôlant la liquidation des factures et en luttant contre la fraude, pour 120 millions d'euros. En somme, ce n'est pas moins de 450 millions d'euros, sur un total de dépenses de 3,8 milliards d'euros, dont nous pourrions faire l'économie, ce qui n'est pas négligeable vu la situation financière de notre pays, surtout en matière de protection sociale.
Le constat que nous faisions en septembre 2012 – sur le rapport de M. Christophe Colin de Verdière –, fondé sur des données qui s'arrêtaient en 2010, n'a pas été démenti depuis. Au contraire, l'augmentation des dépenses de transport prises en charge par le régime général tend à s'accélérer : ramené à 2,7 % en 2011, le taux de progression est passé à 5,5 % en 2012, retrouvant ainsi un niveau historique. En outre, le décalage entre le rythme de progression de l'ONDAM et celui des dépenses de transport tend à se creuser : alors que le second s'accélérait, le premier a ralenti.
Cette évolution récente s'explique essentiellement par deux phénomènes. Premièrement, le nombre de transports pris en charge par le régime général continue d'augmenter : il était de 11,7 millions en 2011 et de 12,3 millions en 2013. Parallèlement, le montant moyen remboursable d'un transport a augmenté encore davantage, passant de 48,52 euros en 2011 à 52,10 euros en 2013 ; l'augmentation s'est élevée à 4,8 % entre 2012 et 2013. L'évolution est globalement identique pour les ambulances et pour les transports assis professionnalisés (TAP), mais varie au sein même de cette dernière catégorie : alors que le nombre de transports en véhicule sanitaire léger (VSL) diminuait – de - 2,9 % en 2012 et de - 0,3 % en 2013 –, le nombre de transports en taxi a très fortement augmenté, de 7,3 % en 2012 et de 4,2 % en 2013. Il faut évidemment mettre ce phénomène en relation avec l'évolution du parc de véhicules consacrés au transport de patients : ces dernières années, le nombre d'ambulances a faiblement augmenté, le nombre de VSL a faiblement diminué et celui des taxis a fortement augmenté. En 2013, on dénombrait ainsi 13 979 ambulances, soit 0,1 % de moins qu'en 2012 ; 14 027 VSL, en baisse de 0,4 % par rapport à l'année précédente ; et 37 100 taxis conventionnés, ce qui représente cette fois une hausse de 2,7 %.

La direction de la sécurité sociale, que nous venons d'auditionner, a parlé de 25 000 taxis.
Les chiffres que nous donnons sont ceux de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). Il y avait 31 384 taxis en 2009 et 37 100 en 2013.
Sur ces différents points – dynamiques des dépenses, augmentation du parc de véhicules, augmentation du nombre de transports –, notre constat n'est pas mieux documenté aujourd'hui qu'en 2012. Nous n'avons pas eu connaissance depuis lors de nouvelles études éclairant davantage les déterminants de la dépense.
Ces derniers incluent des facteurs objectifs, bénéfiques pour les patients et propices à l'efficience du système de soins. Car le transport de patients, naturellement essentiel au parcours de soins, est aussi un gage d'efficience en ce sens qu'il permet de concentrer les ressources du système de santé et les prises en charge dans certains lieux, plateaux techniques ou établissements, tout en garantissant à l'ensemble de la population l'égalité d'accès à des soins de qualité.
D'autres facteurs sont moins positifs. D'abord, les habitudes de prescription peuvent beaucoup varier selon la zone géographique, le département, le médecin prescripteur. Ensuite, le nombre de prescriptions d'un transport paraît d'autant plus important que le parc de véhicules installés est dense.
Qu'ils soient positifs ou négatifs, ces facteurs sont insuffisamment connus. C'est à nos yeux un problème majeur. Pour mieux piloter la dépense, il convient donc d'investir dans une analyse plus précise de ses déterminants.
Précisons en outre que les mesures de « gestion du risque » prises par les pouvoirs publics depuis 2012 n'ont pas encore fait la preuve de leur efficacité.
S'agissant des problèmes organisationnels, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a ainsi prévu l'expérimentation de nouveaux modes d'organisation du transport de patients, consistant à confier ces derniers, dans certaines zones géographiques, à des entreprises de transport de patients désignées sur appel d'offres, quel que soit le prescripteur. Cette disposition a suscité l'émotion des transporteurs, ce qui a conduit les pouvoirs publics à surseoir à la parution du décret d'application de cette expérimentation. Ce sursis perdure à ce jour.
Sans annuler cette expérimentation, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 en a prévu d'autres. Il s'agit d'abord de confier aux établissements de santé volontaires le soin d'organiser le transport de patients à destination ou au départ de l'établissement ; en d'autres termes, d'internaliser la prestation de transport au sein des établissements de santé – mais non son financement comme l'avait proposé la Cour. Là non plus, les décrets d'application ne sont pas encore parus ; il est vrai que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 est parue récemment.
Afin de réguler, et en vue de mieux maîtriser la dépense émanant des hôpitaux, la loi précitée alourdit, en outre, les pénalités dont les établissements de santé sont redevables en cas d'augmentation de leurs prescriptions de transports. Nous avions, en effet, constaté que les prescriptions de transport émanaient à 53 % des médecins hospitaliers et que les contrats d'amélioration de la qualité de l'organisation des soins (CAQOS) en matière de transport de patients avaient essentiellement une existence virtuelle. Il est évidemment trop tôt pour mesurer l'effet de cette disposition.
Un décret du 29 août 2012, qui résultait en grande partie de nos travaux, a renforcé les dispositions tendant à réguler l'offre de transports. Ainsi, la transformation d'un VSL en ambulance, qui permettait jusqu'à présent de contourner le plafonnement du parc d'ambulances, est désormais subordonnée à l'avis favorable des ARS. En outre, pour limiter l'attribution de nouvelles autorisations par l'ARS lorsque le plafond calculé en fonction de la population n'est pas atteint, cette attribution n'est plus automatique ; les conditions du transfert de l'autorisation d'exploitation des véhicules sont durcies ; en particulier, la maîtrise des dépenses peut désormais constituer un motif de refus de transfert.
Ces mesures visent à « colmater » certains des points de fuite que nous avions identifiés. Toutefois, elles ne remédient pas au principal défaut que nous avions mis en lumière : l'absence d'articulation entre les dispositifs de régulation applicables aux VSL et ambulances, d'une part, et aux taxis, de l'autre.
Du côté de l'assurance maladie, on peut noter des progrès dont la portée ne peut être encore véritablement appréciée. Il s'agit de la mise en oeuvre effective, qui nous avait été annoncée par la CNAMTS, d'une évolution de son application informatique permettant d'automatiser davantage la liquidation des factures de transport. Les prescriptions sont dématérialisées, les droits des patients vérifiés lors de l'établissement des factures et les pièces justificatives sont elles aussi dématérialisées. Selon les informations fournies par l'assurance maladie, le nombre de rejets a été divisé par deux depuis que les factures sont traitées par ce nouveau système. Toutefois, la diminution du nombre d'incidents bloquants ne signifie pas que les vérifications soient plus efficaces.
Dans le cadre de notre campagne de certification des comptes 2013 de la branche maladie, dont nous remettrons le rapport au Parlement courant juin, nous avons étudié plus particulièrement l'indicateur de risque financier résiduel, c'est-à-dire la mesure des anomalies touchant les factures de transport de patients. En 2013, 11 % des règlements de prestations de transport sanitaire ont été affectés par des erreurs de liquidation à caractère définitif, imputables à des anomalies de facturation qui n'ont pas été détectées ni corrigées par les dispositifs de contrôle interne. Ces erreurs ont notamment pour origine l'application de tarifs erronés, des cumuls non autorisés de prestations et l'incohérence du nombre de kilomètres parcourus entre le domicile du patient et le lieu où il a bénéficié d'actes de soins. L'incidence financière de ces erreurs représente 3,4 % du montant total des règlements de prestations de transport de patients pris en charge par le régime général au cours de l'année, soit environ 140 millions d'euros, sur un montant total de 3,36 milliards d'euros répartis entre la branche maladie, qui en absorbe l'essentiel, et, pour une part résiduelle, la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
Ce que nous documentons, ce sont des erreurs. Assurément, s'agissant par exemple du nombre incohérent de kilomètres entre le lieu de prise en charge et celui où sont dispensés les soins, on peut s'interroger sur le caractère intentionnel du dérèglement du GPS…
Au total, le secteur du transport de patients pâtit fortement de ces anomalies : il est le deuxième des quatre domaines qui concentrent, en matière d'assurance maladie, 80 % du montant du risque financier résiduel une fois appliqués tous les dispositifs de contrôle, après les médicaments et avant les soins infirmiers, puis les soins de kinésithérapie. En 2013, ce secteur représente 5 % du nombre total d'erreurs de liquidation affectant des prestations en nature de l'assurance maladie, mais ces 5 % sont responsables de 24,2 % de l'incidence financière totale des erreurs de liquidation.
En somme, si l'assurance maladie a amélioré son système d'information, ces anomalies, qui correspondent en grande partie à des excès de versement, demeurent très importantes. L'assurance maladie doit donc particulièrement veiller, surtout dans ce secteur, à renforcer son contrôle interne et la lutte contre la fraude en son sein.

Merci de cette présentation très synthétique de vos travaux.
Vous aviez montré que la hausse de la dépense pouvait résulter de plusieurs facteurs : le référentiel de prescription – une prescription qui émane surtout des établissements hospitaliers – était mal respecté ; l'offre de transports était surabondante, inadaptée à la demande, de sorte que sa tarification alimentait la dépense ; enfin, la gouvernance paraissait éclatée entre l'ARS et les caisses d'assurance maladie. La progression s'est poursuivie depuis. Certes récentes, les mesures de réorganisation de l'offre que vous avez évoquées vous paraissent-elles suffisantes pour la freiner ?
Nous avions préconisé une action résolue de maîtrise de la dépense. Mais celle-ci exige de la pédagogie puisque, dans le secteur des soins de ville, le dispositif dont nous parlons se caractérise par le fait qu'il n'a encore jamais été véritablement régulé. Cette pédagogie doit s'adresser aux patients et assurés sociaux comme aux prescripteurs et aux transporteurs eux-mêmes : tous devraient être partie prenante de la démarche de régulation.
Vis-à-vis des assurés sociaux, en particulier, il convient d'insister sur deux points cruciaux qui ont fait l'objet de dérives. Premièrement, la règle de l'établissement le plus proche : depuis 1986, le patient doit en principe être soigné dans l'établissement le plus proche qui soit compatible avec son état de santé. Or cette règle n'est véritablement appliquée ni par l'assurance maladie, ni par le corps médical. Il importe de rassurer le patient sur ce point : la mise en oeuvre de ce principe n'implique pas pour lui une perte de chance. Toute pathologie n'a pas besoin d'être soignée en centre hospitalier universitaire (CHU). Pourtant, il existe des stratégies d'adressage qui font augmenter le nombre de kilomètres parcourus.
Deuxièmement, la liberté de choix du patient. Les conventions conclues avec les transporteurs de patients font une application inexacte des dispositions du code de la sécurité sociale qui établissent ce principe. En effet, la liberté concerne le choix du professionnel de santé ; ce n'est qu'au nom d'une conception extensive, extra legem, qu'elle a pu être étendue au choix du transporteur. De ce point de vue, la pédagogie doit d'ailleurs également viser les transporteurs.
Si ces règles ne sont pas clarifiées, la dépense n'a aucune raison de cesser sa progression.

Je suis tout à fait d'accord.
Le simple fait d'évoquer l'internalisation de la gestion budgétaire du transport de patients au sein des établissements de soins suscite les craintes des transporteurs, tous modes de transport confondus – ambulances, taxis ou VSL. Certes, dès lors que la dépense de transport est diligentée par les établissements à près de 60 %, l'application de ce principe, appuyée sur le référentiel de prescription de 2006, permettrait de rationaliser le système sans nuire à l'intérêt du patient. Mais l'on y voit souvent la porte ouverte à des appels d'offres dont seraient exclues de petites entreprises, lesquelles craignent pour leur viabilité financière. Sans aller jusqu'à parler de prise d'otages, on sort alors de la logique sanitaire : c'est l'offre qui conditionne la dépense publique, alors qu'il faudrait définir les moyens sanitaires adaptés en tenant compte des recettes disponibles.
Au contraire, si les mesures récemment décidées par l'exécutif tardent à être mises en oeuvre, c'est, semble-t-il, faute de volonté, quelle que soit la majorité politique en place. Le principe de l'expérimentation en témoigne : selon une démarche dont notre pays est coutumier, l'on se satisfait d'initiatives artisanales au lieu de mener une politique volontariste à l'échelle de tout le territoire.
Il s'agit en effet d'une forme de procrastination qui n'est d'ailleurs pas nouvelle. En 2012, nous avions été très surpris de constater que l'idée du référentiel de prescription, principe simple qui aurait dû n'être qu'une première étape, avait été inscrite dans les textes en 1986, mais n'avait fait l'objet d'un arrêté d'application qu'en décembre 2006, soit vingt ans plus tard – vingt ans de perdus. La mesure n'était peut-être pas totalement oubliée, mais on hésitait à la mettre en oeuvre.
En outre, aujourd'hui, le respect de ce référentiel n'est contrôlé ni par les caisses primaires, ni dans les hôpitaux. Dans les CHU, en particulier, c'est traditionnellement l'interne qui signe un bon de transport rempli par la secrétaire ou l'assistante sociale du service. En d'autres termes, le caractère nécessairement médicalisé de la prescription, qui fonde la notion même de transport de patients telle que la définissent les textes, par opposition à un transport de confort, n'est pas du tout assimilé. Le bon de transport constitue un automatisme et le choix du transporteur résulte d'habitudes locales, celles du prescripteur ou celles du patient.
Ce problème central doit être au coeur de l'effort de pédagogie.

Votre constat pourrait être étendu aux logiciels d'aide à la prescription – LAP – ou aux fiches-repères, établies par la CNAMTS et validé par la Haute Autorité de santé, que nous avons étudiés dans le cadre de nos travaux sur les arrêts de travail et les indemnités journalières. Malheureusement, nos préconisations à ce sujet n'ont pas passé le barrage de la validation parlementaire. Cela témoigne de résistances qui ne se limitent pas au milieu médical et conduisent à diaboliser une proposition pourtant raisonnable, fondée sur des critères scientifiques.
Alors que, pour être efficace, la démarche de régulation devrait associer toutes les parties prenantes, les expérimentations prévues par les lois de financement de la sécurité sociale pour 2013 et pour 2014 ne s'inscrivent pas dans une stratégie globale. Voilà pourquoi les acteurs du transport de patients peuvent se sentir stigmatisés et redouter leurs conséquences économiques. Le cadre n'est pas assez clair, l'effort de persuasion n'est pas suffisant. Il faut montrer qu'il n'est pas question de mettre en doute la pertinence de tout transport, simplement de consacrer la dépense d'assurance maladie à la qualité et à l'efficience de la prise en charge. Faute d'une stratégie globale, appliquée à chaque catégorie d'acteurs, on s'expose inévitablement au risque de réactions exacerbées comme celles que nous avons connues début 2013.

En effet, les réactions sont épidermiques lorsque la viabilité du secteur est en jeu. Or celui-ci bénéficie de la dynamique de la dépense, mais n'échappe pas au contexte actuel de contrainte budgétaire.
Pouvez-vous nous en dire plus sur le contrôle médical et la lutte contre la fraude ? Vous le soulignez dans votre rapport, l'assurance maladie cherche désormais à récupérer les sommes indûment versées, mais celles-ci sont bien inférieures aux montants qui se sont accumulés avant l'instauration des contrôles ; en outre, les sanctions sont rares et limitées, ce qui n'est guère dissuasif pour les prestataires, certes minoritaires, qui font délibérément fi des besoins du patient et de l'orthodoxie budgétaire.
Le contrôle médical est essentiel, s'agissant d'une prestation thérapeutique. Pour l'instant, il prend surtout la forme de la mise sous accord préalable de certains médecins de ville qui sont de forts prescripteurs. Cette mesure n'est pas négligeable, car elle peut être dissuasive : elle produit un effet de tempérance réel et durable, pour autant que nous ayons pu le documenter en 2012. Outre le renforcement des pénalités financières applicables aux hôpitaux, prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, on pourrait donc s'interroger sur l'opportunité d'une mise sous accord préalable, mutatis mutandis, des prescripteurs hospitaliers qui se distingueraient par leurs pratiques. Cela pose le problème de la régulation de la prescription hospitalière.
Désormais, celle-ci est censée être mesurable, grâce à l'ordonnancier individuel.
Ce n'est pas le seul problème : une prescription hospitalière qui donne lieu à un achat en ville pèse aussi sur l'enveloppe des soins de ville.
Une action menée au niveau de l'établissement reste à peu près sans effet. J'ai été directeur d'hôpital ; on connaît les réactions que suscite l'intervention d'un administratif en matière de prescription, même dans un établissement important où le directeur général a plus d'autorité qu'ailleurs. Quant aux instances médicales de l'hôpital, leur action en la matière est généralement limitée. Ne faudrait-il donc pas inciter directement certains prescripteurs à surveiller leurs prescriptions ? La question se pose en matière de transport comme dans d'autres domaines de la prescription hospitalière. Cela supposerait que les services du contrôle médical établissent une typologie des prescriptions hospitalières, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Cette question a fait l'objet d'un amendement, mais celui-ci n'a pas connu un sort heureux.
En tout cas, nous constatons l'inefficacité de toutes les formes de contrat liant l'assurance maladie aux établissements, dans le domaine du transport de patients comme du médicament. La pénalisation accrue prévue par la loi de financement pour 2014 provoquera-t-elle une responsabilisation collective ? Je n'en suis pas entièrement certain.
Par ailleurs, l'assurance maladie doit vérifier beaucoup plus systématiquement que le référentiel est respecté. Sur les sept caisses où nous nous étions rendus en 2011, une seule s'y employait.
En matière de lutte contre la fraude, le transport de patients doit être considéré comme une zone à risque qui appelle une attention particulière, ce qui n'était pas le cas lorsque nous avons mené notre enquête. En outre, les sanctions appliquées en cas de fraude devraient être plus sévères. La lutte contre la fraude a naturellement pour objectif de détecter, de redresser et de recouvrer, mais elle doit aussi avoir une vertu pédagogique – celle de la peur salubre du gendarme. Donner le sentiment que le risque mérite d'être pris revient à encourager la fraude.

Je suis heureux d'entendre ces propos de bon sens.
Que pensez-vous de la politique de transport de patients dans le secteur médico-social ?
Nous ne l'avons pas étudiée spécifiquement. Je ne pourrai donc vous répondre sur ce point.

Venons-en à la garde ambulancière, c'est-à-dire au problème de l'organisation départementale du transport sanitaire et de l'articulation entre les services d'aide médicale urgente (SAMU), les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et les associations des transports de secours d'urgence (ATSU). Il ressort des travaux de la Cour des comptes et de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS), ainsi que de rapports parlementaires, que le coût de la garde est, dans certains territoires, disproportionné par rapport à la demande. Vous avez donc suggéré de recourir plutôt à l'existant, c'est-à-dire aux SDIS, dont plus de 60 % de l'activité est dédiée au secours à personne, et 15 % seulement à des interventions en cas de sinistre. Certes, l'armement en effectifs d'un camion de sapeurs-pompiers est deux fois supérieur à celui d'une ambulance ; mais, en lissant le coût de la garde au moyen de forfaitisations par voie conventionnelle, l'on pourrait, sans refondre le système, adapter l'organisation aux réalités du territoire lorsque le nombre d'interventions n'y dépasse pas un certain seuil. Les départements ont pu craindre que cette approche affinée ne dissimule une mesure plus générale propre à alourdir encore les dépenses consacrées aux SDIS, qui représentent déjà quelque 4,5 milliards d'euros pour les collectivités, auxquels s'ajoute un milliard pour l'État au titre de la sécurité civile.
Les coûts de transport restent donc pour l'instant très disparates, allant de 200 euros à 1 100 euros pour le déplacement d'un camion de sapeurs-pompiers, tandis que, en cas de carence ambulancière, l'indemnisation du SDIS est de 105 euros. Les entreprises privées de garde perçoivent quant à elles une indemnité d'environ 340 euros par période de douze heures ; en contrepartie, un abattement de 60 % s'applique au tarif du déplacement.
À ce problème s'ajoute le manque de coordination entre les SAMU et les SDIS, qui ne disposent pas d'une plateforme téléphonique commune dans tous les départements.
Sur ce dernier point, la Cour a constaté comme vous que la conjonction géographique entre les services, et même la simple concaténation informatique de leurs systèmes de permanence, progressent à la vitesse d'un escargot. Elle a donc proposé récemment que l'obligation d'unifier les centres de traitement des appels des SDIS et ceux des SAMU soit inscrite dans la loi.

Selon les chiffres dont je dispose, et qui méritent sans doute d'être actualisés, seuls une quinzaine de départements compteraient une plateforme commune aux SAMU et aux SDIS.
Ils ne doivent pas être beaucoup plus nombreux aujourd'hui. Nous pourrons vous communiquer les derniers chiffres dont nous avons connaissance.
La garde ambulancière, qui découle de la mise en place de la permanence des soins telle qu'elle s'est construite après 2002, constitue une réponse un peu trop générale à des situations très particulières. Si le dispositif est trop peu mobilisé, les coûts d'intervention s'envolent : nous avons établi qu'un déplacement pouvait revenir à 1 600 euros. Inversement, dès lors que la garde ambulancière est fréquemment sollicitée, l'application de l'abattement de 60 % fait perdre de l'argent au transporteur. Bref, le système est ubuesque : s'il ne fonctionne guère, ou pas du tout, cela coûte très cher à l'assurance maladie ; s'il fonctionne bien, le transporteur sanitaire est en déséquilibre économique. Nous avons donc préconisé de le réformer sous ces deux aspects. Là où des déplacements sont nécessaires et n'exigent pas la mobilisation du SAMU, il faut assurer l'équilibre d'exploitation du transporteur sur ce segment d'activité qui est pour lui coûteux ; en revanche, là où les déplacements sont exceptionnels, mieux vaut faire appel au SDIS, qui a toujours un camion armé pour le prompt secours, et non simplement pour l'incendie – relativement rare, heureusement.
À ce propos, la Cour a bien documenté l'importance du coût des effectifs mobilisés par les SDIS – souvent exagérément, d'ailleurs. Lorsque nous avons étudié le fonctionnement des SDIS, nous avons eu le sentiment que l'importance des mobilisations de nuit, très variable, n'était souvent pas fondée sur un besoin réel. Cela ne vaut pas pour les SDIS qui ont procédé à des études d'effectivité. Le fait qu'il revienne à chaque centre de définir le nombre de sapeurs-pompiers qu'il mobilise chaque nuit explique que les chiffres liés à l'armement et au déplacement d'un camion varient considérablement d'un centre à l'autre. Du point de vue de la Cour, les marges d'efficience sont considérables dans ce domaine aussi.

On a pu justifier ces sureffectifs par l'éventualité que les sapeurs-pompiers soient détournés de leur mission initiale de transport de patients pour intervenir à la suite d'un grave accident de la route. Chacun est libre de se faire son opinion à ce sujet.
Chaque territoire est différent.

Quoi qu'il en soit, tout cela ne témoigne pas d'une optimisation des moyens disponibles dans la situation financière que connaît notre pays.
Merci, monsieur le président, d'avoir répondu aussi complètement à nos questions. Nous serons très attentifs à d'autres préconisations opérationnelles, tant législatives que réglementaires ; dans ce dernier domaine, nous aurons à coeur d'user de notre influence sur l'exécutif.
La réunion s'achève à douze heures quarante.