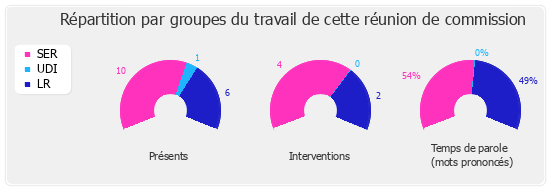Commission des affaires étrangères
Réunion du 17 janvier 2017 à 16h45
La réunion
La séance est ouverte à seize heures quarante-cinq.

Nous avons le plaisir d'accueillir M. Filippo Grandi pour une audition fermée à la presse, qui va nous permettre de faire précisément le point sur la situation des personnes déplacées dans le monde et sur la politique des Nations Unies en la matière.
Notre commission est très intéressée par ce sujet, auquel elle consacre une mission d'information dont le président et le rapporteur, M. Guillet et M. Germain, en déplacement au Niger, m'ont priée de bien vouloir excuser auprès de vous leur absence.
Le nombre de personnes déplacées dans le monde n'a cessé d'augmenter : il atteint aujourd'hui 65,3 millions, contre 38 millions seulement, si l'on peut dire, il y a dix ans. Un peu plus de la moitié d'entre elles provient de trois pays : la Syrie, l'Afghanistan et la Somalie. On dénombre également 10 millions d'apatrides. C'est la région de l'Afrique subsaharienne qui connaît la situation la plus critique, avec 460 000 réfugiés au Tchad du fait de la présence de Boko Haram dans les États voisins. Mais la Syrie est également dans une situation dramatique : le pays compte 6,3 millions de déplacés, ce qui représente une proportion considérable de la population.
Cet état de fait a d'importantes répercussions en Europe. Depuis janvier 2015, un million de migrants sont entrés sur le territoire de l'Union en conséquence des conflits au Moyen-Orient – en Syrie puis en Irak –, mais aussi de l'insécurité au Sahel et de la crise en Libye.
Vous voudrez bien nous dire quelle action mène le Haut-Commissariat pour relever ce défi. Nous savons que votre budget est très imparfaitement financé : seules 50 % de vos dépenses sont couvertes par les dons des États, dont 40 % provenant des États-Unis et 30 % des membres de l'Union européenne.
Vous nous direz également, je l'espère, ce que vous pensez de la politique conduite par les pays membres de l'Union pour faire face à ces flux : de leur politique d'asile, et du partage des responsabilités. Vous êtes ici en tant que haut fonctionnaire international, mais vous venez d'Italie, le pays européen qui a accueilli le plus de migrants : l'année dernière et cette année, les flux se sont réorientés de la Méditerranée orientale vers la Méditerranée centrale, et l'Italie est de toute façon en première ligne depuis le début de la crise à cause des traversées tragiques de la Méditerranée par les migrants.
Merci, monsieur le Haut-Commissaire, de nous faire l'honneur de nous consacrer un peu de votre temps au terme de votre séjour à Paris.
Merci de votre invitation, madame la présidente, à laquelle je me rends accompagné de Mme l'ambassadeur de France auprès des Nations Unies à Genève. J'achève une visite de deux jours : hier, j'assistais avec vous à une conférence sur les migrations et les réfugiés organisée par Sciences Po et, aujourd'hui, j'ai eu le privilège de rencontrer le Président de la République, le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'intérieur, ainsi que plusieurs fonctionnaires du Quai d'Orsay, pour discuter des différents aspects de notre partenariat.
Je confirme vos chiffres, madame la présidente. Le nombre de personnes qui relèvent du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) était en 2015 – les statistiques étant un peu lentes à venir, nous nous référons toujours à celles de l'année précédente – de 65 millions. Parmi ces réfugiés et déplacés, un tiers le sont hors de leur pays et deux tiers à l'intérieur des frontières de leur propre pays. Nous nous occupons en outre de 10 millions d'apatrides. Nous n'avons pas encore les chiffres définitifs pour 2016, mais nous supposons que ce nombre n'a hélas pas diminué ; nous ne pensons pas qu'il ait vertigineusement augmenté : il sera certainement stable ou légèrement supérieur à celui de l'année passée.
Ce nombre, le plus élevé que l'on ait observé depuis des décennies, reflète une réalité bien connue : des conflits multiples, une difficulté croissante à leur trouver des solutions politiques, des causes mêlées qui poussent les personnes à se déplacer et à tenter de trouver une protection ou des opportunités dans un autre pays que le leur. Depuis quelques années, les flux sont de plus en plus « mixtes ». Dans mon pays, l'Italie, qui est en effet le pays d'Europe ayant reçu le plus grand nombre de personnes au cours des derniers mois, ces personnes ne sont, tout au moins à première vue, qu'en partie des réfugiés – de Somalie, d'Érythrée –, beaucoup d'autres étant en quête d'opportunités économiques.
Il nous paraît important de maintenir cette distinction. J'ai coutume de dire que les réfugiés sont des gens qui risquent leur vie s'ils sont rapatriés, à cause de la guerre ou de persécutions, tandis que les migrants économiques s'exposent à la pauvreté et aux privations : si difficile cela soit-il, ce n'est pas la même chose.
Je vous remercie du soutien que la France nous apporte sous différentes formes. Politiquement, d'abord : alors que le dossier est complexe et que les politiques touchant les réfugiés sont désormais au coeur du débat public dans de nombreux pays, la France a défendu les principes de la protection internationale dans les forums européens et internationaux. La France a aussi accru ses contributions financières au HCR, surtout à partir de 2015 ; le niveau atteint cette année-là a été maintenu et même un peu dépassé en 2016 ; lors des entretiens de ce jour, l'on m'a assez fermement assuré qu'il serait également maintenu en 2017. C'est important.
Parmi les crises qui nous occupent le plus, vous avez évoqué la Syrie ; je parlerais pour ma part des crises jumelles de la Syrie et de l'Irak. Elles mobilisent une proportion très importante – 25 ou 30 % – de nos ressources, tant humaines que financières.
En ce qui concerne la Syrie, depuis quelques années déjà, nous nous occupons de 5 millions de réfugiés syriens dans les pays voisins, surtout en Turquie, au Liban et en Jordanie. En Syrie comme en Irak, on compte un très grand nombre de déplacés internes. Le chiffre de 6,5 millions que vous avez cité à propos de la Syrie est une estimation, car nous n'avons pas accès à toutes les zones. En Irak, ce sont 3,5 millions de déplacés que l'on dénombre, en conséquence des conflits qui sévissent depuis cinq ou six ans dans le pays. Parmi eux, 120 000 personnes, peut-être 130 000, ont fui Mossoul : c'est bien moins que ce que l'on imaginait au début, mais cela reste un flux important qui mérite l'attention, d'autant qu'il pourrait augmenter si l'offensive se poursuit ; or elle n'est pas terminée, comme il ressort des conversations que nous avons eues aujourd'hui. Cette offensive militaire, nécessaire du point de vue sécuritaire pour éliminer la menace – au moins territoriale – que représente Daech, comporte des retombées humanitaires, qu'il faut tenter de mitiger autant que possible.
En Syrie, l'évolution politique reste très peu sûre et plutôt fragile. C'est également l'impression qui se dégage de nos entretiens d'aujourd'hui et de ceux que nous avons eus avec les représentants des États au cours des dernières semaines. Nous observons bien sûr attentivement le processus entamé avec l'accord entre la Russie et la Turquie et la proposition d'une conférence à Astana, au Kazakhstan, le 23 janvier, qui sera peut-être suivie d'une autre conférence à Genève, déjà convoquée par l'envoyé spécial du Secrétaire général. Il faudra voir quelles seront les perspectives de progrès et de succès de ces initiatives politiques.
Mais l'on ne sait pas ce qui va se passer ni comment ce processus politique influencera les dynamiques de déplacement des populations. Je vous répète donc ce que j'ai dit au cours de mes entretiens de ce matin, ce que nous disons à tous nos interlocuteurs, notamment aux bailleurs de fonds : les ressources dont nous continuons d'avoir besoin pour faire face à cette situation humanitaire, et dont nous aurons certainement besoin pendant quelques années encore, doivent être allouées de la manière la plus flexible possible.
En effet, il pourrait y avoir de nouveaux déplacements, notamment en Syrie si à l'offensive sur Mossoul, en Irak, s'en ajoute une autre sur Raqqa, la zone de Syrie contrôlée par Daech. Le statu quo pourrait également être maintenu ; cela signifierait que beaucoup de réfugiés restent dans les pays voisins de la Syrie, qui auront alors besoin de soutien. L'on pourrait enfin assister à des retours, même si la situation reste fragile – cela s'est vu dans d'autres contextes. Des déplacés internes pourraient rentrer : c'est arrivé à la fin de l'intervention militaire à Alep, mais nous ignorons si le phénomène se reproduira à plus grande échelle.
La reconstruction de ces pays dépend de la conclusion d'un accord politique solide et qui satisfasse aux exigences politiques internationales ; or celui-ci n'est assurément pas pour demain. Néanmoins, nous en appelons à tous, comme nous l'avons fait ce matin, pour que l'action humanitaire ne soit pas prise au piège des incertitudes politiques. L'action humanitaire est nécessaire quelle que soit la situation et il importe de la poursuivre et de la soutenir sans relâche.
Je reviendrai sur d'autres crises comme celles du Yémen ou de la Libye si vous le souhaitez.
L'Afrique reste bien sûr le continent où nous sommes mobilisés par le plus grand nombre de crises, souvent liées les unes aux autres.
La plus sévère en ce moment est probablement celle du Sud Soudan, avec 1,4 millions de réfugiés dans les pays voisins, surtout l'Ouganda ; c'est déjà deux fois, voire deux fois et demi plus que lors de l'exode du même pays pendant la guerre civile soudanaise. Ce chiffre est révélateur de deux éléments. D'abord, la violence du conflit a atteint des niveaux sans précédent. C'est ce qu'indiquent les témoignages des réfugiés en provenance du Sud Soudan : les civils y subissent des violences inouïes, infligées par les nombreuses parties à cette guerre de plus en plus complexe. Ensuite, ils expriment un sentiment de désespoir qui distingue cette guerre des précédentes : ils ont déjà dû fuir par le passé, ont été rapatriés au Sud Soudan et doivent maintenant en repartir ; ils s'établissent dans les pays voisins avec leur communauté et ne sont pas prêts à revenir aussi facilement qu'auparavant, car ils ne sont pas optimistes quant à l'avenir de leur pays. Cette crise difficile à gérer frappe essentiellement, comme beaucoup d'autres, les pays voisins : très peu de réfugiés sud-soudanais arrivent en Europe. Or ces pays d'accueil n'ont guère de ressources. Il ne faut pas l'oublier.
Le bassin du lac Tchad, dont je reviens, est une autre région en crise. Deux membres de votre commission, m'avez-vous dit, sont au Niger. Il est important de soutenir les pays qui hébergent les réfugiés du Nigéria. Leur nombre est relativement peu élevé – relativement, car ce sont tout de même plus de 200 000 personnes qui ont fui le terrorisme de Boko Haram et les combats entre celui-ci et les forces du gouvernement et de ses alliés. Mais cette crise a aussi entraîné au Nigéria même un immense mouvement, qui concerne peut-être 2 millions de personnes dans le Nord du pays, déplacées à cause des combats, de l'insécurité, des violences perpétrées par Boko Haram sur les civils. Ces déplacements touchent également les pays voisins – le Niger, le Tchad, le Cameroun –, dont les citoyens sont eux aussi affectés par un phénomène régional qui bloque l'activité économique de ce bassin, vitale pour la région. La pauvreté induite par les combats s'ajoute ainsi à des problèmes structurels qui s'aggravent, qu'ils soient climatiques, comme l'assèchement du lac, ou économiques.
Dans cette région très complexe, la réponse à la crise a été essentiellement sécuritaire. Certes, c'est important ; par ailleurs, des progrès ont été accomplis puisqu'un espace pour l'action humanitaire s'y est également ouvert et que nous nous y engageons désormais beaucoup plus. J'ai vu moi-même la situation au Nord du Nigéria ; l'endroit reste très dangereux, car – ne nous faisons pas d'illusions – Boko Haram, comme Daech, demeure une menace même s'il se retire du territoire, par ses attaques terroristes sur les marchés, par exemple. Notre engagement n'en est pas moins réel ; c'est essentiel. Mais à cette action humanitaire doit s'ajouter dès que possible une action de développement à long terme, pour faire face aux problèmes structurels dont je viens de parler et qui contribuent d'ailleurs à expliquer l'émergence de Boko Haram – le manque d'éducation, d'opportunités économiques, etc.
Je l'ai signalé au Président de la République : les trois pays voisins du Nigéria, impliqués sous diverses formes dans la gestion de cette crise et affectés par elle, ont tous exprimé d'autres préoccupations. « Il est très bien », m'ont-ils dit en substance, « que la communauté internationale se focalise sur la solution à la crise de Boko Haram, mais il ne faut pas oublier que nous sommes au voisinage de deux autres crises : d'un côté au Mali, de l'autre en République centrafricaine » – deux crises dans lesquelles la France a été très impliquée et qui, malgré des progrès du point de vue sécuritaire et politique, ne sont pas entièrement résolues. Les pays voisins craignent que cette fragilité ne s'aggrave de nouveau, provoquant d'autres crises dans ces deux pays, et des retombées sécuritaires et humanitaires chez eux. Il y a là un entrecroisement de situations très complexes vis-à-vis desquelles il faut rester vigilant et engagé. Tel est le message que j'ai transmis – et j'ai reçu une réponse très positive à ce sujet.
Nous restons également attentifs à la situation de beaucoup d'autres pays d'Afrique très fragiles, dont la Gambie, qui traverse un processus politique délicat, ou le Tchad lui-même.
J'en viens à l'Europe. Début décembre, nous avons présenté à la Commission européenne un document intitulé « Mieux protéger les réfugiés en Europe et dans le monde ». Voici ce que nous y proposons à l'Europe.
Premièrement, celle-ci devrait adopter une conception beaucoup plus stratégique de ses investissements dans les pays fragiles, ceux dont proviennent le plus de réfugiés, comme dans les pays qui les hébergent parce qu'ils avoisinent les zones de conflit. Ces investissements ont toujours été réalisés, mais ils ont été essentiellement humanitaires. Or il faut aller plus loin pour stabiliser les flux de réfugiés et réduire le nombre de personnes qui choisissent – parce qu'il est aujourd'hui très facile de se déplacer – de quitter leur pays ou les pays voisins : il faut investir plus et de manière beaucoup plus ciblée et stratégique.
Nous avons à ce sujet un dialogue très fructueux avec la Banque mondiale. Celle-ci a créé des instruments financiers entièrement nouveaux, très précieux pour affronter ces problèmes. Les institutions européennes, vos institutions chargées du développement doivent adopter cette approche, beaucoup plus calculée. Il est nécessaire de traiter les phénomènes de déplacement de populations comme des phénomènes globaux qui demandent des réponses globales. Il convient donc de former des alliances beaucoup plus vastes : si l'on veut parvenir à une stabilisation, la Banque, la Commission européenne, les États membres ne doivent pas travailler séparément mais discuter ensemble. Une approche fragmentée ne sera guère efficace. Cette démarche collective est nécessaire parce que la réponse humanitaire, adaptée à la phase aiguë de la crise, peut satisfaire les besoins immédiats, non les besoins structurels et durables.
Naturellement, il faut aussi s'investir davantage dans la résolution politique des conflits. À cet égard, nous fondons beaucoup d'espoirs sur l'action du nouveau Secrétaire général, mon prédécesseur pendant dix ans à la tête du HCR, où il a naturellement développé une sensibilité particulière à ces problèmes. Nous espérons que, sous sa direction, les Nations Unies contribueront davantage à la recherche d'une solution pacifique à ces conflits, par la médiation. Ses premiers pas dans ses nouvelles fonctions confirment cette orientation, mais il faudra le soutenir, car il ne pourra réussir seul.
Enfin, le document présenté à la Commission européenne incite celle-ci à améliorer la qualité et l'efficacité de l'accueil en Europe – cela vous concerne directement. La France a apporté sa contribution, mais elle doit en faire plus ; surtout, davantage de pays européens doivent contribuer à l'effort. Tout ce que nous proposons dans le document – un dispositif plus efficace d'attribution du statut de réfugié, la promotion du regroupement familial et surtout la relocalisation à travers l'Europe de ceux auxquels l'asile a été accordé – se fonde sur l'idée de solidarité et de coopération entre les pays européens. La France fait partie de ceux qui y sont favorables, mais ces derniers sont minoritaires en Europe. On me dit que c'est une bataille perdue ; je ne le pense pas : nous devons continuer de promouvoir ce concept et les pratiques subséquentes.
J'ai parlé ce matin de la relocalisation au Président de la République. Si je ne me trompe, la France s'est engagée à relocaliser 24 000 personnes venues de Grèce et d'Italie ; on en est pour l'instant à 11 ou 12 % du total. L'intention est là, mais il faut accélérer le processus. Il en va de même d'un autre aspect qui fait partie des mesures permettant d'améliorer l'accueil : la réinstallation des réfugiés syriens du Liban, de Turquie, etc. La France s'est engagée à réinstaller environ 10 000 personnes avant la fin 2017 ; on en est à 3 000. Bref, des progrès ont été accomplis, mais il faut aller plus vite pour parvenir aux objectifs, dont le Président de la République m'a confirmé le maintien.
Je vous parle de la France parce que vous êtes des parlementaires français ; mais d'autres pays n'ont rien fait du tout ! Le discours sur la solidarité doit prendre corps. Malheureusement, le climat politique y est très défavorable, mais il ne faut pas renoncer à livrer cette importante bataille.
Vous le savez, en septembre dernier a eu lieu à New York, en marge de la session de l'Assemblée générale des Nations Unies, un sommet lors duquel les chefs d'État et de gouvernement ont approuvé une déclaration réitérant clairement leurs engagements collectifs envers les réfugiés. Certes, c'est une déclaration, mais elle est très importante : pour la première fois depuis des décennies, le concept de responsabilité partagée dans la gestion des crises des réfugiés est discuté et approuvé par la communauté internationale à l'unanimité. Cette avancée doit maintenant se traduire en gestes concrets.
La déclaration de New York charge le HCR de développer des modèles d'assistance ; nous y procédons, et nous présenterons nos résultats en 2018. Mais l'Europe doit donner l'exemple, car si elle n'est pas capable d'être solidaire, de répartir entre pays européens la responsabilité des arrivants, il sera très difficile de convaincre des États disposant de moindres ressources de se charger de cette responsabilité. On le constate déjà.

Merci beaucoup, monsieur le Haut-Commissaire, de cet exposé à la fois exhaustif et précis. Vous êtes manifestement au moins aussi déterminé que l'était votre prédécesseur António Guterres, dont nous sommes heureux qu'il ait été désigné Secrétaire général des Nations Unies : vous allez former une équipe formidable pour traiter de ce dossier très difficile.

Monsieur le Haut-Commissaire, j'aimerais vous interroger sur les femmes migrantes. On a longtemps considéré qu'elles accompagnaient des hommes ou relevaient du regroupement familial, mais l'on s'aperçoit que nombre d'entre elles migrent seules. Elles subissent pendant leur voyage de multiples violences : viols, abus sexuels, prostitution et traite humaine. Or le problème des violences de genre est très peu pris en considération lors de leur accueil. Que fait le HCR pour y remédier ? L'article 1A(2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés permet de considérer que les femmes forment un groupe social, mais la France refuse cette interprétation, ce que je regrette : très souvent, elle repousse les demandes d'asile pour persécutions ou violences sexuelles, contrairement à d'autres pays comme l'Australie ou le Canada. Le HCR souhaite-t-il améliorer l'accueil réservé à ces femmes tout au long de leur périple, et non seulement à l'arrivée ? La nécessité de prendre en considération les notions de genre et de violences de genre fait-elle l'objet d'un consensus ?

Monsieur le Haut-Commissaire, je vous félicite de tout ce que vous faites. Il faut saluer la compétence du HCR, toujours sur le qui-vive.
Néanmoins, je m'interroge. Il existe différents types de migrations, dont certaines résultent de la déstabilisation de pays du Sud par des conflits locaux. Mais je suis frappé de ce qui se passe au sud de l'Italie, en direction de la Libye : je m'interroge sur la manière dont nous recueillons quotidiennement en mer des gens qui ont été jetés sur des barcasses par les passeurs et les mafias. Il va falloir cesser ce petit jeu, car il crée un appel d'air. Je ne remets absolument pas en cause la légitimité du secours, mais nous devrions changer de politique pour casser cette dynamique sans fin que les pays européens, par humanisme, contribuent aujourd'hui à alimenter.
La presse britannique vient de se faire l'écho de ce qui se passe dans le camp de Grande-Synthe, près de Dunkerque : immédiatement après que la « jungle » a été démantelée, un autre camp s'est recréé juste à côté ; les conditions d'hygiène y sont épouvantables et des mafias y sévissent. Nous, Français, n'avons pas à en être fiers ! La BBC en a fait des gorges chaudes.
Comment tempérer le phénomène – il n'est pas question de le stopper : nous n'en sommes qu'au début – et éviter de créer un appel dans les pays concernés ?

Je m'associe aux félicitations qui vous ont été adressées.
Vous avez essentiellement évoqué les répercussions des crises en Irak et en Syrie, ainsi que l'Afrique. Est-ce à dire qu'en Asie, et peut-être, dans une moindre mesure, en Amérique du Sud, les flux de réfugiés et de déplacés se tarissent ?
Ma seconde question est plus politique : que pensez-vous des annonces faites par le président élu des États-Unis, dont on ne peut pas dire qu'il se montre très généreux s'agissant des questions qui nous occupent ?

Je félicite le HCR pour le travail qu'il accomplit avec sérieux et efficacité – je l'ai constaté lorsque j'ai eu l'honneur de présider la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe – et je vous remercie, monsieur Grandi, de vous être exprimé dans notre langue.
Pouvez-vous nous dire si le HCR est impliqué dans l'accord « clandestins contre réfugiés » qui a été conclu entre l'Union européenne et la Turquie ? Si tel est le cas, pouvez-vous nous dire si des moyens permettent de détecter d'éventuels terroristes infiltrés parmi les réfugiés ?
Il faut bien sûr, comme le prescrit le droit humanitaire, sauver tous ceux que l'on peut quand des hommes sont à la mer. Mais, ce faisant, n'est-on pas pris dans une sorte de « cercle vertueux vicieux », ceux qui ont été sauvés ne sortant plus d'Europe ? Que pensez-vous de l'idée parfois émise de créer des camps de réfugiés hors des frontières européennes ?
Enfin, quelles sont les contributions du Qatar, de l'Arabie saoudite et du Koweït au budget du HCR, et quelle est leur participation à l'accueil des réfugiés ?

L'accord entre l'Union européenne et la Turquie a eu pour effet que le flux d'arrivée de migrants en Europe a beaucoup diminué, mais bien peu nombreux ont été les retours vers la Turquie. Quelle appréciation portez-vous sur cet accord ? Selon vous, la Turquie joue-t-elle le jeu ?

Vous décrivez des situations effroyables. J'ai été intéressé par votre invitation faite à l'Union européenne de s'engager dans une démarche stratégique par un dialogue plus fructueux avec la Banque mondiale, en vue de financer le développement des zones en crise. Quel est, selon vous, le « seuil de tolérance » des pays voisins des États en crise ? Sont-ils prêts à envisager des actions de cette sorte ? Les réfugiés peuvent-ils être eux-mêmes acteurs du développement dont ils ont été privés dans des zones proches ? Penser des politiques de développement, dont les pays bailleurs de fonds sont souvent le carburant, dans des pays souverains accueillant de nombreux réfugiés provenant de pays voisins vous semble-t-il vraiment être la solution stratégique adéquate ?

Je joins mes éloges à ceux qui vous ont été adressés, monsieur le Haut-Commissaire ; ils sont d'autant plus vifs que l'accueil des réfugiés n'est pas très à la mode ces temps-ci. Je suis surpris par le manque général d'anticipation des mouvements de population, mouvements que l'on semble découvrir au moment où ils se produisent. Ainsi, des « déplacés climatiques » et des « déplacés démographiques » sont déjà en route en Afrique, mais on les découvrira quand ces flux poseront problème… La prise de conscience de ces mouvements d'ampleur affleure-t-elle chez les responsables politiques qui sont vos interlocuteurs et au sein du HCR ?

Redoutez-vous que le nouveau président des États-Unis remette en cause la considérable contribution de son pays au budget du Haut-Commissariat ? Envisagez-vous, avec le nouveau Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, de réformer le HCR ? Quelle est la situation à Alep, à Mossoul et en Jordanie ? Il se dit que le gouvernement kenyan menace de fermer un camp où sont regroupés quelque 350 000 réfugiés ; est-ce exact ? Toutes ces questions disent le grand intérêt que nous portons au Haut-Commissariat – il est heureux qu'il existe !
L'Asie et l'Amérique connaissent encore des crises, mais d'un niveau bien moindre qu'au cours des années 1970 et 1980. Au Myanmar, la situation est complexe : des progrès ont eu lieu sur le plan général mais le sort de la minorité musulmane, les Rohingyas, se détériore. Nous pensons tous – c'est aussi le sentiment exprimé par M. Jean-Marc Ayrault ce matin – qu'il faut donner un peu de temps à Aung San Suu Kyi. D'autre part, en Afghanistan, la crise héritée de la guerre froide demeure irrésolue. Ces deux pays mis à part, les problèmes ne sont plus aussi graves qu'ils l'ont été en Asie, et c'est tout aussi vrai pour l'Amérique latine. Certes, cette région du monde est toujours le théâtre d'importants mouvements de population et, en Amérique centrale, la criminalité est croissante, des bandes se comportant comme de « mauvais États », contrôlant des territoires dont ils terrorisent la population et provoquant des exodes, mais à une échelle plus faible qu'il y a quarante ans. La démocratisation, la résolution de conflits et le progrès économique ont radicalement modifié la situation. Il est bon de rappeler par ces exemples que le développement et la paix ont un effet majeur sur les mouvements de population : c'est dire, aussi, qu'ils ne sont pas nécessairement sans fin et que l'on peut trouver des solutions aux situations qui sont à l'origine des flux de réfugiés.
Vous avez souligné vous-mêmes la complexité du problème des sauvetages en mer. Quand les migrants sont à l'eau, il est trop tard pour s'interroger.
Les ramener où, monsieur le député ? La Libye est un pays dangereux, bien trop dangereux pour que nous puissions même y travailler. Comment imaginer conclure des accords avec un pays démantelé, où l'État est défait, sans autorité centrale, fragmenté et sous le contrôle de bandes criminelles armées ? Si la Libye était un État stable et solide, on pourrait tenir un autre discours, mais ce n'est pas le cas. À cela s'ajoute que très peu de pays tiers seraient disposés à accepter la création sur leur territoire de camps dans lesquels on agrégerait les gens pour les trier. Sans parler des questions éthiques, une solution de ce type serait d'application très difficile : elle accroîtrait la présence de migrants dans des pays qui, ne disposant que de très faibles ressources, dépendraient entièrement de l'aide des pays européens et d'autres pour soutenir une population déstabilisante. Il a été question de faire jouer ce rôle à la Tunisie mais je ne pense pas que ce pays compte prendre cette direction.
Plutôt que d'imaginer aller dans cette voie, il me semble plus constructif de faire ce que nous avons proposé : d'une part, adopter une vision plus stratégique de l'aide pour prévenir la formation des flux de population ; d'autre part, dans les pays voisins des zones de crise et qui hébergent la plupart des réfugiés avant que ceux-ci ne choisissent d'aller plus loin, investir dans le potentiel que représentent ces réfugiés, avec une enveloppe bien supérieure à ce qu'elle est actuellement et de manière beaucoup plus réfléchie. Un exemple vous éclairera : pendant cinq ans, aucun investissement n'a été fait visant à l'éducation et à l'emploi des Syriens réfugiés en Jordanie et au Liban, ni au soutien de ces pays fragiles et sans ressources – ceux-là mêmes d'où provenaient les premiers réfugiés arrivés en Europe.
La leçon, au moins pour cette région, a été apprise, puisque lors de la conférence de Londres consacrée à la Syrie, les pays donateurs ont décidé d'allouer entre 11 et 12 milliards de dollars à ces secteurs – et l'on commence à voir des résultats positifs : les flux se stabilisent. Bien sûr, tout n'est pas résolu. La Jordanie continue de se plaindre que le poids qui pèse sur elle est insupportable et le Liban reste un pays très fragile mais, au moins, un nombre croissant d'enfants réfugiés commence à aller à l'école. Aurait-on entrepris cette démarche dès le début de la crise et non après cinq années de guerre que, j'en suis sûr, on aurait évité pour une grande part la crise qui a affecté l'Europe en 2015, car ceux qui ont ouvert la voie à tous les autres ont été les Syriens. Les investissements de ce type seront le futur de l'assistance humanitaire aux réfugiés ; il faudra toujours donner des vivres et des médicaments et protéger les personnes, ce qui est notre spécialité, mais les très importantes ressources nécessaires pour stabiliser les flux de population ne peuvent venir que d'autres institutions. La Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la Banque islamique de développement manifestent un intérêt croissant pour cette approche ; c'est moins le cas dans les institutions d'aide au développement de l'Union européenne. Leur intérêt reste théorique, si bien que des mécanismes automatiques persistent et que les aides sont dispersées au lieu d'être ciblées selon les modalités que j'ai décrites. Elles n'ont pourtant rien d'utopique : le président de la Banque mondiale, qui a très bien compris notre démarche, encourage ses services à aller dans cette direction. À l'échelle humanitaire, qui est relativement limitée, le projet de fonds, initialement doté de 2 milliards de dollars destinés à quinze pays, que nous sommes en train de discuter avec la Banque mondiale, n'est pas indifférent. Outre cela, un autre fonds, de 14 milliards de dollars celui-là, est prévu pour les pays d'accueil fragiles. Ces sommes ne suffiront pas à stabiliser les flux de réfugiés mais elles y contribueront certainement.
Il faut aussi mieux organiser l'accueil de ces personnes. Au plus fort de l'arrivée des réfugiés en Grèce, on a constaté qu'en termes de sécurité les contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne ne sont pas adéquats. Nous demandons depuis longtemps la création d'un système unifié d'enregistrement et de filtrage, mais, bien que les possibilités technologiques le permettent aisément et que l'Union soit en mesure de le faire, cet effort collectif n'a pas lieu. Or conjuguer des investissements ciblés pour réduire les mouvements de population à un mécanisme de filtrage plus efficace rendrait le phénomène gérable, même s'il se poursuit.
J'ai évoqué devant vous l'importance de l'exemple européen dans l'expression de la solidarité à l'égard des réfugiés. On le voit avec le Kenya, au sujet duquel vous m'avez interrogé. Ce pays héberge depuis des décennies des centaines de milliers de réfugiés somaliens, dont la plupart sont regroupés dans le camp de Dadaab, situé à la frontière avec la Somalie ; il a abrité jusqu'à 400 000 personnes. Mon prédécesseur a dû faire face à l'irritation du gouvernement kenyan, qui a plusieurs fois fait valoir que cette situation était insupportable pour son pays et qu'il entendait renvoyer tout le monde en Somalie. Nous avons toujours réussi à négocier des solutions temporaires, mais cela devient de plus en plus difficile parce que le président kenyan constate que l'Europe refuse d'accueillir des réfugiés en dépit de la disparité patente de ressources entre l'Union européenne et le Kenya – qui va s'aggravant car les donateurs se font plus chiches au Kenya. Je me suis rendu trois fois à Nairobi l'an dernier. Nous avons, une fois de plus, négocié un mécanisme qui permet, en les soutenant, de renvoyer en Somalie les personnes qui le souhaitent, et nous avons considérablement réduit la dimension du camp. Mais il faut aussi investir en Somalie. Je conviens que ce n'est pas facile mais la Banque mondiale a accepté de le faire avec des moyens hétérodoxes, et nous nous sommes portés volontaires pour canaliser des ressources à cette fin. Il faut trouver des solutions créatives pour prévenir d'autres flux de population, car il n'est pas impossible pour des réfugiés somaliens au Kenya de traverser le désert et d'embarquer, au Nord de l'Afrique, sur des canots à destination des côtes européennes ; cela se produit déjà. C'est un exemple supplémentaire de la nécessité d'investissements très importants.
Nous avons écouté avec attention et non sans une certaine préoccupation les déclarations du président américain élu. Les États-Unis financent presque 40 % de notre budget, ce qui a représenté 1,5 milliards de dollars en 2016. Je ne pense pas que la nouvelle administration, aussi complexes que soient ses relations avec l'Organisation des Nations Unies, ciblera cette contribution particulière car l'efficacité du travail du HCR a toujours été appréciée des présidences américaines successives, de toutes couleurs politiques, et devrait continuer de l'être. En revanche, les finances du Haut-Commissariat pourraient être touchées indirectement par des coupes claires dans l'aide extérieure en général ; j'espère que ce ne sera pas le cas. Nous défendrons notre cause, car si les États-Unis diminuaient de 20 % ou 30 % leur contribution à notre budget, nous serions évidemment conduits à mettre fin à certains de nos programmes d'aides aux réfugiés, ce qui aggraverait immanquablement la déstabilisation de bien des zones du globe.
L'autre programme menacé est celui des réinstallations de réfugiés aux États-Unis. Le président Obama avait approuvé, en 2016, un plafond sans précédent de réinstallation de 110 000 réfugiés chaque année, en provenance notamment du Liban et du Kenya. Ce programme est particulièrement utile aux femmes qui ont subi des violences sexuelles : elles bénéficient en priorité de la réinstallation aux États-Unis. Si, comme il a été dit au cours de la campagne de M. Trump, le nombre de réinstallations autorisées est réduit, les personnes qui en souffriront seront donc les plus vulnérables ; nous avons commencé d'expliquer les conséquences qu'aurait une telle évolution. Nous craignons aussi une réduction ciblée des réinstallations, visant certaines religions ou nationalités ; ce serait un signal politique très dangereux. Nous avons entrepris de l'expliquer aux nouveaux élus au Congrès qui assistent à des sessions de formation ; le fait que nous ayons été conviés à y participer est positif en soi. Au fil des décennies, le HCR a dialogué avec des présidences américaines très différentes ; celle qui s'annonce pourrait présenter des caractéristiques nouvelles et nous attendons d'y voir plus clair.
Nous faisons beaucoup pour les femmes réfugiées, surtout lorsqu'elles voyagent seules ou accompagnées d'enfants, ce qui les rend particulièrement vulnérables. Nous essayons bien sûr de mobiliser les réseaux sociaux dans les pays où elles se trouvent et nous insistons sur l'importance du regroupement familial là où il est possible, en essayant qu'il s'applique à elles en priorité. Je sais la polémique, très commune en Europe, au sujet du regroupement familial. L'exemple d'un groupe de femmes syriennes réfugiées que j'ai rencontrées à Istanbul devrait pourtant frapper les esprits : une partie d'entre elles voulaient rejoindre leur mari ou leurs fils en Europe, mais ce regroupement leur a été refusé. Cela les a contraintes à rester dans une grande ville où la plupart ont immédiatement été enrôlées de force dans des réseaux de prostitution ; leur aurait-on permis de rejoindre le reste de leur famille que ce destin leur aurait été évité. Nous insistons donc sur l'importance du regroupement familial et sur la nécessité que bénéficient en priorité des programmes de réinstallation les femmes qui ont subi des violences. C'est déjà le cas aux États-Unis et au Canada, qui sont les principaux pays de réinstallation ; nous essayons de parvenir à ce que cela soit généralisé, avec des résultats pour l'instant limités, mais nous avançons. J'ajoute que beaucoup de migrantes économiques subissent les mêmes violences que les réfugiées. Une approche commune est donc nécessaire pour tous ces groupes vulnérables, même s'ils sont juridiquement distincts ; les mesures qui s'appliquent aux unes devraient s'appliquer aux autres. Ces catégories de population vulnérables sont l'objet d'une attention spécifique, de nombreuses initiatives sont prises pour leur venir en aide et certains pays nous allouent des ressources qui leur sont exclusivement destinées – c'est le cas des États-Unis, et nous espérons que cela continuera.
Les pays du Golfe ne sont ni nos donateurs principaux ni des donateurs insignifiants. Leur aide peut être extrêmement importante – ainsi, l'aide reçue du Koweït pendant la crise syrienne s'est élevée à des dizaines de millions de dollars pendant plusieurs années – mais, n'étant pas régie par les critères qui règlent l'assistance humanitaire dans les pays occidentaux, elle a pour inconvénient d'être imprévisible. Ces contributions résultant des souhaits ponctuels des membres des familles princières régnantes, nous recevons parfois des subventions inattendues considérables alors qu'il nous faut d'autres fois réclamer sans relâche des versements programmés qui ne se matérialisent jamais… Nous cherchons à régulariser ces fluctuations et nous commençons d'y parvenir. Nous commençons aussi à obtenir des résultats pour l'accueil de réfugiés ; les Émirats, notamment, se sont dits prêts à accueillir 15 000 réfugiés syriens au cours des années à venir.
Les villes jumelles d'Alep et de Mossoul partagent maintenant un destin tragique. Quelque 120 000 personnes, je vous l'ai dit, ont fui Mossoul. C'est moins que ce à quoi nous nous attendions car le gouvernement irakien et les forces kurdes ont conduit l'offensive en collaboration avec la coalition de manière beaucoup plus « correcte » que lors d'offensives précédentes, pendant lesquelles les milices chiites avaient le champ libre pour se livrer aux pires exactions. Cela a évité un exode majeur à ce jour mais, outre que l'on ne sait si Daech retient des gens à Mossoul, la guerre n'est pas terminée.
Nous ne sommes pas partie à l'accord conclu entre l'Union européenne et la Turquie mais nous avons conseillé les deux parties afin que le texte respecte le droit des réfugiés. Nos préoccupations portent surtout sur l'accès aux réfugiés en Turquie. Ce pays, qui en héberge beaucoup, les a plutôt bien traités, mais la gestion de l'accueil n'y est pas parfaite. Quant à dire que tout le monde peut rentrer en Turquie parce c'est un pays « sûr »… nous avons quelques doutes à ce sujet, et notre accès aux éventuels rapatriés en Turquie n'est pas suffisant pour dire que les rapatriements peuvent avoir lieu sans souci. C'est pourquoi le nombre de retours a été très faible. Les services grecs de l'asile, qui éprouvent les mêmes préoccupations que nous, hésitent à trancher en faveur des retours, sauf dans quelques cas.
Heureusement, les nouvelles arrivées ne sont pas très nombreuses, mais si le flux reprenait, des problèmes se poseraient à nouveau faute que l'accueil des réfugiés ait été amélioré.

Je vous remercie, monsieur le Haut-Commissaire, pour la précision de vos réponses et leur exhaustivité.
La séance est levée à dix huit heures.