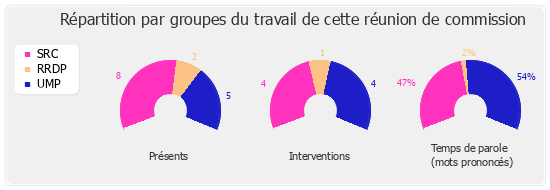Commission des affaires étrangères
Réunion du 3 avril 2013 à 16h30
La réunion
Audition de M. Didier Le Bret, directeur du centre de crise du ministère des affaires étrangères
La séance est ouverte à seize heures trente.

Nous recevons aujourd'hui M. Didier Le Bret, directeur du centre de crise du ministère des affaires étrangères, qui a exercé de nombreuses fonctions auparavant, notamment celle d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Haïti de 2009 à 2013.
Monsieur le directeur, je vous remercie pour votre disponibilité et vous prie d'excuser la présidente de la Commission, Mme Élisabeth Guigou, qui accompagne le Président de la République dans son voyage officiel au Maroc.
Votre audition doit vous permettre de présenter la cellule de crise dont vous avez la charge. Je précise tout de suite qu'il est déjà convenu d'organiser une visite de vos installations à une date qui reste à déterminer.
Vous avez une lourde responsabilité puisque votre centre a pour mission de veiller à la sécurité des Français à l'étranger, soit les quelque 1,5 à 2 millions de Français résidant à l'extérieur de nos frontières et les 14 millions qui s'y rendent en moyenne chaque année pour des raisons touristiques ou professionnelles. Votre centre est également responsable de la gestion des crises humanitaires.
Naturellement, nous serons particulièrement intéressés par l'impact de la crise malienne sur la sécurité de nos ressortissants, qui sont 35 000 dans la seule zone des pays riverains du Sahel.
Je vous remercie de votre invitation.
Le centre de crise que je dirige est l'enfant du Livre blanc de 2007, qui avait constaté que le coeur de métier du Quai d'Orsay que constitue la protection de nos compatriotes partout dans le monde faisait l'objet d'un traitement atomisé au sein du ministère, et suggéré de rassembler les morceaux épars du « puzzle » et de professionnaliser ce métier.
La réforme engagée à partir de 2008 a permis de réunir trois compétences : celle du secrétariat d'État à l'action humanitaire, devenu un service dédié à cette action et intervenant à la demande de pays victimes de catastrophes naturelles ou politiques ; celle de la direction des Français de l'étranger – qui existe toujours – touchant au suivi des dossiers individuels ; et celle de la cellule de crise chargée d'intervenir en appui de nos ambassades au moment où un événement pouvait mettre en danger la sécurité de nos compatriotes.
Au sein du centre de crise, le centre de situation constitue la tour de contrôle permettant d'avoir une vision globale de l'ensemble des pays, qu'il s'agisse de notre perception de la menace, de ses caractéristiques ou de sa localisation cartographique. Il donne aussi des informations à nos compatriotes partant à l'étranger, sachant que le flux annuel de ceux-ci a pratiquement doublé au cours des dix dernières années et que le nombre de Français expatriés s'est aussi considérablement accru, dépassant nettement le chiffre officiel de 1,5 à 2 millions que vous rappeliez.
Le deuxième pôle de notre action est constitué par le centre d'opération d'urgence, qui comporte deux branches. La première traite des affaires individuelles, qui sont souvent les plus sensibles et médiatisées – disparitions inquiétantes, morts subites ou otages. La seconde est consacrée aux réactions aux crises : elle me permet de dépêcher, en appui de nos ambassades, des personnes travaillant dans mon service ou faisant partie d'un « vivier » d'agents formés toute l'année. J'ai ainsi récemment envoyé en Centrafrique un petit groupe à cet effet.
Enfin, le troisième pôle de notre activité repose sur l'action humanitaire, qui permet, dans la limite des moyens disponibles, de mettre un certain nombre d'outils à la disposition des pays qui en font la demande. J'en ai été largement bénéficiaire dans mes fonctions d'ambassadeur à Haïti et ai pu mesurer à l'époque leur efficacité en termes de déploiement et de réactivité.
Pour que le centre de crise fonctionne, il faut qu'il soit ouvert aux autres acteurs de l'action d'urgence, à commencer par le ministère de la défense – nous sommes ainsi obligés de travailler en étroite liaison avec le centre de planification et de conduite des opérations (CPCO), nos plans d'évacuation pouvant parfois se confondre avec les plans d'évacuation militaire. De même, nous coopérons étroitement, pour la protection civile, avec le centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) du ministère de l'intérieur.
Mon ambition à terme est de poursuivre cette logique de façon plus institutionnelle, en ayant au centre de crise des agents de liaison pour chaque ministère.
Plusieurs réformes sont en cours.
La première concerne les fiches conseils aux voyageurs, qui constituent le seul service du Quai d'Orsay ayant obtenu une certification ISO 9001 – laquelle garantit les informations que nous rendons accessibles sur le site diplomatie. gouv. fr sur notre perception du risque dans le monde à l'appui d'une carte et d'un commentaire. 6,5 millions de visiteurs le consultent chaque année, dont 87 % se disent satisfaits.
Mais nous sommes victimes de notre succès, car cet instrument est un peu devenu un étalon à plusieurs usages : la Coface s'en sert par exemple pour savoir si elle va prendre en garantie tel ou tel projet et les assureurs pour graduer le montant des primes. Il est de ce fait surexposé et souvent considéré par les chefs d'État de pays avec lesquels nous avons des relations comme un instrument de mesure de la qualité de la relation bilatérale, ce qui suscite des pressions très fortes.
Ainsi, au lendemain de la prise d'otage de nos compatriotes au nord du Cameroun, nous avons été amenés à revoir notre appréciation sur le Bénin, ce qui a provoqué l'irritation du président Boni Yayi.
J'ai donc suggéré au ministre d'avoir une cartographie des menaces plus fine afin d'éviter le choix entre la zone jaune, où il n'y a pas de risque déterminé, et la zone orange, déconseillée sauf raison impérative. On voit l'impact qu'un tel choix peut avoir sur certains pays dont la sécurité est liée au développement, lui-même tributaire de leur capacité à attirer les flux touristiques.
Nous avons proposé de substituer aux trois couleurs existantes – jaune, orange, rouge – un code météo en quatre couleurs : le vert, pour les zones où le danger est maîtrisé ; le jaune, pour celles impliquant une posture de vigilance renforcée, mais où les flux touristiques ne doivent pas être empêchés ; l'orange, pour les zones déconseillées ; et le rouge pour celles qui le sont formellement et où il ne faut pas aller. Cela va nous aider à sortir de la « seringue » dans laquelle on s'est retrouvé – où soit on ne dit rien, soit on dit quelque chose et le pays concerné se retrouve d'emblée dans la liste noire – sans qu'il soit d'ailleurs aisé ensuite de l'en faire sortir.
Or nos ambassadeurs ont tendance à s'autocensurer pour atteindre leurs objectifs d'excellence dans la relation avec le pays où ils se trouvent. Il faut que le nouvel instrument proposé soit flexible de manière à éviter cette autocensure et qu'il reflète l'état réel de la menace.
La deuxième réforme a trait à Ariane, autre outil développé il y a trois ans, qui devrait être le principal, même s'il continue à ne concerner que 50 000 usagers sur les 14 millions de compatriotes voyageant chaque année. Nous avons inventé à ce sujet un nouveau slogan dans le cadre d'une campagne de publicité prévue pour cet été : « Pour votre sécurité, soyez connecté ». En effet, cet instrument n'est pas très ergonomique et ne fonctionne pas bien avec les smartphones : je vais donc le simplifier, de manière à ce que l'usager puisse être connecté tout de suite après trois ou quatre questions portant sur des informations de base : qui êtes-vous ? Où allez-vous ? Quelle est votre adresse et qui contacter le cas échéant ? Ainsi, en cas de crise dans un pays, on saura à peu près le nombre de touristes français qui s'y trouvent.
Mais pour que cet outil soit attractif, il faut aussi qu'il rende un service à l'usager : nous allons donc faire en sorte que dès que celui-ci sera inscrit, il ait une information. Si c'est un pays à risque, on lui communiquera les quelques risques identifiés ainsi que quelques coordonnées utiles en cas de problème. Par ailleurs, nous allons passer un contrat avec la mutuelle du Quai d'Orsay, qui a un réseau de 250 médecins dans le monde : ceux-ci nous donneront une liste objective actualisée d'établissements hospitaliers ou de cliniques privées.
Mon objectif pour fin 2013 est de passer de 50 000 à 500 000, voire un million d'utilisateurs.
Troisièmement, je suis en train de mettre en place un système de missions de terrain. Nous avons identifié une vingtaine de pays susceptibles d'être à risque. Il y a trois mois, par exemple, j'ai envoyé une équipe en Centrafrique, avant que la crise n'éclate, pour aider notre ambassadeur sur place à se préparer en cas de coup dur. Même si on n'a pu éviter les critiques – les Français estimant qu'ils ne sont jamais assez couverts –, il n'y a eu aucun mort ni aucun blessé. Mon objectif est d'avoir pu envoyer mes équipes dans l'ensemble de ces pays dans les deux ans qui viennent pour aider les postes à préparer leur réponse sécuritaire et vérifier la viabilité et la solidité de leur dispositif, les points de regroupement, ainsi que leur capacité à se transformer en centre de crise.
La quatrième réforme porte sur les entreprises, qui réclament un véritable partenariat avec l'État. Un gros travail a été fait dans le passé pour essayer de collaborer plus étroitement avec elles. Il ne s'agit pas naturellement qu'elles se défaussent : il existe, depuis l'attentat de Karachi, une jurisprudence constante sur leur responsabilité première concernant la sécurité de leurs employés. Nous souhaitons les aider à élaborer les meilleures réponses en la matière de manière qu'en cas de crise, tout se passe de façon coordonnée et harmonieuse.
Elles évoquent ainsi toujours la question des personnels qui ne sont pas de nationalité française : les difficultés, en cas d'évacuation, à les faire monter à bord des avions ou à obtenir les laissez-passer consulaires. Or, rien n'empêche, en amont d'une crise, de passer un accord avec les consulats pour qu'ils puissent avoir des visas de circulation.
Nous avons aussi signé des conventions avec le Club des directeurs de sécurité des entreprises (CDSE), le Centre inter-entreprises de l'expatriation (CINDEX) et le club de Magellan, qui fédèrent les directions de sûreté et sécurité des grandes entreprises et des PME.
Le cinquième chantier en cours concerne les collectivités territoriales. Il a été lancé par la réunion organisée à Lyon par les ministres Laurent Fabius et Pascal Canfin pour enclencher l'action de coopération des collectivités locales françaises en réponse à la crise malienne, avec la création du Fonds d'action extérieure des collectivités locales (Faceco).
L'idée est de constituer un fonds dédié pour éviter l'effet – parfois difficile à gérer pour une petite ou moyenne ambassade – de la coopération par l'offre. Les collectivités pourront ainsi tirer des chèques sur ce fonds, siéger dans un comité de pilotage décidant des projets, et bénéficier d'un effet de mutualisation et de masse pour privilégier l'achat de biens sur place quand cela est possible et la définition d'une politique d'ensemble.
Le dernier chantier fait suite à un questionnaire adressé à notre réseau diplomatique, au lendemain de notre intervention du 11 janvier dernier au Mali, sur la perception qu'ont les ambassades de leur dispositif de sécurité par rapport à la menace nouvelle que suscite une intervention militaire dans un pays sensible – certains blogs islamistes ayant notamment expliqué que les croisés étaient de retour et qu'il fallait lutter contre la France par tous les moyens. 70 ambassadeurs, soit presque la moitié d'entre eux, ont considéré qu'ils avaient à un titre ou un autre de bonnes raisons de renforcer leur dispositif sécuritaire.
Cela m'a conduit, à la demande du ministre des affaires étrangères, à proposer au directeur général de l'administration de réaliser un audit transversal de l'ensemble des directions concourant à la sécurité de nos compatriotes, qu'il s'agisse de la direction générale de l'administration, de la direction des ressources humaines, de la direction de la sécurité – qui a fait de gros progrès sur la sécurité des emprises –, mais aussi de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) – le réseau des établissements scolaires étant très sensible – ou des alliances et instituts français, qui sont encore plus ouverts.
Je ne réponds chaque année qu'à 40 % des besoins exprimés par nos ambassadeurs dans ce domaine. Le coût d'une réponse à tous ces besoins sera prochainement présenté au ministre des affaires étrangères, qui, je l'espère, trouvera auprès du Parlement un allié de poids pour faire en sorte que le budget de sécurité puisse être préservé.

Merci pour cette présentation pragmatique, qui ouvre des perspectives planifiées.
J'ai toujours été surpris par les conseils donnés aux voyageurs : chaque fois que je vais en Inde, je me dis que, au regard des informations dissuasives qui sont diffusées sur ce pays, si je ne le connaissais pas, je n'irais pas. L'appréciation portée par le centre de crise, qui s'apparente en l'espèce à une agence de notation du risque, est très relative, sachant que la situation peut vite évoluer dans certains pays.
Elle est d'autant plus relative que, ce soir, pour l'anecdote, en me rendant sur une autre partie du territoire national, en Corse, je serai accueilli par deux agents armés du Service de protection des hautes personnalités (SPHP), qui vont m'accompagner jusqu'à mon bureau et mon domicile.

Je vous félicite, monsieur le directeur, pour la clarté de votre propos.
J'observe que le nord du Bénin vient d'être classé en zone rouge : est-ce justifié ? Si oui, d'autres pays voisins peuvent-ils faire l'objet du même traitement – ce qui serait assez déroutant pour les capitales de ces pays qui ne sont pas trop touchées par des menaces directes ?
S'agissant de nos entreprises qui, comme Areva, travaillent dans la zone sahélienne sous une véritable menace terroriste, quel est le niveau de sécurité optimal leur permettant d'assurer la protection de leur personnel ?

Merci, monsieur le directeur, pour les informations précieuses que vous nous avez communiquées. Elles nous montrent que ce centre de crise est indispensable et performant.
Cela dit, dans le rapport que nous avons réalisé il y a un an, Henri Plagnol et moi, sur la crise du Sahel, deux points ont suscité particulièrement l'attention : le souhait d'arrêter de payer des rançons en cas de prise d'otage et notre protestation, approuvée par la plupart de nos collègues, contre la facilité avec laquelle les services du Quai d'Orsay utilisent sans limite la stratégie que nous avons appelée du « grand parapluie », consistant à agrandir les zones classées en rouge ou en orange. Cette attitude est scandaleuse, car elle obère dans des proportions considérables le tourisme et l'économie dans les pays concernés. Elle est insupportable pour ceux qui connaissent notamment l'Afrique de l'Ouest.
Je ne pense pas que nos ambassadeurs s'autocensurent, en dehors de quelques exceptions, et ils connaissent mieux ce qui se passe dans leur pays que l'administration centrale !
La dernière fois que je suis allé au Burkina Faso, le président de ce pays s'est inquiété de ce que le Quai d'Orsay envisage de placer une grande partie de celui-ci en zone rouge : or je m'y balade de la même manière qu'à Paris ou à Rouen – peut-être même plus facilement que dans la banlieue parisienne. Allez-vous aller jusque-là ?
Je considère que placer ainsi toute une zone en rouge pour se couvrir relève d'une forme de lâcheté. Et j'espère que votre proposition de réforme va permettre d'améliorer la situation.

Merci, monsieur le directeur, pour votre exposé très instructif.
La création du centre de crise est une initiative intéressante, à l'actif de l'ancien ministre Bernard Kouchner. Mais le fait de mettre des zones entières en catégorie rouge ou orange peut en effet avoir des conséquences négatives. Il faut donc bien réfléchir avant de mettre en oeuvre votre réforme.
Ne devrait-on pas appréhender la question au travers de la situation des expatriés plutôt que de celle des touristes, la seconde découlant de l'appréciation que nous portons sur la première ? Au cours des dernières années, la plupart de nos otages à l'étranger ont en effet été des expatriés ou assimilés, en particulier des membres des ONG ou des journalistes – donc présents plus pour des raisons professionnelles que touristiques. Si les fiches conseils que vous réalisez sont très bien faites, une gradation des mesures de sécurité pourrait être retenue et on pourrait distinguer les pays où l'on peut venir en famille et ceux où on ne le peut pas.
Par ailleurs, quelle leçon tirez-vous de votre expérience à Haïti pendant la période de reconstruction ? Quelles sont les bonnes mesures et celles à éviter ?
Monsieur le président, tout site d'information obsolète ne présente plus d'intérêt : nous devons donc, au titre des critères prévus par nos procédures de certification, montrer notre capacité à délivrer une information aussi récente que possible. Nous faisons entre 1000 et 1400 changements de texte en moyenne chaque année sur environ 190 pays. Mais si notre information est actualisée, il faut enlever beaucoup de données inutiles, qui brouillent le message que nous voulons faire passer.
Monsieur Terrot, le nord du Bénin a été classé en orange – et non en rouge –, en raison de la porosité de la frontière avec le Nigéria, même si nous avions conscience que cela pouvait paraître injuste pour un pays où le risque ne s'était pour l'instant pas manifesté de façon évidente. Le nord du Nigéria est en fait un territoire camerounais : la région connaît des trafics en tout genre et nous avons appris que les prisons camerounaises détenaient des membres de Boko Haram – ce qui aurait dû nous conduire à placer la pointe la plus au nord du Cameroun en rouge.
Monsieur Loncle, je suis entièrement d'accord avec vous sur la stratégie du « grand parapluie », qui est une bêtise. En appliquant le principe de précaution à l'extrême et en surréagissant, on fait le jeu des terroristes, qui sanctuarisent ainsi des terrains d'intervention. Le code en quatre couleurs devrait nous permettre de sortir du manichéisme du tout ou rien que j'évoquais.
À cet égard, le fait que l'organisation du Paris-Dakar ait décidé en 2007, après quatre morts en Mauritanie et l'enlèvement de deux Français, qu'il n'était plus possible de traverser la Mauritanie et le Sénégal dans des conditions de sécurité, prouve que d'autres acteurs ont aussi une appréciation du risque.
Sur la question des rançons alimentant le terrorisme – qui lui-même met davantage en danger nos compatriotes – vous avez raison : le Président Hollande et le ministre des affaires étrangères ont d'ailleurs apporté une réponse claire.
La période actuelle, où 14 de nos compatriotes otages ont leur vie suspendue à un fil, n'est pas facile : les familles demandent une alternative – alors qu'on n'intervient pas, dans la mesure où les trois dernières interventions de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) ont été catastrophiques, et qu'on ne négocie pas avec les terroristes parce qu'on est en train de les combattre au Mali – ; elles se considèrent comme les dommages collatéraux d'une politique conduite dans l'intérêt général. Le simple fait qu'une ambassadrice écrive un livre pour expliquer que la France a payé des rançons, que ce soit vrai ou non, a laissé des marques.
Concernant le Burkina Faso, la tentation était grande de continuer à ouvrir le « parapluie » – nous avions reçu des menaces très directes. Nous avons dit à notre ambassadeur sur place : si vous obtenez des garanties de l'État burkinabé pour qu'il prenne très au sérieux ces menaces, nous sommes prêts à prendre le risque de ne pas le faire ; c'est ce qui a été accompli, et cela s'est bien passé. Il n'est pas d'actualité de placer ce pays en zone orange.
Monsieur Poniatowski, nous sommes conscients du risque d'induire en erreur nos compatriotes en changeant le code des couleurs : nous réaliserons donc cette réforme de façon progressive en essayant d'en expliquer le sens le mieux possible.
Je suis d'accord pour asseoir notre posture sécuritaire avant tout sur les expatriés, la plupart des otages étant en effet des professionnels. Certaines catégories de personnes ne peuvent pas éviter de prendre des risques : c'est le cas des journalistes et des entreprises. Nous continuons donc à prendre très au sérieux la menace sur Arlit, les informations provenant du nord du Niger étant mauvaises, et nous avons réussi à déployer nos forces spéciales sur place, sachant qu'on ne peut protéger tous les groupes industriels français.
Par ailleurs, nous avons des accords particuliers avec les grands groupes sensibles, ce qui nous amène à valider leurs plans de sécurité.
S'agissant d'Haïti, le principal enseignement que j'en retire est que, pour que le remède soit efficace, il faut intégrer en amont une dimension qu'on a toujours sous-estimée : la capacité d'absorption de l'aide et le fait de s'assurer qu'une grosse partie de celle-ci aille directement aux personnes en place.
De même, au Mali, il faut renforcer l'État dans ses composantes territoriales et régaliennes pour construire quelque chose de durable, et non déverser des tombereaux d'aides gérées par les organisations internationales.

Merci pour ces informations.
Pouvez-vous faire le point sur la situation inquiétante de la Centrafrique et ses perspectives d'évolution ?

Est-ce le rôle de l'État d'avoir une assurance tous risques pour des personnes partant dans le monde entier ? Ne peuvent-elles prendre des assurances privées à cet effet ?
Par ailleurs, à force de donner des informations sur l'état des risques, vous courez celui que certains se retournent contre l'État au motif qu'elles sont fausses ou dépassées. Je mets donc en garde contre cette conception de l'État « mère poule ».
Enfin, quand on voit certains journalistes, bien que dûment informés des risques qu'ils couraient, passer outre les recommandations et jouer ensuite les matamores en expliquant qu'on ne leur avait rien dit, on estime qu'il faut établir des sanctions et faire davantage jouer la responsabilité individuelle : on ne peut en permanence mettre en place des dispositifs difficiles, faisant courir des risques aux personnes chargées de les secourir. Certains journalistes sont allés au-delà de leur rôle et se sont conduits de façon irresponsable.

La plupart des crises ont une dimension multinationale : quel mode d'organisation international préconisez-vous à leur égard ? Qu'est-ce qui fonctionne plutôt bien et qu'est-ce qui reste à construire dans ce domaine ?

L'Union européenne a montré qu'une action coordonnée avec des relais de proximité est la réponse la plus efficace. Nous essayons depuis six mois d'agir ainsi au Mali avec les personnes ayant la plus forte légitimité, en leur donnant des moyens pour la reconstruction. Cela étant, je rappelle que le premier acte de l'Union européenne a été de s'orienter vers une ONG du Luxembourg sans partenariat avec les collectivités locales concernées.

Pourriez-vous nous confirmer que nos forces spéciales ont été évacuées de Benghazi sous la contrainte des salafistes ?

Le terme de crise recouvre des réalités très diverses. Avez-vous une méthodologie pour réagir en fonction de la nature de la crise et intervenir de manière soit bilatérale soit multilatérale ? Peut-on en avoir plus ou moins connaissance ?
Monsieur Charasse, ce qui s'est passé en Centrafrique était la chronique d'une mort annoncée. Ce pays est enclavé, compliqué et victime de multiples coups d'État, au point que les Centrafricains en viennent à regretter l'époque de Bokassa !
Aujourd'hui, la situation est dramatique car ce pays n'a pas beaucoup d'atouts. De plus, l'Union africaine a voulu se doter d'instruments de régulation et de sanction pour faire en sorte que la démocratie ne passe pas à côté de l'Afrique, et on a mis un cordon sanitaire autour du nouveau président autoproclamé. Déjà, quasiment tous les expatriés sont partis, les salaires des fonctionnaires et des militaires ne sont pas payés, et le pays connaîtra très vite un problème de pénurie alimentaire : ce cordon sanitaire devrait précipiter une deuxième vague de catastrophes et le président risque d'être à nouveau renversé. Il va donc falloir voir comment accompagner l'inévitable transition – on n'aura peut-être pas d'élections d'ici un an – et éviter de provoquer une nouvelle catastrophe. Je ne suis pas très optimiste sur l'avenir de ce pays.
Monsieur Myard, je suis d'accord avec vous : je suis tout à fait hostile à l'idée de déresponsabiliser les Français, mais Ariane est un outil permettant de compenser notre déficience actuelle sur l'appréciation du nombre de touristes, qui est une information importante pour calibrer les moyens de l'État en cas d'évacuation. Ce mécanisme n'est pas liberticide, mais fondé sur le volontariat.
Nous avons aussi un dispositif réglementaire – qui correspond à une réforme souhaitée par M. Bernard Kouchner –, obligeant les personnes prenant des risques inconsidérés à rembourser les frais engagés par l'État. Si, depuis trois mois que je suis en fonction, je n'ai pu obtenir de mes collaborateurs de me donner un exemple de son application, je vous garantis que dans les trois mois qui viennent, il sera activement mis en oeuvre. Je veux que nos compatriotes le sachent.
S'agissant des journalistes, je vous invite à lire le dernier livre d'Hervé Ghesquière, à qui on a reproché de mettre en danger l'opération en Afghanistan, de mobiliser des moyens et de prendre des risques inconsidérés : il y explique qu'il voulait tester une route censée être sécurisée par les Américains, alors qu'elle ne l'était pas…
Monsieur Marsac, en vertu du traité de Lisbonne, les pays de l'Union européenne doivent une entraide aux autres États membres là où ils ne sont pas représentés. Or, dans 18 pays en crise sur 34, nous sommes État pilote. J'ai à cet égard lancé deux initiatives à Bruxelles : la renégociation du concept d'État pilote – il n'y a pas de raison que la France le soit dans un pays sur deux – et le paiement du service rendu – lorsque par exemple nous assurons la sécurité des Espagnols, des Italiens ou des Estoniens.
Nous avons ainsi négocié un accord avec les Américains à Bangui, où ils nous ont confié leurs intérêts : en cas d'évacuation, l'indemnité qu'ils nous verseraient couvrirait largement nos frais. Pourquoi ne pas passer un accord de ce type avec l'ensemble de nos partenaires européens ?
Monsieur Chauveau, si l'on ne s'appuie pas sur des structures régaliennes que l'on contribue à renforcer, on prend en effet tous les risques.
Monsieur Marsaud, à Benghazi, les agents du dispositif chargé de la protection étaient menacés : nous les avons donc rapatriés.
Monsieur Dufau, nous avons à l'égard des crises un éventail de réponse gradué. Face à une crise mineure, j'appelle l'ambassadeur sur place et, en fonction de ce qu'il me dit, je réunis un premier groupe de personnes – en semaine, nous disposons d'un format interministériel – pour voir les premières mesures à prendre. Ce peut être l'envoi d'un SMS d'alerte via l'ambassade ou le centre de crise à l'ensemble de nos compatriotes sur place. Au-delà, on peut fermer le lycée français pendant quelques jours, prendre des mesures de confinement, voire de sécurisation de l'aéroport, comme nous l'avons fait à Bangui, avec l'accord des autorités centrafricaines, pour permettre de dépêcher des renforts. On peut aussi faire venir des forces directement de Paris, donner la consigne de regrouper l'ensemble des Français en vue d'une éventuelle évacuation, voire, dernier cran de réponse possible, envoyer les moyens pour évacuer toute la communauté française en cas de risque vital.
Si nous n'avons pas d'accord cadre avec Air France, nous dialoguons avec cette compagnie au cas par cas. Par exemple, je vais attirer l'attention de son responsable de la sûreté, qui envisage de fermer le seul vol hebdomadaire avec Bangui, sur le signal que provoquerait une telle mesure.
Je rappelle que quand, dans un pays faible, la France ordonne l'évacuation de ses ressortissants, le chaos s'installe rapidement. C'est la raison pour laquelle nous essayons d'éviter autant que possible d'en venir à cette extrémité.
S'agissant des catastrophes naturelles, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH), qui est le bras armé humanitaire des Nations unies, dépêche un groupe faisant l'évaluation du risque dès qu'il y a une crise humanitaire majeure. Puis il lance un « appel consolidé » précisant le montant des moyens nécessaires.
La séance est levée à dix-sept heures cinquante.