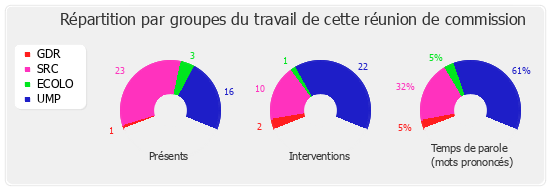Commission des affaires sociales
Réunion du 2 octobre 2012 à 16h15
La réunion
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Mardi 2 octobre 2012
La séance est ouverte à seize heures quinze.
(Présidence de Mme Catherine Lemorton, présidente de la Commission)
La Commission entend M. Jean-Claude Ameisen, médecin et chercheur, dont la désignation à la présidence du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) est envisagée par le Président de la République (application de l'article 13 de la Constitution).

Nous accueillons cet après-midi M. Jean-Claude Ameisen, qui est pressenti par le Président de la République pour prendre la présidence du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE).
Son audition intervient en application de l'article 13 de la Constitution. Notre commission est invitée à donner son avis sur sa nomination. Cette audition sera donc suivie d'un vote. Je vous donnerai tout à l'heure des précisions sur le déroulement du scrutin et son dépouillement. M. Ameisen étant auditionné demain par la Commission des affaires sociales du Sénat, le dépouillement n'interviendra cependant que demain, à l'issue de l'audition du président de la Haute Autorité de santé (HAS), M. Jean-Luc Harousseau. En effet, les dépouillements doivent être simultanés dans les deux assemblées, afin que le vote intervenu dans une commission ne puisse influencer celui de l'autre.
Monsieur Ameisen, vous êtes médecin et chercheur. Vous avez notamment étudié les phénomènes d'autodestruction cellulaire. Vous êtes de longue date engagé dans la réflexion éthique : vous avez présidé le comité d'éthique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), et vous êtes membre du CCNE depuis 2005, au titre des personnalités appartenant au secteur de la recherche. Vous allez donc – si nous y donnons un avis favorable – prendre la présidence d'une instance dont vous connaissez bien le fonctionnement.
Si votre nomination est confirmée, vous succéderez à M. Alain Grimfeld, qui préside le CCNE depuis 2008 et que notre commission avait entendu en février 2010, au moment du renouvellement de son mandat.
Je vous cède maintenant la parole pour présenter votre parcours professionnel, ainsi que les raisons pour lesquelles vous avez postulé – ou accepté – cette fonction. Vous nous direz également les orientations que vous entendez donner à votre action et les modifications que vous envisagez d'apporter au fonctionnement du CCNE. Vous nous préciserez enfin les grands débats éthiques qu'il conviendrait selon vous d'engager dans notre pays. Nous avons mesuré l'importance de ces débats, au sein même des différents groupes parlementaires, lors de la discussion de la dernière loi de bioéthique.
Je suis professeur d'immunologie à l'Université Paris Diderot et à la Faculté de médecine Xavier Bichat. Depuis une vingtaine d'années, je travaille sur des phénomènes de mort cellulaire – phénomènes d'autodestruction, de mort programmée ou d'apoptose –, qu'il s'agisse de leur rôle dans les maladies ou de leur origine possible au cours de l'évolution du vivant. J'ai écrit à la fin des années 1990 un livre qui parlait de ce domaine de recherche, du nouveau regard qu'il permettait de porter sur la santé et la maladie, et sur la manière dont il renouvelait la théorie de l'évolution du vivant, tout en montrant en quoi ce regard nouveau sur les relations entre la vie et la mort pouvait avoir des implications culturelles, philosophiques et anthropologiques.
À la suite de la publication de ce livre, en 2002, des membres du comité d'éthique de l'INSERM m'ont proposé de participer à leurs travaux. Depuis dix ans, j'exerce donc cette activité essentielle et passionnante. La clinique, la recherche et la réflexion éthique procèdent en effet, selon moi, de la même démarche sous une forme différente. Peut-être que cette attitude tient-elle à mon parcours. Cela évoque aussi ce qu'Emmanuel Levinas disait de la démarche éthique, qui était pour lui un reflet de la vocation médicale de l'homme. J'ai toujours pensé que la science et la recherche scientifique devraient faire partie de la culture, et que la réflexion sur les implications éthiques de ces connaissances et applications nouvelles devrait faire partie de la démocratie vivante.
Chacun a une vision personnelle et singulière de la démarche éthique, et c'est ce qui fait sa richesse. À mon sens, il existe une relation très étroite entre cette démarche et celle de la recherche scientifique. Selon moi, il existe la même relation entre la démarche éthique, les lois, les bonnes pratiques, la déontologie, et entre la recherche scientifique et la connaissance ou le savoir. La recherche scientifique est à la fois une démarche de respect pour tout le savoir accumulé et, paradoxalement, une démarche de transgression, qui fait le pari que le meilleur service qu'on puisse rendre aux connaissances est de les remettre en question, d'explorer l'inconnu et d'essayer d'acquérir des connaissances nouvelles plus intéressantes que les anciennes. Bien que son objet ne soit pas le même, la démarche éthique est ce questionnement permanent qui consiste à se demander si ce qui a été établi jusque-là comme les meilleures solutions possibles respecte au mieux les droits des personnes, met le mieux en relation les conduites et les valeurs, voire fait ressortir, dans certaines situations anciennes ou nouvelles, des conflits entre des valeurs toutes aussi respectables les unes que les autres. Je pense aussi que la démarche éthique évolue avec la connaissance, et que la réflexion éthique influe sur la manière dont se développent et dont sont reçues les connaissances nouvelles et leurs applications. Nous sommes ici dans une « co-évolution ».
Si la réflexion éthique est entamée suffisamment en amont dans la recherche, ce qui est hélas trop rare, non seulement la démarche de réflexion éthique et la démarche de recherche scientifique se ressemblent, mais elles peuvent se confondre. S'interroger sur la signification d'une idée ou d'une application nouvelle, c'est en effet aussi s'interroger sur les implications qu'elle pourrait avoir. Se demander quelles pourraient être les conséquences de ce qu'on est en train de produire, c'est une façon de s'interroger sur la signification de ce qu'on produit. Cette dimension épistémologique est le lien, l'articulation sans doute la plus étroite, entre la recherche scientifique et la réflexion éthique.
Vous savez que le CCNE émet des avis et peut faire des recommandations. Il y a souvent une confusion entre les deux – on a tendance à comprendre un avis comme une série de recommandations. Or si les recommandations sont importantes, le travail de questionnement et d'éclairage des enjeux que reflètent les avis est sans doute le meilleur service que puisse rendre le CCNE à la société. Plutôt que de considérer qu'il va donner les bonnes solutions et dicter les conduites, il s'agit d'éclairer les enjeux du choix, et de faire au niveau collectif ce qui est au fondement de la démarche éthique biomédicale moderne : insuffler l'idée que le choix libre et informé est un processus essentiel dans une démocratie.
Le CCNE a été créé en 1983 – il fêtera son trentième anniversaire au printemps. Ce fut le premier à être créé au monde, peu après la naissance d'Amandine, conçue par fécondation in vitro. Les pouvoirs nouveaux donnés par une possibilité d'application nouvelle suscitaient alors interrogations et inquiétudes. S'il est légitime de s'interroger sur les implications des applications ou des objets nouveaux, on méconnaît souvent le fait que les questions éthiques majeures tiennent aux bouleversements des connaissances et des représentations que nous nous faisons du vivant et de l'humain apportés par des démarches scientifiques nouvelles. Le plus grand désastre en termes d'éthique biomédicale est né non de la découverte d'une application nouvelle de la biologie, mais du dévoiement d'une révolution scientifique, la théorie darwinienne de l'évolution du vivant. L'eugénisme, la stérilisation forcée de dizaines de milliers de personnes, la justification pseudo-scientifique du racisme dans des démocraties, l'assassinat de personnes handicapées mentales et le génocide dans une dictature ont été une conséquence de la manière dont une société, la politique et la culture ont revisité une théorie scientifique majeure. Les changements de regard, ce que l'on fait des nouvelles représentations et des nouvelles connaissances, sont parfois plus importants que les applications nouvelles, car ils déterminent la manière dont ces applications seront utilisées. Pour prendre un exemple, un test génétique n'est ni bon ni mauvais : ce qui est important, c'est l'idée que l'on se fait de ce qu'il va dire et de la personne pour laquelle on l'utilisera. Cette réflexion sur les nouvelles représentations est aussi importante que la vigilance, la veille et l'interrogation sur les applications nouvelles.
Un autre point, qui me semble important dans la démarche éthique et les rapports entre science et société, et qui est souvent à l'origine de chocs ou d'effets de sidération, est dû à la démarche scientifique elle-même. La démarche scientifique comprend, explore et manipule d'autant mieux ce qu'elle étudie qu'elle le considère comme un objet vu de l'extérieur. Elle est d'autant plus efficace qu'elle efface, au moins partiellement, la singularité des objets qu'elle étudie – la formalisation mathématique, qui en fait des points dans une courbe ou des chiffres dans une équation, en est un exemple. Cela ne pose pas de problème lorsqu'il s'agit de planètes ou de sable. Mais dès lors que la science étudie du vivant ou de l'humain, il y a quelque chose d'inhumain dans la manière dont elle rend compte de ce qu'elle observe, comme le dit si bien le titre de ce petit livre d'Henri Atlan, La science est-elle inhumaine ? La science, lorsqu'elle nous étudie, parle de nous à la troisième personne du singulier, alors que nous vivons à la première personne du singulier. Martin Buber, dans Je et tu, disait que la science, quand elle parle de nous, dit « il » ou « elle », ou « ceci » ou « cela », et que nous vivons comme des « je » qui disent « tu », et qui attendent qu'on leur dise « tu » pour construire un « nous ». Pour lui, l'essentiel de la démarche éthique était de permettre la réappropriation de ce que les sciences nous disent de nous vus de l'extérieur pour le mettre à profit et au bénéfice de nos relations humaines en tant que sujets et acteurs. La révolution qu'a été, au moment de l'établissement du code de Nuremberg en 1947, la notion de consentement libre et informé, qu'on appelle désormais choix libre et informé, dit quelque chose de cette hiérarchie entre la science et l'exercice de la liberté : la connaissance est au service de la personne, et non l'inverse. La démarche scientifique peut avoir une utilité profonde quand elle n'instrumentalise pas ce qu'elle observe.
La démarche éthique est au coeur d'un paradoxe. La science fait le pari que le monde est déterministe, donc qu'il n'y a pas de liberté. Pourtant, la démarche scientifique est la libre exploration de ce déterminisme. Il y a là un paradoxe : les chercheurs se sentent profondément libres en faisant le pari que le monde, l'univers qu'ils explorent est entièrement déterminé. Lorsque des chercheurs en neurosciences écrivent des articles dont la conclusion est que le libre arbitre humain n'existe pas, ils ne s'interrogent pas sur ce que peut signifier un article scientifique écrit par des gens qui n'ont pas de libre réflexion ! La démarche éthique se tient dans cette articulation entre deux approches apparemment contradictoires : le fait de poser que nous sommes libres, y compris dans notre exploration de l'univers, et le fait que dans la démarche scientifique, chaque phénomène peut être expliqué par ses causes, et donc que nous sommes déterminés.
Je souhaite également insister sur le caractère profondément démocratique de la démarche éthique. Les comités d'éthique fondent tous leur légitimité sur leur indépendance et sur la présence en leur sein de personnes dont les disciplines, le parcours ou la culture dépassent la dimension de l'expertise biologique et médicale. En bref, l'expertise est considérée comme essentielle, mais insuffisante pour asseoir une légitimité permettant de poser des questions importantes en termes de respect de la personne. C'est donc de leur transdisciplinarité, voire de leur épidisciplinarité, « au-delà des disciplines », que ces comités tirent leur légitimité. Cela reste méconnu : notre société a tendance à estimer que les experts doivent non éclairer les enjeux des problèmes, mais déterminer la manière dont nous devrions nous comporter. Dans le domaine biomédical, on a considéré – étrangement il est vrai – que la réflexion devait dépasser l'expertise. Ce type d'approche pourrait avoir valeur de modèle dans d'autres domaines.
Je suis souvent frappé de constater que, dans nos pays démocratiques, les débats débouchent sur des choix entre des opinions préétablies. La démarche du CCNE est différente : la réflexion débouche en général sur une conclusion qu'aucun de ses membres n'avait prévue. Autrement dit, la mise en commun des réflexions fait émerger quelque chose qui dépasse la somme des opinions de chacun. Il y a là un exemple de fonctionnement démocratique.
En éthique biomédicale, il y a une tendance à approcher les problèmes d'éthique par une démarche « hors sol », décontextualisée. Les débats éthiques se focalisent souvent sur le tout début de la vie, la toute fin de la vie ou la procréation. Si c'est marquer un grand respect pour la personne que de considérer que le tout début et la toute fin de la vie méritent une attention particulière, cette focalisation tend parfois à faire disparaître le reste : elle ne complète pas un souci de la personne, mais s'y substitue. La vie de l'enfant, de l'adulte ou de la personne âgée « flotte » entre ces deux extrêmes.
De même, on se focalise souvent – à juste titre – sur des applications nouvelles de la science, en oubliant que les connaissances scientifiques nouvelles peuvent revisiter des problèmes qui, eux, n'ont rien de nouveau. Ainsi, les études épidémiologiques anglaises et internationales sur les effets socio-économiques et culturels sur la santé, les maladies, l'espérance de vie et la mort prématurée sont des questions très anciennes, qui avaient déjà été étudiées au milieu du dix-neuvième siècle, mais qu'une recherche nouvelle fait ressortir d'une manière plus intéressante. Bref, il ne faut pas se focaliser sur les dernières nouveautés dans le domaine biomédical. Il est donc important d'ancrer la réflexion bioéthique dans la réalité, y compris dans sa dimension socio-économique et culturelle. À cet égard, il manque des économistes à l'intérieur du CCNE. Nous raisonnons souvent comme si l'économie était une contrainte externe, mais ne faisait pas partie de l'élaboration de notre réflexion.
La dimension internationale me paraît tout aussi essentielle. Elle l'a d'ailleurs toujours été dans l'éthique biomédicale, comme en témoignent le code de Nuremberg de 1947 et la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948. Plus récemment, la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'Homme de l'UNESCO s'est fondée sur la double idée que le respect des droits fondamentaux doit faire partie de la démarche biomédicale, mais que la démarche biomédicale, dans sa dimension éthique, peut faire progresser le respect des droits fondamentaux.
La réflexion européenne ajoute une spécificité à cette dimension internationale. L'existence d'une Cour européenne des droits de l'Homme et d'une Cour européenne de justice assure le respect des principes fondateurs sur lesquels l'Europe s'est bâtie dans chaque pays. Dans ce cadre, il y a une subsidiarité – il suffit parfois de franchir la frontière pour le constater. La production d'un embryon aux fins de recherche est pénalement réprimée en France, mais financée par l'État en Grande-Bretagne. Dans cette diversité, le croisement des regards est source de richesse. Nous en apprenons plus sur nous-mêmes par le regard des autres, et réciproquement. Nous rencontrons deux fois par an les autres comités d'éthique européens, en particulier anglais et allemand, dans le cadre de rencontres bilatérales ou trilatérales, et au moins une fois par an les comités de la plupart des pays du monde. Ce qui fait défaut, c'est l'association plus étroite d'un certain nombre de pays européens à nos travaux. Nous comprendrions mieux pourquoi nous pensons autrement.
J'en viens à un dernier point. Les anciens présidents du CCNE en sont présidents d'honneur. Ce n'est qu'une fonction honorifique, et ils ne participent donc pas aux travaux du comité. Celui-ci ayant bientôt trente ans, cette mémoire vivante serait pourtant précieuse. En effet, le comité ne doit pas être une photographie à un instant donné de l'état de la réflexion éthique. Si je suis conduit à le présider, je souhaiterais donc associer ses anciens présidents à un certain nombre de travaux ou de missions, afin que nous puissions nous projeter dans l'avenir en bénéficiant de leur expérience.

Nous vous aurions écouté encore longtemps. Vous ouvrez des champs intellectuels et culturels passionnants. Je m'en réjouis comme l'ensemble des membres de la Commission. Vous le disiez à l'instant, nous nous voyons dans le regard des autres. Sartre avait déjà dit que « l'enfer, c'est les autres », non dans ce qu'ils sont, mais dans le regard qu'ils posent sur nous.
Votre propos montre bien combien il est difficile de légiférer sur la bioéthique. Cela suppose en effet d'avoir des certitudes sur le vivant, sur la procréation, de savoir quand commence le vivant et quand commence la fin, toutes questions qui nous interpellent. Bienheureux qui peut avoir des certitudes au moment de décider. Lors de mon premier mandat, c'est sur le vote des lois de bioéthique qu'il m'a été le plus difficile de me prononcer. Vous avez évoqué ce face-à-face avec soi-même. Il n'y a plus ici ni droite, ni gauche : chacun est face à sa conscience.

Je salue M. Jean-Claude Ameisen et l'ensemble de ses travaux. Je salue plus particulièrement son immense oeuvre de divulgation, qui permet à des millions de Français de se familiariser avec la recherche scientifique et l'histoire des sciences, ainsi que sa capacité à tisser des liens avec d'autres disciplines que la sienne, qui devrait lui être précieuse à la tête du CCNE. Nous avons également apprécié la leçon de démocratie qu'il a bien voulu partager avec nous, sans arrogance aucune. Je ne doute pas qu'elle sera entendue au sein de notre Commission, et j'espère au-delà des murs de cette salle.
Si vous aviez à rédiger la feuille de route du CCNE pour les deux ou trois ans qui viennent, monsieur Ameisen, quelles grandes questions vous sembleraient être les questions clés ?

En tant que chercheur, et travaillant moi aussi sur l'apoptose et la mort programmée, j'ai eu le privilège de suivre vos travaux à mon modeste niveau. Je dois dire que c'est toujours un plaisir de vous écouter ou de vous lire.
J'aimerais avoir votre avis sur une question qui fait débat, celle de la recherche sur l'embryon ou les cellules souches.
Nous allons entamer sous peu l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Si la rationalisation des dépenses de santé apparaît comme une nécessité, l'accès aux soins pour tous constitue aujourd'hui un enjeu majeur. Le risque n'est-il pas de créer une médecine à deux vitesses ? Il y a là une vraie question d'éthique : avons-nous le droit de réfléchir en termes de coût-efficacité en matière de santé ?

Je salue le professeur Ameisen, que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer, son parcours scientifique et sa démarche éthique.
Je souhaite d'abord aborder le sujet de la démocratie. Trop souvent, on a l'impression que ces sujets appartiennent aux politiques ou aux experts. Or nous avons vu avec les lois de bioéthique que les Français pouvaient se les approprier. À présent que les comités d'éthique régionaux sont en place, comment y animer les débats, comme le prévoit la loi de bioéthique, qui impose un débat ouvert avant toute modification des lois de bioéthique, avec la faculté – dont nous avons déjà usé – de constituer des panels citoyens, selon des méthodes couramment utilisées au Danemark ou en Allemagne, qui permettent de sortir des pratiques « sondagières », dont nous mesurons les limites ?
Par ailleurs, le CCNE va être saisi de la question de l'évolution de la législation sur la fin de vie, sur laquelle il a déjà émis plusieurs avis dont nous avons pris connaissance avec intérêt. Comment envisagez-vous de conduire la démarche sur ces deux points ?
Vous avez noté que la démocratie, comme l'éthique, est une interrogation permanente, une recherche de l'intérêt général et du souverain bien, et qu'elle implique d'accepter la complexité, l'ambiguïté, l'ambivalence ou la contradiction. Il y a toujours un conflit de valeurs, car le conflit est rarement entre le bien et le mal ou entre le progrès et la morale, mais plutôt entre le bien et le bien. Comment le CCNE peut-il apporter des avis éclairants ? Plus que des avis d'experts, on attend aujourd'hui d'un comité d'éthique qu'il éclaire le débat sur les véritables enjeux, afin que chaque citoyen puisse être capable de décider en toute connaissance de cause et en toute liberté.
Le groupe UMP soutiendra votre candidature, car l'éthique n'est ni de droite ni de gauche. Nous connaissons votre engagement politique, mais il ne nous gêne pas. Nous pensons en effet qu'il ne saurait corseter la recherche éthique et les interrogations que vous conduirez. Je ne me suis moi-même jamais senti bridé par mon parti lorsque je débattais de problèmes éthiques. Je vous pose donc, non sans malice, la question suivante : y a-t-il à votre avis une éthique de droite et une éthique de gauche ? Je viens d'écrire une contribution sur ce thème avec mon ami Alain Claeys, et je pense que vous apporterez la même réponse que nous à cette question.
De même, pensez-vous qu'il existe une éthique française ? Je me suis souvent posé cette question, car toute culture induit des repères. Nous avons des repères de liberté, d'égalité, de fraternité. Ce ne sont pas exactement les mêmes que dans les pays d'Europe du nord, qui ont une culture d'habeas corpus, de préservation de l'individu et d'autonomie. Notre tradition, elle, favorise plutôt une éthique de vulnérabilité et de protection des plus faibles. Il arrive que l'éthique d‘autonomie et l'éthique de vulnérabilité s‘affrontent. Discernez-vous une éthique française dans les débats qui se tiennent à l'échelle européenne ? Pensez-vous, comme moi, que la position française est éclairante pour le reste du monde, parce que notre tradition est faite de cette liberté et de cette fraternité, qui sont quelquefois contradictoires, mais si souvent mêlées ?
Telles sont les questions que je souhaitais vous poser, en vous renouvelant mon amitié et mon soutien.

Je me réjouis à mon tour de la candidature à la présidence du CCNE de M. Jean-Claude Ameisen, dont la carrière scientifique est exemplaire et que je connais depuis longtemps. Il est important que cette fonction soit confiée à une personnalité qui a fait ses preuves dans un domaine scientifique.
Jean Bernard disait qu'en recherche, tout ce qui n'est pas rigoureusement scientifique n'est pas éthique. L'inverse n'est pas toujours vrai. Surtout, il faut une approche scientifique pour conduire la démarche éthique, même si l'on peut associer à celle-ci de nombreuses personnalités n'ayant pas de formation scientifique. Il est important que le CCNE ait à sa tête une personnalité qui sache rappeler la nécessité fondamentale d'inclure le progrès comme une obligation, qui dise que la quête de la connaissance et ses progrès ne sont jamais non éthiques, mais que les moyens utilisés pour acquérir ces connaissances ou l'application des découvertes peuvent poser des questions éthiques.
Il me paraît également fondamental, à l'heure actuelle, de donner une dimension européenne à la réflexion, afin de prendre en compte les diverses visions existantes. Peut-être la France a-t-elle péché par arrogance en pensant pouvoir édicter une éthique universelle dans le temps et dans l'espace. Nous devons être plus modestes et accepter les différences, même si nous formulons les principes qui correspondent à notre propre vision et à notre propre histoire.
Nous ne devons pas non plus oublier que nous vivons dans un pays laïc. Les recommandations éthiques doivent être le fruit des libres réflexions de l'ensemble des composantes de la communauté nationale ; elles ne peuvent se fonder sur les seules vérités révélées. L'alpha et l'oméga ne sauraient procéder que de la réflexion des humains de notre temps.
Vous siégez dans la mission présidée par M. Didier Sicard sur la fin de vie. Où en est la réflexion, et quel est le calendrier prévu ? Beaucoup de personnes attendent en effet que la mission se prononce et propose une juste formulation sur ce sujet sensible.
Les cellules souches sont un autre sujet qui a alimenté la réflexion lors de la révision des lois de bioéthique. Beaucoup souhaitent aujourd'hui que les recherches soient encadrées, mais positivement acceptées plutôt qu'interdites avec des possibilités de dérogation. Il y a là une nuance plus que symbolique. Je ne vous demande pas nécessairement de répondre, là n'est pas le rôle du Comité, mais de nous éclairer sur la démarche qui sera appliquée pour avancer dans ces domaines.
Enfin, quelles modifications entendez-vous apporter au mode de fonctionnement du CCNE ? J'ai compris que vous souhaitiez inclure des compétences économiques, qui sont souvent présentes dans les comités anglo-saxons, alimenter les débats de société, renforcer la dimension européenne de la réflexion et impliquer davantage les anciens présidents du CCNE. Envisagez-vous d'autres modifications ?

Vos propos nous confortent dans l'idée que vous pouvez assumer la présidence du CCNE. Pour ma part, je retiendrai ce que vous avez dit de la réflexion éthique qui conduit à un questionnement permanent, et aussi que l'éthique évolue en fonction des connaissances.
Vous avez également rappelé que la France peut s'enorgueillir d'avoir créé le CCNE il y a trente ans. Avez-vous une vision des évolutions en termes d'éthique sur des sujets sur lesquels le Comité a eu à se prononcer depuis trente ans ? Comment la France a-t-elle évolué sur un certain nombre de sujets ?
J'aimerais aussi savoir comment cette éthique peut être partagée par l'ensemble de nos concitoyens. Vous l'avez dit, ces sujets difficiles requièrent le développement de relations entre la culture, la science et la société. Comment associer nos concitoyens à la réflexion sur l'éthique, s'agissant de sujets qui les dépassent parfois – fin de vie, mariage ouvert à tous ?
Vous avez déploré l'absence de représentants du monde de l'économie au CCNE. Entendez-vous y remédier ? Je suis pour ma part convaincu que le monde de l'économie et le monde du travail doivent être pleinement associés à cette réflexion.
Je rejoins enfin mon collègue Jean Leonetti : l'éthique n'est pas politique en tant que telle ; elle dépasse justement les convictions personnelles. Partagez-vous cette vision en ce qui concerne l'approche religieuse ou culturelle, qui est sans doute plus intime, et peut influencer l'éthique que nous avons les uns et les autres ?

Nouvellement élue dans cette Assemblée, j'aimerais que vous nous rappeliez la composition et les modalités de saisine du CCNE.

Permettez-moi d'ajouter une dernière question à cette liste. Il me semblait que lorsque s'était posée la question de la levée de l'anonymat des donneurs de gamètes, il y a trente ans, la question de la part de l'inné et de l'acquis chez un individu avait été tranchée : hormis la couleur des yeux, des cheveux et de la peau, tout était de l'acquis. Dès lors, poser la question de lever l'anonymat revenait à ramener l'individu à ses origines génétiques. Je vous pose cette question, car je participe en ce moment à une réflexion avec les Centres d'études et de conservation des oeufs et du sperme (CECOS) de France. À mon sens, il y a eu un recul philosophique il y a deux ans. Encore une fois, il me semblait qu'un individu était surtout de l'acquis et du culturel. Qu'en pensez-vous ?
Je vous remercie pour toutes ces questions.
Il y a aujourd'hui une contradiction ou une tension sur le sujet que vous soulevez, madame la Présidente. Dans sa vision extrême, le déterminisme génétique revient à dire que dès que l'on a une cellule oeuf fécondée, les caractéristiques principales de la personne et les éléments essentiels de son devenir sont déjà écrits, le seul problème étant de réussir à les lire. Une autre démarche se développe depuis une vingtaine d'années : l'épigénétique, étude de la manière dont les gènes sont utilisés par les cellules et les corps en fonction de l'environnement et de l'histoire. Il apparaît en effet que celle-ci joue un rôle aussi important – voire plus important dans certaines circonstances – que la séquence même de ces gènes. Faire la part de l'inné et de l'acquis n'est donc plus poser le problème comme il se pose en biologie moderne, puisqu'il y a une intrication et une rétroaction permanentes. En fonction de la séquence des gènes, il y aura certaines interactions avec l'environnement, qui vont déterminer en retour la manière dont ces gènes vont être utilisés. La part de l'inné et de l'acquis se tresse donc pendant toute l'existence. Selon une étude conduite il y a tout juste un an, au fur et à mesure que de vrais jumeaux – donc génétiquement identiques – grandissent, les différentes cellules et les différents organes de leur corps n'utilisent pas de la même façon leurs gènes pourtant identiques. Sans même parler d'influence culturelle ou de psychologie, on constate donc qu'au niveau le plus élémentaire, leur avenir en termes de santé ou d'espérance de vie n'est pas le même : qui dit gènes identiques ne dit pas même façon de les utiliser.
Dans Le gène égoïste, publié dans les années 1970, Richard Dawkins exprimait la vision déterministe génétique extrême en disant : « les gènes sont à l'intérieur de gigantesques robots, à partir desquels ils manipulent et contrôlent le monde à distance. Les gènes sont en vous et moi. Ils nous ont construits corps et esprit, et leur propagation est la seule raison de notre existence. » À la même époque, un grand généticien américain, Richard Lewontin, disait : « l'intérieur et l'extérieur s'interpénètrent, et chaque être vivant est à la fois le lieu, l'acteur et le produit de ces interactions. » C'est cette vision qui tend à s'imposer aujourd'hui. L'acquis joue un rôle fondamental, même si on ne peut faire la part de l'inné et de l‘acquis. Il y a des circonstances – je pense aux maladies monogéniques comme la maladie de Huntington – où une séquence de gène contraint tellement le développement que l'avenir devient prévisible, non qu'il soit écrit dans les gènes, mais parce qu'il y a une telle contrainte que le champ des possibles n'est plus ouvert. Il y a des cas où l'environnement exerce une contrainte telle – je pense aux pays du Tiers-monde, avec la pollution, les maladies infectieuses, la dénutrition – que l'on peut hélas prédire l'avenir. Mais en dehors de ces situations extrêmes, les gènes ne permettent pas de prédire l'avenir.
Le CCNE a évoqué ces questions il y a quatre ans dans un avis sur la filiation. Connaître ses origines génétiques ou biologiques apporte un élément supplémentaire. Toutefois, les représentations courantes tendent à en faire la vraie connaissance, comme si ce qui est traçable d'un point de vue biologique ou génétique était l'essentiel de la vérité. L'importance que l'on attribue à cet élément dépend des représentations que l'on se fait de la part des gènes dans la construction des individus. Si c'est une partie de la vérité parmi d'autres, pourquoi ne pas chercher à la connaître ? Le problème est que beaucoup de ceux qui le font la tiennent pour LA vérité. Or il y a quelque chose de dérisoire ou de tragique dans le fait de penser que la filiation puisse venir d'une cellule, et pas d'êtres humains. Certes, les cellules participent à la construction d'un enfant, mais celui-ci est infiniment plus que l'identité particulière de la cellule qui lui a donné le jour. Bref, le débat serait plus serein si l'idée de ce qu'est la contribution génétique à la construction d'un individu était plus claire dans la société.
Il en va de même des tests génétiques, dont la commercialisation se développe considérablement. Certains disent que si le test est positif, vous avez 5 % de probabilité de plus que la population générale d'avoir un diabète ou un cancer de la prostate. Cela veut dire que si le test est positif, il y a 95 % de probabilité que vous n'ayez pas plus de risque que la population générale de développer ces maladies. Si l'on raisonnait de la même façon pour le test biologique d'infection VIH, c'est-à-dire si l'on vous disait que si le test est négatif, vous n'êtes pas infecté, et que s'il est positif, il y a 95 % de probabilité que vous ne le soyez pas, vous ne le feriez pas ! Mais l'importance attribuée aux gènes est telle que ce qui paraît absurde dans la pratique habituelle devient quelque chose de magique quand il s'agit des gènes. La société redoute hélas moins des risques environnementaux ou liés à l'histoire de 30 % qu'un risque génétique de 5 %. Il y a donc un effort majeur à faire pour que chacun comprenne de quoi il s'agit. Les choix n'en seront que plus sereins.
Le CCNE est composé de 40 membres, madame Le Callennec. Au moment de sa création, François Mitterrand a souhaité que cinq d'entre eux soient nommés par le Président de la République en raison de la famille philosophique, spirituelle ou religieuse à laquelle ils appartiennent. Siègent donc au Comité une personnalité proposée par l'Église catholique, une personnalité proposée par l'église protestante, une personnalité proposée par l'islam et une personnalité proposée par le judaïsme. Elles ne représentent pas l'instance qui les a proposées, mais elles sont choisies en raison de leur appartenance à une famille. C'est je crois une originalité du CCNE, au moins en Europe, et la réflexion gagne beaucoup à cette diversité.
Quinze personnes sont nommées par différentes instances – Collège de France, INSERM, Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Institut national de la recherche agronomique (INRA), ministère de la santé – pour leur expertise dans le domaine biologique ou médical. Enfin, 19 personnes – dont un sénateur et un député – sont nommées par d'autres instances, pour leur intérêt pour les questions éthiques. Cette composition très large assure la richesse des débats. Le nombre d'autorités de nomination est relativement important, ce qui évite tout monopole. C'est un équilibre qui fonctionne bien depuis trente ans.
Cela m'amène à la question de M. Leonetti : oui, certaines démarches éthiques sont plus particulièrement propres à telle famille religieuse ou spirituelle, à telle profession, à telle tendance politique – qu'elle soit de gauche, de droite ou du centre. Mais une véritable réflexion éthique n'a de sens que si elle inclut ces différentes composantes, pas si elle les oppose. Je le constate avec les travaux de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, dont les clivages ne recouvrent pas l'appartenance politique de ses membres. Une démarche éthique n'a d'intérêt que si elle dépasse les clivages habituels ; elle peut donc difficilement se dire « de gauche » ou « de droite ». En tout cas, de telles distinctions doivent être dépassées au niveau national ou international.
Deux questions m'ont été posées sur les cellules souches. Sur ce point, l'avis donné il y a deux ans à l'occasion de la révision de la loi de bioéthique traduit bien la volonté du Comité de substituer aux recommandations un éclairage sur les problèmes éthiques identifiés comme majeurs. Depuis l'avis n° 1, publié en 1984 et qui abordait déjà ce sujet, le Comité a en effet publié six ou sept avis relatifs à la recherche sur l'embryon, et il a toujours recommandé de l'autoriser dans certaines circonstances particulières. Il aurait donc été peu pertinent pour lui de se répéter à nouveau.
Certains problèmes éthiques sont causés par la recherche, mais dans d'autres cas, cette dernière n'intervient qu'en aval. Ainsi, après une interruption médicale de grossesse, ou lorsqu'un diagnostic pré-implantatoire a mis en évidence la présence d'une anomalie génétique chez un embryon, entraînant la destruction de ce dernier, les cellules ou les tissus de l'embryon ou du foetus peuvent faire, par la suite, l'objet d'une recherche – dans le premier cas, il suffit d'une absence d'opposition de la mère –, mais ce n'est pas l'éventualité d'une recherche qui influe sur la décision de détruire l'embryon. Or, dès lors qu'une démarche est considérée comme licite, n'est-il pas souhaitable d'en tirer des connaissances nouvelles ? Il nous a semblé, dans ce cas très précis, que la société et, peut-être, le législateur faisaient inconsciemment porter sur la recherche une suspicion de transgression alors que cette transgression est en l'occurrence inexistante.
En tout état de cause, le problème éthique posé par la recherche est très différent selon qu'il s'agit de cellules issues d'un embryon détruit ou d'un embryon vivant et en cours de développement dans un tube à essai. Le législateur semble confondre les deux ; nous avons en tout cas été étonnés qu'il ne fixe pas un terme temporel aux recherches, alors que nul ne sait jusqu'à quand il est possible de prolonger le développement embryonnaire in vitro. Paradoxalement, l'Angleterre, qui autorise la création d'un embryon à visée de recherche, interdit de travailler sur celui-ci au-delà de quatorze jours, délai correspondant à l'apparition des premières cellules nerveuses.
Je le répète, nous n'avons pas voulu prendre de nouvelles recommandations, mais plutôt relever les points obscurs ou contradictoires et pointer les éléments permettant d'éclairer les choix. Nous ne nous sommes donc pas préoccupés de savoir quelle orientation devait prendre la recherche, monsieur Touraine, mais dans quels cas la recherche pose des problèmes éthiques et dans quels cas elle n'en pose pas. En l'occurrence, la recherche sur l'embryon vivant en cours de développement nous semble mériter une interdiction assortie de dérogations, tandis que celle portant sur des cellules issues d'un embryon détruit doit pouvoir ressortir d'une simple autorisation encadrée.
À quelques détails près, les états généraux de la bioéthique, évoqués par M. Leonetti, ont d'ailleurs proposé la même chose. Cela traduit la complémentarité entre les réflexions du Comité d'éthique national et des divers comités régionaux, celles des états généraux de citoyens ou celles de groupes tels que la mission sur l'accompagnement en fin de vie. Le premier débat public organisé par le professeur Sicard a d'ailleurs eu lieu il y a une dizaine de jours à Strasbourg, toutes les personnes intéressées par ces questions étant invitées à rencontrer des experts pour une journée incluant des ateliers et un débat général. Si le grand avantage des états généraux était de permettre la construction collective d'une pensée, cette journée aura été l'occasion de voir surgir des questions, des espoirs, des inquiétudes ou des contradictions auxquels on n'aurait pas forcément songé et qui viennent nourrir la réflexion de la société.
Les états généraux ont apporté beaucoup à la réflexion éthique parce qu'ils ont montré que des citoyens, sans expérience ni connaissance spécifique, étaient capables d'élaborer une réflexion d'une grande intelligence et d'une grande cohérence. De telles formes de démocratie vivante leur permettent de s'approprier une réflexion plutôt que de contenter d'approuver ou de désapprouver des propositions élaborées « en haut ».
J'ai par ailleurs été frappé, à Strasbourg, de constater que l'adoption de positions parfois radicalement opposées n'empêchait pas l'écoute respectueuse des opinions exprimées, l'envie de partager étant plus forte que les divisions. Alors que le débat sur les nanosciences et les nanotechnologies a tourné au pugilat – au point que la commission particulière du débat public a dû se réfugier à huis clos –, les états généraux de la bioéthique ou les débats sur la fin de vie, qui concernent des questions touchant bien plus profondément à notre vie intime et quotidienne, ont été une école de respect. Il y a là une leçon à tirer.
En ce qui concerne le calendrier, la mission sur la fin de vie doit organiser des rencontres avec les citoyens dans six ou sept villes et remettre un rapport avant le 22 décembre, soit dans un délai assez court. Nous avons tendance, en France, à vouloir que de tels mouvements de réflexion soient menés très vite, alors que les questions de fond gagnent à être examinées dans la durée. Un délai de six à neuf mois, comme on le pratique dans certains pays européens, n'aurait pas été de trop.
J'en viens au risque d'une médecine à deux vitesses et au rapport coûtefficacité, autant de questions qui justifieraient la participation d'économistes aux travaux du Comité.
Lorsque la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) produisent des rapports sur l'état défaillant du système de santé dans certains pays du Sud, les conséquences de ces défaillances sont évaluées non en termes de souffrance humaine, mais de coût économique. À l'inverse, dans nos pays dotés d'un système de santé performant, nous calculons le coût de ce système, mais pas la valeur de ses bénéfices. La santé n'est envisagée qu'en tant que source de dépenses. Or l'inexistence d'un système sanitaire a aussi un coût.
C'est pourquoi le Programme des Nations unies pour le développement – PNUD – défend depuis longtemps l'idée, développée dans un rapport d'Amartya Sen, Joseph Stiglitz et Jean-Paul Fitoussi, selon laquelle la santé devrait être comptée comme une richesse. Dans une telle perspective, les dépenses de santé – ou plutôt les investissements en la matière – prendraient une tout autre signification. Pour M. Sen et pour le PNUD, des éléments tels que la santé ou l'espérance de vie devraient être pris en compte dans le calcul du produit intérieur brut (PIB). Malheureusement, cette idée n'a jamais trouvé à se concrétiser.
Je ne sais pas, monsieur Paul, quels sont les sujets les plus importants dont le Comité devrait s'emparer. Mais je suis particulièrement frappé par la fragmentation de la société et par l'isolement des personnes les plus vulnérables, qu'elles soient âgées, atteintes de maladies psychiatriques ou de handicaps. De cette fragmentation résulte une inégalité de traitement.
Je prendrai un exemple qui n'a rien d'économique. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et la loi Leonetti de 2005 sur la fin de vie ont permis des avancées en matière de choix libre et informé – même si celles-ci s'accompagnent d'une forme de transgression – : on ne peut désormais pas imposer à une personne dotée d'une pleine capacité de raisonnement, au nom de ce que l'on croit être son bien, un choix qu'elle refuse. Depuis 2002, un patient en pleine possession de ses moyens peut ainsi refuser un traitement susceptible de lui sauver la vie. Mais le résultat de cette avancée majeure, c'est que, dans notre pays, des personnes refusant le traitement qui leur est proposé coexistent avec des personnes n'ayant pas accès au traitement. Les premières peuvent dire « oui » ou « non » ; les secondes n'ont rien à dire.
Il en est de même au niveau international, où le développement durable ne correspond pas à un développement équitable. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 2 millions d'enfants de moins de cinq ans meurent chaque année de maladies que des vaccins ou des antibiotiques permettraient de soigner, et 2 millions de personnes meurent du Sida alors même que des traitements existent. Le bénéfice du progrès est très inégalement réparti, ce qui est d'ailleurs une préoccupation pour les comités d'éthique internationaux. Or ce constat est également valable dans nos pays, quoiqu'à un moindre degré. Au-delà de la question du rapport coûtefficacité, il importe donc de s'assurer que chacun ait la possibilité de préserver sa santé. Et dans cette question, la dimension économique joue évidemment un rôle essentiel.
Nous avons souvent évoqué la question des sondages avec M. Leonetti. Aussi intéressants soient-ils, ces derniers ne font que mettre en présence des opinions différentes, et ne participent pas à la construction d'une opinion collective. Au contraire, en laissant entendre que tout est déjà joué, ils peuvent même entraver la réflexion.
J'ai présidé le comité de révision de la stratégie nationale de la biodiversité qui, tel un « mini-Grenelle », réunissait des chercheurs, des agriculteurs, des chefs d'entreprise, des maires, des urbanistes, etc. Chaque participant représentait un secteur particulier du monde économique, et tous, malgré leurs approches parfois contradictoires, étaient désireux de contribuer à l'élaboration du bien commun. Dès lors que l'on donne à des personnes la possibilité de participer à une réflexion commune, elles sont en général prêtes à le faire.
Pour répondre à Mme Le Callennec, je rappellerai que le Comité peut être saisi par le Gouvernement, le Parlement ou d'autres institutions, mais qu'il peut également s'autosaisir et le fait d'ailleurs volontiers. Cela étant, dans l'hypothèse où la mission Sicard ne conclurait pas à la nécessité de réviser la loi, il n'est pas sûr que ses travaux donnent lieu à une saisine du CCNE.
On m'a par ailleurs demandé comment avait évolué la doctrine du Comité. En ce qui concerne par exemple la recherche sur l'embryon, les principes essentiels définis en 1984 ont continué jusqu'à ce jour à lui servir de ligne directrice. En revanche, le CCNE a évolué au sujet de la fin de vie. Tout d'abord, saisi en 1991 sur la question de l'euthanasie, il avait donné une réponse à la fois très courte et totalement négative. Puis, à propos du choix libre et informé, cette réponse a priori négative était devenue questionnement. Enfin, en 2000, dans son avis n° 63, il s'est interrogé sur la possibilité d'ouvrir une exception a posteriori, de façon à inciter le tribunal à apprécier les circonstances exceptionnelles pouvant conduire à des arrêts de vie. Cette évolution progressive, parfois mal comprise, s'explique à mon avis par le fait que le Comité consacre de plus en plus de temps à sa réflexion : alors que son premier avis tenait en trois pages, le n° 63 est beaucoup plus long. Il est donc passé d'une réaction « évidente » à un processus beaucoup plus complexe. La comparaison entre les différents avis donnés par le CCNE au fil des ans est d'ailleurs toujours intéressante, même lorsque sa position ne change pas fondamentalement.
J'espère avoir répondu à la plupart de vos interrogations.

Par définition, certaines questions seront toujours en suspens. Mais vous avez allumé certaines lumières dans nos esprits, et cela nous change par rapport à d'autres débats. Je vous en remercie.
La présidente précise les conditions dans lesquelles le scrutin va se dérouler, conformément à l'article 29-1 du Règlement de l'Assemblée nationale. Elle rappelle que le dépouillement aura lieu le lendemain à l'issue de l'audition du président de la Haute Autorité de santé.
Il est alors procédé au scrutin par appel nominal.
Puis la Commission examine, sur le rapport de M. Dominique Tian, la proposition de loi de M. Christian Jacob relative à l'aide médicale de l'État (n° 145).

Disons-le d'emblée, cette proposition de loi de M. Christian Jacob et plusieurs de ses collègues n'a pas pour objectif de remettre en cause dans son principe l'aide médicale de l'État (AME), mais d'en améliorer la gestion afin d'en garantir la légitimité auprès de tous nos concitoyens.
Vous le savez, les dépenses de l'AME sont passées de 138 millions d'euros en 2000 – année de sa montée en charge – à 633 millions d'euros en 2011. Une forte augmentation – de respectivement 13,3 % et 12,3 % – a notamment été enregistrée en 2009 et en 2010. Or cette évolution ne peut s'expliquer par la hausse du nombre de bénéficiaires, resté relativement constant au cours de ces dernières années.
De plus, dans un contexte de crise financière généralisée, et au moment où l'on demande à nos concitoyens de faire des efforts, il est difficile de justifier que certaines personnes, quel que soit leur statut, ne participent pas, même symboliquement, aux efforts demandés au reste de la population. C'est d'autant plus vrai s'agissant d'étrangers présents irrégulièrement sur le territoire national.
En effet, la sécurité sociale ne prend en charge qu'environ 70 % des dépenses de soins de ville des assurés du régime général, qui doivent en outre s'acquitter des franchises, du paiement d'un euro forfaitaire par consultation et du forfait hospitalier. Un travailleur sans mutuelle, qui paie des cotisations sociales obligatoires, a donc une moins bonne couverture qu'un étranger en situation irrégulière. Ce n'est pas acceptable.
La France fait d'ailleurs sur ce point figure d'exception en Europe. Même l'Espagne, qui avait une réglementation proche de la nôtre, a récemment adopté des mesures prévoyant la participation des personnes de nationalité étrangère aux dépenses de soins.
Je reprends à mon compte la position des rapporteurs du Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'AME, Claude Goasguen et Christophe Sirugue, qui estiment que « le régime de l'AME doit permettre de maintenir une distinction administrative et symbolique entre les personnes en situation irrégulière et les étrangers disposant d'un titre de séjour ».
Certes, l'AME est utile et doit être maintenue. Mais face au fort dynamisme des dépenses depuis quelques années, et compte tenu des efforts demandés à l'ensemble de nos concitoyens pour assurer la pérennité de notre protection sociale, il est évident que la légitimité du dispositif implique sa régulation.
Sous la précédente législature, le gouvernement a engagé des réformes afin de mieux gérer l'AME. Je pense notamment à la modification de la tarification des soins hospitaliers, à la mise en place d'un agrément préalable pour les soins coûteux ou au forfait annuel de 30 euros pour les adultes, hors soins d'urgence.
Ces diverses mesures ont porté leurs fruits, puisque, après la forte croissance constatée en 2009, la dynamique des dépenses d'AME a ralenti en 2010, avec tout de même une augmentation de 7,5 %.
Hélas, ces efforts ont été partiellement annulés par les mesures – suppression de l'agrément pour les soins coûteux et de la participation annuelle de 30 euros – adoptées en loi de finances rectificative du 16 août 2012 à l'initiative du nouveau gouvernement.
Non seulement cette décision a un impact financier important, mais nos concitoyens peinent à comprendre, en ces temps de difficultés budgétaires, et alors même qu'ils sont mis à contribution pour assurer la pérennité de notre système de protection sociale, que l'accès aux soins des bénéficiaires de l'AME ne soit plus soumis, depuis le 4 juillet, à aucune participation financière. Ainsi, selon un sondage réalisé en septembre 2012 par l'IFOP, 62 % des Français désapprouvent la suppression du droit de timbre de 30 euros.
Dans ce contexte, la proposition de loi suggère plusieurs mesures destinées à réguler l'aide médicale de l'État.
L'article 1er rétablit le principe du guichet unique pour le dépôt des demandes d'aide – une mesure de bonne gestion et de lutte contre la fraude, adoptée en juin 2011, mais malheureusement supprimée par la loi du 16 août 2012. Les dossiers ne pourront donc être constitués que par les caisses primaires d'assurance maladie, et non plus, comme c'est le cas aujourd'hui, par les bureaux d'aide sociale des communes. Non seulement cela évitera les doublons, mais nous pourrons ainsi améliorer notre connaissance statistique des bénéficiaires en centralisant l'information.
L'article 2 vise à rétablir l'obligation d'agrément préalable pour les soins hospitaliers et à l'étendre aux soins de ville, hors soins d'urgence, délivrés aux mineurs ou aux femmes enceintes. Ces mesures ont permis d'économiser plusieurs millions d'euros, notamment en mettant fin aux surfacturations réalisées par les grands centres hospitaliers de Paris, Lyon ou Marseille. Une telle pratique est peut-être bonne pour le budget des établissements, mais elle ne l'est sûrement pas pour l'assurance maladie ni pour les assurés sociaux qui la financent.
L'article 3 vise à soumettre aux franchises les bénéficiaires de l'AME, comme le sont ceux de la couverture maladie universelle (CMU) et tous les assurés du régime général, même de revenus modestes. Il s'agit ainsi de les faire participer a minima au système de soins, dans la limite d'un plafond journalier et annuel.
Enfin, je vous présenterai un amendement destiné à accélérer la réforme de la tarification des soins hospitaliers pris en charge au titre de l'AME. En effet, comme l'ont montré différents rapports, l'hôpital concentre le plus gros des dépenses d'AME, et le mode de tarification au prix de journée qui y est pratiqué est en grande partie responsable de leur dérive. En 2011, nous avons décidé d'imposer une facturation calée sur le droit commun, tout en appliquant des coefficients correcteurs. Je vous proposerai de passer pleinement au droit commun. Cette proposition représente une économie potentielle de 160 millions d'euros, sans toucher la qualité de la prise en charge des patients.

Monsieur le rapporteur, on pourrait difficilement vous reprocher de manquer de constance dans vos propositions.

C'est à croire qu'il existe peu de dossiers importants dont il faudrait s'occuper aujourd'hui : le premier texte que l'UMP souhaite inscrire à l'ordre du jour qui lui est réservé est une proposition de loi relative à l'AME, moins de deux mois après qu'un débat s'est tenu sur ce sujet à l'Assemblée nationale. Cela tourne à l'obsession.
Toutes ces questions ont pourtant déjà fait l'objet d'un rapport conjoint de l'Inspection générale des affaires sociales et de l'Inspection générale des finances dont la qualité est reconnue par tous, ainsi que d'un rapport que j'ai réalisé avec Claude Goasguen et dont les conclusions n'ont pas fait l'objet de critiques, même de la part de l'ancienne majorité. Ces travaux montrent que l'accroissement des dépenses liées à l'AME, s'il est réel, ne s'explique ni par une explosion du nombre d'ayants droit ni par la fraude. Si le nombre de bénéficiaires a augmenté en 2009, c'est parce que les mesures prises alors par le gouvernement ont eu pour conséquence d'accroître le nombre de déboutés du droit d'asile et donc de personnes en situation irrégulière. L'autre raison est que les hôpitaux ont recherché plus activement les droits à une couverture maladie des patients hospitalisés, en particulier des bénéficiaires de l'AME. Or ils facturent leurs soins sur la base d'un tarif spécifique, beaucoup plus élevé que la tarification à l'activité. C'est sur ces points qu'il aurait fallu travailler.
Non seulement les mesures contenues dans cette proposition de loi sont accusatoires et stigmatisantes, mais elles sont inutiles.
Vous souhaitez à nouveau faire de la caisse primaire d'assurance maladie le seul dépositaire de la demande d'AME. Mais c'est justement à la demande des caisses elles-mêmes que nous avons décidé d'autoriser les centres communaux d'action sociale et les associations à participer au montage administratif des dossiers : leur expérience du public concerné représente en effet un atout.
Quant à l'agrément préalable, lorsqu'il était en vigueur, ce dispositif s'était avéré extrêmement compliqué et coûteux à mettre en place, alors que son efficacité est douteuse.
J'en viens à la franchise médicale. Pourquoi proposer que chacun cotise de la même façon alors même que vous avez appelé à ne pas faire de confusion entre étrangers irréguliers et bénéficiaires de la CMU ? Avec une telle mesure, l'UMP promeut un système universel de protection de santé, mais à géométrie variable.
Quelles que soient les raisons de l'augmentation des coûts de l'AME, aucun des trois articles de cette proposition de loi ne saurait y remédier. Mais nous avons bien compris qu'entraînés dans une surenchère populiste, votre objectif était surtout de tenir un discours agréable à l'oreille de certaines personnes peu au fait des réalités.
Mais cette proposition n'est pas seulement inutile, elle est aussi dangereuse. Plus nombreuses, en effet, seront les dispositions destinées à limiter le recours à l'AME, plus la santé des personnes les plus fragiles sera atteinte, plus tard elles se présenteront à l'hôpital et plus cher coûteront les soins. En effet, une pathologie qui n'a pas été identifiée à temps a des conséquences beaucoup plus graves et nécessite des soins plus onéreux. L'effet sera donc l'inverse de celui recherché. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas soutenir ce texte.

Les députés du groupe UMP ont été très étonnés de trouver, dans le projet de loi de finances rectificative pour 2012, une disposition visant à abroger les mesures justes, équilibrées et respectueuses du principe d'égalité que l'ancienne majorité avait adoptées pendant la législature précédente : droit annuel forfaitaire de 30 euros, procédure d'agrément préalable pour les opérations dépassant la somme non négligeable de 15 000 euros, guichet unique, alignement de la tarification des soins hospitaliers pour les bénéficiaires de l'aide sur celle applicable aux autres assurés sociaux.
Comme vous, nous avons la volonté de faire reculer dans le pays le racisme et la xénophobie, et de faciliter l'intégration des étrangers en situation régulière. Or les dispositions adoptées en juillet et sur lesquelles cette proposition de loi se propose de revenir ont l'effet inverse. La réaction des citoyens, dans nos circonscriptions – et dans les vôtres aussi, j'imagine –, a été l'étonnement : comment justifier une différence de traitement aussi manifeste entre des Français, des étrangers en situation régulière et des étrangers en situation irrégulière ? La décision que vous avez prise est justement de nature à opposer les Français les uns contre les autres, à renforcer la xénophobie, le rejet de l'autre et les égoïsmes. La proposition de loi que nous examinons a donc pour but de réparer cette erreur.

C'est en revenant sur ce sujet - notamment sur ce fameux droit de 30 euros – que vous relancez le débat et contribuez à monter certains Français – pas tous, heureusement – contre les personnes dites en situation irrégulière qui ont besoin de soins.

Le groupe écologiste est bien évidemment opposé à cette proposition de loi, d'autant qu'il s'était félicité de l'adoption de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012, visant à faciliter l'accès aux soins des bénéficiaires de l'AME en supprimant le droit de timbre de 30 euros. L'objectif de ce dernier n'était pas de créer une nouvelle recette de 5 millions d'euros, comme vous avez voulu le faire croire en l'instaurant à la fin de 2010, mais de bien de réduire le nombre de bénéficiaires.
Votre spécialité est de présenter certaines mesurettes administratives comme des dispositions justifiées par l'exigence de bonne gestion, alors que l'intention qui préside à leur mise en place est tout autre. Cette proposition de loi ne déroge pas à la règle : sous couvert d'encadrer l'AME, le rétablissement du guichet unique, de l'accord préalable et de la franchise n'ont pour but que de rendre plus difficile l'accès à l'aide et dissuader les personnes malades d'y avoir recours. Or les conséquences humaines et sociales seraient très graves : outre la situation personnelle des bénéficiaires, c'est la santé publique qui est en jeu.
L'article 1er de la proposition va à l'encontre des recommandations du rapport de Claude Goasguen – pourtant de votre groupe – et de Christophe Sirugue, rapport qui soulignait l'importance du rôle joué par les associations dans l'accompagnement des demandeurs, en pleine coopération avec les caisses primaires.
L'article 2 aurait pour conséquence de retarder la prise en charge médicale des bénéficiaires.
Quant à l'article 3, en instituant de nouveaux frais, il défavoriserait les plus démunis. L'exposé des motifs parle de « mesure d'équité », mais l'équité ne saurait être recherchée au détriment de la justice sociale.
Un de vos arguments récurrents est que la France est le seul pays à proposer une telle aide. Nous devrions justement en être fiers. L'AME est un dispositif de justice sociale, de solidarité et de santé publique ; elle doit le rester.

Il est inutile de rechercher la polémique. Mais j'aimerais que vous réfléchissiez à ce qu'implique le fait de mieux traiter un étranger entré illégalement sur le territoire national qu'un étranger en situation régulière.

Nous y reviendrons. Les droits sont les mêmes, tous les spécialistes le disent. À ce sujet, vous persistez dans l'erreur.
De même, vous semblez trouver normal que les hôpitaux surfacturent sciemment les soins délivrés aux bénéficiaires de l'AME.

Si, puisque vous demandez la suppression de l'article 2, lequel cherche à mettre fin à une pratique qui coûte à la sécurité sociale 10 ou 12 millions d'euros à Paris et 7 à 8 millions à Marseille. Tous les rapports le prouvent : le tarif appliqué profite à l'hôpital.

Vous l'avez dit vous-même, monsieur Sirugue : les hôpitaux ont compris comment faire porter sur la sécurité sociale le maximum des dépenses. Ils le font au détriment des contribuables et des assurés sociaux, à hauteur de 160 millions d'euros. Votre attitude ne sert pas la volonté du Gouvernement de réduire le déficit de la sécurité sociale. Il sera bien obligé, un jour ou l'autre, de se saisir de cette question, car il est anormal qu'un hôpital facture plus cher les mêmes soins selon qu'ils sont délivrés à une personne entrée irrégulièrement sur le sol national ou à un citoyen français. Si vous acceptez de tels passe-droits, pour ne pas dire de telles « magouilles », vous devrez en porter la responsabilité. On ne peut pas prétendre ignorer de tels faits. Il existe même des filières destinées à faire bénéficier de la procréation médicalement assistée à des étrangers en situation irrégulière.

Cela figure dans le rapport de l'IGAS. De même, certains sont envoyés en cure thermale : ce système est un formidable aspirateur à touristes médicaux.

Ce n'est pourtant pas un hasard si l'Espagne et tous les autres pays européens qui étaient dotés d'un dispositif similaire ont fini par le supprimer. La France est le seul pays à le conserver, et vous en paierez les conséquences économiques et politiques.
Vous poussez même l'absurdité jusqu'à ouvrir aux centres communaux d'action sociale et aux associations la possibilité d'instruire les dossiers, alors que pour tous les citoyens français, l'institution compétente est la caisse primaire d'assurance maladie. C'est une grave erreur. Une association milite pour une cause, elle ne saurait ouvrir des droits à la sécurité sociale. C'est la porte ouverte à la fraude, à l'amateurisme et au copinage.

Mais quels soins ? Et vous, en tant que médecin, soignez-vous gratuitement les bénéficiaires de l'AME, ou facturez-vous le prix de la consultation à la sécurité sociale ?
Il faut voir la réalité en face : tout cela coûte très cher aux assurés sociaux. Le coût de l'AME est devenu insupportable pour la collectivité. On ne peut pas accepter une progression annuelle des dépenses de l'ordre de 13 ou 14 % sans se poser certaines questions de bon sens ni faire preuve de courage.

Je tiens à rappeler une vérité toute simple : il existe un lien de subordination entre le malade et le médecin. Si des cures thermales ou l'assistance médicale à la procréation ont vraiment été prescrites, la responsabilité en incombe à ce dernier.

Tout à l'heure, le professeur Ameisen s'étonnait qu'il existe des positions préétablies dans le débat politique – contrairement, selon lui, à ce qui se passe dans les débats d'ordre éthique. Et Jean Leonetti s'interrogeait : y a-t-il une éthique de droite ou de gauche, une éthique française ? De fait, nous sommes le seul pays à être doté d'un dispositif tel que l'AME, et nous pouvons en être fiers. Ce débat est donc proche d'un débat éthique : il renvoie à une tradition républicaine d'accueil. Les associations qui assistent les étrangers en situation irrégulière sont d'ailleurs souvent des associations confessionnelles, ce qui n'est sans doute pas un hasard. Je note en outre que les députés du groupe UMP sont peu nombreux à défendre la proposition de loi : tous ne ressentent donc probablement pas les choses de la même manière.
Nous parlons de médecine. En tant que médecin, et pour répondre à votre question, il m'arrive de soigner gratuitement – et secrètement – des personnes en situation irrégulière. Je regrette d'ailleurs de ne plus pouvoir leur faire bénéficier des échantillons de médicaments proposés par les laboratoires – mais c'est un autre débat.
Enfin, même en raisonnant de façon purement égoïste, c'est-à-dire en s'en tenant à des préoccupations d'ordre budgétaire, il est absurde de penser que l'application d'une telle proposition de loi pourrait nous faire économiser de l'argent. C'est l'inverse ! D'un point de vue médical, c'est une évidence. Nous sommes déjà confrontés à des cas de rougeole ou de tuberculose alors que les médecins n'en avaient pas vus depuis longtemps. Et je ne parle pas des conséquences dramatiques que l'application de ce texte aurait en matière de chirurgie.

Le groupe GDR, confirmant la position qu'il avait prise lors du débat sur le projet de loi de finances rectificative, ne peut qu'être défavorable à cette proposition de loi, dont l'intention véritable est d'empêcher l'accès aux soins des personnes les plus vulnérables et les plus démunies, ou en tout cas de retarder cet accès. Or une telle politique aurait des conséquences sociales, mais aussi financières : le coût serait beaucoup plus élevé.
Quant à la surfacturation pratiquée par les hôpitaux, si elle existe, elle devrait faire l'objet de sanctions. En tout état de cause, les bénéficiaires de l'AME n'en sont pas responsables et n'en tirent aucun profit. Appliquons donc la loi.
Pour ma part, voir M. Johnny Hallyday bénéficier, sans verser le moindre centime, d'un transport par hélicoptère entre la Guadeloupe et la Martinique afin d'être hospitalisé me choque beaucoup plus que la délivrance à des malheureux de soins indispensables non seulement à leur propre santé, mais aussi à celle de leur entourage. Une prise en charge suffisamment précoce est en effet bénéfique pour la société tout entière, pas seulement pour le malade lui-même.

Nous ne vous ferons pas le plaisir d'un long débat. Cette proposition de loi – d'autant plus choquante qu'elle émane d'un président de groupe, Christian Jacob –, vous fait porter une lourde responsabilité. Cette discussion que vous nous imposez, fondée sur des faits isolés, souvent erronés et généralement travestis, n'obéit qu'à un seul objectif populiste et électoraliste : créer des divisions dans notre pays, et ce n'est pas à l'honneur de votre groupe de commencer ainsi cette session. Le groupe SRC votera contre cette proposition de loi, tant en commission que dans l'hémicycle.

Je rappelle que la réforme de la tarification des soins hospitaliers, que le gouvernement socialiste a commis la grave erreur d'annuler en juillet 2012, était l'une des préconisations de votre collègue Christophe Sirugue, co-auteur du rapport sur l'évaluation de l'AME. Il s'agit d'une mesure de bon sens qui permettait de faire économiser jusqu'à 160 millions d'euros à la sécurité sociale, et qu'il faut absolument rétablir tant le système de tarification actuel est néfaste pour les finances publiques. En vertu de quelle logique un Français devrait-il être davantage facturé, pour les mêmes soins, qu'un étranger en situation irrégulière ?
Je ne connais pas le cas sanitaire de M. Johnny Hallyday, mais cette proposition de loi ne changera rien à l'accès aux urgences et aux soins au titre de l'AME. Elle ne vise que les soins non urgents, dits aussi soins de complaisance ou de confort, comme la procréation médicalement assistée, qui peut coûter jusqu'à 6 000 euros. La possibilité d'en bénéficier gratuitement en France fait prospérer les filières clandestines. Il serait temps de vous poser des questions sur cet état de fait, car les électeurs vous demanderont des comptes.
Cette proposition de loi n'est pas inhumaine, et ne remet pas en cause la santé publique ; elle représente des mesures de bon sens et d'économie auxquelles vous devriez tous souscrire sous peine de voir ce problème revenir au centuple dans deux ou trois ans, quand le coût de l'AME s'élèvera à un, voire à 1,2 milliard d'euros. La France étant le seul pays d'Europe à garder ce système, l'effet d'aubaine est malheureusement évident.
Article 1er : Rétablissement du guichet unique pour les bénéficiaires de l'aide médicale de l'État.
La Commission examine l'amendement AS 1 de M. Christophe Sirugue portant suppression de l'article 1er.

C'est le texte de la Commission qui sera ensuite débattu dans l'hémicycle, donc ne pas défendre ici un amendement aussi important constitue une dévalorisation du travail en commission auquel nous avons tous voulu donner plus de poids.

Monsieur Accoyer, vous êtes arrivé au cours du débat, et tous les arguments ont déjà été largement exposés par la majorité. Lors d'une récente réunion, il vous est même arrivé de ne faire qu'entrer et sortir. Vous n'avez donc pas de leçons à donner en matière de respect de la Commission, et en tant qu'ancien président de l'Assemblée, vous le savez mieux que quiconque.

Je souhaite qu'il soit inscrit au compte rendu de la Commission que M. Accoyer est arrivé après quarante-cinq minutes de débat sur cette proposition de loi, au stade de l'examen des amendements, et qu'il n'a par conséquent ni pu participer au débat, ni entendu la grande qualité des arguments que nous avons opposés à ce texte dont nous avons dit à plusieurs reprises, monsieur Accoyer, qu'il n'honorait pas votre groupe.

Monsieur Sirugue, vous écrivez dans l'exposé des motifs de votre amendement que « la création d'un guichet unique traduit une volonté de restreindre l'accès aux bénéficiaires ». Vous affirmez donc que lorsqu'on passe par une caisse primaire d'assurance maladie, on n'a pas la garantie d'obtenir l'accès aux soins, autrement dit que la sécurité sociale ne remplit pas son rôle – c'est un jugement assez sévère sur cette institution, qui sera apprécié comme il se doit par les assistantes sociales des caisses. Or, dans le dispositif légal, soit on a droit à l'AME, soit on n'y a pas droit, et la possibilité pour les associations et centres communaux et intercommunaux d'action sociale d'intervenir dans la constitution des dossiers ne signifie pas qu'ils puissent octroyer des droits que la loi ne prévoit pas.

Monsieur le rapporteur, l'audition que Claude Goasguen et moi-même avions effectuée à la caisse primaire de Nanterre nous a permis de constater que le fait de n'avoir que les caisses comme porte d'entrée rendait l'accès à l'AME plus compliqué, surtout dans un contexte de réduction du nombre de leurs antennes sur le territoire – fruit de la politique du précédent gouvernement. Or, un service prévu par les lois de la République doit être le plus accessible possible. C'est pourquoi nous avons prévu la possibilité de constituer les dossiers auprès des centres d'action sociale ou par le biais des associations, sachant que seuls les services des caisses – et vous entretenez volontairement la confusion sur ce point – peuvent ensuite procéder à leur instruction.
La Commission adopte l'amendement AS 1.
En conséquence, l'article 1er est supprimé, et l'amendement rédactionnel AS 4 du rapporteur devient sans objet.

Je rassure M. Accoyer qui s'inquiétait de l'importance du travail en commission : même si la Commission rejette ce texte, c'est la proposition de loi initiale qui sera examinée dans l'hémicycle, et il sera possible à chacun de s'exprimer aussi longuement qu'il le souhaite.
Article 2 : Rétablissement de l'agrément préalable en cas de soins hospitaliers coûteux.
La Commission examine l'amendement AS 2 de M. Christophe Sirugue portant suppression de l'article 2.

Les arguments que j'ai développés tout à l'heure dans mon propos portaient sur chacun des trois articles et justifiaient, entre autres, la suppression de cet article 2.

Supprimer l'accord préalable de la sécurité sociale pour des soins particulièrement coûteux, et qui ne relèvent pas de l'urgence, revient à autoriser le tourisme médical. C'est aberrant. Lorsqu'un étranger en situation irrégulière affirme avoir besoin de soins non urgents coûtant plus de 15 000 euros, il serait logique et normal que la sécurité sociale soit informée et puisse donner, ou ne pas donner, un accord préalable.

Que ne l'avez-vous fait ! ce dispositif a été tellement compliqué à mettre en place qu'il n'a jamais fonctionné.

Bien sûr que ce dispositif a été difficile à mettre en place ; mais les économies que nous avons réalisées ne sont pas négligeables.
La Commission adopte l'amendement AS 2.
En conséquence, l'article 2 est supprimé, et l'amendement rédactionnel AS 5 du rapporteur devient sans objet.
Article 3 : Paiement des franchises médicales par les bénéficiaires de l'aide médicale de l'État.
La Commission examine l'amendement AS 3 de M. Christophe Sirugue portant suppression de l'article 3.

Il s'agit de traiter les étrangers entrés légalement sur le territoire national de la même manière que ceux qui y sont entrés illégalement, souvent par le biais de filières organisées. Ce débat ne devrait même pas avoir lieu, tant il s'agit de simple respect de l'égalité entre êtres humains. Il me paraît inconcevable que l'on traite mieux ceux qui entrent illégalement sur le territoire national que ceux qui en demandent l'autorisation.

Comme je l'ai déjà indiqué, si l'on veut traiter tout le monde de la même manière, alors il faut supprimer l'AME et généraliser l'accès à la CMU. Car, comme le montrent les tableaux présents dans les deux rapports de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et dans celui que j'ai réalisé avec Claude Goasguen, la CMU donne des droits plus étendus que l'AME. Nous souhaitons que cet article soit supprimé.

En se focalisant sur la distinction entre étrangers en situation régulière et étrangers en situation irrégulière, le rapporteur omet le fait que beaucoup de personnes aujourd'hui en situation régulière sont entrées en France illégalement et ont été régularisées par la suite. Il est vrai qu'à cause de la politique du précédent gouvernement, qui a durci les conditions d'accès à la régularisation, certaines d'entre elles n'ont pas eu, ou n'ont pas encore cette chance. C'est donc précisément à cause de votre politique d'exclusion que ces personnes se retrouvent dans des situations d'extrême précarité. Par ailleurs, vous parlez de logique, mais j'ai du mal à comprendre la vôtre : vous êtes à la fois contre l'avortement et contre la procréation médicalement assistée ; il faudrait savoir si vous êtes pour la vie ou non.

Je ne suis pas contre la procréation médicalement assistée ; je pense simplement que quand une personne entrée illégalement sur le territoire national demande de bénéficier de cette prestation très coûteuse, le contribuable français peut se poser la question de savoir si elle n'est pas venue dans ce seul but. La France est le seul pays où l'on pratique gratuitement de tels actes pour le monde entier : à vous – et aux électeurs – d'en mesurer les conséquences.
Par ailleurs, M. Sirugue, si l'on va jusqu'au bout de votre raisonnement, il faudra prévoir un amendement du groupe socialiste au prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale supprimant la franchise médicale pour tous les assurés sociaux. Car si cette franchise est inacceptable pour les étrangers en situation irrégulière, elle l'est aussi pour les Français qui pourtant continuent à payer.
La Commission adopte l'amendement AS 3.
En conséquence, l'article 3 est supprimé, et l'amendement rédactionnel AS 6 du rapporteur n'a plus d'objet.
Après l'article 3
La Commission examine l'amendement AS 7 du rapporteur, portant article additionnel après l'article 3.

L'amendement concerne la réforme de la tarification des soins hospitaliers. La règle générale est celle de la tarification à la pathologie, ou T2A, où une prestation hospitalière donnée est facturée d'une façon homogène, dans le privé comme dans le public, en vertu du principe de convergence. Cette règle permet de savoir quel est le prix de revient exact d'une opération dans différents hôpitaux et cliniques, et nous estimons que si elle s'applique aux soins des citoyens français, elle doit également s'appliquer à ceux des étrangers. Je vous propose donc d'ajouter cet article additionnel qui permettra enfin d'en savoir un peu plus sur la façon dont sont tarifés les soins accordés aux étrangers entrés illégalement sur le territoire national.

Ces facturations étaient auparavant portées au titre de créances irrécouvrables ; les hôpitaux les ont ensuite basculées sur d'autres postes, dont l'AME pour les personnes qui relevaient de ce dispositif. Elles ne constituent donc pas une nouveauté dans les budgets : elles y figuraient déjà et ont simplement été affectées sur des lignes différentes.
Nous sommes tous conscients de la nécessité d'aller vers une tarification plus adaptée. Mme la ministre de la santé a annoncé la tenue d'un débat sur ce thème, et nous estimons que c'est dans ce cadre qu'il faudra évaluer la place de l'AME. Nous ne pouvons pas soutenir cet amendement qui nous paraît ici déplacé, mais le sujet mérite que l'on y revienne.

Vous avez raison d'indiquer que l'on facture enfin les prestations pratiquées à l'hôpital. Si la loi oblige tant les hôpitaux que les cliniques à produire une facture, seules les cliniques le faisaient systématiquement – sinon elles n'étaient pas payées –, l'inorganisation de l'hôpital public faisant que l'on pouvait souvent en sortir sans facture, au mépris de la loi. Ces factures sont d'ailleurs également importantes pour le patient, qui a le droit de savoir quels soins lui ont été prodigués, dans quelles conditions et à quel prix. La Cour des comptes note un progrès important dans la facturation des prestations réalisées à l'hôpital, ce qui est très positif.
Sans vouloir lancer une polémique – mais c'est vous, monsieur Sirugue, qui avez abordé ce point –, si l'on devait parler de la dette des pays étrangers envers l'État français, il serait question non de millions mais de dizaines de millions d'euros consacrés aux soins qui ont été prodigués en France à leurs ressortissants et dont la facture n'est pas réglée. Je ne veux pas nommer ces pays, mais il s'agit de sommes considérables.

Dans les excès qui nous emportent tous, vous avez eu des propos exagérés et injustes vis-à-vis de l'hôpital. Vous parliez des assistantes sociales des caisses primaires, mais les personnels de l'hôpital apprécieront, à n'en pas douter, la manière dont vous les traitez.
La Commission rejette l'amendement AS 7.

Tous les articles ayant été rejetés par la Commission, c'est le texte de la proposition de loi initiale qui sera examiné en séance publique le 11 octobre 2012.
La séance est levée à dix-huit heures quarante.