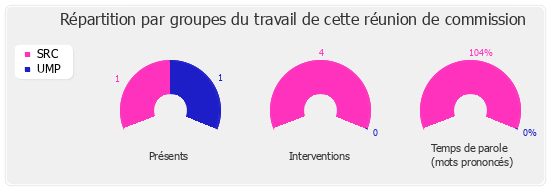Mission d'information commune sur la banque publique d'investissement, bpifrance
Réunion du 16 avril 2015 à 11h00
La réunion

Nous accueillons à présent M. Augustin Landier, professeur à l'École d'économie de Toulouse.
Monsieur, nous avons souhaité vous entendre ce matin afin d'avoir le regard d'un économiste sur le positionnement que devrait avoir une banque publique dans le paysage économique actuel – qui n'est d'ailleurs plus celui qui avait conduit à la création de la BPI. À quels besoins répond-elle aujourd'hui et quelles seraient, selon vous, les conditions de l'efficacité de son intervention ?
Ce qui fait la pertinence d'un outil comme la BPI aujourd'hui, c'est qu'elle semble répondre à la vague entrepreneuriale que connaît la France, que ce soit chez les travailleurs très qualifiés, dans le domaine des high-tech par exemple, ou chez les moins qualifiés, qui souhaitent devenir autoentrepreneurs ou développer des projets même modestes. Cela répond à un besoin de réinventer l'emploi dans notre pays, qui connaît notamment un problème de chômage massif chez les peu qualifiés.
Il s'agit donc pour l'État d'accompagner les PME et la création d'entreprises, et d'éviter à tout prix les situations où de bons projets, c'est-à-dire des projets générant des flux de cash supérieurs en valeur actualisée au coût des investissements initiaux, ne trouvent pas de financeur.
L'analyse de ces situations est tout l'objet de la finance d'entreprise, qui a identifié trois types de cas dans lesquels peuvent survenir des défauts de financement.
Le premier est lié aux asymétries d'information, qui empêchent le financeur d'investir dans un projet. Soit le porteur de projet n'arrive pas à faire la preuve de sa compétence et de sa crédibilité aux yeux des prêteurs, soit l'évaluation du projet requiert de la part du prêteur trop d'investissement en temps pour que cela soit rentable : aucun banquier n'acceptera en effet de consacrer une semaine entière, à l'étude d'un investissement d'une valeur de 5 000 euros.
Le second cas est celui où l'incitation à entreprendre n'est pas assez forte. Cela peut se produire lorsqu'un entrepreneur est obligé de faire intégralement financer son projet par la banque. Dans ce cas, même si le projet était viable à l'origine, il n'en retirerait qu'un revenu trop faible pour le motiver, car une partie importante des revenus générés par son activité sera prélevée par la banque en remboursement de son prêt.
Il y a enfin ce que j'appellerais les situations historiques extrêmes, caractérisées par un dysfonctionnement majeur du marché du crédit. Ce peut être le cas lors d'une crise systémique, comme la crise de 2009 aux États-Unis, qui fut pour le système bancaire un véritable accident nucléaire, ou lors des périodes de transition économique : la reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale ou la réunification allemande. Dans ces situations particulières, les banques ont tendance à adopter des positions attentistes, conscientes que la transition n'aura qu'un temps. L'État peut alors avoir un rôle à jouer, d'autant que ces périodes de transition ont souvent pour origine des chocs politiques majeurs.
Hormis ce dernier cas, les marges de manoeuvres de l'État sont limitées. Lorsqu'il existe des asymétries d'information ou lorsque l'incitation à entreprendre est trop faible, le banquier public est soumis aux mêmes contraintes que l'investisseur privé. Il me semble donc que, si une banque publique d'investissement peut avoir un rôle à jouer dans la gestion de chocs politiques lors de transitions historiques, il faut se poser la question de sa pertinence en régime de croisière.
Il faut ensuite se pencher sur la question des projets non viables – au sens où l'argent qu'ils génèrent directement ne suffit pas à couvrir les investissements initiaux – mais qui engendrent des externalités positives sur le reste de l'économie. C'est essentiellement le cas des projets innovants : en matière d'innovation, un entrepreneur ne s'appropriera qu'une petite partie des rendements générés par son idée, qui sera reprise et transformée par d'autres. C'est également vrai pour l'éducation, et il est établi que les bénéfices à tirer de l'éducation dépassent l'accroissement de salaire induit pour celui qui la reçoit et irriguent, grâce à la diffusion des savoirs et des idées, le reste de l'économie.
On peut enfin évoquer les externalités en termes d'emploi. En période de fort chômage financer un projet créateur d'emplois, même peu rentable, peut être plus intéressant que de subventionner des emplois publics. Dans ce cas pourtant, une banque publique n'est pas nécessairement l'outil le plus approprié, et l'on peut plutôt envisager de recourir soit à des baisses de charges sur les bas salaires pour inciter les PME à embaucher, soit à des allègements fiscaux.
Ce qui suscite ma critique en tant qu'économiste, c'est le discours peu explicite que tient la BPI. Nous sommes certes dans une période où l'État doit restaurer la confiance des acteurs économiques et leur délivrer un discours positif, et c'est exactement dans cette tonalité que s'inscrit la BPI, tant dans sa communication publique que dans sa communication en direction des investisseurs. N'est-il pas naïf cependant d'affirmer comme elle le fait qu'elle va financer des entreprises viables dans un mouvement gagnant-gagnant ? Le rôle de la BPI est-il de gagner de l'argent ou d'en perdre, et n'est-il pas étrange, s'il y a tant d'argent à gagner dans ces investissements, que le système bancaire ne s'y engage pas ? Je rappelle que nous ne sommes plus dans le même contexte qu'en 2009 et que la situation des banques françaises est particulièrement saine par rapport à leurs homologues européennes. C'est ce que démontre une étude que j'ai cosignée avec Jacques Cailloux et Guillaume Plantin pour le Conseil d'analyse économique sur la situation du crédit aux PME en France.
Certes, il y aura toujours des entrepreneurs pour s'étonner que des banquiers leur refusent des prêts, mais il s'agit souvent de problèmes d'informations, face auxquels l'État n'a pas d'avantage comparatif. En revanche, il peut agir pour tenter de limiter les asymétries d'information, par exemple grâce au fichier positif, qui permettrait aux personnes peu qualifiées de prouver qu'elles sont sérieuses sur le marché du crédit, ou encore, comme le prévoit la loi Macron, en élargissant l'accès au fichier bancaire des entreprises, le FIBEN. Le droit des faillites a également toute son importance car, si les banquiers sont parfois frileux, c'est qu'ils savent, en cas de faillite, ils ne récupéreront qu'une faible part de leurs fonds.
La doctrine de la BPI doit être clairement affichée. Son but est-il de financer des projets très rentables – auquel cas elle entre directement en concurrence avec les banques privées – ou entend-elle se spécialiser dans le financement de projets trop incertains pour des banquiers privés, ce qui implique une forte prise de risque et des pertes d'argent ? En tout état de cause, il serait injuste qu'elle gagne trop d'argent, car cela signifierait qu'elle entre dans une concurrence déloyale avec le secteur privé, dans la mesure où un organisme public a toujours l'avantage sur un organisme privé de bénéficier de la signature de l'État et de n'être pas soumis aux mêmes contraintes en termes de gestion du risque.

Vous vous êtes interrogé sur le fait de savoir si le rôle d'une banque publique d'investissement était d'intervenir sur l'ensemble des marchés, y compris pour financer des projets dont la rentabilité était assurée, où si elle devait se concentrer sur les failles de marché ? Au regard de cette alternative théorique, comment jugez-vous l'action de Bpifrance ?
Pourriez-vous nous donner des éléments de comparaison étrangers sur le financement public : je pense en particulier à la KfW allemande ?
Enfin, que pensez-vous des obligations auxquelles est soumise Bpifrance en matière de cofinancement ? Ne sont-elles pas contraires à l'objectif qui consiste à combler les failles de marché ?
Il est très difficile d'évaluer la pertinence de l'action de la BPI à partir des documents officiels disponibles. Ce que l'on peut dire, en revanche, c'est qu'elle axe clairement sa communication sur le fait qu'elle est rentable et affiche des performances comparables à celles du privé.
Quant à son rôle de cofinanceur, c'est une manière pour elle d'écarter toute idée de concurrence avec le secteur privé, dont elle s'affirme le partenaire, arguant du fait qu'elle n'est pas une banque à proprement parler mais un établissement de coopération, qui offre cofinancement et garanties. Cela revient, de manière indirecte et implicite, à subventionner des projets qui ne trouvent pas preneurs, et il me semble qu'il serait plus approprié dans ce cas d'agir par des moyens plus directs, par exemple en baissant l'impôt sur les sociétés. Mais le fait que la BPI n'affiche pas de pertes semble indiquer qu'elle n'assume pas réellement sa doctrine, selon laquelle elle est censée financer des projets à très fortes externalités mais médiocres en termes de cash-flow direct.
Par ailleurs, au lieu de se spécialiser dans un domaine très précis, la BPI est présente partout, témoignant d'une implication croissante de l'État dans le domaine du capital-investissement – private equity –, ce qui n'est nullement nécessaire compte tenu du niveau de développement qu'a atteint dans notre pays ce secteur, qui n'a pas besoin de coup de pouce particulier.
Le fait que la BPI s'engage dans un grand nombre d'affaires est un choix tout à fait judicieux pour assurer sa pérennité, car vous trouverez très peu d'acteurs privés prêts à la critiquer publiquement, par peur d'être mis sur la touche. Reste qu'au bout du compte il n'est pas certain que le secteur privé bénéficie réellement de l'action de la BPI car, si celle-ci affiche des profits, c'est bien le signe qu'elle les confisque pour partie aux investisseurs privés. C'est toute la faiblesse de son positionnement actuel, et je m'interroge sur sa pertinence à présent que nous sommes sortis de la crise systémique pendant laquelle les banques n'étaient plus en mesure de remplir leur rôle.
On est, bien sûr, toujours à la merci de chocs systémiques, et il est important que l'État puisse intervenir, mais il est tout aussi important qu'il le fasse grâce à des dispositifs « biodégradables », c'est-à-dire qui peuvent s'éteindre une fois la crise passée. Or le risque est que ces institutions cherchent à organiser leur propre pérennité, à l'exemple du Plan, judicieusement mis en place au moment de la reconstruction de l'après-guerre. C'est donc là-dessus qu'il faut interroger la BPI : Doit-elle continuer d'exister lorsque l'économie retrouve son rythme de croisière ? En affichant des objectifs contracycliques, elle semble reconnaître elle-même qu'elle a vocation à prendre de l'importance dans les périodes de crise et à réduire la voilure en temps normal.

Formé à l'école de Bernard Schmitt et du circuit, école minoritaire chez les économistes, je m'intéresse aux questions d'amorçage et de fonds de retournement ; c'est en effet là que le bât blesse.
En ce qui concerne l'amorçage, ne conviendrait-il pas de recentrer les actions de la BPI vers ceux qui ne sont pas déjà introduits dans les dispositifs et qui, faute de disposer des informations suffisantes et du bon carnet d'adresses, n'ont pas accès aux financements ? Il s'agit souvent de porteurs de projet qui ont de bonnes idées mais manquent de carburant.
Quant aux fonds de retournement, même si on a dépassé la crise financière, il y a encore des entreprises qui souffrent de difficultés qui n'ont rien à voir avec leur carnet de commandes mais relèvent davantage d'un défaut de gouvernance ou de stratégie. Or, les fonds de retournement tels qu'ils existent actuellement ne sont pas suffisants pour faire face à ce type de situation, et certaines entreprises qui en ont pourtant la capacité ne parviennent pas à rebondir faute de financements. Sans doute la BPI n'est-elle pas suffisamment présente sur ce front ; c'est en tout cas ce qui ressort des propos qu'Henri Emmanuelli a tenus devant nous. Je ne dis pas que la BPI doit être partout, mais il conviendrait qu'elle fasse la preuve de son efficacité là où on attend davantage d'elle.
La question de l'amorçage renvoie à celle du risque, parfois trop important pour que l'entrepreneur puisse démarrer son projet, alors que celui-ci a globalement de la valeur pour la société. Mais il faut alors admettre clairement que l'on se situe dans une logique de subvention, et il existe déjà de nombreux dispositifs prévus à cet effet.
Quant à l'accompagnement, je partage ce que vous dites, mais nous sommes dans un autre registre que celui de la banque. Notre étude sur le financement des PME a clairement mis en lumière que ces dernières souffraient souvent d'une méconnaissance de base des mécanismes comptables, administratifs et financiers, qui pénalisait les chefs d'entreprise. Il y a donc là un véritable besoin, auquel entend d'ailleurs répondre la BPI en lançant Bpifrance Université.
Par ailleurs, il existe en France de nombreux dispositifs de subventions à l'entreprenariat. Je pense notamment aux mesures incitatives à destination des chômeurs souhaitant créer leur entreprise. Je vous renvoie ici à un article de David Thesmar, qui livre une évaluation plutôt positive de ces dispositifs, dans la mesure où les entreprises créées par des chômeurs fonctionnent plutôt mieux que ce qu'on pourrait imaginer.
En ce qui concerne les fonds de retournement, la BPI a délibérément pris la précaution d'éviter le sujet, car elle sait pertinemment qu'en tant qu'acteur public il lui sera impossible de supprimer des emplois. Dès qu'il s'agira d'entreprises d'une certaine taille, elle risque de s'exposer à subir des pressions politiques et aura les plus grandes difficultés à imposer un changement de business model. J'insiste par ailleurs sur le fait qu'imaginer que les investisseurs privés ne sont que de méchants financiers toujours enclins à supprimer des emplois en réalité rentables à court terme relève de la mythologie. Les professionnels du private equity savent identifier les sources de profit et en tirer parti. Je ne vois donc guère ici de faille de marché ; en revanche, j'attire votre attention sur les risques de conflit d'intérêts pour une institution publique placée dans une situation où elle serait contrainte de détruire des emplois.
Encore une fois, les questions de rentabilité renvoient à la fiscalité, au droit des faillites et aux diverses frictions administratives, qui diminuent in fine la part des bénéfices. Mais je persiste à croire qu'il vaudrait mieux user du levier fiscal que de subventions à l'amorçage et que ce circuit qui consiste à redistribuer ce que l'on a prélevé fiscalement dans un premier temps, s'apparente à de la fausse générosité. Si ces procédés sont légitimes en tant de crise, ils ont tendance à perdurer et le système s'auto-entretient : dès lors, en effet, que la fiscalité est élevée peu de projets sont viables.

En tant que députés, nous rencontrons régulièrement des acteurs économiques et des porteurs de projet – j'ai récemment été saisi du cas d'un boulanger souhaitant monter son affaire – qui, malgré un apport conséquent, se voient refuser l'accès au crédit, et ce malgré l'aide de la SIAGI – Société interprofessionnelle artisanale de garantie d'investissement. Il existe donc des failles de marché, et ce peut être le rôle de la BPI que de les pallier. Certes, elle va parfois au-delà, mais Joseph Stiglitz a suggéré hier, dans Les Échos, que la Banque européenne d'investissement pourrait gérer directement des fonds de la BCE : ne pourrait-on donc pas envisager de faire également, demain, de la BPI, un bras armé de la BCE ?
Paradoxalement, la BPI ne finance pas directement les infrastructures – auxquelles Joseph Stiglitz fait sans doute référence – alors que c'est précisément un domaine dans lequel l'État a, comme investisseur, un avantage comparatif : en effet, s'il est parfois difficile de trouver des financements privés pour les infrastructures, c'est que les investisseurs ont toujours peur que l'État ne change les règles du jeu ex post.
En revanche, j'ai du mal à croire que les banques ne soient pas capables de distinguer un projet de boulangerie viable. Peut-être ne disposent-elles pas des bonnes informations, auquel cas il faut trouver le moyen de mieux les informer. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas, à proprement parler, d'une faille de marché, car je vois mal, en l'occurrence, la BPI faire mieux que les banquiers.

La SIAGI peut fournir une lettre de prégarantie certifiant que la viabilité du projet a été examinée en amont par un organisme indépendant. Muni de ce document, le porteur de projet devrait pouvoir obtenir un prêt de sa banque. On pourrait envisager des procédures de ce type pour permettre à des entrepreneurs de ne pas être exclus des circuits de financement.
Vous parlez ici d'une subvention, du même type que les garanties accordées aux propriétaires contre les défauts de loyers. Croire que cela n'a pas de coût est une fiction, et c'est la raison pour laquelle les organismes privés sont très vigilants en la matière. Je trouve dangereux qu'un organisme disposant de la signature de l'État puisse distribuer des garanties ; il doit en tout cas être soumis à la même culture de gestion des risques qu'un organisme privé.

Ne considérez-vous pas que la rationalité des acteurs économiques connaît des limites ? À vous entendre, dans une situation de concurrence libre et non faussée, on devrait parvenir à un équilibre qui rendrait tout le monde heureux, mais c'est faire fi des asymétries d'information, dont vous avez vous-même parlé, et de toute une série d'entraves qui sont bien réelles.
Une partie de mes recherches porte précisément sur la psychologie des acteurs, notamment dans l'entrepreneuriat. Or il me semble que l'entrave majeure dont souffre le marché en la matière, c'est l'optimisme des entrepreneurs. Dans la majorité des cas, les gens sont trop confiants sur la valeur de leur projet, et le rôle du banquier est précisément de tempérer cet optimisme.

Vous assimilez les garanties à des subventions. Or il s'agit d'une part importante de Bpifrance qui, depuis janvier 2015, garantit des projets à hauteur de 200 000 euros, contre 100 000 euros auparavant, sans étude de dossier préalable. Ce dispositif vous choque-t-il ? L'assimilez-vous à une manière de subvention ?
Il s'agit très clairement selon moi d'une subvention, notamment parce que la BPI ne prétend pas avoir en matière d'évaluation des dossiers une compétence que n'aurait pas le banquier. Cette garantie ne serait pas assimilable à une subvention si la BPI détenait un savoir ou des informations confidentielles que ne possédait pas le banquier. Dans ce cas, elle ferait en quelque sorte office d'agence de rating, pouvant procéder à une certification. Mais ce n'est absolument pas le cas : la BPI en sait plutôt moins que les banques sur l'entrepreneur. Je ne pense donc pas que ces garanties aient un fondement économique. Elles se justifient à la limite sur de petits dossiers, à l'évaluation desquels le banquier n'a guère de temps à consacrer, mais pour un montant de 200 000 euros, je ne vois pas comment nommer ces garanties autrement que subventions. Cela étant, un système de subventions peut être utile. C'est une manière de contourner le droit de la concurrence, et il existe des raisons économiques pour subventionner l'innovation et la recherche : c'est en partie le rôle du crédit impôt recherche. Je persiste en tout cas à penser qu'il faut appeler les choses par leur nom.
Un mot pour conclure sur l'exemple allemand, qui doit nous mettre en garde contre les dysfonctionnements de ces organismes, puisqu'une des filiales de l'équivalent allemand de la BPI avait beaucoup investi dans les subprimes américaines. Ce cas d'école illustre parfaitement ce qui peut se produire lorsqu'une institution n'a pas de doctrine très claire sur sa politique et qu'elle n'est pas directement exposée aux mêmes contraintes de gestion des risques que les banques.
Tous les acteurs bancaires n'ont évidemment pas eu un comportement irréprochable mais on peut s'interroger sur les risques de dérive à long terme et les problèmes de gouvernance auxquels peut-être exposée la BPI. Je ne doute pas que ses intentions initiales étaient bonnes mais son action manque de lisibilité et, compte tenu de la prolifération de ses activités et de l'absence de doctrine claire sur la cible de ses interventions, il faut rester vigilants. Nous sommes dans une période où la BPI aurait tout intérêt à recentrer ses actions.