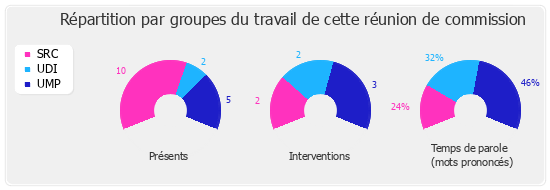Commission des affaires étrangères
Réunion du 1er juillet 2014 à 17h00
La réunion
Table ronde, ouverte à la presse, sur l'Iran en présence de M. François Nicoullaud, ancien ambassadeur de France en Iran, et de M. Ahmad Salamatian, ancien député d'Ispahan, ancien vice-ministre des affaires étrangères iranien
La séance est ouverte à dix-sept heures cinq.

Je vous prie d'excuser Mme Élisabeth Guigou, qui m'a demandé de la suppléer.
Je vous remercie, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Nicoullaud, vous êtes un spécialiste reconnu de l'Iran ; vous avez notamment été ambassadeur de France à Téhéran de 2001 à 2005. Monsieur Salamatian, vous avez été, au lendemain de la révolution de 1979, vice-ministre des affaires étrangères, puis député d'Ispahan. En exil en France depuis la destitution du président Bani Sadr en 1981, vous continuez à consacrer d'importants travaux à l'Iran, notamment un ouvrage sur la Révolte verte de 2009.
Notre table ronde se concentrera sur l'évolution de la situation en Iran, un an après l'élection de M. Hassan Rohani à la présidence de la République islamique le 14 juin 2013 et quelques semaines avant la date butoir du 20 juillet pour les négociations sur le programme nucléaire iranien.
J'ai eu l'honneur de conduire une délégation de cette commission en Iran, composée de MM. Jean-Philippe Mallé, Jacques Myard et Jean-Luc Reitzer. Notre objectif était de contribuer à la relance des échanges parlementaires – étant entendu que seul un accord solide, crédible et durable sur le programme nucléaire iranien permettra à la relation bilatérale de prendre toute son ampleur –, mais aussi de mieux connaître la situation de l'Iran et ses positions sur les principaux dossiers qui intéressent notre commission. Nous avons eu sur place des entretiens très riches et de haut niveau. Les responsables iraniens se disent déterminés à obtenir un accord avant la date du 20 juillet, mais insistent dans le même temps sur les risques d'échec si les parties défendent des positions maximalistes. Il faut espérer un accord permettant de régler ce différent, qui fait peser une menace grave sur la sécurité régionale et sur le régime de non-prolifération. D'autant qu'il pourrait éventuellement en résulter des relations plus constructives sur des dossiers régionaux pour lesquels Téhéran détient manifestement un certain nombre de clés.
M. Rohani a été élu sur un programme de réforme et d'ouverture, après avoir appelé à une interaction constructive avec le monde. Croyez-vous, messieurs, à un règlement durable de la crise nucléaire par la voie diplomatique ? Quelles perspectives cela pourrait-il ouvrir sur les questions régionales, notamment sur la situation en Irak, qui constitue – nous avons pu le constater – un grave motif de préoccupation pour nos interlocuteurs iraniens ? Qu'en est-il de la situation interne sur les plans politique, économique et social, ainsi qu'en matière de droits de l'homme ? M. Rohani a dénoncé un contexte sécuritaire étouffant pendant sa campagne électorale. Dans quelle mesure ce contexte a-t-il évolué ? Un succès diplomatique sur la question nucléaire pourrait-il donner au président Rohani des marges de manoeuvre supplémentaires ? Ou bien toute ouverture du régime paraît-elle illusoire ?
Vous pourrez notamment nous éclairer, monsieur Salamatian, sur le contexte intérieur dans lequel s'insèrent les négociations sur le programme nucléaire, ainsi que sur les conséquences que les acteurs iraniens peuvent en attendre. Monsieur Nicoullaud, vous pourrez ensuite traiter plus spécifiquement de la crise nucléaire et des chances de succès des négociations.
Il existe une vie politique intense en Iran. Sous le gouvernement Hoveida, un des conseillers du Shah s'était plaint, dans ses notes, que Sa Majesté avait fermé la porte au débat politique six ans auparavant et avait laissé la clé sous le paillasson sur lequel elle s'essuyait les pieds chaque matin. Dans le cadre de la République islamique, c'est tout le contraire : on fait de la politique du matin au soir, même si ce n'est pas nécessairement de la bonne politique.
Cela tient à la nature hybride du régime. Dès la naissance de la République islamique – personne ne croyait alors à sa survie, or cela fait trente-cinq ans qu'elle dure –, ses fondateurs ont nourri l'ambition de marier deux principes contradictoires : la théocratie et la démocratie. Après son passage en France – est-ce là l'influence du climat parisien ? –, l'ayatollah Khomeini a cessé de réclamer l'instauration d'un « gouvernement islamique » pour demander une « République islamique ». Et celle-ci est née non pas d'un coup d'État, comme d'autres régimes de même nature, mais d'une révolution.
Dans le droit comme dans la pratique, les institutions de la République islamique prétendent à un caractère démocratique. L'article 6 de la constitution dispose que le président de la République, les députés, les membres des conseils régionaux et municipaux, ainsi que les membres de l'Assemblée des experts – qui désigne le Guide suprême – sont élus au suffrage universel. De plus, l'élection n'est pas un fait nouveau en Iran : le majlis – parlement – a été créé il y a plus de cent ans. Tout dépend donc du contenu que l'on donne aux élections et des limites que l'on impose ou non au choix des électeurs. Reste que les élections sont organisées à échéance régulière et que la participation atteint un certain niveau. En trente-cinq ans d'existence, la République islamique a réussi non seulement à légitimer la procédure du vote aux yeux de la majorité de la population iranienne, mais aussi à la ritualiser. À tel point que les acteurs politiques imaginent difficilement de boycotter une élection aujourd'hui en Iran.
Cependant, ces institutions sont soumises à un carcan théologique : une tutelle, sous l'autorité du Guide, leur impose de travailler dans un certain cadre. Celle-ci a toujours eu tendance à transformer les élections en plébiscites, tandis que les électeurs ont, pour leur part, constamment cherché à disposer du choix le plus large possible. On assiste ainsi à une forme de jeu entre la société et le pouvoir : il s'agit de voir jusqu'à quel point la tutelle peut encadrer les élections et développer une ingénierie visant à éviter que son résultat ne remette en cause les autorités établies ou, au contraire, jusqu'à quel point elle est contrainte d'autoriser une certaine diversité des candidatures pour introduire une forme de compétition, les candidats du pouvoir étant élus de plus en plus difficilement.
Or un troisième élément intervient : une société civile de plus en plus éduquée, évoluée et politisée s'est formée, et elle tend à dominer culturellement l'ensemble de la société iranienne, même les cercles les plus archaïques du clergé. Cette société civile a pris l'habitude de jouer avec les règles des élections encadrées. Chaque fois que se crée une jonction entre la compétition électorale et la mobilisation de la société civile, on assiste à une explosion politique soutenue par la population. L'élection de M. Rohani est un de ces « moments de rencontre » que personne n'attendait. Jusqu'au dernier moment, malgré les sondages, on ne savait pas qui serait élu. Parmi les six candidats, quatre étaient des anciens représentants du Guide, mais ils se sont présentés sous des jours différents. Au cours de la campagne électorale, M. Rohani, qui a fait sa carrière dans les organes de sécurité du pays, a su se démarquer de son adversaire M. Ghalibaf, le maire de Téhéran, qui semblait pourtant incarner une certaine ouverture à la société civile urbaine. Au cours d'un débat télévisé, il lui a rétorqué : « Je suis un juriste, pas un colonel ! »
D'autre part, l'institution du Guide suprême a terriblement vieilli : elle semble aujourd'hui de plus en plus archaïque. Alors que le Guide devait être en principe une source d'imitation, une grande partie de l'establishment religieux remet en cause la doctrine du velayat-e faqih, qui confère à la religion la primauté sur le politique. En outre, le Guide fait face à une contestation croissante de la classe moyenne. L'expérience réformatrice de M. Khatami – pendant huit ans, la présidence et le parlement ont été contrôlés par les réformateurs – a abouti à une certaine remise en cause de l'étendue des pouvoirs du Guide. Cela a constitué une première alerte pour le pouvoir vieillissant, qui a tenté de se raidir face aux exigences croissantes de la société. Mais à la longue, je vois au contraire les signes d'une tentation d'adaptation de ce pouvoir.
D'autant que le Guide porte la responsabilité du bilan catastrophique laissé par M. Ahmadinejad : conflit entre les deux têtes de l'exécutif – le président de la République élu au suffrage universel est censé être un gestionnaire, alors que le Guide est le gardien des principes immuables de la Révolution –, dégradation de la situation économique, sanctions internationales. En effet, M. Ahmadinejad s'était présenté comme le plus plébiscitaire des présidents, « simple soldat dans les rangs du Guide », en totale fusion avec lui.
Au moment de l'élection, M. Rohani a bien compris qu'il devait cultiver sa différence et se montrer critique à l'égard de la politique menée antérieurement. Soulignant l'importance du poste de président de la République, il est allé jusqu'à déclarer qu'il souhaitait des changements profonds. Acculé, le Guide a accepté son élection. À la différence de ses prédécesseurs, M. Rohani connaît très bien le sérail, au sein duquel il a lui-même évolué : il a présidé pendant dix-huit ans la commission de la défense du parlement iranien ; il a également été le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale pendant plus de dix ans et le représentant du Guide à la tête d'un think tank important, le Centre de recherche stratégique du Conseil de discernement. Au sein de cet institut, il a réuni les meilleurs éléments de la République islamique.
Après les événements de 2009, qui ont amené le régime au bord d'un affrontement avec la population, il s'est présenté comme un modéré, acceptant les priorités des uns et des autres, mais le règlement du problème nucléaire est resté sa première préoccupation. Je suis convaincu qu'il voulait déjà le faire en 2003 avec M. Khatami. Mais, à ce moment-là, les déclarations américaines classant l'Iran dans l'« axe du mal » ont entraîné un raidissement d'une partie des organes de sécurité iraniens – ce sont les tensions qui permettent à ceux-ci de promouvoir leurs intérêts. Or les principaux rivaux du Guide au sein du sérail sont précisément les organes de sécurité, notamment les Gardiens de la Révolution. C'est pourquoi le Guide a finalement préféré M. Rohani à M. Jalili ou à M. Ghalibaf, qui étaient, pour différentes raisons, plus dépendants que lui de ces organes.
Actuellement, le président Rohani ne dispose pas de la majorité au parlement, mais son élection lui confère suffisamment d'autorité pour conduire les négociations sur le programme nucléaire d'une manière telle que la République islamique n'a jamais pu les mener auparavant. Les cadres iraniens chargés de la négociation sont les meilleurs diplomates que la République islamique pouvait produire. Ils ne sont pas issus des écoles religieuses. Au ministère des affaires étrangères, on les appelle la « bande de New York », non pas parce qu'ils seraient compréhensifs à l'égard de la politique américaine, mais parce qu'ils connaissent très bien les rouages de la diplomatie internationale et le langage juridique, et qu'ils savent où les a acculés la politique de défi contre-productive de M. Ahmadinejad.
M. Rohani cherche à limiter les conséquences politiques internes du problème nucléaire. L'enjeu, ce sont les prochaines élections législatives. En principe, en Iran, le résultat des élections législatives est conforme à celui de l'élection présidentielle qui les a précédées. Seul un échec des négociations peut empêcher M. Rohani de l'emporter. D'où l'empressement de la partie iranienne à conclure un accord. Actuellement, M. Ahmadinejad ne compte qu'une trentaine de partisans au sein du parlement. Bien que ces députés bénéficient du soutien de la télévision et d'une partie des conseillers du Guide, ils ne sont pas en mesure de faire adopter une motion de censure. Mais si le résultat des négociations n'est pas probant, les adversaires de M. Rohani auront davantage de chances de prendre le contrôle du parlement.
La classe moyenne iranienne aspire à s'insérer dans le monde moderne et dans la compétition internationale. La société civile n'est pas favorable à l'affrontement, et les images des guerres civiles en Syrie et en Irak lui font horreur. Les Iraniens prendront leur temps pour choisir entre un pays transformé en champ de bataille et une évolution vers la démocratie ! Un peu à l'image des Français sous la IIIe République, ils sont las de la guerre et ils participent aux élections pour influer sur le cours de la politique. L'arrivée au pouvoir de Rohani a déjà permis d'alléger une partie de la charge économique de l'État.
Le rapport de forces tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Iran n'a jamais été aussi favorable à la conclusion rapide d'un accord solide et durable sur le dossier nucléaire – on n'est jamais sûr de rien en politique, mais je suis d'un naturel optimiste. Ce rapport de forces s'impose à tous les acteurs. M. Rohani et M. Zarif, le ministre des affaires étrangères, ont besoin d'un accord pour assurer leur avenir politique. De nombreuses personnalités, même celles qui sont en résidence surveillée ou en prison, se sont dites favorables à l'aboutissement des négociations, ne serait-ce que pour éloigner la menace d'une militarisation du pouvoir iranien.
Quant au Guide, certains signes montrent qu'il serait prêt à accepter l'accord à condition qu'il lui permette de sauver la face. Comme je l'ai indiqué, il est handicapé par le bilan de M. Ahmadinejad : chaque critique de la politique économique ou de la diplomatie de ce dernier s'adresse indirectement à lui. Pour l'instant, il s'abrite derrière un prétexte : il affirme que les Américains, une fois de plus, ne permettront pas qu'on aboutisse à un accord. Derrière cette assertion se trouvent les organes de sécurité, qui savent très bien qu'un conflit créerait le vide autour d'eux et leur permettrait de s'imposer dans tous les rouages de l'État. L'enjeu des négociations menées par le gouvernement de M. Rohani, c'est donc aussi l'avenir politique du pays : l'Iran a le choix entre un régime militaire à la pakistanaise ou un début de démocratisation. En tout cas, tout le monde s'accorde pour dire que l'ère de l'idéologie et des mythes est désormais révolue en Iran : la République islamique ne va plus chercher son modèle à Médine il y a quatorze siècles. D'autant qu'elle s'est elle-même construite sur les bases laissées par l'Iran moderne, État-nation le plus ancien de la région.
Je suis très heureux de m'exprimer après mon ami Ahmad Salamatian, dont la voix est très respectée par tous ceux qui s'intéressent à l'Iran et au Moyen-Orient. Le tableau qu'il a dressé me facilite beaucoup la tâche.
Demain à Vienne vont s'ouvrir les négociations entre l'Iran et les « 5 + 1 », c'est-à-dire les cinq membres du Conseil de sécurité des Nations unies et l'Allemagne. L'objectif est d'aboutir à un accord définitif en trois semaines, avant la date butoir du 20 juillet, qui a été arrêtée dans l'accord intérimaire du 24 novembre 2013. Cet accord avait permis de prolonger les discussions d'un délai de six mois éventuellement renouvelable, mais toutes les parties sont désormais assez pressées d'aboutir. Il s'agit d'un bon accord, à la qualité et à la solidité duquel les Français ont contribué, notamment en intervenant de manière assez vigoureuse et remarquée au moment de son bouclage. D'une part, il a fixé le point d'aboutissement de la négociation et dessiné les grandes lignes d'un accord définitif, ce que les Iraniens attendaient depuis longtemps. D'autre part, il a défini les gestes de bonne volonté que les deux parties devaient accomplir pendant la période intérimaire pour paver la voie à l'accord définitif : allègement de certaines sanctions du côté des Occidentaux ; ralentissement du programme nucléaire du côté iranien, afin de faire baisser le niveau d'inquiétude de la communauté internationale.
Les deux parties ont été poussées à négocier par le système très impressionnant de sanctions mis en place à l'égard de l'Iran dans les dernières années – selon le président Obama, il s'agit du dispositif de sanctions le plus complet jamais adopté en temps de paix à l'époque contemporaine –, tant en raison du succès relatif de ces sanctions que de leur échec partiel. En effet, les sanctions ont en partie atteint leur objectif : elles ont ralenti, voire fait régresser l'économie iranienne, ce qui s'est traduit par une baisse du pouvoir d'achat de la population. Elles ont créé une crise, dont les Iraniens souhaitent aujourd'hui sortir. M. Rohani en a fait un de ses thèmes de campagne et a utilisé à cet égard un slogan frappant : « Ce n'est pas la peine d'avoir des centrifugeuses qui tournent si, pendant ce temps-là, l'économie ne tourne pas ! »
Néanmoins, les sanctions ont aussi échoué en partie : même si elles ont créé de nombreux obstacles à la poursuite du programme nucléaire iranien, elles ne l'ont pas empêchée. Il y a dix ans, l'Iran possédait quelques dizaines de centrifugeuses. Malgré la montée en puissance des sanctions au cours de ces dix années, il disposait de quelques milliers de centrifugeuses au bout de cinq ans et en a aujourd'hui environ 20 000, dont 10 000 fonctionnent effectivement. Il s'agit certes, d'une première génération de centrifugeuses, d'un modèle très primitif, qui ne permettent pas de produire de l'uranium à une échelle industrielle et de répondre aux besoins d'un parc de centrales nucléaires. Mais ce nombre relativement restreint de centrifugeuses est tout de même suffisant pour produire en quelques mois l'uranium hautement enrichi nécessaire à la fabrication de une à quatre bombes. Conscients des implications de ce programme nucléaire en termes de prolifération, les Occidentaux en sont venus à la conclusion qu'il fallait négocier pour arrêter ce programme, la seule alternative étant des frappes aériennes, c'est-à-dire la guerre.
La volonté d'aboutir est très forte des deux côtés. Comme l'a très justement relevé Ahmad Salamatian, les Iraniens sont pressés par le contexte de politique intérieure : les fondamentalistes, notamment, sont en embuscade. Quant au président Obama, il souhaite lui aussi parvenir à un accord. D'une part, c'est à peu près le seul succès de politique internationale dont il pourra se targuer à l'heure du bilan, tout le reste ayant échoué. Cela peut être un événement de la portée du voyage de Nixon en Chine, qui a marqué un changement d'époque. D'autre part, M. Obama a intérêt à boucler la négociation avant les élections de mi-mandat à l'automne prochain : il est possible que le Congrès, déjà très crispé sur le dossier nucléaire iranien, le soit plus encore après son renouvellement, et que le président ait alors de grandes difficultés à faire accepter l'idée que les États-Unis doivent eux aussi remplir les engagements qu'ils auront souscrits au titre d'un éventuel accord, c'est-à-dire alléger les sanctions. M. Obama sent bien que tout retard et tout signe de délitement de la négociation donnera des ailes à tous les pays qui s'inquiètent d'un renforcement de l'influence de l'Iran dans la région, en particulier à l'Arabie saoudite et à Israël, qui disposent d'une certaine influence à Washington.
Cependant, les négociateurs vont être confrontés à de redoutables obstacles techniques sur le fond du dossier. Jusqu'ici, la ligne américaine – répétée par tous les responsables politiques – a été : « Mieux vaut pas d'accord du tout qu'un mauvais accord. » Selon les explications des experts, un « mauvais accord » serait un accord qui permettrait à l'Iran d'accumuler suffisamment d'uranium hautement enrichi en moins de six mois pour produire une première bombe. Il faudrait donc absolument diviser par deux, trois ou quatre la capacité actuelle du parc iranien de centrifugeuses, c'est-à-dire démanteler ce parc en grande partie.
Un « mauvais accord » serait en outre un accord qui ne permettrait pas de faire toute la lumière sur le programme nucléaire clandestin développé par l'Iran à la fin des années 1980 et dans les années 1990, comme le demandent l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et l'ensemble de la communauté internationale. Même s'il a mis fin à ce programme, l'Iran devrait donc avouer tout ce qu'il a fait au cours de cette période, avant que les Occidentaux passent définitivement l'éponge et lui délivrent un brevet de bonne conduite.
Un « mauvais accord » serait aussi un accord qui autoriserait la mise en service du réacteur d'Arak – les Français ont mis ce point au premier plan. Il s'agit en principe d'une installation à vocation scientifique, mais qui présente toutes les caractéristiques d'un réacteur destiné à la production massive de plutonium, matière avec laquelle il est possible, comme avec l'uranium hautement enrichi, de fabriquer une bombe nucléaire. Le réacteur d'Arak ressemble beaucoup à ceux de Dimona en Israël, de Trombay en Inde ou de Khushab au Pakistan, qui ont tous fourni du plutonium entrant dans la composition de bombes.
Un « mauvais accord » serait enfin un accord qui ne se concentrerait que sur la question nucléaire et laisserait de côté le programme balistique que l'Iran continue à développer. Il s'agit en effet du deuxième volet de la constitution d'une force de dissuasion : il ne suffit pas de disposer de la bombe, encore faut-il avoir les moyens de lui faire atteindre une cible.
Si l'on additionne tous ces arguments, auxquels il est difficile de résister, on s'aperçoit qu'un « mauvais accord », c'est, au fond, un accord qui ne serait pas parfait. L'aboutissement des discussions est donc menacé non seulement par les éléments extérieurs que j'ai mentionnés – Congrès, classe politique, États rivaux de l'Iran –, mais aussi par ceux qui, à l'intérieur des équipes de négociation, souhaitent arriver à un accord parfait. Les spécialistes de ces questions ont tendance à considérer que la non-prolifération est un enjeu tellement important pour l'équilibre et la sécurité du monde qu'elle ne mérite que des accords parfaits. Or, dans la réalité, la limite entre un « bon » et un « mauvais » accord est ténue : la vie politique comme la négociation internationale se nourrissent de compromis qui, par définition, ne sont ni parfaits ni entièrement satisfaisants pour l'une ou pour l'autre partie.
D'un côté, les Iraniens ont tendance à placer la barre très haut au départ, afin de fatiguer l'adversaire et de pouvoir négocier à leur aise. Ainsi, ils expliquent qu'ils auront besoin de 50 000 et bientôt de 100 000 centrifugeuses afin d'alimenter en uranium leur futur parc de centrales nucléaires, lequel n'existe pourtant que sur le papier : actuellement, une seule centrale fonctionne, celle de Bouchehr, et elle est alimentée par les Russes.
De l'autre côté, certains confèrent à la non-prolifération un caractère quelque peu transcendantal et estiment que l'Iran devra posséder au plus quelques milliers, voire quelques centaines de centrifugeuses, comme ont pu l'affirmer les négociateurs français. C'est oublier que les normes de non-prolifération elles-mêmes sont issues de compromis parfois boiteux, à commencer par le Traité de non-prolifération (TNP). Aux termes de celui-ci, certains États ont le droit de conserver et même de développer leur arsenal nucléaire, mais pas les autres. Quant aux pays qui ont pris l'engagement de ne pas acquérir la bombe, ils peuvent néanmoins développer leurs capacités jusqu'à une limite extrême au-delà de laquelle ils basculeraient dans la fabrication d'un engin nucléaire. Au moment où le TNP a été signé, beaucoup ont estimé qu'il était mauvais, notamment les Français, qui ont mis près de vingt-cinq ans – soit une génération – pour y adhérer. Aujourd'hui, le TNP fait encore l'objet de nombreuses critiques. Est-ce à dire qu'il aurait mieux valu, à l'époque, « pas d'accord du tout » que ce « mauvais accord » ? Non, le TNP a constitué un immense progrès en matière de non-prolifération.
Il conviendrait d'ailleurs d'en revenir à cet esprit dans la négociation qui s'ouvre et d'accepter, avec un peu d'humilité, qu'on n'arrivera pas à un accord parfait, et qu'il faut laisser un peu de travail aux négociateurs suivants. Un accord même imparfait crée un nouveau cadre, dans lequel de nouvelles dynamiques, le cas échéant vertueuses, peuvent s'enclencher. Lorsqu'il est bien appliqué, un tel accord devient une machine à créer de la confiance entre les parties. Il faut tenir compte de ce phénomène.
En l'espèce, la négociation risque d'achopper in fine sur un point très précis : les capacités d'enrichissement que l'Iran sera autorisé à conserver. Du point de vue de l'observateur extérieur, le compromis apparaît assez évident : il s'agirait que l'Iran accepte de plafonner ses capacités d'enrichissement à leur niveau actuel. Pour ce faire, il faut que les Occidentaux acceptent l'idée qu'il est politiquement impossible, pour le Gouvernement et les négociateurs iraniens, d'afficher un accord qui imposerait un démantèlement, même partiel, d'installations dont la mise en place a coûté des efforts considérables. Un tel accord ferait immédiatement l'objet d'une volée de critiques de la part des différentes composantes de l'opposition, qui demeurent majoritaires au sein du régime. Cela fragiliserait sérieusement M. Rohani et son gouvernement. D'autant que le Guide lui-même a fixé certaines lignes rouges, même s'il laisse beaucoup de liberté aux négociateurs iraniens. L'une d'elles est de n'accepter aucun démantèlement, aucun recul par rapport au point où l'Iran est arrivé.
Mais lorsque les Iraniens revendiquent le droit de faire fonctionner 100 000 centrifugeuses, ce n'est pas sérieux non plus. Ils doivent accepter l'idée qu'ils peuvent s'en tenir à leurs capacités d'enrichissement actuelles pendant plusieurs années, tant qu'ils ne disposent pas des centrales nucléaires capables d'absorber une production d'uranium à l'échelle industrielle. Plutôt que d'accumuler des stocks d'uranium, leur intérêt serait d'ailleurs de travailler sur la recherche et le développement, afin de mettre au point des centrifugeuses qui dépassent le modèle primitif et peu efficace dont ils disposent actuellement.
Si l'on parvient à ce point d'équilibre – plafonner les capacités d'enrichissement de l'Iran à leur niveau actuel –, on entendra hurler des deux côtés que l'accord est très mauvais. Mais si le niveau de protestation est à peu près équivalent de part et d'autre, cela voudra dire que l'on est arrivé à un bon compromis, à partir duquel il est possible de construire l'avenir.
En définitive, je retournerais la formule utilisée par les Américains : « mieux vaut un accord imparfait que pas d'accord du tout ». Car une absence d'accord signifierait que l'Iran poursuit son programme nucléaire, que l'inquiétude de la communauté internationale continue à croître, que l'on risque de s'engager, avec des frappes aériennes, dans une aventure incertaine. À l'opposé, un accord signé, même imparfait, quand bien même il faudrait maintenir une certaine pression pour l'améliorer ultérieurement, serait synonyme de détente pour les deux parties, c'est-à-dire d'une ouverture pour la société iranienne et d'un soulagement pour la communauté internationale. L'Iran pourrait retrouver la place assez naturelle qui lui revient dans la région, et nous augmenterions les chances d'un apaisement dans cette partie du monde, qui en a bien besoin.

Notre délégation a été reçue par la représentante du groupe des femmes au parlement iranien. Elle nous a expliqué que les femmes constituaient 60 % des étudiants dans les universités du pays et qu'elles accédaient très facilement à toutes les professions, y compris celles d'ingénieur et de pilote de ligne. Pour ma part, j'ai ressenti une certaine oppression physique. Selon vous, comment la situation des femmes évolue-t-elle en Iran ?
Est-il exact qu'il existe une fatwa interdisant à l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire ?

À votre connaissance, y a-t-il, au sein du clergé chiite, une réflexion critique, voire une remise en cause de la théocratie telle qu'elle a été formalisée par l'ayatollah Khomeini ?
L'Irak est un pays important pour l'Iran : les deux États partagent une longue frontière ; la population irakienne est en majorité chiite ; plusieurs lieux saints du chiisme se trouvent en Irak. Quelle est la position de la population iranienne, d'une part, et du régime, d'autre part, sur les événements en Irak ? Quelles peuvent en être les conséquences sur les relations avec les États-Unis ?
Les Kurdes constituent une minorité importante dans plusieurs pays de la région. En Irak, ils protègent une partie importante de la population contre les djihadistes. Quelle est l'attitude des Iraniens et de leurs dirigeants à l'égard des Kurdes ?

Nous en convenons tous : il faut absolument trouver une solution diplomatique à la crise nucléaire iranienne. La France est d'ailleurs en première ligne sur ce dossier.
Cependant, les Occidentaux se sont fait rouler dans la farine pendant des années : l'Iran a signé le TNP, mais trois sites nucléaires cachés ont été découverts à Fordow, Natanz et Arak grâce à l'opposition iranienne – j'étais présent vendredi dernier à une grande manifestation organisée par les opposants iraniens en exil, aux côtés de M. Liberman, de M. Zapatero, de Mme Alliot-Marie et de M. Kouchner. L'Iran n'a aucune raison de nature économique ou civile de mettre en oeuvre son programme nucléaire. S'il souhaite développer l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, il peut très bien acheter des centrales à l'étranger, comme il l'a fait récemment en construisant le réacteur de Bouchehr en coopération avec la Russie. Or les objectifs des Iraniens sont uniquement militaires : comme vous l'avez rappelé, monsieur l'ambassadeur, ils sont en train de mettre au point des missiles balistiques d'une portée de 2 500 kilomètres.
Pourtant, 600 condamnations à mort ont été prononcées en Iran l'année dernière. La situation des femmes, des homosexuels, des journalistes et des minorités est préoccupante. Internet est bloqué. À l'extérieur, l'Iran continue à soutenir Bachar Al-Assad – qui est déjà responsable de la mort de près de 160 000 personnes –, le Hezbollah et les mouvements terroristes dans la bande de Gaza. Comme l'a rappelé notre représentant permanent adjoint auprès des Nations unies, un rapport de l'ONU – dont le contenu a filtré la semaine dernière – a établi que la cargaison de missiles embarquée sur le fameux navire Klos-C provenait d'Iran. Cette situation suscite une immense inquiétude. Or ce n'est plus M. Ahmadinejad qui est au pouvoir, mais bien M. Rohani. De quelle crédibilité le régime iranien peut-il encore disposer s'il fait précisément l'inverse de ce à quoi il s'est engagé ?
L'acquisition de l'arme nucléaire par l'Iran se solderait par un embrasement de la région, de la Turquie à l'Égypte. Toutes les parties, y compris la Russie, souhaitent une solution diplomatique. Nous aurons gagné si nous obtenons trois choses : le démantèlement complet des installations nucléaires militaires, y compris du réacteur à eau lourde d'Arak ; la fermeture du site de Fordow, construit à trente ou quarante mètres sous une montagne ; le démantèlement de l'usine d'enrichissement de Natanz et, si possible, la sortie d'Iran de la totalité de l'uranium enrichi. Nous devons donc maintenir la pression. Pensez-vous que nous parviendrons à un tel accord ?

L'Iran a régi très rapidement pour venir en aide à son voisin irakien, menacé par le chaos. Des Gardiens de la révolution sont également présents en Syrie. D'un côté, Washington se propose de travailler avec Téhéran. De l'autre, le vice-ministre des affaires étrangères russe a rencontré récemment son homologue iranien. Une coopération de l'Iran à la fois avec les États-Unis et avec la Russie serait inédite. Cela correspond-il à un changement de stratégie ? Ce contexte peut-il influer sur la négociation qui commence demain à Vienne sur la question nucléaire ?

L'Iran est voisin de l'Azerbaïdjan, de l'Arménie et de la Turquie. Il a développé des relations économiques avec l'Arménie, d'autant plus importantes pour ce pays qu'il est en conflit avec l'Azerbaïdjan et que la Turquie lui impose un blocus. Au Haut-Karabagh, un cessez-le-feu est en place depuis vingt ans, mais il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait des blessés ou des morts. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) tente de régler le conflit avec le groupe de Minsk, coprésidé par la France, les États-Unis et la Russie. L'Iran pourrait-il jouer un rôle pour débloquer la situation et parvenir à une paix véritable ?

Quand on voyage en Iran, même pendant trois jours, on est frappé par la vitalité de la société civile. Celle-ci utilise beaucoup les réseaux sociaux, ce qui pose visiblement problème aux autorités. En outre, l'égalité entre les femmes et les hommes semble une réalité, à quelques nuances près.
Nous cherchons à contrôler la situation, mais en ajoutant les sanctions aux sanctions, nous arrivons à une situation de blocage. Le peuple iranien est fier de son passé et très nationaliste. L'Iran a pris conscience de son poids dans la région, et nous de nos faiblesses. C'est un pays incontournable. Certes, nous ne devons rien céder sur l'essentiel et il convient de sceller un certain nombre de garanties dans l'accord, mais un compromis même boiteux, un « mauvais accord » est sans doute la seule solution pour créer une dynamique et faire évoluer le régime.

De même que Jacques Myard, j'ai été frappé par le dynamisme de la société iranienne. Nous nous attendions à trouver une société exsangue à cause des sanctions. Or les magasins offrent toute la palette des biens de consommation, et les Iraniens ne semblent manquer de rien. On nous a bien dit que certaines industries – l'aéronautique, le bâtiment – souffraient, car des pièces font défaut. De même, il est difficile d'effectuer certaines transactions financières internationales – on ne peut d'ailleurs pas utiliser de carte bancaire. Mais quel a été l'effet réel des sanctions pour le citoyen iranien dans sa vie quotidienne ? On l'a, semble-t-il, surestimé.
Dans les administrations et dans la rue, nous avons très souvent vu la photo de l'ayatollah Khomeini et celle du Guide actuel. En revanche, nous n'avons jamais vu celle de M. Rohani. D'une manière générale, on nous a parlé du Guide, de tel ou tel ministre influent, mais guère du président de la République. Quel est le rôle réel de ce dernier ?
S'agissant de la situation des femmes, on voit moins de voiles dans les rues de Téhéran ou d'Ispahan que dans celles d'Istanbul. Au restaurant, les femmes sont maquillées et habillées à l'occidentale. J'ai d'ailleurs lu que le marché des cosmétiques était particulièrement dynamique en Iran. L'évolution de la société iranienne semble donc contraster avec l'image véhiculée par les médias, celle d'un islam intégriste et de femmes opprimées. Confirmez-vous cette analyse ?
Je commencerai par évoquer la situation des femmes. Souvent, par l'excès de zèle, on obtient un résultat contraire à celui que l'on souhaitait. Quand les religieux ont pris le pouvoir en Iran, l'évolution de la société était balbutiante : il y avait un petit nombre de femmes iraniennes modernes, derrière une jolie vitrine. Les religieux ont jeté des pierres sur cette vitrine, et les morceaux se sont éparpillés dans toute la société. Aujourd'hui, la société iranienne est féminisée. En termes d'évolution des mentalités sur la place des femmes, elle est même l'une des plus évoluées au Moyen-Orient, si ce n'est la plus évoluée – je suis prêt à soutenir ce point de vue face à quiconque.
Je donnerai un seul exemple. Avant la révolution de 1979, l'âge légal du mariage était de quinze ans en Iran. Cependant, le législateur avait prévu une dérogation : les jeunes filles pouvaient se marier dès treize ans si leurs parents le demandaient. Résultat : les bureaux qui étaient chargés de délivrer ces dérogations étaient l'une des administrations les plus fréquentées du pays ; les mères mettaient du coton dans le soutien-gorge de leurs filles pour montrer que celles-ci étaient en âge de se marier. En définitive, l'âge moyen auquel les jeunes filles se mariaient était de treize ans. La République islamique a ramené l'âge légal du mariage à neuf ans, comme c'était le cas dans la charia à Médine il y a quatorze siècles. Mais, après trente-cinq ans de régime islamique, l'âge moyen auxquelles les jeunes filles se marient en Iran est aujourd'hui de vingt-six ans. C'est un miracle démographique !
Aujourd'hui, les femmes iraniennes sont présentes dans la vie politique et dans toutes les professions. Elles produisent plus de films que les hommes. Il y a quelques années, j'ai aidé le maire d'Évry – l'actuel premier ministre – à organiser un festival de cinéma féminin iranien dans sa commune. Ensuite, la mairie de Paris a voulu en faire un à son tour. Elle a posé comme condition que les cinéastes aient déjà réalisé trois longs métrages et cinq courts métrages, diffusés à l'écran. Un responsable des affaires culturelles de la mairie de Paris s'est alors rendu en Iran et a identifié trente-cinq réalisatrices pour participer au festival !
Ne vous laissez pas abuser par deux mètres de tissu sur la tête des femmes ou sur celle des mollahs : sous le tchador, il y a des femmes, et sous le turban, il y a des cerveaux – ce qui ne veut pas dire que ces cerveaux pensent toujours bien.
Je n'ai jamais dit que tout allait bien ! La société iranienne a une histoire ancienne et elle est entrée dans un processus de modernisation complexe. Mais je ne fais pas non plus partie des Iraniens d'Auvers-sur-Oise ! Ceux qui s'enferment dans les stéréotypes ne voient pas la réalité.
On a dit que M. Rohani était le seul religieux candidat à l'élection présidentielle. Or, quand je l'ai connu, il était étudiant à l'université de Glasgow, s'appelait Hassan Feridon et ne portait pas de turban. Aujourd'hui, il s'appelle « Rohani » – qui signifie « religieux » – et porte un turban. Mais en réalité, parmi les six candidats en lice, c'était le moins religieux de tous. L'habit ne fait pas le moine ! Les Iraniens ont suffisamment d'expérience pour ne pas se laisser abuser par les apparences.
Je le répète : la vie politique en Iran est intense, et l'évolution de la société rend le régime de plus en plus anachronique. Quant aux véritables adversaires de ce pouvoir archaïque, ils se trouvent non pas dans les think tanks militaires étrangers, mais au sein même de la société iranienne. On n'exporte pas la démocratie par les armes ! Ou alors, vive la démocratie irakienne !
J'en viens à la place de l'Iran dans la région. Si vous observez la situation de manière dépassionnée, vous constaterez que, d'Istanbul à New Delhi et du sud du Caucase à la Corne de l'Afrique, il n'y a pas d'entité politique plus construite, consistante et intégrée que l'Iran. Et ce n'est pas là l'oeuvre des mollahs ! Nous vivons une époque de pouvoir émergent.
Alfred Grosser disait : « Si ce n'est pas l'Empire du Milieu, c'est le milieu des Empires ». Que veut dire « être au milieu des Empires » ? Cela signifie que votre position géopolitique et géostratégique vous donne des moyens de dissuasion en vous dispensant de recourir aux armes. L'Iran a des frontières avec dix-huit pays, qui peuvent être regroupés en six ensembles : le Caucase, l'Asie centrale, l'Asie du Sud, le golfe Persique, la Mésopotamie et la Turquie. Observez quelle est la politique du pays à l'égard de chacun de ces ensembles : elle peut avoir des effets importants sur l'évolution du contexte stratégique. Ainsi, bien que la population chiite soit proportionnellement plus importante en Azerbaïdjan qu'en Iran, la République islamique a su adopter une position bienveillante à l'égard de l'Arménie. Le génocide arménien est commémoré chaque année en Iran. La communauté arménienne d'Ispahan – où j'ai été député – est un des lobbys qui militent le plus activement en faveur d'une normalisation des relations entre l'Iran et la France.
D'autre part, l'Iran a une tradition diplomatique déjà ancienne. Au XVIIIe et au XIXe siècle, le pays était en déclin et n'avait pas d'armée. Les troupes russes et britanniques étaient présentes sur son territoire. Comment l'Iran a-t-il conservé sa place ? Grâce au jeu diplomatique qu'il a développé en s'appuyant sur sa position géographique. Le grand poète iranien Nizami – qui est né à Gandja et dont la statue a été installée à la place de celle de Lénine sur la place principale de Bakou – a écrit : « L'Iran est le coeur et l'univers le corps. De cette parole, le poète ne ressent ni humilité ni remords. »
Il suffirait de faire comprendre aux gouvernements iraniens, qu'ils soient enturbannés ou couronnés, qu'ils n'ont pas besoin, dans une telle situation géopolitique, de l'assurance-vie qu'est censée constituer la bombe nucléaire. L'assurance-vie nucléaire s'est d'ailleurs révélée caduque tant pour l'Union soviétique que pour l'Afrique du Sud, et elle n'a pas empêché les attentats du 11 septembre 2001. Les mollahs ont suffisamment de cervelle sous leur turban pour le comprendre : ils sont en train de négocier habilement sur le dossier nucléaire, afin de pouvoir insérer l'Iran dans la société internationale. Ils sont prêts à jouer un rôle responsable.
Quant à la société civile et aux mouvements démocratiques iraniens – aussi bien les femmes qui se battent pour leurs droits que les religieux emprisonnés –, ils ont fortement besoin de la solidarité internationale, mais nullement de paternalisme. Le jour où la France vivra les événements en Iran comme elle a vécu la mobilisation autour de Solidarność en Pologne, elle aura fait un grand pas, et l'Iran aussi.
Aujourd'hui, une des contestations les plus virulentes du velayat-e faqih vient des religieux eux-mêmes. L'ayatollah Montazeri, théoricien de cette doctrine, qui avait plaidé pour que le commandement des forces armées soit confié au Guide, est revenu sur ses positions. Il est allé jusqu'à déclarer, dans son langage de religieux, que le velayat-e faqih absolu – c'est-à-dire le pouvoir absolu du Guide – était une forme de polythéisme. Et il n'est pas le seul à le dire.
D'autre part, l'institution du Guide s'est sécularisée à tel point que, sous le turban de certains de ces mollahs, on voit très distinctement le képi. Dans les premiers temps de la République islamiques, les mollahs cherchaient à obtenir des titres universitaires ; on a alors utilisé le terme ayatollah doktor. Avec la guerre Iran-Irak est apparue la figure de l'ayatollah sardâr – général. Ce sont des hommes formés dans les casernes qui ont choisi de porter le turban afin de s'élever dans la hiérarchie sociale. Ils sont arrivés dans les cercles du pouvoir à l'époque du président Ahmadinejad.
L'élection de M. Rohani est pour moi le signe que la société et même le régime ont senti le danger qui les menaçait. Il s'agit non pas des frappes aériennes ou des sanctions – la société iranienne n'est pas en train de s'agenouiller à cause de la famine –, mais de la militarisation du pays. Le risque est en effet que les tensions internationales soient telles que la nation traumatisée ne trouve d'autre voie pour son salut que la militarisation. Si cela se produit, ce sera alors le règne des services de renseignement militaire.
D'ailleurs, que va faire Téhéran en Irak ? Pour des raisons historiques, l'Iran entend défendre les villes saintes du chiisme comme s'il s'agissait de son propre territoire. Mais, pour ce faire, il n'a pas besoin d'envoyer de corps expéditionnaire : il lui suffira de renouveler l'expérience qu'il a conduite au Liban, c'est-à-dire de transformer la communauté chiite en une entité centralisée et militarisée – même si ceux qui ont envahi le Liban au début des années 1980 ont bien plus contribué à l'apparition du Hezbollah que le pouvoir iranien lui-même. Aujourd'hui, la situation en Irak rappelle celle qui prévalait alors au Liban. Cependant, l'administration américaine semble faire preuve de sagesse, loin de l'attitude guerrière de George W. Bush. En 2003, les États-Unis ont d'ailleurs hésité : devaient-ils attaquer l'Irak ou l'Iran ? Ils ne tenaient nullement compte de la complexité de la région.
Quoi qu'il en soit, si Daech continue à gagner du terrain, le ventre mou de la région sera non pas l'Iran, mais l'Arabie saoudite et la Jordanie. C'est de la sécurité de ces deux pays que l'Occident devrait se préoccuper dans les années qui viennent. De son côté, l'Iran en profitera pour annexer de fait la communauté chiite irakienne et pour l'organiser. L'autorité religieuse la plus influente au sein de cette communauté est l'ayatollah Sistani, lequel s'est prononcé à plusieurs reprises contre la doctrine du velayat-e faqih.
Vos questions, très pertinentes, se nourrissent des observations que vous avez pu faire au cours de votre mission en Iran. Cela montre bien que rien ne remplace l'expérience de terrain.
Sur les questions de société, je rejoins largement l'analyse d'Ahmad Salamatian : la condition des femmes a considérablement progressé en Iran depuis trente-cinq ans. Un peu comme au judo, les femmes ont transformé à leur avantage les contraintes qui leur étaient imposées. Avant la Révolution de 1979, les familles pieuses n'envoyaient pas leurs filles à l'université, car le port du voile y était interdit. Depuis que celui-ci est devenu obligatoire, des jeunes filles qui auraient dû rester à la maison auparavant ont pu fréquenter l'université. Elles se sont ainsi ouvertes au monde extérieur. Et, malgré le voile, l'université est restée un lieu de flirt pour les jeunes.
Les familles n'osent plus marier leurs filles à treize ou à quinze ans et les envoient à l'université en attendant qu'elles atteignent l'âge considéré comme acceptable pour se marier dans une société moderne – vingt à vingt-cinq ans. C'est une dynamique vertueuse, qui permet aux femmes de s'émanciper. Comme dans l'ensemble du monde arabo-musulman les femmes sont même plus nombreuses que les hommes à l'université, car une partie de ces derniers est immédiatement absorbée par le marché du travail.
La situation est moins favorable pour les femmes à la sortie de l'université. Certaines professions leur restent fermées, par exemple celle de juge. Dans l'administration, un peu comme dans la France des années 1960, elles sont confinées dans des tâches relativement subalternes, notamment de secrétariat, les fonctions de direction restant réservées aux hommes. En revanche, elles investissent massivement les professions libérales – médecin, architecte…. À tel point que les universités, encouragées par le régime, en arrivent à instaurer des quotas pour éviter que certaines professions, notamment médicales, ne se féminisent au-delà de ce qu'elles jugent acceptables.
Quant aux mariages, ils demeurent majoritairement arrangés, conformément à la tradition. Cependant, de nombreuses femmes ont un niveau d'éducation supérieur à celui de leur mari et cherchent à s'émanciper. Résultat : le taux de fécondité en Iran est inférieur à 2 enfants par femme, c'est-à-dire à peu près équivalent à ce qu'il est en France. En outre, le taux de divorce à Téhéran est comparable à celui que l'on connaît à Paris. En résumé, la société iranienne s'est modernisée et ressemble de plus en plus à nos sociétés occidentales.
Le rapport de la société avec le régime est complexe : c'est le jeu du chat et de la souris.
Il est assez logique, monsieur Reitzer, que vous n'ayez pas vu la photo du président Rohani dans les administrations ou dans les commerces : le président iranien joue à peu près le rôle de notre premier ministre, le Guide étant l'équivalent de notre président de la République.

On voit beaucoup de photos du Guide dans les bâtiments officiels et à l'aéroport, mais relativement peu dans les rues. Il n'y a pas de personnalisation exagérée du régime.
C'est juste.
Des fatwas tendant à interdire l'arme nucléaire ont été émises par l'ayatollah Khomeyni, puis par l'ayatollah Khamenei. Mais les Iraniens n'en parlent jamais. Il s'agit plutôt d'un produit destiné à l'exportation, qui vise à convaincre le monde extérieur de la bonne volonté de l'Iran. D'autre part, une fatwa se fait et se défait. Elle ne saurait donc à elle seule nous rassurer, ni constituer la base d'un accord.
Ces fatwas sont mises en avant pour conférer, symboliquement, un rôle central au Guide dans la négociation de l'accord nucléaire. C'est une manière d'affirmer que le religieux a sa place dans ce domaine. Mais une fatwa n'aura jamais la valeur d'un traité dûment signé, qui responsabiliserait l'Iran et le ferait sortir de son isolement actuel.
Pour vous répondre, monsieur Mallé, la théocratie est en effet critiquée par une partie du clergé. Comme l'a indiqué Ahmad Salamatian, de nombreux membres du clergé sont en prison. Pour tout un courant de pensée, le fait que les religieux se soient investis en politique a décrédibilisé la religion. Il serait dès lors salutaire de séparer à nouveau celle-ci du politique, afin de la revitaliser. D'autre part, Khamenei jouit d'une estime moindre que d'autres ayatollahs – en particulier que Sistani, qui est très populaire en Iran comme en Irak. Khamenei est volontiers considéré comme un « petit jeune » qui a obtenu le titre d'ayatollah en trichant un peu.
M. Meyer Habib a présenté une thèse bien connue sur la question nucléaire. Nous serions évidemment très contents que l'Iran démantèle toutes ses installations nucléaires, y compris les sites de Fordow et de Natanz, et qu'il ne mette jamais en service le réacteur d'Arak. Mais nous n'obtiendrons jamais ce résultat par la négociation. Devons-nous dès lors essayer de l'obtenir par la force ? Avec un accord, nous obtiendrons un résultat en théorie moins satisfaisant, mais nous commencerons à entraîner l'Iran dans la bonne direction.
Certes, il est arrivé que l'Iran s'autorise quelques arrangements avec des accords qu'il avait passés, mais contrairement à ce qu'a affirmé M. Meyer Habib, il respecte globalement ses engagements, en particulier en matière de contrôles internationaux. Les installations nucléaires de Fordow, de Natanz, et d'Arak – qui suscitent à juste titre l'inquiétude de certains pays de la région – sont placées sous la surveillance des inspecteurs de l'AIEA, qui s'y rendent régulièrement. Les Iraniens ne pourraient pas détourner une petite quantité d'uranium enrichi, installer de nouvelles centrifugeuses ou introduire du combustible dans le réacteur d'Arak sans que les inspecteurs de l'AIEA le repèrent au maximum dans les quinze jours et leur demandent des explications. Pendant un moment, l'Iran a même appliqué le protocole additionnel de l'AIEA, qui renforce encore les pouvoirs des inspecteurs. Il laisse d'ailleurs entendre actuellement qu'il pourrait à nouveau accepter ces contrôles renforcés dans le cadre d'un accord global. Quoi qu'il en soit, dans chacun de ses rapports semestriels sur l'Iran, l'AIEA conclut que le pays respecte ses engagements en matière de contrôles et ne conteste pas les chiffres que le pays a fournis dans ses comptabilités matières, qui font apparaître les quantités d'uranium présent en Iran.
Nous sommes à la croisée des chemins. Si on n'aboutit pas à un accord et que l'on frappe militairement l'Iran, comme cela a été envisagé et l'est sans doute encore, il y a un résultat certain : l'Iran sortira du TNP, et nous perdrons les moyens de contrôle dont nous disposons actuellement. Nous sauterons alors dans l'inconnu, car la très grande majorité des informations que nous recueillons sur le programme nucléaire iranien nous sont fournies non pas par les services secrets occidentaux, mais par les inspecteurs de l'AIEA autorisés à se rendre sur les sites. Si, au contraire l'on souhaite trouver un arrangement, il faut s'appuyer sur cette bonne volonté relative de l'Iran, qui accepte tout de même les contrôles de l'AIEA .
M. Meyer Habib s'est fait l'interprète des inquiétudes que suscite le programme nucléaire iranien et estime que l'on ne peut pas faire confiance à Téhéran. Mais il ne prend sans doute pas assez en compte l'instinct de conservation des religieux au pouvoir. La Révolution iranienne s'est embourgeoisée : elle a atteint en quelque sorte son stade thermidorien. Le régime n'a aucune envie de se faire attaquer par Israël ni par un quelconque pays. Cette volonté de survie le pousse à trouver des solutions de compromis qui garantissent sa pérennité. De son point de vue, le modèle idéal est celui de la Chine : conserver le contrôle politique, pratiquer une ouverture économique pour satisfaire la population et durer ainsi le plus longtemps possible. Nous disposons donc de quelques leviers pour agir sur ce régime.
S'agissant du Haut-Karabagh, je doute que l'Iran ait la capacité de peser sur l'évolution du dossier, dans la mesure où il a choisi son camp, en prenant fermement partie pour l'Arménie. Il est vrai que Téhéran craint les revendications irrédentistes de Bakou sur les régions iraniennes peuplées d'Azéris. Les relations entre le régime iranien et le gouvernement azerbaïdjanais sont donc empreintes d'une méfiance réciproque.
En ce qui concerne l'Irak, dans la situation difficile où il se trouve, le gouvernement de M. Al-Maliki accepte le concours de tous ceux qui sont prêts à l'aider : les États-Unis, la Russie, l'Iran. Pour autant, il est peu probable que cela entraîne une détente des relations entre ces trois pays, notamment entre les États-Unis et l'Iran. D'autre part, je ne pense pas que Washington et Téhéran mettront en place une coopération institutionnalisée : ils n'iront sans doute pas au-delà d'une coordination opérationnelle pour éviter de se gêner mutuellement en intervenant sur le terrain. Enfin, un arrangement donnant donnant qui ferait le lien entre le dossier irakien et la question nucléaire – par exemple une augmentation du nombre de centrifugeuses autorisées en échange d'une collaboration de Téhéran en Irak – me paraît illusoire. Ces deux dossiers sont strictement séparés et obéissent à des logiques différentes. Néanmoins, une éventuelle amélioration de la situation en Irak peut créer une atmosphère favorable à la négociation sur la question nucléaire.
Le risque d'une partition de l'Irak devenant tangible, tous les pays de la région se rendent compte qu'un pays divisé en trois parties leur poserait plus de problèmes qu'un pays uni. Tel est le cas, en particulier, de l'Arabie saoudite, malgré son hostilité profonde à l'égard du régime de M. Al-Maliki – elle n'a pas accepté que la majorité chiite s'empare du pouvoir à Bagdad. Elle ne voit d'un bon oeil ni la constitution d'un califat islamique à ses frontières, qui semble prêt à s'étendre dans toutes les directions, ni l'apparition d'un État chiite, qui serait très prospère – car disposant d'une grande partie des ressources pétrolières du pays – et considérerait sans doute la frontière avec les communautés chiites du Koweït et d'Arabie saoudite comme poreuse. Quant à une indépendance du Kurdistan irakien, elle créerait une onde de choc dans la région : les tentations irrédentistes seraient fortes, les Kurdes étant plus nombreux en Iran et en Turquie qu'au Kurdistan irakien. Chacun essaierait d'exercer son influence sur le nouvel État. En définitive, si une fédéralisation de l'Irak ou, à tout le moins, une meilleure répartition du pouvoir entre ses différentes communautés apparaît à tous comme indispensable, tout le monde a intérêt à ce que le pays reste uni.

Je vous remercie, messieurs. Vous avez complété très utilement les informations que nous avons recueillies pendant notre mission.
La séance est levée à dix-huit heures quarante.