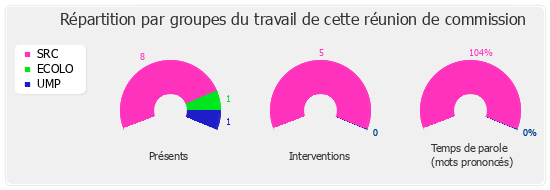Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Réunion du 11 février 2015 à 17h00
La réunion
La Commission entend Mme Agnès Bénassy-Quéré, présidente déléguée du Conseil d'analyse économique, professeure à l'École d'économie de Paris.

Nous avons le plaisir d'accueillir Mme Agnès Bénassy-Quéré, économiste reconnue qui, titulaire d'un doctorat d'économie, intégra la direction de la prévision avant de rejoindre le Centre d'études prospectives et d'informations internationales, le CEPII, qu'elle dirigea de 2006 à 2012. Depuis octobre 2012, elle est présidente déléguée du Conseil d'analyse économique – CAE.
Par ailleurs, madame la professeure, vous enseignez à l'université Paris I et êtes membre associée de l'École d'économie de Paris. Vous êtes également membre de la Commission économique de la nation, du Haut Conseil de stabilité financière et du Cercle des économistes.
Notre cycle d'auditions vise à nous éclairer, à partir de points de vue aussi variés que possible, sur les questions de la croissance et de l'emploi. Comment améliorer notre croissance ? Le produit intérieur brut – PIB –, d'ailleurs, en est-il le bon ou le seul indicateur ? Comment favoriser l'emploi et lutter contre le chômage ?
Merci de votre invitation. Je m'appuierai principalement, dans mon propos liminaire, sur les notes du CAE, en commençant par celle sur laquelle nous travaillons actuellement, consacrée à la gouvernance de la zone euro. Sous réserve des décisions prise aujourd'hui par l'Eurogroupe, dont je n'ai pas connaissance, les nouvelles récentes ont été plutôt bonnes, avec les baisses de l'euro et du prix du pétrole et les frémissements d'une reprise de l'activité. Il a été demandé au CAE de se pencher sur la politique macroéconomique de la zone euro ; or, une telle politique fait précisément défaut. Cela explique que la croissance, repartie en 2011 après le creux de 2009, soit retombée en 2012 alors qu'elle s'est maintenue aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui avaient pourtant connu la même crise. Des erreurs ont sans doute été commises dans notre politique économique en 2012 ; il y en eut en tout cas de massives pendant la crise, qui n'ont pas toutes été corrigées.
La coordination des politiques économiques entre États souverains n'est pas chose naturelle ; on le voit avec l'inflexibilité de l'Allemagne en matière budgétaire, alors même que le Traité de Lisbonne impose en principe aux États de coordonner leurs politiques économiques. La Banque centrale européenne – BCE – souffre également de cette lacune : si l'Europe était fédérale, comme le sont les États-Unis, l'institution de Francfort aurait fait du « quantitative easing » depuis longtemps, à l'instar de la Réserve fédérale américaine, la FED – laquelle n'achète pas de dette du Kansas ou du Missouri...
L'Europe n'étant pas une fédération, elle élabore des règles qui deviennent des procédures : elle ne dispose pas des soubassements institutionnels lui permettant de conduire une politique discrétionnaire. On s'est ainsi focalisé sur le pacte de stabilité, et plus précisément sur la soutenabilité des dettes publiques, mais ce critère, malgré son importance qu'illustre la situation grecque, n'est pas l'alpha et l'oméga de la coordination. Les pays de la zone euro devraient aussi coordonner leurs réactions aux cycles – ce qu'ils font très mal – et surtout leurs politiques macro-prudentielles. En 2001, le Conseil européen a adressé à l'Irlande, dont l'inflation dépassait alors 5 %, une recommandation au titre des grandes orientations de la politique économique ; mais cette recommandation se concluait sur la nécessité de restrictions budgétaires, alors que l'Irlande était sur ce plan en excédent. Une politique macro-prudentielle bien comprise aurait appelé un resserrement du crédit et des mesures susceptibles de dégonfler la bulle immobilière. Une coordination en matière de compétitivité, au vu des divergences nominales, serait également souhaitable : elle est au moins aussi importante que la coordination budgétaire.
En un mot, l'idée générale de notre note à paraître en mars est non une remise en cause des règles mais un agencement différent entre elles : cela redonnerait sens au semestre européen, vécu par les États membres comme une succession de procédures plutôt qu'un outil de coordination.
Cela dit, l'essentiel des ressorts de la croissance relèvent de la politique nationale. Pour la France, le diagnostic du CAE se résume à deux constats principaux. Le premier est que l'emploi des jeunes est à la traîne, et pas seulement depuis la crise. Un relèvement de dix points du taux d'emploi des 15-29 ans, qui représentent 28 % de la population en âge de travailler – soit les 15-64 ans –, entraînerait une hausse de l'emploi de 2,8 % et, compte tenu d'un coefficient affecté de 0,6 %, de 1,6 % du PIB : sans être considérables, ces chiffres sont significatifs.
L'augmentation sensible de l'emploi des séniors, même si elle n'est pas spécifique à la France – qui n'a donc pas encore comblé son retard en la matière –, prouve que l'on peut agir sur l'emploi des jeunes. Les réformes des retraites ne sont pas indifférentes à ce phénomène, au demeurant pas contradictoire avec la hausse conjointe du chômage. S'agissant de la catégorie des 30-54 ans, les statistiques montrent que la France se situe dans la moyenne des autres pays. Bref, sur les deux problèmes traditionnels, les jeunes et les séniors, la situation s'améliore pour les seconds mais pas pour les premiers, surtout lorsqu'ils sont peu qualifiés.
Second constat : la stagnation, depuis dix ans, de la productivité globale des facteurs, autrement dit la productivité combinant travail et capital.
Les faiblesses structurelles de la France nous paraissent être au nombre de quatre. La première, l'emploi des jeunes peu qualifiés, s'explique d'abord par le décrochage scolaire, mais aussi par l'apprentissage, pour lequel nous préconisons une réforme de l'offre, à des fins de fluidification et d'encouragement d'initiatives « hyperlocales » : un cahier des charges pourrait être élaboré au niveau national ; il inclurait des critères de qualité dont des agences privées, aussi nombreuses que nécessaire, assureraient la certification. Un groupe d'entrepreneurs locaux, par définition au fait des besoins sur le terrain, aurait ainsi la possibilité d'organiser une formation à brefs délais, en évitant les nombreuses embûches du système actuel.
Le faible taux d'emploi des jeunes non qualifiés pose aussi le problème de la mobilité. La réduction du délai d'obtention du permis de conduire est souhaitable – aussi saluons-nous la réforme en cours –, sans oublier les coûts. Le secteur étant très protégé, les nouveaux entrants, comme les auto-écoles en ligne, ont du mal à s'y insérer. La mobilité, d'ailleurs, est surtout un problème pour les jeunes qui vivent en milieu rural ou dans des petites villes : la libéralisation du secteur des autocars aura sans doute des effets bénéfiques pour eux, mais l'on pourrait aller plus loin.
On parle beaucoup plus des enquêtes PISA – Programme for international student assessment – que des enquêtes PIAAC – Programme for the international assessment of adult competencies –, dont les résultats sont pourtant catastrophiques pour la France. Ils mesurent les compétences des adultes – personnes âgées de plus de quinze ans – dans les domaines du chiffre et de l'écrit – c'est-à-dire, pour ce dernier critère, la faculté à comprendre ce qu'on lit et à s'exprimer à l'écrit. Le fait que la main-d'oeuvre française ne soit pas assez formée pour s'adapter à certaines technologies nouvelles explique en partie les difficultés qu'éprouvent les entreprises à innover, par exemple en matière de robotisation. La formation initiale est coupée de la formation continue, dont le coût est dix fois supérieur ; ce phénomène, sur lequel on peut s'interroger, rend très difficile la reprise d'études.
Troisième problème de fond : le surdéveloppement relatif des secteurs non échangeables, à savoir principalement les services – même si certains d'entre eux sont échangeables. Ce problème s'est posé avec force dans les pays périphériques, notamment l'Espagne – compte tenu du développement de la construction –, qui depuis ont procédé à un ajustement, contrairement à la France – où le déséquilibre était moindre – et à l'Italie. Notre pays, vous le savez, rencontre aussi un problème d'offre de logements, avec un niveau de constructions insuffisant, l'argent dépensé pour soutenir la demande se répercutant en hausse des prix. Ce mécanisme a de surcroît des effets pervers très indirects : il explique, par exemple, que les salaires, tirés à la hausse par les prix du logement, aient augmenté plus vite que la productivité, ce dont pâtit la compétitivité-coût. La compétitivité, rappelons-le, n'est pas l'apanage exclusif de l'industrie : chacun y contribue, y compris, de par sa productivité, la fonctionnaire que je suis. Cela paraît contradictoire avec le surdéveloppement des secteurs non échangeables, mais celui-ci tient aussi à ce que les profits sont plus élevés dans ces secteurs, qui pour cette raison attirent davantage le capital et le travail.
Le coût du travail est un sujet délicat. Le graphique qui vous est projeté a été publié dans l'une de nos notes : Pierre Cahuc vous en reparlera sans doute mercredi prochain. Le salaire minimum n'est pas créateur de chômage, sauf pour les jeunes non qualifiés. Ce graphique vous montre, en abscisse, le salaire net mensuel auquel peut prétendre une personne en fonction de différentes caractéristiques – sexe, zone de résidence, niveau de diplôme ou expérience –, rapporté, en ordonnée, au taux de chômage. Pour la plupart des catégories, le taux de chômage est faible et le niveau de salaire n'a que peu d'incidence sur lui ; mais il monte brutalement à 40 % pour les jeunes non qualifiés, dont le niveau de salaire est au surplus très proche du smic. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les économistes préconisent une baisse des charges sur les bas salaires. Le problème peut aussi être traité à travers l'apprentissage, un apprenti étant en principe payé en dessous du salaire minimum.
Le développement global de l'apprentissage est trompeur, car celui-ci, en réalité, ne se développe qu'au sein de l'enseignement supérieur : pour les diplômes de plus basse catégorie, le nombre d'apprentis stagne alors même que c'est à ce niveau qu'un apprentissage est le plus rentable. Qu'un étudiant en mastère suive apprentissage est sans doute très bénéfique pour lui – et pour l'entreprise –, mais, même sans cet apprentissage, il aurait sans doute trouvé un emploi correspondant à sa qualification, ce qui est beaucoup moins vrai pour les diplômes inférieurs.
L'image suivante vous montre les scores PIAAC : la France y apparaît en antépénultième position. Ces tests, entend-on souvent dire – notamment au sujet du programme PISA –, ne correspondraient pas à notre culture ; mais l'argument ne me paraît pas satisfaisant : il a surtout été un prétexte à l'immobilisme. La formation professionnelle a été réformée, avec le compte personnalisé qui est un pas vers la « flexisécurité », mais cette réforme ignore l'offre de formation, très peu contrôlée quant à sa qualité. De plus, l'accès à une formation s'apparente à un parcours du combattant, notamment pour ceux qui en auraient le plus besoin, à savoir les chômeurs.
Le graphique intitulé « Faciliter la reprise des études » détaille, pays par pays, la part des 25-29 ans sans diplôme qui, en 2011, étaient en formation, recevant ainsi une deuxième chance. Cette part est de 25,1 % en Suède, contre seulement 1 % en France. Comment revenir dans le système scolaire une fois qu'on a un peu mûri ? Il semble que les portes soient fermées... En d'autres termes, les intéressés s'en sortent s'ils ont la chance de trouver une entreprise qui paie leur formation, mais les autres n'ont plus accès à l'université.
Deux autres graphiques illustrent l'évolution annuelle de la valeur ajoutée dans les secteurs respectivement échangeables et non échangeables entre 2001 et 2008, puis entre 2009 et 2013, soit avant et après la crise. On voit par exemple que, de 2001 à 2008, en Irlande, la croissance annuelle du secteur non échangeable a été de 4 points supérieure à celle du secteur échangeable, ce qui est considérable. Le phénomène va de pair avec une augmentation relative des prix, créant une rente qui attire les entreprises et génère de l'emploi ; normal pour un pays en développement – et moins pour un pays développé –, il s'est aussi constaté en France pendant la même période, alors que l'Allemagne, elle, voyait plutôt se développer les secteurs échangeables. Depuis la crise, l'Irlande et l'Espagne ont connu d'importantes corrections, avec une inversion du phénomène qui, en Italie comme en France, s'est seulement atténué. On le sait, les taux de marge ont beaucoup plus baissé dans l'industrie que dans les services, d'où les différences de profitabilité. Pour les économistes, le projet de loi sur la croissance et l'activité est, de ce point de vue, un rééquilibrage au profit des secteurs échangeables par une diminution de la rente des non échangeables.
Par comparaison avec d'autres pays, l'investissement des entreprises, en France, a relativement bien résisté à la crise, de même que l'investissement public. Reste que le taux d'investissement brut – rapporté au PIB – fait apparaître une baisse tendancielle des équipements et, conjointement, un rebond des constructions non résidentielles. De fait, les investissements directs étrangers en France visent surtout des opérations telles que le rachat de groupes hôteliers. Relancer l'investissement des entreprises dans les équipements est donc un véritable enjeu.
J'en viens au logement. Les prix de l'immobilier sont repartis à la hausse après une inflexion due à la crise, l'Île-de-France restant en ce domaine un cas particulier. Le CAE publiera demain une note relative aux territoires, en suggérant que les aides comportent deux volets qu'il ne faut pas confondre : d'une part l'investissement dans les métropoles, de l'autre les mesures susceptibles de donner sa chance à chacun, où qu'il se trouve. Le fait est que les investissements dans les métropoles ont une meilleure rentabilité. Ceux qui tendent à limiter les effets de congestion, par exemple, sont de bons investissements ; c'est d'ailleurs l'idée directrice du Grand Paris.
Il ne faut cependant pas oublier les territoires non métropolitains et peu attractifs au plan touristique. Chacun doit avoir sa chance, en termes d'éducation, de santé – où de fortes inégalités persistent – et de mobilité. Quoi qu'il en soit la hausse des prix du logement pénalise évidemment le pouvoir d'achat des ménages et se répercute sur les coûts des entreprises.

Je vois que ce graphique, relatif aux prix de l'immobilier, s'appuie sur des sources de la Réserve fédérale de Dallas...
En effet ; ils ne remplissent pas non plus leur obligation de collecte. Ces informations sont donc très difficiles à obtenir : davantage de transparence serait souhaitable, même si la création d'observatoires permettra sans doute d'y voir plus clair – pas forcément sur les prix, mais sur les loyers.

Les coups de projecteur que vous avez proposés éclairent bien certaines difficultés de notre économie.

Vous avez évoqué, s'agissant de l'égalité des chances entre les territoires, la santé, la mobilité et l'éducation : cette triade constitue-t-elle à vos yeux le panier essentiel et minimal ? Quid des infrastructures numériques et des réseaux de téléphonie mobile ? Car qui dit santé dit télémédecine, par exemple.
Le développement du numérique dans les territoires sous-équipés est un autre problème que celui des start-up, dont les métropoles restent le foyer. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les services s'agglomèrent davantage que les industries car, outre qu'ils ont moins besoin de surfaces, le contact humain y joue un rôle moteur. Quoi qu'il en soit, le numérique peut contribuer à une diminution des coûts et à une montée en gamme de la médecine dans les territoires à faible densité.
Me taraude aussi la question de savoir comment développer des activités dans ces territoires déshérités. Le premier facteur peut être le prix du foncier, plus bas qu'ailleurs – et l'écart ira croissant. Cela peut intéresser les activités peu agglomérées et consommatrices d'espace. Le problème est que les salaires restent très homogènes au sein d'un même territoire : si celui-ci est déshérité, il ne peut jouer sur l'attractivité salariale – pour le dire autrement, ce sera le smic partout... Néanmoins, la proportion des personnes à bas niveau de qualification est plus élevée au sein des territoires déshérités : en toute logique, les allégements de charges devraient leur être plus profitables qu'aux métropoles – les évaluations du crédit d'impôt pour la compétitivité l'emploi – CICE – le confirmeront peut-être.

Vos constats ne sont pas toujours réjouissants... Je m'interroge notamment sur l'incapacité de l'Europe à mener des politiques coopératives, compte tenu de l'absence d'intégration politique. Sur ce point, M. Tirole, que nous avons auditionné en début d'après-midi, allait d'ailleurs dans votre sens.
M. Askenazy indiquait ce matin que, s'agissant de la croissance, la métropole parisienne marquait le pas tandis que les métropoles de province – Nantes ou Lyon, par exemple – connaissaient un certain essor : le confirmez-vous ? Au demeurant, cela permettrait sans doute un rééquilibrage.
Philippe Azkenazy est coauteur, avec Philippe Martin, de la note sur les territoires que j'évoquais précédemment. En l'absence de statistiques proprement territoriales, l'analyse s'est concentrée sur les bassins d'emploi correspondant à des grandes, moyennes et petites villes. Il ressort en effet de cette étude que l'emploi a crû de façon sensible dans les grandes métropoles autres que Paris, qui n'arrive qu'en deuxième position. À partir d'un certain seuil les effets de cogestion dominent, de sorte que l'activité se déplace dans des métropoles encore dynamiques.
La note suggère par ailleurs de ne pas lutter contre les effets d'agglomération, et même de les encourager à travers le développement des transports et des logements, lequel solvabilisera les politiques mises en oeuvre sur l'ensemble du territoire. L'activité économique de Paris, par exemple, a un effet macroéconomique sur l'ensemble du PIB, et ce faisant tend à solvabiliser le système social. Or, les inégalités de revenu disponible entre les grandes régions vont diminuant, malgré la stagnation des inégalités de croissance. Une redistribution s'opère notamment via le tourisme, les retraites et les revenus du capital.
Cependant, l'agglomération ne doit pas être la règle partout : une petite localité hyperspécialisée dans un secteur serait à la merci d'une crise de ce dernier, alors qu'une grande métropole caractérisée par la diversité de son tissu économique, non seulement quant aux entreprises d'un même secteur, mais aussi en termes de développements sectoriels, a la capacité de résister. La ville de Toulouse, par exemple, ne dépend pas que de l'aéronautique, dont elle pourrait par conséquent surmonter la crise.
Au fond, monsieur Caresche, l'euro peut être vu comme un substitut, via l'intégration, à la coordination défaillante des politiques monétaires – la monnaie unique ayant d'ailleurs été créé après deux crises majeures en ce domaine, au début des années 1990 –, de même que l'union bancaire au regard de la coordination des politiques prudentielles. L'union budgétaire est l'étape suivante ; nous formulerons des propositions en ce sens, sans illusions néanmoins sur leur succès. Il s'agit de savoir si l'on entend vraiment traiter le problème par la création d'un étage budgétaire fédéral, lequel prendrait en charge des politiques contracycliques au niveau de la zone euro. Cela suppose bien entendu une capacité d'emprunt digne de ce nom, donc des décisions politiques fortes, car si cette capacité se limite à 2 % du PIB de la zone, elle est superflue : un tel dispositif n'a de sens qu'avec une capacité de s'endetter en phase basse et de rembourser en phase haute.
Une union budgétaire permettrait également le partage de risques macroéconomiques : c'est tout l'enjeu, par exemple, d'un pilier européen de l'assurance chômage, avec des transferts temporaires entre États, pour un jeu à somme nulle au bout du compte. Cela n'a bien entendu de sens que si les chocs sont asymétriques.
Troisième intérêt d'un tel système : l'investissement dans des projets susceptibles de doper la croissance et caractérisés par leur forte externalité, tels les interconnexions électriques ou les universités du futur. Cela dit, on peut douter qu'il soit possible de mener de front programmes d'investissements et politiques contracycliques. Le « plan Juncker » a d'abord été conçu pour soutenir la croissance dans une période difficile, avant de privilégier le rendement des dossiers, procédures d'étude à l'appui ; moyennant quoi, les mois passant, ces investissements arriveront sans doute quand la croissance sera revenue... Nous ne sommes plus dans une politique contracyclique. Il faut donc un débat au niveau européen sur l'usage d'un budget qui ne permet pas d'agir concomitamment sur les trois aspects que je viens d'évoquer.

Votre exposé me permet de souligner, une nouvelle fois, l'intérêt de ce cycle d'auditions.
La compétitivité, vous l'avez suggéré, pose la question, non seulement des coûts, mais aussi de la montée en gamme ; personnellement, j'y ajouterai le dialogue social puisque, selon vos propres termes, chacun est appelé à contribuer à la compétitivité.
Vous avez aussi souligné l'impératif de la formation, à la fois initiale et continue, l'emploi de jeunes peu qualifiés, l'apprentissage et la possibilité de rebondir après un licenciement ou de progresser au sein de son entreprise. M. Askenazy observait ce matin que les institutions européennes ont, pour beaucoup d'entre elles, été bâties avant la crise ; or, nous avons selon moi besoin de règles d'après-crise, dont participent justement les politiques de coordination. Vous avez présenté l'euro comme un substitut de la coordination monétaire et l'union bancaire comme un substitut de la coordination bancaire, et vous venez d'évoquer la coordination budgétaire. Qu'en est-il des coordinations dans un cadre non fédéral, telles les coordinations fiscale et industrielle ?
Dernière remarque, en forme de sourire : l'amour du français, suggériez-vous, n'oblige pas à s'exprimer en alexandrins ; toutefois, il pourrait inciter à nous présenter des slides dans la langue de Molière, surtout lorsqu'elle propose des équivalents aux termes anglo-saxons...
J'approuve tout à fait votre dernière remarque : présidente déléguée du CAE, je ne cesse de « faire la guerre » aux anglicismes, même si je navigue très souvent entre les deux langues lors de mes interventions.
Le CAE a publié une note sur la coordination fiscale, en faveur de laquelle nous plaidons. Nous soutenons ainsi le principe de l'ACCIS, l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés. En ce domaine la France, nous semble-t-il, prend le débat par le mauvais côté en mettant en avant des questions de justice : nos partenaires sont bien plus réceptifs à l'idée du marché unique. L'un des enjeux, pour les années à venir, est la création de banques paneuropéennes, qui puissent continuer à injecter du crédit dans des pays en crise. Nous en sommes encore loin, l'union bancaire tendant au contraire à fermer les barrières nationales sur ce plan. Elle a en tout cas unifié la régulation et la surveillance : pourquoi, dès lors, exclure la fiscalité ? Le CAE est pour « l'union bancaire TTC », c'est-à-dire pour un transfert de la fiscalité bancaire – hors cotisations sociales, bien sûr – au niveau de la zone euro. Par le fait, les taxes sur les banques sont très hétérogènes : notre pays taxe les salaires, quand d'autres taxent les bonus ou des parts du bilan. Une coordination en ce domaine renforcerait l'union bancaire et, au passage, accélérerait sans doute l'abondement du fonds de résolution.
On a suggéré que l'ACCIS pourrait d'abord ne concerner que la France et l'Allemagne – même si, outre-Rhin, l'organisation en Länder rend la chose difficilement applicable. À quoi nos partenaires objectent souvent que les entreprises se délocaliseraient dans les paradis fiscaux, en Irlande ou ailleurs. Mais une littérature récente semble démentir cette idée reçue, mettant en évidence l'intérêt d'une coordination au sein d'un sous-groupe, non seulement pour les pays membres mais aussi pour les autres : la concurrence fiscale imposée par les seconds est une garantie que les impôts n'augmenteront pas au sein du sous-groupe, et, pour les pays qui en sont membres, la coordination génèrerait des gains d'efficacité, y compris pour les entreprises – gains qui, selon la Commission européenne, avoisineraient les 2 % pour les grands groupes.
La coordination fiscale, à nos yeux justifiée pour l'impôt sur les sociétés, l'est en revanche beaucoup moins pour l'impôt sur le revenu, car l'existence d'une concurrence en ce domaine est loin d'être avérée. L'absence de taxation de la richesse peut avoir de tout autres raisons que la concurrence : la volonté d'un basculement de la production vers la consommation, par exemple, ou tout simplement le vieillissement de la population, donc de l'électeur médian, qui dès lors appartient à une classe d'âge généralement hostile à une taxation du patrimoine et des richesses.
Quant à la coordination industrielle, je ne crois pas en avoir parlé.

M. Askenazy, ce matin, soulignait la nécessité de politiques européennes industrielles, en lieu et place des stratégies nationales, concurrentes et disparates.

Des stratégies industrielles claires, selon M. Askenazy, font effectivement défaut, aussi bien au niveau européen que français.
L'une des conclusions de notre note relative à la politique industrielle est que l'argent public devait en priorité financer des équipements partageables entre plusieurs entreprises ou secteurs. La gouvernance des stratégies de filière est loin d'être transparente. Dans la filière automobile, par exemple, elle est captée par les dirigeants et les équipementiers : elle ne permet pas de fertilisation entre les secteurs. Mais nous sommes sans doute sortis du laisser-faire total.

Être conscient de ses faiblesses est utile, mais je m'étonne que l'ensemble des intervenants soulignent les points faibles et jamais les points forts sur lesquels nous pourrions nous appuyer.
Vous avez relevé les faiblesses françaises en matière de formation, notamment pour les plus de vingt ans. Vous avez aussi évoqué l'insertion des 15-29 ans dans le marché du travail ; or, dans notre pays, on commence plutôt à travailler à partir de dix-huit ans. Pourquoi donc vos statistiques commencent-elles à l'âge de quinze ans ?
Quoi qu'il en soit, la formation semble défaillante dès l'école, et les choses deviennent dramatiques avec la formation continue : qu'est-ce qui l'explique, selon vous ? Les modes de financement ou l'organisation sont-ils en cause ? Les sommes dépensées en ce domaine, comme dans la recherche, paraissent peu efficientes – le retour sur investissement du crédit d'impôt recherche, par exemple, est relativement faible.
Enfin, pourriez-vous expliciter vos idées quant à la répartition entre public et privé ? Le secteur public n'est pas forcément improductif : les enseignants, dont vous êtes, jouent bien entendu un rôle important dans la formation.
Je vois effectivement passer mille étudiants par an dans mes cours : si ceux-ci sont mauvais, ma productivité est donc très négative... L'université française fait beaucoup d'abattage, ce qui est d'ailleurs son problème.
Le ciblage sur les 15-29 ans n'est guère adapté aux pays développés, j'en conviens, mais il correspond aux standards internationaux sur lesquels chacun s'aligne, y compris l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE. La comparaison entre la France et l'Allemagne nous est d'ailleurs d'autant plus défavorable que les études, outre-Rhin, sont plus longues.
Notre note sur la croissance mentionne les points forts de la France, au premier rang desquels les innovations qui, toutefois, restent modestes quant à leur ampleur, pour une reconnaissance internationale limitée. Qui plus est, la transition entre les découvertes scientifiques et leur mise sur le marché reste problématique.
Même si l'on me taxe parfois d'élitisme lorsque je le dis, la France forme par ailleurs des élites d'une très grande qualité : les jeunes issus de nos écoles d'ingénieurs s'arrachent à l'international. À nous, donc, de savoir les attirer en France et de leur offrir les conditions d'une productivité et d'un rayonnement optimaux. Cette élite demeure néanmoins trop retreinte : il faudrait l'élargir.
Je m'élève bien entendu contre l'idée selon laquelle seul le secteur privé serait productif : il va de soi que le secteur public peut l'être aussi. Le rapport de France Stratégie Quelle France dans dix ans ? a été enterré trop vite : il comportait des idées intéressantes, s'agissant notamment du basculement de secteurs non échangeables vers les échangeables, y compris dans le secteur public. On peut penser, par exemple, aux services de santé, que leur renommée rendrait facilement exportables – même s'il faudrait alors en revoir l'organisation –, ainsi qu'à l'enseignement supérieur. Il est un peu stupéfiant d'observer, au vu des conditions d'accueil, le nombre d'étudiants étrangers qui continuent d'affluer dans nos universités : si l'accueil s'améliorait, notre pays serait en quelque sorte le roi en ce domaine. Étudier à la Sorbonne demeure le rêve de beaucoup de personnes à travers le monde ; cela justifierait des frais de scolarité élevés, moyennant bien sûr un accueil à la hauteur. Le secteur public est tout à fait capable de mettre en oeuvre de tels projets, sous réserve d'être accompagné.
Les universitaires sont accablés de contraintes diverses ; personnellement, je dois assurer mon propre secrétariat, classer mes 650 copies à la fin de l'année, enregistrer les notes et transporter lesdites copies, dont l'anonymat n'est évidemment pas respecté, dans une valise à roulettes jusqu'à Lognes avant de les rapporter à l'université... Les enseignants du supérieur n'ont à se plaindre ni de leur vie ni de leurs salaires, mais leurs conditions de travail brident assurément leurs capacités à innover ou à mettre en place des formations nouvelles : ouvrir les portes de l'université à des entrepreneurs, surtout s'ils sont intéressés aux résultats, serait bénéfique de ce point de vue.

Avez-vous des propositions sur la formation des adultes ? On l'a vu, 28 % des jeunes en âge de travailler ne trouvent pas de débouchés. L'organisation régionale vous paraît-elle correctement adaptée à la demande ?
L'idée générale du CAE est d'abattre la frontière entre formation initiale et continue, qui ne correspond plus aux réalités du monde actuel, dans lequel une personne peut avoir besoin, pour le dire ainsi, d'une seconde formation initiale. On pourrait fusionner les contrats de qualification et l'apprentissage, et imaginer un mécanisme plus fluide que l'apprentissage, encore très encadré. Nous avons longuement débattu aussi du contenu des enseignements dispensés au niveau du certificat d'aptitude professionnelle – CAP – : ils incluent très légitimement les matières académiques, comme le français, mais celles-ci sont enseignées de la même façon qu'au collège. Outre-Rhin, par exemple, l'allemand est enseigné dans ces filières à travers une mise en condition : plutôt que d'étudier un poème, on étudie le mode d'emploi d'une machine... Les méthodes pédagogiques sont donc sans doute à revoir en profondeur.
Nous suggérons aussi de valoriser les initiatives locales. Un groupe d'entrepreneurs pourrait définir un programme, chercher des financements le cas échéant, puis déposer une demande d'agrément auprès d'une commission nationale, laquelle désignerait, au cas par cas – afin d'éviter toute collusion –, une agence de certification, par exemple un organisme paritaire collecteur agréé – OPCA – nouvelle génération. Cette agence examinerait les dossiers sur la base du cahier des charges et en fonction de critères très locaux. La formation serait soumise, à des fins d'évaluation, à une nouvelle certification au bout de quatre ou cinq ans. Une fois l'agrément obtenu, le dossier serait bouclé et les subventions débloquées. On pourrait alors se consacrer à l'essentiel : la pédagogie.
Beaucoup d'initiatives « hyperlocales », prises entre différentes gouvernances, ont en effet du mal à prospérer. Qui connaît mieux le tissu local que les entrepreneurs et les élus de proximité ? La région est le bon échelon pour des plans de développement universitaire mais, pour les qualifications plus basses, c'est l'environnement le plus local qui l'est. Il faudrait aussi favoriser la mobilité des jeunes n'ayant pas trouvé de formation conforme à leurs aspirations au sein de leur commune. Beaucoup de remontées font état de cas de jeunes placés ici ou là contre leur gré. Des rapports de l'inspection générale sur la formation professionnelle, dont la lecture laisse ébahi, il ressort que l'accès à l'emploi n'est pas du tout envisagé comme un objectif : il faut assurément revoir ce système. L'emploi, pas seulement à court terme mais aussi tout au long de la vie, doit être au coeur des préoccupations. Pour ce faire, les formations doivent rester suffisamment qualifiantes : si on les abandonnait aux seules entreprises, celles-ci seraient tentées de les orienter en fonction de leurs besoins immédiats. La vigilance s'impose donc sur la qualité des formations initiales, mais un rééquilibrage est souhaitable pour donner aux entreprises davantage de poids dans la définition des programmes.
Informations relatives à la Commission
La Commission a créé une mission d'information sur Le financement du secteur audiovisuel en France et désigné MM. Jean-Marie Beffara et Éric Woerth en tant que co-rapporteurs.
Membres présents ou excusés
Commission des Finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Réunion du mercredi 11 février 2015 à 17 h 30
Présents. - M. Éric Alauzet, M. Guillaume Bachelay, M. Dominique Baert, M. Jean-Claude Buisine, M. Christophe Caresche, M. Gilles Carrez, M. Alain Fauré, M. Régis Juanico, Mme Christine Pires Beaune, M. Michel Vergnier
Excusés. - M. Étienne Blanc, M. Marc Goua, M. Jérôme Lambert, Mme Véronique Louwagie, M. Camille de Rocca Serra, M. Éric Woerth