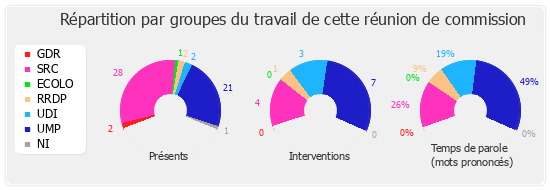Commission des affaires étrangères
Réunion du 4 mars 2015 à 9h45
La réunion
Réunion sur l'Égypte et son environnement régional : Compte rendu du déplacement en Égypte de Mme Elisabeth Guigou, présidente, suivi de l'intervention de M. Michel Duclos, ancien ambassadeur à Damas et conseiller au Centre d'analyse, de prévision et de stratégie du Ministère des affaires étrangères et du développement international
La séance est ouverte à neuf-heures cinquante.

Nous consacrons notre réunion d'aujourd'hui à la situation au Moyen-Orient. Je commencerai par vous rendre compte d'un déplacement que j'ai effectué récemment en Égypte. Je demanderai ensuite à M. Michel Duclos de nous présenter son analyse. Enfin, j'inviterai ceux d'entre vous qui le souhaitent à évoquer les visites qu'ils ont pu faire dans la région. M. Jean Glavany, notamment, est disposé à nous parler de son déplacement au Liban. D'autres collègues s'étant rendus dans la région, je ne verrai aucun inconvénient à ce qu'ils s'expriment, afin de nous faire part des informations qu'ils ont pu recueillir. Nous pourrons ainsi juger de leur intérêt.

Je tiens à porter à votre connaissance un épisode désagréable : hier, une journaliste de France 2 a téléphoné à un certain nombre d'entre nous, en indiquant qu'elle réalisait un reportage sur les groupes d'amitié. J'ai accepté, assez naïvement d'ailleurs, de répondre à ses questions. Or le reportage, diffusé hier soir à la télévision, était à charge : il accréditait l'idée que les groupes d'amitié ne servaient à rien, sinon à organiser des voyages touristiques gratuits pour les députés, et que tout cela constituait une énorme gabegie, un scandale supplémentaire touchant l'Assemblée nationale. J'ai essayé d'expliquer à ladite journaliste à quoi servaient les groupes d'amitié, mais mes propos sur ce point n'ont pas été repris. De manière caricaturale, elle a interrogé le président du groupe d'amitié France-Seychelles. Au-delà de nos modestes personnes, c'est l'image de l'Assemblée qui est en jeu. Il me paraîtrait nécessaire que le président de l'Assemblée nationale ou vous-même, madame la présidente, adressiez une lettre à la rédaction de France 2 pour expliquer le rôle des groupes d'amitié, rappeler les règles qui encadrent leur fonctionnement et faire valoir que leur activité n'a rien à voir avec du tourisme.

Je partage l'avis de M. Lellouche. Ce reportage a présenté les groupes d'amitié d'une façon tout à fait scandaleuse : nous ne ferions que nous promener, à travers les deux hémisphères…
Dans le contexte actuel, il est pourtant plus que jamais nécessaire que les parlementaires de différents pays se rapprochent et, si possible, développent ensemble des stratégies afin de faire retomber la pression sur un certain nombre de dossiers que nous évoquons régulièrement au sein de notre commission.

Je vais regarder ce reportage, puis me rapprocher du Président de l'Assemblée nationale afin d'envisager une réaction à son niveau ou au mien. En tout cas, je m'exprimerai volontiers au nom de la commission pour souligner l'intérêt des groupes d'amitié. Nous les invitons d'ailleurs systématiquement à participer aux petits déjeuners que nous organisons, et ils sont également les bienvenus dans nos réunions.
Je me suis rendu en Égypte le 16 février dernier au titre de la Fondation Anna Lindh, qui a financé mon déplacement. J'en ai profité pour rencontrer plusieurs personnalités politiques, notamment le ministre des affaires étrangères égyptien, M. Choukri, qui vient fréquemment à Paris et que certains d'entre vous connaissent bien, le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Nabil Al-Arabi, et le recteur de la mosquée Al-Azhar. J'ai également été reçue par le président Al-Sissi en même temps que les parlementaires qui accompagnaient le ministre de la défense Jean-Yves Le Drian. Ma visite a en effet coïncidé – c'est un hasard – avec la signature du contrat sur les Rafale. C'est aussi à ce moment-là que nous avons appris l'exécution des vingt et un otages égyptiens de confession copte par Daech, qui a soulevé un émoi considérable dans le pays.
Quelques mots, tout d'abord, sur la situation intérieure de l'Égypte.
Le président Al-Sissi jouit d'une véritable popularité, qui repose sur un rejet massif des Frères musulmans par les Égyptiens. Dans leur rapport d'information sur les révolutions arabes – publié en décembre 2013 après la destitution de Morsi, mais reprenant des éléments recueillis au cours d'une mission qui avait eu lieu avant celle-ci –, Jean Glavany et Jacques Myard avaient souligné que les Frères musulmans avaient non seulement profondément déçu, mais qu'ils avaient aussi inquiété les Égyptiens, alors que ceux-ci étaient disposés à leur laisser une chance. En effet, après leurs succès électoraux, les Frères musulmans ont tenté d'accaparer toutes les responsabilités politiques. Ils ont notamment imaginé une réforme constitutionnelle qui prohibait les insultes aux prophètes et qui conférait à Al-Azhar un rôle consultatif sur toute affaire liée à la charia. Cela a conduit leurs alliés politiques à se séparer d'eux progressivement. Rappelons-nous que, avant de destituer le président Morsi, M. Al-Sissi avait fait alliance avec lui et était son ministre de la défense.
En outre, à l'instar d'autres mouvements islamistes, les Frères musulmans ont mené une politique économique d'inspiration très libérale : s'ils obéissaient volontiers aux injonctions du Fonds monétaire international (FMI), ils étaient en revanche impitoyables à l'égard des syndicats. Or cette politique n'a pas eu de résultats sur la croissance. Compte tenu d'une situation économique et sociale déjà très dégradée, le mécontentement est monté. On leur a aussi reproché, à juste titre selon moi, d'avoir cherché à prendre le contrôle de « l'État profond », en remplaçant des hauts fonctionnaires par des fidèles. Quant à leur rapprochement avec le Hamas, d'une part, et avec la Turquie, d'autre part, il a achevé de rompre l'alliance qu'ils avaient conclue avec l'armée. Dans leur majorité, les Égyptiens ne feront plus confiance aux Frères musulmans. D'autre part, beaucoup d'entre eux sont fatigués des troubles politiques incessants. Ce sont probablement là les raisons de la très large victoire de M. Al-Sissi à l'élection présidentielle de mai 2014 : il a recueilli alors 23 millions de voix.
Souvenons-nous cependant que les problèmes sociaux ont fortement contribué à la chute de Moubarak. Or ils demeurent : la croissance est très faible, le déficit public est très élevé – il serait de 12 % du PIB – et le tourisme n'a que très peu repris. Le taux de chômage s'établit en moyenne à 13 % et la pauvreté reste très élevée, notamment en milieu rural et en Haute-Égypte, où elle touche 51 % de la population contre 25 % en moyenne dans le pays. Elle est d'autant plus choquante que l'Égypte a reçu une aide internationale considérable pendant de nombreuses années. Les réformes destinées à stimuler l'investissement se font attendre.
Néanmoins, on peut relever quelques signaux positifs, notamment la reprise des discussions avec le FMI et la baisse des subventions sur les carburants, qui peut contribuer à l'émergence d'une autre forme d'économie, à condition qu'elle n'aggrave pas encore plus la situation des catégories défavorisées. L'Égypte reste très dépendante de l'aide extérieure : depuis le changement politique, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Koweït auraient décaissé 21 milliards de dollars en sa faveur, soit l'équivalent de 10 % du PIB du pays. Le gouvernement égyptien essaie de relancer les investissements, notamment étrangers. Il organise prochainement une conférence à Charm el-Cheikh afin de mobiliser des financements à la fois publics et privés pour de grands projets d'infrastructures tels que le doublement du canal de Suez – dont il est question depuis longtemps, mais dont le président Al-Sissi a fait un projet phare –, le creusement de tunnels ou la construction de logements. Nous devons encourager les investisseurs français à se rendre à Charm el-Cheikh. Le ministre des finances Michel Sapin a prévu d'y aller. Je rappelle que Thales et Alstom, qui ont construit le métro du Caire, viennent d'être retenus pour réaliser son extension pour un montant de 440 millions d'euros. À l'évidence, nos investisseurs et nos entreprises ont une carte importante à jouer dans un pays qui se rapproche considérablement de la France.
La situation des droits de l'homme laisse sérieusement à désirer. La répression s'étend à toute forme d'opposition, y compris aux jeunes révolutionnaires libéraux, alors que ceux-ci représentent aujourd'hui une force très marginale. Quant aux Frères musulmans, ils font l'objet d'une répression massive : 3 000 d'entre eux auraient été tués depuis juillet 2013, et 40 000 de leurs sympathisants seraient en prison, la justice ayant prononcé plus de 1 400 condamnations à mort à leur encontre.
Lorsque l'on évoque ces questions avec les représentants du pouvoir exécutif, ceux-ci nous répondent qu'ils ne peuvent pas faire pression sur la justice. M. Amr Moussa, ancien secrétaire général de la Ligue arabe, nous avait expliqué, lorsque nous l'avions reçu, que les condamnations à mort étaient prononcées par les juges en quelque sorte à titre de précaution, afin que les tribunaux chargés de confirmer les peines aient eux-mêmes la possibilité de prononcer de telles condamnations. Certes, les juges égyptiens ont sans doute une revanche à prendre sur les Frères musulmans, mais cela ne saurait en aucun cas excuser de telles pratiques.
Certains responsables reconnaissent que les brutalités policières existent et que l'Égypte a beaucoup de progrès à faire. Ils ne contestent pas que ces pratiques sont condamnables. On sent un certain embarras, mais la répression contre les Frères musulmans ne semble pas près de s'arrêter, au contraire.
Le président Al-Sissi est très sensible à l'image qu'il donne à l'extérieur ; nous devons continuer à dire ce que nous pensons de cette situation. Notons que le président a consenti à extrader les journalistes étrangers d'Al-Jazeera qui avaient été condamnés à des peines de prison. D'autre part, il insiste beaucoup sur la défense des droits des femmes, et son attitude à l'égard des Coptes est irréprochable.
Les prochaines élections législatives devaient se dérouler entre le 21 mars et le 7 mai, mais elles viennent d'être reportées, car la Cour constitutionnelle a annulé la loi électorale à la suite, semble-t-il, de recours des partis d'opposition. Ceux-ci avaient de toute façon menacé de boycotter les élections en raison des atteintes aux libertés publiques.
La menace terroriste augmente. Elle est chronique dans le nord-est du Sinaï, mais aussi dans les grandes villes du delta. Le Caire et Assouan sont assez régulièrement le théâtre d'attentats. On estime à 3 000 le nombre de djihadistes en Égypte, dont un millier seraient affiliés au principal groupe, Ansar Baït al-Maqdis. Celui-ci a prêté officiellement allégeance à Daech en novembre 2014, essentiellement dans l'objectif de susciter de nouveaux ralliements, les liens opérationnels entre les deux organisations n'étant pas vraiment établis. L'entraînement et l'expertise viendraient de Gaza, les armes de Libye. En revanche, selon les informations qui nous ont été communiquées, peu d'Égyptiens auraient rejoint Daech et Jabhat al-Nosra, et le Nord-Sinaï ne serait pas une destination pour les djihadistes européens.
Les Frères musulmans avaient négocié avec les groupes extrémistes en vue d'obtenir une trêve, sans y parvenir tout à fait. Depuis juillet 2013, ces groupes se sont engagés dans une véritable insurrection. Quelque 600 personnes, membres des forces de l'ordre pour l'essentiel, ont été tuées dans des attaques terroristes. Cela a conduit à un durcissement des mesures sécuritaires, déjà importantes, dans le Nord-Sinaï : état d'urgence, frappes aériennes, fermeture quasi complète du point de passage de Rafah, déplacement des populations pour créer une zone tampon avec Gaza et détruire les tunnels construits par le Hamas. Le risque est évidemment que le régime s'enferme dans une politique exclusivement répressive qui approfondisse le fossé entre la partie de la population qui est radicalement hostile aux Frères musulmans et celle, sans doute minoritaire mais encore nombreuse, qui les soutient. Cela pourrait encourager la radicalisation des militants islamistes et le renforcement de leur présence dans les zones qui échappent en partie au contrôle sécuritaire de l'État telles que le Sinaï ou la frontière libyenne.
La politique étrangère de l'Égypte nous a semblé largement déterminée par le souci de défendre la légitimité de la « Révolution du 30 juin ». L'Égypte a pris ses distances de manière très marquée avec la Turquie et avec le Qatar, qu'elle soupçonne de financer Daech. Selon les indications dont nous disposions, notamment de la part des ministères français, ces financements seraient le fait d'individus ou d'associations. En tout cas, les Égyptiens affirment que nous, Occidentaux, sous-estimons le danger.
Fait nouveau : l'Égypte et les États-Unis ont mutuellement pris leurs distances. Le Caire reproche à Washington une certaine complaisance à l'égard des Frères musulmans. En outre, les autorités actuelles veulent se démarquer à la fois des Frères musulmans et de Moubarak, qui étaient connus pour leurs excellentes relations avec Washington, non sans raison, compte tenu de la manne financière américaine. Les États-Unis ont, eux aussi, pris une certaine distance, car ils n'ont voulu ni cautionner ni condamner l'éviction des Frères musulmans et ont, comme nous, un avis très réservé sur la situation des droits de l'homme, sur la stratégie anti-terroriste du régime et sur sa capacité à réformer l'économie. Néanmoins, il ne s'agit pas d'une rupture : les États-Unis ont maintenu leur aide financière à l'armée égyptienne à son niveau habituel, à savoir 1,3 milliard de dollars par an, tout en refusant de livrer certains équipements, notamment des F16 supplémentaires. Rappelons que les Américains avaient refusé de qualifier le changement de régime de coup d'État, car le Congrès aurait alors demandé la suppression de toute aide financière à l'Égypte.
Le rapprochement avec la Russie doit probablement s'analyser de la même manière : l'Égypte se tourne vers un ancien allié clairement anti-islamiste. La visite de M. Poutine les 9 et 10 février, soit une semaine avant mon déplacement, a été un succès. Il a été reçu par M. Al-Sissi, et les deux pays ont notamment signé un accord de coopération sur le nucléaire civil. En outre, selon les officiels égyptiens, de nouvelles possibilités d'exporter des produits, notamment agroalimentaires, s'offrent à leur pays du fait de l'embargo russe et des sanctions européennes.
On constate un rapprochement très net de l'Égypte avec l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Koweït, et à un refroidissement des relations très marqué avec la Turquie et le Qatar, alors que ces deux derniers pays étaient considérés comme des alliés très proches par le président Morsi. Quant à l'opinion publique égyptienne, elle est hostile aux récentes tentatives de rapprochement entre l'Égypte et le Qatar, soutenues par l'Arabie saoudite. La condamnation par le Qatar des bombardements ordonnés par le président Al-Sissi en représailles après l'assassinat des vingt et un travailleurs égyptiens en Libye n'a fait qu'aggraver le ressentiment à l'égard de ce pays. Pour sa part, la Turquie nie farouchement toute coopération stratégique avec les Frères musulmans. Toutefois, les relations bilatérales entre Le Caire et Ankara risquent de pâtir durablement des déclarations publiques très dures faites par Erdogan au lendemain de la destitution du président Morsi le 3 juillet 2013. D'autre part, les militaires égyptiens n'apprécient guère le sort réservé à l'armée turque par le régime de M. Erdogan.
Les relations avec l'Iran ne sont pas mauvaises. L'Égypte ne peut pas se démarquer de l'Arabie saoudite, mais elle tient à ne pas être en première ligne sur le dossier nucléaire iranien.
Ces éléments expliquent sans doute aussi la position particulière de l'Égypte au sein de la coalition contre Daech : elle est politiquement solidaire de celle-ci, mais n'y participe pas. Cela procède de sa volonté de concentrer ses forces dans le Sinaï et sur les théâtres proches de ses frontières, ainsi que d'une certaine réserve à l'égard d'une coalition qu'elle estime entièrement dirigée par Washington.
Trois sujets retiennent particulièrement l'attention des autorités égyptiennes. Tout d'abord, le Hamas et la bande de Gaza, dossier central eu égard à la lutte contre le terrorisme engagée dans le Sinaï. Là encore, le régime se démarque des Frères musulmans qui entretenaient de bonnes relations avec le Hamas. La justice égyptienne vient de classer le Hamas parmi les organisations terroristes. Naturellement, cela complique encore le rôle que l'Égypte pourrait jouer dans le dossier israélo-palestinien.
Deuxième sujet de préoccupation majeure pour les autorités égyptiennes : la crise syrienne. Leur faible degré d'implication dans le conflit leur permet de se présenter comme une possible force de médiation. Peu avant ma visite, les Égyptiens ont accueilli des représentants de la Coalition nationale syrienne au Caire ou, plus exactement, une partie de cette coalition, car ils ne souhaitaient pas recevoir des personnalités proches des Frères musulmans, en raison de leur allégeance supposée à des puissances extérieures. Cette initiative rejoint celle qui a été prise par Moscou et doit être suivie avec attention.
Troisième sujet : la Libye. L'Égypte avait déjà pris des initiatives avant l'assassinat de ses ressortissants, la sécurité de la frontière avec la Libye étant essentielle pour sa propre sécurité : il s'agit notamment d'empêcher le passage d'armes destinées aux terroristes du Sinaï. Plus d'un million d'Égyptiens vivent en Libye. Après l'exécution des vingt et un otages, le président Al-Sissi a décrété immédiatement une semaine de deuil national, confirmant ainsi sa volonté de traiter les Coptes comme des citoyens à part entière. Les autorités comme les médias les ont présentés comme des Égyptiens assassinés par Daech, sans nécessairement mentionner leur confession. Le président a ordonné une action aérienne contre des positions de Daech en Libye.
Les autorités égyptiennes ont indiqué qu'elles attendaient un appui de notre part en Libye. On a parfois dit que l'Égypte cherchait à nous entraîner dans une intervention militaire. La demande officielle n'est pas formulée de cette façon-là : les autorités égyptiennes insistent plutôt sur la nécessité d'aider les autorités légitimes, c'est-à-dire, de leur point de vue, le gouvernement et le parlement de Tobrouk, à renforcer leur armée. Selon le ministre des affaires étrangères égyptien, les négociations parrainées par le représentant spécial des Nations unies, Bernardino León, sont utiles, mais elles le seraient davantage encore si l'embargo sur les armes était levé. Les Égyptiens sont convaincus que les Frères musulmans manipulent le gouvernement et le parlement de Tripoli, et que seule une petite fraction des forces fidèles à l'ancien parlement libyen peut être associée à une solution politique. Ils soutiennent résolument le général Haftar, qui cherche à reprendre Benghazi. Celui-ci est très offensif, mais il ne semble guère enclin à se soumettre au pouvoir civil, y compris à celui de Tobrouk. Nous devons donc surveiller la situation de près.
On retrouve, dans le dossier libyen, le clivage que j'ai mentionné précédemment entre la Turquie et le Qatar, d'une part, et l'Égypte, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, d'autre part. Chaque camp s'accuse d'ingérence et de partialité, tout en soutenant l'action de M. Bernardino León. Celui-ci a réuni des représentants du parlement de Tobrouk, des modérés de Misrata et divers représentants de la société civile. Il conviendrait sans doute d'élargir ce cercle pour parvenir à un compromis réaliste. Ce processus a été interrompu à cause des frappes aériennes égyptiennes, mais surtout parce que les propositions de M. León quant à la composition du gouvernement d'union nationale qu'il préconise ne sont pas apparues suffisamment précises aux différentes parties. Aux dernières nouvelles, le gouvernement de Tobrouk accepterait de reprendre les discussions. Quant au général Haftar, il a été promu ministre de la défense au sein de ce gouvernement, après avoir pourtant tenu des propos presque insultants envers le premier ministre qui le dirige. Il convient de surveiller l'évolution des relations entre ces deux personnages. En tout cas, nous avons tout un travail diplomatique à accomplir pour que les États voisins soutiennent le processus de médiation des Nations unies, qui paraît le seul praticable alors que la menace sécuritaire s'amplifie.
Enfin, il y a un réel rapprochement entre la France et l'Égypte, qui vient d'être scellé par le contrat sur les Rafale. C'est une chance pour notre diplomatie. Nous devons établir une relation de confiance avec l'Égypte, mais pas de confiance aveugle. Nous pourrions non seulement accroître notre influence dans ce pays très peuplé, mais aussi utiliser notre relation avec Le Caire pour peser davantage dans les dossiers régionaux où l'Égypte joue un rôle important. Bien évidemment, il s'agit non pas de participer à une sorte de Sainte-Alliance anti-terroriste, mais d'inciter les États de la région à dépasser les clivages qui les opposent.
Je donne maintenant la parole à M. Duclos pour qu'il nous livre son analyse de la situation dans la région. Je rappelle qu'il a été ambassadeur à Damas de 2006 à 2009, puis conseiller diplomatique du ministre de l'intérieur pendant une partie de la législature précédente. Il est aujourd'hui chargé de mission pour le Moyen-Orient au centre d'analyse, de prévision et de stratégie du ministère des affaires étrangères.
Je suis très honoré de m'exprimer devant votre commission. Dans le temps qui m'est imparti, je m'en tiendrai à quelques remarques générales sur les grandes lignes de fracture qui traversent la région. Pendant très longtemps et il y a quelques années encore, lorsque l'on évoquait le Proche-Orient, on pensait essentiellement au conflit israélo-palestinien ou israélo-arabe. Puis le clivage entre sunnites et chiites s'est creusé. Il s'agit dans une certaine mesure d'un héritage de l'invasion américaine en Irak, laquelle a conféré un atout considérable à l'Iran. À ces clivages s'est surajoutée la division entre pro et anti-Frères musulmans que vous venez d'évoquer à propos de l'Égypte, madame la présidente, en montrant bien qu'elle avait des répercussions dans l'ensemble de la région. Enfin, dans les derniers mois, un dernier clivage s'est surimposé aux autres : celui qui est apparu entre les djihadistes et les anti-djihadistes. Les djihadistes ont formé un véritable proto-État à cheval sur la frontière syro-irakienne et constituent, à leur tour, un facteur de division très important dans la région.
Le clivage entre pro et anti-Frères musulmans – l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis, d'un côté ; la Turquie et le Qatar, de l'autre – se retrouve sur les théâtres les plus divers. Vous avez mentionné à juste titre la Syrie, madame la présidente : lorsqu'ils réunissent l'opposition syrienne au Caire, les Égyptiens tiquent s'il y a des personnalités proches des Frères musulmans parmi ses représentants. Mais ce clivage affecte aussi des théâtres tels que la Libye, où nous avons assisté à une scène incroyable : certaines positions tenues par des forces clairement soutenues par le Qatar ont été la cible de frappes aériennes attribuées aux Émirats arabes unis, même si ceux-ci n'ont pas reconnu en être les auteurs. Ainsi, deux pays du Conseil de coopération des États arabes du Golfe se font la guerre sur un théâtre extérieur ! Néanmoins, je ne suis pas certain que cette ligne de fracture soit durable : elle peut encore bouger. Le changement de roi en Arabie Saoudite, notamment, commence à décrisper la situation. Et si, par bonheur, le Gouvernement turc parvenait à régler son différend avec les Kurdes, cela détendrait aussi l'atmosphère.
En revanche, la ligne de fracture entre sunnites et chiites est quasi structurelle et joue un rôle capital. Depuis l'invasion américaine en Irak, l'Iran n'a cessé de progresser d'un point de vue géopolitique dans la région. Il a accru sa mainmise d'abord sur l'Irak, puis sur le Liban. Du fait du conflit syrien, les Iraniens sont désormais les vrais patrons à Damas. Et ils avancent aujourd'hui leurs pions jusqu'au Yémen. Le conseiller diplomatique du Guide suprême a déclaré officiellement que l'Iran contrôlait désormais Beyrouth, Damas, Bagdad et Sanaa.
Face à cette situation, le camp sunnite est dans un état de dépression et de fureur. Il assiste avec une sorte de rage impuissante à la montée en puissance de l'arc chiite, c'est-à-dire essentiellement des « Perses », pour reprendre le terme employé dans la région. Cette fureur est aggravée par trois facteurs : le sentiment que les États-Unis ont trahi en se retirant de la région, même si ce reflux est plus fantasmé que réel ; la perspective d'un accord avec l'Iran sur le dossier nucléaire, lequel est perçu comme la trahison suprême sinon par les gouvernements, du moins par les opinions publiques des pays sunnites ; le maintien du régime de Bachar Al-Assad à Damas. Ce dernier élément cristallise le sentiment d'impuissance face à l'influence croissante de l'Iran et l'idée que les Occidentaux ont trahi, dans la mesure où ils n'ont pas fait grand-chose pour déstabiliser ce régime.
L'apparition du dernier clivage, entre djihadistes et anti-djhadistes, a eu, dans une certaine mesure, un effet positif : elle a obligé les puissances de la région à se focaliser sur une menace commune. Cela peut en effet les aider à relativiser les innombrables sujets de discorde régionaux, même si, de manière frappante, l'Égypte et la Turquie ne font pas complètement partie de la coalition contre Daech, ainsi que vous l'avez rappelé, madame la présidente. Néanmoins, l'apparition de ce clivage a aussi eu un effet négatif : elle a accru la méfiance de l'ensemble des pays de la région à l'égard des Occidentaux, à tout le moins des Américains.
Dès lors, que faire ? Je ne me risquerai pas à présenter une politique complète – telle n'est d'ailleurs pas ma mission –, mais je formulerai deux propositions.
Première proposition : la France doit éviter d'apparaître comme partisane, en particulier au regard du clivage entre les sunnites et les chiites, lequel est non seulement religieux, mais aussi politique. Notre rôle n'est pas de prendre parti. Nous devons notamment nous habituer à l'idée qu'un accord sera conclu avec l'Iran sur le dossier nucléaire. Même si celui-ci devait ne pas intervenir in fine, il faut se préparer à cette échéance. Nous devons donc être prêts à renouer nos relations avec l'Iran dans de nombreux domaines. La France a heureusement anticipé en la matière, en envoyant à plusieurs reprises le directeur d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, Jean-François Girault, parlementer à Téhéran, et en dépêchant sur place une mission commerciale, qui a été très critiquée. Nous devons continuer à montrer que nous sommes disposés à dialoguer avec l'Iran, sans renoncer, bien entendu, à nos positions sur le dossier nucléaire.
D'ailleurs, nous ne sommes nullement placés devant une alternative qui nous obligerait à entretenir de bonnes relations soit avec l'Iran, soit avec les puissances sunnites. Bien au contraire : si nous nous présentons les mains vides à Téhéran, uniquement avec nos beaux yeux, nous ne pèserons guère et nous ne serons pas accueillis avec des fleurs ! Les partenariats solides que la France a noués avec les puissances sunnites de la région constituent un atout vis-à-vis des Iraniens.
Deuxième proposition – je coiffe là ma casquette d'ancien conseiller diplomatique du ministre de l'intérieur, fonction que j'ai exercée pendant trois ans : notre préoccupation centrale doit être Daech et la menace qu'il représente pour notre sécurité intérieure, laquelle est un phénomène, à certains égards, fantastique. Ainsi que nous le disons aux Américains, nous ne pouvons pas nous contenter de bombarder Daech : ce n'est qu'une partie de la réponse. Il faut avoir une action déterminée pour couper les trois principales sources d'alimentation de ce mouvement. La première est la politique sectaire menée en Irak : les milices chiites s'y conduisent, aujourd'hui encore, très mal vis-à-vis des sunnites, ce qui favorise l'implantation de Daech. À cet égard, M. Al-Maliki a été l'un de ses grands « parrains ». Deuxième source : la porosité des frontières. Il convient de mettre un terme de la manière la plus résolue à la circulation des armements, des financements et des hommes qui convergent vers Daech. Troisième source : le régime de Bachar Al-Assad à Damas, qui constitue une sorte de produit d'appel pour les djihadistes de la région et du monde entier. Il s'agit en effet d'un véritable « chiffon rouge » qui incite les sunnites à rallier cette forme extrême d'expression du sunnisme qu'est Daech.
Concernant le régime de Bachar Al-Assad et Daech, trois options ou thèses sont sur la table. Selon la première, qui a le vent en poupe, il conviendrait de renouer avec le régime de Bachar Al-Assad en raison de la progression de Daech. Pour ma part, ayant beaucoup fréquenté l'entourage de M. Al-Assad et mûrement réfléchi, je ne vois pas ce que nous aurions à gagner à relancer la coopération avec ce régime. Et il s'agit non pas d'une question de sentiments, mais de calcul au regard de nos intérêts. Sur le plan militaire, l'armée syrienne est exsangue : elle est évaluée à 70 000 hommes et, les rares fois où elle s'est confrontée à Daech, elle a été battue à plate couture, notamment lors de son opération sur la base aérienne de Tabka. Ce n'est donc pas le régime syrien qui nous aidera à combattre Daech. Quant à la coopération en matière de sécurité, même si d'anciens membres des services français font campagne pour que nous la reprenions, je ne vois pas très bien, là non plus, ce que l'on peut en attendre : les djihadistes français se trouvent, par définition, dans des zones qui ne sont plus contrôlées par le régime.
En revanche, les inconvénients d'un rapprochement avec le régime de Bachar Al-Assad apparaissent clairement. Il y a en effet un prix à payer : nous rendrions ses adversaires plus furieux encore et augmenterions donc le risque d'attentats contre nous. Surtout, nous favoriserions la propagande de Daech, qui pourrait prétendre : « Nous vous l'avons toujours dit, cet hérétique est allié avec les infidèles ! » À l'extrême limite, si nous en venions à réhabiliter vraiment Bachar Al-Assad, nous serions sûrs de jeter toute l'opinion sunnite de la région dans les bras de Daech.
La deuxième option est celle des Américains. Elle consiste à dire qu'il serait dangereux de renouer avec Bachar Al-Assad, mais que l'on ne peut pas tout résoudre à la fois. En d'autres termes, chaque chose en son temps : on commence par taper sur Daech en Irak et, dans une moindre mesure, en Syrie, puis on verra le moment venu ce qu'il convient de faire avec le régime. À toutes fins utiles, on entraîne et on équipe les rebelles syriens, à condition qu'ils soient contre Daech mais pas contre le régime – ce qui est un peu douteux politiquement. Cette position présente, selon moi, de nombreuses faiblesses : lutter contre Daech en segmentant les problèmes revient à combattre en se liant une main dans le dos. Il faut avoir, au contraire, une approche globale, et assécher les trois sources d'alimentation de Daech, que j'ai citées : le sectarisme irakien, la porosité des frontières, le régime de Bachar Al-Assad.
La troisième option, c'est d'accélérer la transition à Damas. C'est évidemment la plus difficile à mettre en oeuvre, mais, en même temps, la seule réaliste. Nous ne pourrons lutter sérieusement contre Daech que si nous sommes capables de montrer que cette transition est possible. Comment procéder ? Le temps qui m'était imparti touchant à sa fin, je laisse la question en suspens pour l'instant.

Quelle est selon vous, monsieur l'ambassadeur, la situation du régime syrien ? Quels sont ses soutiens ? Est-il capable de rétablir son contrôle sur le territoire et sur la population ? On entend beaucoup dire, ces temps-ci, qu'il serait nécessaire de s'allier avec Staline pour combattre Hitler. Mais le général de Gaulle ne se serait sans doute pas allié avec Staline si celui-ci n'avait pas disposé d'une armée composée de nombreuses divisions, ainsi que d'un charisme personnel, indéniable à l'époque. Bachar Al-Assad possède-t-il vraiment tous ces attributs ? Pour ma part, j'en doute, et vos propos me renforcent dans cette conviction.

Nous avons appris hier que Harakat Hazm, groupe financé et armé par Washington – et peut-être également par nous –, est passé avec armes et bagages à Al-Nosra et Al-Qaïda. Je veux bien que l'on aide de « bons islamistes » contre Bachar Al-Assad, mais c'est visiblement plus que risqué !
Je me suis rendu à Damas avec quelques collègues. Je tiens à confirmer un point majeur : tous les États de la région font preuve de duplicité, à un niveau parfois étonnant. Et ces informations ne sont pas orientées : nous les avons recueillies non seulement à Damas, mais aussi à Beyrouth. La grande crainte des Libanais, pour ne pas dire leur terreur, c'est que, si Bachar tombe, tout tombe avec lui, que l'armée soit balkanisée et que le Liban soit balayé. Ils redoutent une attaque dans la plaine de la Bekaa. Le Hezbollah, en particulier, est très inquiet. En principe, la France devrait fournir des armes, notamment des hélicoptères, à l'armée libanaise, via un financement de l'Arabie Saoudite, mais cela risque de prendre du temps.
Bref, ce n'est plus seulement l'Orient compliqué, c'est l'Orient hyper-compliqué ! Évitons donc les postures ! Ne disons pas, en particulier, que nous ne parlerons jamais avec Bachar. Il nous a d'ailleurs été confirmé que les Américains avaient des contacts avec lui, par des intermédiaires. Et n'oublions pas que Staline a reçu un armement massif des États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Si nous accélérons la transition à Damas – vaste programme ! –, il y aura une balkanisation de l'armée. Tout explosera et nous en reviendrons aux grandes compagnies du Moyen-Âge ! C'est en tout cas ce que tout le monde nous dit dans la région. Cessons donc de jouer les apprentis sorciers !
Selon le ministre des affaires étrangères syrien, au début des événements, en 2012, Erdogan a demandé à Bachar de faire entrer les Frères musulmans dans son gouvernement. Bachar a répondu qu'il n'en était pas question : la Syrie était un État laïc, et les Frères musulmans des terroristes. L'objectif d'Erdogan était de créer un axe entre la Turquie, la Syrie et l'Égypte du président Morsi. Il cherche à contrôler directement l'État syrien. Il faut donc savoir ce que nous voulons !
D'autre part, si les Égyptiens ont pris leurs distances avec les Américains, c'est que ces derniers leur ont interdit d'utiliser les F16 pour frapper un « essaim de frelons » en Libye. C'est également l'une des principales raisons de l'achat des Rafale à la France. Les Américains jouent également un double jeu dans cette affaire, notamment avec les Frères musulmans, qu'ils ont beaucoup aidé, fut un temps.
Je vous rejoins sur un point, monsieur l'ambassadeur : nous devons adopter une position équilibrée. Mais, de grâce, gardons-nous des postures, car la situation est très compliquée : une partie de poker menteur se joue sur l'ensemble de la scène internationale !

C'est précisément parce qu'il y a des doubles, triples ou quadruples jeux et que la situation est hyper-compliquée qu'il faut éviter de se faire instrumentaliser !

Je suis allé au Sud-Liban – à titre personnel et sur mes propres deniers – pour rendre visite à un régiment de Tarbes engagé dans la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL). Près de trente nations ont fourni un bataillon à cette force, non seulement la France, l'Italie et l'Espagne, mais aussi l'Inde et la Malaisie. La FINUL est actuellement dirigée par un général italien
Mon séjour a été très instructif. Premier enseignement : la tension est très vive et la FINUL, force d'interposition entre Israël et le Hezbollah, compte d'une certaine manière les coups. Au mois de janvier, deux incidents très graves se sont produits à bref intervalle. Le 18 janvier, Israël a touché un convoi par un tir de missile très ciblé, provoquant la mort de l'un des dirigeants les plus importants du Hezbollah, ainsi que celle d'un général iranien en visite à des fins de coopération militaire avec ce mouvement. Dix jours plus tard, le 28 janvier, le Hezbollah a tiré à son tour un missile sur un convoi, tuant deux soldats israéliens. Israël a répondu par des tirs d'artillerie très violents qui ont duré plusieurs heures.
Je suis allé en patrouille avec les militaires, en particulier dans la zone très tendue des fermes de Chebaa, où la ligne de démarcation passe à quelques mètres des premières maisons israéliennes. Deuxième enseignement, très frappant : à quelques kilomètres à peine des fermes de Chebaa, aux confins du Golan, des combats ont lieu quotidiennement non pas entre le Hezbollah et Israël, mais entre une coalition de l'armée libanaise et du Hezbollah, d'une part, et les djihadistes, d'autre part. Il s'agit, certes, de djihadistes de Jabhat Al-Nosra et non de Daech, mais, d'après les diplomates et les spécialistes militaires que j'ai pu interroger, les drapeaux de ces deux mouvements sont facilement interchangeables.
Ces combats très violents se déroulent sous le regard intéressé et pas si passif que cela des Israéliens. En effet, la complicité de ces derniers avec Jabhat Al-Nosra est avérée : ils recueillent et soignent les djihadistes blessés dans leurs hôpitaux. Israël raisonne de la manière suivante : les ennemis de mes ennemis ne sont pas mes ennemis, à défaut d'être mes amis. Ses principaux ennemis étant le Hezbollah et l'Iran, il voit d'un oeil bienveillant le combat de Jabhat Al-Nosra contre le Hezbollah. Cela ne fait qu'ajouter à la confusion générale dans la région. J'apporte ainsi un tout petit peu d'eau au moulin de Jacques Myard.

Vous avez évoqué, madame la présidente, les vingt et un Coptes qui ont été décapités en Libye. En dehors du deuil national, les dirigeants égyptiens ont-ils pris d'autres décisions, notamment pour sanctionner les personnes responsables de ces décapitations ? Y a-t-il eu des contacts à cet égard ?

Les Égyptiens ont condamné publiquement ces exécutions. Ils ont bombardé les positions de mouvements islamistes en Libye et répriment de manière très brutale, à l'intérieur, ceux qui sont soupçonnés d'avoir de l'indulgence pour eux, c'est-à-dire les Frères musulmans. Ils cherchent à favoriser le gouvernement et le parlement de Tobrouk, qui échappent, selon eux, à l'influence des islamistes et qu'ils considèrent comme la seule autorité légitime. J'ignore s'ils ont pris d'autres initiatives.

Monsieur l'ambassadeur, comment voyez-vous l'évolution de la situation au Liban dans le contexte régional actuel ? Jacques Myard a évoqué l'explosion qui pourrait se produire en fonction des événements en Syrie.

L'attitude de la France m'a surpris, voire inquiété, à trois reprises. D'abord, lorsque le Gouvernement a affirmé que la chute du régime à Damas était une question de jours ou d'heures. Actuellement, c'est plutôt une question d'années. Ensuite, lorsque nous nous sommes dits prêts à attaquer la Syrie. Nous avons finalement renoncé quand le président Obama a annoncé qu'il allait consulter le Congrès. Enfin, lorsque nous avons été pratiquement sur le pied de guerre avec l'Iran. Selon les déclarations officielles, nous devions alors envisager « toutes les options » à l'égard de ce pays, ce qui est lourd de sens en langage diplomatique.
Or, aujourd'hui, le régime de Damas tient bon. Vous contestez sans doute qu'il progresse sur le terrain, mais il n'est pas près de tomber. Comme beaucoup, notamment comme les Américains, je considère que l'on ne pourra pas retrouver la paix sans que le régime de Damas soit, d'une manière ou d'une autre, partie à la négociation, même si c'est pour organiser son retrait.
L'exécutif américain s'accorde avec l'Iran et accepte tout ce qu'il rejetait précédemment. Le Congrès refusera peut-être cette évolution, mais nous n'en sommes pas là pour le moment. En outre, même si je n'en ai pas la preuve, j'ai tendance à penser que les États-Unis ont des contacts indirects avec le régime de Damas.
En conclusion, cessons de porter des jugements de nature morale, de dire qu'il y a des « bons » et des « méchants ». On affirme que Bachar est un boucher, mais nous avons parfois traité avec des gens pires que lui ! Nous devrions méditer ce proverbe bien connu dans tous les pays du Moyen-Orient : « Baise la main que tu ne peux couper. »

L'ambassadeur Duclos a bien souligné qu'il n'énonçait pas des positions morales, mais qu'il faisait une analyse de nature politique.

J'ai participé à une mission internationale d'observation de l'élection présidentielle en Égypte. M. Al-Sissi a été élu dans des conditions assez curieuses : un troisième jour de scrutin a été rajouté pour inciter la population à voter, alors que le deuxième jour était déjà férié. Au sujet de M. Al-Sissi, il se disait alors que les Égyptiens préféraient la sécurité à la démocratie.
D'autre part, tout le monde pensait que, une fois élu, M. Al-Sissi organiserait rapidement des élections législatives relativement inclusives à l'égard des mouvements d'opposition, notamment des Frères musulmans, afin de favoriser la réconciliation nationale. Or, un an après, il exerce toujours le pouvoir législatif à lui tout seul, la Cour constitutionnelle ayant rejeté la loi électorale. Existe-t-il selon vous, monsieur l'ambassadeur, un risque de déstabilisation du régime ? Les militaires pourraient-ils reprendre la main ? Au moment de l'élection, il se disait que, si cela ne fonctionnait pas avec Al-Sissi, les militaires le débarqueraient et le remplaceraient par un autre.
Enfin, je suis impatiente de savoir comment il convient de procéder selon vous pour accélérer la transition à Damas.

Je me suis rendu, moi aussi, en Égypte, lundi et mardi derniers, pour des contacts avec le Parti des Égyptiens libres. J'ai été surpris de constater le soutien dont bénéficie le régime actuel, y compris au sein de la société civile.
Monsieur l'ambassadeur, l'Égypte ne risque-t-elle pas d'intervenir plus fortement en Libye, au-delà de l'opération militaire ponctuelle qui a eu lieu il y a quelques jours ? J'ai senti une exaspération très forte. Les Égyptiens disent aux Occidentaux : « Vous n'avez pas fini le travail en Libye. C'est désormais le chaos. Si vous ne vous en mêlez pas, nous serons bien obligés de le faire. »

Les témoignages des uns et des autres montrent bien toute l'importance de la diplomatie française. C'est une bonne chose, et il convient d'encourager ces initiatives.
Vous exercez, monsieur l'ambassadeur, une fonction très importante au sein du ministère des affaires étrangères : vous rassemblez les éléments sur la base desquels l'exécutif fait ses choix ; la façon dont vous les préparez et les présentez est donc déterminante pour la définition de notre politique étrangère.
Je vous suis tout à fait dans l'analyse factuelle très intéressante que vous avez faite de la situation. En revanche, je ne me retrouve guère dans les trois scénarios que vous avez décrits. S'agissant du premier scénario, il est bien sûr exclu d'aider Bachar. Le scénario américain consiste, lui, à faire la guerre et à voir ce qui se passe ensuite. Quant au scénario français, que vous semblez justifier, il me semble irréaliste. Certes, personne n'est favorable à Bachar, mais accélérer la transition à Damas aujourd'hui – je ne parle pas de ce qui pourrait éventuellement se passer dans quelque mois –, c'est favoriser la prise du pouvoir par Daech. Pourriez-vous développer votre propos sur ce troisième scénario ?

Je partage le scepticisme d'Axel Poniatowski quant à ce scénario.
Pouvons-nous envisager de faire partir Bachar Al-Assad sans les Iraniens ni les Russes ? À mon sens, non. Il faut donc que les différentes négociations que nous avons avec Téhéran et Moscou se dénouent à un moment ou à un autre. En d'autres termes, même la crise ukrainienne entre ligne de compte.
Pouvons-nous envisager un partenariat avec l'Iran sans rompre avec l'Arabie Saoudite ? Selon vous, c'est faisable. En tout cas, la situation au Yémen n'est pas aussi univoque qu'on pourrait le penser : les Saoudiens ne sont pas totalement hostiles aux Houthistes, car leur principal ennemi, ce sont les Frères musulmans. Leurs intérêts peuvent donc converger dans une certaine mesure avec ceux des Iraniens. Néanmoins, d'un point de vue géopolitique et stratégique, l'Arabie Saoudite et l'Iran sont des adversaires. Sont-ils pour autant des adversaires irréductibles ? J'aimerais avoir votre éclairage sur ce point.
Dans ce contexte, lorsque M. Netanyahou se rend devant le Congrès américain pour faire des déclarations hostiles à tout accord avec l'Iran, ne fait-il pas le jeu de l'Arabie Saoudite ? Quelles peuvent être les conséquences de ces déclarations sur la situation dans la région ? Quelle doit être, dès lors, notre stratégie ?
Enfin, si Bachar Al-Assad n'est pas Staline – je suis d'accord avec vous sur ce point, madame la présidente –, Al-Baghdadi ne possède pas non plus la puissance de l'Allemagne nazie. Il faut bien évaluer le rapport de forces sur le terrain.

S'agissant du processus politique engagé en Égypte, peut-on penser que les élections législatives se tiendront dans un délai raisonnable ? Ou bien les éléments dont nous disposons sont-ils insuffisants pour que nous ayons une certitude en la matière ?
La lumière est braquée sur Bachar, mais on a le sentiment qu'il est un pion dans un jeu très compliqué et obscur. Son sort, celui de la Syrie et celui du Moyen-Orient dépendent en partie de tractations en cours sur d'autres dossiers, notamment l'Iran et l'Ukraine, pour n'en citer que deux. Quels sont les éléments déterminants de ces tractations ? Pouvez-vous nous éclairer sur ce point ?

Je me suis rendu au Caire il y a environ deux mois dans le cadre d'une mission du groupe d'amitié France-Égypte, à l'invitation du président Al-Sissi et de son entourage. Pendant une heure, le président nous a répété : « Si la porte de devant qui se trouve chez nous cède, la porte de derrière qui se trouve chez vous cédera aussi. Dites-le à votre gouvernement. » D'autre part, il a estimé que nous n'avions pas terminé le travail en Libye – je précise que cet entretien a eu lieu avant la décapitation des Coptes.
Les agents du consulat général au Caire m'ont confié en aparté qu'ils en avaient assez de recevoir des Français islamisés « réfugiés » en Égypte qui viennent leur réclamer le versement du revenu de solidarité active (RSA). Ceux-ci seraient quelques centaines. J'ignore si ce phénomène est anecdotique ou non. En tout cas, c'était pour moi une découverte.
Je partage tout à fait l'analyse et l'avis des collègues qui se sont exprimés sur la Syrie : ne rajoutons pas de déséquilibres à ceux qui existent déjà. Loin d'apporter de la stabilité, un processus de transition risque de déstabiliser encore plus la situation.

En tant que député des Français de l'étranger, je précise qu'on ne peut pas toucher les prestations sociales, en particulier le RSA, lorsqu'on réside à l'étranger. Ou alors il s'agit de fraude.

Pour pouvoir toucher les prestations sociales et la retraite, il faut en effet revenir en France et y résider un certain temps.
S'agissant de la question soulevée par Chantal Guittet et Jean-Pierre Dufau, il n'y a actuellement pas de parlement en Égypte. J'ai souligné auprès des responsables égyptiens à quel point c'était dommageable, d'une part parce que cela donnait une image désastreuse du pays, d'autre part parce que nous étions privés d'interlocuteur. Ils reconnaissent qu'il y a un problème, mais disent qu'ils n'y peuvent rien, car cela tient aux recours juridictionnels. Je ne suis pas en mesure de vous dire à quelle échéance les élections auront lieu : cela dépendra de la date des jugements. Néanmoins, un certain nombre de ministres et de personnes proches du pouvoir semblent décidés à avancer sur cette question.
Pour répondre à Thierry Mariani, il existe en effet un risque que les Égyptiens interviennent plus fortement en Libye. Ils nous demandant d'ailleurs de leur donner les moyens de le faire, ainsi que de livrer des armes et d'être présents sur les côtes. Car Daech a désormais pris position à Derna et à Syrte, ce qui est très dangereux. S'ils veulent que nous soyons plus actifs, les responsables égyptiens ne nous demandent pas, en revanche, d'intervenir nous-mêmes. Nous avions d'ailleurs pris les devants pour leur faire connaître notre position à cet égard, notamment faire valoir que la France ne peut pas tout faire. De même qu'avec Jean-Claude Guibal, tous mes interlocuteurs, en particulier le grand imam, ont souligné que nous n'avions pas assuré le suivi après notre intervention militaire en Libye. En effet, nous n'avons pas fait ce que nous sommes parvenus à faire à peu près correctement au Mali, c'est-à-dire organiser un processus qui débouche sur des élections.
Monsieur Myard, je ne doute pas que M. Erdogan ait eu des intentions du type de celles que vous avez évoquées. De même, les Iraniens utilisent la situation pour consolider l'axe chiite. Soyons en effet lucides : tous les acteurs de la région jouent un double ou un triple jeu.
Certes, nous devons tenir compte du fait que les Turcs ou les Iraniens avancent leurs pions, mais nous devons avant tout défendre nos propres intérêts. À cet égard, après avoir passé trois ans au ministère de l'intérieur, je ne saurais trop insister sur l'importance de nos intérêts de sécurité intérieure. C'est d'ailleurs un débat que j'ai pu avoir avec mes collègues du Quai d'Orsay : la France n'est pas une abstraction, et la sécurité est une préoccupation majeure de nos concitoyens. Or, aussi longtemps qu'existera une situation de chaos en Syrie, nos intérêts de sécurité intérieure seront directement affectés. L'enjeu n'est pas d'éviter une déstabilisation, car il n'y a pas, actuellement, d'équilibre stable : nous sommes confrontés à une situation de guerre civile avec des prolongements dans la région, qui alimente la machine à fabriquer des djihadistes français. Néanmoins, vous avez, les uns et les autres, tout à fait raison sur un point : il ne faut pas que la situation devienne encore plus chaotique.
Pas du tout. Pour lutter contre Daech, nous ne pouvons pas faire l'économie de l'éviction de Bachar Al-Assad. De manière très cynique, du point de vue des pays européens – il n'en allait pas de même pour les États-Unis –, tant que le conflit se limitait à une guerre civile entre Syriens, le bilan humain – plusieurs centaines de milliers de morts – était certes triste, mais nous n'étions pas affectés directement. Toutefois, à partir du moment où le conflit est devenu l'une des causes – ce n'est bien sûr pas la seule – qui alimentent Daech, nous devons absolument nous en occuper très sérieusement.
Comment faire ? Il faut en effet partir du rapport de forces. À l'origine, l'armée syrienne comptait 300 000 à 350 000 hommes. Aujourd'hui, elle comprend au maximum 70 000 combattants effectifs, dont probablement 20 000 à 30 000 sunnites que le régime se garde bien d'envoyer au front. Quant à la 4e division blindée de la Garde républicaine, qui constitue le dernier carré des fidèles, elle est exsangue.
Par ailleurs, j'appelle votre attention sur les travaux du professeur Youssef Courbage, grand démographe spécialiste de la région. Il rappelle que les 2,5 millions d'Alaouites représentent 10 % de la population syrienne, contre 73 % pour les Sunnites. Sur les 220 000 victimes que le confit syrien a fait jusqu'ici selon les Nations unies – le nombre réel est certainement supérieur –, au moins 50 000 sont des Alaouites. Si la guerre dure quinze ans comme au Liban, les Alaouites seront réduits à presque rien, pour de simples raisons démographiques. Les minorités, notamment les Alaouites, sont bien conscientes que les évolutions démographiques depuis vingt ou trente ans leur sont très défavorables. C'est l'une des raisons pour lesquelles elles craignent à ce point le changement. Cette peur de disparaître est particulièrement poignante chez les Chrétiens.
Comme toujours lorsque l'on souffre d'une carence démographique, on est obligé de recourir à l'immigration. C'est ce qu'a fait le régime : il a sollicité l'appui de milices chiites, principalement irakiennes, mais aussi libanaises, en particulier du Hezbollah. Ces milices compteraient actuellement 35 000 hommes, dont au moins 5 000 appartiennent au Hezbollah. Le potentiel de ce dernier était évalué initialement à 5 000 ou 6 000 combattants, avec des réserves mobilisables de 20 000 à 30 000 hommes. D'autre part, le régime a fait appel à des milices syriennes pour tenter de combler les trous dans l'armée. Celles-ci comprendraient environ 50 000 hommes actuellement. Elles peuvent faire le siège des villes, tenir des postes de contrôle – check points –, piller ou rançonner, mais elles ne participent pas aux combats. En termes de force de frappes contre Daech, nous ne pourrons donc pas compter, en pratique, sur les forces syriennes, ce qui nous posera d'ailleurs un problème si nous parvenons à enclencher une transition.
Comment peut-on sortir de la situation actuelle ? Je suis conscient, moi aussi, que ce sera très difficile. Au vu de mon expérience de la Syrie, Bachar Al-Assad s'accrochera tant qu'il le pourra au pouvoir : il ne le quittera qu'à l'ultime minute. Il ne suivra pas l'exemple de Ben Ali ou de Moubarak, mais peut-être pas non plus celui de Kadhafi, car il préférera sans doute sauver sa peau. Nous avons une chance de réussir, moins en favorisant les discussions inter-syriennes qui sont, certes, indispensables, qu'en recherchant un accord avec les puissances tutélaires et régionales. Ce qui compte du point de vue des Russes et des Iraniens, ce ne sont pas les « parlottes », mais le rapport de forces sur le terrain. Pour l'instant, les Iraniens ne bougent pas, car ils trouvent qu'ils ne se tirent pas si mal que cela de ce chaos : leurs milices s'infiltrent partout, leur axe avec le Hezbollah tient. Et, si jamais nous parvenons à un accord sur le dossier nucléaire avec eux, il ne faut pas croire que cela facilitera les choses, puisqu'ils auront alors des ressources supplémentaires à consacrer à leurs « danseuses » sur les théâtres extérieurs. En outre, ils seront probablement obligés de compenser un tel geste en direction de l'Occident en laissant davantage les mains libres aux pasdaran et autres milices.
Malgré tout, à la longue, le conflit finit par coûter. Les chiffres que j'ai mentionnés concernant le Hezbollah ont leur importance. En effet, le Hezbollah est, aujourd'hui, très mobilisé : il combat la rébellion en Syrie et en Irak ; il envoie des instructeurs au Yémen ; il doit continuer à tenir le front libanais. On peut donc se demander combien de temps cela va durer. Dans nos discussions avec les Iraniens, nous pourrions leur suggérer qu'ils sont en train d'user sérieusement la carte du Hezbollah qui est si importante pour eux vis-à-vis d'Israël. À la différence de l'armée syrienne, qui n'avait pas tiré un coup de feu depuis trente ans, le Hezbollah est une force très aguerrie qui a participé à différents conflits, mais il n'est tout de même pas l'équivalent de l'armée américaine, ni même de l'armée britannique ! À la longue, le parrain iranien pourrait donc bouger, s'il finit par trouver que la situation devient dangereuse.
S'agissant du parrain russe, la baisse du prix du pétrole joue en notre faveur. Certes, nous ne pouvons pas exclure que M. Poutine continue à bétonner et s'en tienne à sa position rigide sur le dossier syrien, compte tenu de sa posture générale anti-occidentale. Mais, selon les rares indications dont nous disposons, les Russes font le raisonnement que je faisais tout à l'heure concernant la défense des intérêts de sécurité intérieure : ils constatent qu'un certain nombre de Tchétchènes rejoignent Daech et se demandent où cela va s'arrêter. À un moment donné, ils pourraient donc être favorables à un compromis régional qui permette de retrouver une certaine stabilité.
Vous avez raison, monsieur Poniatowski : la transition n'est pas pour aujourd'hui, mais nous devons commencer à y travailler dès maintenant pour obtenir un résultat dans un, deux ou peut-être trois ans. Notre politique doit être celle des gens raisonnables qui considèrent qu'il y a un « après », qu'il faut arrêter les logiques de guerre et proposer un projet de paix. Pour qu'un tel projet soit viable, il est clair qu'il faudra garantir les intérêts des Iraniens, des Russes, mais aussi des Saoudiens et des Turcs. Tel est le rôle des diplomates. Nous devons imaginer, dans le cadre de discussions, des institutions de transition qui confient l'essentiel du gouvernement aux sunnites – qui représentent, je le rappelle, 73 % de la population –, mais qui donnent aussi des garanties aux Alaouites, notamment dans l'armée, et qui permettent aux Iraniens de conserver l'accès au Hezbollah, élément clé pour qu'ils acceptent un compromis. La Syrie « d'après » ne sera sans doute pas un pays idéal au regard des principes démocratiques et des droits de l'homme, mais nous pouvons faire en sorte que ce soit un pays vivable, dans la mesure où les intérêts des uns et des autres auront été pris en compte.
Le représentant spécial conjoint des Nations unies et de la Ligue arabe, Lakhdar Brahimi, était à la pointe des activités de médiation. Dans les guerres civiles, on le sait, les parties ne s'assoient à la table des négociations que lorsqu'elles sont complètement épuisées. Tel n'était pas le cas ces dernières années. Mais on peut penser qu'on se rapproche désormais de ce moment : il y a une chance que les puissances tutélaires et les puissances régionales en arrivent à la conclusion qu'il faut commencer à discuter sérieusement.
Venons-en au rôle de Bachar Al-Assad. Au vu des contacts que j'ai en Syrie, il est clair que plus personne ne le soutient de manière enthousiaste : tout le monde a bien compris, les Syriens comme les autres, qu'il n'était plus seulement un dictateur qui fait torturer ses opposants, mais aussi, désormais, un criminel de masse. Il n'y a donc pas d'avenir pour Bachar. Cependant, il continue à remplir une fonction symbolique très importante, notamment pour la communauté alaouite : chacun croit que son départ serait la défaite d'un camp. Pour l'instant, il bénéficie encore de l'allégeance de l'armée. Quant aux services de sécurité, ils sont passés depuis longtemps du côté des plus forts, c'est-à-dire des Iraniens, qui sont, je l'ai dit, les vrais patrons à Damas. Selon moi, le jour où nous entamerons des discussions sérieuses, nous ne devrons évidemment pas commencer par demander le départ de Bachar, car cela bloquerait le processus. Il faudra que la question vienne au cours des discussions et qu'il apparaisse aux principaux intéressés – Russes, Iraniens, Alaouites – qu'ils disposent de garanties suffisantes pour pouvoir se passer de la fonction symbolique d'Assad. C'est ainsi que les choses peuvent se passer de mon point de vue de diplomate. Je ne dis pas que cela se fera dès demain, mais, pour un pays tel que la France, l'ambition d'introduire un projet de paix dans la région est ce qui correspond le mieux à ses intérêts et à sa vocation.
Encore une fois, ayons les pieds sur terre : tout dépend du rapport de forces sur le terrain. Si les responsables de l'opposition sont en mesure de continuer la guerre d'attrition qu'ils mènent actuellement au détriment des forces du régime, cela renforcera d'autant les chances de déclencher un processus de paix. Quant à Daech, monsieur Myard, il s'est armé tout seul plus qu'il n'a été armé par d'autres. Les Américains n'ont pas voulu fournir d'armes à l'opposition de crainte qu'elles ne parviennent aux islamistes. Ce faisant, ils ont renforcé la faction islamiste de l'opposition, et celle-ci s'est servie elle-même en armes en prenant les arsenaux américains à Mossoul. Accélérer la transition est, certes, un jeu très risqué, mais, à certains moments, il faut savoir prendre des risques.

Que peut-on attendre de la Coalition nationale syrienne (CNS), dont le président sera reçu prochainement à Paris ?
La bourgeoisie sunnite des villes constituait le centre de gravité de la Syrie. Il s'agit d'une élite très importante, composée de nombreux avocats, médecins, etc. Ce sont généralement des personnes assez douées, qui font fortune lorsqu'elles s'installent à l'étranger. Mais, historiquement et culturellement, ces sunnites – c'est l'un des drames de la Syrie – se sont occupés de commerce et de religion, mais pas du pouvoir politique, lequel a été exercé successivement par les Mamelouks, les Ottomans, les Français et les Alaouites. Ils n'ont donc pas l'habitude de mener des débats, ni de faire émerger le consensus, ni même d'élaborer un programme politique.
De plus, loin de former une communauté soudée – asabiyya –, les 73 % de sunnites sont un agrégat fragmenté entre Damas et Alep – deux mondes complètement différents –, entre citadins et ruraux, entre sédentaires et Bédouins, etc. Malheureusement, cet éparpillement se retrouve aujourd'hui dans la structure de l'opposition. Jusqu'à ce jour, malgré le potentiel de talents que j'ai évoqué, les sunnites n'ont pas été capables de s'unir. Certes, l'actuel président de la CNS est un homme moderne et il jouit d'une stature supérieure à celle de ces deux prédécesseurs. Mais je ne me fais guère d'illusion : tant qu'il n'y aura pas de projet concret grâce auquel ils sentiront qu'ils peuvent accéder aux responsabilités, ils auront beaucoup de mal à se rassembler. Les discussions de Genève II, souvenez-vous en, avaient été très pénibles : l'opposition était encore plus divisée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Néanmoins, nous avions réussi à créer une délégation honorable, qui avait produit des papiers honnêtes. On peut en déduire que, si nous, Occidentaux, engagions un véritable processus de discussion d'un règlement politique, nous aurions une chance de cristalliser une opposition modérée convenable.
Le Liban sera sauvé si la Syrie est sauvée. Pour nous Français, c'est là une raison supplémentaire de plaider en faveur d'un passage du chaos à une situation de compromis.

Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur, de vos propos très éclairants. Il est important que nous puissions nous faire une opinion à partir de faits aussi établis que possible, même si vous n'avez pas caché les interrogations qui demeurent.
Andorre : Examen du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (lecture définitive)
La commission examine, le mercredi 4 mars 2015, en vue de la lecture définitive, le projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu.

Pour la troisième fois, nous sommes réunis pour débattre de la convention fiscale entre la France et la Principauté d'Andorre. Cette fois-ci, notre assemblée est appelée par le Gouvernement à statuer définitivement sur le projet de loi autorisant son approbation.
À ce stade des débats, les arguments des uns et des autres sont bien connus. À ma connaissance, personne ici ne conteste le bien-fondé de la conclusion d'une convention fiscale avec Andorre. La Principauté s'est, au cours des dernières années, mise en conformité avec les règles de la fiscalité internationale. Elle mettra en oeuvre l'échange automatique de données au plus tard fin 2018. La conclusion d'une convention fiscale vient accompagner et couronner ce processus.
En réalité, le débat ne porte pas sur l'essence de la convention, qui est de facture classique, si ce n'est qu'elle est assortie de clauses anti-abus particulièrement exigeantes. Les désaccords portent sur le d) de l'article 25 de la convention, qui comporterait – selon certains de nos collègues – les prémices d'une imposition sur la nationalité des Français de l'étranger.
Le Gouvernement a déjà eu maintes fois l'occasion de nous expliquer l'origine de cette clause, qui renvoie au contexte bien particulier des négociations avec Andorre. Il n'y avait alors pas d'imposition sur le revenu des personnes physiques dans la Principauté. Cette clause visait à éviter que la convention ne fournisse un terreau favorable à l'exil fiscal. Elle ne pourrait cependant trouver à s'appliquer que dans le cas d'une réforme d'ampleur de notre fiscalité, dont nous aurions évidemment à connaître en tant que législateur.
Le Gouvernement nous a donné l'assurance qu'aucune réforme de cette espèce n'était envisagée à court ou moyen terme. Certes, disent les détracteurs de ce texte, mais nous n'avons pas de garanties sur ce que décideront les gouvernements successifs dans le long terme. Je leur répondrai que nous n'en avons pas non plus si nous supprimons cette clause, qui n'a, à elle-seule, aucun effet juridique. Les gouvernements futurs resteront toujours libres, dans une situation comme dans l'autre, de proposer une imposition sur la nationalité des Français de l'étranger.
Puisque cette clause ne sert à rien, pourquoi ne pas la supprimer ? Parce qu'il faudrait, pour cela, rouvrir les négociations avec Andorre et reprendre le processus de ratification à zéro. Je l'ai dit et je le répète : je n'y suis pas favorable. Des voix se sont élevées lors de la nouvelle lecture en séance publique pour suggérer que nous pourrions adresser à l'Andorre une déclaration interprétative exposant que la France renonce au bénéfice de la clause de l'article 25 d). L'idée peut sembler bonne, mais en réalité cela n'aurait aucun sens de faire vis-à-vis d'Andorre une déclaration à propos d'une clause qui ne concerne que la France et n'est qu'une simple faculté.
J'en reste donc à la position que j'ai défendue devant vous au cours de nos précédents débats, et vous encourage à approuver cette convention sans arrière-pensées ni craintes infondées.
La commission adopte le projet de loi voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
En conséquence, en application de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution et de l'article 114, alinéa 3, du Règlement, la commission des affaires étrangères demande à l'Assemblée nationale d'adopter le texte voté par elle en nouvelle lecture.
Informations relatives à la commission
Au cours de sa réunion du mercredi 4 mars 2015 à 9h45, la commission des affaires étrangères a nommé :
– M. Gwenegan Bui, rapporteur sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification du traité d'extradition entre la France et la Chine (n° 1095) ;
– M. Pierre-Yves Le Borgn', rapporteur sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (n° 1096) ;
– M. François Rochebloine, rapporteur sur le projet autorisant la ratification de l'accord entre la France et l'Union européenne visant à l'application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation de l'Union sur la fiscalité de l'épargne et la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité (n° 2550) ;
– M. Daniel Gibbes, rapporteur sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre la France et les Pays-Bas relatif à la coopération insulaire en matière policière à Saint-Martin (n° 1961).
Informations relatives aux missions d'information
Création d'un groupe de travail et de missions d'information :
• Groupe de travail chargé de suivre la lutte contre le terrorisme international
Présidente : Mme Elisabeth Guigou (SRC).
Vice-président : M. Jacques Myard (UMP).
Co-rapporteurs : M. Pouria Amirshahi (SRC) et M. Pierre Lellouche (UMP).
Membres :
SRC : M. Kader Arif, M. Philippe Baumel, Mme Seybah Dagoma, M. Jean-Pierre Dufau, M. Jean-Marc Germain, M. Boinali Said.
RRDP : M. Paul Giacobbi.
GDR : M. François Asensi.
Ecolo: Mme Cécile Duflot.
UMP : Mme Marie Louise Fort, M. Hervé Gaymard, M. Jean-Claude Guibal, M. Alain Marsaud, M. Jean-Luc Reitzer, M. Michel Terrot.
UDI : M. Philippe Gomes, M. Meyer Habib.
• Mission d'information sur le Liban
Président : M. Axel Poniatowski (UMP).
Rapporteur : M. Benoit Hamon (SRC).
Membres :
SRC : M. Jean-Paul Bacquet, M. Christian Bataille, M. Jean-René Marsac.
UMP : M. Jean-Jacques Guillet, M. Alain Marsaud.
• Mission d'information sur les relations entre la Russie, l'Union européenne et la France
Président : M. Thierry Mariani (UMP).
Rapporteur : M. Jean-Pierre Dufau (SRC).
Membres :
SRC : M. Jean-Luc Bleunven, Mme Marie-Line Reynaud, Mme Odile Saugues
UMP : M. Philippe Cocher, M. Jean-Claude Mignon.
• Mission d'information sur l'ouverture d'un dialogue culturel et politique avec l'Amérique latine
Président : M. Patrice Martin-Lalande (UMP).
Rapporteur : M. Michel Vauzelle (SRC).
Membres :
SRC : M. Kader Arif, M. Michel Destot.
Ecolo : M. Noël Mamère.
UMP : M. Edouard Courtial, M. Lionnel Luca.
• Mission d'information sur la Libye
Présidente : Mme Nicole Ameline (UMP).
Co-rapporteurs : M. Philippe Baumel (SRC) et M. Jean Glavany (SRC).
Membres :
SRC : Mme Chantal Guittet, M. François Loncle.
UMP : M. Jean-Claude Guibal, M. Jean-Luc Reitzer.
• Mission d'information sur la diplomatie et la défense des frontières maritimes de la France
Co-rapporteurs : M. Paul Giacobbi (RRDP), M. Didier Quentin (UMP).
• Mission d'information sur la diplomatie sportive de la France et son impact économique
Co-rapporteurs : Mme Valérie Fourneyron (SRC), M. François Rochebloine (UDI).
• Mission d'évaluation et de contrôle (MEC) créée par la commission des finances
Co-rapporteur : Jean-René Marsac (SRC)
La séance est levée à onze heures trente-trois.