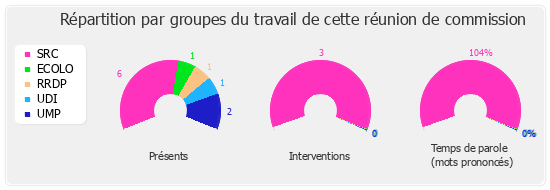Commission d'enquête sur les missions et modalités du maintien de l'ordre républicain dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de protection des personnes et des biens
Réunion du 16 avril 2015 à 9h00
La réunion
COMMISSION D'ENQUÊTE CHARGÉE D'ÉTABLIR UN ÉTAT DES LIEUX ET DE FAIRE DES PROPOSITIONS EN MATIÈRE DE MISSIONS ET DE MODALITÉS DU MAINTIEN DE L'ORDRE RÉPUBLICAIN, DANS UN CONTEXTE DE RESPECT DES LIBERTÉS PUBLIQUES ET DU DROIT DE MANIFESTATION, AINSI QUE DE PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
La séance est ouverte à neuf heures cinquante-cinq.

Monsieur Vigouroux, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, je dois vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Christian Vigouroux prête serment.)
Je vais à présent, selon nos habitudes, vous demander un exposé liminaire, avant que notre rapporteur et les commissaires présents vous posent leurs questions.
Le rôle de la jurisprudence étant d'assurer la sécurité juridique, elle est par nature constante, et ce qui est constant est connu ; je ne dévoilerai donc pas grand-chose que vous ne connaissiez déjà.
Avant d'en venir aux cinq observations qui constitueront l'objet de mon propos liminaire, je souligne que, s'agissant d'ordre public et donc de liberté, nous pensons que tout n'est pas dans tout, qu'il faut éviter les confusions et que les catégories juridiques ont leur intérêt. La procédure, si elle peut paraître compliquée, est nécessaire pour assurer la liberté, et c'est notamment le cas du code de procédure pénale, qui est à mes yeux un texte fondamental.
Par ailleurs, puisqu'il s'agit d'ordre public et de prévention, la police administrative doit pleinement jouer son rôle, mais l'infraction commise relève, à tout moment, des tribunaux judiciaires. L'ordre public passe par un évitement des confusions.
Première observation : en parlant d'ordre public, il faut commencer par parler de liberté, car l'ordre public n'est qu'une manière de permettre à chacun d'exercer sa liberté. Tout préfet, tout policier devrait avoir dans sa poche la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Si des ministres, à certaines époques, l'ont fait afficher dans les commissariats de police ou les prisons, c'est dans cet esprit.
Dans une décision du 18 janvier 1995, le Conseil constitutionnel, saisi d'une loi modifiant le décret du 23 octobre 1935 relatif aux manifestations sur la voie publique, a rangé parmi les libertés constitutionnellement garanties le droit d'expression collective des idées et des opinions. Il peut y avoir des restrictions – l'ordre public doit permettre à chacun d'exercer sa liberté sans qu'une minorité empêche les autres de s'exprimer – mais, conformément à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté est le principe et les restrictions non seulement sont l'exception mais doivent aussi se justifier.
En 1995, le Conseil constitutionnel, ayant à traiter l'interdiction de transporter des objets pouvant servir d'arme, applique ce principe de liberté sauf justifications. Les justifications ont trait aux circonstances faisant craindre des troubles graves. Qui plus est, les restrictions doivent toujours être assorties de limites dans le temps et l'espace, et une définition aussi exhaustive que possible des objets pouvant être une arme doit être formulée.
La liberté peut être encadrée par des régimes d'autorisation ou, dans le domaine qui nous intéresse, de déclaration, qui consistent, s'agissant de ces derniers, en l'information préalable de l'autorité afin qu'elle puisse prendre les dispositions permettant l'exercice de la liberté. S'il n'y a d'autre moyen de préserver l'ordre public et d'empêcher que l'exercice d'une liberté se transforme en infraction, une interdiction peut être prononcée. Le décret de 1935 dispose : « Si l'autorité investie du pouvoir de police estime que la manifestation projetée est de nature à provoquer l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté. » Le Conseil d'État, dans l'arrêt du 23 février 2011 Syndicat des enseignants du second degré, a ainsi validé le décret du 19 juin 2009 qui a introduit dans le code pénal un article R. 645-14 créant une contravention de dissimulation du visage dans une manifestation.
En résumé, le régime est celui de la liberté avec un encadrement législatif minimal – la déclaration – et la possibilité d'aller plus loin, par l'interdiction, mais alors sur preuves, en fonction des circonstances étroitement évaluées, et dans les limites strictement nécessaires au rétablissement de l'ordre public.
Les termes de « proportionnalité » et de « strictement nécessaires » se retrouveront tout au long de mon propos. Ils peuvent paraître incantatoires mais ne le sont en réalité pas du tout. C'est justement parce que ce sont des concepts assez souples, qui peuvent s'incarner de différentes manières, qu'ils sont forts. Je ne suis pas un enthousiaste des régimes spécialisés, compartimentés, qui cassent ces grands principes.
Ma deuxième observation concerne, une fois que l'on a parlé de liberté, l'ordre public, une notion fondamentale pour le Conseil d'État puisque le juge administratif en est le gardien, ou le praticien, depuis la décision Benjamin du 19 mai 1933, bien connue des étudiants. Une mesure de police n'est pas normale : elle ne doit intervenir que pour imposer des contraintes strictement nécessaires au maintien de l'ordre public. Ce sont les conclusions du commissaire du gouvernement Corneille sur l'arrêt Baldy de 1917 : la liberté est la règle et la restriction de police l'exception.
Le Conseil constitutionnel, dans une convergence de jurisprudence avec le Conseil d'État, a déclaré objectif de valeur constitutionnelle la notion d'ordre public. L'objectif de valeur constitutionnelle n'est pas une règle, mais le Conseil constitutionnel indique par là au législateur et à ceux qui préparent les lois, dont le Conseil d'État quand nous sommes consultés conformément à la Constitution, que c'est aussi au regard de cet objectif qu'il dira si telle loi est constitutionnelle ou non.
Dans de nombreux propos sur l'ordre public, est citée la pensée de Max Weber selon laquelle l'État détient le monopole de la violence légitime. Mon avis est qu'il faut se préserver de cette phrase : l'État n'a pas à faire de la violence légitime. Le texte de la Déclaration des droits de l'homme parle de « force publique ». Que des actes de force soient nécessaires pour faire respecter l'ordre public, c'est un fait, mais la violence n'est pas un terme qui doit figurer dans les textes de l'État.
Selon la Déclaration des droits de l'homme, toute société a besoin, pour l'exercice des libertés, d'une force légitime. C'est d'ailleurs le même article qui crée l'impôt, car pour payer cette force légitime il faut une « contribution commune », et c'est un autre article sur l'impôt qui crée le Parlement, car voter l'impôt est la prérogative de ce dernier. Toute la construction se fait ainsi à partir de la force publique : ce n'est pas inintéressant pour une Commission qui s'intéresse à celle-ci.
La Cour européenne des droits de l'homme ne parle pas non plus de violence légitime mais de force légitime, notamment dans sa décision du 24 mars 2011 Giulani et Gaggio contre Italie, la grande décision sur le contrôle de la force proportionnée en vue de maîtriser une manifestation.
Cet ordre public est autoritaire puisque c'est une décision unilatérale qui encadrera une manifestation ou éventuellement l'interdira, et les autorités administratives assument ce pouvoir de police, mais il est en même temps négocié : il fait l'objet de discussions avec les citoyens auxquels les mesures restrictives s'appliqueront. Dans l'affaire relatée par la décision du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2008 SNCF, les forces de l'ordre ont demandé aux manifestants qui souhaitaient interrompre la circulation des trains en Bretagne de bloquer le TER plutôt que le TGV.
La troisième observation, c'est que le contentieux de l'ordre public montre qu'il s'agit d'une activité à risque, à la fois pour les manifestants, quand la force utilisée est susceptible de leur causer des dommages, physiques et autres, pour les tiers, qui peuvent voir leurs biens détruits ou subir eux aussi des dommages physiques s'ils sont pris par hasard dans une manifestation, mais aussi – c'est un sujet dont j'ai traité dans plusieurs de mes écrits – pour les policiers.
Prenons un exemple, sans intérêt jurisprudentiel, mais qui montre bien ce qu'est le travail des hommes de la force publique qui ont à maîtriser des manifestations. Il s'agit d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 mars 2004 concernant un fonctionnaire mécontent de ne pas avoir reçu une décoration pour un fait de courage, contrairement à deux de ses collègues. Voilà ce qui est dit : « Considérant qu'il ressort des pièces que les deux fonctionnaires – ceux qui ont reçu la décoration – appartenant à une compagnie républicaine de sécurité, présents sur les lieux dès l'origine de l'incident et qui ont bénéficié d'un avancement exceptionnel de deux échelons, faisaient directement face à l'individu en cause, que ce sont eux qui ont récupéré la goupille de la grenade auparavant jetée à terre par ce dernier et la lui ont rendue après l'avoir convaincu de la remettre en place ; qu'après avoir engagé une conversation avec l'intéressé, lui proposant de fumer une cigarette, ils lui ont proposé du feu et profité de cet instant pour récupérer la grenade et en recrocheter la goupille… » : ce n'est pas un feuilleton de TF1 mais une décision de juge administratif. Le troisième fonctionnaire fait valoir qu'il « assurait avec plusieurs collègues la protection rapprochée de l'opération, se trouvait lui aussi à une distance de moins de six mètres de l'individu et était en conséquence placé dans une situation de danger équivalente, eu égard à la nature de l'arme en cause qui présente un danger mortel à plus de vingt-cinq mètres autour du point d'explosion ». Le contentieux n'ignore pas que les fonctionnaires prennent des risques et ne savent jamais devant qui ils se trouveront ni à quelle violence ils auront à faire face.
Un deuxième exemple de ces mauvaises surprises de l'ordre public est tiré d'un arrêt du tribunal administratif de Caen du 28 mars 2013, Association Percy sous tension. Le préfet de la Manche commandait les forces de l'ordre au cours d'une manifestation bloquant l'accès à un château d'eau en opposition à une ligne à très haute tension en Normandie. Dans le bâtiment, les forces de l'ordre ont découvert entreposés un plan détaillé de l'emplacement des pylônes de la ligne THT, des disques à couper le métal, des liquides inflammables, du matériel d'escalade, du matériel électrique. Par ailleurs, le collectif anti-THT, dans la capture d'écran produite au dossier par l'administration, avait lancé comme mot d'ordre « Sabotons le chantier » : « ces éléments démontrent que l'occupation du château d'eau par l'association requérante avait un but autre que celui de permettre à ses membres de se réunir paisiblement ».
Je vous cite ces deux exemples, non pas pour dire que toutes les manifestations sont dangereuses, mais de manière à ce que chacun adopte un instant le regard des agents des forces publiques qui ont à respecter les instructions reçues en ne sachant pas du tout ce à quoi ils devront faire face. Le contentieux marque le courage quotidien de ces personnels.
Ma quatrième observation, c'est, inversement, le devoir de l'autorité civile de ne pas courir après les forces de l'ordre. On doit croire aux faits et non à la présentation des faits, et savoir si le compte rendu que l'on reçoit, ou son absence, présente la vérité ou non demande beaucoup d'expérience et de discernement.
Les autorités civiles ont intérêt à traiter les questions en amont. Je vous cite les paroles d'un expert de l'ordre public, Victor Hugo, dans Choses vues, qui pense qu'une foule immense va venir écouter sa lecture publique sur Les Châtiments. Il écrit : « On craint une foule immense, tous les faubourgs, plus de quatre-vingt mille hommes et femmes. Trois mille entreront. Que faire du reste ? » Une question pour l'école de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or : comment gérer la foule immense des mécontents qui ne pourront entrer ? Déjà au temps de l'empire romain, Ammien Marcellin a écrit des choses passionnantes sur la gestion des foules. Hugo poursuit : « Le gouvernement est inquiet. Il craint l'encombrement, beaucoup d'appelés, peu d'élus, une collision, un désordre. Il me demande si j'accepte cette responsabilité… Nous avons décidé que les trois mille places seraient distribuées dimanche, veille de la lecture, dans les mairies des vingt arrondissements, à quiconque se présenterait, à partir de midi. Chaque arrondissement aura un nombre de places proportionné au prorata de sa population. Le lendemain, les trois mille porteurs d'entrées feront queue à l'Opéra, sans encombrement et sans inconvénient. Le Journal officiel et des affiches spéciales avertiront le peuple de toutes ces dispositions, prises dans l'intérêt de la paix publique. » La source du trouble est ainsi traitée sans attendre que les 80 000 personnes se présentent.
Une société qui crée un appel d'air, par un spectacle ou une lecture publique, doit prendre sa part de responsabilité et discuter avec les autorités. Dans les faits rapportés par l'arrêt du tribunal administratif de Paris du 29 mai 2012, une société avait créé un tel appel d'air en organisant une distribution publique de billets de cinq euros. Je ne vous cache pas que je ne suis pas enthousiasmé – on a le droit de commenter les décisions de justice – par ce jugement du tribunal administratif, car j'aurais versé la responsabilité première sur cette société. Le jugement dit : « Il est effectivement constant que les organisateurs de la manifestation n'ont pas été en mesure de prévenir les débordements auxquels elle pouvait donner lieu par un dispositif de sécurité approprié », mais « il résulte de ce qui précède que les services de la préfecture de police ont eux-mêmes fait preuve de carence dans l'appréciation des désordres que cette manifestation était de nature à provoquer et se sont trouvés pris au dépourvu devant leur ampleur lorsqu'il s'est agi de les faire cesser, alors pourtant qu'ils avaient été mis en mesure, par le dépôt de déclaration de la société requérante effectué quatre jours auparavant, sinon de prévenir la situation, du moins de prévoir les moyens nécessaires pour y faire face. » Parfaite expression du devoir des forces publiques. Cependant, le tribunal administratif annule le titre de recouvrement que la préfecture de police avait émis à l'égard de la société, et c'est ce que je trouve sévère. J'ai cité ces deux exemples pour montrer qu'il faut traiter les choses en amont.
Tout responsable des forces publiques aura tendance à présenter un dispositif suréquipé par rapport à la réalité. Certains préfets l'ont même théorisé : il convient de montrer une force très lourde pour ne pas avoir à s'en servir. Les responsables doivent cependant en prendre et en laisser, et ne pas cautionner de manière automatique les dispositifs revendiqués par les techniciens.
Ma cinquième et dernière observation porte sur le principe de proportionnalité. L'ancêtre des codes de déontologie, le décret Joxe du 16 mars 1986 sur la police, prévoyait déjà, à son article 9, un usage de la force « strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre ». Les ministres des gouvernements successifs ont, et c'est heureux, maintenu et renforcé ce code. Si le mot de « proportionnalité » ne figure pas dans l'arrêt Benjamin que j'ai cité, on le retrouve dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel comme dans celle de la Cour européenne des droits de l'homme.
Je terminerai par quelques mots de la responsabilité. Celle-ci suppose une analyse de la nature de la manifestation. La création de catégories juridiques est, je l'ai dit au début de mon propos, ce qui protège notre liberté. À chaque situation correspondent des mesures et des limites. L'attroupement, défini aux articles L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales et 431-1 du code pénal, est un bel exemple de catégorie juridique. Il s'agit d'une technique de socialisation du risque, faisant supporter à la société tout entière un risque particulier.
La responsabilité administrative comporte la responsabilité disciplinaire du policier ou du gendarme, ainsi qu'une forme de responsabilité civile de l'administration par le paiement d'indemnités. Il arrive que l'on puisse identifier suffisamment la personne à l'origine du dommage pour la faire payer. Dans les faits rapportés par la décision du tribunal administratif de Nantes du 22 novembre 2013, la FDSEA avait lâché dans Le Mans des dizaines de porcelets, ce qui avait occasionné des dommages. Une disposition du code rural indiquant que les animaux errants sont à charge de ceux qui les ont laissé errer, la FDSEA reçut une facture de récupération des animaux et de réparation des dommages causés. Au-delà de l'anecdote, qui peut prêter à sourire, il s'agit d'une question très importante : qui paye les dommages entraînés par la manifestation ?
Dans ce jugement de 2013, l'article 211-20 du code rural sert de base spécifique permettant la mise à charge, mais le plus souvent une telle base fait défaut. Un système de socialisation du risque a été conçu, l'attroupement, en vertu duquel la collectivité publique est responsable des dommages causés par tout rassemblement de personnes sur la voie publique susceptible de troubler l'ordre public. Ce dispositif est la source première des indemnisations versées aux personnes victimes, au cours de manifestations, de jets de grenades, coups de matraque, piétinements…
Comme dans tout système de responsabilité, une série de haies doivent être franchies avant qu'un manifestant victime d'agissements involontaires – si les agissements sont volontaires il s'agit de responsabilité pénale – de la police ou de la gendarmerie puisse recevoir une indemnité. Il faut tout d'abord respecter les délais. Dans un jugement de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 juillet 2009, une victime de blessures dues à un tir tendu de grenade lacrymogène ne reçoit pas d'indemnités car elle a laissé courir les délais.
Il faut ensuite prouver qu'il s'agit d'une grenade et non d'un coup porté par une personne isolée : voyez à cet égard la décision de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 décembre 2007.
Il faut montrer que la bille de plomb ayant frappé le manifestant représente une faute lourde des agents de police : voir l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 mars 2005 Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme. Une telle preuve n'existait pas pour la manifestation à Clichy qui a entraîné les conséquences que chacun connaît.
Il faut encore, une fois que les faits ont été établis, que les agissements de la victime n'exonèrent pas l'administration. Par exemple, il ne faut pas avoir été imprudent en restant sur les lieux malgré les sommations : arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 juillet 2006. Il vaut mieux ne pas avoir ramassé une grenade G4 alors que les forces de l'ordre tentent de se dégager : arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 13 décembre 1999. Même pour une grenade à effet de souffle, il faut parvenir à démontrer que l'administration a agi dans des conditions qualifiant la faute lourde, c'est-à-dire contraires soit aux ordres reçus soit aux modalités prévues dans le code de sécurité intérieure et le code pénal : arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 11 novembre 2012.
Mais le juge administratif, une fois que ces haies sont franchies, indemnise. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 24 février 1994 confirme ainsi un jugement du tribunal administratif de Rennes indemnisant un manifestant victime de blessures à l'oeil par une grenade lacrymogène lancée par les forces de l'ordre à Brest en 1991. De même, dans un autre arrêt, une personne est indemnisée pour amputation liée à une blessure grave par grenade lacrymogène lors de manifestations à Papeete le 23 octobre 1987.
Cependant, le juge tient compte du comportement de la victime, par exemple dans l'arrêt de la cour administrative d'appel du 29 décembre 1992 : « considérant toutefois qu'en demeurant près du pont de X. alors qu'il avait vu l'incendie qui sévissait dans cette zone et le caractère violent que prenaient les événements, et en se trouvant ainsi mêlé aux manifestants alors qu'après les sommations d'usage les forces de l'ordre procédaient à des tirs de grenades lacrymogènes, M. X a commis une imprudence de nature à exonérer l'État de sa responsabilité à hauteur de 50 %... »
Ainsi, le juge administratif place des haies de procédure, prend en considération le comportement de la victime, ce qui peut conduire à une diminution de l'indemnité, mais il indemnise, soit automatiquement dans le cas d'un attroupement ou d'une émeute, soit lorsque l'administration a commis une faute lourde.

Le cadre juridique que vous venez de présenter, globalement libéral, vous semble-t-il adapté aux nouvelles formes de protestation telles que les zones à défendre (ZAD) et l'occupation de terrains privés ? Lorsqu'il s'agit de demander que cessent ces occupations, les procédures contentieuses sont relativement lourdes et longues. Parallèlement à ces procédures, un conflit s'installe sur le terrain dans la durée, qui justifie la présence prolongée de forces de l'ordre et donne parfois lieu, au moment de l'exécution des tardives décisions de justice, à des opérations de maintien de l'ordre. Ces problématiques ont été pointées dans le rapport de l'inspection générale de la gendarmerie nationale sur l'affaire Sivens. Les nouvelles formes de protestation n'ont pas encore été intégrées dans notre droit. Pensez-vous qu'il serait souhaitable d'envisager des procédures adaptées ?
Pour prévenir la participation de casseurs à des manifestations où leur présence n'est le plus souvent pas souhaitée, et est même déplorée, par les organisateurs eux-mêmes, que pensez-vous, ensuite, de l'introduction dans notre droit d'une mesure de police administrative qui viserait à empêcher un individu de participer à une manifestation ? Ce serait une mesure d'exception dont le législateur devrait définir précisément la cible, une mesure qui concernerait par exemple des personnes ayant déjà fait l'objet d'une condamnation pour des voies de fait dans le cadre de manifestations.
Nous avons beaucoup tâtonné sur les modalités de mise en oeuvre. Quand un itinéraire a été retenu, il est assez fréquent que des contrôles d'identité soient réalisés sur l'itinéraire de la manifestation et les voies adjacentes. Pourrait-on envisager de notifier à certains individus une interdiction de pénétrer dans ce périmètre pendant la durée de la manifestation ? Serait-ce, selon vous, conforme aux libertés constitutionnelles ?
Enfin, selon quelle fréquence la responsabilité des agents de l'État, fonctionnaires de police ou militaires, est-elle mise en cause devant la justice administrative pour des faits survenus au cours d'opérations de maintien de l'ordre ? Quels sont les moyens les plus souvent invoqués pour engager de telles procédures ?

Considérez-vous que le droit français du maintien de l'ordre soit conforme à la Convention européenne des droits de l'homme ? L'État français a-t-il déjà été condamné par la Cour en raison de telles opérations ?
Pouvez-vous également préciser la procédure administrative préalable au dépôt d'une plainte à l'encontre d'un agent des forces de l'ordre en raison d'actes commis au cours d'une opération de maintien de l'ordre ?
Enfin, que pensez-vous de la création d'une autorité indépendante pour mener des enquêtes sur ces opérations ? Les inspections générales sont des institutions de contrôle interne. Ne gagnerions-nous pas en confiance vis-à-vis des forces de l'ordre avec la création d'une autorité indépendante ?
Je n'utilise pas le terme de ZAD. Ce n'est pas parce que les manifestants se qualifient d'une certaine manière que nous sommes obligés de reprendre leurs termes. Pour moi, les ZAD sont les zones d'aménagement différé des années soixante. Du côté des manifestants comme de celui des forces de l'ordre, on tire sur le vocabulaire, car le vocabulaire c'est le droit, la qualification juridique.
Je suis sensible à ce que vous dites, monsieur le rapporteur, sur les procédures rapides. C'est pour des considérations du même ordre que la loi de 2000 a créé la procédure de référé devant le juge administratif, qui sert beaucoup pour les interdictions de manifestations. La nécessité, en matière de libertés publiques, de procédures rapides existe pour le juge judiciaire et, depuis 2000, aux articles 511 et suivants du code de justice administrative, pour le juge administratif.
Les occupations de terrains privés ne sont toutefois pas un phénomène nouveau. La jurisprudence Couitéas du Conseil d'État, de 1923, sur le refus des autorités de mettre les forces de l'ordre à disposition du propriétaire qui avait pourtant obtenu un titre de justice, montre bien les difficultés, depuis des années, de l'application du droit en ce domaine. Une chose est d'obtenir un titre de justice pour récupérer son terrain – et la propriété est défendue par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen –, autre chose d'obtenir des autorités civiles la mise à disposition de la force publique pour réaliser l'évacuation, à cause de certaines circonstances. Le juge administratif a reconnu ce pouvoir d'appréciation à l'autorité civile, avec pour conséquence l'indemnisation du propriétaire pourvu d'un titre de justice.
Des procédures rapides ne seraient pas plus contraires que le référé administratif à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme. Il existe déjà des procédures particulières d'évacuation de terrains occupés : la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, revue le 5 mars 2007, a prévu des procédures de mise en demeure et d'évacuation. Il est vrai qu'elle a été en partie censurée par le Conseil constitutionnel en 2011, sur le chapitre de l'exécution forcée qui est le point sur lequel vous m'interrogez. Pour créer un dispositif législatif rapide, il faut donc ne pas perdre cette décision de vue ; c'est possible mais la voie est étroite.
S'agissant de la mise en cause de fonctionnaires pour des agissements au cours d'opérations de maintien de l'ordre, il y a deux ou trois affaires par an au Conseil d'État, vingt ou vingt-cinq devant les tribunaux et les cours d'appel.
En ce qui concerne l'interdiction individuelle de manifester, nous sommes dans un domaine très sensible car une telle restriction de la liberté d'aller et de venir est une version diluée de l'assignation à résidence, qui est elle-même une version diluée de la prison.

Cela existe déjà dans le cadre de manifestations sportives. Certaines personnes sont contraintes de se présenter dans un commissariat au moment de l'admission dans le stade ; quand elles ont satisfait à cette obligation, les portes du stade sont fermées. Ou bien une pure et simple interdiction d'entrer dans le stade est prévue. Le cadre est un peu différent puisqu'il s'agit d'enceintes closes et qu'il est assez simple d'empêcher les individus d'y pénétrer, alors qu'une manifestation se déroule sur la voie publique, dans un espace non clos. Mais l'élément de privation de liberté existe.
Il faut prendre en compte le fait que cela a été tenté comme peine complémentaire et que le Conseil constitutionnel l'a validé en 1995. Le précédent sportif auquel vous faites allusion n'a pas non plus été déclaré inconstitutionnel, en 2011. C'est l'idée de faire pointer quelqu'un, plusieurs fois si la manifestation se répète, que j'appelle une assignation à résidence diluée.

Ce n'est pas l'idée que j'ai à l'esprit. Si la personne pointe, cela ne lui prend pas assez de temps pour ne pas pouvoir se rendre ensuite à la manifestation. Quant à l'idée de retenir préventivement la personne, elle nous a paru excessive. Il s'agirait donc plutôt d'interdire l'accès à un périmètre défini ayant une base juridique dans l'arrêté pris par le préfet pour autoriser les contrôles d'identité. Si la personne est contrôlée dans ce périmètre, elle aura de fait commis une infraction.
Je n'y vois pas d'objection constitutionnelle, compte tenu des réponses du Conseil sur les deux versions existantes du dispositif. Que votre hypothèse soit une mesure administrative de police ou une décision prononcée par le juge, il faut que ce soit strictement défini. L'Allemagne s'est dotée d'un dispositif, validé par la Cour fédérale, qui exerce un contrôle très strict. Le Royaume-Uni également. Le législateur a une marge de manoeuvre.
Les opérations de maintien de l'ordre, monsieur le président, ne sont pas le domaine où la France est le plus condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, ce domaine étant le milieu pénitentiaire, au titre des articles 2 et 3 de la Convention. En matière d'ordre public, il existe une demi-douzaine de condamnations de la France, dont la plus célèbre est l'arrêt Saoud contre France du 9 octobre 2007 pour une mort par asphyxie au moment d'une interpellation. Dans la condamnation Douet contre France de 2013, concernant des lésions suite à l'usage de bâtons télescopiques par les gendarmes qui ont procédé à l'arrestation de la personne alors que celle-ci avait adopté une attitude de résistance passive, la Cour analyse de très près les faits. Quand elle estime qu'il y a disproportion entre l'attitude du manifestant et les blessures subies, il lui arrive de condamner l'État. Dans l'arrêt Darraj contre France, le requérant a été conduit au commissariat pour un contrôle d'identité, ce qui peut arriver en fin de manifestation, et une fois isolé les policiers ont fait un usage disproportionné de la force à son endroit. En revanche, il n'existe pas, comme en jurisprudence administrative française, de jurisprudence déterminante sur l'usage des grenades, des flash-balls ou des Tasers.
Si la protection du fonctionnaire n'existe plus, le barrage au dépôt de plainte est souvent l'identification du fonctionnaire, la responsabilité pénale n'étant pas collective. La Cour européenne des droits de l'homme, dans ses deux arrêts célèbres contre l'Italie en 2011 et 2015, a reconnu que la responsabilité de l'État italien et la responsabilité pénale du fonctionnaire étaient très difficiles à mettre en oeuvre dans la mesure où la police faisait bloc en affirmant que la personne responsable des gestes en cause, au sein de l'équipe d'intervention, n'était pas identifiée. Il faut donc le plus souvent porter plainte contre X. Ce sont les investigations pénales, souvent menées par l'inspection générale de la police nationale, qui détermineront l'identité de l'individu. Une procédure particulière qui faciliterait la plainte contre un agent de police n'existe pas.
C'est une autre question, largement débattue en France et dans plusieurs autres États. La position des gouvernements, en France, balance entre, d'une part, la nécessité, rappelée dans la loi de 2000 sur les relations entre l'administration et les usagers, de faire apparaître le nom des fonctionnaires, donc un principe général d'identification des fonctionnaires, et, d'autre part, des exceptions de plus en plus nombreuses, la dernière étant celle concernant les officiers de protection de l'OFPRA, dans la loi sur l'asile actuellement au Parlement. Afficher le nom des policiers lors d'interventions ne va pas de soi à mes yeux. Je ne sais pas, du reste, si cela faciliterait beaucoup la procédure pénale ; il faudrait que le manifestant ait une particulièrement bonne vue.
Enfin, la première autorité administrative indépendante, c'est selon moi l'autorité judiciaire, et je trouve que cela n'est pas assez rappelé. En tant que citoyen, je suis plus rassuré par l'autorité judiciaire que par des autorités indépendantes, qui restent malgré tout administratives. La police est déjà contrôlée par une autorité administrative indépendante qui est le Contrôleur des lieux de privation de liberté, par une autre AAI qui est le Défenseur des droits, par la justice et par son pouvoir hiérarchique. Je serais donc tenté de dire que c'est plus son commandement qui compte que la multiplication des contrôles. Une AAI n'est pas responsable devant le Parlement, contrairement aux ministres qui rendent compte de leur autorité devant cette institution. Je suis donc prudent sur le sujet, dans la ligne du rapport du Conseil d'État sur les autorités indépendantes et du rapport parlementaire de M. Dosière sur l'évaluation de ces autorités.
La séance est levée à dix heures cinquante-cinq.