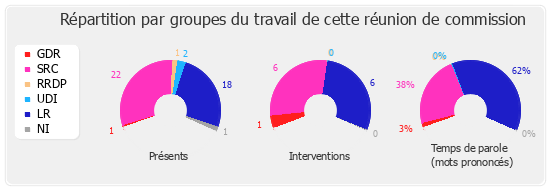Commission de la défense nationale et des forces armées
Réunion du 2 décembre 2015 à 9h30
La réunion
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Nous accueillons aujourd'hui Louis Gautier, secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, pour évoquer la réflexion en cours sur l'emploi des armées sur le territoire national et la doctrine qui y préside. Le rapport doit être rendu en janvier. Au sein de notre commission, Olivier Audibert Troin et Christophe Léonard travaillent déjà sur la question, avec d'autres collègues. Vu l'importance du sujet, nous avons souhaité faire bénéficier tous les membres de notre commission de ce qui peut en être dit aujourd'hui. La question de l'emploi des armées sur notre territoire, qui ne s'était pas posée depuis très longtemps, doit être examinée sous tous ses angles. En lien avec ce sujet, notre commission travaille aussi sur les réserves et sur les différents moyens d'apporter aux jeunes, en dehors du cadre d'un service national, information et formation dans le domaine de la défense.
Cette audition était prévue avant les attentats qui ont frappé très durement notre pays le 13 novembre. Ces événements tragiques ont accru les préoccupations des Français et conduit les plus hautes autorités de l'État à prendre des mesures de réplique inédites : application de l'état d'urgence sur le territoire national et intensification des frappes contre Daech en Syrie.
Ils ont aussi eu un effet sur les travaux interministériels que le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) conduit depuis le début de l'année. Trois chantiers, distincts mais imbriqués, sont concernés : la réévaluation de la menace terroriste et l'évaluation des dispositifs que nous déployons face à elle ; Vigipirate ; l'opération Sentinelle.
Je viens devant vous alors que l'ensemble de ces travaux ne sont pas finalisés : ils font l'objet d'ultimes discussions, avant d'être soumis à l'arbitrage du Président de la République et du Gouvernement. Je rencontrerai vos rapporteurs, MM. Audibert Troin et Léonard, le 15 décembre afin de compléter la présente audition. Nous sommes donc actuellement dans une phase d'échange où il importe de recueillir l'expression des préoccupations et des interrogations des uns et des autres. Vous comprendrez que, les travaux n'étant pas achevés, je ne sois pas en mesure de produire devant vous des documents qui auraient déjà été approuvés.
Le SGDSN n'est pas un service d'enquête ni un service de police. Son intervention se situe en amont, à côté, puis en aval de leurs interventions. En matière de sécurité et de défense, le SGDSN est en effet un architecte qui définit et propose des outils de gestion et de planification de crise ; il est aussi un maître d'ouvrage, car il fait vivre ces outils – je songe à Vigipirate dont les postures ont été adaptées une quinzaine de fois depuis janvier, pour réagir à l'évolution des menaces et des attentats. Ainsi, à la suite de l'attaque de Saint-Quentin-Fallavier, nous avons immédiatement procédé à un audit et à une réévaluation de la protection des sites Seveso. La mission du SGDSN obéit donc à une temporalité particulière. Elle consiste à vérifier et à améliorer la qualité des instruments et des processus de gestion de crise ; à tirer des alertes, des informations, de l'étude des événements, des circonstances et des dangers, les analyses les plus pertinentes à l'intention des autorités qui vont procéder aux arbitrages, notamment le Conseil de défense et de sécurité nationale ; puis à veiller à l'efficacité des mesures prises.
Que nous enseigne la tragique séquence de 2015 ? D'abord que des travaux conduits bien auparavant, notamment sous la responsabilité de mon prédécesseur, Francis Delon, ont été efficaces. Je songe en particulier à l'instruction interministérielle n° 10100 signée en 2010 et qui, en permettant de déployer des militaires sur le territoire, est à l'origine de l'opération Sentinelle. Je songe également au rapport de 2013 sur la radicalisation, qui a nourri une grande partie des dispositifs législatifs ou réglementaires adoptés pour réagir à ce phénomène. Je songe enfin à l'adaptation du plan Vigipirate en 2014, qui a permis de mobiliser les services de l'État – même si ce dispositif nécessite une actualisation, comme on l'a vu dès les attentats de janvier 2015.
Au cours de la séquence plus brève qui s'est déroulée depuis janvier, nous avons dû faire vivre les instruments dont nous disposions en nous montrant aussi réactifs que possible, mais aussi, dans le cadre du Retex (retour d'expérience), dégager les premiers enseignements des réponses apportées aux événements auxquels nous étions confrontés.
Tout d'abord, nous avons revu le fonctionnement de la cellule interministérielle de crise. Celle-ci a d'ailleurs donné entière satisfaction depuis le 13 novembre et a montré sa capacité à travailler dans la durée en basculant de la gestion opérationnelle déclenchée par les attentats à la sécurisation de la COP21.
De même, nous avions constaté quelques insuffisances de la cellule interministérielle d'aide aux victimes placée sous l'autorité du Premier ministre ; lors des récents attentats, celle-ci a été activée très rapidement, ce qui lui a permis de traiter dans la nuit même les premiers appels téléphoniques – elle en a traité 11 000 –, puis d'accomplir ses missions d'aide aux victimes.
Outre ces remises à niveau, le SGDSN a également rédigé un document confidentiel qui a été transmis au Premier ministre le 23 juillet. Il s'agit d'un guide d'aide à la décision en réaction à un attentat massif ou à une vague d'attentats, un mémento de ce que l'on peut immédiatement faire pour mobiliser les services de l'État. Ce document évoquait la possibilité de déclencher l'état d'urgence selon les circonstances. Il a été utile.
Pendant l'été, le SGDSN a été mandaté pour rendre un rapport sur les aménagements possibles du dispositif Sentinelle. Pourquoi à cette époque ? Parce qu'au premier semestre, le déclenchement du contrat d'emploi protection des armées débouchait sur la nécessité de procéder à des adaptations pour assurer la disponibilité, la capacité d'action et l'efficacité des militaires déployés au sol pour la protection du territoire national. Il fallait aussi dégager toutes les conséquences pour les armées d'effectifs mobilisés sur le territoire non pour une courte période, mais dans la durée.
Après l'attentat de Saint-Quentin-Fallavier, nous avons également été chargés de réévaluer la sécurité des sites Seveso. Nous avons dressé un inventaire des mesures à prendre sur l'ensemble de ces sites et nous sommes en train de finaliser un rapport qui contient des préconisations visant à améliorer encore davantage la protection de ces sites industriels.
En faisant vivre les quinze postures Vigipirate déclenchées depuis janvier, nous avons constaté que le plan Vigipirate méritait d'être également à nouveau adapté, à la suite de trois observations.
Premièrement, le déploiement d'effectifs militaires sur notre territoire relève de trois types de documents : l'instruction interministérielle n° 10100 ; le plan Vigipirate dont certaines mesures spécifiques, notamment la BAT 13-04, consistent à recourir à des effectifs militaires pour sécuriser certains sites ; enfin, le « contrat opérationnel de protection » qui, selon la doctrine des armées, permet lors d'une catastrophe de déployer jusqu'à 10 000 soldats, mais pour quelques semaines seulement. Entre ces documents, il n'y avait pas de contradiction, mais il n'existait pas non plus d'articulation. Celle-ci faisait particulièrement défaut entre le plan Vigipirate, qui impliquait alors pour les armées de fournir de manière permanente près de 1 000 militaires pour participer à la protection du territoire, et le contrat opérationnel de protection des armées qui, conformément à la doctrine et à la programmation militaires, prévoit en cas d'urgence le déploiement sur le territoire de 10 000 militaires dans une opération de projection intérieure vers une zone définie et pour une période brève. Il fallait donc réarticuler entre eux ces différents dispositifs.
Deuxièmement, la posture « alerte attentat » du plan Vigipirate, considérée comme celle caractérisant l'urgence maximale, avait été prolongée en Île-de-France depuis les attentats de janvier alors que cette posture ne devait initialement s'appliquer que pendant une courte période en raison des fortes contraintes qu'elle impose aux opérateurs. En outre, cette posture s'est trouvée complètement dépassée en novembre 2015 par la déclaration de l'état d'urgence.
Troisièmement, comment assurer une parfaite souplesse de la gestion des effectifs militaires sur le territoire de manière à pouvoir les réduire, les relocaliser ou modifier leur mission en fonction des menaces, des dangers et des besoins exprimés par les autorités civiles ? En d'autres termes, comment gérer durablement la réversibilité de la mobilisation, avec des périodes de décrue permettant de reconstituer les forces, d'accorder des permissions et de concilier la mission menée sur le territoire national avec l'ensemble des autres missions des armées ?
À partir de cette réflexion, deux ou trois orientations possibles se dégagent que je vais dessiner à grands traits car les propositions que nous allons formuler ne sont pas encore arrêtées ; le travail interministériel n'est même pas achevé.
Le plan Vigipirate devant être adopté devrait prévoir quatre postures de protection. D'abord nous devrions adopter un premier niveau de vigilance impliquant diverses préconisations et correspondant à une sorte de socle comparable à celui d'ores et déjà existant dans Vigipirate ; ensuite serait établi un niveau dit de vigilance renforcée, qui se caractériserait par le renforcement des mesures de précaution et par le déclenchement du contrat opérationnel de protection des armées, afin de densifier la présence militaire sur le territoire.
S'y ajouteraient deux autres niveaux. L'un – déclenché en cas d'alerte d'un service de renseignement sur une zone très spécifique, par exemple lorsque l'on recherche un fugitif, etc. – correspondrait au niveau alerte attentat actuel et serait caractérisé par l'imposition, pendant une courte période, d'une série de préconisations drastiques de vigilance, d'alerte, de protection.
Le dernier stade découlant de l'application de l'état d'urgence, correspondrait à une posture qualifiée d'« urgence attentat » et consisterait à moduler les mesures d'état d'urgence pour une période donnée. Il ne peut se concevoir que dans le cadre d'une loi sur l'état d'urgence rénovée. Cette posture est encore en état futur d'achèvement car elle nécessite une phase de préparation et d'arbitrage gouvernemental, puis un débat au parlement, et enfin le vote d'une loi permettant d'imposer certaines dispositions, de réformer la loi de 1955 et, sans doute, de fixer des règles contraignantes pour certains opérateurs. Aujourd'hui, en effet, même au stade le plus élevé de l'alerte attentat, le plan Vigipirate ne formule que de simples préconisations aux opérateurs ou aux acteurs économiques : les contrôles à l'entrée des grands magasins, les fouilles, etc., ne sont pas obligatoires ; l'application de telles mesures suppose donc un travail de persuasion et une capacité d'autodiscipline et d'autofinancement des entreprises ou des établissements désignés. La déclaration de l'état d'urgence sous une forme adaptée permettrait, dans certaines conditions et selon certaines modalités, d'imposer des mesures adéquates de protection qui seraient alors obligatoires. Cela peut aussi concerner les lieux accueillant du public ou les services de transports. Il s'agirait au total d'un dispositif « à la carte », nécessairement guidé par l'attention à la nature du risque, soumis à conditions et de durée limitée. Le travail de préparation de ce texte commence aujourd'hui et se poursuivra selon le calendrier parlementaire que vous connaissez.
Venons-en maintenant au sujet qui est au coeur de la réflexion de la commission de Défense : l'opération Sentinelle proprement dite – même si toutes les questions (Vigipirate, état d'urgence et contrat emploi protection des armées) sont totalement emboîtées.
La première question qui se pose est celle de l'opportunité de recourir aux armées dans le cadre de la mise en oeuvre des plans Vigipirate. Certains estiment qu'il suffit d'accroître les effectifs des forces de police ou de gendarmerie. Même si comparaison n'est pas raison, constatons d'abord ce qui est fait autour de nous. En Belgique, vous l'avez vu, les autorités, confrontées à des événements d'ampleur similaire à ceux que nous connaissions, ont déployé des militaires. Ce même choix est effectué d'ailleurs partout en Europe : en Espagne, en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni. Je recevais il y a quelques jours les responsables de la sécurité britannique. Chez eux, l'opération Temperer, qui n'est pas pour l'heure déclenchée, est analogue dans son principe à l'opération Sentinelle.
Pourquoi donc ce recours aux armées ? Pour réagir aux situations d'urgence, aux circonstances exceptionnelles, nous avons besoin d'un réservoir de forces et de moyens immédiatement mobilisables. Or les effectifs militaires, importants, permettent de déployer des unités substantielles, de les renouveler, de les faire relever par d'autres unités militaires. Il n'existe d'ailleurs aucune antinomie entre la politique de renforcement des effectifs menée pour faciliter le rehaussement du contrat opérationnel de protection des armées, notamment dans le cadre de l'actualisation de la loi de programmation militaire que vous avez votée, et la hausse des effectifs de police et de gendarmerie. J'en veux pour preuve le fait que le président de la République et le Gouvernement ont simultanément pris le parti d'augmenter les effectifs de police et de gendarmerie et, dans le cadre des décisions qui ont conduit à la suppression des déflations des effectifs militaires, d'accroître le niveau de la force opérationnelle terrestre et le contrat d'emploi protection des armées. Le réservoir de forces dont je parlais se trouve ainsi sensiblement augmenté, de manière à pouvoir mobiliser durablement une force de 7 000 soldats dans la durée, comme nous le faisons depuis janvier.
Du point de vue de la gestion des ressources humaines, alors que le recrutement d'un policier ou d'un gendarme l'inscrit dans une carrière, celui d'un militaire du rang correspond à un contrat, qui pourra être renouvelé mais ne durera pas nécessairement. En outre, les effectifs de police et de gendarmerie sont positionnés, donc disséminés sur l'ensemble du territoire, ce qui rend compliqué la génération très rapide d'une force pour les besoins de Vigipirate. Certes les escadrons de gendarmerie mobile et les compagnies républicaines de sécurité (CRS) font exception à cet égard, mais l'on ne peut pas augmenter leur nombre au-delà des besoins habituels en matière d'ordre public.
Ce raisonnement est en quelque sorte validé par les solutions adoptées ailleurs, en particulier chez nos partenaires européens, où les possibilités d'engagement des forces militaires peuvent même être supérieures – par exemple en Italie.
L'idée est au fond que les armées, qui constituent une ressource de forces, interviennent non en remplacement, mais en appui, en soutien, en parfaite complémentarité avec les forces de sécurité intérieure, notamment parce que leurs effectifs, leur organisation, leurs capacités, y compris du point de vue des équipements, procurent des ressources mobilisables dans l'urgence et parfaitement réactives. Voilà d'ailleurs pourquoi on les réquisitionne lors de catastrophes.
À partir de cette analyse, ont été adoptées diverses mesures d'effectifs, en faveur des armées mais également au profit des services de police et de gendarmerie, ce qui a conduit à l'arrêt des déflations prévues dans la programmation militaire. L'arrêt partiel de ces déflations a été voté dans le cadre de l'actualisation de la LPM en juillet 2015 et l'annonce devant le parlement par le président de la République de l'abandon total des déflations prévues sur la période 2016-2019 devrait entraîner une nouvelle actualisation des bases de cette loi.
La deuxième question qui se pose à nous est la suivante : faut-il ou non changer le cadre juridique en vertu duquel l'implication de l'armée de terre dans des missions de protection sur le territoire procède de la réquisition par le pouvoir civil ? La réponse est négative. Même si l'on envisage aujourd'hui, lorsqu'il le faut, de recourir sur le territoire national à des forces militaires plus nombreuses et à le faire plus durablement, cela ne doit pas modifier le principe de déploiement sur réquisition de l'autorité civile, c'est-à-dire du ministre de l'intérieur et des préfets.
Fallait-il bouleverser d'autres aspects du cadre réglementaire ? On a évoqué la possibilité d'instituer en agents ou officiers de police judiciaire (OPJ) les militaires, ou du moins certains officiers ou sous-officiers. Mais l'on a finalement estimé que si l'on définissait bien les missions, il n'était pas nécessaire de changer le droit. D'abord parce que des OPJ sont souvent présents sur le terrain au côté des militaires déployés. Ensuite parce qu'il existe toute une série d'actes – contrôle de foules, vérification d'identité – que l'on peut effectuer à droit constant, sans avoir besoin d'exciper d'un statut d'OPJ. On le voit dans les transports, par exemple. Les citoyens ne sont pas tenus de déférer à la demande qui leur est faite de prouver leur identité ; mais s'ils s'y refusent, par exemple à un passage filtrant, ils ne peuvent pas le franchir. La question s'est posée à propos de la préparation de l'Euro 2016. Les militaires ne pourront pas obliger un individu à prouver son identité, mais pourront refuser l'accès aux personnes qui refuseraient de le faire, ou les renvoyer vers un OPJ qui sera à proximité. D'ailleurs, dans des espaces privés comme les entrées de bâtiments, ou dans les trains, des contrôles sont pratiqués par des personnes qui ne sont pas OPJ.
Bref, les grands principes juridiques encadrant l'emploi des militaires ne devraient pas être bouleversés, même si des adaptations sont envisagées. L'idée est plutôt de consolider les principes républicains fondamentaux sur lesquels reposent actuellement les missions confiées aux armées sur le territoire national.
La troisième question concerne la doctrine des armées. Cette question primordiale explique ma méthode de travail : j'ai laissé la réflexion décanter au sein de chaque ministère avant d'en venir au stade interministériel de la discussion et de rechercher la formulation d'une proposition de compromis. Les choix dont nous parlons ont donc été étudiés puis assumés par les autorités civiles et militaires du ministère de la Défense. Cela me paraissait essentiel de laisser d'abord se développer une discussion au sein de ce ministère. En effet, la mission confiée aux armées dans le cadre de Vigipirate depuis janvier induit un aménagement de la doctrine et des formats militaires.
Depuis la fin de la guerre froide, les politiques militaires étaient en effet principalement guidées par la priorité donnée à la projection extérieure. Toute une série de décisions – la professionnalisation, la limitation des réserves, la restructuration sur de grandes bases – a de fait allégé l'empreinte territoriale des armées, en particulier de l'armée de terre. À l'époque où j'ai fait mon service militaire, dans les années 1980, l'armée de terre était répartie par régiment dans de nombreux chefs-lieux de canton et les unités étaient facilement mobilisées en cas de défaillance des services publics. Les choix qui ont été faits ultérieurement étaient logiques, compte tenu de l'évolution des risques qu'affrontait notre pays.
Ce primat de la projection extérieure, qui impliquait une armée plus ramassée, professionnalisée, donc plus légère, moins présente à l'intérieur, avait conduit à considérer l'action de protection sur le territoire national comme une autre forme de projection : une projection intérieure, déclenchée par une urgence absolue, en cas de catastrophe ou d'événement extraordinaire. Dans ces circonstances, on planifiait au niveau national la mission et les moyens militaires en mobilisant des forces venues de toute la France et projetées dans des endroits précis, par exemple après une marée noire, pour rétablir les voies de communication après une tempête, etc., bref en vue d'une action ponctuelle circonscrite dans le temps et dans l'espace.
Cette doctrine, à cause de la menace terroriste, a été modifiée afin de déployer dans la durée davantage d'effectifs militaires sur le territoire national. De ce fait, l'enjeu est devenu celui de reconnecter la mission de protection terrestre à celles qui avaient perduré en matière de surveillance et de protection de nos approches maritimes, assurée par la marine nationale, et de surveillance du ciel au-dessus de notre pays et de ses pourtours, confiée à l'armée de l'air. C'est à mon sens un résultat pertinent. Voilà pourquoi il était important que la discussion vienne des armées elles-mêmes. Il s'agit en somme pour l'armée de terre d'une réarticulation doctrinale, très intéressante du point de vue de son cadre d'emploi. La discussion au sein du ministère de la Défense a permis de redéfinir les postures des trois armées de telle sorte que la mission territoriale de l'ensemble du ministère renoue, s'agissant de l'armée de terre, avec une logique de la permanence et de la continuité qui avait été préservée dans les domaines aérien et maritime.
Parmi les autres aspects de la réflexion qui préside à l'élaboration du rapport se pose le problème de la génération de forces, qui a encore besoin d'être approfondi.
Il faut d'abord fixer les règles de la gouvernance. Au sommet de l'État, le président de la République, chef des armées, dispose de la force militaire, donc détermine les décisions prises au sein du Conseil de défense et de sécurité nationale – lequel a été réuni plusieurs fois en 2015, pour déclencher le contrat opérationnel de protection, l'adapter, puis le revoir, en particulier au cours de la phase que nous venons de vivre.
Il faut également, dans le cadre de la réquisition, articuler le besoin exprimé par le pouvoir civil à la capacité de l'autorité militaire à y répondre. Comment conjoindre la planification des missions, qui doit rester aux mains du pouvoir civil et des préfets, et celle des moyens, qui implique nécessairement les autorités militaires, en particulier les officiers généraux chargés des zones de défense ? Cette coordination civilo-militaire doit être assurée de telle sorte que les décisions puissent être prises dans la journée, voire dans l'heure, ce qui suppose d'identifier des instances de rapprochement permettant la réaction la plus rapide possible.
Comment définir les missions respectives des militaires, d'une part, et des policiers et gendarmes, de l'autre, de manière à proscrire toute redondance ? Ce point a déjà été développé. Le principe est que les armées relaient la police et la gendarmerie pour permettre à ces dernières de se réorienter vers leurs missions propres. Dès lors, les armées entendent voir privilégier le contrôle de zones, la mobilité tactique, la sécurisation de grands espaces tels que les gares.
S'agissant enfin des règles d'engagement, de formation et d'équipement des armées, nous en sommes également à une phase de discussion et de rapprochement des points de vue. Je constate en tout cas que les autorités militaires, soucieuses de préserver la réversibilité des missions confiées aux armées à l'intérieur ou à l'extérieur, ne souhaitent pas que l'on modifie l'équipement des militaires et qu'ils sont formés et entraînés à utiliser. L'essentiel, ce sont les formations adaptées à ces missions, qui doivent être confortées.

Vous n'avez pas abordé les réserves, une question récurrente dans nos travaux depuis un certain temps et particulièrement actuelle. Peut-être pourrez-vous y revenir.

Monsieur le secrétaire général, vous vous êtes défini à la fois comme un architecte et comme un maître d'ouvrage. Mais alors qui est le donneur d'ordres, quels objectifs vous a-t-il assignés et avec quelles entreprises travaillez-vous ?
Je souhaite également vous alerter sur les problèmes que rencontrent les maires. Très sollicités par les directeurs d'établissements scolaires à la suite de courriers envoyés par des recteurs ou des inspecteurs d'académie, ils sont victimes d'une surenchère : on ouvre le grand parapluie et on se retourne contre les communes, par des mesures parfaitement déplacées. Ne pourrait-on ramener à la réalité ceux qui rejettent ainsi toute la responsabilité sur les autres ?
Enfin, qu'en est-il des éventuels problèmes d'hébergement des forces de l'opération Sentinelle ?

Merci pour votre exposé, Monsieur le secrétaire général. Nous avons bien compris que vos travaux sont en cours et que vous ne pouvez en dire davantage. Vous nous avez néanmoins fait part d'une vision de nos armées et d'une conception de leur rôle qui me paraissent quelque peu inquiétantes.
Vous avez ainsi évoqué la nécessité d'articuler les différents dispositifs existants ainsi que les différentes composantes de nos forces de sécurité – police, gendarmerie, défense nationale. De votre intervention ressort ce postulat : le choix a déjà été fait de la polyvalence plutôt que de la spécialisation d'une force vouée à opérer sur le territoire national. En d'autres termes, tout en intervenant chacun dans leur cadre d'emploi, les acteurs doivent coopérer. En vertu de cette hypothèse de travail, l'armée est logiquement considérée comme un réservoir permettant de mobiliser immédiatement 10 000 hommes sur le territoire national : c'est le contrat opérationnel actuel.
Mais celui-ci vaut à court terme, alors que nous nous inscrivons désormais dans la durée. Le problème se pose donc de l'engagement et de la place de nos armées dans le dispositif – de leur mission, en somme. Dans ce contexte, je vous le dis très librement, j'ai été choqué que vous distinguiez le recrutement d'un policier, dans le cadre d'un plan de carrière, de celui d'un soldat, pour la durée déterminée d'un contrat. Je ne suis pas convaincu que ce genre de propos facilite la tâche de ceux qui, sur le terrain, s'efforcent tant bien que mal de recruter 11 000 hommes et femmes comme l'actualisation de la LPM l'autorise. Nos soldats attendent qu'on leur confie une véritable mission, qui dessine une carrière, un vrai métier. Vous semblez introduire une hiérarchie entre les forces chargées de la sécurité intérieure : entre les policiers et gendarmes, d'une part, et d'autre part les subalternes que seraient les militaires des armées. Vous êtes d'ailleurs allé dans le même sens en affirmant ensuite que nos armées viennent « en relais » – c'est-à-dire, finalement, qu'elles effectuent des tâches secondaires.
Quelle est donc la plus-value apportée par nos armées sur le territoire national ? Le retour d'expérience de l'assaut de Saint-Denis a révélé un défaut de fluidité dans les relations entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. Quel rôle voulons-nous donc faire jouer à nos armées sur le territoire national, dans le contexte très particulier que nous connaissons aujourd'hui ?

Les mêmes propos ont retenu mon attention, mais c'est une autre question qu'ils m'inciteront à poser.
Mais d'abord : sommes-nous en guerre ? Si l'on peut se dire en guerre à l'extérieur, ce qui est sans doute de nature à améliorer profondément notre action en Syrie – et en Libye demain –, sommes-nous en guerre sur le territoire national ? On pourrait le croire, puisque le président de la République a déclaré que nous avions été victimes d'actes de guerre et que nous avons déployé 10 000 militaires.
La présence de militaires des armées sur le territoire national n'a pas la même charge symbolique que celle des forces de sécurité intérieure. Or nous prévoyons qu'elle sera durable. Vous avez indiqué que les armées avaient fait l'objet d'une politique d'effectifs parce qu'elles constituaient un réservoir de moyens et de capacités, mais aussi que vous n'envisagiez pas, au stade actuel de votre réflexion, de faire évoluer le cadre juridique de leur emploi sur le territoire. Vous avez ensuite évoqué la nécessité d'une meilleure coordination entre les armées et les forces de sécurité intérieure.
Une action renforcée à l'extérieur nécessite des effectifs militaires ; à ce besoin, l'actualisation de la LPM votée en juillet répond en partie. Mais si, sur le territoire national, le cadre juridique reste peu ou prou identique à celui qui s'applique aux forces de sécurité intérieure, pourquoi ne pas recruter davantage dans la gendarmerie et la police ? Et puisque nous en sommes au stade de la réflexion, pourquoi ne pas proposer, dans ces services aussi, un recrutement sous contrat qui corresponde à l'urgence, au lieu d'opposer à celui-ci le temps long d'une carrière ? Cela nous épargnerait des efforts de coordination dont les événements récents ont montré le caractère délicat.
Monsieur Boisserie, les responsabilités que j'occupe m'engagent fortement, y compris personnellement, mais le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale n'est architecte et maître d'ouvrage que de la gestion des outils de crise : la gestion de la crise elle-même incombe aux autorités politiques – le Premier ministre et, sur le terrain, essentiellement le ministre de l'intérieur. Ceux qui sont chargés de l'action opérationnelle, ce sont les services de renseignement, de police, d'enquête judiciaire. Je n'entends pas confondre les registres. Cette formule visait simplement à montrer que le rôle du SGDSN consiste à définir, établir et actualiser pour le compte du Premier ministre les instruments de gestion de crise qui sont ensuite utilisés et développés par les services que j'ai cités.
L'hébergement des forces Sentinelle est une vraie préoccupation. Le ministère de la Défense y travaille, notamment avec le gouverneur militaire de Paris, afin de trouver des solutions adaptées et pérennes, en particulier à Paris et en région parisienne où se concentrent les effectifs.
Monsieur Audibert Troin, les mesures touchant les effectifs ont permis de revaloriser le contrat opérationnel de protection de manière à pouvoir déployer 7 000 soldats dans la durée, grâce aux rotations régulières, ce qui implique de disposer d'un réservoir de forces de 21 000 militaires.
Quant aux carrières militaires, c'est ainsi qu'elles ont été organisées ! Dans les faits, la majorité des militaires – notamment tous les militaires du rang - servent en vertu d'un contrat ; d'autres servent sous statut de militaire de carrière. Le service pour une période courte correspond d'ailleurs souvent au souhait de ceux qui sont recrutés comme militaires du rang : alors qu'ils peuvent le plus souvent rester huit ans, ils partent majoritairement au bout de cinq ans. Cette courte durée de service reflète donc une réalité sociologique plutôt qu'une situation subie. Elle est en outre utile dès lors que l'on veut une armée jeune. Ainsi beaucoup d'engagés décident-ils de mener une première carrière dans l'armée avant d'entamer une seconde carrière dans la vie civile. C'est la réalité des armées d'aujourd'hui. Mais ce modèle existait dès l'origine. Il a permis de préserver souplesse et dynamisme en évitant la déformation de la pyramide des âges et le vieillissement des armées.
Il existe aussi des contrats courts dans la police mais les parcours y sont plus organisés, du fait des nécessités du métier et de la conduite de la carrière sur l'ensemble du territoire national : on est d'abord affecté à certains postes, avant, l'expérience venant, de gagner en autonomie à d'autres postes.
Bref, ce sont deux métiers différents, sans être opposés. La logique de réservoir et le fait qu'aucun militaire ni aucune unité ne soient voués à des missions exclusivement sur le territoire national, mais qu'il leur soit ensuite possible de rejoindre le Mali ou une autre opération extérieure, fait partie de l'intérêt du métier militaire.
S'agissant de la réserve et de la garde nationale, notre réflexion actuelle implique de renforcer la réserve opérationnelle. C'est une question d'effectifs et de budget. Il convient également d'étudier la manière de la régionaliser davantage, de territorialiser son commandement et son emploi. Ce travail est encore en cours.
Sommes-nous en guerre sur le territoire national ? Mais c'est l'état d'urgence que vous avez voté, non l'état de siège ! En France, un djihadiste est un criminel. En revanche, la France est en guerre contre Daech. Ce n'est d'ailleurs pas elle qui a désigné son ennemi, mais lui qui a fait d'elle son adversaire, qui a porté des coups sur son territoire.
En ce qui concerne la coordination entre gendarmerie, police et soldats, vous avez raison : l'essentiel, c'est ce que l'on va faire sur le terrain ; comment définir et affiner, au niveau des zones de défense, puis au niveau local, le contact entre les officiers subalternes ou supérieurs qui gèrent une opération sur place, le sous-préfet et le commissaire de police ? La logique qui est à l'oeuvre est normale. La planification des moyens est plus hiérarchique, plus verticale, au ministère de la Défense, cependant que la définition de la mission suppose d'être au plus près du terrain et de ses besoins ; elle doit donc provenir de ceux qui savent où sont les points sensibles, les zones vulnérables, les noeuds routiers potentiellement problématiques, etc. Vu la manière dont se posent les problèmes et la difficulté à ajuster les moyens aux missions, c'est sur ce point qu'il nous faut travailler le plus, en identifiant les instances chargées de définir les besoins, puis celles auxquelles incombe l'arbitrage en cas de conflit.
C'est un point que nous n'avons pas particulièrement développé dans le cadre du rapport sur Sentinelle, mais je connais l'argument et cette question des déports de charges mérite d'être entièrement instruite.
Oui ; mais comment la demande peut-elle être adressée aux maires et comment l'arbitrage s'opère-t-il ?

Vous n'avez pas répondu à ma question. On utilise les forces armées comme des forces de sécurité intérieure ; pourquoi donc ne pas recruter plutôt des forces de sécurité intérieure ? En effet, quel peut être l'apport des militaires si, comme vous le dites, nous ne sommes pas en guerre sur le territoire national ?
C'est d'abord une question de logique. Le recours à l'armée permet de déployer immédiatement des effectifs importants à partir d'une base considérable. Les forces de police et de gendarmerie continuent en parallèle à mener des enquêtes judiciaires, à faire du flagrant délit, à assurer la sécurité routière, etc. : elles n'ont pas la même disponibilité.
Ensuite, l'armée a ses spécificités. Pour réagir à certaines menaces, à certains dangers, il existe des compétences et des moyens qu'elle est seule à détenir, qu'il s'agisse des grands engins utilisés pour déblayer après une catastrophe ou de la capacité d'évaluer une menace chimique et de réagir au risque que représentent les explosifs. Bref, on trouve dans les armées des savoir-faire, une expérience, une culture de la planification plus poussée qu'ailleurs.
N'oublions pas que tout cela a un coût budgétaire : l'État ne peut pas répliquer toutes les capacités dans tous les services chargés de protéger notre pays. Voilà pourquoi il a été décidé de les utiliser là où elles existent, parmi les militaires.

La réserve peut contribuer à l'exercice des missions territoriales. Mais, il y a quelques mois, le chef d'état-major des armées nous indiquait que le nombre de réservistes engagés dans l'opération Sentinelle était assez faible, ce qu'il attribuait au fait que le dispositif ne serait pas suffisamment réactif. Il en concluait que l'arsenal juridique devrait être amélioré pour que les réservistes puissent arriver plus rapidement. On a pu mobiliser quelque 300 réservistes par jour alors qu'il en faudrait peut-être 1 000.
Par ailleurs, aux termes de la LPM, le nombre de réservistes devrait passer de 27 700 à 40 000. Est-ce possible ? On annonce des chiffres, mais pour les concrétiser il faut recruter, ce qui n'est pas simple.
Aujourd'hui, la réserve est-elle davantage et suffisamment engagée dans l'opération Sentinelle ? Peut-on faire encore mieux, pour soulager d'autres militaires affectés à d'autres opérations ?
La formation des personnels réservistes est-elle suffisante face à la violence extrême que nous observons désormais ?
Quelle pourrait être la place de la réserve dans une future garde nationale ? Quelle serait son implantation territoriale ? Si l'on fait abstraction de la présence des gendarmes, qui sont encore sous statut militaire, un nombre croissant de territoires n'a plus aucun lien direct avec la défense nationale.

Nos forces sont soumises à rude épreuve. L'opération Sentinelle mobilise environ 10 000 soldats. Quelles sont les conséquences sur leur formation, sur les compétences techniques et opérationnelles correspondant à leur coeur de métier, sur leur vie familiale – les permissions sont très souvent supprimées et les absences du domicile sont récurrentes ? Qu'en résulte-t-il pour leur efficacité et surtout leur sécurité en opération ? Cette situation provoque-t-elle des ruptures de contrat ou des désertions ?
Nos interventions ne sont-elles pas de plus en plus nombreuses, trop nombreuses ? Nos forces s'épuisent, notre matériel s'abîme et notre image de marque en pâtit.

Ceux qui font vivre le plan Vigipirate et l'opération Sentinelle, ce sont des hommes et des femmes. Comment avez-vous conçu la logistique qui les entoure ? Y avez-vous réfléchi ? C'est important pour leur bien-être. Qu'en est-il de leur hébergement ? Vous l'avez rappelé, le temps où un casernement était installé dans chaque canton est révolu. Dès lors, comment les accueillir au mieux ? Cette question est une réalité et une priorité du point de vue personnel, familial, humain.

Je partage entièrement votre constat d'un changement de perspective à long terme. Depuis la chute du Mur et la fin de la guerre froide, nous avons essentiellement mené des actions de projection, pour ainsi dire de police extérieure, ou de gendarme mondial – c'est d'ailleurs ce qui a pu être reproché à l'armée des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, tout en maintenant des opérations extérieures, nous devons revenir à des missions de sécurisation et de protection sur le sol national des citoyens et des intérêts du pays, qui sont des missions fondamentales des armées. Nous devrons en tenir compte dans notre réflexion.
Je suis convaincu qu'il faudra aussi revoir notre doctrine de sécurité intérieure, ou du moins l'adapter, en raison du nouveau contexte stratégique : la menace terroriste est durable, pour la France comme pour l'ensemble du continent européen. Partagez-vous cette conviction ? Avez-vous commencé à y réfléchir ? À vous entendre, je crois comprendre que oui. Quelles conclusions pouvez-vous déjà tirer de cette réflexion, tout en continuant bien entendu à travailler aussi à la doctrine des armées et au lien entre les deux ?
En ce qui concerne les réserves et la garde nationale – c'est-à-dire la réserve opérationnelle poussée à un niveau supérieur –, rappelons que, pendant de nombreuses années, les armées elles-mêmes n'ont pas souhaité développer beaucoup la réserve opérationnelle : celle-ci ne venant qu'en second rideau lors d'opérations extérieures, c'eût été inutile et coûteux, sans compter les besoins de formation et d'encadrement. D'ailleurs, si l'on devait déployer des réservistes opérationnels sur le territoire national – certainement, là encore, en second rideau –, il faudrait les former à cette mission spécifique.
On a beaucoup fait appel à la fonction publique nationale pour constituer la réserve opérationnelle et la réserve citoyenne, notamment à d'anciens militaires s'agissant de la réserve opérationnelle. Nous devons maintenant nous poser la question de la mobilisation de la fonction publique territoriale.
Vous avez raison d'insister sur la formation. Du côté des militaires, le chef d'état-major des armées (CEMA) et le chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT) font valoir avec bon sens que les soldats qui ont été engagés à Gao, très aguerris, ne risquent pas de vaciller face au risque. Il faut néanmoins leur apprendre à gérer une mission sur le territoire national, ce qui n'est pas la même chose : il s'agit de sécuriser un périmètre, des noeuds de communication, de grands lieux publics comme les gares, de faire des patrouilles sur zone, etc. Cela suppose d'adapter les formations.
Les gardes statiques font débat. Ces missions sont très consommatrices d'emplois, au sein des forces de police comme des forces militaires. Il convient donc de privilégier les moyens d'autoprotection des lieux – vidéosurveillance, sas de protection, recours à des sociétés privées. Ce travail est également en cours.
J'en viens au problème de la vie privée et familiale des militaires et des risques supposés de rupture de contrat. Je suis frappé par la manière dont notre pays en général réagit aux événements si durs que nous vivons : par la reconsolidation de l'unité et de la communauté nationales. On l'avait constaté après « Charlie », mais certains se demandaient ce qui allait se passer la fois suivante : allions-nous sombrer dans la division ? Ce qui me frappe, au contraire, c'est la sagesse, la cohésion, la convergence. On les retrouve chez ceux, engagés – ô combien ! – au service de la Nation, qui servent dans les armées. Je n'observe nullement dans leurs rangs la tentation de la démission, de la recherche du confort. Ce sont tout de même d'abord des soldats ! Je vois plutôt des soldats vigilants, attentifs à la nouvelle mission qui leur est confiée.
Il n'empêche que les responsables publics doivent veiller à leurs conditions d'accueil et d'hébergement. Vous savez d'ailleurs qu'un plan d'urgence a été immédiatement déclenché à cette fin pour l'îlot Saint-Germain, à Paris. Il faut aussi veiller à la récupération des permissions et des soldes. Mais, sur le terrain – je vais de nouveau rencontrer la semaine prochaine, avec le gouverneur militaire, les sections qui patrouillent dans Paris –, je n'observe aucune des réactions dont vous avez évoqué l'éventualité, monsieur le député. Les armées réagissent comme le pays, comme la société tout entière, qui accusent le coup mais sont mobilisés.
Je pourrais en dire autant des services de police et de tous les services de l'État, au contact desquels j'ai vécu, comme vous, ces journées très dures et qui sont directement confrontés à la lutte contre le terrorisme.
Bref, les sujétions dont nous parlons sont inhérentes au métier militaire et je n'y vois aucun motif de rupture de contrat – ni aucun obstacle au recrutement, puisque la question m'a été également posée. Il est vrai que les recrutements planifiés à la suite de l'arrêt des déflations ne sont pas encore effectués et que les effectifs de la force opérationnelle terrestre (FOT) ne sont pas encore reconstitués ; dès lors, les sujétions n'en sont que plus grandes pour ceux qui sont engagés dans la bande sahélo-saharienne, sur le théâtre syro-irakien et sur le territoire national. Le CEMA et le CEMAT ont dû vous faire part de ces contraintes. Mais l'armée de terre ne m'indique pas qu'elle a des difficultés particulières à recruter en ce moment, non plus que les autres armées, d'ailleurs. Les candidats sont même meilleurs qu'il y a quelques années.
Monsieur Rihan Cypel, le travail que vous appelez de vos voeux sera fait. La menace est déjà réévaluée en permanence. Sa nature a changé du fait de la militarisation induite par les filières djihadistes. Il y a quarante fois plus de combattants français en Syrie qu'il n'y en avait qui partaient faire le coup de feu en Afghanistan. Vous connaissez les chiffres : ce sont 1 600 à 1 700 personnes qui sont impliquées dans ces filières, dont 500 combattants actifs. Daech leur refuse en fait tout choix personnel en les faisant participer ou assister à des violences terribles, en les conditionnant et en les aliénant par les abominations auxquelles ils leur font prendre part. C'est d'ailleurs un problème qui se posera lorsque Daech aura été anéanti comme je l'espère. Certains, notamment parmi les combattants étrangers, tenteront de rejoindre d'autres sanctuaires – dont la Libye, plus proche de notre territoire, pourrait faire partie, ce qui est préoccupant. D'autres voudront rentrer dans leur patrie d'origine, en Europe. Dans quelles conditions ? Comment pourrons-nous les suivre, les réadapter si possible alors qu'ils auront développé une forte accoutumance à la violence ? C'est un vaste débat – mais que nous n'allons pas ouvrir maintenant.

Nous sommes face à un ennemi qui possède une grande marge de manoeuvre dans les territoires qu'il occupe, en Irak, en Syrie, maintenant en Libye, dans la bande sahélo-saharienne, et une capacité de pénétration dont ont témoigné les deux terribles séries d'attentats qui ont frappé la France.
Le choix qui a été fait d'utiliser notre armée est respectable. Elle est, comme vous le dites, un réservoir, mais un réservoir insuffisant : la force opérationnelle terrestre doit repasser de 66 000 à 77 000 hommes et les recrutements ne sont pas encore faits.
Au bout de presque un an de mobilisation, deux problèmes se posent, que vous avez finalement assez peu abordés.
D'abord, l'utilisation de cette force. Cela ne se passe pas trop mal, dites-vous. Je vous incite à cet égard à continuer d'aller sur le terrain pour écouter nos soldats, voire les sous-officiers qui les accompagnent, car on ne peut pas dire qu'ils estiment tous faire ce pour quoi ils se sont engagés. Certes les patrouilles ont succédé aux gardes statiques, mais la priorité pour eux est de pouvoir se projeter, après avoir été formés et préparés. Ils acceptent évidemment de participer aux opérations intérieures puisqu'ils sont payés pour cela et que cette obligation est incluse dans leur engagement. Mais, d'une manière ou d'une autre, la répartition entre opérations intérieures et opérations extérieures doit être revue. Peut-être le renforcement de la FOT le permettra-t-il.
Ensuite, les citoyens voient où sont affectées les patrouilles, les gardes statiques, et se demandent : « Pourquoi pas nous ? » La question, que j'entends souvent à Paris, concerne certains lieux culturels, sportifs ou religieux. Il y a donc un problème d'organisation des patrouilles, ainsi que de visibilité – puisque tel est bien le sens de la présence des forces armées : envoyer un signe clair à la population.
Lorsque nous l'avons auditionné le 15 octobre dernier, le général Pierre de Villiers, chef d'état-major des armées, a souligné, en une formule puissante, qu'il ne fallait pas limiter l'emploi de nos forces armées à un rôle « supplétif » en matière de sécurité. Il a également souhaité que la valeur ajoutée de nos armées – leur expérience, leur savoir-faire – soit mise au service de notre sécurité intérieure. Ce qui nous ramène à la question d'Olivier Audibert Troin, à laquelle vous n'avez pas répondu. À cet égard, où en êtes-vous ? Certes vous n'avez pas achevé votre rapport, mais vous n'en êtes pas loin.

Il se trouve que j'ai rencontré ce matin des militaires qui participent à l'opération Sentinelle, dont un jeune capitaine venu à Paris avec sa compagnie d'infanterie et qui, entre la projection et trois participations à Sentinelle, aura été absent de son domicile pendant huit mois cette année. Je ne sais pas si beaucoup de policiers ou de gendarmes mobiles accepteraient cela. En outre, ces militaires sont logés – à l'îlot Saint-Germain dans le cas dont je parle – dans des conditions de précarité qui ne sont plus excusables à la date où nous sommes : le lit picot, c'est sympathique, mais on aurait pu faire un peu plus d'efforts !
En ce qui concerne le « rôle supplétif », qu'ont fait les militaires le 13 novembre ? Où étaient-ils ? On sait que la police a mis assez longtemps à intervenir. Les militaires eux-mêmes s'étonnent de ne pas avoir été sollicités, du moins dans un premier temps, alors que de nombreux endroits dans Paris étaient visés. C'est longtemps après qu'on les a vus apparaître, lors de l'opération menée à Saint-Denis, pour faire de la sécurisation. Aujourd'hui, ils se demandent à quoi ils servent vraiment. Quel est leur rôle lors d'un attentat ? Où est la coordination ? Ils ont le sentiment que leurs capacités ne sont pas utilisées au mieux. Ils se disent qu'ils seraient plus utiles s'ils gardaient les frontières, qu'ils y accompliraient mieux leur mission qu'en restant à Paris, le plus souvent statiques.
Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il ne faut pas utiliser l'armée sur le territoire national ; je pense au contraire que cet emploi est conforme au rôle de l'armée de terre. Mais c'est la manière dont celle-ci est utilisée qu'il faut revoir sans tarder. Dans l'urgence, il a bien fallu projeter un dispositif sur le terrain ; mais, maintenant, il faut se hâter de mener la réflexion à son terme.

Passé le choc des attentats, nous sommes conduits à questionner notre culture du risque et de la sécurité. Comme le savent tous ceux qui sont allés en Israël, ce pays, comme d'autres, a développé une culture de la sécurité à cause des risques permanents auxquels il a été et reste exposé. La France n'est pas dans le même cas, mais nous allons devoir changer de culture.
Voilà pourquoi nous nous interrogeons sur le caractère proportionné de la réaction ; voilà aussi pourquoi il existe un risque que chacun se défausse sur l'autre de ses responsabilités, comme l'a dit Daniel Boisserie. Il me semble à ce propos que le rôle des préfets est de responsabiliser chacun, et non d'ouvrir le parapluie. Ce problème témoigne en tout cas d'un besoin d'information et de formation auquel il est pleinement de votre ressort de répondre, monsieur le secrétaire général.
Comment faire évoluer cette culture à moyen et à long terme, puisque ces conflits vont durer ? Comment nous doter de dispositifs proportionnés dans lesquels les missions sont définies de telle sorte que chacun puisse s'y retrouver ? On l'a dit, l'adéquation des missions aux métiers est problématique. Pour l'instant, la situation a été gérée au fil de l'eau, ce qui est bien compréhensible puisque nul ne s'attendait à un choc de cette nature et de cette ampleur. Mais comment y remédier et quelle part y prenez-vous ?

Monsieur le secrétaire général, j'ai été un peu surpris que vous excluiez d'emblée la modification au bénéfice des militaires des règles d'utilisation de la contrainte vis-à-vis des civils.
Le Gouvernement a choisi de recourir aux forces armées dans les opérations de sécurité intérieure. Certains de mes collègues ont émis des doutes quant à la possibilité de le faire durablement sans affaiblir les capacités de projection. C'est un problème fondamental. Mais, dès lors que ce choix a été fait, il convient d'aller jusqu'au bout de cette logique, en donnant à l'armée les moyens juridiques d'assurer la sécurité intérieure aussi efficacement que possible.
Or, actuellement, les militaires en opération de sécurité intérieure ne détiennent aucun pouvoir juridique de contrainte vis-à-vis des civils. Les vérifications d'identité, la fouille à corps ou l'arrestation d'un suspect ne sont autorisées que s'ils sont accompagnés au moins d'un agent de police judiciaire et, si possible, d'un OPJ.
Monsieur le secrétaire général, vous faites une erreur fondamentale en écartant toute possibilité d'évolution de ces règles. Nous sommes engagés dans des opérations très étendues dans l'espace et dans le temps ; il est donc exclu de faire accompagner chaque patrouille de militaires par des agents de police judiciaire, a fortiori par des OPJ. D'autant que la tendance est de substituer des méthodes dynamiques à l'utilisation statique de l'armée : comment embarquer des agents ou des officiers de police judiciaire dans des patrouilles aléatoires, le cas échéant à bord d'un véhicule ?
Je vous invite donc à reprendre votre réflexion sur ce sujet, car vous faites fausse route.

Plus cette audition progresse et plus je me demande si, depuis janvier, on a tout fait pour protéger la sécurité des personnes et des biens en France. Il faudra bien que nous dressions un jour le bilan de cette action pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné.
J'aimerais d'abord revenir à la première question posée par Daniel Boisserie. Nous, élus locaux, sommes confrontés à un véritable problème de posture que l'on a mesuré dès le lendemain des attentats. Il s'agit non seulement des maires mais aussi des présidents d'intercommunalité, chargés de gérer des piscines, des stades, parfois des crèches. Président de conseil départemental, j'ai rencontré le préfet dès le dimanche 15 novembre au matin. L'après-midi, nous nous sommes posé la question des cars ; « au prochain appel d'offres », m'a-t-il dit, « vous ferez installer des caméras dans les cars ». On m'a demandé ce matin l'autorisation de diffuser un document sur le djihadisme. J'ai refusé ; je ne la donnerai que lundi 14 décembre. Il ne faut pas ajouter à la confusion.
Monsieur le secrétaire général, puisque vous allez faire un tour dans Paris avec le gouverneur militaire, ne pourriez-vous venir aussi dans nos départements et nos régions ? Je vous accueillerai très volontiers et j'organiserai une réunion avec les maires, pour que vous leur redisiez ce que vous avez déclaré tout à l'heure, à des fins de sensibilisation. Les élus locaux ne reçoivent aucune information précise de l'État. N'oublions pas la prise d'otages qui s'était déroulée dans une école à Neuilly. Les élus locaux, départementaux, régionaux – chargés des lycées – restent sans directive et je vous avoue ma crainte chaque matin au moment où partent mes 200 cars scolaires. Dans le cadre de la réflexion que vous menez avec vos services, faites quelque chose pour ces élus, vos alliés objectifs, qui s'interrogent au quotidien.
Vous avez tout à fait raison, monsieur le député. Nous avons besoin, comme l'a dit Mme Fioraso, de développer une culture, mais aussi des outils et des moyens d'information. Car la menace à laquelle nous sommes exposés peut se concrétiser à Montauban comme à Saint-Quentin-Fallavier ou à Paris. C'est donc toute la chaîne formée par les responsables administratifs ainsi que par les élus qui doit recevoir des éléments de réponse, même s'il leur appartient d'apprécier la situation. Je viendrai très volontiers dans votre département. Le SGDSN pourrait, en lien avec l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ) et le Haut Comité français pour la défense civile présidé par le sénateur Jacques Gautier, organiser des séminaires et diffuser des documents d'information, en collaborant avec les préfets.
Cette culture doit aussi toucher la population. Nous réfléchissons actuellement, avec le service d'information du Gouvernement (SIG), aux messages à diffuser. Ils ne doivent pas être anxiogènes : inutile d'en rajouter en développant une culture de l'angoisse. On m'a présenté des modèles d'affichettes sur la conduite à tenir dans telle ou telle situation. Le choix est délicat. On pourrait diffuser dans le métro des vidéos montrant où se trouvent les issues dans chaque station, ou des messages de prévention comme on l'a fait à propos des colis abandonnés. Tout cela est bien difficile, mais il est nécessaire de s'y atteler : tout en faisant preuve de circonspection, nous devons faire passer ces messages. Car comme on l'a vu au Bataclan, il existe des moyens de se mettre à l'abri du danger, que certains ont utilisés spontanément.
Monsieur de La Verpillière, peut-être ne me suis-je pas bien fait comprendre. Je pense en effet – mais ce sera à vous, parlementaires, d'en débattre – que la nouvelle loi sur l'état d'urgence pourrait permettre des évolutions.
À l'origine, toutefois, nous raisonnions à droit constant. Les armées demandent que l'on ne transforme pas leur métier ; elles ne veulent être ni des supplétifs, ni des forces de police de troisième catégorie. Nous avons donc d'abord cherché à poursuivre un même objectif en adaptant la mission. Ainsi la SUGE (surveillance générale de la SNCF) peut-elle recourir à des barrages, à des filtrages et à des contrôles, bien que ses membres ne soient pas OPJ.
Peut-être la future loi permettra-t-elle, dans un périmètre très restreint, pendant une période très courte – dans une situation comparable à celle de l'assaut de Saint-Denis –, d'autoriser les officiers à pratiquer des contrôles plus directifs. Mais cela suppose un débat, et un arbitrage entre ces nécessités et les libertés publiques qu'il n'est pas question d'improviser ici.
L'armée de terre a demandé que la formation dont bénéficient ses soldats soit adaptée. C'est en effet nécessaire, Monsieur Lamour, ainsi que de repréciser les missions. Il a été question d'un capitaine ; de fait, ce sont souvent eux, ou les lieutenants, qui ont le plus besoin que l'on précise leur mission : les officiers supérieurs sont en contact avec le préfet, le sous-préfet ou le commissaire de police, tandis que ceux qui patrouillent – sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux, militaires du rang – ne connaissent que leur feuille de route quotidienne. Vous savez, puisque vous avez reçu le général Jean-Pierre Bosser, que la période peut fournir l'occasion de dispenser des formations. Il peut s'agir de formations préalables à la mission ou bien destinées aux soldats, auxquels elles étaient auparavant délivrées dans le cadre de l'entraînement ou de la reconstitution opérationnelle des unités – secours aux blessés, formations spécifiques, sport, tir, etc. Autant de moyens, envisagés par l'armée de terre, de densifier l'activité des unités sur place et aussi le rôle d'encadrement des jeunes officiers lors des missions Vigipirate.
Le risque de surchauffe opérationnelle est réel ; mais la période que nous vivons n'est-elle pas exceptionnelle ? Comme le constatait le CEMA : « Comment l'armée ne répondrait-elle pas aux préoccupations de la population, qui demande à être protégée ? » Cette réflexion du CEMA était pleine de sagesse. L'armée n'a-t-elle pas pour mission de défendre le territoire, la patrie, de sauvegarder la population ? Cette reformulation était demandée par les militaires eux-mêmes.
Reprenons la séquence politique longue. Le premier plan gouvernemental Vigipirate date de 1978. En 1991, lors de la Guerre du Golfe, les armées sont impliquées pour la première fois. Depuis 1995, elles sont employées sans discontinuer dans cette protection du territoire national.
L'actualisation de la programmation militaire pour 2015-2019 a ouvert un nouveau cycle, mais auparavant, dans le sillage du Livre blanc de 2008 et de la réforme des armées, les contraintes opérationnelles qui s'imposaient à l'extérieur avaient conduit à limiter à près de 1 000 soldats la mobilisation des effectifs militaires dans le cadre de Vigipirate, un nombre que l'on pouvait doubler en cas de crise. À cette possibilité s'ajoutait celle, que j'ai déjà évoquée, de projeter 10 000 hommes pendant une période très courte.
Le fait d'avoir allégé la pression sur les effectifs permet finalement de renouer en 2015 avec la logique d'emploi des armées dans Vigipirate mise en oeuvre depuis les années 1980.
Naturellement, ce desserrement n'est pas d'effet immédiat, de sorte que l'engagement simultané de nos armées sur le territoire national et dans des opérations importantes sur deux autres théâtres les soumet à de fortes contraintes.
Il serait injuste, a suggéré l'un d'entre vous, d'imposer aux militaires des sujétions exceptionnelles que l'on n'attendrait pas des policiers. Mais c'est aussi pour cela – je suis désolé de le dire – que nous avons besoin des militaires, qui constituent du fait de la taille des armées un réservoir de forces disponibles ! Le régime, le statut, les missions propres aux forces de sécurité intérieure – enquête judiciaire, ordre public, sécurité routière – ne sont pas les mêmes. Il est vrai que ces sujétions sont très fortes cette année, et le resteront sans doute l'année prochaine : il faut absolument mettre en oeuvre les plans d'engagement et de recrutement pour les alléger. Mais notre pays connaît des circonstances tout à fait exceptionnelles.
La séance est levée à onze heures quinze.