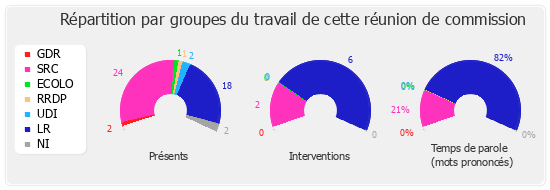Commission des affaires étrangères
Réunion du 13 janvier 2016 à 9h30
La réunion
Réunion sur les relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran avec Mme Fatiha Dazi-Héni, enseignante à l'IEP de Lille et chercheure à l'IRSEM, et M. Matthieu Rey, maître de conférence au Collège de France.
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Nous accueillons ce matin Mme Fatiha Dazi-Héni, enseignante à l'IEP de Lille et chercheure à l'IRSEM, et M. Matthieu Rey, maître de conférences au Collège de France. Je les remercie de leur présence. Pouvez-vous nous préciser, madame, ce qu'est l'IRSEM ?
Il s'agit de l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Il dépend de la nouvelle direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère de la défense.

Nous avons décidé de consacrer cette séance aux relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Nous sommes très informés sur ce sujet – nous l'avons notamment évoqué hier avec le ministre des affaires étrangères –, mais nous voulons aller plus loin avec vous ce matin.
Je suggère que vous commenciez, madame Dazi-Héni, par traiter de la situation intérieure en Arabie saoudite. Nous nous posons beaucoup de questions à cet égard. Nous constatons que la diplomatie saoudienne, qui était jusque-là très prudente, est beaucoup plus offensive depuis quelque temps, avec l'intervention au Yémen, la constitution d'une coalition de pays sunnites contre le terrorisme et l'exécution récente de quarante-sept personnes, dont un dignitaire chiite. Que signifient tous ces événements du point de vue de la situation intérieure ? Ces exécutions sont-elles un signe de puissance ou de fragilité du régime saoudien ? Comment analysez-vous les rapports de force au sein de ce régime ? S'agit-il d'un problème entre anciennes et nouvelles générations ? Quelles sont les relations entre la monarchie et le pouvoir religieux, dont l'alliance est à l'origine de la création de l'Arabie saoudite ? Comment les Saoudiens analysent-ils la montée en puissance de l'Iran dans la région, notamment depuis l'accord nucléaire ? On connaît la rivalité multiséculaire qui existe entre les deux pays. Qu'en est-il de la montée en puissance de groupes terroristes en Arabie saoudite ? Il semble qu'un certain nombre de jeunes Saoudiens se réclament désormais de Daech.
Monsieur Rey, je vous propose d'approfondir la question du contexte régional. Nous n'avons pas le sentiment – nous avons interrogé le ministre sur ce point hier – qu'une confrontation directe entre l'Arabise saoudite et l'Iran soit l'hypothèse la plus probable, mais leur antagonisme peut avoir des répercussions dans toute la région et au-delà. Selon vous, quelles sont les conséquences sur la Syrie – nous espérons que le processus de négociation s'ouvrira comme prévu le 25 janvier –, sur le Liban – qui se trouve toujours dans une situation de paralysie institutionnelle, malgré une petite lueur d'espoir – et sur le Yémen, mais aussi sur d'autres pays tels que Bahreïn, qui compte une importante communauté chiite. J'ai accompagné le ministre de la défense à Manama le 31 décembre pour rencontrer les marins français. Lors de l'entretien que nous avons eu avec l'émir de Bahreïn, celui-ci a laissé percer son extrême inquiétude. Nous avons le souvenir des répressions féroces qui avaient eu lieu dans ce pays il y a quelques années.
Nous assistons en effet à un tournant dans la gouvernance au sein de la monarchie Al-Saoud. Depuis l'accession au trône du roi Salman il y a un an, beaucoup de choses ont changé. Alors que l'Arabie saoudite nous avait habitués à une diplomatie « derrière le rideau », qu'elle ne se mettait jamais en avant, même si, pendant des décennies, elle a diffusé un peu partout via son soft power ses conceptions religieuses issues du salafisme version wahhabite, elle mène aujourd'hui une politique régionale très interventionniste, ce qui est très nouveau. Si elle tente ainsi de prendre les choses en main, c'est non pas par arrogance ou parce qu'elle se sent puissante, mais au contraire, selon moi, parce qu'elle est plus que jamais fragilisée et sur la défensive.
Cette politique proactive avait déjà commencé à la fin du règne du roi Abdallah, qui avait fait intervenir sa garde nationale au Bahreïn en mars 2011, aux côtés des Émirats arabes unis, pour aider la dynastie sunnite Al-Khalifa à mater le soulèvement populaire dominé par la communauté chiite. Celle-ci représente 60 à 65 % de la population du pays, selon une estimation haute. Depuis une décennie, les autorités bahreïniennes procèdent à un rééquilibrage démographique en naturalisant massivement des Syriens et des Jordaniens sunnites, ce qui était précisément l'un des griefs de la communauté chiite.
Mais cette politique devenue aujourd'hui assez agressive est surtout symbolisée par la formation de la coalition arabe sous l'égide de l'Arabie saoudite pour intervenir au Yémen à partir du 25 mars 2015. En outre, dès l'arrivée du roi Salman, les Saoudiens ont affirmé de manière très nette qu'ils ne lâcheraient pas le dossier syrien comme ils l'avaient fait auparavant avec le dossier irakien. L'Arabie saoudite a aujourd'hui très peu de relais et de leviers en Irak, et elle ne veut absolument pas perdre ceux dont elle dispose en Syrie.
Tout cela se déroule dans un contexte de rivalité régionale avec l'Iran. Celle-ci n'est pas nouvelle – elle remonte à la révolution islamique iranienne de 1979 –, mais elle a connu un tournant très marqué avec la chute de Saddam Hussein en 2003. Les Saoudiens étaient opposés à une invasion américaine de l'Irak. Ils ont essayé de conseiller l'administration Bush, mais n'ont pas été écoutés. Ils nourrissent donc beaucoup de griefs contre les États-Unis, qui ont, selon eux, offert l'Irak à l'Iran sur un plateau d'argent. La communauté chiite étant plus nombreuse que la communauté sunnite en Irak, la chute de Saddam Hussein a entraîné mécaniquement l'arrivée d'un pouvoir chiite, lequel n'a eu de cesse qu'il n'ait pris sa revanche.
L'exclusion des sunnites du champ politique en Irak a beaucoup contribué à accentuer la tension sectaire entre sunnites et chiites. Néanmoins, selon moi, nous avons affaire non pas à une guerre sunnito-chiite – pas du tout –, mais à une tension politique entre deux acteurs régionaux actuellement dominants, mais paradoxalement assez faibles. L'Iran a certes accru son influence au Moyen-Orient depuis 2003, mais il ne parvient pas à pousser son avantage de manière déterminante. On le voit en Syrie, mais aussi en Irak, où la présence iranienne crée beaucoup de tensions. Quant à l'Arabie saoudite, elle est, bien plus que l'Iran, dans une situation de faiblesse. D'où la politique proactive et la grande nervosité des Saoudiens. Ils se sentent quelque peu abandonnés par les États-Unis, qui non seulement leur tournent le dos en se rapprochant de l'Iran ou, à tout le moins, en facilitant son retour avec la signature de l'accord nucléaire, mais surtout laissent dans une certaine mesure les acteurs régionaux régler les conflits. C'est d'ailleurs assez paradoxal : les Saoudiens sont très critiques à l'égard des États-Unis lorsqu'ils interviennent trop, mais aussi quand ils n'interviennent pas assez.
De quels changements sommes-nous témoins avec l'arrivée du roi Salman ?
La famille Al-Saoud est très large et constituée d'un certain nombre de clans. Issu d'un clan assez mineur, le roi Abdallah avait besoin de s'allier avec d'autres clans et consultait beaucoup, ce qui donnait l'impression d'un processus décisionnel assez long et consensuel. En outre, certains poids lourds de la famille Al-Saoud imposaient leur avis. D'où une diplomatie prudente.
Aujourd'hui, la situation a changé : c'est un clan puissant qui est au pouvoir, celui des Soudaïri, du nom de Hassa Al-Soudaïri, l'une des nombreuses épouses du roi Ibn Saoud, laquelle a donné naissance à un nombre impressionnant d'hommes de premier plan : le roi Fahd, le prince Sultan, ministre de la défense pendant cinquante ans, le prince Nayef, ministre de l'intérieur pendant près de quarante ans, le roi Salman, ainsi qu'un vice-ministre de l'intérieur et un vice-ministre de la défense.
Le roi Salman est en train de clore le chapitre de la deuxième génération des Al-Saoud, c'est-à-dire des fils d'Ibn Saoud. Il arrive au pouvoir à quatre-vingts ans, un peu fatigué et affaibli, mais c'est un homme pivot au sein de la famille, dont mes amis saoudiens disent qu'il aurait fait un très grand roi il y a quinze ans. Il a à coeur de promouvoir au sein du clan Soudeïri sa propre filiation et notamment son fils préféré, Mohammed Bin Salman.
Aujourd'hui, il y a un saut générationnel avec le prince héritier et ministre de l'intérieur, Mohammed ben Nayef. C'est le « monsieur sécurité » : à la tête de la lutte antiterroriste, il a combattu avec succès les cellules djihadistes d'Al-Qaïda à l'intérieur du royaume pendant toute la décennie 2000. C'est un homme très puissant, respecté et compétent. Reste qu'il représente l'option « tout sécuritaire » : c'est lui qui est à l'initiative de la décision, prise en accord avec le roi, d'exécuter quarante-sept personnes le 2 janvier dernier. Même s'il est critiqué, il fait relativement consensus, parce qu'il a fait ses preuves.
En revanche, celui qui ne fait pas du tout consensus et fait couler beaucoup d'encre, c'est le jeune prince Mohammed ben Salman, fils apparemment favori du roi Salman, qui est – excusez du peu – vice-prince héritier, ministre de la défense et président du Conseil économique et de développement, cette dernière fonction étant, selon moi, au coeur de ses ambitions – j'y reviendrai. Âgé d'à peine trente ans, titulaire de l'équivalent d'une licence de droit de l'université du roi Saoud de Riyad, il est peu connu. Il a très peu voyagé à l'étranger, mais a acquis une culture politique et une expérience des affaires intérieures auprès de son père, qu'il suit depuis qu'il est tout jeune.
Il a donné récemment, pour la première fois, une interview à un grand journal étranger, The Economist. D'une manière générale, il est très décrié dans la presse occidentale : certains se demandent s'il est « l'homme le plus dangereux du monde » ; d'autres disent qu'il aurait des relations très difficiles avec le prince héritier… Cependant, il faut se méfier des supputations de cette nature, car personne n'est vraiment en mesure de décrypter les relations très opaques entre les princes Al-Saoud.
Le roi Salman, le prince Mohammed ben Nayef et le prince Mohammed ben Salman gouvernent à trois, ce qui est inédit en Arabie saoudite. D'où des décisions rapides, assez tranchées et, parfois, des annonces un peu impromptues, telle que celle de la coalition islamique antiterroriste. Une chose est sûre : ces trois personnages à la tête du pouvoir ont un intérêt vital à s'entendre. Même si, visiblement, les objectifs de guerre de Mohammed ben Salman au Yémen ne sont pas tout à fait partagés par Mohammed ben Nayef : le premier voulait carrément envoyer des troupes au sol, mais le second s'y est totalement opposé, et le roi l'a écouté.
Pour le moment, le moins que l'on puisse dire, c'est que Mohammed ben Salman n'a pas fait ses preuves au portefeuille de la défense : la guerre au Yémen, qui était annoncée comme une opération décisive, dure depuis dix mois. Le Yémen – dont on ne parle guère – est entièrement détruit et vit un désastre humanitaire : la population souffre de malnutrition à plus de 80 % et subit des épidémies épouvantables. Néanmoins, apparemment, 80 % des territoires qui avaient été conquis par les rebelles Houthis ont été repris.
Rappelons que le problème du Yémen n'est pas l'opposition entre chiites et sunnites : celle-ci est instrumentalisée. Les rebelles Houthis, zaïdites « chiitisés », se sont alliés avec leur pire ennemi d'hier, l'ancien président Ali Abdallah Saleh, lui-même de confession zaïdite et proche des Saoudiens pendant une quarantaine d'années. Fort de cette alliance, ils ont pris Sanaa, puis se sont dirigés vers Aden, ce qui était une ligne rouge pour l'Arabie saoudite, qui a décidé d'intervenir militairement. Cette décision ne m'étonne pas : il ne pouvait guère en être autrement compte tenu de l'état d'esprit à Riyad. En interne, le roi et son fils ont plutôt bien communiqué : la population saoudienne a estimé que le déclenchement de la guerre était parfaitement justifié ; l'intervention a même été très populaire au début.
Si je dis que l'Arabie saoudite est très fragilisée aujourd'hui, c'est que trois de ses piliers sont aujourd'hui mis à mal.
Premièrement, l'alliance stratégique avec les États-Unis ne sera plus jamais ce qu'elle a été. Cela rend les Saoudiens très fébriles, car ils ont mis tous leurs oeufs dans le même panier et sont aujourd'hui totalement dépendants de la garantie de sécurité américaine. D'où la main tendue vers la France, qui a renforcé sa coopération de défense avec l'Arabie saoudite et est devenue, en Europe, l'un des principaux exportateurs d'armes vers ce pays. Une grande relation de confiance s'est établie entre les Saoudiens et les militaires français, ce qui est de moins en moins le cas entre les Saoudiens et les Américains. J'ai entendu des responsables saoudiens affirmer clairement qu'ils avaient des difficultés à obtenir des Américains l'information et le renseignement dont ils ont besoin pour mener leurs opérations au Yémen. Ils ont l'impression d'avoir affaire à deux gouvernements à Washington : d'un côté, le Pentagone et, de l'autre, la Maison blanche, très réticente quant à l'intervention au Yémen. Il faut dire que les Américains ont été mis devant le fait accompli. L'armement saoudien provenant à 95 % des États-Unis, de même que le renseignement et les images satellitaires, ils sont entraînés dans cette guerre. Les Français le sont d'ailleurs aussi.
Deuxièmement, les organisations terroristes, tant l'État islamique qu'Al-Qaïda, menacent le Royaume d'Arabie saoudite dans son existence. S'il est certain que certaines grandes fortunes du Golfe soutiennent des salafistes djihadistes, il est absolument faux d'affirmer que l'État Al-Saoud finance Daech.
Certes, la matrice idéologique salafiste wahhabite a alimenté ces groupes. Certes, l'inspirateur d'Al-Qaïda, Oussama ben Laden, était saoudien. Mais l'Arabie saoudite n'a jamais financé Daech.
Aujourd'hui, ces organisations terroristes mettent en péril le pacte entre la famille Al-Saoud et l'establishment religieux wahhabite, en affirmant que le second est totalement sous la dépendance de la première, ce qui est vrai : ce sont des fonctionnaires. À la différence de l'Iran, République islamique où le pouvoir est sous le contrôle du Guide suprême, l'Arabie saoudite n'est pas une théocratie : ce sont les Al-Saoud qui contrôlent le pouvoir politique, de manière classique. Et c'est précisément sur ce point que Daech et Al-Qaïda contestent leur légitimité.
L'Arabie saoudite est menacée dans son existence par l'État islamique, non seulement par la présence de celui-ci à la frontière nord, mais aussi par sa surenchère anti-chiite, qui épouse en partie l'idéologie wahhabite, laquelle considère les chiites non pas comme des musulmans, mais comme des « réjectionnistes » – râfidhin en arabe. Actuellement, comme en Europe, certains jeunes de quinze à vingt ans sont très attirés par l'idéologie extrémiste de l'État islamique. Les dirigeants saoudiens prennent cette grave menace très au sérieux.
Dans ce contexte, comment ces dirigeants auraient-ils pu expliquer à leur population qu'ils n'exécutent que des salafistes djihadistes, condamnés il y a dix ans pour des attentats perpétrés dans les années 2000 – dont Fares Al-Shuwail, ancien idéologue d'Al-Qaïda ? Selon moi, l'exécution de quatre contestataires chiites, dont le cheikh Nimr Baqer Al-Nimr, visait à compenser, aux yeux de l'opinion, celle de quarante-trois salafistes djihadistes. Le leadership Al-Saoud y a été, d'une certaine manière, acculé. Ce n'était pas une provocation délibérée à l'égard de l'Iran ou un « quasi-acte de guerre », ainsi qu'on a pu le lire dans la presse, même si les Al-Saoud pouvaient tout à fait prévoir l'émotion qui a saisi le monde chiite et la colère de l'Iran. Je ne crois pas du tout à une confrontation directe entre l'Arabie saoudite et l'Iran, car elle n'est dans l'intérêt ni de l'une ni de l'autre. Mais cette tension très forte ne favorise pas, bien sûr, les négociations de sortie des conflits, notamment syrien et yéménite.
Troisième pilier mis à mal : le pétrole, dont le prix a chuté de 70 % entre juin 2014 et aujourd'hui. Cela ne fait les affaires de personne en Arabie saoudite, en tout cas pas celles des Al-Saoud. Cependant, le jeune prince Mohammed ben Salman, président du Conseil économique et de développement, a saisi cette occasion pour annoncer un plan d'austérité pour 2016. Il a visiblement l'intention de réformer structurellement le royaume et d'inventer un nouveau pacte social, en passant, pourquoi pas, à une économie post-pétrolière. C'est en tout cas ce qui ressort de l'interview qu'il a donnée à The Economist et du rapport remis par le cabinet McKinsey à la demande des autorités Al-Saoud pour les aider à mener des réformes, notamment à introduire des taxes et à mettre fin aux prix subventionnés. Ces nouvelles mesures concerneraient 80 % de la population saoudienne, Mohammed ben Salman ne voulant absolument pas qu'elles affectent les 20 % de couches moyennes et pauvres – rappelons que les salaires sont assez bas en Arabie saoudite.
Avec la nouvelle gouvernance que j'ai décrite, toute une partie de la famille Al-Saoud a été exclue de la prise de décision, désormais monopolisée par quelques membres d'un seul clan. Cela crée du mécontentement dans le premier cercle, mais aussi dans le second : de grands groupes tels que Saudi Bin Ladin group (SBG) sont en disgrâce. Or, avec le plan d'austérité, le mécontentement ne va-t-il pas s'étendre au-delà, au sein de la population saoudienne dans son ensemble ? En réalité, Mohammed ben Salman fait un pari : il fait un appel du pied à de nouveaux entrepreneurs saoudiens, dont il tente de se faire des alliés dans le cadre de son pacte social, en écartant ceux qui se sont beaucoup engraissés au cours des trente ou quarante dernières années.
En cela, il s'inspire de l'expérience menée actuellement par le sultan Qabous à Oman. Il a également deux autres modèles chez ses voisins, deux princes puissants et visionnaires : l'émir de Doubaï, Mohammed ben Rachid, qui a développé l'économie de son émirat, et le prince héritier d'Abou Dabi, Mohammed ben Zayed, qui privilégie la défense et le hard power. C'est visiblement une synthèse de ces deux personnalités que ce jeune ambitieux a l'intention de réaliser.
Je me concentrerai sur la Syrie et l'Irak, qui sont deux cas d'école permettant de comprendre comment l'Arabie saoudite et l'Iran exercent leur influence dans la région.
Loin d'analyser l'Arabie saoudite et l'Iran comme deux pays caractérisés par leur diplomatie religieuse, sunnite ou chiite, il me semble préférable de les lire selon un autre modèle, celui de la citadelle assiégée. L'une et l'autre se vivent comme des pays encerclés par des ennemis qui cherchent à détruire systématiquement leur originalité propre : pour l'Iran, le fait d'être une République islamique achevée, qui a réussi une révolution anti-impérialiste en 1979 en chassant l'ancien allié américain ; pour l'Arabise saoudite, le fait d'avoir fondé un régime d'islam pur, contrôlant les lieux saints et ayant vocation à exercer un droit de regard sur le troisième lieu saint que serait, à terme, Jérusalem.
Nous connaissons bien le modèle de la citadelle assiégée pour avoir vu la politique pratiquée par l'Union soviétique pendant environ soixante-dix ans. L'État soviétique s'appuyait sur une idéologie assez floue, malléable, dont il jouait, en la mettant de côté lorsqu'il s'agissait de promouvoir ses intérêts stratégiques – en 1956, lorsqu'il a cherché à se faire de l'Égypte une alliée, cela ne lui a pas posé de problème que les communistes soient emprisonnés dans ce pays – et en la mettant en avant pour créer de la contestation ou des divisions internes chez l'adversaire. Le parallèle est assez fort : aujourd'hui, l'Arabie saoudite et l'Iran utilisent de même un ensemble d'outils et d'acteurs afin de se positionner en Syrie et en Irak.
Les cas syrien et irakien sont distincts, à ceci près qu'un acteur des plus nuisibles, l'État islamique, s'est étendu sur le territoire des deux pays. Nos deux citadelles assiégées n'ont qu'une peur : que cet acteur s'étende encore. Elles se retrouvent paradoxalement dans l'opposition à un tiers, et c'est leur seul point de convergence.
Historiquement, l'Irak est le pays qui a été le plus secoué et transformé : depuis l'invasion américaine en 2003, on a assisté à une extension progressive des positions chiites. Après les élections de 2010, on a vu arriver au pouvoir une coalition dominée par un acteur qui se revendique du chiisme politique : d'abord M. Al-Maliki, puis M. Al-Abadi, qui appartient au même clan et suit la même ligne.
Cependant, si l'on observe les dynamiques internes en Irak, on constate – c'est aussi pour cette raison que c'est un cas d'école – la même chose qu'en Syrie : certes, il y a une ligne de partage entre chiites et sunnites, mais elle ne concerne qu'un front donné, celui qui oppose les forces gouvernementales et l'État islamique ; en réalité, les principales lignes de conflit passent à l'intérieur des clans. Par exemple, à Bassora, deux ensembles d'acteurs – tous des milices – s'opposent : le premier est favorable à une plus grande influence de l'Iran dans la région, en particulier en Irak, qui se concrétise par des liens financiers, matériels et symboliques ; le second se revendique d'une nation irakienne et veut chasser les acteurs étrangers, au premier chef l'Iran, mais aussi l'État islamique. Selon ce dernier ensemble d'acteurs, la refondation de la souveraineté irakienne sous le leadership chiite permettrait de restaurer un espace public permettant aux composantes chiites de survivre à terme face à la menace existentielle que représente l'État islamique.
Cette grille de lecture fonctionne de manière relativement similaire en Syrie, où, en dépit de l'intervention d'un nombre croissant d'acteurs, on trouve schématiquement deux grands ensembles, les pro-Bachar et les anti-Bachar.
Au sein de la coalition soutenant le président en place, l'Iran tente de maintenir son leadership, mais n'y parvient plus tout à fait depuis l'intervention russe. Jusqu'à l'été 2015, il occupait une position dominante, grâce au déploiement d'un ensemble d'acteurs sur le terrain, notamment d'hommes qui encadrent les milices dépendant du régime pour empêcher l'effondrement de celui-ci, mais qui ont aussi été jusqu'à donner des coups de main pour réorganiser la poste d'Alep, intervenant ainsi à un niveau de responsabilité très bas. Cependant, après l'accord de Zabadani – trêve décidée de manière autonome par les acteurs dépendant de Téhéran sans en référer à Damas –, la Russie est entrée en action de manière beaucoup plus vigoureuse et a tenté de récupérer le leadership sur l'ensemble des forces dépendant du régime. Ainsi, il y a de plus en plus d'acteurs au sein de cet ensemble, de même qu'au sein de l'opposition syrienne, ce qui rend la situation difficile à comprendre.
Quant à l'Arabie saoudite, elle s'est montrée beaucoup plus offensive sur le terrain syrien à partir de mars 2015, moment où elle est aussi intervenue militairement au Yémen.
Rappelons que, pour l'État saoudien, ce ne sont pas les mêmes variables qui sont en jeu en Irak et en Syrie. S'il existe des connexions historiques importantes entre l'Arabie saoudite et l'Irak, notamment du fait de tribus qui se trouvent des deux côtés de la frontière, la construction de l'Irak moderne s'est faite en opposition à celle de l'Arabie saoudite : la constitution de l'Irak est avant tout une borne à une possible extension de l'Arabie saoudite. Dès lors, les liens entre les deux pays se sont établis sur une durée de quatre-vingts ans. En comparaison, les familles de la partie occidentale de l'Arabie saoudite – c'est-à-dire des grandes villes de La Mecque, de Médine et de Djedda – ont des liens de parenté et de mariage avec celles du bassin sud-ouest de la Syrie – qui va jusqu'à Damas, voire Homs – depuis environ cinq siècles. Aussi, lorsque des événements touchent les populations de Damas ou du Hauran, au sud de la Syrie, de nombreuses familles saoudiennes se sentent concernées. La politique saoudienne à l'égard de la Syrie se déploie donc à deux niveaux, celui de l'État saoudien et celui des grandes familles.
Ainsi, la monarchie saoudienne s'est repositionnée sur le dossier syrien de manière à satisfaire ces grandes familles, lesquelles seraient à même de la contester éventuellement dans les grandes villes religieuses, zone vitale pour elle. À partir de la fin de l'hiver 2014-2015, alors que le régime syrien grignotait très lentement les positions de l'opposition, l'Arabie saoudite a réorganisé le front sud, de manière très offensive, en écartant temporairement la Jordanie. Puis, devant l'essoufflement de cet effort, elle a pris une initiative diplomatique, plutôt réussie, pour restructurer l'ensemble des composantes de l'opposition syrienne, à l'exception d'un acteur majeur, le groupe des Hommes libres – Ahrar Al-Cham.
Cependant, le problème crucial pour l'Arabie saoudite, tout comme pour les grandes puissances et l'Iran, en Syrie comme en Irak, est de se faire obéir de ses alliés et de définir un agenda politique. Depuis 2013, il n'y a plus de régime qui tienne, ni d'un côté ni de l'autre, mais un réseau de postes de contrôle – check points. De ce fait, il n'est plus possible de prendre de grandes décisions. Ainsi, un certain nombre de trêves établies à Homs entre le régime et l'opposition ont été immédiatement violées alors même que les deux acteurs s'étaient engagés, car il est de plus en plus difficile de contrôler les groupuscules.
Dans cette guerre picrocholine, les grands acteurs internationaux – États-Unis dans un premier temps, Russie depuis peu – et régionaux – Arabie saoudite, Iran – sont confrontés à la même question : ils n'arrivent pas à imposer un agenda cohérent, à construire une plateforme qui permette en même temps de répondre aux urgences locales, à Homs ou à Ramadi, et de traiter la crise, syrienne ou irakienne, au niveau national. C'est pourquoi ils ont de plus en plus de difficultés à combattre leur pire ennemi, l'État islamique.
L'Arabie saoudite et l'Iran sont des citadelles assiégées qui font face à un danger existentiel qui vient de leurs marges et qu'ils ont dans une large mesure créé. Ce sont, en quelque sorte, des pôles de stabilité fragiles, entourés de zones dans lesquelles le lien politique, étatique se rétracte de façon de plus en plus violente, sans que de nouvelles formes politiques telles que nous les connaissons, à savoir des États, émergent véritablement. Nous avons affaire, au contraire, à des réseaux mouvants, très décentralisés et d'autant plus performants qu'ils n'ont pas à proposer de programme politique – il est très pratique, pour une organisation politique, de ne pas avoir à répondre à des demandes immédiates. C'est ce qui fait aujourd'hui la force de l'État islamique, qui puise sa légitimité dans les contestations syrienne et irakienne, et attire à lui une part croissante de la population.

D'après moi, la communauté internationale réagit très peu aux fréquentes violations des droits de l'homme en Iran et en Arabie saoudite – où la soeur du jeune blogueur Raïf Badaoui vient d'être arrêtée. Malgré ces violations, l'Arabie saoudite a été désignée à un poste clé au sein du Conseil des droits l'homme. Que pensez-vous de la position de la communauté internationale et de l'Union européenne en la matière ? Favorise-t-elle la résolution des conflits que nous avons évoqués ?

Quelles cartes la France peut-elle jouer dans la relation entre l'Arabie saoudite et l'Iran, ?
Madame Dazi-Héni, vous avez indiqué que la France était entraînée dans la guerre au Yémen, à l'instar des États-Unis. Pouvez-vous développer ce point ?

Selon une thèse qui est parfois avancée, les réserves de gaz découvertes entre le Qatar et l'Iran dans les années 1970 joueraient un rôle dans les relations entre différents pays de la région, notamment l'Arabie saoudite, le Qatar et la Syrie. Qu'en pensez-vous ?
Le califat souhaité par Daech est-il une menace réelle pour la domination politique de l'Arabie saoudite, d'une part, et pour les frontières nationales dans la région, d'autre part ?

Monsieur Rey, concernant l'Arabie saoudite et l'Iran, vous avez parlé de deux « citadelles assiégées ». Au-delà des protestations de principe de l'Arabie saoudite, l'accord nucléaire avec l'Iran a-t-il eu une réelle influence sur les relations entre les deux pays ?

Madame Dazi-Héni, vous avez expliqué que l'État islamique ne recevait pas de financement de l'État saoudien. Pouvez-vous préciser s'il reçoit, le cas échéant, d'autres financements en provenance d'Arabie saoudite ou d'ailleurs ?
L'exécution des quatre chiites en même temps que les quarante-trois autres personnes condamnées a-t-elle calmé le jeu à l'intérieur de l'Arabie saoudite ?

L'Arabie saoudite est en effet très fragilisée. C'est un nid de frelons et la sécurité intérieure n'est absolument pas garantie : le pays est toujours à la merci d'attaques virulentes.
La famille royale saoudienne, qui compte 2 300 personnes – j'ai vu une copie de l'arbre généalogique : il est assez impressionnant –, est traversée par des luttes d'influence très fortes à tous les niveaux. Le roi Abdallah passait pour être assez favorable à une évolution interne, notamment en ce qui concerne le statut de la femme, mais le roi Salman ne le serait pas du tout. Quel est votre jugement sur ce point ?
L'Arabie saoudite et l'Iran sont en effet deux citadelles assiégées, mais les structures publiques de la première sont concentrées dans les mains d'une famille royale pléthorique et divisée en clans, alors que le second est, à mon sens, un véritable État. La France semble avoir mis – je le dis prudemment – tous ses oeufs dans le même panier saoudien. Selon vous, est-ce vraiment, à terme, une politique sage et responsable ?

La famille Al-Saoud a structuré l'Arabie relativement récemment, il y a moins d'un siècle, après avoir pris le Hedjaz en 1925. Vous avez évoqué, monsieur Rey, les grandes familles d'Arabie qui ont des liens anciens, notamment matrimoniaux, avec la Syrie. Ces grandes familles peuvent-elles avoir un rôle politique à l'avenir, en cas de déstabilisation de l'Arabie saoudite ? D'autre part, certaines tribus, dont l'une joue actuellement un rôle important, sont à cheval sur l'Arabie saoudite, l'Irak et la Syrie.

Nous avons été nombreux à nous étonner qu'un Saoudien soit nommé à la présidence d'une des commissions consultatives du Conseil des droits de l'homme. À la lumière des événements récents, quel jugement portez-vous sur cette affaire ?

Je vous remercie, cher Jacques Myard, d'avoir abordé la question des droits des femmes. En effet, depuis 2013, des femmes siègent au Conseil consultatif.
Monsieur Rey, pouvez-vous nous en dire plus sur les relations entre l'Arabie saoudite et les autres pays sunnites de la région, notamment la Jordanie, pays clé, mais aussi le Koweït, qui n'a pas rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran, ou encore Oman, qui s'est toujours tenu en retrait des tensions entre Riyad et Téhéran ?
Les violations des droits de l'homme en Arabie saoudite ne sont pas une chose nouvelle. Il est vrai que le pays a débuté l'année de manière très violente avec ces quarante-sept exécutions. Les réactions ont été très timides, tout particulièrement dans notre pays : la France a « déploré »… c'est le moins qu'elle pouvait faire ! En revanche, l'Allemagne a réagi beaucoup plus fortement : elle a annoncé qu'elle étudierait la possibilité de réduire ses exportations d'armements vers l'Arabie saoudite.
Le problème fondamental de la France dans la région n'est pas qu'elle va devoir rééquilibrer les choses avec l'Iran parce qu'elle en aurait trop fait avec l'Arabie saoudite, c'est un problème plus général de positionnement : alors qu'elle est tout de même l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, elle ne parle que de diplomatie économique. Le fait que nous cherchions à tout prix à obtenir des contrats n'est pas perçu comme très respectable : cela se sait dans la région et la France y est considérée comme un pays faible. Vous n'imaginez pas à quel point les pays du Golfe en jouent, et de manière très humiliante ! Lorsqu'ils voient arriver les Français avec leurs gros sabots à la recherche de contrats, ils se disent qu'ils vont « faire mumuse » avec eux ! Pardonnez-moi de le dire aussi brutalement, mais c'est exactement de cette manière que cela se passe.
S'il y a une chose que respectent ces pays – non seulement l'Arabie saoudite, mais aussi des micro-États tels que les Émirats arabes unis, qui adorent jouer avec le hard power –, c'est la puissance. Lorsque cheikh Hazza ben Zayed, le « monsieur sécurité » des Émirats arabes unis, est venu, missionné par son frère cheikh Mohammed ben Zayed, demander à Mme Merkel de considérer les Frères musulmans comme une organisation terroriste, celle-ci lui a répondu que l'Allemagne était un pays souverain qui gérait ses affaires comme elle l'entendait. Je ne pense pas que les dirigeants français auraient eu une telle attitude : ils écoutent, font le dos rond...
Si, demain, l'Iran revient dans la région et que la France conserve cette attitude, les choses vont être autrement plus compliquées qu'avec le partenaire saoudien ou émirien : les Iraniens ayant tenu pendant douze ans une négociation avec le reste du monde, il faut s'attendre à de sacrés maux de tête avec eux !
Il faudrait que la France change d'attitude et soit en mesure de mener, à l'instar de l'Allemagne et de la Suède, un véritable dialogue critique avec ces pays, notamment lorsqu'ils procèdent à des exécutions massives. À ce propos, ne tombons pas dans l'angélisme à l'égard de l'Iran : ce pays a exécuté plus de 1 100 personnes en 2015. Certes, ce nombre paraît moindre si on le rapporte à la population, l'Iran comptant quatre-vingts millions d'habitants, soit près de trois fois plus que l'Arabie saoudite.
L'Arabie saoudite est très différente de l'Iran, mais elle est aussi un État. Et c'est précisément sur ce point que l'État islamique attaque la famille Al-Saoud : celle-ci exerce le pouvoir politique, mais n'a, selon lui, aucune légitimité religieuse.
La France est entraînée dans la guerre au Yémen, car elle a une coopération de défense très forte avec l'Arabie saoudite.

Pouvez-vous être plus précise sur ce point ? Dire qu'il y a une coopération de défense entre le France et l'Arabie saoudite et dire que la France est entraînée dans la guerre au Yémen, ce n'est pas la même chose.
Les Saoudiens ont aujourd'hui beaucoup plus confiance dans la coopération avec les militaires français qu'avec les militaires américains. D'ailleurs, après avoir investi autant d'efforts pendant près de trente ans pour développer un partenariat stratégique avec l'Arabie saoudite et les voisins du Conseil de coopération du Golfe, il n'est pas nécessairement opportun de remettre complètement en question cette relation de confiance, que ce soit en raison des problèmes de gouvernance au sein de l'État Al-Saoud ou en vue d'un rééquilibrage dans la perspective du retour de l'Iran.
D'autant que les Iraniens ne vont pas nous tomber immédiatement dans les bras, compte tenu de ce qu'a été la position de la France pendant les négociations sur le dossier nucléaire. Cela reflète d'ailleurs un problème interne à notre pays : les directions chargées des affaires stratégiques et de la prolifération nucléaire au sein du Quai d'Orsay et du ministère de la défense ont pris le dessus sur l'expertise régionale, qui a été quelque peu méprisée. D'où l'impression qu'on a eue de voir les « néoconservateurs » dominer lors des négociations sur le dossier nucléaire iranien, quelle qu'ait été la coloration politique des gouvernements français successifs.
La famille Al-Saoud compte en effet 2 300 princes mais la famille dans son ensemble plus de 20 000 personnes, dont une centaine d'altesses royales. Le fait que les décisions régaliennes soient prises aujourd'hui par trois personnages au sommet de l'État suscite beaucoup de contestation, mais bien davantage au sein du premier cercle du pouvoir qu'au sein de la société. On ignore ce que cette contestation peut donner et si elle va s'organiser plus amplement au sein de la société à la faveur du plan d'austérité et de la tentative de créer un nouveau pacte social. En tout cas, ce sera compliqué, car on assiste à une répression à tous crins, qui touche non seulement les jeunes salafistes qui basculent dans le djihadisme, mais aussi les contestataires pacifistes tels que les membres de l'Association saoudienne des droits civils et politiques, ce qui est assez préoccupant. Mohammed ben Nayef, ministre de l'intérieur et prince héritier, a une vision ultra-sécuritaire. Cette politique suscite des interrogations et contribue à fragiliser le royaume.
Le roi Abdallah a eu le mérite de mettre la place et le rôle de la femme saoudienne au coeur du débat, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant. La situation des femmes était le meilleur argument pour essayer de mettre la population saoudienne au travail : diplômées de l'enseignement supérieur à près de 60 %, elles n'ont malheureusement accès qu'à très peu de secteurs professionnels et acceptent souvent des emplois en deçà de leurs qualifications, à la différence des hommes. Les femmes saoudiennes concourent de manière fondamentale à la cohésion sociale. Comme dans nos sociétés, elles jouent un rôle central dans l'éducation des enfants et sont donc un vecteur du changement des mentalités. En Arabie saoudite, le taux de célibat des femmes et le taux de divorce sont très élevés, ce qui soulève la question du statut de la femme, qui est toujours sous la tutelle d'un homme – mahram. Toutes ces questions ont été évoquées du temps du roi Abdallah, qui était très populaire auprès des femmes saoudiennes.
Aujourd'hui, ces questions ne sont pas au coeur des préoccupations du roi Salman, qui est un conservateur beaucoup plus proche de l'establishment religieux officiel que ne l'était le roi Abdallah. Cependant, il ne remet pas non plus en cause l'héritage de son prédécesseur : il a laissé les femmes voter et se présenter aux élections municipales. Les conseils municipaux n'ont pas beaucoup de prérogatives, mais c'est un symbole qui a son importance.
La priorité de la monarchie, aujourd'hui, c'est de réussir le pari du passage à une société post-pétrolière, avec un prix du baril qui restera bas. L'Arabie saoudite contribue d'ailleurs elle-même à l'effondrement des prix en défendant ses parts de marché avec beaucoup d'agressivité, notamment en Asie. Certains disent que c'est aussi pour compromettre le retour de l'Iran sur le marché pétrolier et affaiblir la Russie, ce qui n'est pas faux, mais ce n'est pas l'objectif premier.
À la différence d'Al-Qaïda, qui était très dépendante des financements qu'elle recevait d'individus fortunés d'Arabie saoudite ou du Koweït, Daech s'autofinance très largement, notamment grâce à l'exploitation des puits de pétrole et au pillage de la banque centrale de Mossoul. C'est l'organisation terroriste la plus riche de tous les temps. Même si certains riches citoyens du Golfe parviennent certainement à lui transférer des fonds, elle n'a guère besoin de ces ressources annexes.
Il faut garder une chose en tête : Daech est à peu près dans la situation d'un gouvernement qui doit faire un budget pour 10 000 fonctionnaires sur un an, ce qui est assez facile. Il gère une armée de pauvres, qui n'a pas besoin de grand-chose, et se fiche de perdre des hommes. D'autre part, il n'a pas de programme politique et donc pas de comptes à rendre à terme, par exemple en matière de réduction du chômage. Dès lors, il n'a pas besoin de beaucoup de financements.
On connaît aujourd'hui relativement bien les trois sources de financement de Daech. La première est la contrebande pétrolière. Une polémique s'est engagée sur les moyens de la maîtriser. Toutefois, comme pour le trafic de cannabis, il se trouvera toujours un douanier qui laissera passer la marchandise à la frontière : il suffit pour les trafiquants de faire varier le prix.
Deuxième source de financement : la vente et le recel d'antiquités. Le problème s'était déjà posé en Irak après 2003, mais n'a toujours pas fait l'objet d'une attention particulière de la communauté internationale. Les marchés sont en Occident. C'est donc dans nos pays qu'il faut faire le travail.
Troisième source, sur laquelle nous n'avons aucun moyen d'agir : l'ensemble des taxations locales. Les impôts prélevés antérieurement par des régimes autoritaires de type socialiste alimentent désormais directement les caisses de Daech. Une taxe de 5 % sur le pain ne représente pas grand-chose pour l'acheteur, mais permet à un État de tenir.
Je répondrai en deux temps sur la question des droits de l'homme. Premièrement, dans cette région, le niveau de violence est aujourd'hui incommensurable. Cela peut sonner comme une provocation, mais, d'une certaine manière, l'Arabie saoudite et l'Iran sont des enfants de choeur ! Ils ne bombardent pas leur propre population, n'emploient pas l'arme de la faim contre elle. Le dernier dans l'histoire à avoir pratiqué à une telle ampleur la politique de famine que mène aujourd'hui Bachar Al-Assad, c'est Joseph Staline en Ukraine en 1932 ! À Moadamiyeh, aux portes de Damas, 50 000 personnes n'ont pas reçu un seul colis de nourriture depuis environ trente toujours. À cet aune, l'exécution de quarante-sept personnes peut être relativisée. Si respecter les droits de l'homme, c'est de ne pas procéder à des exécutions, mais de laisser mourir de faim toute une population, il y a deux poids, deux mesures.
Deuxièmement, il faut que nous soyons cohérents dans les messages que nous adressons. On déplore ce qui se passe en Arabie saoudite ou en Iran, on dit que M. Poutine ne respecte pas les droits de l'homme, mais on laisse faire M. Al-Sissi sans rien dire, alors qu'il a fait arrêter 40 000 personnes et en a fait exécuter 1 000 autres sur la place publique dans sa capitale. Lorsqu'il a fait arrêter l'intellectuel Ismaïl Iskandarani à l'aéroport d'Hurgada, lequel rentrait de Turquie après avoir délivré des conférences en Allemagne, puis l'a fait condamner, il y a deux jours, à deux semaines d'emprisonnement, aucun pays occidental n'a émis la moindre protestation. Ce faisant, quel message la France, pays des droits de l'homme, fait-elle passer ? Pour la population de la région, il est très clair : notre politique en la matière est à géométrie variable, selon que nous avons signé un contrat ou non. Si c'est cela, la diplomatie des droits de l'homme, mieux vaut en sortir !
Le problème, aujourd'hui, c'est que nous ne sommes plus en mesure de contrôler les répercussions de la politique étrangère dans le champ national : dans nos banlieues, la situation en Syrie est connue. Il y a cinq ans, les trois quarts des Français, quelle que soit leur origine ou leur ascendance, ignoraient où était la Syrie ; aujourd'hui, il y a des gens qui se battent en raison de ce qui s'y passe. Or une personne qui part en Syrie pour y faire de l'humanitaire, à l'image d'un Bernard Kouchner dans les années 1970, peut en revenir transformée et armée jusqu'aux dents. C'est pour cette raison que la question syrienne est centrale, notamment la dimension des droits de l'homme. Il faut réfléchir à la manière dont nous pouvons remédier à cette situation…
Quelle peut être la position de la France entre l'Arabie saoudite et l'Iran ? Il faut passer de l'émotion à la politique, c'est-à-dire proposer un agenda précis. Pour différentes raisons, l'Iran a été systématiquement mis de côté. Aujourd'hui, il est nécessaire de le réintégrer dans le jeu, même si on ne l'aime pas. Chaque État défend ses intérêts de manière égoïste, et c'est normal. Il faut voir en quoi nos intérêts convergent avec ceux des autres États.
Auparavant, la Turquie laissait passer tous les djihadistes vers le théâtre syrien, considérant qu'ils ne représentaient pas une menace pour elle. Récemment, elle a fait une avancée, dont elle a payé le prix hier à Istanbul. Dès lors, elle va nous demander des comptes. Notons que nous n'avons jamais réussi à intégrer la Turquie dans un dispositif.
Dans le camp sunnite, la Turquie et l'Arabie saoudite se rapprochent, avec la présence d'un tiers parti, Israël, dont on connaît les liens avec les États-Unis. Depuis les années 1970, les intérêts de l'Arabie saoudite et d'Israël convergent dans la mesure où ils ont un ennemi commun, l'Iran.
Le rôle de la France, si elle souhaite en avoir un à terme, doit être d'accompagner le retrait américain, qui est significatif, avec une diplomatie qui vise à réintégrer les pays concernés dans le jeu international, ce qui implique de négocier véritablement.
J'ignore si l'exécution des quatre chiites a calmé le jeu à l'intérieur de l'Arabie saoudite. À l'extérieur, elle a été considérée comme relativement anecdotique, sauf en Iran. Lorsqu'un pays est persuadé d'être assiégé, il interprète tout signe extérieur à travers cette grille de lecture – c'est le principe même de la paranoïa, qui a cours aussi dans les relations internationales. Ainsi, pour l'Arabie saoudite, la signature de l'accord nucléaire entre les États-Unis et l'Iran lui prouve qu'elle est mise de côté. Réciproquement, l'Iran analyse nécessairement l'assassinat d'un dignitaire religieux chiite comme un message qui lui est adressé.
Du gaz a été trouvé en Syrie en 2010. En juin 2011, après l'adoption des sanctions internationales, de grands patrons étrangers, y compris français, se sont rendus à Damas à titre exploratoire. Néanmoins, les acteurs sont rationnels et agissent pour défendre leurs intérêts immédiats. Ils n'en sont donc pas à dessiner de grandes politiques. Mais naturellement, à terme, le gaz peut entrer en ligne de compte.
J'ignore si les grandes familles du Hedjaz joueront un rôle politique à l'avenir. Actuellement, elles ont un rôle symbolique fort dans la mesure où elles contrôlent les lieux saints. Elles ont donc une influence « par plaques tectoniques » sur l'ensemble de la région.
Du point de vue des Al-Saoud, il existe trois grands ensembles distincts au sein des voisins sunnites. Le premier est la zone du Golfe. Elle est marquée par une rivalité non pas entre sunnites et chiites, mais entre Arabes et Perses. Celle-ci date moins de la révolution iranienne de 1979 que de la fondation de l'Arabie saoudite, vue par Téhéran comme une tentative d'emprise sur l'autre versant du Golfe. De manière significative, le Golfe reste appelé « persique » d'un côté et « arabo-persique » de l'autre.
On assiste actuellement à des recompositions intéressantes dans cette zone, par exemple à un rapprochement très diffus entre les Émirats arabes unis et certaines composantes du paysage syrien. Ainsi, actuellement, les principaux capitaux investis à la bourse d'Abou Dabi sont syriens.
Du point de vue dynastique, l'Arabie saoudite a réglé sa dette historique à l'égard du Koweït en 1991 en intervenant massivement pour libérer ce pays. Pour mémoire, en 1913, Ibn Saoud, chassé de l'oasis de Riyad, s'était réfugié auprès de la famille régnante au Koweït, laquelle s'était entendue avec les Britanniques pour conserver une certaine indépendance. Aujourd'hui, le Koweït se concentre sur la préservation de ses équilibres internes et s'investit moins à l'extérieur qu'il n'a pu le faire à une certaine époque. À la différence de l'Arabie saoudite, il a connu des menaces internes très sérieuses, avec des attentats contre des mosquées. Il est exposé à un risque de déstabilisation élevé.
Deuxième ensemble : la marge syro-irakienne. Le Liban pourrait représenter une plateforme de négociation à propos de cette zone. Il s'agirait pour l'Arabie saoudite et l'Iran d'avoir une discussion politique pour déterminer à qui revient quoi et de quelle manière.
Troisième ensemble : l'Égypte à elle seule. C'est un pays essentiel pour l'Arabie saoudite, ne serait-ce qu'en raison des hommes entraînés qu'il lui fournit. Lorsqu'il y a une dissonance entre Riyad et Le Caire, le rôle de l'Arabie saoudite s'en trouve nécessairement amoindri dans l'ensemble de la région.
Pour que les dirigeants saoudiens et iraniens sortent de leur vision de citadelle assiégée, il faudra mener une diplomatie à moyen terme, c'est-à-dire sur plusieurs années, car il y a toujours une certaine inertie dans les mentalités. Il faudra aussi tenir compte du fait que l'Iran est tourné non seulement vers le Moyen-Orient stricto sensu, mais aussi et peut-être davantage encore vers le Pakistan et l'Afghanistan.
La séance est levée à onze heures.