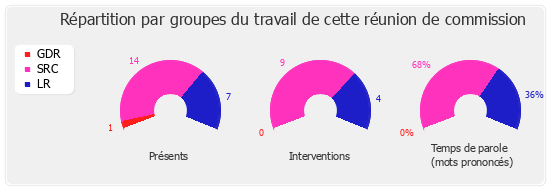Commission des affaires économiques
Réunion du 8 mars 2016 à 17h00
La réunion
La commission des affaires économiques a organisé une table ronde sur la numérisation de l'économie, réunissant Mme Christine Balagué, vice-présidente du groupe de travail du Conseil national du numérique ayant remis le rapport « Travail, emploi, numérique : les nouvelles trajectoires », M. Nicolas Colin, fondateur de « TheFamily » et auteur de « L'âge de la multitude », Mme Anne Perrot, économiste, et M. Philippe Portier, avocat associé chez Jeantet.

Mesdames, messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation qui s'insère dans nos travaux sur l'économie numérique. La semaine dernière, M. Pascal Terrasse a présenté devant notre commission le rapport qu'il a remis au Premier ministre sur l'économie collaborative. Par ailleurs, notre commission a créé une mission d'information sur les objets connectés, dont Mmes Laure de la Raudière et Corinne Erhel sont les corapporteures.
Notre commission des affaires économiques, compétente au fond dans ce domaine, a également été saisie de plusieurs textes de loi touchant de près ou de loin l'économie numérique. Je pense à la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, qui comporte des mesures en faveur de la couverture du territoire, au projet de loi pour une République numérique en cours d'examen, qui a fait l'objet d'une saisine pour avis de notre commission, et à la loi relative à l'économie sociale et solidaire, notre commission ayant créé une mission de contrôle de la mise en application de cette loi.
L'économie collaborative, l' « ubérisation » de l'économie, l'économie numérique, la numérisation de l'économie sont des termes qui effraient parfois. Ils sont mal compris par nos concitoyens et ils font l'objet de définitions diverses. Peut-être pourrez-vous nous éclairer sur ce point, nous dire quels concepts vous placez derrière ces mots et comment on peut concilier l'économie traditionnelle et la transition économique vers de nouveaux modèles sans concurrence déloyale.
Nous avons également débattu, dans le cadre de la loi de finances pour 2016, d'amendements portant sur les plateformes collaboratives comme Airbnb. Ce travail étant peut-être un peu éparpillé, nous souhaitons recentrer nos travaux de façon à avoir une continuité et la possibilité de travailler sur les textes à venir, notamment sur le projet de loi sur les nouvelles protections pour les entreprises et les salariés qui sera présenté prochainement en conseil des ministres, ainsi que sur le projet de loi dit « Sapin II ».
Dans le courant du mois de mars, nous organiserons une autre table ronde orientée sur les métiers de l'artisanat et du bâtiment, et qui réunira notamment des représentants de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) et de la Fédération française du bâtiment, afin de réfléchir à manière de concrétiser la numérisation de l'économie.
les nouvelles trajectoires. Madame la présidente, mesdames, messieurs les députés, je vous remercie de m'avoir conviée à cette table ronde.
Cela fait des années que je travaille sur le sujet du numérique. J'ai cofondé et présidé pendant plusieurs années Renaissance numérique, un think tank citoyen sur la société numérique et l'économie numérique. J'ai été également vice-présidente du Conseil national du numérique pendant trois ans. Nous avons abordé le thème de l'ubérisation dans plusieurs rapports, notamment le rapport Ambition numérique qui avait été demandé par M. Manuel Valls. Ce rapport, que nous avons rendu le 18 juin 2015, comprend une partie sur l'économie collaborative. Nous avons travaillé sur ces questions dans un autre rapport intitulé Neutralité des plateformes. Je précise que toutes ces activités sont bénévoles.
Parallèlement à ces activités, je suis professeure à l'Institut Mines-Télécom et je dirige une chaire de recherche sur les réseaux sociaux. J'ai étendu le champ de cette chaire à ce que j'appelle les nouveaux réseaux d'humains et d'objets, c'est-à-dire le marché des objets connectés. Demain, il n'y aura plus seulement des échanges entre humains sur des plateformes collaboratives mais des échanges entre des humains et des objets. Les recherches que je mène sont soutenues par des partenariats d'entreprise. Enfin, je suis présidente de la commission thématique services de Cap Digital.
Le début du numérique date de 1990 en France, soit de plus d'un quart de siècle. On ne peut donc plus parler de révolution digitale : on doit réguler ce secteur qui devient un secteur économique comme un autre.
On peut regarder cette révolution digitale sous deux angles. La première vision est traditionnelle : c'est celle de la plupart des acteurs qui constatent que de nouvelles technologies sont apparues, des objets nouveaux, des smartphones que tout le monde utilise aujourd'hui, des ordinateurs et un certain nombre de plateformes. On explique cette évolution du numérique par une abondance et un usage massif des technologies. Ces technologies ont donné aux individus une capacité d'agir croissante, ce que les Anglo-saxons appellent l'empowerment.
Cette capacité d'agir peut être décomposée en quatre périodes principales.
Le début des années quatre-vingt-dix voit le démarrage de l'internet et l'apparition des premiers sites web. On a ce que l'on appelle une capacité basée sur la demande, demand-based. L'individu n'est capable que d'aller sur un site web, que de regarder une information, voire passer d'un site à un autre.
À la fin des années quatre-vingt-dix, deux acteurs majeurs apparaissent : Google et Amazon. Ils créent une capacité d'agir pour les individus beaucoup plus importante avec un accès massif à l'information et à une multitude de produits en ce qui concerne Amazon. Cette deuxième phase est appelée information-based. On est dans l'économie de la contribution : les individus sont capables de produire de la donnée, de noter des marques ou des entreprises. Ils sont capables de créer de la réputation, positive ou négative, sur les entreprises.
La fin des années 2000 voit l'arrivée des réseaux sociaux – Facebook est créé en 2004 et Twitter en 2006. Dans cette phase, les individus ont une capacité sur la demande des entreprises, ils sont capables de fournir une information et de se mettre en réseau avec des amis où ils échangent et produisent de l'information.
Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle capacité d'agir basée sur la foule, crowd-based. En plus des trois capacités précédentes, on est capable de se mettre en réseau avec ses amis mais aussi avec des gens qui sont à l'autre bout du monde, que l'on ne connaît pas nécessairement et avec lesquels on va non seulement échanger mais aussi produire. Grâce à ces plateformes, les individus sont capables aujourd'hui de devenir des acteurs économiques. Ils passent du statut de consommateur à celui de producteur. Demain, nous serons reliés à des objets qui changeront notre capacité d'agir.
Les outils qui se sont développés modifient donc la capacité d'agir des individus. On oublie souvent que les citoyens sont capables de faire des choses avec ces technologies, et ils n'hésitent pas à le faire. Ils n'hésitent donc pas à dire qu'ils n'ont pas besoin d'une licence de taxi pour transporter des gens via Uber, ils n'ont pas besoin d'être un acteur du tourisme pour louer leur appartement via Airbnb, et ils n'ont pas besoin d'être un acteur économique pour devenir un acteur du transport via BlaBlaCar. Et si l'on est inscrit sur La Ruche qui dit Oui, on est capable de vendre sa production localement.
Si l'économie collaborative connaît une forte croissance, c'est notamment parce que nous sommes toujours dans une période de crise économique. Le succès de l'économie collaborative, en particulier en France, est lié au fait que les gens essaient de trouver un complément de revenus.
Cette économie collaborative peut être regardée sous l'angle d'une consommation collaborative. C'est ce que l'on appelle l'économie de la fonctionnalité, la vie quotidienne des gens : se loger, se nourrir, se déplacer.
Cette économie collaborative est liée à l'une des caractéristiques du monde numérique qui est un formidable univers d'innovation. La question n'est pas de supprimer ces formes nouvelles. En revanche, elle ne doit pas se faire aux dépens des droits et des libertés de chaque individu.
On s'aperçoit que, dans cette économie, les captations de valeurs sont essentiellement faites par ces plateformes. Airbnb et BlaBlaCar sont devenus des acteurs majeurs. On se retrouve donc avec les mêmes problèmes que l'on a avec Google, Apple, Facebook et Amazon, ces fameux GAFA. L'autre problème que pose l'économie collaborative est celui du statut des travailleurs. Quid du statut des chauffeurs Uber ? Le développement à outrance de l'économie collaborative ne remet-il pas en question notre système de protection sociale ? Ces questions peuvent conduire à de la régulation.
Enfin, on reproduit sur l'économie collaborative ce qui s'est passé avec les GAFA. Le projet de loi pour une République numérique en cours d'examen a déjà ouvert des pistes, puisqu'il prévoit que tout opérateur de plateforme est tenu de délivrer au consommateur une information loyale et transparente en ce qui concerne les conditions générales d'utilisation (CGU), les plateformes étant très peu transparentes vis-à-vis des utilisateurs. J'ajoute que le Conseil national du numérique a remis un rapport sur la neutralité des plateformes, dont une grande partie a trait à la loyauté des plateformes. La loyauté des plateformes d'économie collaborative se pose de la même manière.
Mesdames, messieurs les députés, je suis universitaire, professeure de sciences économiques et spécialisée dans les problèmes de concurrence. Après avoir été vice-présidente, pendant huit ans, de l'Autorité de la concurrence, j'ai rejoint en 2012 un cabinet de conseil en économie qui traite des problèmes de concurrence. Je suis par ailleurs membre du Conseil d'analyse économique, ce qui m'a donné l'occasion de réaliser, avec M. Nicolas Colin, une note sur l'économie numérique.
On peut aborder l'économie numérique de différentes manières, notamment par l'économie du travail. Comme l'a dit à l'instant Mme Christine Balagué, la forme de protection sociale que l'on a envie d'offrir aux acteurs du numérique est la question centrale.
L'économie numérique n'est pas un secteur à réguler, mais il provoque des changements technologiques très importants. Je pense, par exemple, à la télédéclaration des revenus qui ne peut pas se faire sans repenser l'organisation d'un certain nombre d'administrations. De même, le secteur de la santé, y compris dans sa dimension publique, sera affecté par l'économie numérique. Le terme d'ubérisation vise à décrire l'utilisation de l'ensemble des technologies numériques, en particulier dans leur dimension de mobilité. Tous les usages mobiles de l'internet ont permis l'explosion de l'ensemble de ces plateformes, qu'il s'agisse d'Uber, d'Airbnb, etc.
Ce qui est commun à l'ensemble de ces technologies, à ces plateformes, c'est ce que l'on appelle dans le jargon des économistes les effets de réseaux. C'est ce qui permet à des plateformes d'être attractives pour des utilisateurs situés de plusieurs côtés du marché. Par exemple, lorsque vous êtes sur la plateforme Uber et que vous cherchez une voiture, ce qui vous intéresse c'est le très grand nombre de chauffeurs qui sont raccordés à cette plateforme, ce qui vous permettra de trouver une voiture très rapidement. S'il n'y avait que trois chauffeurs, ce ne serait pas très intéressant. Ce mouvement est assez symétrique puisque, de leur côté, ce qui attire les chauffeurs vers la plateforme Uber et qui jusqu'à présent ne leur a pas tellement donné envie d'aller créer une plateforme concurrente – cela arrivera probablement un jour – c'est le fait que nous, consommateurs, sommes attirés vers Uber à cause du jeu de ces effets boule de neige. C'est ce que l'on appelle des effets de réseaux indirects.
Évidemment, les plateformes numériques sont à la base de certains des problèmes de concurrence soulevés par l'ubérisation ou la numérisation d'un certain nombre d'activités. Dès lors que le moteur du fonctionnement de ces plateformes est le grand nombre, l'efficacité des services qu'elles proposent est liée en majeure partie à la grande taille des opérations. Ces plateformes reposent donc sur la qualité de ce que l'on appelle les mécanismes d'appariement. Quand vous allez dans une agence immobilière, vous cherchez un certain type d'appartement avec des caractéristiques précises, et ce qui vous intéresse c'est que vous allez pouvoir y trouver de nombreuses offres qui correspondent à votre demande. Cette grande taille des opérations facilite le matching, c'est-à-dire l'appariement entre une offre et une demande. Comme ces plateformes sont nécessairement de grande taille, elles posent des problèmes de concurrence. Finalement, ce que l'on voudrait, c'est le beurre et l'argent du beurre : on aimerait que les plateformes soient efficaces, qu'elles réunissent tous les attributs qui permettent un bon matching entre les deux faces du marché, mais aussi qu'elles puissent être concurrencées par d'autres plateformes.
Mais il y a une espèce de contradiction dans les termes qui pose des problèmes de régulation concurrentielle, ce qui ne veut pas dire de régulation sectorielle. J'ai été invitée récemment à un colloque d'hôteliers qui m'ont demandé ce que je pensais d'une mesure qui viserait à demander à chaque loueur d'appartement de payer une somme de 5 000 euros pour pouvoir avoir le droit de le louer. Ce n'est pas du tout à ce type de régulation sectorielle que je pense.
La Commission européenne a aujourd'hui les plus grandes difficultés à savoir ce que l'on doit imposer à Google d'un point de vue concurrentiel. On ne peut pas imaginer le développement d'une économie numérique qui reposerait sur ces plateformes de grande taille sans repenser les outils à mettre entre les mains des autorités de concurrence. Par exemple, à l'heure actuelle une autorité de concurrence est tout à fait incapable de dire s'il y a ou non distorsion dans l'ordre où on voit apparaître, à l'issue d'une requête, des réponses sur un moteur de recherche, qu'il s'agisse de Google ou de moteurs de recherche plus spécifiques que l'on appelle les moteurs de recherche verticaux. Par exemple, on ne sait pas dire aujourd'hui si Booking.com déforme les résultats des requêtes, s'il répond au fait que tel ou tel hôtelier a payé plus cher pour être mieux référencé. Ce n'est pas vraiment de la régulation sectorielle, mais plutôt de la régulation concurrentielle et une question de transparence des informations qui sont mises à la disposition des utilisateurs.
Il faut retenir que, reposant sur le développement d'opérations à grande échelle, l'économie numérique a une tendance à la concentration et à la grande taille, ce qui pose des problèmes tout à fait nouveaux. Toutes les plateformes se développent de manière virale, ce qui veut dire que la rapidité avec laquelle les utilisateurs, d'un côté, et les opérateurs, de l'autre, se rattachent à ces plateformes pose des problèmes spécifiques.
Dans la note que j'ai rédigée avec M. Nicolas Colin, nous avons mis en avant les handicaps de la France en matière d'économie numérique. Si notre pays n'est pas très en retard par rapport à ses voisins européens et mondiaux en ce qui concerne la demande puisque les Français sont pour la plupart des internautes, il n'en est pas de même du côté des entreprises puisque moins des deux tiers ont un site internet. De ce point de vue, nous nous situons entre la Grèce et la Pologne ! Tous les pays scandinaves, en particulier la Finlande, mais aussi l'Allemagne et la Grande-Bretagne font bien mieux que nous. Quant à l'État, il a engagé de nombreuses initiatives intéressantes. Mais la pénétration du numérique, tant dans les entreprises qu'au sein de l'État, se heurte très probablement à des intérêts difficiles à bouger. Je pense au secteur de la santé. Il n'est pas certain que les acteurs de la santé soient prêts à participer à l'élaboration de mécanismes plus efficaces, par exemple dans la télémédecine.
On a relevé que l'économie française avait plusieurs handicaps en matière de numérique. Premièrement, la main-d'oeuvre est insuffisamment qualifiée. En la matière, on accuse un réel déficit par rapport à la Finlande ou à l'Allemagne. 2,8 % de l'emploi en France procède des technologies de l'information et de la communication, contre 3,5 % en Allemagne et 6,1 % en Finlande. Deuxièmement, la pression concurrentielle, qui est moindre, est liée à des réglementations sectorielles extrêmement protectrices. Je pense à Uber, mais on pourrait démultiplier les exemples à l'infini. Troisièmement, la structure de financement est peu adaptée au développement des activités numériques.
Bien entendu, l'arrivée des technologies numériques affecte considérablement le fonctionnement du marché du travail. Ces technologies commencent à faire disparaître assez sérieusement les professions intermédiaires pour lesquelles notre modèle social est en grande partie construit. Toutes ces professions intermédiaires sont concernées par la robotisation dans les services. L'arrivée massive des technologies numériques reconfigure le marché du travail autour de deux pôles : d'un côté des métiers très peu qualifiés – tout ce qui nécessite de la présence, comme la garde d'enfants ou de personnes âgées, la livraison de courses faites sur internet –, de l'autre des métiers beaucoup plus créatifs et qualifiés, ceux qui sont impliqués par les startups du numérique.
À côté des problèmes de protection sociale qui ont déjà été évoqués tout à l'heure, se posent des problèmes temporaires et d'autres plus définitifs, plus permanents puisque le numérique incite les consommateurs à profiter de services à la demande. Finalement, quand on va sur Airbnb, on se moque totalement de savoir s'il y a de la permanence dans l'offre. On est très content d'avoir trouvé un appartement dans une capitale européenne, parce que c'est moins cher que l'hôtel et que l'on aura à sa disposition le soir un salon pour discuter avec des amis. On est satisfait de cette prestation un peu au coup par coup qui n'entraîne aucune permanence puisqu'elle ne fait pas appel, en principe, à des professionnels.
Mesdames, messieurs les députés, je vous remercie de m'avoir invité.
J'ai travaillé plusieurs années à l'Inspection générale des finances où j'ai établi des rapports sur l'économie numérique. En 2013, j'ai coécrit, avec le conseiller d'État Pierre Collin, un rapport consacré à la fiscalité de l'économie numérique. De 2010 à 2012, j'ai été directeur d'une entreprise numérique, et depuis 2013 je suis associé fondateur d'une société d'investissement, TheFamily.
Je suis par ailleurs coauteur, avec Mme Anne Perrot, d'une note du Conseil d'analyse économique. J'ai rédigé des rapports administratifs et j'ai coécrit, avec M. Henri Verdier, l'ouvrage L'âge de la multitude. Plus récemment, j'ai rédigé un rapport pour le think tank Terra Nova sur l'économie numérique et son impact sur les institutions économiques et sociales.
On peut diviser l'histoire de l'économie numérique en quatre parties. La première partie commence en 1971, année où est mis au point le premier microprocesseur, ce composant électronique qui est le coeur des ordinateurs personnels. Grâce au microprocesseur, la filière de l'informatique personnelle va se développer pendant vingt ans, ce qui permet à chacun d'avoir un ordinateur sur sa table et un smartphone dans sa poche. Malgré tout, l'informatique personnelle est demeurée balbutiante durant cette période parce que les ordinateurs étaient très peu connectés les uns aux autres. On ne peut pas faire grand-chose avec un ordinateur qui n'est connecté à rien. On peut juste faire de la bureautique et jouer à des jeux vidéo.
Le premier secteur à avoir connecté les ordinateurs entre eux est la finance, dans les années quatre-vingts. Ce n'est pas du tout un hasard si la finance est le premier secteur à s'être globalisé de façon aussi impressionnante en prenant beaucoup d'avance sur les autres secteurs.
La deuxième période de l'histoire de l'économie numérique commence en 1995, avec l'introduction en bourse de l'entreprise Netscape, qui va déclencher une bulle spéculative. Cette bulle spéculative signale l'arrivée à maturité de technologies qui peuvent commencer à être appliquées à très grande échelle pour le grand public. Tout cela naît, bien évidemment, dans le contexte de la mise en place d'internet. Internet, c'est la connexion universelle des ordinateurs les uns aux autres qui offre une telle promesse et une telle opportunité économique que les investisseurs, sans trop savoir ce qu'il en adviendra, veulent tous en être. Quand on investit dans une entreprise qui exploite une nouvelle technologie, on ne sait pas du tout ce que cela va donner. Le seul point de repère, c'est ce que font les autres investisseurs. C'est pour cela que toute nouvelle technologie qui parvient à maturité déclenche systématiquement un phénomène de bulle spéculative. Il y a les bonnes et les mauvaises bulles. La bulle des années quatre-vingt-dix était une bonne bulle parce que, si beaucoup de gens ont perdu de l'argent – mais on ne va pas les plaindre, puisqu'ils en ont regagné depuis –, elle a eu des effets extrêmement positifs puisqu'elle a permis de financer à fonds perdus des actifs extraordinaires qui ne l'auraient jamais été si les investisseurs étaient restés rationnels. Parmi ces actifs qui ont pu être financés par la bulle, citons l'infrastructure d'internet qui a été déployée et surtout les grandes entreprises comme Google et Amazon, qui sont restées en place après l'éclatement de la bulle et ont continué à grandir et à produire leurs effets sur l'économie en la transformant.
La troisième période va de 2000 à 2009. En France, c'est une période de grands malentendus. Quand la bulle a éclaté, beaucoup de gens se sont dit que cette économie leur avait promis monts et merveilles mais qu'ils s'étaient fait avoir. Ils pensaient que l'on reviendrait à la façon traditionnelle de faire des affaires et de créer de la valeur. Beaucoup de gens ont considéré que ce n'était qu'une parenthèse dans l'histoire industrielle et qu'on allait revenir à ce que l'on connaissait déjà, et ils ont refermé le couvercle. Les élites du secteur public et du secteur privé en France se sont désintéressées massivement de cette économie numérique qui s'est mise à stagner et qui n'a continué à se développer que dans une seule région du monde, la Silicon valley.
La Silicon valley nous a fait entrer à toute vitesse dans la quatrième période de l'histoire de l'économie numérique, celle dans laquelle nous sommes. C'est une période de déploiement, c'est-à-dire qu'une nouvelle manière de produire et de consommer a été révélée, rendue possible par les technologies, expérimentée à grande échelle par des entreprises qui ont pris des positions dans des premières filières, dans la publicité, les contenus et les médias. Cette nouvelle manière de produire et de consommer a fini par être mieux comprise. Lorsqu'est survenue la crise économique de 2008, qui a mis toute notre économie à terre, il s'en est suivi une accélération de la conversion de toutes les filières de notre économie à cette nouvelle manière de produire et de consommer qui est le propre de l'économie numérique. Le déploiement, c'est la conversion de tous les secteurs de l'économie, les uns après les autres, de la façon fordiste de produire, c'est-à-dire la production en masse de produits standardisés pour écouler sur des marchés de consommation de masse vers la façon numérique de produire et de consommer avec des applications qui permettent d'avoir accès à des ressources extraordinaires et personnalisées pour les besoins particuliers de chacun.
La rupture est fondamentale. C'est la même rupture que lorsque l'économie fordiste a fait son apparition au début du XXe siècle. Nous avons tous vu Les temps modernes, de Charlie Chaplin, film qui dénonçait cette nouvelle condition ouvrière se développant dans des usines considérées comme aliénantes. Aujourd'hui, beaucoup de Français rêvent d'être ouvrier qualifié dans une usine d'assemblage parce que ce métier n'est plus exercé comme il l'était à l'aube du fordisme, mais il est sécurisé, qualifié, rendu plus productif et bien mieux rémunéré grâce à toutes les institutions mises en place pour rendre l'économie fordiste plus soutenable et permettre de redistribuer de la valeur à tout le monde, aux entreprises, aux ménages, aux plus riches et aux plus pauvres. Cela a donné naissance aux classes moyennes.
Si l'on a ce recul historique, on prend conscience de la rupture qui a lieu aujourd'hui devant nos yeux. Toutes les institutions qui permettent à notre économie de fonctionner ont été mises en place dans l'économie fordiste. La politique de la concurrence a moins d'un siècle et toutes les institutions fiscales ont été instituées au XXe siècle. L'impôt sur le revenu a été instauré en 1914, la protection sociale en 1945, la TVA dans les années cinquante et la CSG dans les années quatre-vingt-dix. Toutes ces mesures ont été mises en place pour épouser les besoins d'une économie fordiste. Si notre économie n'est plus fordiste et qu'elle devient numérique, les institutions seront inadaptées et seront davantage des freins que des manières de sécuriser les entreprises et les ménages. On prend du retard parce que l'on est freiné par ces institutions qui ont été instaurées pour une autre économie qui est en train de disparaître pour être remplacée par l'économie numérique. Voilà le problème de la France aujourd'hui dans l'économie numérique globale.
Notre pays s'est laissé abuser par l'idée selon laquelle l'économie numérique, c'était fini quand la bulle a éclaté. Du coup, il n'a rien fait pendant dix ans, il n'a pas fait grandir des grandes entreprises, tandis que les Américains profitaient de la bulle pour créer Google et Amazon. Personne n'est capable de citer une entreprise française née dans la bulle et qui serait devenue aujourd'hui une grande entreprise. Nous continuons à prendre du retard ; pire nous l'aggravons puisque nous préférons défendre d'anciennes institutions qui ont été créées pour le fordisme plutôt que de chercher à imaginer les nouvelles institutions qui rendraient l'économie numérique plus soutenable et permettraient de redistribuer la valeur qu'elle crée massivement au profit de tous, ménages et entreprises, et de tous les territoires.
Ce retard, cette résistance, cette volonté farouche de défendre les anciennes institutions même si elles sont à bout de souffle et qu'elles ne fonctionnent plus, d'où la crise que l'on connaît depuis les années soixante-dix, ont de bonnes et de mauvaises raisons. La première mauvaise raison, c'est le clientélisme. Nos décideurs, du secteur privé comme du secteur public, et en particulier les parlementaires, sont très familiers des entreprises traditionnelles. Ils les fréquentent bien, ils les connaissent bien, ils les comprennent bien. Par contre, ils sont bien moins familiers de ces entreprises nouvelles, de ces startups que l'on ne comprend pas trop. On préfère défendre ce que l'on connaît même si cela crée des difficultés – c'est ce que les Américains appellent better the devil you know than the devil you don't – plutôt que d'essayer de comprendre les nouveaux problèmes issus des nouvelles entreprises.
La deuxième mauvaise raison, c'est que la France n'a pas fait grandir, jusqu'à BlaBlaCar, de grandes entreprises numériques. Pour nous, l'économie numérique est 100 % américaine. Or comme notre pays a plutôt un fond d'anti-américanisme, il a vite fait de dire que l'économie numérique renvoie aux États-Unis. Dans la bonne vieille tradition gauloise, résister au numérique signifie donc résister aux États-Unis.
Mais il est vrai qu'en l'absence d'institutions adaptées, l'économie numérique échoue à créer de la valeur inclusive, redistribuée au profit de tous. Certes, elle crée de la valeur, mais celle-ci est concentrée au profit de quelques-uns et géographiquement, en l'occurrence dans la Silicon valley.
Nous sommes à un moment qui ressemble beaucoup à ce qu'a écrit Karl Polanyi dans La grande transformation. Il explique que les institutions économiques du XIXe siècle sont devenues inadaptées quand l'économie fordiste a commencé à se développer, ce qui a entraîné la première, puis la seconde guerre mondiale et l'holocauste.
Si l'on extrapole le propos de Karl Polanyi aujourd'hui, on reconnaît une crise latente depuis les années soixante-dix, des conflits terribles, et une crise en 2008 qui ressemble beaucoup à la grande dépression de 1929 qui a mis toute l'économie à terre et a précipité les tensions extrêmes. Aujourd'hui on voit monter dans tous les pays du monde les partis extrémistes, ce qui ressemble beaucoup à la montée du fascisme dans les années trente. C'est une réaction de la société face à une économie qui devient trop dure, insupportable pour les individus parce que les institutions n'existent pas encore pour les protéger et redistribuer la valeur.
Le chantier prioritaire aujourd'hui n'est pas de résister à l'économie numérique en essayant de défendre des institutions qui ne sont plus adaptées, mais d'imaginer à toute vitesse les nouvelles institutions qui permettraient à cette économie de se développer de façon plus harmonieuse et de profiter à tous plutôt qu'à quelques-uns.

Je ne doute pas que vos propos susciteront des réactions. Nous avons organisé cette table ronde pour comprendre, pour accompagner et non pour faire de la résistance.
Je suis avocat chez Jeantet, un cabinet de droit des affaires qui existe depuis 1924 et qui emploie une centaine d'avocats à Paris et une cinquantaine dans cinq bureaux étrangers. Depuis 1924, le cabinet a eu l'occasion d'accompagner les mutations de la société et leurs conséquences sur l'environnement juridique, fiscal et social.
Nous avons développé une activité autour de l'économie collaborative qui nous a conduits à créer un blog sur le sujet. Nous y commentons ce qui peut se passer dans ce domaine. On sent surtout qu'il n'y a pas de généralité possible, en tout cas pas sous l'angle juridique.
On nous a demandés de travailler sur la notion d'ubérisation qui pose d'emblée à un juriste, mais peut-être aussi au législateur, un problème sémantique. Quand on parle de numérisation, on sait qu'il s'agit de l'irruption de la technologie dans des économies qui ne l'avaient peut-être pas anticipée, tandis que le terme « ubérisation » véhicule une connotation différente. Comme l'indique M. Maurice Lévy, le président de Publicis, tout le monde a peur de se réveiller un matin en s'apercevant que l'on se sera fait ubériser.
Quand Uber est arrivé sur le marché français, on a pu voir que son comportement était en rupture avec ce qui existait auparavant. L'ubérisation a véhiculé tout à coup quelque chose qui allait au-delà de ce qu'était Uber en tant que tel pour englober positivement ce qui relevait de l'économie de plateformes, c'est-à-dire la création de communautés réunissant des gens qui se passent d'intermédiaires ou vont travailler ensemble dans différents secteurs.
Il existe une autre acception du terme d'ubérisation qui nuit un peu à la faculté de se projeter dans la conceptualisation de ce que doit être l'encadrement de l'économie collaborative : c'est la problématique sociale. En effet, le modèle social incarné par Uber soulève des questions, comme la précarisation des travailleurs. Uber promeut un modèle d'organisation anti-fordiste. La rupture schumpétérienne qu'entraîne Uber, c'est le remplacement du travailleur salarié dans une logique hiérarchique classique pyramidale avec un lien de subordination par un travailleur réputé indépendant qui, avec un outil de travail donné, va entrer dans une logique de prestataire de service et non plus de salarié. En cela, on en revient au modèle du journalier du XIXe siècle. Je rappelle que le contrat de travail a été créé pour répondre à la demande des entreprises : comme elles devaient investir dans la formation de leurs salariés, elles voulaient s'en assurer une forme d'exclusivité sur une période donnée. Auparavant, on était dans un système de louage d'ouvrage qui se faisait à durée indéterminée et qui pouvait être rompu à tout moment par le travailleur. En réalité, on en revient un peu à ce modèle. Est-ce bien ou non ? Le projet de loi dit « El Khomri » propose de créer un système hybride entre le régime salarié et le régime de l'auto-entrepreneur.
Une fois que l'on sait de quoi l'on parle, il est très ennuyeux de s'enfermer dans quelque chose qui recouvre plusieurs réalités. Il faut être capable d'aller au-delà des mots. De ce point de vue, le rapport Terrasse est intéressant même s'il ne va pas suffisamment loin dans la clarification des thématiques. Deux choses vont cohabiter autour d'un point commun qui contribue peut-être à créer cette ambiguïté. Le point commun, c'est cette technologie de plateformes, d'objets connectés, de smartphones, qui permet aux gens de discuter ensemble, de se partager des informations, voire des services, de l'intelligence, du savoir mais aussi des objets, un logement, du temps... Cette notion de partage, qui véhicule quelque chose de vertueux, est troublée par le fait que ces plateformes sont des acteurs économiques. Le rapport Terrasse prône une forme de neutralité entre les plateformes de nature mutualiste ou coopérative, à but lucratif ou non. C'est un bon point parce que l'émergence d'acteurs français comme BlaBlaCar n'est pas possible si l'on se cantonne à une logique de pure gratuité qui enterrera le sujet aussi rapidement qu'il est né.
Avant de se poser des questions réglementaires, fiscales et sociales, il faut savoir de quels univers on parle. Il faut distinguer les plateformes de nature professionnelle – par exemple Uber qui met en rapport un professionnel et un consommateur en effaçant les codes traditionnels de l'entreprise – de celles qui relèvent du partage, d'une logique non lucrative – par exemple BlaBlaCar.
On parle souvent de BlaBlaCar comme d'un acteur vertueux. Mais il ne faut pas se leurrer. Quand BlaBlaCar a lancé son activité, il était dans l'illégalité totale puisque le code des transports ne permettait pas le covoiturage, fût-ce à des fins non lucratives. En 2013, la Cour de cassation a pris une position assez ambigüe qui a été relayée, et c'est une bonne chose, car on sentait bien qu'il y avait un volet environnemental important. Ce qui a surtout permis à BlaBlaCar de se développer, c'est l'absence de concurrence. À l'époque, son seul concurrent était la SNCF qui n'a pas jugé bon de faire appliquer les règles. En tout cas, avant le vote de la loi « Macron », la concurrence des autocars n'existait pas. Par contre, en Espagne, BlaBlaCar, qui fait le même travail avec 2,5 millions d'utilisateurs, est considéré comme un UberPop. La Confédération espagnole de transport par autobus (Confebus) voit en effet BlaBlaCar comme un concurrent direct.
Il y a donc coexistence de deux univers : d'un côté BlaBlaCar continue de prospérer, de l'autre Airbnb va conduire à une régulation progressive de son secteur d'activité en raison d'une forte concurrence. Jeantet s'est engagé dans cette dynamique en accompagnant des startups en affaires publiques en raison d'une asymétrie en ce qui concerne leurs capacités d'influencer le producteur de normes. Une fédération largement installée pourra faire valoir des arguments qui peinent à trouver la contradiction auprès d'acteurs qui bien souvent ne sont pas préparés à ce genre de conflit. Airbnb est-il vraiment un concurrent de l'hôtellerie ? C'est une question qu'il faut se poser. L'hôtellerie est avant tout une industrie de services où la mise à disposition d'un local est l'un des éléments parmi d'autres, tandis qu'Airbnb se contente de mettre un local à disposition. Au Texas, une étude a montré qu'Airbnb ne faisait concurrence à l'hôtellerie que sur le segment du bas de gamme.
Je pense que l'ubérisation menace toutes les activités. En tant qu'avocat, je me sens concerné. On parle de l'ubérisation des avocats, comme celle de la médecine. Cela veut dire qu'il faut se demander si l'on rend bien le service que l'on doit rendre et si en ne le rendant pas on ne laisse pas la voie à une concurrence d'un genre nouveau. Si Uber est apparu sur le marché, ce n'est pas pour rien. Il en est même d'Airbnb : à Londres, par exemple, il est très difficile de trouver une chambre d'hôtel à un prix raisonnable et de qualité décente.
Il est donc important de savoir distinguer les problématiques du monde professionnel de celles du monde non professionnel. Dans le monde professionnel, il n'y a pas de problèmes de réglementation sectorielle mais un problème social. Le statut d'indépendant est-il le bon ? Cette question fait l'objet de débats ici même. Dans le monde non professionnel, la pratique sociale ne se pose plus puisque le consommateur lambda partage un bien, un temps de travail ou de trajet. Les problèmes sont alors d'ordre fiscal. À cet égard, il est regrettable que le rapport Terrasse renvoie plutôt à une réflexion et qu'il ne promeuve pas véritablement de solution. Il faut rester dans le cadre de la fiscalité française, c'est-à-dire qu'un revenu doit être taxé. Mais en France, un revenu taxé est un revenu net et non brut. Qu'est-ce que l'on entend par revenu de l'économie collaborative dès lors que l'on parle d'une économie de partage ? On considère que BlaBlaCar est un partage de frais. Mais si j'amortis le véhicule, est-on encore dans le partage de frais ? Si je loue ma chambre et que cela me rapporte moins que le montant de mon loyer, suis-je dans un revenu ou dans un partage de frais de loyer ? Je reconnais que le problème n'est pas simple. Il n'y a pas de solution idéale. La retenue à la source ne serait pas constitutionnelle et la taxation forfaitaire serait compliquée.
Un problème fiscal va se poser dans l'univers non professionnel alors qu'il est réglé dans l'univers professionnel.
Enfin, se pose le problème de la responsabilité des plateformes. En la matière, il faut lire attentivement le rapport Terrasse et se référer aux travaux du Conseil national du numérique pour savoir si ces plateformes sont des hébergeurs ou si elles ont une autre responsabilité. Va-t-on libérer cet élan de l'économie saisi par le numérique ? Les frottements sont dans les réglementations sectorielles. BlaBlaCar a eu de la chance, il a pu prospérer non en raison d'une réglementation favorable, mais grâce à une absence de concurrence.
L'équivalent de BlaBlaCar dans le secteur du colis sera également vertueux au plan environnemental, et il ne met pas en danger la sécurité des personnes. La France a décidé de faire appliquer la réglementation du code de transports, c'est-à-dire à partir de zéro tonne de motorisation alors que la directive européenne prévoit 3,5 tonnes. La plupart des pays voisins de la France ont transposé la directive, non à partir d'une cylindrée de 30 cm3, mais de véritables véhicules de transport.
Les professionnels sont soumis à des réglementations. Si les non professionnels ne le sont pas, cela pose un problème de concurrence frontale. Toutefois, on a, d'un côté un monde lucratif et, de l'autre, un secteur non lucratif. Quelle doit être l'attitude de la France en la matière ?
Je prendrai un dernier exemple, celui du coavionnage, qui, s'il a un caractère anecdotique, montre bien le poids que peut avoir le message politique. Pour conserver son brevet, un pilote doit effectuer un certain nombre d'heures de vol par an. Depuis 1982, la réglementation française prévoit qu'il peut transporter des passagers avec lesquels il partage les frais de vol. Le problème, c'est qu'une plateforme lui permet de transporter non plus simplement la famille ou les amis proches mais une population beaucoup plus large. L'Union européenne considère, par un règlement de 2014, qu'il est possible de partager les frais si le pilote ne fait pas de profits. Par contre, la direction générale de l'aviation civile (DGAC) estime qu'il y a danger et recommande aux aéroclubs d'inscrire dans leur règlement intérieur l'interdiction du coavionnage.
En conclusion, la problématique n'est pas globale, elle est avant tout sectorielle. Que laisse-t-on faire à des particuliers, à des non professionnels ? Qui est particulier et qui ne l'est pas ? Faut-il fixer un seuil financier ? Est-ce une question de répétition, d'intention lucrative ou non ? Comment réglementer ces acteurs nouveaux qui, d'une certaine manière, font concurrence aux acteurs installés mais dans une dynamique totalement différente de la tradition concurrentielle économique que l'on connaît ?

Je considère que le numérique est d'abord une opportunité. La question n'est pas de savoir quels secteurs seront affectés par le numérique – on sait maintenant que tous les secteurs sont et seront concernés –, mais celle de l'adaptation des modèles et des compétences.
La semaine dernière, M. Pascal Terrasse a présenté le numérique comme une opportunité mais aussi comme un vecteur de destruction d'emplois, notamment d'emplois intermédiaires. Quel est votre regard sur la formation initiale et sur l'adaptation des compétences ? Avez-vous travaillé sur les nouveaux modèles d'employabilité ? Comment adapter notre système de formation au sens large à ces nouvelles formes d'emplois et ces nouveaux secteurs ?
S'agissant du financement, on le sait la France souffre de faiblesses en phase de post-amorçage et de développement. Quel est votre regard aujourd'hui ? Un certain nombre de dispositifs, notamment la French Tech, ont permis de mettre en valeur des écosystèmes régionaux, mais on remarque que les systèmes de financement sont encore centralisés, c'est-à-dire que l'on n'a pas réussi à franchir ce palier.
Le projet de loi pour une République numérique contient des dispositions relatives à la définition d'une plateforme. Êtes-vous d'accord avec les débats qui ont eu lieu ? Quel est votre regard sur la notation des plateformes ? Êtes-vous favorables à une autorégulation plutôt qu'à une notation ex ante ou ex post ? La régulation des avis des consommateurs vous paraît-elle être une bonne chose ? Le curseur fixé dans le projet de loi pour une République numérique vous paraît-il ou non pertinent ?
Il faut prendre garde à ce que la régulation ne soit pas franco-française dans un univers mondial. Quel est votre regard sur les débats que nous avons eu dernièrement ?

Je remercie les intervenants pour leurs propos à la fois complémentaires et pédagogiques.
Vous avez bien rappelé que les institutions actuelles ont été mises en place dans une économie non numérisée mais également non mondialisée, qu'il s'agisse du droit du travail, des outils fiscaux, de la protection sociale et des réglementations sectorielles. Vous avez rappelé également que les acteurs du net sont extrêmement puissants et que les services qu'ils rendent sont plébiscités par les citoyens.
Comment faire pour favoriser le développement des grands acteurs du numérique en France et permettre que des acteurs français prennent des parts de marchés dans les secteurs d'activité qui ne sont pas encore ubérisés tout en accompagnant la transformation de l'économie traditionnelle en France ? À quel niveau doit se poser le débat ? Si on légifère en France, on risque d'handicaper le développement de son économie numérique. Comment porter ces enjeux et à quel niveau ? Au niveau européen ? Qu'est-ce qui n'est pas fait aujourd'hui et qui pourrait l'être ? Comment peut-on accompagner la transformation des secteurs traditionnels ?
Si, d'un côté, on voit quelle est la violence de l'affrontement entre les voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) et les taxis, d'un autre côté personne n'a envie de supprimer l'offre de services que peuvent apporter les VTC. Si vous étiez ministre de l'économie, quelles dispositions prendriez-vous pour résoudre la guerre qui oppose les VTC et les taxis ? Merci de nous aider concrètement, car c'est ce qui nous est demandé. L'intérêt de cette table ronde, c'est de nous faire des propositions.

Madame Christine Balagué, votre rapport et celui de M. Pascal Terrasse contiennent des propositions communes pour la valorisation de l'acquis de l'expérience (VAE), et nous y reviendrons lors de l'examen du projet de loi dit « El Khomri ». Une réflexion est en cours sur les conditions d'exercice du télétravail. Pensez-vous que des avancées peuvent être facilement mises en oeuvre dans cette future loi ?
Monsieur Nicolas Colin, lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2015, notre collègue Bernadette Laclais a fait adopter des amendements qui visent à instaurer des dispositions fiscales pour mieux répondre aux attentes des structures qui accompagnent les jeunes entreprises, les business angels. Pensez-vous que ces mesures peuvent permettre des retombées favorables ? Hier encore, j'étais avec des investisseurs qui s'interrogent sur l'investissement dans les startups, compte tenu de la frilosité des banques. Faut-il encore apporter des améliorations, afin d'être mieux à même d'aider le financement de ces startups ?

Il a été évoqué un retard français en matière d'économie numérique, or il me semble que ce retard ne touche pas seulement notre pays, mais l'ensemble de l'Europe, qui doit s'interroger sur cette problématique.
M. Philippe Portier a dit qu'Airbnb ne faisait concurrence à l'hôtellerie que sur le segment du bas de gamme, mais je pense que cela n'est plus tout à fait vrai : on trouve aujourd'hui par l'intermédiaire de ce site des chambres très proches de l'hôtellerie haut de gamme, et le premier marché étranger pour Airbnb est le marché français, en particulier le marché parisien. Alors que notre pays tarde à adapter ses dispositifs fiscaux à cette nouvelle réalité, d'autres pays ont d'ores et déjà réagi : Amsterdam applique une taxe d'un taux de 5 % du prix du logement, la Floride de 6 %, San Francisco, où se situe le siège social d'Airbnb, de 14 % et l'Inde, de 14,5 % – le principe étant qu'Airbnb collecte ces sommes pour les reverser aux collectivités locales concernées. M. Philippe Portier a dit qu'un tel dispositif posait un problème de constitutionnalité : pour ma part c'est la première fois que j'entends cet argument et j'ai plutôt tendance à penser que Bercy est, comme c'est souvent le cas, en retard par rapport à l'évolution de l'environnement économique.

En 2017, un utilisateur de smartphone sur deux auras installées une application santé ou de bien-être, par exemple pour mesurer la qualité de son sommeil ou analyser ses performances physiques. Situées à la frontière du bien-être et de la santé, les entreprises proposant ces applications ne sont pas soumises à la réglementation renforcée propre aux données de santé. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) s'interroge aujourd'hui sur la manière d'accompagner le développement de ce marché, tout en préservant la vie privée des utilisateurs. Pouvez-vous nous faire connaître votre avis sur ce point ?
Par ailleurs, je souhaite aborder le débat de la fiscalité de l'e-commerce, dont les enjeux sont importants. Contrairement aux magasins physiques, les sites de vente en ligne sont très peu taxés – ainsi, ils ne sont pas soumis à la taxe sur les surfaces commerciales. Cette situation renforce la place de l'e-commerce et menace le commerce de proximité, en particulier dans les territoires ruraux. Face à ce déséquilibre fiscal, j'aimerais que vous nous indiquiez vos pistes de réflexion.

On estime que la révolution numérique va détruire quelque trois millions d'emplois dans des métiers divers au cours des dix prochaines années. En revanche, de nombreuses autres activités vont être créées par la robotique et le numérique, étant précisé que 60 % des métiers de l'avenir n'ont pas encore été inventés – cela rejoint la théorie de la destruction créatrice de l'économiste autrichien Joseph Schumpeter. Toute la question est de savoir si la disparition de métiers actuels et leur remplacement par d'autres pourront engendrer une nouvelle croissance économique. Comme Mme Corinne Erhel, je me demande si l'enseignement supérieur dispensé en France anticipe suffisamment la révolution numérique pour préparer dans les meilleures conditions aux métiers de demain. Dans la négative, comment pourrions-nous anticiper l'arrivée des générations futures sur le marché du travail ?

Ma question porte sur le rapport rendu par le Conseil national du numérique en janvier dernier, sur le thème « Travail, emploi, numérique : les nouvelles trajectoires ». Le développement de l'économie collaborative crée parfois des situations de dépendance des travailleurs à certaines plateformes, en termes de revenus ou de conditions de travail, en dépit de leur statut d'indépendants. Ces travailleurs ni salariés, ni véritablement indépendants sont doublement privés de protection. N'étant pas indépendants, ils ne bénéficient pas non plus de la protection économique que procure la multiplicité des donneurs d'ordres. L'avocat qu'est M. Philippe Portier pourrait-il nous indiquer quelle protection sociale pourrait être imaginée pour les personnes concernées afin d'éviter que ne se forment de véritables armées de travailleurs largement précarisés ?

J'aimerais connaître votre avis sur le statut intermédiaire de travailleur économiquement dépendant qui a été instauré en Espagne, ainsi que sur le rôle de l'État en la matière – j'estime pour ma part qu'il doit se limiter à rendre la compétition équitable en posant des balises plutôt que des digues de sable, et être soucieux avant tout d'harmonisation et d'attractivité fiscale.

J'ai tendance à penser, comme M. Nicolas Colin, qu'il n'est plus temps de voir une nouveauté dans ce que l'on appelle la révolution numérique, et de nous camper dans des postures d'indignation. Tous les jours, le big data trouve de nouvelles applications – je pense par exemple à la possibilité de souscrire un prêt par simple consultation numérique –, et nous devons nous adapter rapidement à ces évolutions. Selon vous, quelles orientations majeures la France et l'Europe devaient-elles prendre, et quels pays vous semblent actuellement les mieux adaptés à l'économie numérique, tant en ce qui concerne les institutions que l'acceptation sociale ?

Si la croissance exponentielle des échanges dématérialisés sur internet crée indéniablement de la richesse et de la valeur, elle entraîne aussi une destruction d'emplois et une certaine précarisation, notamment en ce qui concerne les métiers intermédiaires, souvent peu qualifiés – on estime ainsi que trois à quatre millions d'emplois pourraient être détruits d'ici à 2025. Doit-on redouter que l'économie numérique ne détruise plus d'emplois qu'elle n'en créera ? En une période de transformation majeure de l'économie, comment organiser la protection des nouveaux travailleurs – ce qui soulève la question du statut à créer ou à aménager ? Comment accompagner les travailleurs dont les emplois ont été détruits vers une reconversion professionnelle ? Enfin, en ce qui concerne le développement du télétravail, n'est-il pas à craindre que celui-ci ne se traduise par un isolement du salarié ? De ce point de vue, d'autres États nous fournissent-ils des exemples de ce qui doit être fait ou évité ?

Comme Mme Laure de La Raudière, je m'interroge sur ce que nous pourrions faire pour essayer de résoudre les difficultés des acteurs de l'économie numérique : selon vous, est-il envisageable d'imaginer pour cela une sorte de commande publique ayant vocation à répondre à des besoins sociaux et citoyens qui restent aujourd'hui insatisfaits ? En matière de logement, Airbnb ne fait peut-être pas de concurrence à l'hôtellerie classique – la question reste posée –, mais cette formule a pour conséquence de soustraire des logements pérennes au marché de l'immobilier, donc d'accroître la tension sur un marché où la demande est constamment supérieure à l'offre. Existe-t-il un « barbare de l'immobilier » qui, sous la forme d'une commande publique ou d'un accompagnement, serait susceptible de se mettre au service de l'intérêt général en répondant à une vraie demande de nos concitoyens ?

Pour l'élue que je suis, les interventions que nous avons entendues étaient aussi intéressantes qu'inquiétantes. Il a été dit que les institutions actuelles, notamment l'Autorité de la concurrence, étant inadaptées, de nombreuses professions intermédiaires allaient disparaître, ce qui risque de se traduire par l'accroîssement des inégalités, avec d'importantes conséquences sociales. Pour éviter cela et revenir à l'équilibre économique et social pour le plus grand nombre, il nous faut donc imaginer de nouvelles institutions sans trop tarder. À votre avis, combien d'années seront nécessaires pour le faire ?

La numérisation de l'économie entraîne une évolution exponentielle de notre société. Or, on parle beaucoup de l'économie, mais peu des hommes qui la font vivre. Vous êtes-vous demandé si la numérisation de l'économie était source de bien-être ou si elle risquait, au contraire, de détériorer la qualité de vie de nos concitoyens et de freiner leur épanouissement ?
L'intérêt que vous témoignez pour les questions de l'économie numérique constitue une heureuse surprise pour moi : ayant régulièrement l'occasion de participer à des réunions et des tables rondes sur ce thème avec des députés et des sénateurs, j'ai plutôt l'habitude de constater que ces questions ne suscitent qu'un intérêt très limité chez les parlementaires – même si cela a tendance à changer.
C'est vrai, et j'espère que le nombre de parlementaires intéressés continuera de croître dans les années qui viennent, car l'économie numérique est un sujet très important pour la société.
Mme Corinne Erhel a évoqué les questions relatives au travail et à la formation. Dans le cadre du rapport du Conseil national du numérique (CNNum), nous avons beaucoup réfléchi à ces questions, en nous demandant notamment en quoi le numérique pouvait induire de nouvelles formes de travail. Nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle le contrat de travail tel qu'il est actuellement conçu va devoir évoluer pour tenir compte de la possibilité de produire via l'économie collaborative : les gens pourront tout à la fois avoir une activité salariée et tirer d'autres revenus d'une activité exercée dans le cadre d'Uber ou d'Airbnb. Certains affirment même que nous sommes tous appelés à devenir des intermittents qui, par exemple, seront salariés le matin et travailleront selon d'autres modalités l'après-midi.
Pour ce qui est de la formation, il est évident que 50 % de l'enseignement dispensé aux étudiants du supérieur n'existera plus dans quelques années : tout le monde sera obligé de suivre une formation tout au long de sa vie, quel que soit son métier. Dans le cadre de ses travaux, le CNNum a constaté que l'offre de formation relative au digital était actuellement très pauvre : un gros effort de régulation doit être accompli en termes de qualité et de labellisation des formations disponibles. Nous avons également travaillé sur la question de la valorisation des acquis de l'expérience dans le cadre du compte personnel d'activité (CPA). L'évolution des métiers va rendre nécessaire la formation tout au long de la vie, selon diverses modalités – au sein d'organismes de formation, mais aussi au moyen de massive open online courses (MOOC, en français « cours en ligne ouvert et massif »). Toutes ces formations doivent être intégrées aux acquis contenus dans le CPA afin de nous suivre tout au long de notre vie.
Il est un autre point qui me tient beaucoup à coeur, et sur lequel j'aimerais que nous avancions, celui de la régulation des plateformes au sens large : non seulement les GAFA – Google, Apple, Facebook, Amazon –, mais aussi l'économie collaborative et les avis des consommateurs. Au sein du CNNum, j'ai beaucoup plaidé pour l'idée consistant à instaurer une ou plusieurs agences de notation ayant vocation à noter divers éléments, notamment la loyauté des plateformes et celle des algorithmes. Lorsqu'on est sur internet, on se voit sans cesse soumettre des recommandations basées sur des algorithmes : or, ces algorithmes sont alimentés par des données issues du big data, obtenues de manière illégale et permettant à certaines entreprises d'obtenir un meilleur référencement. L'agence de notation qui pourrait être créée, d'abord au niveau français puis, très vite, au niveau européen, serait sans nul doute très efficace puisque l'économie numérique repose en grande partie sur des phénomènes de réputation. De mon point de vue – qui, je le précise, n'était pas celui de tous les membres du CNNum –, cette agence de notation ne devrait pas être de nature étatique, mais s'appuyer sur la multitude des internautes. Elle ferait de la rétro-ingénierie d'algorithmes, afin de vérifier que les entreprises fournissent bien le service qu'elles proposent.
Mme Laure de La Raudière a demandé ce qui pouvait être fait pour favoriser le développement des grands acteurs du numérique – un sujet sur lequel nous sommes nombreux à travailler depuis des années. Des réflexions ont déjà été menées à ce sujet à l'échelle européenne, notamment avec l'Allemagne, et nous avons fait en sorte d'encourager la création de l'équivalent du Conseil national du numérique dans d'autres pays, afin qu'une réflexion globale puisse être menée.
Quoi qu'en disent certains, la première phase du numérique est dominée par les acteurs américains. Cela dit, nous sommes entrés dans une deuxième phase, celle du big data et des objets connectés, qui constitue un marché au sein duquel la France et l'Europe ont toute leur place. Le CNNum fait valoir l'idée, que je soutiens, selon laquelle les acteurs européens qui sortiront vainqueurs de la prochaine révolution numérique seront des acteurs plus éthiques, qui défendront davantage la protection des données personnelles, par exemple. Il me semble donc intéressant que des sociétés françaises tentent d'ores et déjà de se positionner sur le marché en recourant à des modèles basés sur les valeurs que je viens d'évoquer. Seb, une société française très innovante et aujourd'hui leader sur le marché mondial, mène actuellement une réflexion approfondie portant sur la rénovation complète du domaine de la cuisine en association avec les concepts de révolution numérique et d'objets connectés. Open Food System, un gros projet financé par le programme d'investissements d'avenir (PIA), et regroupant autour de Seb vingt-cinq partenaires comprenant des laboratoires, des startups et des grands groupes, vise à créer un écosystème de référence basé sur le concept de « cuisine numérique ». C'est ainsi qu'il faut procéder : non pas individuellement, mais en faisant en sorte de mobiliser un grand nombre d'acteurs du secteur concerné sur des projets d'envergure.
Le secteur de la santé, qui a également été évoqué, est très propice à l'innovation : l'économie numérique peut jouer un rôle majeur dans la médecine du futur, notamment en France. Cependant, l'évolution de ce secteur est actuellement bloquée par un élément légal, l'interdiction faite aux startups de procéder à des tests préalables à la mise en oeuvre d'une innovation dans le domaine de la santé : avant de pouvoir développer une application, il faut être en mesure de prouver qu'elle fonctionnera correctement. D'un point de vue législatif, il serait donc souhaitable d'évoluer en permettant aux startups de mener des expérimentations ex ante auprès de patients.
M. Jean-Pierre Le Roch a évoqué la question des applications dédiées à la santé et au bien-être. Travaillant beaucoup sur ce sujet du fait de mon intérêt pour l'internet des objets, je suis intervenue très récemment auprès du Conseil national de l'ordre des médecins sur la question de la gouvernance en matière d'e-santé. Cette question étant aujourd'hui ignorée par les institutions, d'autres acteurs vont s'en emparer et cela commence déjà à être le cas, avec la constitution d'importantes communautés de patients. Cependant, il y a un danger à laisser le secteur se réguler seul, celui de voir se produire des évolutions qui ne sont pas forcément celles que l'on souhaite, c'est pourquoi nous devons impérativement nous emparer de la gouvernance de l'e-santé.
Enfin, sur la question de l'enseignement supérieur, il convient de souligner que s'il existe en France des modules consacrés aux nouveaux métiers du digital, ils sont encore en nombre insuffisant. Il convient donc de les développer, ce qui est en train de se faire dans le cadre d'une très large transformation de l'enseignement supérieur effectuée autour de ces nouveaux enseignements : dans toutes les grandes écoles et les universités, des réflexions sont actuellement menées en ce sens.
Je conclurai en rappelant que le CNNum a été saisi par M. Thierry Mandon, secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur, sur la transformation numérique de l'enseignement supérieur. J'ai travaillé sur cette question lors des derniers mois de mon mandat, et le rapport rédigé par le CNNum sera rendu dans les prochaines semaines.
Plusieurs questions ont porté sur le marché du travail, ce qui semble légitime, car c'est bien dans ce domaine que les effets du numérique se font ressentir en priorité. Il est intéressant de se pencher sur la carte faisant apparaître le lieu de résidence des chauffeurs d'Uber en Île-de-France, en la comparant à celle du chômage. Cette analyse cartographique effectuée à un niveau très précis, celui de l'IRIS – un découpage infracommunal de l'INSEE – permet de constater que les deux cartes se superposent presque parfaitement, et que la quasi-totalité des chauffeurs Uber habitent en Seine-Saint-Denis, dans les communes et même dans les quartiers les plus affectés par le chômage. On déplore souvent, à juste titre, que les nouveaux métiers que font apparaître les diverses formes d'ubérisation aboutissent à la création d'emplois précaires, mais l'expérience que je viens de décrire montre que ces nouveaux emplois, notamment ceux de chauffeurs de VTC, ne sont pas créés en lieu et place de contrats à durée indéterminée (CDI) qualifiés et bien payés : c'est au chômage qu'ils constituent une alternative !
À mon sens, la même analyse pourrait être appliquée à beaucoup d'autres sources de revenus associées à l'activité de plateforme et donnerait des résultats similaires. Il ne faut pas pour autant s'arrêter à ce constat, car les effets de l'ubérisation ne sont pas tous positifs. Pour ce qui est du marché de l'immobilier, des études sont actuellement menées afin de déterminer l'impact sur les loyers de l'arrivée massive d'Airbnb : il en ressort très clairement que les loyers augmentent du fait de l'emprise croissante de la plateforme sur certaines zones, un effet qui se propage d'ailleurs de quartier en quartier, car les personnes ne trouvant plus à se loger à l'endroit où ils habitaient précédemment sont repoussées un peu plus loin – ce phénomène est particulièrement marqué dans les zones touristiques.
Pour contrer la destruction d'emplois liée au numérique, il ne faut surtout pas essayer de repousser les métiers qui y sont liés. Au cours des décennies passées, on a souvent cherché, lorsque des emplois étaient menacés par la délocalisation, à les maintenir à toute force : c'était une erreur qu'il faut éviter de commettre à nouveau. Ce ne sont pas les emplois – de toute façon destinés à disparaître – qu'il faut chercher à sécuriser, mais les personnes. Cette réflexion nous amène naturellement à évoquer le conflit opposant les taxis aux VTC, un problème qui se pose depuis des années et n'est toujours pas réglé en France – alors qu'en Italie, par exemple, le Gouvernement de M. Romano Prodi s'en est emparé.
La première réponse – un peu brutale – à ce problème consiste à dire que le montant de la licence de taxi, certes élevé, a été compensé au cours de la durée d'activité des taxis par des prix de monopole : le fait que le secteur soit très régulé et que peu de licences soient délivrées a permis aux taxis d'échapper à toute forme de concurrence, que ce soit entre compagnies ou entre chauffeurs au sein d'une compagnie. En d'autres termes, si Uber s'est implanté sur le marché, c'est parce que les taxis ont mené une politique malthusienne durant des décennies – là encore, la cartographie nous est d'un enseignement précieux, en ce qu'elle nous montre que c'est dans les zones où les taxis ont été le plus régulés qu'Uber marche le mieux aujourd'hui.
La deuxième réponse est basée sur le constat que les taxis se sont livrés à un calcul économique rationnel en comptant sur la revente de leur licence sur le marché secondaire pour payer leur retraite, et se trouvent brutalement privés, en raison d'un changement des conditions réglementaires, d'une ressource sur laquelle ils comptaient – le prix des licences s'effondrant un peu plus chaque jour. Dans cette optique, il ne reste plus qu'à puiser dans la poche du contribuable afin de dédommager les chauffeurs de taxi de la perte qu'ils subissent. Si cette solution semble de nature à régler politiquement, de manière rapide et efficace, le conflit entre les taxis et les VTC, elle n'est pas sans inconvénient : dans le contexte actuel, la poche du contribuable est de moins en moins profonde. Elle permettrait cependant le développement d'Uber et de ses concurrents – que j'espère voir arriver, car je crois aux vertus de la concurrence.
Pour ce qui est du marché du travail, l'une des recommandations faites par le Conseil d'analyse économique – partiellement reprise par le projet de loi pour une République numérique – consiste à faire en sorte que les notations sur les chauffeurs d'Uber, sur les logements Airbnb et, plus généralement, sur les hôtels et restaurants, puissent être certifiées afin de servir de référence à des personnes ne disposant pas de qualifications classiques. Ainsi un chauffeur d'Uber, qui n'a pas passé les examens pour devenir chauffeur de taxi et est donc certainement beaucoup moins qualifié – on n'a jamais exigé de lui, par exemple, qu'il apprenne par coeur le plan des rues de la commune dans laquelle il transporte des personnes – pourra-t-il se prévaloir d'une bonne notation attribuée par les utilisateurs sur des critères tels que la ponctualité, l'amabilité ou la capacité à conduire les clients à destination sans se tromper. Un tel système peut aider à faire tomber les barrières sur le marché du travail, notamment dans l'hypothèse où une personne voudrait cesser d'être chauffeur pour Uber pour tenter sa chance ailleurs, car les qualités mises en valeur par la notation sont valorisées dans le monde professionnel, mais peuvent également se révéler utiles quand il s'agit d'aller trouver son banquier pour obtenir un crédit. Le nouveau marché du travail qu'ouvrent les professions du numérique pourrait donc également permettre des voies d'accès à l'emploi différentes de celles des anciennes professions, plutôt valorisées par un système de qualification et d'examens professionnels.
De plus en plus de formations sont proposées dans le domaine des data sciences. Ainsi, à l'École nationale de la statistique et de l'administration économique (ENSAE), où j'enseigne, il existe une voie aboutissant à la délivrance d'un certificat de data scientist, reposant sur des compétences statistiques et économétriques et attirant un très grand nombre d'étudiants. À cet égard, il est frappant de constater que la voie de formation dans le domaine des finances de l'ENSAE, dans laquelle tout le monde s'engouffrait il y a quelques années, est aujourd'hui complètement délaissée au profit de la voie des data sciences, empruntée par ceux qui se destinent au big data. Cela dit, la France accuse encore un déficit très important en matière de formations destinées aux spécialistes du code.
Enfin, une question importante va se poser au sujet des données de santé, consistant à savoir ce que nous devons autoriser les assurances à en faire. Les assurances sont en effet assises sur un véritable trésor de données personnelles de nature à permettre, à partir de l'analyse des parcours de santé des individus, d'obtenir une masse considérable de renseignements qui pourraient être très valorisés par la collectivité, notamment en matière prédictive. Parallèlement, plus ces données personnelles se multiplient, plus les assurances qui les possèdent peuvent en tenir compte pour modeler leurs contrats, le cas échéant en discriminant les individus, donc les clients, avec une extrême finesse. Même si certaines pratiques sont aujourd'hui interdites, la tentation est grande pour les assurances, ce qui rend urgente la nécessité de réfléchir à cette question.
Plusieurs d'entre vous se sont interrogés sur ce qu'allait être l'incidence sur l'emploi de la disparition d'un certain nombre de métiers, et l'incertitude dans laquelle on se trouve aujourd'hui sur la capacité de l'économie numérique à créer suffisamment d'emplois pour compenser ceux qu'elle détruit. Pour répondre à cette question, nous devons d'abord essayer de définir ce que seront les emplois de l'économie numérique, et quels sont les obstacles qui, aujourd'hui déjà, freinent leur création.
L'idée reçue selon laquelle les emplois de l'économie numérique seraient beaucoup plus qualifiés que ceux de l'ancienne économie a prévalu durant toutes les années 1990 et une partie des années 2000, justifiant le discours sur la formation tout au long de la vie et l'idée selon laquelle il fallait retourner à l'école pour augmenter encore la qualification que l'on possédait déjà. En vertu de ce discours, plusieurs générations d'étudiants se sont lancées dans des études toujours plus longues, ce qui a souvent suscité de cruelles désillusions au moment de découvrir que ces études et les très hautes qualifications obtenues ne permettaient pas d'obtenir un emploi sur le marché du travail. En réalité, l'économie numérique provoque plutôt une déqualification de la main-d'oeuvre : grâce aux technologies numériques et aux outils qu'elles permettent de mettre au point, on peut aujourd'hui rendre le même niveau de qualité de service, voire un niveau supérieur, en étant beaucoup moins qualifié : la technologie vient en effet se substituer à la qualification.
De ce point de vue, les chauffeurs d'Uber évoqués par Mme Anne Perrot constituent un très bon exemple. Ils peuvent en effet conduire leurs clients à bon port sans connaître par coeur toutes les rues de la ville et ils sont en mesure de s'assurer un revenu stable sans savoir devant quel grand hôtel ou quel aéroport et à quelle heure ils doivent se tenir pour trouver des courses intéressantes : tous ces renseignements leur sont fournis par la technologie, ce qui permet à un grand nombre de personnes de s'improviser chauffeurs – et de fournir un niveau de service suffisant – sans connaître le plan de la ville et sans connaître les astuces, tirées de l'expérience, auxquelles ont recours les chauffeurs de taxi.
Les emplois de demain sont tout à fait cohérents avec une vision polarisée du marché du travail : il y aura, d'une part, des emplois très qualifiés et très créatifs dans la finance, dans le design, dans le développement de logiciels ou l'ingénierie et, d'autre part, les emplois destinés aux personnes qui compensent leur faible niveau de qualification par l'utilisation d'outils numériques, grâce auxquels ils sont en mesure de rendre des services d'une qualité exceptionnelle à très grande échelle – ce qui leur permet de prétendre à un niveau de revenus supérieur à celui obtenu aujourd'hui par les personnes peu qualifiées : ils seront payés comme des classes moyennes, c'est-à-dire en tenant compte du niveau de qualité et de productivité du service rendu. Les classes moyennes ne naissent pas par miracle : elles émergent parce que l'on met en place les institutions destinées à accompagner la main-d'oeuvre peu qualifiée vers une plus grande productivité et une meilleure qualité, grâce à la technologie.
Quels sont les obstacles freinant la création d'emplois dans l'économie numérique ? Le premier est constitué par les réglementations sectorielles : aujourd'hui, pour exercer une profession, vous êtes obligé d'avoir une qualification ou d'immobiliser un actif tel qu'une licence de taxi. La technologie vous permettrait de rendre le même niveau de service sans disposer de la qualification, mais la loi l'interdit, ce qui fait que les emplois correspondants ne sont pas créés. Aujourd'hui, Uber tient le discours selon lequel une importante demande n'est pas satisfaite, et affirme que des emplois de chauffeurs pourraient être créés massivement si l'on n'obligeait pas les chauffeurs de VTC à être aussi qualifiés que les chauffeurs de taxi – ce qui n'est pas justifié, car le recours aux outils technologiques fait que cette qualification n'est plus nécessaire.
Le deuxième obstacle, celui du marché immobilier, n'a rien de nouveau : cela fait longtemps que les Français ont du mal à se loger. L'économie numérique, qui va redéployer la main-d'oeuvre non qualifiée des usines de l'ancienne économie fordiste vers les services à la personne, va aussi concentrer les gens dans les villes – car travailler dans le secteur des services à la personne nécessite d'être à proximité des personnes dont on veut s'occuper : il faut donc habiter en ville, là où sont les clients, à savoir les personnes âgées dépendantes, les enfants à garder ou les personnes souhaitant se faire livrer leurs courses à domicile. Or, les grandes villes sont extrêmement difficiles d'accès en termes de logement : selon les économistes, cela empêche la création d'un grand nombre d'emplois non qualifiés. Une demande importante restant non satisfaite, on a également recours à une main-d'oeuvre employée au noir et souvent mal payée, ou à des robots – ce qui ne suffit pas à satisfaire la demande.
Face à cette situation, il est nécessaire de revoir les réglementations sectorielles et de régler le problème du marché immobilier, ce qui n'est pas une mince affaire. L'année dernière, nous avons organisé, dans le cadre de TheFamily, un cycle de conférences intitulé : « Les barbares attaquent les politiques publiques ». Ceux que nous appelons les barbares, ce sont les entrepreneurs de l'économie numérique, qui font irruption dans une économie en ne se comportant pas du tout comme les autres, ce qui fait qu'on ne les comprend pas : cette terminologie fait référence à ceux que l'on appelait barbares dans l'Antiquité, à savoir les gens qui ne parlaient pas la même langue que les sujets de l'empire romain. Ce cycle de conférences visait à faire comprendre aux décideurs que les politiques publiques à bout de souffle ne font que dégrader la qualité du service tout en augmentant le niveau des prélèvements, ce qui provoque un mécontentement de nos concitoyens, qui se ressent dans leur comportement électoral. Pour renverser cette dynamique délétère, il faudrait selon nous rendre les services publics plus performants et moins chers, en recourant aux technologies numériques et aux nouveaux modèles d'affaires de l'économie numérique. Dans ce domaine, des entrepreneurs montrent la voie à suivre, en apportant la preuve qu'il est possible de servir plus de monde à un niveau de qualité supérieur, de façon soutenable et à très grande échelle : il s'agit notamment d'Uber et d'Airbnb, sur ces tout petits segments que sont le transport de personnes en voiture et l'hébergement.
Pour ce qui est du marché du logement et de ce qu'il pourrait être demain, j'ai deux anecdotes relatives à Airbnb qui pourraient vous éclairer. Je me suis laissé dire qu'à Dijon, certains étudiants se logeaient à l'année via Airbnb, cette formule convenant parfaitement à leurs besoins : d'une part, cela les dispense de présenter un énorme dossier comprenant la caution d'un tiers pour accéder à une location, d'autre part, ils peuvent quitter leur logement du jour au lendemain s'ils le souhaitent. Le propriétaire y trouve également son compte, puisque les occupants entrent dans les lieux en ayant payé d'avance, et peuvent être mis à la porte sans formalités quand ils cessent de payer.
La deuxième anecdote m'a été rapportée par une personne qui a utilisé la plateforme Lyft – un concurrent d'Uber aux États-Unis. Lors d'un trajet effectué dans la Silicon Valley, son chauffeur lui a expliqué qu'il habitait plusieurs centaines de kilomètres plus au sud, et qu'il ne venait dans la Silicon Valley que trois ou quatre jours par semaine, durant lesquels il effectuait des courses pour faire le plein d'argent, avant d'aller retrouver sa famille ; durant le temps passé dans la Silicon Valley, il se logeait sur Airbnb, ce qui constitue un exemple intéressant de deux économies collaboratives s'appuyant l'une sur l'autre. Cela montre ce que pourrait être notre vie professionnelle demain, dans un marché immobilier tendu : nous pourrions, tels des marins qui partent en mer, passer quelques jours par semaine dans la ville où nous travaillons avant de retrouver notre domicile.
M. Yves Daniel nous a demandé si, au-delà de la création de valeur, l'économie numérique améliorait le bien-être des gens. Il ne faut pas perdre de vue que la plupart des entrepreneurs de l'économie numérique sont habitués à résoudre des problèmes pour améliorer la vie quotidienne des utilisateurs : c'est parce que leur chemin de développement le leur impose qu'ils sont amenés à proposer des services de meilleure qualité pour beaucoup moins cher. Cela implique une amélioration notable en termes de bien-être, et on ne peut comprendre le succès d'Amazon ou d'Uber si on ne réalise pas que ces offres consistent à offrir au plus grand nombre ce qui était auparavant réservé à quelques-uns. Uber n'est rien d'autre qu'un service de chauffeurs de maître facturé beaucoup moins cher que les traditionnelles voitures de grande remise – seuls les privilégiés, habitués de longue date à être transportés par des chauffeurs dans de belles voitures noires ne voient pas ce qu'apporte Uber.
L'autre élément de bien-être est à rechercher du point de vue des pouvoirs publics. Si l'on déteste les nouveaux problèmes, on s'est peut-être un peu trop habitué à ceux qui sont là depuis si longtemps qu'on ne les voit plus. Par rapport aux taxis, les VTC présentent l'avantage de faire l'économie des transactions en liquide – qui permettent aux professionnels concernés de ne pas déclarer la majorité des revenus aux administrations sociales et fiscales. De ce point de vue, le numérique apporte une réponse instantanée aux phénomènes de fraude que l'on pensait ne jamais pouvoir résoudre, en imposant le paiement systématique par carte bancaire. Il est dommage que les pouvoirs publics ne voient que les problèmes nouveaux, alors que, globalement, le niveau de bien-être collectif se trouve amélioré du fait de la résolution des anciens problèmes.
La question compliquée du financement et des business angels donne actuellement lieu à une réflexion au sein du Conseil d'analyse économique. L'économie numérique a donné naissance à des entreprises se développant de façon exponentielle, ce qui nécessite des investissements fréquents, au moyen de « tickets » dont le montant augmente en permanence. Au début on investit un peu pour voir, si cela semble marcher on investit un peu plus, et ainsi de suite, avec des investisseurs de nature différente à chaque phase : d'abord des particuliers, puis des petits fonds, des grands fonds, enfin des investisseurs institutionnels. Le principal problème pour les particuliers, c'est qu'ils ne touchent rien durant des années, tant que la startup n'a pas trouvé d'acquéreur, donc n'a pas été introduite en bourse – la plupart ne touchent jamais d'argent, même si la startup continue à fonctionner. On essaie souvent de rassurer ces personnes en leur disant qu'un bon investissement nécessite de rester très longtemps au capital d'une entreprise, mais je pense que c'est l'inverse qui est vrai : le bon investissement en amorçage est celui qui permet de sortir très vite du capital, afin de récupérer sa mise et de la réinvestir ailleurs.
Quand parviendrons-nous à l'âge d'or de l'économie numérique, c'est-à-dire au moment où nous aurons terminé le travail d'imagination et de mise en place des institutions permettant de la faire fonctionner ? Quand on porte un regard sur le passé, il est inquiétant de constater que cette période n'a été atteinte qu'à l'issue de conflits d'une violence inouïe, impliquant la destruction des anciennes institutions. Toute la question est de savoir si nous allons pouvoir éviter d'en passer par cette phase, c'est-à-dire arriver directement aux Trente Glorieuses sans passer par la Seconde Guerre mondiale. C'est à mon sens possible, si des pouvoirs publics éclairés parviennent à mettre à profit la puissance exponentielle de développement des entreprises numériques, qui ont une capacité d'imposer leur modèle que ne possédaient pas les entreprises fordistes.
Mus par un idéalisme naïf auquel les Français, plus cyniques, ont du mal à croire, les Américains ont la volonté sincère, pour ne pas dire l'obsession, de résoudre les problèmes qu'ils créent. De ce point de vue, il faut espérer que le dialogue puisse se nouer entre les grandes entreprises américaines et les pouvoirs publics français ; il est permis de penser que cela finira par se faire quand on voit que l'administration Obama a commencé à établir un dialogue extrêmement fructueux avec les entreprises de la Silicon Valley, susceptible d'aboutir à une adaptation des politiques publiques à la nouvelle économie. En attendant que les entreprises numériques françaises se soient suffisamment développées, il convient que nos pouvoirs publics engagent le dialogue avec les entreprises américaines.
Je commencerai par évoquer une question que je connais bien, à la fois en tant qu'avocat et à titre personnel, celle de la rupture engendrée par le numérique. La première anecdote que je peux citer à ce propos concerne mon père qui, lorsqu'il s'est installé comme médecin dans les années 1970, a racheté à son prédécesseur une patientèle perçue comme un investissement, un élément de patrimoine professionnel qu'il pensait pouvoir revendre au moment de partir en retraite. Or, les patients se sont mis à revendiquer une liberté de choix somme toute légitime, mais ayant pour effet d'affaiblir le rapport de loyauté qui existait entre les médecins et leurs patients, donc de diminuer la valeur de la patientèle jusqu'à ce qu'elle ne vaille plus rien : à l'instar de l'ensemble des confrères de sa génération, mon père n'a donc rien pu en tirer lors de son départ en retraite.
La seconde anecdote a trait à mon activité d'avocat, dans le cadre de laquelle j'ai participé, au cours des années 2000, à la formation de nombreux conseillers juridiques. Ils pensaient tous qu'au moment de prendre leur retraite, le syndicat d'avocats d'affaires dont ils faisaient partie leur trouverait un repreneur, ce qui leur permettait de mettre fin à leur activité en récupérant le fruit de leur investissement initial, puisqu'ils avaient eux-mêmes acheté leur clientèle au début de leur activité. Or, le monde a changé et les clients des avocats, agissant comme le font les autres consommateurs, ne voient désormais plus aucune raison de rester fidèles à un cabinet, ce qui a réduit à néant la valeur des fonds de clientèle. Je ne dis pas cela pour me plaindre, mais pour souligner que le choix des consommateurs n'est pas conditionné par l'offre, mais par la demande : c'est une réalité à laquelle de nombreuses professions, en France et dans le monde, ont dû se confronter. Pour chacune d'elles, cela donne lieu à une douloureuse période de rupture, lors de laquelle les personnes qui avaient fait un investissement en début d'activité apprennent qu'il n'en reste rien : cela a été le cas pour les médecins jusqu'à une période récente, et ce sera sans doute aussi le cas pour les taxis demain.
Pour ce qui est du débat taxi-VTC, je crois pouvoir dire sans cynisme que, sur le plan juridique, il a été tranché avec le vote de la loi sur les VTC, qui leur confère des droits et des obligations différents de ceux des taxis. Certes, le contexte social est difficile, mais les taxis me paraissent livrer aujourd'hui une bataille d'arrière-garde : ils font simplement face à une mutation à laquelle la société devait se préparer, et qui ne fait qu'annoncer la prochaine, celle de la voiture autonome, qui pourrait bien avoir des conséquences autrement plus brutales à une échéance plus ou moins proche – il reste à savoir si la France sera pionnière ou retardataire dans l'acceptation sociale, légale et sécuritaire de la voiture autonome –, car elle rendra négligeable la problématique du chauffeur, quel qu'il soit.
L'un des principaux facteurs d'évolution des modes de consommation en France réside, indépendamment d'une pression supposément exercée par de grandes entreprises américaines sur les professionnels, dans un facteur d'ordre sociologique, à savoir le désintérêt de nos concitoyens pour la propriété, et la volonté croissante de partage dont ils font preuve, que ce soit pour des raisons idéologiques ou économiques. En matière de transport automobile, cela se traduit par le développement du covoiturage, mais aussi de l'autopartage, consistant à acheter un véhicule à plusieurs personnes. La propriété de certains biens de consommation – le logement et le véhicule, notamment –, qui pouvaient autrefois être vus comme des trophées constituant une preuve de réussite sociale, n'a plus aujourd'hui la même importance qu'autrefois.
La société ne cesse d'évoluer et, encore une fois à titre personnel, je vous citerai l'exemple de mes deux fils aînés, âgés de vingt-quatre et vingt-six ans, qui ont refusé d'entrer dans la logique du salariat – avec le lien de subordination et de hiérarchie qu'il implique – et préféré créer leurs propres entreprises, d'abord sous la forme de l'auto-entrepreneur. Une telle démarche n'est pas simple, mais répond à une aspiration partagée aujourd'hui par de nombreux citoyens-consommateurs.
Je ne sais pas si l'économie numérique va se traduire par une destruction massive d'emplois mais, en tant qu'avocat, j'appelle sur cette question à la nuance et à la catégorisation des rubriques : il est certain que tous les secteurs de l'économie numérique ne vont pas entraîner des disparitions d'emplois. Ainsi, à l'instar du concept O'tera, lancé par les actionnaires de Décathlon, consistant à mettre en rapport direct les producteurs de biens alimentaires et les consommateurs, La Ruche qui dit Oui propose le même service, à la différence près qu'elle repose sur une plateforme numérique. Un tel système peut effectivement faire disparaître des emplois, si l'on considère qu'il aura un impact sur la grande distribution. De ce point de vue, il faut se demander si nous souhaitons privilégier la qualité et la traçabilité des produits, donner un nouveau débouché à une filière agricole aujourd'hui bien malmenée. Lors d'une table ronde sur le thème de l'ubérisation de la filière agroalimentaire, à laquelle j'ai participé lors du salon de l'agriculture, les intervenants sont tombés d'accord sur le fait que la loi finale serait la volonté du consommateur.
En tout état de cause, la destruction d'emplois qui surviendra éventuellement dans certains secteurs sera accompagnée par une création d'emplois dans d'autres. On peut toujours essayer de se demander quels seront les secteurs concernés, mais il paraît d'ores et déjà plus intéressant de s'efforcer d'accompagner le mouvement le plus rapidement possible, plutôt que de le subir demain.
En matière de fiscalité, je suis peut-être allé un peu vite quand j'ai évoqué l'inconstitutionnalité d'une retenue à la source des revenus de l'économie de partage. Je rappelle tout de même que la commission des finances du Sénat avait proposé une solution pragmatique et intelligente, mais juridiquement non recevable, consistant à établir un seuil d'imposition de l'ordre de 5 000 euros pour l'économie collaborative. Cela ne pouvait pas fonctionner dans la mesure où cela instaurait un avantage au profit de certaines personnes, en contradiction avec le principe d'égalité devant l'impôt : il n'y a pas de raison de donner aux personnes mettant leur appartement à disposition sur Airbnb un avantage fiscal dont ne bénéficie pas le loueur habituel. On peut rechercher une solution passant par la perception de taxes d'habitation, de séjour ou d'hébergement, mais encore faudrait-il que ces taxes s'appliquent à toute la filière, et pas seulement à certains acteurs.
En ce qui concerne Airbnb, je précise bien que je n'ai pas d'intérêts dans cette société, et suis simplement curieux des phénomènes auxquels donne lieu son fonctionnement. Une énorme masse d'arguments pour et contre Airbnb a été avancée, opposant l'aspiration du consommateur à pouvoir choisir de nouvelles méthodes d'hébergement dans un marché du tourisme mondial connaissant une croissance de l'ordre de 3 % par an. À l'Institut Montaigne, nous avions rédigé un rapport sur le tourisme en France, mettant en évidence la pénurie d'offre d'hôtelière en adéquation avec l'aspiration touristique – due notamment à l'idée erronée selon laquelle un voyageur low cost était un touriste low cost, sur laquelle les hôteliers sont en train de revenir. De ce point de vue, Airbnb s'est positionnée sur un créneau laissé vacant, et sans doute en est-il de même pour l'ensemble du phénomène de l'ubérisation. Les professionnels qui font les frais de cette évolution – les hôteliers et les chauffeurs de taxi sont loin d'être les seuls : les avocats et les experts-comptables sont, eux aussi, susceptibles de devoir faire face à la concurrence d'offres numériques de type Small Business Act – doivent se remettre en question.
Trois arguments principaux sont avancés au sujet d'Airbnb. Premièrement, au sujet de la concurrence qu'on lui reproche de faire à l'hôtellerie classique, je ne pense pas que l'hôtellerie de qualité, celle qui offre du service plus qu'un simple lit, puisse être vraiment impactée par Airbnb, surtout dans le contexte de croissance de la demande touristique en France. Je rappelle que notre pays, leader mondial en nombre de touristes, est placé loin derrière nombre de ses concurrents, notamment l'Espagne, en termes de recettes par individu : notre tourisme n'est pas rentable, ce qui est lié à la faible qualité de notre offre réceptive. L'argument de la concurrence faite à l'hôtellerie me paraît donc constituer une posture largement soutenue par une dynamique corporatiste sur laquelle il convient de s'interroger.
Le deuxième argument est celui de l'impact éventuel d'Airbnb sur la politique du logement. Sur ce point, vous avez voté une loi interdisant de proposer sur la plateforme numérique autre chose que sa résidence principale, c'est-à-dire le logement occupé au moins huit mois par an – cela vaut pour les grandes villes, à moins d'obtenir une déclassification municipale, ce qui est impossible à Paris : dans ces conditions, j'ai un peu de mal à comprendre en quoi Airbnb peut avoir un impact sur le logement.
Le troisième argument est celui de l'abus et de la fraude. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut bien distinguer les pratiques occasionnelles de celles effectuées de façon régulière, et se demander quel serait le sens d'une mesure consistant à soumettre les acteurs occasionnels aux mêmes réglementations sectorielles que les professionnels, si ce n'est celui d'une simple barrière à l'exercice d'une activité. Si BlaBlaCar a échappé à l'application de la réglementation sectorielle alors que la question de la protection des personnes pouvait se poser, c'est juste parce qu'il ne s'est trouvé personne pour affirmer la nécessité de cette application. Les « BlaBlaCar du colis » qui commencent à fonctionner ne sont pas légalisés, et risquent de ne pas l'être en raison de la réaction corporatiste des transporteurs qui, depuis des années, érigent d'énormes barrières sectorielles afin de favoriser l'émergence de gros acteurs plutôt que d'une kyrielle de tout petits.
La différence entre les acteurs occasionnels et les professionnels soulève également la question de l'indépendance du travailleur, à laquelle se rattache celle de la précarité du travailleur indépendant. En tant qu'avocat, je parle en connaissance de cause, puisque nous n'avons pas d'employeur et ne travaillons donc qu'en fonction des clients faisant appel à nos services : nous n'avons donc aucune sécurité de l'emploi. Deux tendances s'affrontent actuellement. La première, incarnée par le projet de loi « El Khomri », repose sur l'idée consistant à verrouiller le statut de l'auto-entrepreneur – c'est-à-dire qu'il ne pourra être requalifié en contrat de travail – à plusieurs conditions, notamment celle de la participation de la plateforme concernée à certaines responsabilités, formations et obligations en matière de protection sociale. Cette idée est intéressante, mais aboutit à créer un animal hybride entre le salarié et le travailleur indépendant. Surtout, elle pose problème en ce qui concerne la notion de plateforme, car il n'est pas impossible qu'une personne travaille pour plusieurs plateformes au cours d'une même journée : dans ces conditions, comment répartir les responsabilités entre les différentes plateformes ? De même, sur le plan fiscal, à qui incombera le soin de retenir éventuellement un impôt à la source ? Comme on le voit, ce qui paraît très simple sur le papier peut se révéler très compliqué à mettre en oeuvre.
La question du faux indépendant constitue un sujet à part entière : à partir de quand une personne cesse-t-elle d'être réellement un indépendant ? La question a été soulevée en Californie pour Uber, ce qui a permis de faire émerger le critère de dépendance économique : un travailleur indépendant peut être dépendant économiquement. En France, une procédure a été engagée à l'encontre de LeCab, qui avait inséré dans ses conditions générales d'utilisation (CGU) une clause d'exclusivité aux termes de laquelle le travailleur indépendant s'interdisait de travailler pour un concurrent. En France, le rapport Mettling de septembre 2015 se référait, lui aussi, à ce critère de dépendance économique, tandis que le rapport Terrasse de février 2016 renvoyait plutôt à des préconisations d'ordre méthodologique.
Loin d'être monolithique, la problématique du travailleur indépendant est complexe, et se pose surtout dans le domaine du transport de personnes. Dans de nombreux autres domaines, on peut penser que des professionnels qui étaient déjà des indépendants vont simplement démultiplier leur accès à la clientèle – au risque de se faire noter. En tout état de cause, la problématique de l'économie de plateforme ne doit pas se voir réduite à une problématique sociale centrée sur le risque de précarisation – un risque qui, selon moi, ne concerne vraiment que les chauffeurs de VTC, venus se positionner sur un créneau très sensible socialement.
Chaque secteur économique a ses propres codes et difficultés. Pour ce qui est des avocats, je ne pense pas que l'ubérisation puisse avoir pour conséquence que des avocats se fassent concurrencer par des personnes qui ne sont pas des avocats. En revanche, il est certain que des avocats vont recourir au numérique dans une logique concurrentielle avec des acteurs plus traditionnels, dans le respect des codes. Si une telle pratique soulève des problèmes, ceux-ci ne sont a priori pas d'ordre fiscal ou réglementaire. Dans chaque secteur, une dynamique globale est engendrée par un besoin ou une aspiration sociétale – souvent de nature économique dans la période difficile que nous traversons –, qui rencontre le mouvement général d'affaiblissement des codes traditionnels, notamment la disparition progressive du sacro-saint contrat de travail qui, devenant extrêmement difficile à obtenir, incite à travailler autrement.
Parallèlement, il existe des problématiques fondamentalement sectorielles, avec des termes de débat largement impactés par le fait qu'il existe ou non une concurrence, et une structuration plus ou moins forte des secteurs concernés. Quand Airbnb est arrivé en France, cela s'est fait sur un terrain quasiment vierge de réglementation : depuis, celle-ci ne fait que se renforcer. Il est permis de se demander si la même mobilisation se serait produite si Airbnb avait été une société française, et si la situation actuelle est de nature à motiver un acteur français équivalent à Airbnb – qui n'existe pas pour le moment – à venir faire concurrence à la société américaine. La réponse à cette dernière question est évidemment non. Veillons donc à ne pas nous laisser éblouir par des argumentaires qui, pour légitimes qu'ils soient, ne doivent pas déborder sur d'autres secteurs et trahissent des origines largement corporatistes qu'il faut savoir reconnaître.

Mesdames, messieurs, je vous remercie pour la clarté et la richesse de vos interventions, qui éclaireront utilement les travaux de notre commission.
Membres présents ou excusés
Commission des affaires économiques
Réunion du mardi 8 mars 2016 à 17 heures
Présents. – Mme Marie-Noëlle Battistel, M. André Chassaigne, M. Yves Daniel, Mme Corinne Erhel, Mme Marie-Hélène Fabre, M. Daniel Fasquelle, Mme Pascale Got, M. Jean Grellier, Mme Laure de La Raudière, M. Jean-Luc Laurent, Mme Annick Le Loch, M. Philippe Le Ray, M. Jean-Pierre Le Roch, Mme Audrey Linkenheld, Mme Marie-Lou Marcel, Mme Frédérique Massat, M. Jean-Claude Mathis, M. Hervé Pellois, Mme Béatrice Santais, M. Éric Straumann, M. Lionel Tardy
Excusés. – M. Damien Abad, M. Thierry Benoit, M. Franck Gilard, M. Antoine Herth, M. Dominique Potier, M. Bernard Reynès, M. Frédéric Roig, Mme Catherine Troallic
Assistait également à la réunion. – Mme Virginie Duby-Muller