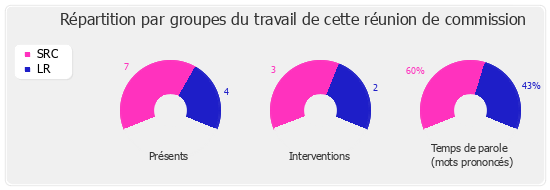Commission des affaires étrangères
Réunion du 8 mars 2016 à 17h00
La réunion
Audition, dans le cadre de la journée internationale de la femme, de Mme Alya Chérif Chammari, directrice exécutive du réseau maghrébin Collectif 95 Maghreb Egalité, et de Mme Fadia Kiwan, représentante du Liban au conseil exécutif de l'Organisation de la femme arabe.
La séance est ouverte à dix-sept heures.

Merci de votre présence, mesdames. Notre commission s'intéressant beaucoup aux relations euro-méditerranéennes et, naturellement, à la question des femmes, nous avons souhaité bénéficier, à l'occasion de la journée internationale de la femme, de l'éclairage des deux éminentes ressortissantes du Sud de la Méditerranée que vous êtes.
Au sein de l'Assemblée nationale et spécialement de cette commission, nous savons tous combien les rapports entre les hommes et les femmes, l'égalité et la parité – promue par une loi que j'ai eu l'honneur de défendre ici – sont fondamentaux pour l'avenir de l'humanité. En la matière, nous, Européens et Sud-Méditerranéens, avons beaucoup à faire et à échanger.
La conférence ministérielle de l'Union pour la Méditerranée sur le renforcement du rôle des femmes dans la société, qui s'est tenue en septembre 2013, a débouché sur l'adoption de conclusions ambitieuses en matière d'égalité salariale et de participation des femmes aux instances de direction des entreprises. Comme souvent, dans ce domaine comme dans d'autres, l'application en est encore timide. On progresse – vous nous direz ce que vous en pensez –, mais beaucoup reste à faire. La journée internationale de la femme nous a d'ailleurs donné l'occasion de dresser le bilan de la situation française à cet égard.
J'aimerais évoquer aussi d'autres textes internationaux, en particulier le programme d'action adopté lors de la conférence de Pékin de 1995 et à propos duquel Nicole Ameline, ici présente, s'est montré très active. Est-il en mesure d'orienter les politiques publiques dans la région euro-méditerranéenne ? Ces conclusions servent-elles de point d'appui aux acteurs de la société civile ?
À ce propos, je suis convaincue que la mobilisation de la société civile est particulièrement déterminante dans le domaine qui nous occupe. Au Maroc, les organisations féministes ont suscité et accompagné l'adoption en 2005 du nouveau code de la famille (moudawana), qui a beaucoup réduit les inégalités, sans les faire disparaître. On se souvient également des très vifs débats qui ont entouré l'élaboration de la nouvelle Constitution tunisienne et que nous avons suivis de très près. Au Liban, le mariage civil est interdit mais, paradoxalement, reconnu lorsqu'il est contracté à l'étranger. Si l'action des associations se concentre sur sa reconnaissance, celle-ci divise profondément la classe politique et provoque l'opposition des dignitaires religieux. Quel est votre sentiment sur le résultat de ces mobilisations, sur les progrès et les lacunes que l'on peut observer en ces matières ?
En Europe, particulièrement en France, on a tendance à lier étroitement le combat féministe à la question de la laïcité. Or les acteurs associatifs arabes s'appuient beaucoup sur le droit musulman contre ceux qui voudraient confiner les femmes dans un statut d'infériorité au nom de la religion. On entend ainsi dire quelquefois que c'est le système patriarcal qui génère les inégalités, non le Coran. Il me semble que de tels arguments ont une place grandissante. Qu'en pensez-vous ? Ne marquent-ils pas une forme de renoncement au combat féministe ? Sont-ils tactiques ? Sont-ils sincères ? Et comment surmonter l'incompréhension qu'ils suscitent ici ou là ?
Nous pourrions également parler du bilan de la mise en oeuvre de la convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes, adoptée en 2011 par le Conseil de l'Europe. Pour vous, est-elle un instrument efficace ou une simple déclaration d'intention ?
Le Maroc a accueilli en février dernier une grande conférence régionale réunissant plus de 21 pays arabes afin de promouvoir un agenda positif en matière de participation des femmes à la prise de décision politique. Comment la coopération euro-méditerranéenne peut-elle y contribuer ? Quelle approche vous semble la plus adaptée ? Personnellement, je tiens beaucoup à l'approche paritaire et je suis défavorable à l'approche par quotas, car les femmes sont la moitié de l'humanité et j'estime qu'il ne faut pas minorer ses ambitions à cet égard.
Enfin, le problème se pose évidemment de la protection des femmes dans les conflits.
Les femmes sont les principales victimes des préjugés culturels et des guerres, mais aussi les principales actrices du dialogue entre les sociétés européennes et méditerranéennes. Présidente de la fondation Anna Lindh, qui leur accorde une attention particulière ainsi qu'aux jeunes, je mesure d'autant mieux l'apport économique, social, culturel de leur action.
Merci de votre invitation.
Mon intervention liminaire devrait me permettre de répondre à la plupart de vos questions, qui sont fondamentales ; nous pourrons en aborder d'autres au cours de l'échange qui suivra.
L'objet de cette audition est la coopération euro-méditerranéenne et l'égalité entre les femmes et les hommes. L'idée de coopération euro-méditerranéenne évoque immédiatement le processus de Barcelone institué en 1995. Or si, à l'origine, celui-ci n'a pas clairement fait de l'égalité entre les femmes et les hommes l'un de ses fondamentaux, il en a bien été question immédiatement après. En effet, ce processus a été remplacé par l'Union pour la Méditerranée (UPM). Et, dans le cadre du cheminement qui a conduit à l'UPM, alors que les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée sont aujourd'hui confrontés à des défis qui vont des conflits armés aux transitions démocratiques, l'engagement a été pris de soutenir les efforts des différents acteurs de la région pour promouvoir l'égalité entre femmes et hommes. Cet engagement est évidemment fondé sur les droits universels définis et prescrits par les instruments internationaux.
Je commencerai par un rapide état des lieux de la situation des femmes dans la région, c'est-à-dire au Sud et à l'Est comme au Nord de la Méditerranée, avant d'aborder la coopération euro-méditerranéenne.
Cinq ans après ce qui a été qualifié de « printemps arabe », les gouvernements en place, imposés dans certains cas par les urnes, sont dominés par les partis islamistes ou conservateurs, qui restent attachés au droit musulman malgré, ici et là, des discours qui se veulent rassurants sur l'instauration d'un État civil dit démocratique. En réalité, un État sécularisé et démocratique ne peut se concevoir sans égalité pleine et entière entre les femmes et les hommes, une égalité qui garantisse l'exercice par les femmes de leur citoyenneté sans aucune exclusion ni réserve.
Un constat : les violations des droits des femmes, plus particulièrement de celles qui défendent les droits humains, sont de plus en plus nombreuses dans les pays que l'on dit engagés dans un processus de transition démocratique. Certes, un processus de transition politique est à l'oeuvre. Sera-t-il démocratique ? L'avenir le dira, et la réponse est cruciale pour la région.
Dans les pays du Bassin méditerranéen, les violations des droits humains fondamentaux des femmes sont aggravées par les crises économiques, l'insécurité liée aux attentats terroristes et les situations de conflit armé, qui les touchent en premier lieu. Traditionnalistes et conservateurs, la plupart des gouvernements en place dans le Sud et l'Est de la Méditerranée concentrent leurs revendications identitaires et leurs projets de société sur le corps des femmes, dont le statut doit rester conforme à la tradition musulmane et au droit musulman, présentés l'un et l'autre comme immuables.
Dans tous ces pays, le corps des femmes est menacé. Il constitue un enjeu politique. Les extrémistes religieux de tous bords tentent de le camoufler sous les niqab, hijab et autres foulards, et même sous des perruques. Ils aspirent à exclure totalement les femmes de l'espace public.
Les islamistes remettent en cause les droits acquis par les Tunisiennes et veulent maintenir dans une citoyenneté de seconde zone les Libyennes et les Égyptiennes, alors que toutes ces femmes ont été en première ligne pendant les années de résistance et de lutte contre les despotismes.
L'ambiguïté de la Constitution adoptée par l'Assemblée constituante en Tunisie – qui a été dominée par les islamistes – est telle qu'elle pourrait entraîner la remise en cause de tous les droits des Tunisiennes et des femmes vivant en Tunisie. D'ailleurs, les ténors du parti Ennahdha – parti islamiste majoritaire à l'Assemblée constituante et actuellement premier parti au Parlement tunisien, après la scission du parti Nidaa Tounès qui avait remporté les élections en 2014 – appellent à réinstaurer la polygamie, le mariage coutumier, le mariage précoce, l'excision des filles, et à interdire l'interruption volontaire de grossesse, la contraception, l'adoption, la mixité dans les écoles. Ils ont même tenté de constitutionnaliser la « complémentarité » entre femme et homme. Les femmes devraient selon eux rester sous la protection des maris, des pères, des frères et des fils. Ils opposent le « familialisme » au féminisme, déniant ainsi toute individualité et toute autonomie aux femmes, afin d'empêcher l'égalité entre femmes et hommes. Le harcèlement sexuel des femmes sert à les exclure des lieux publics. Les violences physiques et verbales se multiplient de manière inquiétante lors des manifestations de rue pour la sauvegarde et la promotion des droits des femmes, et ce dans une quasi-impunité. 47 % des Tunisiennes sont ainsi victimes de violences physiques et sexuelles.
En Syrie, vous le savez, le recours à la violence fondée sur le genre comme arme de guerre tend à se généraliser. Plusieurs rapports documentés par les Nations Unies évoquent des femmes détenues, dans les deux camps, et violées parfois sous les yeux de leurs proches. Les femmes subissent viols, mariages forcés, mariages « de plaisir » avec des mineures. Elles sont également victimes de crimes d'honneur de leur proche suite aux violences sexuelles qu'elles ont subies lors de leur incarcération.
Les Palestiniennes, quant à elles, continuent de porter le double fardeau de la violence et de la discrimination perpétrée par la puissance occupante et de la violence qui découle des valeurs et attitudes patriarcales de leur propre société. Leur contribution considérable à la résistance et à la cohésion du tissu social palestinien demeure marginalisée.
En Algérie, au Maroc, malgré quelques améliorations, la condition des femmes reste discriminatoire, alors que le principe d'égalité entre citoyen et citoyenne est proclamé par la Constitution – celle du Maroc a été adoptée en 2011. Si ce principe reste lettre morte, c'est parce que rien ou presque n'est fait pour adapter les lois de la famille à ce que proclament les constitutions.
Je laisserai à Mme Kiwan le privilège de parler du Liban ainsi que de la Jordanie, où les femmes sont également discriminées.
Ainsi, les croyances et pratiques patriarcales sont renforcées par la faiblesse de l'État de droit, voire son absence, par l'absence d'engagement des gouvernements à respecter les droits humains fondamentaux des femmes, par les mesures d'austérité et par la montée des extrémismes religieux.
L'engagement, manifestement opportuniste et conjoncturel, de la plupart des gouvernements de la Méditerranée du Sud et de l'Est à protéger, promouvoir et respecter les droits des femmes n'augure nullement de la promulgation ni de la mise en oeuvre de dispositions légales et de politiques garantissant l'égalité des sexes. En conséquence, la situation des femmes se détériore dans tous ces pays dits en transition.
Le Nord de la Méditerranée ne fait pas exception, ainsi que Mme Guigou l'a souligné : en Europe, les femmes subissent aussi des violences physiques et verbales à des degrés divers. En France, vous le savez, 44 % des femmes sont victimes de violences physiques selon l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les autres États européens ne sont pas en reste. En ces temps de crise économique internationale, la pauvreté et l'exclusion sociale frappent en premier lieu les femmes. En Europe, elles représentent la grande majorité des travailleurs à temps partiel et occupent des emplois précaires et mal payés. Elles sont les premières à subir le chômage, l'appauvrissement, la précarité, les coupes budgétaires en matière de santé et d'éducation qu'imposent les mesures gouvernementales d'austérité. En outre, les mesures et les politiques liées à l'égalité des sexes ne sont pas considérées comme prioritaires en ces temps de difficultés économiques.
Ces mesures d'austérité économique vont de pair avec la montée des mouvements extrémistes religieux, politiques, racistes dont l'idéologie renvoie les femmes à leur rôle familial traditionnel et dont les choix politiques remettent en cause leurs droits et leur santé sexuelle et reproductive.
Face à cet état des lieux très préoccupant, face aux dangers de régression des droits des femmes, la solidarité entre les sociétés des deux rives de la Méditerranée est plus que jamais nécessaire pour dénoncer et condamner toutes les formes de violence que subissent les femmes, en particulier l'utilisation volontaire de la violence sexuelle comme stratégie sociale et politique destinée à les effrayer, à les stigmatiser et à les exclure de l'espace public.
Aujourd'hui plus que jamais, en effet, la mobilisation permanente des ONG féministes de défense des droits humains, des partis politiques démocratiques et sécularisés, des syndicats, tant au Nord qu'au Sud et à l'Est de la Méditerranée, est nécessaire pour rappeler, défendre et inscrire dans les constitutions les droits fondamentaux qui caractérisent toute démocratie. Les droits et les libertés des femmes et des hommes doivent être interprétés à la lumière des droits humains universels, dans le respect du principe de non-discrimination en raison du sexe, de la religion et de la race.
Pour que l'on y parvienne, il faut que la religion cesse d'être annexée par le politique. Pour mettre fin à l'artificielle et redoutable sacralisation des inégalités et des discriminations à l'égard des femmes, il faut émanciper les lois et les règles de tout impératif qui les transcende et placer les religions et la spiritualité de leur message hors de l'atteinte des gouvernants et de l'ensemble des courants politiques.
Il faudrait aussi rappeler aux États leurs engagements internationaux et l'exigence de mettre en oeuvre les instruments internationaux qu'ils ont ratifiés, au premier rang desquels la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes – la CEDAW – et le programme d'action de Pékin. Il faut aussi, plus que jamais, remettre en oeuvre les instruments euro-méditerranéens tels que le plan d'Istanbul et de Marrakech sur le rôle des femmes dans la société, adopté en 2006, réévalué en 2009 et rappelé en 2013, lors de la troisième réunion ministérielle de l'UPM.
Cette conférence ministérielle a manifesté l'intérêt accordé aux droits des femmes dans la région, mais sans faire référence aux instruments internationaux en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, dont la CEDAW, ni mettre en place un mécanisme de suivi de la situation des femmes en Méditerranée, se contentant de prévoir la labellisation par l'UPM de projets économiques sur le terrain. En cette période de violence extrême à l'égard des femmes, l'UPM a passé outre les lignes directrices de l'Union européenne sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, la convention d'Istanbul ainsi que la politique européenne de voisinage renouvelée de 2011, fondée sur de nouveaux critères tels qu'une approche « donnant-donnant ».
Actuellement, malheureusement, la politique européenne semble accepter les dérives des gouvernements en place, surtout en matière de droits des femmes, dans tout le Sud-Est de la Méditerranée. Alors que les femmes ont participé tout autant que les hommes aux mouvements qui ont entraîné la chute des dictatures au Sud de la Méditerranée, et bien que leur situation varie selon les pays, elles subissent la remise en cause de leurs droits, les tentatives d'exclusion de la vie publique, les violences des groupes extrémistes, des forces de sécurité et des forces armées dans les pays en conflit.
Il convient toutefois de nuancer ce propos en signalant que l'Union européenne a conclu avec la Tunisie, lors du Conseil d'association de novembre 2012, un accord de partenariat privilégié incluant l'adoption d'un plan d'action concernant les droits humains. La Commission européenne a appuyé l'intégration du genre à différents programmes afin de promouvoir les droits des femmes rurales, la santé reproductive, et a apporté son appui au projet de loi intégrale sur les violences faites aux femmes et aux filles. Le même plan d'action prévoit un programme spécial d'appui à la société civile qui se consacre à l'égalité des sexes, coordonné par le bureau Tunisie du réseau EuroMed Droits (réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme).
Toutes ces initiatives soulignent l'importance de la responsabilité mutuelle de l'Union européenne et de ses partenaires du Sud et de l'Est de la Méditerranée. Il faut nouer des partenariats non seulement entre gouvernements mais également avec les acteurs de la société civile, et reconnaître le rôle crucial de celle-ci, particulièrement des associations de défense des droits humains fondamentaux des femmes.
La réussite de ce processus démocratique est cruciale pour le Sud et l'Est de la Méditerranée, mais aussi pour l'Europe, au Nord. Elle dépend des forces vives et démocratiques de la région et des liens de solidarité que celles-ci ont su et sauront tisser. Aujourd'hui, ce sont les sociétés civiles indépendantes des pays de cette région qui, grâce à ces liens, dessinent ce que pourrait être une région euro-méditerranéenne fière de sa diversité, attachée aux mêmes principes et riche de ses solidarités, exprimées à travers les luttes communes et le partage d'expériences. Ce sont elles qui peuvent et qui doivent faire adhérer les États à cette vision.
C'est dans ce contexte social et politique, auquel il convient d'ajouter la nouvelle donne de la révolution dans laquelle les femmes ont été en première ligne, qu'il faudrait réfléchir à une stratégie qui tienne compte des changements sociaux dans le cadre de référentiels fondés sur l'égalité de droit et en droit entre les femmes et les hommes.
Tous les pays qui entourent la Méditerranée ont une communauté de destin. Voilà pourquoi les gouvernants d'Europe ne doivent plus soutenir les dictatures ni les despotismes en tenant compte de leurs seuls intérêts géostratégiques et économiques. Dans la foulée des révoltes tunisienne et égyptienne, ils ont appuyé celle de la Libye, mais laissent depuis lors massacrer sa population civile ainsi que celle de la Syrie, sans parler de la Palestine. L'Occident, l'Europe en particulier, doit aussi cesser de stigmatiser sa population musulmane ou d'origine musulmane car ces éléments ont été, avec d'autres, à l'origine de la montée des extrémismes religieux. Le partenariat euro-méditerranéen ouvert à tous les pays de la région ne peut reposer uniquement sur des projets de développement économique, si importants soient-ils.
La nouvelle politique européenne de voisinage doit s'appuyer sur les fondamentaux qui ont conduit au lancement du processus de Barcelone : la volonté de partager un destin commun, dans le respect de la diversité des sociétés, de l'intangibilité des valeurs que sont les droits humains, les libertés fondamentales, les principes d'égalité inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans tous les instruments internationaux et régionaux, notamment européens, qui ont suivi.
Enfin, la réussite du processus de coopération euro-méditerranéen s'agissant de l'égalité entre les femmes et les hommes et, par voie de conséquence, de l'instauration de véritables démocraties dans cette région dépend en premier lieu des forces vives et démocratiques sur place, mais également des solidarités internationales et des mouvements démocratiques dans le monde entier.
Merci infiniment de nous avoir invitées. C'est un véritable honneur pour nous que d'être écoutées par des parlementaires français aussi influents.
Madame la présidente, vous avez embrassé dans votre introduction les principaux enjeux de la question qui nous occupe. De mon côté, je me permettrai de commencer par la fin : par ce que l'on appelle les priorités, mais dans une perspective stratégique. Je parlerai du monde arabe car je le connais mieux que le réseau de l'UPM, auquel nous ne sommes pas pleinement associés puisqu'il se limite dans le Machrek à des activités locales, souvent entreprises par des ONG.
Dans le monde arabe, donc, un enjeu majeur est la protection des femmes, dans deux situations. D'abord les conflits armés – et leurs conséquences – dont les femmes, comme l'a si bien dit la présidente, sont les victimes par excellence. Des centaines de milliers, des millions de femmes et de filles sont soit prises en otage, soit enlevées et violées avant que l'on ne se débarrasse d'elles. Dans la seule communauté yézidie, il y a encore à ce jour 3 400 femmes et filles détenues dont on ne sait rien ; une jeune yézidie en parlait sur une chaîne française il y a une petite semaine. Ce problème très grave touche directement les populations concernées par les conflits armés et les guerres dans les différents pays arabes.
La question a été abordée par les organisations de la société civile dans chaque pays, ainsi que par les instances nationales, par le biais d'instruments juridiques internationaux, principalement la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que ses autres résolutions, jusqu'à celle d'octobre 2013 sur la nécessité d'apporter aux femmes et aux filles une protection directe dans les zones de conflit armé, ainsi qu'un soutien juridique.
Il faut le dire fortement, les crimes commis contre les femmes et les filles sont des crimes de guerre qui ne sauraient être amnistiés et dont les auteurs doivent être traduits devant un tribunal international. Or on n'entend aucune voix s'élever pour le dire, ni dans le monde arabe ni ailleurs. C'est très grave.
La seconde forme de violence est habituelle, elle n'a rien de nouveau : c'est la violence domestique, ainsi que la violence symbolique et le harcèlement dans les lieux publics. Utilisé en particulier en Égypte lors des mouvements de contestation du printemps égyptien, le harcèlement systématique était destiné à effrayer les femmes pour qu'elles quittent les lieux publics. De manière générale, le phénomène se poursuit. Alya en a parlé à propos de la Tunisie. Il s'agit bien d'un moyen de repousser les femmes hors de l'espace public.
Un problème également très grave, qui avait été spécifiquement examiné par le Parlement égyptien sous le régime Moubarak, du temps de Mme Moubarak, et avait alors fait l'objet d'une loi, est la mutilation génitale des filles, assez fréquente en Égypte. Au moment du printemps arabe, dans les deux pays qui ont connu un changement de régime, la Tunisie et l'Égypte, une contre-révolution a suivi la révolution et « redressé le tir ». Chez les Tunisiens, l'évolution a été pacifique et négociée dans des salles fermées ; chez les Égyptiens, ce fut le mouvement de rue du 30 juin. Or, entre le 25 janvier 2011 et le 30 juin 2013, le régime en place, porté par les révolutionnaires, a tenté d'abroger la loi fixant un âge minimum pour le mariage et celle qui tendait à pénaliser l'excision. Il y a alors eu un bras de fer entre, d'un côté, les libéraux et les modernistes au sein de la société et du Parlement et, de l'autre, les islamistes. En fin de compte, c'est le mouvement de rue du 30 juin qui a changé la donne. Aujourd'hui, les Égyptiens sont très conscients de cet enjeu et de l'importance de ces textes.
Toutefois, ces textes ne sont pas systématiquement appliqués. Au combat pour élaborer des textes de loi qui pénalisent, qui dissuadent, qui instaurent de nouvelles conduites sociales, il s'en ajoute ainsi un second, pour les mettre en oeuvre. Son issue n'est assurée ni en Tunisie ni en Égypte, qu'il s'agisse de parité ou de quotas, ou encore de l'âge minimum du mariage.
Il existe aussi un problème culturel qu'il faut regarder en face ; j'y reviendrai.
La violence est la priorité des priorités. Contre la violence domestique, on a fréquemment voté des lois, mais celles-ci ont parfois été vidées de leur contenu, comme dans le cas libanais, et, souvent, n'ont pas été appliquées. Il arrive aussi que les mécanismes manquent pour appuyer les femmes qui souhaitent faire des recours. Au total, on est un peu dans une situation de transition.
Mais je veux voir sinon le verre à moitié plein, puisqu'il n'est pas rempli à moitié, du moins un doigt : les sociétés arabes ne correspondent pas à des stéréotypes ; elles sont multiples, et elles sont en mouvement. C'est important, car cela ouvre une brèche : cela montre que l'on peut avancer et tirer un profit mutuel de nos expériences, qu'il existe une stratégie des acteurs qui permet de prendre des décisions et de progresser, même sur fond de culture religieuse et de volonté de s'enraciner dans les traditions jusqu'au fondamentalisme et au retour aux sources.
On peut distinguer six vagues successives dans l'intérêt accordé à la situation et aux droits des femmes dans le monde arabe.
Au cours de la première vague, on considérait qu'il fallait éduquer les filles, les envoyer à l'école. Ensuite, on s'est rendu compte que cela ne suffisait pas, car les textes étaient discriminatoires.
La deuxième vague a donc concerné l'assainissement des textes juridiques et l'adoption de lois qui protègent les femmes ou créent une véritable égalité entre elles et les hommes. Mais il est apparu que l'égalité dans les textes ne suffisait pas non plus si les femmes restaient à la maison, absentes du marché, du champ économique, de la production.
On s'est alors focalisé – c'est la troisième vague – sur le développement des capacités des femmes afin qu'elles entrent sur le marché du travail. Et l'on s'est aperçu que cela ne suffisait pas toujours pas, que, dans de nombreux domaines, il fallait un système de protection et que la décision politique était essentielle.
C'est à ce stade que la conférence de Pékin, en 1995, a apporté une valeur ajoutée au combat des femmes. Pékin a mis en relief la nécessité de « voir le monde à travers les yeux des femmes », pour reprendre un slogan associé à la conférence. En outre, le programme d'action de Pékin s'est focalisé sur la nécessité d'instaurer un quota pour que les femmes participent à la décision.
Tel était le sens de la quatrième vague : il faut que les femmes prennent part à la décision pour que les choix publics soient faits en fonction de leurs intérêts, de leurs doléances, de leurs aspirations, autant que de ceux des hommes, et pour déconstruire le stéréotype de la femme qui reste toujours en arrière, qui est toujours à la charge de quelqu'un, même si elle travaille. Des recherches sur le Liban, le Syrie et la Jordanie ont ainsi montré que les femmes ne disposaient pas de leur revenu même lorsqu'elles en avaient un, sinon pour des dépenses destinées à leur famille : elles n'avaient pas un sentiment d'autonomie suffisamment fort pour penser à elles et à elles seules. La plupart n'avaient presque aucun patrimoine, et elles consacraient à leur famille l'intégralité de leur revenu.
Le quota proposé à Pékin était destiné à impulser l'entrée des femmes dans la vie active, mais on a constaté dans certains pays arabes que les femmes qui entraient en politique n'étaient pas nécessairement sensibles à la question des femmes. Et l'on a souvent vu des femmes défendre essentiellement l'ordre établi, l'ordre culturel, un code empreint de misogynie.
Les associations de la société civile ont alors souligné que n'importe quelle femme ne défendait pas les femmes, et souhaité que les députées et les ministres femmes qui participaient à la vie politique grâce à la lutte qu'elles-mêmes avaient menées promeuvent un « agenda femmes ». Le débat était rouvert : faut-il que les femmes soient féministes, rien que féministes ? Beaucoup de femmes estimaient qu'elles ne pouvaient se limiter à cela, étant entrées au gouvernement ou au Parlement par d'autres moyens que le féminisme. Il y a ainsi aujourd'hui, dans certains pays que je connais bien, une rupture entre les femmes qui militent au sein des associations, les vraies féministes au sens strict du terme, et les femmes actives politiquement. C'est un gros problème.
Toutefois, cette quatrième lutte semble avoir ouvert la voie à la cinquième, contre la violence domestique. L'une des premières Koweïtiennes entrées au gouvernement avait déclaré publiquement à sa nomination : « C'est là que commence notre combat pour améliorer notre vie de famille. » C'était très courageux. Elle pouvait prendre toutes les décisions politiques qu'elle voulait, mais, de retour à la maison, son statut la confinait à des tâches qui ne garantissaient pas sa dignité humaine.
La cinquième vague, qui est en cours, tend à l'adoption et à la mise en oeuvre de lois et de sanctions concernant la violence exercée contre les femmes, dans les zones de conflit armé et, ailleurs, dans la vie quotidienne – violence domestique, harcèlement, mutilation génitale, mariage précoce. Mme la présidente s'est enquise des instruments juridiques employés dans ce combat : il s'agit du programme d'action de Pékin, bien sûr, de la CEDAW, et des différentes résolutions du Conseil de sécurité, de 2000 à 2013.
Nous sommes au début d'une sixième vague et nous devons regarder les choses en face. Le monde arabe a montré en 2011 qu'il n'était pas figé. En fait, il ne l'a jamais été. Mais, une trentaine d'années auparavant, un changement de régime politique avait eu lieu par la voie du coup d'État (inqilâb) ; après quoi, par un concours de circonstances, la donne internationale avait contribué au maintien des régimes ainsi installés, pendant une assez longue période. Or, à cette époque, un féminisme d'État a vu le jour, dans tous les pays – y compris le vôtre. Et même les régimes qui ont été bannis par leur population étaient féministes. C'était d'ailleurs un piège pour les femmes, cooptées à de nombreux postes et sièges, souvent bénéficiaires de quotas qui n'étaient pas issus de leur lutte mais de la volonté d'un régime qui cherchait à blanchir son image à l'étranger.
Le régime Moubarak avait ainsi prévu d'augmenter de 20 % le nombre de parlementaires et d'allouer aux femmes les sièges supplémentaires ainsi créés. Le président Morsi a maintenu les 20 % et annulé leur allocation aux femmes. Avec le président actuel, on a assisté à un retour du féminisme d'État. Aujourd'hui, 89 femmes siègent au Parlement : c'est une vraie première. Mais il faut aussi penser à la « sustainability » du phénomène, si vous me permettez cet anglicisme.
Au Maroc, la parité aux élections ne s'applique qu'une fois : les femmes qui en ont bénéficié une fois doivent par la suite se présenter seules, se jeter à l'eau, en quelque sorte, et, si la parité est maintenue, ce sont d'autres femmes qui en profiteront. Cela montre que la parité n'est pas mise en oeuvre de bon coeur.
Aujourd'hui, le combat qui se prépare, pour nous tous, est un combat culturel. Il sera livré au niveau de la société, cette société qui s'est récemment élevée contre des régimes considérés comme répressifs, ce qui a produit soit des guerres civiles, soit des régimes qui ne sont pas nécessairement plus démocratiques. Le combat pour un parcours vraiment démocratique commence. Et la reconnaissance des droits des femmes est un prérequis de la démocratie, plutôt que l'inverse. Il faut que les femmes progressent et participent activement pour qu'une véritable démocratie voit le jour. Car si la démocratie est une démocratie des hommes, les femmes seront en permanence cooptées, instrumentalisées par les politiciens, ce qui s'apparenterait au féminisme d'État du passé.
Par la contestation qui a débuté en janvier 2011, les sociétés arabes, principalement arabo-musulmanes, ont montré qu'elles vivent dans le présent. Ces sociétés sont partagées. Autrefois, on leur proposait de rompre avec l'ensemble de leur passé et de leur culture pour devenir modernes : il n'était pas possible d'être à la fois musulman et moderne. Dans le sillage de ces mouvements de rue, il y a eu des tentatives, que nous sommes tenus de respecter, pour s'approprier la modernité tout en tentant de la réconcilier avec la tradition. En disant cela, nous sommes amères, car nous sommes pleinement favorables à la rupture entre le spirituel et le temporel et au fait que la vie des citoyens soit régie par des lois positives. Mais on ne peut pas passer d'une rive à l'autre si facilement. Il faut donc que nous acceptions ce combat de quelques-uns. De la part de certains, c'est assurément de la tactique. Et, pour nous, c'est affaire de patience. Nous devons faire avec : nous ne pouvons pas transporter les gens d'un monde à un autre. Si nous nous y essayions trop brutalement, cela ferait remonter au créneau les forces radicalistes et islamistes qui nous accuseraient d'impérialisme. Il faut accepter la pluralité des voies au sein d'une société.
Les nouvelles générations seront de plus en plus familières du code culturel de l'humanité entière, inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme – car ce n'est plus un code européen ni occidental, même si vous, en Europe, y avez beaucoup contribué. Dès lors que ce code est universel, il faut donc laisser faire le temps, en aidant les différents mouvements qui existent. Le plus périlleux et le plus courageux est celui de nos amies qui militent au sein même de l'islam. Il s'agit de démythifier le texte, d'actualiser la perception des Ayat, et de faire appel à sa raison et à sa dignité pour trouver des solutions actuelles à des problèmes actuels au lieu de toujours les chercher dans le passé ou dans un texte. Ce mouvement est à l'oeuvre, on ne peut l'ignorer. On peut ne pas y croire beaucoup, mais on doit le respecter, respecter la pluralité des parcours de ceux qui ont en commun de vouloir que l'on reconnaisse la dignité aux femmes en les considérant comme des êtres humains à part entière et en faisant d'elles des citoyennes.
Ainsi, si l'on s'efforce de déconfessionnaliser le Liban au motif qu'il faut tenir compte non de l'appartenance communautaire mais de l'appartenance citoyenne, l'on rencontrera nécessairement une résistance au niveau du code civil du statut personnel et l'on verra rapidement s'imposer une majorité numérique fondée sur une asabiyya (cohésion) communautaire, plus que jamais cramponnée aux textes religieux qui s'appliquent en matière de vie de famille. Où est la vie de famille, pourrait-on dire, quand un homme peut épouser plusieurs femmes, quand il se partage entre plusieurs couches, plusieurs maisons ? Mais laissons les femmes qui vivent ces situations en parler. D'autant qu'aujourd'hui, personne n'est plus innocent : tout le monde sait qu'il s'agit d'une instrumentalisation de la religion, contre laquelle de nombreux musulmans s'élèvent, et qui vise à maintenir certains rapports politiques de domination ou entre les hommes et les femmes au sein de la famille.
C'est un combat de longue haleine, mais il faut le respecter, et aider beaucoup le monde arabe. Le Parlement français devrait à mon sens lui apporter une valeur ajoutée en faisant une déclaration sur les femmes victimes des conflits armés, voire en prenant position pour un règlement rapide de ces conflits : non seulement les réfugiés sont à vos portes, mais la misère se multiplie !

Merci beaucoup, mesdames, pour ces exposés passionnants, qui éveillent bien des résonances de ce côté-ci de la Méditerranée, et que vous avez prononcés dans un français excellent, ce qui nous touche évidemment beaucoup.

Merci pour vos interventions.
Je vais faire un peu de provocation amicale : en vous écoutant, j'ai bien l'impression qu'il existe en France aussi un féminisme d'État. Désormais, chaque gouvernement, qu'il soit de gauche ou de droite, veut à tout prix afficher la parité ministérielle ; on en est à voter des lois qui garantissent la parité parmi les conseillers départementaux, après le quota de femmes dans les conseils d'administration qui va bientôt être pleinement appliqué. Or cette méthode ne donne pas de si mauvais résultats : on peut toujours la trouver imparfaite, mais elle permet au moins d'avancer.
Je le constate avec une grande tristesse, l'évolution du bassin sud-méditerranéen au cours des cinq dernières années témoigne en revanche d'une régression tous azimuts. Je me souviens de mes déplacements en Irak, qui était tout sauf une démocratie, mais pratiquait le féminisme d'État, en Égypte, en Tunisie – encore que ces deux pays se soient ressaisis, comme l'a dit Mme Kiwan. Dans toute cette zone qui a connu des révolutions, les droits de la femme reculent.
Ma question est, elle aussi, un peu provocatrice : est-ce vraiment un problème de démocratie, puisque les régimes autoritaires étaient beaucoup plus féministes que ceux qui ont pris le relais ? N'est-ce pas plutôt un problème de religion ?
En Turquie, l'évolution sans révolution est elle aussi très inquiétante.

Merci, mesdames, pour vos présentations passionnantes.
Vos propos m'ont inspiré beaucoup d'empathie, mais un point m'a étonné. À aucun moment vous n'avez parlé, y compris à propos de la rive nord de la Méditerranée, des sociétés matriarcales. C'est dans une société de ce type que je vis. Le matriarcat fait partie de leur culture, de leurs traditions. Le vrai pouvoir y est exercé par les femmes. Les hommes sont considérés comme des machos, comme violents envers les femmes, ce qui fait la mauvaise réputation de ces sociétés, alors que le machisme n'est qu'un spectacle puisque la réalité du pouvoir appartient aux femmes.
Vous parlez de modernité ; je vous comprends, c'est ce que nous vivons tous. Mais cela correspond, me semble-t-il, à une conception très anglo-saxonne des relations entre les hommes et les femmes. Dans votre stratégie très légitime qui vise à permettre l'évolution des sociétés méditerranéennes – en distinguant celles de la rive nord, de tradition chrétienne, et celles de la rive sud, de tradition musulmane –, comment intégrez-vous cette donnée ethnologique que sont les sociétés matriarcales ?

Je vous remercie à mon tour de vos exposés.
Vous avez évoqué le problème des dispositions législatives adoptées mais non appliquées, un problème que nous connaissons aussi en France – par exemple en matière d'égalité salariale.
Dans les pays dont vous nous avez parlé, n'est-ce pas aussi le rapport entre droit positif et droit coutumier qui pose un problème ? La loi n'est pas connue partout, de sorte que le droit coutumier s'applique au détriment du droit positif, ce qui nuit considérablement aux femmes. Comment remédier à cette situation ?
Dans différents pays auxquels je me suis intéressée, notamment au sein du réseau francophone, dont je fais partie, les violences envers les femmes sont toujours condamnées, la CEDAW ratifiée et les résolutions de l'ONU approuvées, mais il demeure dans le code de la famille des éléments qui empêchent de faire leur place aux femmes. Je songe à la filiation, à la transmission du patrimoine. On en parle peu, préférant dénoncer les violences faites aux femmes. Celles-ci sont évidemment épouvantables, mais que dire de l'impossibilité pour les femmes de transmettre leur patrimoine, leur nationalité, leur nom, d'hériter ? À la mort de leur conjoint, certaines n'ont plus droit à rien ou sont placées sous le joug d'un homme de leur belle-famille.

J'aimerais vous poser une question difficile, à laquelle je n'ai personnellement pas trouvé de réponse. Ce qui peut apparaître comme une régression des sociétés arabo-musulmanes en matière de droits des femmes, sous l'effet de la montée de l'islam radical, est-elle une sorte de convulsion en réaction au choc de la rencontre avec la modernité, mais qui s'inscrit dans la série des vagues décrites par notre seconde intervenante ? On aurait alors des raisons de rester optimiste à long terme : la tentation du repli identitaire, du retour en arrière, ne pourrait faire obstacle à l'entrée de ces sociétés dans la modernité.
En ce qui concerne la nécessité d'un « code culturel universel » et le « combat culturel » à livrer, comment les femmes, les féministes et les acteurs politiques du monde arabo-musulman pourraient-ils faire en sorte que cela n'apparaisse pas comme une forme d'impérialisme des valeurs occidentales ? Et comment pouvons-nous les y aider, si tant est que cela soit possible ?
Chez nous, les conquêtes féministes doivent beaucoup à la démocratie occidentale. Qu'auraient-elles été sans la République, sans les batailles démocratiques, sans les mouvements sociaux que la démocratie a permis ? On a d'ailleurs vu assez vite les limites du féminisme d'État défendu par les régimes non démocratiques, auquel il manquait l'essentiel : la démocratie.

Je n'aurai malheureusement le temps d'écouter que le début de vos réponses, mesdames, avant de devoir vous quitter pour un autre rendez-vous. Mais je lirai le compte rendu de la fin de l'audition.
Pour répondre à la question « provocatrice » de M. Mariani – est-ce l'absence de démocratie ou la religion qui fait obstacle au féminisme ? –, il me semble que, comme vient de le dire M. Hamon, l'égalité entre les hommes et les femmes est impossible, dans quelque culture ou quelque pays que ce soit, sans démocratie pleine et entière, sans reconnaissance aux femmes et aux hommes du même droit à la citoyenneté.
Qu'en est-il de nos sociétés arabo-musulmanes ? Elles ne sont d'ailleurs pas que cela ; on a parlé de code culturel universel, et l'on pourrait mentionner, sur notre rive de la Méditerranée, les composantes berbère, kabyle, africaine,…
Aussi : nous sommes tout cela à la fois.
Quoi qu'il en soit, on retrouve l'inégalité entre les hommes et les femmes dans les trois religions du Livre. Elle est liée à une civilisation patriarcale qui est née dans le Bassin méditerranéen.
Ensuite, l'Europe a fait sa révolution, particulièrement la France en 1789 ; et, en 1905, celle-ci a réussi à imposer ce que l'on appelle la laïcité, c'est-à-dire la séparation de l'Église et de l'État. À partir de là, on a bâti un État et une civilisation fondés principalement sur la République et la démocratie. Dans nos pays, il est essentiel que nous suivions le même chemin. À mes yeux, les dernières « révolutions » sont en fait des révoltes, et nous sommes en transition politique ; cette transition sera-t-elle révolutionnaire, admettra-t-elle la République et la démocratie ? Là est toute la question.
J'en viens au constat de M. Guibal : nous vivrions dans des sociétés matriarcales et – en substance – il y aurait une femme derrière tout grand homme.
C'est une formule que l'on entend souvent.
Vous dites en tout cas que le pouvoir est entre les mains des femmes : non. Nous souhaitons, nous, que le pouvoir soit partagé entre les femmes et les hommes et que, sans être identiques, ils aient droit à la même reconnaissance. C'est aussi de cette manière que les sociétés occidentales démocratiques et républicaines ont pu progresser. Il y a eu au niveau institutionnel et législatif des engagements qui se sont concrétisés par des législations égalitaires. Après la guerre s'est construit le système onusien, avec la Déclaration universelle, les pactes et l'ensemble des conventions portant plus précisément sur les droits humains fondamentaux des femmes.
Ce qui me permet de répondre incidemment à M. Hamon : ce n'est pas seulement l'Occident qui est à l'origine de ces instruments juridiques universels ; toutes les cultures du monde y ont contribué. Naturellement, l'Occident, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, a été pionnier, avec M. Hessel, Mme Roosevelt, M. Cassin ; mais le mouvement qu'il a lancé a entraîné et intégré toutes les cultures et toutes les civilisations. Je ne crois donc pas qu'il soit difficile de construire un code universel. Les instruments sont là. Simplement, nos pays sont encore fortement imprégnés de leur identité religieuse.
Voilà pourquoi la Tunisie est un laboratoire intéressant. Notre Constitution reconnaît un État civil – ce qui n'a guère de sens à mes yeux : l'État doit être démocratique et sécularisé, ce qui signifie que les textes fondamentaux ne doivent plus faire référence à la religion, afin d'éviter toute ambiguïté d'interprétation. Or la Constitution tunisienne continue de renvoyer à l'identité arabo-musulmane. Mais, par ailleurs, elle reconnaît aux femmes le droit à la parité dans toutes les élections, elle maintient dans son article 46 les droits acquis des femmes, elle contient un engagement à lutter contre toutes les formes de violence – non seulement physiques et sexuelles, mais institutionnelles et liées à la discrimination au sein de la famille.
Car malgré ces droits, en Tunisie comme dans l'ensemble des pays du Sud-Est de la Méditerranée, la femme n'est pas l'égale de l'homme s'agissant des relations familiales et du statut personnel. Mme Guittet y a fait allusion : le code tunisien du statut personnel prévoit l'inégalité successorale ; le père y reste le chef de famille. Je précise que les veuves ne peuvent être exclues de l'héritage de leur époux, mais en perçoivent un huitième. L'inégalité successorale réside dans le fait qu'au même degré de parenté, l'homme reçoit le double de la part de la femme.
Comment progresser ? Comment instaurer une véritable démocratie ? Par la séparation de l'État et du droit vis-à-vis de la religion. C'est fondamental. Aussi longtemps que l'on fera référence à l'identité arabo-musulmane et à la religion, il n'y aura pas d'égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Monsieur Mariani, le terme de féminisme d'État n'était pas connoté négativement dans ma bouche, au contraire : les femmes ne se portaient pas trop mal sous ces régimes par ailleurs répressifs.
Je note toutefois que les grandes actions sont souvent, à l'origine, le fait d'individus, et qu'elles prennent du temps. Voyez la manière dont le français a été imposé à toutes les provinces par François Ier, ce qui a largement contribué à consolider la communauté nationale. Ainsi des actions menées par quelques-uns ont-elles pu avoir des effets structurants sur l'histoire de leur société.
Je songe aussi à la moudawana de Bourguiba en Tunisie : c'est ce patrimoine qui a immunisé les femmes contre la récente montée en puissance des islamistes et qui a permis de conserver le terme d'« égalité » dans la Constitution, plutôt que « complémentarité » ou « équité » (insâf), proposés par les islamistes. On le doit à un homme éclairé qui était musulman, qui croyait en Dieu, mais qui estimait que la vie quotidienne devait être civile. C'est lui qui a mis les choses en marche ; évidemment, il n'est pas allé jusqu'au bout.
Au Maroc aussi, le code de la famille est né de l'initiative du roi. Celui-ci a installé une commission qui, après avoir procédé à des consultations pendant deux ans, se trouvait divisée : elle lui a donc remis deux rapports. Il a choisi le projet le plus éclairé et l'a fait adopter à la Chambre. Les islamistes s'y sont opposés par des mouvements de rue, mais, fort de sa légitimité de commandeur des croyants, le roi est allé de l'avant. Et le code qui en résulte est assez avancé même si, comme l'a très bien dit Alya, il continue, comme en Tunisie, de se placer dans une perspective musulmane : l'un et l'autre codes partent du texte religieux.
Cela dit, la notion de charia elle-même peut être interprétée de deux manières différentes, et ce point divise fortement les exégètes. Soit c'est le Coran et lui seul qui fonde l'organisation de la cité, soit c'est le texte coranique auquel on adjoint les hadîths nabaoui (paroles du Prophète) et la sîrat an-nabi – la vie du Prophète, relatée un peu à la manière des Évangiles chez les chrétiens : ce que le Prophète a fait ou dit dans telle ou telle situation.
Vous avez à l'esprit vos sociétés laïques ; mais songez que leur sécularisation est le fruit d'un processus long de plusieurs siècles. Il fallait une brèche dans la compréhension des textes religieux : elle a été ouverte par Saint Thomas. Celui-ci a introduit la liberté de pensée au sein du christianisme, laquelle a mené à la sécularisation et a sauvé le christianisme de l'instrumentalisation qui en était faite, la même que subit aujourd'hui l'islam dans nos sociétés.
On a l'impression d'une complicité secrète entre les régimes répressifs, qui accaparent le pouvoir politique, et les hommes, auxquels est abandonné le pouvoir au sein de la famille. Le code de la famille est un peu le jouet qu'on laisse aux hommes : ils sont maîtres chez eux, ils ont droit à une double part d'héritage, etc.
Il y a aujourd'hui parmi les musulmans beaucoup de personnes favorables à une lecture structurale du Coran lui-même. Ainsi, dans ce passage où il est dit que la part d'héritage de l'homme est le double de celle de la femme, figure également une répartition des obligations qui est tout à fait inégale puisque toutes sont confiées à l'homme et que la femme n'en a aucune. Des personnes éclairées qui cherchent à donner un sens au texte en proposent donc une interprétation selon laquelle, si les hommes et les femmes ont aujourd'hui des obligations égales, rien ne justifie que leurs droits successoraux soient inégaux. Il faut respecter ces tentatives émanant de musulmans de notre temps, qui font face à un dilemme mais qui veulent sauver la religion. Laissons-les faire : nous n'avons rien contre.
Le féminisme d'État n'est pas une mauvaise chose, y compris en France, comme vous l'avez si bien dit, monsieur Mariani – il est même élégant de votre part de l'avoir si bien dit. Ce féminisme d'État est nécessaire, car les règles du jeu peuvent structurer les comportements : si l'on agit au sommet, non seulement à l'initiative du régime mais par la loi, si les textes adoptés sont en avance sur les mentalités et les conduites sociales, celles-ci peuvent évoluer. Si la conviction est là, il ne faut pas hésiter à agir. Je l'avoue, je suis volontariste, comme tous les militants : je n'attends pas que tout le monde soit convaincu, je le suis tellement moi-même que je tire les autres vers l'avant ! Et c'est le cas s'agissant de ce code universel.
Monsieur Guibal, je voulais laisser Alya vous répondre à propos des sociétés matriarcales, mais j'ajouterai que les sociétés occidentales sont en pleine transformation. La famille et les rapports en son sein changent profondément : en témoignent le nombre croissant de familles monoparentales et le fait qu'un couple, fût-il marié ou pacsé, ne dure pas toute la vie.
M. Hamon s'interrogeait sur la régression des droits des femmes. Elle est réelle. Mais, pour paraphraser un révolutionnaire : « Deux pas en avant, un pas en arrière » ! Il y a toujours dans la société des forces de résistance qui tirent vers l'arrière. C'est ce mouvement que nous vivons aujourd'hui. C'est dans les zones de conflit armé que les femmes sont vraiment dans une situation tragique. Dans les pays qui ont réussi à instaurer une certaine stabilité, comme la Tunisie et l'Égypte, les constitutions ont consacré un progrès en la matière. Il convient donc d'être nuancé.
Madame Guittet, vous avez parfaitement raison : l'enjeu est de passer du droit coutumier au droit positif – pour appeler un chat un chat, du droit religieux au droit positif. Mais seules les personnes directement concernées devraient le faire. Nous devons leur témoigner beaucoup d'amour, de compréhension, de respect vis-à-vis de leur religion.
Je suis personnellement convaincue que l'islam a opéré une véritable révolution culturelle par rapport à la Jâhiliyya, l'anté-islam. À l'époque, on brûlait vives les filles, les gens s'entretuaient sur le fondement de la asabiyya tribale et clanique. « Que de frères tu peux avoir que ta mère n'a pas mis au monde », a dit le Prophète lors de conversations avec ses proches : cela montre qu'il concevait une fraternité entre les humains qui ne repose pas sur les liens du sang. Même le Coran est permissif vis-à-vis des non-musulmans : « point de contrainte en religion », dit-il. Cette parole du Prophète date d'un temps où tous étaient intolérants, où les peuples devaient avoir la même religion que leur roi. Il a aussi appelé à la tolérance à l'égard des gens du Livre. Ce qui est arrivé ensuite, ce n'est plus le Prophète ni le Coran !
Bien avant que nous n'inventions la démocratie dans les temps modernes, le Prophète a aussi appelé à la choura, la consultation : « Que votre gouvernement soit affaire de consultation parmi vous ! » Il avait même préconisé que le califat disparaisse une trentaine d'années après son départ. Il a été très ambigu pour ne pas indisposer Ali, évitant de désigner comme son successeur Abou Bakr qui se rapprochait de lui par sa sagesse et qui était plus âgé que ses autres compagnons, mais qui n'était pas son parent proche, à la différence d'Ali. Il n'en a pas moins rompu avec l'idée que le successeur devait faire partie de la proche parentèle.
Ce sont là des intuitions évoluées pour une époque aussi lointaine. Aujourd'hui, la légitimité religieuse est instrumentalisée pour nous faire digérer des choses qui ne sont plus acceptables de notre temps.
Pour passer au droit positif, il faut d'abord créer des brèches dans le code culturel musulman, ce que seuls les musulmans, je le répète, peuvent faire : nous devons les encourager, rien de plus. Monsieur Hamon, vous parlez d'impérialisme de l'Occident, mais le code que j'ai évoqué est défendu par tous les militants de nos sociétés, qui en reconnaissent le caractère universel et n'y voient pas un produit occidental. Nous utilisons ces instruments dans les combats que nous menons chez nous, nous nous les approprions. L'idée que l'Europe voudrait nous faire la leçon ou nous acculturer n'a plus cours. C'est l'évolution de la communauté internationale au sein du système des Nations Unies au cours des dernières décennies et l'instauration progressive de nombreux instruments juridiques et de suivi – notamment les réunions internationales – qui ont donné au débat cette portée internationale. Nous avons là un instrument de combat qui peut servir aux hommes comme aux femmes du monde arabe à défendre la démocratie, le respect des droits humains et la reconnaissance des droits des femmes.

Vous insistez, madame, sur le fait que la sécularisation est un long combat, y compris dans les sociétés européennes dont la société française. Je suis d'accord s'agissant de certains acquis de la loi de 1905, comme des lois républicaines et laïques de la fin du xixe siècle. À certains égards, ce combat n'est d'ailleurs pas achevé – même s'il n'a pas la même acuité que celui dont vous parlez à propos du monde arabe –, comme en atteste le retour dans notre pays de la religion dominante, le catholicisme. Mais j'ai un peu de mal à vous rejoindre quand vous soutenez que c'est la religion catholique qui, par l'intermédiaire de Saint Thomas, a ouvert la première brèche. Ce qui a ouvert la voie à la séparation des Églises et de l'État, c'est une lutte d'une grande violence à la fin du xixe siècle et au début du xxe. Les débats de 1905 ici même en témoignent : le parti clérical a combattu la séparation avec une violence inouïe ; et la violence a pris une tournure quasi insurrectionnelle lors de l'épisode des inventaires, un peu plus tard.
Je suis tout à fait d'accord. Ce que vous dites me rappelle d'ailleurs un mot de l'historienne Madeleine Rebérioux, qui fut présidente de la Ligue française des droits de l'homme et que j'avais retrouvée à Marseille pour parler, justement, des droits des femmes du Bassin méditerranéen. Elle m'a éclairée à propos du processus de sécularisation en rappelant que les femmes, en France, étaient encore sur les genoux de l'Église au sortir de la guerre et qu'il a fallu du temps pour qu'elles cessent d'écouter la consigne religieuse. Elle définissait précisément la sécularisation par l'autonomie croissante de la conscience individuelle et de la morale privée vis-à-vis de cette consigne.
Revenons à nos pays, en particulier la Tunisie. Je suis très réticente vis-à-vis du féminisme d'État. Il y fallait un Bourguiba, une volonté politique. Mais ni M. Bourguiba ni M. Moubarak n'ont jamais été féministes. Le premier, qui fut un précurseur en matière de droits des femmes mais sans leur accorder l'égalité totale, a toujours considéré que les femmes étaient des mères, des épouses, des soeurs avant d'être des citoyennes. Voilà pourquoi il n'est pas allé jusqu'au bout de ce qu'il avait entrepris d'instaurer : une société moderniste qui reconnaîtrait l'égalité entre les femmes et les hommes. Toutefois, dans notre société, c'est grâce au code du statut personnel que les femmes, mais aussi les hommes, ont pris du recul vis-à-vis de la consigne religieuse et ont commencé à se comporter de manière sécularisée. Quand les femmes décident d'avorter, elles n'obéissent pas à la consigne religieuse. Quand on envoie les petites filles à l'école, à l'école mixte, on n'obéit pas à la consigne religieuse.
Néanmoins, depuis quelque temps, particulièrement depuis une vingtaine d'années, nous sommes témoins au sein des sociétés maghrébines d'un phénomène de piétisation, en lien avec la conjoncture géopolitique régionale au sens large, principalement avec le conflit israélo-palestinien qui pose un très gros problème identitaire, mais aussi avec l'Irak ou l'Afghanistan. Ce recul au sein de sociétés qui s'étaient modernisées résulte également de la manière dont les communautés musulmanes en Occident, particulièrement en France, sont régulièrement stigmatisées au moindre problème, en particulier sous l'effet de l'extrémisme politique.
Voilà pourquoi je soutiens que nous devons repenser notre stratégie, tisser des liens de solidarité entre le Nord, le Sud et l'Est en nous appuyant sur les fondamentaux définis par les instruments internationaux relatifs aux droits humains, afin de progresser ensemble, et surtout bâtir un véritable partenariat. Celui-ci, je l'ai dit, ne doit pas concerner les seules institutions étatiques, mais aussi la société civile et les associations de femmes. C'est à elles que nous devons d'avoir fait reculer le parti islamiste tunisien qui était majoritaire à la Constituante, et d'avoir adopté une Constitution égalitaire et paritaire même si son article 1er fait référence à l'identité arabo-musulmane.
Le défi auquel nous sommes désormais confrontés correspond à celui qu'a évoqué Mme Guittet, même si je le formule différemment : il consiste à harmoniser les textes de loi – le droit positif actuel – avec les principes constitutionnels. Cela vaut de la Tunisie comme du Maroc et de l'Algérie. Le combat sera beaucoup plus dur en Égypte où le président, certes porté au pouvoir par les urnes, n'est pas féministe et n'impose nullement un féminisme d'État, et où l'on observe un mouvement de répression très préoccupant – sans parler, évidemment, de la Syrie ni des autres États de la région.
Je suis moi aussi parfaitement d'accord avec vous, monsieur Glavany. Toutefois, la France n'est pas le seul pays à s'être sécularisé. En France, le processus a pris une forme particulière, brutale, en raison de la position qu'occupait l'Église sous l'Ancien Régime. Mais toutes les sociétés occidentales ont connu une démythification progressive de la métaphysique et un recours croissant au droit positif pour fonder la vie en commun. C'est l'individuation graduelle des rapports sociaux qui a permis de concevoir le citoyen, plutôt que la famille, comme un sujet de droit face à l'État. Voilà pourquoi le chemin qui s'ouvre devant nous reste long et difficile.
Les sociétés arabo-musulmanes sont largement musulmanes, mais ne le sont pas entièrement, et l'islam n'est pas uniquement arabe. Sur un milliard et 350 millions de musulmans dans le monde, 300 millions seulement sont arabes, et sur 350 millions d'arabes, quelque 300 millions sont musulmans. Ces sociétés, je l'ai dit, sont très partagées, entre différents mouvements – modernistes, favorables à la sécularisation, de gauche, traditionnels, islamistes. Et l'islamisme lui-même revêt plusieurs formes. Ne mettons donc pas les islamistes à l'écart au risque de les voir devenir tous salafistes. Il faut leur faire croire que nous croyons qu'ils veulent certes faire respecter la religion, mais aussi la réconcilier avec la modernité. Ceux qui adhèrent aux mouvements islamistes « modérés » – même si je ne crois pas à cette modération, car le gris, entre le noir et le blanc, me fait peur – sont à mi-chemin : pourquoi ne pas les attirer vers nous au lieu de les brutaliser, ce qui les poussera vers le radicalisme – qui n'est pas encore le terrorisme ?
Nous devons rétablir le sens de l'historicité des événements. Même moi, fille du pays et du monde arabe, je ne peux forcer les autres à penser comme moi alors que mes conditions particulières de vie, mon milieu immédiat m'ont offert des opportunités qui ne sont pas données à tous. Bref, il faut aider et laisser faire.
L'aide à apporter concerne essentiellement l'amélioration des textes de loi. Je l'ai dit, je crois beaucoup au volontarisme, dont la Révolution française nous fournit un excellent exemple : on n'a pas attendu que tout le monde ait évolué pour instaurer un régime entièrement nouveau. Permettez-moi pour finir de lancer une fleur aux Français. Ayant toujours remarqué que la situation des femmes était bien meilleure au Maroc, en Algérie et en Tunisie, et même en Mauritanie, que dans le Machrek, nous avons fait des recherches qui nous ont montré que cela résultait de la proximité non seulement géographique, mais culturelle, de ces pays avec le vôtre.
La séance est levée à dix-huit heures trente.