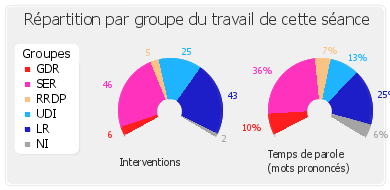Séance en hémicycle du 12 février 2015 à 15h00
Sommaire
- Débat sur le rapport d'information sur le fair-play financier européen et son application au modèle économique des clubs de football professionnel français (voir le dossier)
- Débat sur le rapport d'information sur l'évaluation de l'adéquation entre l'offre et les besoins de formation professionnelle (voir le dossier)
- Croissance activité et égalité des chances économiques (voir le dossier)
- Ordre du jour de la prochaine séance (voir le dossier)
La séance

La séance est ouverte.
La séance est ouverte à quinze heures.
Débat sur le rapport d'information sur le fair-play financier européen et son application au modèle économique des clubs de football professionnel français
Débat sur le rapport d'information sur le fair-play financier européen et son application au modèle économique des clubs de football professionnel français

L’ordre du jour appelle le débat sur le rapport d’information sur le fair-play financier européen et son application au modèle économique des clubs de football professionnel français.
La Conférence des présidents a décidé d’organiser ce débat en deux parties.
Dans un premier temps, nous entendrons tout d’abord les orateurs des groupes, puis le Gouvernement.
Nous procéderons ensuite à une séance de questions-réponses. La durée des questions et des réponses sera limitée à deux minutes, sans droit de réplique.
La parole est à Mme Marie-George Buffet.

Monsieur le président, monsieur le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, monsieur le président de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, mes chers collègues, vendredi dernier, un quotidien sportif titrait : « La Ligue 1 est-elle à vendre ? ». La question peut surprendre ; elle est pourtant pertinente. Certes, le football est le sport le plus pratiqué. Avec près de deux millions de licenciés, avec ses éducateurs et bénévoles, la Fédération française de football est la première fédération sportive de France.
Le football est aussi le sport le plus populaire, tant par le nombre de ses supporters que par le taux de suivi des retransmissions audiovisuelles. Cet engouement, cet intérêt commun pour le football se traduit non seulement dans le soutien à l’équipe de France, mais aussi, beaucoup, dans l’attachement à un club. Ainsi, 46 clubs professionnels emploient plus de 1 000 joueurs professionnels auxquels s’ajoutent les joueurs en formation, les encadrants sportifs et les administratifs. Au total, ces clubs sont porteurs de plusieurs milliers d’emplois. Beaucoup a été dit sur les enjeux financiers qui traversent ce sport, ainsi que sur les sommes colossales perçues, dans les salaires ou les transferts.
Mais le rapport d’information publié en juillet 2013, intitulé « Le fair-play financier : une nouvelle époque pour le football français en Europe ? » auquel j’ai pu contribuer avec mes collègues Thierry Braillard, appelé aujourd’hui à d’autres responsabilités, Pascal Deguilhem et Guénhaël Huet, a montré que cette peinture à grands traits cachait de grandes fragilités.
Le rapport révélait d’abord une grande diversité de situations entre les clubs professionnels français. D’un côté, une minorité de grands clubs sont largement financés par des fonds étrangers, qui capitalisent sur l’image de ces clubs et se placent stratégiquement. Ces logiques financières permettent, à courte échéance, de subvenir aux besoins et surtout aux ambitions de ces clubs, avec l’achat de grands joueurs. Cependant, elles ne présentent aucune garantie quant à la pérennité de leur investissement. Ayant interrogé les responsables des deux clubs les plus concernés par ces financements sur les garanties qu’ils avaient à long terme de leurs financeurs, aucun n’a pu me donner une réponse claire.
De l’autre côté, de nombreux clubs ne bénéficient pas de l’effet d’aubaine de ces capitaux étrangers et se retrouvent dans des situations de réelle fragilité économique. Au coeur du problème figurent des masses salariales trop importantes pour des budgets reposant sur un modèle économique à bout de souffle. Cette situation s’explique non seulement par les conséquences de la crise, mais aussi par une diversification des recettes insuffisante. Ainsi, en dehors des revenus des transferts, qui sont fluctuants et qui n’ont de véritable incidence que sur le budget de certains clubs, le modèle économique du football professionnel français apparaît trop télédépendant.
Un récent rapport du Conseil supérieur de l’audiovisuel révèle ainsi que si le football représente 81 % des droits de retransmissions sportives en France, on assiste non seulement à un tassement de l’audience sur les chaînes gratuites, mais également à un ralentissement de la croissance des marchés des droits.
Une partie de plus en plus risquée est menée entre la Ligue 1 et les médias sur ces droits de retransmission. Les chaînes payantes offrent plus, mais, en leur vendant les droits, le football se prive de la large audience des chaînes gratuites. Les résultats d’exploitation en Ligue 1, la différence entre les charges des clubs et leurs revenus, sont structurellement déficitaires, avec une différence moyenne négative de 274 millions d’euros. De nombreux clubs équilibrent tant bien que mal leurs trésoreries grâce aux actionnaires et aux transferts.
Nous avons, en France, des centres de formation particulièrement efficaces et reconnus, ce dont nous nous félicitons. Ces centres forment des joueurs qui, pour certains d’entre eux, évolueront demain sur le marché international du football. Mais, comme je l’évoquais précédemment, ces transferts sources de revenus, par leur nature exceptionnelle, n’autorisent pas de vision stratégique de long terme. De plus, ils privent les clubs français de talents.
Le rapport d’information a alors évoqué l’application du fair-play financier initié par le président de l’Union européenne des associations de football – UEFA –, Michel Platini, comme un possible remède à cette situation préoccupante. Le fair-play financier est apparu aux yeux des rapporteurs de la mission d’information comme un outil positif. Permettant de mettre un frein aux dérives actuelles ou potentielles du football professionnel, il peut ralentir la course aux salaires et aux transferts en exigeant un équilibre budgétaire.
Notons qu’en France, l’exercice budgétaire des clubs était déjà placé, depuis 1984, sous le contrôle efficace de la Direction nationale du contrôle de gestion – DNCG. Néanmoins, les outils et pratiques encouragées par le fair-play ne règlent pas une question fondamentale, celle de l’égalité de ressources entre les clubs. Contrairement à la DNCG, en visant l’équilibre financier, le fair-play peut figer les inégalités existantes.
Aussi, compte tenu de la place du football dans le sport et dans la société française, et dans un souci d’équité sportive, les membres de la mission d’information ont étudié la diversification et la pérennité des ressources des clubs, la maîtrise de leurs dépenses, faisant plusieurs recommandations afin d’assurer un développement durable du football en France. Certaines de ces recommandations relèvent du domaine de la loi ; d’autres sont à destination du mouvement sportif ; quelques-unes enfin concernent l’action de la France dans l’Union européenne.
Mon propos, se concentrera sur certaines d’entre elles, en sollicitant, monsieur le ministre, votre avis sur leur opportunité et leur mise en oeuvre.
La recommandation 2, tout d’abord, répond à la question brûlante de la régulation en proposant la mise en place d’un Observatoire européen du sport professionnel, afin de mieux définir et sécuriser la « spécificité sportive » et de promouvoir le modèle européen du sport. On sait la longue bataille qui fut nécessaire pour que ces spécificités soient reconnues à l’échelle européenne, en annexe du traité de Nice, en 2001. Pensez-vous, monsieur le ministre, qu’une nouvelle étape puisse être franchie concernant le sport professionnel en Europe ?
Les recommandations 6 et 9 permettent d’assainir la gestion des carrières et de limiter les conflits d’intérêts au sein des clubs en rétablissant la rémunération de l’agent sportif par le seul joueur et en instaurant une incompatibilité temporaire entre les fonctions d’agent sportif et d’agent entraîneur. Ces mesures visent également à assurer de meilleures conditions de pratique et de carrière pour les joueurs, en leur donnant plus de maîtrise sur celles-ci.
Ces dispositions, comme celles de la recommandation 25, visant à revenir aux sociétés anonymes à caractère sportif et à limiter le soutien des collectivités territoriales aux missions d’intérêt général et à la formation, relèvent de mesures législatives modifiant le code du sport. Quelles sont, monsieur le ministre, vos intentions à ce sujet ? Vous nous aviez fait part, en commission, de vos interrogations sur l’utilité d’une loi-cadre sur le sport. Qu’en est-il aujourd’hui ? Une loi plus centrée sur le sport professionnel est-elle envisageable ?
D’autres recommandations, comme la suppression du mercato d’hiver, la fixation d’un plafond de masse salariale exprimé en pourcentage du chiffre d’affaire des clubs, ou l’extension du rôle de la DNCG ont-elles été débattues avec la FFF ?
Alors que l’Union des clubs professionnels de football – UCPF – évoque un « décrochage sportif et économique », toutes ces mesures pourraient permettre aux clubs de stabiliser leur masse salariale, d’avoir une maîtrise sur le long terme de leurs moyens et donc, de se focaliser pleinement sur leurs ambitions sportives.
Au-delà de ces dispositions, c’est bien d’une nouvelle dynamique que le football français a besoin. Aussi, le rapport propose de mieux valoriser les clubs formateurs par un mécanisme de contribution de solidarité, de 25 % sur les transferts. Il insiste aussi sur la nécessité de garantir une éducation citoyenne aux jeunes en cours de formation. L’importance des éducateurs est en effet connue, face parfois, au mirage du sport professionnel pour les jeunes.
Le football doit aussi appartenir à ses supporters. A ce titre, le modèle des « socios » en Espagne ou du 50+1 en Allemagne permettrait à la fois d’assurer de nouveaux revenus et d’impliquer dans la vie financière et administrative des clubs les acteurs et actrices les plus nombreux du football, les supporters. Les associations de supporters ont d’ailleurs présenté hier au Sénat une proposition de loi sur laquelle j’aurai l’occasion de vous interroger tout à l’heure.
Je terminerai mon propos par la recommandation 15, relative à l’obligation de constituer des équipes féminines pour l’octroi de la licence de club. Parmi ses licenciés, la FFF ne compte que 4,5 % de femmes. Il est donc plus que temps de prendre des mesures volontaristes, afin que chacun et chacune puisse pratiquer ce sport. Et quoi de plus naturel que d’utiliser la vitrine qu’est le sport professionnel pour cela ? On sait que la visibilité de la pratique et son exposition médiatique sont essentielles pour faire naître des vocations. Le rapport du CSA, mentionné auparavant, le souligne : des suites lui seront-elles données ? A cet égard, pouvez-vous, monsieur le ministre, nous préciser également l’objectif sportif poursuivi par l’article 62 de la loi dite loi Macron concernant la publicité sur les stades ?
Au nom du groupe GDR, je souhaiterais connaître, s’agissant de ces diverses recommandations, votre appréciation, vos intentions et l’action que votre ministère compte engager.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, lors des nombreuses auditions effectuées à l’occasion de la mission d’information parlementaire par les rapporteurs – je salue ici Marie-George Buffet et Guénhaël Huet –, je me souviens de l’étonnement, voire de l’irritation qui a été celle de certains acteurs auditionnés face à l’intrusion du législateur dans le monde du football professionnel.
Au-delà cet hémicycle peu rempli, le court débat de cet après-midi sera sans doute regardé par les acteurs du football professionnel. Je veux donc à nouveau rappeler ici que cette mission d’information, qui a toujours eu pour souci d’analyser de manière objective et dépassionnée la réalité à laquelle sont confrontés les clubs de football professionnels français, visait à oeuvrer à la construction d’un modèle économique performant, soutenable et respectueux de l’éthique sportive. Ce fut le sens des vingt-six propositions arrêtées par les rapporteurs.
C’est aussi parce que le football occupe une place particulière dans le paysage sportif, par le nombre de ses pratiquants, par le poids économique qu’il représente, par la place qui est la sienne dans les médias, que les rapporteurs ont souhaité établir ce diagnostic partagé. Les rapporteurs ont bien conscience que les recommandations qui découlent de cette mission d’information relèvent, pour nombre d’entre elles, de l’initiative des acteurs du football et pour quelques-unes d’entre elles, des pouvoirs publics.
L’initiative du groupe GDR, visant à faire le point avec le Gouvernement sur cette question, est tout à fait légitime. C’est bien le sens du travail parlementaire que de donner vie aux rapports d’information.
La nouvelle réglementation de l’UEFA, dont l’objectif est d’assurer une meilleure maîtrise des dépenses des clubs au regard de leurs recettes, figure au coeur du débat. En effet, en France, comme dans de nombreux pays européens, trop d’excès ont nui à l’image du football professionnel, qui se trouve à ce titre dégradée et menacée. Oui, car telle est la situation ! Ce n’est pas moi qui le dis, ce sont les acteurs eux-mêmes.
Bien que la question du fair-play financier ne concerne que quelques clubs dans le championnat national, mais aussi européen, c’est la situation financière d’une majorité de clubs qui devient intenable. Il en va de même pour de nombreux clubs de Ligue 2, et particulièrement pour ceux qui passent régulièrement de la Ligue 2 à la Ligue l.
Sans caricaturer la situation d’un sport qui fait vibrer tant de supporters, qui réunit tant de téléspectateurs, qui apporte souvent de la fierté à la nation dans les grandes compétitions internationales et donc prochainement, ici en France en 2016, je veux garder un oeil éclairé sur la situation du football professionnel car elle n’est pas sans incidence sur l’ensemble de la pratique. C’est une activité où la concurrence est excessivement forte, où les inégalités se creusent année après année. C’est une activité économique où le capital financier s’est concentré dans quelques équipes, dans l’hexagone et en Europe, dans les plus grandes métropoles au fort pouvoir d’attraction.
Ces équipes attirent les meilleurs joueurs, les investisseurs les plus fortunés, les spectateurs les plus nombreux. Elles deviennent ou sont déjà propriétaires de leurs installations et concentrent l’attention des médias. Mais la quasi-totalité des autres équipes, si nécessaires à l’organisation d’un championnat et d’un spectacle sportif qui doit rester équilibré pour capter l’attention, connaissent des budgets huit à dix fois inférieurs, et l’écart ne cesse de se creuser entre les équipes du haut et celles du bas du tableau.
Quant au marché des transferts, qui sera évoqué au cours des questions, il se concentre pour les trois quarts sur les équipes phares. Ainsi, tous les clubs qui n’appartiennent pas au cercle des riches – ils sont très nombreux –, ne survivent que grâce à l’implication de partenaires historiques passionnés, à la qualité de leur formation, qui permet d’opérer des transferts indispensables à leur équilibre financier, avec pour effet contraire d’expatrier les talents issus de leur formation.
Dans cet équilibre, il est heureux que nous nous soyons dotés, avec la Direction nationale d’aide, de contrôle et de gestion – DNACG –, d’un organe de contrôle efficace. Malheureusement, celle-ci ne peut toutefois tout prévenir, en particulier les aléas sportifs qu’on a parfois tendance à oublier.
De l’avis partagé des rapporteurs de la mission d’information, la mise en place du fair-play financier européen apparaît donc comme un outil efficace pour apporter les corrections nécessaires à certaines dérives. Je ne m’attarderai pas sur la question de savoir si le fair-play financier fige ou non une situation d’inégalité, car ce n’est pas, à mon sens, l’objet de notre échange cet après-midi.
Nos échanges visent au contraire à faire le point sur ce que peut faire le Gouvernement ou le pouvoir législatif, ou ce qui a déjà été engagé au regard des recommandations de la mission. En invoquant souvent la discipline financière, l’arrêt de l’inflation des salaires et des transferts, la nécessaire recherche de diversification des revenus, on met trop peu en avant une disposition vertueuse et majeure du fair-play : l’orientation des investissements vers les moyens dédiés à la formation et les infrastructures.
Parmi les cinq propositions que les rapporteurs ont formulées sur la valorisation de la formation, j’attache une importance toute particulière à la proposition 14. Je sais, monsieur le ministre, l’intérêt que vous portez à ce sujet. Dès lors, pourriez-vous nous indiquer de quelle façon vous souhaitez appréhender cette proposition ?
Ne pouvant, faute de temps, aborder que quelques sujets, je souhaite cependant faire le lien entre la formation et les circuits financiers issus des transferts, les indemnités liées à la formation en étant l’un des aspects. Comme l’actualité nous le rappelle, l’opacité demeure sur les flux financiers relatifs aux mouvements des joueurs.
Ainsi, la recommandation no 4 tend à faire transiter sur un compte dédié de la Ligue Pro l’ensemble des indemnités dues en cas de mutation de joueurs.
Enfin, est-il nécessaire de rappeler que notre football professionnel dispose d’un atout privilégié, avec la perspective de l’Euro 2016 en France, pour mettre en oeuvre les évolutions et régulations nécessaires et en promouvoir la diffusion en Europe.
La responsabilité du Gouvernement et notre responsabilité de législateur est de l’encourager et de l’aider dans cette voie. Le groupe SRC y est prêt.
Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des affaires culturelles, chers collègues, le football est le sport le plus populaire en France, en Europe et dans le monde. Les grandes compétitions internationales et mondiales sont des rendez-vous très attendus et très suivis, qui suscitent une ferveur et une émotion populaires incontestables. À cet égard, le football, comme d’autres disciplines sportives – je pense notamment au cyclisme –, au-delà de sa capacité à faire rêver, exerce une véritable fonction de lien social dans une société qui en a bien besoin.
Mais le football est aussi, nous le savons bien, en proie à de graves dangers qui le menacent – la violence, les fraudes de toute nature et l’inflation financière que connaissent depuis plusieurs années de nombreux clubs et de nombreux championnats. La récente vente des droits de retransmission télévisée du championnat britannique – près de 7 milliards d’euros pour trois ans – est à cet égard très révélatrice.
Afin de répondre à l’endettement de certains clubs, mais aussi de redonner toute sa place à l’esprit de compétition, l’UEFA a mis en place la règle du « fair-play financier » – ou, mieux encore, dans notre langue, une série de bonnes pratiques que doivent respecter les équipes qui participent aux compétitions qu’elle organise.
Le fair-play financier a été mis en place voilà un peu plus de quatre ans afin d’interdire aux clubs de football européens participant aux compétitions de l’UEFA de dépenser plus d’argent qu’ils n’en gagnent. L’objectif affiché par I’UEFA est sans équivoque : il s’agit d’assainir les comptes des clubs de football.
Plongés au coeur d’un cercle vicieux de surendettement, de transferts et de salaires démentiels, les clubs européens étaient dans une situation financière particulièrement inquiétante. Leurs pertes ont atteint un montant record de 1,6 milliard d’euros en 2010. Signe parmi d’autres de la dérive du système, certains joueurs espagnols n’ont pas reçu de salaires pendant presqu’un an, car leurs clubs étaient trop endettés.
Le fair-play financier vise donc à garantir la stabilité à long terme du football en instaurant une discipline budgétaire et en rationalisant les finances des clubs. Avec ce système, tous les clubs doivent équilibrer leurs comptes et seront placés sous la surveillance de l’instance européenne. Quatre critères ont été définis à cette fin par l’UEFA : la possibilité financière pour le club de poursuivre son activité, l’absence de fonds propres négatifs, l’équilibre financier et l’absence de dettes envers d’autres clubs, des joueurs ou le fisc.
Si un club ne remplit pas l’un de ces critères, il doit fournir un rapport détaillant les mesures prévues pour y remédier. Des explications lui seront également demandées si sa masse salariale dépasse 70 % de son budget ou si sa dette est supérieure à son chiffre d’affaires.
Cependant, le fair-play financier ne peut, à lui seul, régler tous les problèmes. Il existe en effet, une vraie différence entre les grands clubs, qui sont très endettés en raison des montants des transferts, et des clubs plus petits qui ont chaque année des déficits importants.
À l’occasion du rapport d’information publié en juillet 2013 – je veux à mon tour saluer Thierry Braillard, Marie-Georges Buffet et Pascal Deguilhem –…

… nous avons pu constater que le système français était celui qui organisait le mieux le contrôle des clubs grâce à la Direction nationale des comptes de gestion.
Malgré tout, il faut aller plus loin et il importe de souligner qu’une nouvelle loi, si elle apparaît souhaitable et si tel était votre projet, ne pourrait pas régler tous les problèmes – il existe du reste déjà un arsenal juridique assez précis en la matière.
Surtout, il est indispensable que l’Europe se saisisse de ce dossier et travaille à mieux connaître la spécificité sportive. Un coup d’accélérateur est nécessaire car, si tout le monde déclare soutenir l’UEFA s’agissant du fair-play financier, ce soutien reste relativement distant pour l’instant. Il faut donc que l’Union européenne prenne toutes ses responsabilités.
Par ailleurs, il est très important de s’attaquer à la source des problèmes financiers des clubs de football, que sont les transferts de joueurs, multipliés par plus de trois en une quinzaine d’années, passant de 5 300 par an dans les années 1995-2000 à près de 20 000 aujourd’hui.
Depuis la mise en place du fair-play financier, les pertes des clubs européens ont été divisées par deux en deux ans. Si la plupart des clubs soutiennent ces nouvelles règles, certains les trouvent injustes. Pourtant, le fair-play financier est un pas supplémentaire vers l’équité entre les différents clubs de football et nous devons collectivement appuyer cette saine démarche de l’UEFA.
Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des affaires culturelles, mes chers collègues, la vérité de l’effort et de la performance, qui seule peut faire mentir les pronostics, est l’âme même du sport. En elle réside la glorieuse incertitude du sport, cette part d’incertitude, cet aléa intrinsèque à la compétition, qui doit être préservé à tout prix pour que le sport continue d’être une école de la vie.
La glorieuse incertitude du football, sport populaire par excellence, est-elle en danger ? Telle est la principale question soulevée par le débat qui nous réunit aujourd’hui.
Le constat est clair : la puissance financière démesurée de certains clubs européens, les transferts et les salaires excessifs mettent en péril l’équité du sport. En outre, comment ne pas voir que les dépenses incontrôlées ou le manque de sérieux budgétaire et comptable menacent la pérennité de ces clubs et fragilisent l’économie générale de ce sport ?
Le « fair-play financier », qui trouve depuis le 28 mai 2010 sa traduction dans le règlement de l’UEFA, vise à encadrer ces pratiques. Nous pouvons nous féliciter que la France soit, en la matière, à l’avant-garde, la Direction nationale du contrôle de gestion de la Ligue de football professionnel ayant oeuvré à prévenir les dérives les plus importantes.
Cependant, l’application du fair-play financier au modèle économique des clubs de football professionnel français exige d’aller plus loin encore.
Ces règles obligent en effet les clubs à équilibrer leurs dépenses avec leurs recettes, sans que le soutien financier de leurs propriétaires intervienne durablement et massivement. L’enjeu est double : il y va de la survie des clubs et du dynamisme du football en France.
Ce défi sera d’autant plus difficile à relever que notre championnat est celui qui offre le moins de recettes directes aux clubs professionnels parmi les cinq grands championnats de football européen. La question de la diversification des sources de revenus du football et du développement du sponsoring, chère à M. François Rochebloine, membre comme moi du groupe UDI, est par conséquent clairement posée.
Comment se satisfaire, en effet, que la Premier League bénéficie de 874 millions d’euros de financement lié au sponsoring quand la Ligue 1 ne draine que 198 millions d’euros ? N’oublions pas non plus que nous nous sommes en quelque sorte tiré une balle dans le pied avec la taxe à 75 % décidée par cette majorité, qui a considérablement handicapé le football français par rapport à ses concurrents étrangers.
Il n’en reste pas moins que les clubs français disposent d’atouts solides pour s’adapter aux règles du fair-play financier.
Premièrement, ils se sont engagés sans réserve dans une démarche d’assainissement de leurs comptes. Nous sommes loin des 650 millions d’euros de dette du Real Madrid ou des 6,5 millions d’euros de salaire annuel moyen à Manchester City.
En outre, si la saison 2013-2014 de Ligue 1 a été la sixième consécutive de déficit, les clubs français possèdent néanmoins de véritables relais de croissance avec la modernisation des stades et leurs centres de formation.
Enfin, la montée en puissance du Paris Saint-Germain et, dans une moindre mesure, de Monaco permettra aux compétitions nationales de voir leur attrait renforcé et au football français de briller de nouveau dans les joutes européennes. La dernière victoire d’un club français en ligue des champions remonte en effet, je le rappelle, à 1993 …

… et la dernière participation à une finale à 2004. Or à la clé, ce sont des sources de revenus supplémentaires qui viendront soutenir l’ensemble du football français.
Il nous appartient par conséquent d’oeuvrer aux niveaux européen et national pour parvenir au juste point d’équilibre entre performance sportive, compétitivité économique et éthique du sport.
Le football, en tant que sport, est un vecteur d’instruction, d’éducation et de cohésion sociale. Il contribue également au rayonnement de la France et constitue un enjeu économique majeur. Il est, à cet égard, un enjeu pour le développement des territoires et pour l’emploi, et c’est pourquoi nous devons absolument relever l’immense défi du fair-play financier et oeuvrer ainsi en faveur d’un modèle de développement soutenable, compétitif et respectueux de l’éthique sportive.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des affaires culturelles, chers collègues, à l’occasion de cette semaine de contrôle, le groupe de la Gauche démocrate et républicaine a choisi un thème de débat intéressant : le fair-play financier. Celui-ci peut se résumer par une règle simple : un club de football professionnel ne doit pas dépenser plus que les recettes qu’il dégage.
Ce sujet, porté par l’UEFA depuis cinq ans, procède du constat de l’accroissement périlleux des déficits des clubs. En quatre ans seulement – entre 2007 et 2011 –, l’ensemble des déficits cumulés en Europe est en effet passé de 0,7 à 1,7 milliard d’euros.
Depuis 2012, l’application des règles du fair-play financier a permis de remplir son objectif : cet endettement a été divisé par deux.
Le fair-play financier est cependant remis en question par les clubs qui subissent les sanctions. De fait, il doit être amélioré et reste fragile juridiquement.
Il serait souhaitable que le Parlement français se prononce sur cette question et encourage le Gouvernement à porter une parole, en premier lieu au niveau de l’UEFA, puis auprès des pays européens, pour affiner les règles en vigueur et poursuivre deux objectifs.
Le premier est de donner les moyens à nos grands clubs d’être en mesure de rayonner sur la scène européenne dans des conditions de concurrence équitable et de jouer leur rôle de locomotive en entraînant derrière eux l’ensemble du sport français.
Le second est de consolider la mutualisation de ces grands clubs avec les milliers de clubs moins médiatiques, en favorisant leur développement. Ces clubs sont certes plus petits en taille, mais la tâche dont ils s’acquittent est immense. Est-il utile de rappeler leur fonction majeure dans nos sociétés contemporaines, que ce soit pour l’intégration, pour notre vivre ensemble ou sur le plan éducatif et social ?
Depuis 1995 et l’arrêt « Bosman », la circulation des joueurs en Europe est libéralisée. Les conséquences en termes d’inflation des prix des transferts et des salaires ont été phénoménales. Ainsi, la masse salariale de certains clubs a fini par représenter près de 70 % du chiffre d’affaires, faisant peser un risque déraisonnable.
Face à ces dérives récentes, le groupe RRDP se réjouit que la représentation nationale soit saisie de ce débat, d’autant qu’il est la suite logique de l’excellent rapport parlementaire rendu en juillet 2013 sur le fair-play financier à l’initiative de M. Thierry Braillard, alors député du groupe.
Le premier volet des règles interdit aux clubs tout arriéré de paiement et le second contraint les clubs à l’équilibre financier. Or, en mai 2014, la commission indépendante mise en place par L’UEFA a estimé que le PSG ne se conformait pas aux règles du fair-play financier. Pour la saison 2014-2015, elle a donc obligé le PSG à limiter à 21 joueurs au lieu de 25 son effectif pour la Ligue des champions et sa masse salariale à 230 millions d’euros.
Huit autres clubs en Europe ont également été sanctionnés. Pour ceux qui en doutaient, le talent de Michel Platini est intact : c’est une belle frappe cadrée qui a nettoyé une lucarne !

Mais pour la deuxième mi-temps, une question se pose : ne devrait-on pas se mettre à l’abri par une nouvelle frappe dans la lucarne opposée, celle des clubs historiques ? En effet, les règles actuelles ne touchent pas les grands clubs historiques, beaucoup plus lourdement endettés. Pourquoi ? La définition juridique des dépenses et des recettes dans le fair-play financier pose problème : pour les dépenses, seules les charges générées par les emprunts, et non la dette des clubs elle-même, sont prises en compte ; pour les recettes, les apports des actionnaires ne sont pas considérés. Ces définitions constitueraient une entrave au droit à une concurrence équitable en stabilisant les injustices au lieu d’essayer de les réduire. L’UEFA – Union of European Football Associations – ne réussira peut-être pas à trouver toutes les solutions juridiques.
Monsieur le ministre, nous souhaitons tous renforcer la compétitivité du football professionnel français. Permettez-moi de vous encourager à vous battre au niveau européen pour exiger des réformes dans chacun des États dont la qualité du contrôle de la gestion des clubs est insuffisante. Si le football est le sport le plus populaire dans le monde, c’est aussi en raison de ses spécificités et de la part de l’aléa sportif. Mais si cet aléa sportif donne sa beauté au football, il y a un revers à la médaille : il est générateur d’un risque financier trop minoré dans le modèle économique des clubs.
Au-delà du seul fair-play financier, nous avons l’intuition que ce sport ne pourra faire l’économie d’un pacte social renouvelé, fidèle à ses traditions, pour se moderniser sans risquer de perdre son âme.
Nous ne doutons pas que la réflexion suscitée par notre débat permettra de progresser dans le sens d’une refondation équitable, cohérente et pragmatique.

Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, notre débat s’intéresse à la question du fair-play financier dans le football. Si cela ne touche que quelques grands clubs, ceux-ci sont tout à la fois la vitrine et le moteur du monde du football composé, lui, de millions de joueurs professionnels ou amateurs, d’équipes locales et de passionnés.
Ces grands clubs ont donc une responsabilité toute particulière. Leurs valeurs ne doivent être ni celles du profit ni celles de l’opulence, mais tout simplement celles du sport : loyauté, respect, contrôle de soi, dépassement de soi et, évidemment, dans la joie de l’activité et de l’affrontement sportifs.
Or qu’observe-t-on aujourd’hui ? La Ligue 1 est éclatée, à deux vitesses. Songez que les quatre plus gros budgets additionnés sont supérieurs à ceux des seize autres clubs ! Le montant des transferts est vertigineux, déconnecté de la vie des Français ; les rémunérations des agents sont opaques ; les droits télévisés sont disproportionnés, créant une véritable télédépendance ; l’opacité règne toujours concernant les investissements de certains mécènes ou les contrats de sponsoring. Réjouissons-nous tout de même que l’actuel leader de la Ligue 1 soit celui qui intègre le plus de jeunes issus de son centre de formation parmi les grands clubs français. Cette qualité est reconnue dans le monde entier : ainsi, plus de 180 joueurs français évoluent dans d’autres championnats.
Il reste cependant une réalité que nous devons affronter : celle des clubs français déracinés de leur territoire, où ne joue plus aucun joueur issu de leur centre de formation ; un football où les femmes ne sont pas représentées, où les clubs ne peuvent plus recruter. Et que dire des valeurs du sport, alors que la coupe du monde de 2022 se jouera au Qatar sur le sang des travailleurs immigrés morts sur les chantiers ? Nous sommes ici bien loin des valeurs du sport ! Nous sommes trop près du « foot business » et nous le réprouvons.
Aussi, dans ce contexte, la décision prise par l’UEFA et son président Michel Platini d’instaurer le fair-play financier des clubs est par principe une bonne chose. L’objectif était de mettre fin au cercle vicieux du surendettement qui venait alimenter l’inflation des dépenses des clubs de football et du montant des transferts et, in fine, dévoyer les valeurs sportives dont ces clubs devraient être les premiers défenseurs.
À certains égards, ce dispositif a déjà rempli son objectif en divisant par deux en deux ans les pertes des clubs européens. Cependant, force est de constater que le système actuel, tel qu’il est conçu comptablement, ne fonctionne pas convenablement, notamment parce que les dettes passées ne sont pas prises en compte dans ce calcul. Il protège ainsi les clubs établis, pénalise les nouveaux entrants et a donc gravé dans le marbre une situation inégalitaire. Les neuf clubs ayant les plus gros chiffres d’affaires actuels faisaient déjà partie du top 10 de ce même classement en 2001. Il faudra donc améliorer ce système.
S’il est utile que le mouvement sportif se dote de ses propres régulations, la puissance publique ne peut faire l’économie d’une intervention étant donné l’importance du football en France et de ses nombreux dysfonctionnements. Aussi devons-nous prendre nos responsabilités. L’excellent rapport sur le fair-play financier dans le football présenté en 2013 par Thierry Braillard, Marie-George Buffet, Pascal Deguilhem et Guénahël Huet, offre de nombreuses propositions pragmatiques et judicieuses, auxquelles nous adhérons totalement.
L’ancrage territorial des clubs doit être rétabli, notamment par le biais des centres de formation qui doivent former, éduquer, permettre aux jeunes de s’émanciper dans leur équipe et avant tout dans la vie ; je l’ai évoqué en faisant référence au leader actuel de la Ligue 1. Aucun jeune ne doit être laissé sans solution : c’est aussi l’autre point que nous devons avoir à l’esprit.
Le caractère populaire du football doit être préservé et le football féminin largement encouragé. Nous sommes par exemple favorables à une subordination de l’octroi des licences à l’existence d’une équipe féminine.
Bien sûr, le contrôle de la gestion des clubs doit être largement renforcé, tant l’opacité semble de mise. Dans ce domaine, aucune solution ne doit être a priori écartée, comme la limitation des transferts ou le plafonnement de la masse salariale. Certaines solutions devront naturellement être négociées dans un cadre européen, au-delà même du cadre de l’Union, pour éviter une distorsion trop rapide entre les clubs ; mais rien ne nous empêche d’être force de proposition, et je compte sur vous, monsieur le ministre.
Ne nous résignons pas à voir le football accaparé par quelques multinationales et milliardaires. Ouvrons ce débat, défendons le développement d’un sport populaire, démocratique, ouvert à toutes et à tous, un football durable, un football vecteur des valeurs originelles du sport collectif – ces valeurs que, d’une certaine manière, nous avons retrouvées ce 11 janvier : respect, loyauté, dépassement de soi, au service d’une certaine idée du vivre ensemble dans les moments forts, que ce soit sur le terrain ou dans notre république.

La parole est à M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission, mesdames, messieurs les députés, nous avons ce débat – hasard des dates ! – alors que notre dossier de candidature potentielle pour les Jeux olympiques est sur orbite depuis ce midi. J’espère que nous allons ainsi initier une démarche très positive pour notre pays au travers de cette candidature espérée par le Gouvernement, mais qui nécessite naturellement des accords préalables, en particulier de Mme la maire de Paris, Anne Hidalgo, avec le soutien du mouvement sportif, comme il se doit.
Comme bien des élus ici présents, j’ai souvent eu l’occasion d’aller voir des matchs de football professionnel. J’ai encore régulièrement l’occasion de le faire en tant que ministre des sports et pas seulement dans cette belle discipline. Je vous l’avoue : c’est presque toujours un plaisir, pas seulement pour le spectacle sportif mais surtout pour l’ambiance que l’on retrouve dans les stades, faite de joie populaire et d’émotions collectives, grâce aux nombreux spectateurs – plus nombreux que dans l’hémicycle cet après-midi !
Mais derrière cette joie et ces sentiments qui me sont naturels, il y a aussi des inquiétudes, que beaucoup d’entre vous ont rappelées il y a quelques instants : le fair-play financier – le fair-play tout court – est-il encore au coeur de cette compétition ? La sécurité est-elle bien assurée ? Le match est-il équitable ?
Ces questions, nous nous les posons toutes et tous parce que le sport est devenu un spectacle et donc, disons-le très clairement, une activité économique à part entière. Le double effet de l’explosion des droits télévisés et du fameux arrêt Bosmanont radicalement transformé cette économie. Il est donc nécessaire de savoir comment rendre les évolutions du sport compatibles avec le respect des valeurs qu’il porte, valeurs que tous les députés ici présents ont rappelées dans leurs interventions.
Je salue par conséquent l’initiative du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et de son avant-garde éclairée et sportive, Marie-George Buffet, qui nous permet de débattre aujourd’hui de ce sujet, sur la base du rapport d’information de qualité remis en juillet 2013.
Au-delà de Thierry Braillard, que je salue particulièrement et que j’ai l’occasion de voir régulièrement dans ses responsabilités ministérielles, je souhaite insister sur la qualité de l’analyse rendue par les parlementaires auteurs de ce rapport et issus de tous les bancs de cet hémicycle : Mme Marie-George Buffet, M. Pascal Deguilhem et M. Guénhaël Huet.
Avant d’entrer dans le coeur du sujet, il est bon de rappeler le contexte particulier dans lequel se situe le football, et plus largement le sport professionnel.
Juridiquement, le sport a cette spécificité de se situer dans un double champ. D’une part, il y a le droit des États : nous partageons tous le souhait que l’éthique sportive et l’équité des compétitions soient respectées dans les pratiques sportives, des matchs amateurs aux grandes rencontres professionnelles.
Grâce aux ministres des sports successifs, que je salue, et à l’action du législateur, la France est en pointe sur la protection des valeurs, notamment du sport professionnel, avec l’existence obligatoire d’un contrôle de gestion des clubs, des règles en matière de subventionnement par les collectivités ou encore la réglementation de l’activité d’agent – je reviendrai sur ce point.
En outre, la France inscrit sa législation dans un cadre conventionnel, et particulièrement dans celui des traités de l’Union européenne. À cet égard, nos règles doivent tenir compte des décisions du juge communautaire, notamment celles prises en application des principes de libre circulation des travailleurs ou de libre concurrence. Tant en matière de transferts de joueurs que de dispositifs relatifs au financement de la formation, le droit français doit se conformer aux règles des traités.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous poussons autant pour la reconnaissance d’une spécificité sportive au niveau communautaire, afin que les règles du sport, notamment celles qui ont pour objet de faire respecter l’équité sportive, ne soient pas systématiquement soumises aux dispositions de droit commun de la libre concurrence. Je crois que nous partageons toutes et tous cet avis : non, le sport, comme la culture, n’est pas une activité comme les autres, quand bien même il serait une activité économique.
Mais parlons de l’autre champ des règles auxquelles le sport est soumis, que l’on appelle la lex sportiva. C’est tout le champ de la loi sportive, issu non seulement des organisations et fédérations internationales, bien sûr, mais aussi de nos fédérations sportives, puisque le code du sport leur reconnaît un pouvoir réglementaire propre.
Ces règles, qui sont liées à l’autonomie du mouvement sportif, sont édictées par des organes privés ; mais nous ne pouvons pas les ignorer. Le fait par exemple que la FIFA – Fédération Internationale de Football Association – déréglemente l’activité d’agent à partir de 2015 ne peut être passé sous silence. Le fair-play financier de l’UEFA, qui est le thème de votre rapport, est un exemple typique de ce droit privé qui vient se superposer à nos propres règles, cette fois-ci de manière pertinente.
Au plan national aussi, il est tout à fait nécessaire de le prendre en compte. Ainsi, en matière de contrôle de gestion, d’incompatibilités liées aux conflits d’intérêts – ils sont nombreux –, de licences de clubs ou encore de plafonnement de la masse salariale, nos fédérations et ligues sont extrêmement actives.
Je tiens à le souligner : le mouvement sportif s’est pris en main et si nous sommes là parfois pour l’inciter, voire le contraindre, nous sommes aussi et surtout là pour le soutenir et le protéger dans ses démarches.
À cet égard il faut rappeler que la plupart des initiatives prises par les ligues, notamment sur les questions de joueurs formés localement ou de régulation financière, sont attaquées judiciairement par certains clubs – je ne ferai pas d’autres commentaires.
Elles ne le sont pas sur la base des règles du droit français, qui encouragent ces initiatives tout en laissant à chaque discipline le soin de définir les règles qui protègent le mieux ses compétitions ; elles le sont sur la base du droit communautaire. L’État est à leurs côtés, je pense par exemple au basket ou au rugby, pour défendre les règles qu’ils ont définies et qui doivent être respectées par les équipes participant à leurs championnats.
Évoquons maintenant, un à un, chacun des grands thèmes abordés par le rapport dont nous discutons – de manière synthétique, rassurez-vous !
En ce qui concerne la reconnaissance de la spécificité sportive au niveau communautaire, je vous en ai déjà un peu parlé et je peux vous dire que nous sommes déterminés et actifs, et d’abord auprès de la Commission européenne : ma prédécesseure et Thierry Braillard ont ainsi saisi dès leur arrivée la Commission pour encourager une initiative communautaire en matière de fair-play financier, qui pourrait prendre la forme d’une directive.
Auprès du Conseil ensuite : j’ai moi-même proposé aux ministres européens des sports réunis à Rome, et à Michel Platini, que l’on reconnaisse la spécificité sportive en lui donnant une traduction concrète à travers l’édiction de règles. Je vous avoue qu’il n’est pas forcément évident de convaincre nos homologues européens sur ce point, notamment ceux d’Europe du Nord, qui considèrent l’autonomie sportive comme un principe fondamental interdisant l’intervention des États en la matière. Mais là encore, notre salut peut venir des institutions sportives elles-mêmes, qui demandent aux États une faculté de régulation propre, dérogatoire aux strictes règles de droit commun. C’est ainsi que l’UEFA est parvenue à définir des règles compatibles avec les traités en négociant avec la Commission. Des alliances avec d’autres États, tout aussi concernés, peuvent aussi être passées et nous permettre de tracer de nouvelles perspectives dans ce domaine.
Nous encourageons aussi pleinement les initiatives du Conseil de l’Europe en matière d’intégrité sportive. Après en avoir été l’inspiratrice, la France a ainsi très récemment signé la convention de Macolin contre la manipulation des compétitions sportives. La démarche que nous menons auprès de l’Union européenne pour qu’elle signe elle aussi cette convention a de fortes chances d’aboutir.
Le niveau européen est le plus pertinent pour deux raisons. D’une part, dans un contexte extrêmement compétitif sur le plan sportif, nous ne pouvons pas imposer des règles nationales si contraignantes qu’elles constitueraient un désarmement unilatéral de la France.
Nous saluons les initiatives très fortes et très saines de la ligue nationale de rugby en matière de plafonnement de la masse salariale. Mais si elles peuvent être prises, c’est parce que le championnat de France est le plus puissant d’Europe sur le plan économique et que nous pouvons montrer la voie. C’est évidemment moins le cas de nos championnats de basket-ball ou de football, qui doivent trouver le moyen d’assainir leur discipline tout en se maintenant dans un environnement très concurrentiel.
D’autre part, notre meilleure chance de faire évoluer notre droit est de faire évoluer d’abord les règles communautaires. C’est bien le désarmement collectif et la définition de solutions communes que nous prônons en matière de sport professionnel.
Je ne veux pas dire que nous ne pouvons pas avancer seuls sur certains sujets, et de nombreuses propositions du rapport dans le domaine du respect de l’éthique et de la transparence sont à prendre en considération. La proposition d’une chambre de compensation placée auprès de la ligue pour gérer les flux financiers relatifs aux transferts de joueurs, l’obligation du dépôt des mandats ou encore l’interdiction formelle d’embauche des joueurs sous tierce propriété sont tout à fait pertinentes et je les soutiens.
La transparence sur les transferts doit aussi prendre d’autres formes. L’idéal serait certes, madame Buffet, que les joueurs paient leurs agents. Mais à cet égard, ni la prohibition du paiement des agents par les clubs, en vigueur avant 2010, ni son autorisation n’ont fait la preuve de leur efficacité. Je suis donc convaincu que la solution réside dans l’amélioration de la traçabilité des sommes versées aux agents. Et qui de mieux placé pour surveiller les transferts d’argent que les organismes de contrôle de gestion, qui scrutent au quotidien les comptes des clubs ? Des organismes similaires à la DNCG, dont l’indépendance serait encore renforcée, seraient à mon sens le meilleur outil de supervision financière et de transparence s’ils avaient le pouvoir de contrôler les comptes des agents. Je pense que cette mesure innovante serait particulièrement efficace dans un contexte où les clubs paient les agents, car ce sont les clubs qui sont le plus facilement contrôlables.
Dans le domaine de la promotion des talents locaux et de la valorisation de la formation, il y a aussi des améliorations à apporter. Vous avez raison de dire que la règle des joueurs formés localement est saine pour protéger et encourager la formation. Les fédérations et les ligues en sont d’ailleurs parfaitement conscientes. Le football a la chance d’être exportateur de joueurs et la France est même la première au monde en la matière. Dans les autres disciplines, des règles de protection très fortes ont été mises en place, mais elles sont aujourd’hui attaquées au niveau communautaire par des agents et par des clubs. Je peux vous dire ici que nous soutenons au quotidien les efforts des ligues pour faire reconnaître leur droit d’édicter ces règles et que nous mettons les services de l’État à leur disposition.
Nous avons aussi lancé un travail sur la formation dispensée dans les centres des clubs professionnels afin de garantir le double projet et l’éducation citoyenne. Le sport professionnel comptant beaucoup de candidats, mais peu d’élus, la formation ne doit pas être que sportive : je peux vous dire, que la encore, en dépit des efforts qu’il reste à faire, la France est en pointe.
Le sujet de l’amélioration de l’image du sport est aussi important. Je tiens à souligner qu’il ne faut pas se laisser aveugler par les montants très élevés de certains salaires ou les mauvais comportements de quelques-uns. Le sport est à l’image de notre société, c’est-à-dire imparfait. Mais je sais aussi que de nombreux clubs professionnels ont mis en place des actions citoyennes, des programmes éducatifs ou caritatifs. Dans le cadre de notre dialogue avec eux et dans la perspective de la réunion, le 6 mars, du comité interministériel pour la lutte contre les inégalités et la promotion de la citoyenneté, le Premier ministre nous a demandé de réfléchir au rôle du sport dans la construction de cette unité nationale tant attendue par nos quartiers en difficulté.
Thierry Braillard a parlé hier, aux assises du supporterisme, de la place des supporters. Il a été clair : nous soutenons la structuration du mouvement parce que les clubs, les pouvoirs publics et le sport français ont tout intérêt à disposer d’interlocuteurs représentatifs pour améliorer la sérénité du spectacle sportif.
Mesdames, messieurs les députés, j’ai déjà beaucoup parlé du contrôle de gestion. Ces organismes ont un rôle terriblement difficile puisqu’ils ont quasiment droit de vie ou de mort sur les clubs pour préserver l’intérêt supérieur du sport, qui passe par l’équité des compétitions. Il faut qu’ils soient indépendants. Cela pourrait passer par la loi, même s’ils font régulièrement la preuve qu’ils le sont de fait. Il faut aussi, à mon sens, qu’ils soient adaptés à chaque discipline, pour lesquelles les enjeux et les pratiques sont différents. Ne tuons pas un système qui a largement fait ses preuves. D’ailleurs, si nous soutenons pleinement le fair-play financier mis en place par l’UEFA, nous souhaitons également qu’il puisse s’inspirer du modèle français, notamment à travers la prise en compte de l’endettement des clubs.
Enfin, et vous avez parfaitement eu raison de l’aborder, le sujet de la compétitivité des clubs sportifs est le corollaire nécessaire à notre capacité à lui appliquer des règles de régulation efficaces. Celles-ci seront en effet d’autant plus appliquées et respectées que le sport français sera fort au niveau européen. La suppression de la taxe sur les spectacles que nous avons proposée et que vous avez votée en loi de finances est un premier pas que je tiens à saluer.
Mais tous les moyens doivent aussi être mis en oeuvre pour améliorer la gestion des enceintes sportives par les clubs : on le sait, le renforcement de leur principal outil productif est nécessaire au développement économique du sport professionnel et sera le seul moyen d’assurer le désengagement progressif des collectivités.
Après ces mots sur le sport professionnel, qui est l’objet de ce rapport, j’ai envie de conclure sur le sport amateur, celui qui est pratiqué le week-end dans nos stades et dans nos gymnases municipaux. Je veux saluer tous les éducateurs et tous les bénévoles, le mouvement sportif étant le plus grand secteur bénévole de France, qui accompagne les jeunes, et les moins jeunes, sur les terrains. Rappelons-nous que le fair-play, ce sont en premier lieu ces éducateurs qui le font respecter au cours des milliers de rencontres sportives qui se déroulent chaque semaine.
J’ai bien entendu, madame Buffet, votre propos sur l’article 62 du projet de loi Macron, qui n’a d’ailleurs pas encore été examiné par votre assemblée. Il faut naturellement permettre aux clubs d’accroître leurs ressources propres si l’on veut qu’ils se passent du financement des collectivités locales. Cependant – je le dis avec une grande sérénité – si ces ressources doivent passer par une extension du modèle publicitaire, encore faut-il que celle-ci soit compatible avec d’autres règles de droit, notamment la loi Evin.
Mesdames, messieurs les députés, j’ai bon espoir que l’organisation, probablement au cours du second semestre de 2015, d’assises décentralisées du sport, mobilisant, outre les pouvoirs publics, les associations, les clubs professionnels et l’ensemble du mouvement sportif nous permettra de débattre de ces sujets et de continuer à réfléchir sur ce qui fait du sport la principale activité sociale de notre pays.
Applaudissements sur tous les bancs.

Nous en venons aux questions.
La parole est à Mme Marie-George Buffet, pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

La recommandation no 15 du rapport d’information porte sur la place qui devrait être celle des supporters dans la vie et la gestion des clubs, sachant que plus de dix millions de supporters soutiennent les clubs, parfois depuis plusieurs générations, alors que les actionnaires et les présidents changent. Cette recommandation se réfère à l’expérience d’autres pays européens, citant notamment les socios espagnols ou le « 50 + 1 » allemand.
Que pensez-vous, monsieur le ministre, de cette recommandation, qui d’ores et déjà a reçu quelque écho parmi les supporters eux-mêmes ? Le Conseil national des supporteurs de football – CNSF – a rédigé sur cette base un texte susceptible de devenir une proposition loi et ces travaux ont été présentés hier au Sénat, dans le cadre d’un colloque ouvert par M. le secrétaire d’État au sport. Il s’agirait de modifier le code du sport afin d’assurer la représentativité des supporters au sein des fédérations et dans les organes des sociétés commerciales par la mise en place de comités de supporters.
De ce que j’en sais, M. le secrétaire d’État a apporté son soutien à ces propositions, qui n’ont pas reçu le même accueil de la part du mouvement sportif.
Monsieur le ministre, je compte, avec d’autres collègues de différents groupes, déposer cette proposition de loi sur le bureau de l’Assemblée. Je pensais vous demander si ces dispositions pouvaient être intégrées dans une future loi sport, mais vos propos me laissent penser qu’une telle loi n’est pas pour demain – cela dit, je me trompe peut-être !
Faut-il une loi sport, madame la députée ? C’est un débat que nous avons déjà eu en commission. En tout état de cause, c’est dans cette perspective que je propose d’organiser des assises décentralisées consacrées à l’avenir du sport en France. C’est à partir de ce moment de démocratie participative, chère à votre coeur, que nous pourrons éventuellement envisager un tel projet de loi, déjà évoqué par Mme Fourneyron et qui est une de mes priorités.
La création d’une association nationale des supporters, inspirée d’un modèle européen qui fonctionne bien, celui d’une instance structurée qui ferait des associations un interlocuteur crédible de l’UEFA, est une excellente initiative qui a toute ma faveur.
Nous en sommes loin dans notre pays. Les supporters ont besoin d’une double structuration : au niveau local tout d’abord, afin de fédérer les très nombreuses associations existantes et constituer des interlocuteurs représentatifs et crédibles pour les clubs ; au niveau national ensuite, avec une fédération de ces structures locales représentatives qui puisse être un interlocuteur de la fédération sportive et de la Ligue. Je n’ignore pas que certains, notamment au sein de ces instances, ne sont pas de cet avis.
Cette double évolution est la condition pour que la parole des supporters ait du poids. Nous comptons soutenir les supporters dans leurs efforts de structuration. La balle est encore dans leur camp, mais nous allons essayer de la faire remonter des terrains !

Nous en venons aux questions du groupe SRC.
La parole est à M. le président de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

Je rappelle qu’une loi sport peut être d’initiative tout autant parlementaire que gouvernementale.
Ma question est double, monsieur le ministre. Je voudrais d’abord vous interroger sur la formation des joueurs des clubs professionnels.
En effet, le code du sport protège l’investissement des clubs dans la formation en prévoyant qu’à l’issue de celle-ci, s’il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire de la formation peut être dans l’obligation de conclure, avec l’association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail de sportif professionnel, dont la durée ne peut excéder trois ans.
Le non-respect de cette obligation de contracter se traduit dans les faits par le versement d’indemnités au club formateur par le club recruteur, indemnités correspondant à la fois à un remboursement forfaitaire du coût de la formation et à une valorisation de celle-ci, en fonction de la carrière sportive ultérieure du joueur.
Or, l’application de ce dispositif n’est actuellement pas garantie au-delà du coût de la formation lorsque le jeune joueur est recruté par un club étranger, au risque pour les clubs de ne pouvoir protéger un investissement particulièrement coûteux dans la formation, ô combien essentielle, des jeunes joueurs.
Dès lors, je souhaite savoir quels moyens pourraient être mis en place pour consolider la sécurisation de cet investissement par les clubs.

Enfin, les règles du fair-play financier qui nous occupent cet après-midi sont censées encourager les investissements dans les secteurs liés à la jeunesse et dans les infrastructures sportives. Pouvez-vous nous dire si, dans les faits, vous avez pu constater que tel était bien le cas ?

Monsieur le ministre, et monsieur le président de la commission des affaires culturelles, je souhaite à travers ma question faire entendre la voix de nombreux citoyens amoureux du football qui veulent accéder, pour partie via un diffuseur gratuit public ou privé, à des images des journées de championnats – c’est d’ailleurs le sens de la proposition no 16 de notre rapport.
Je note que, depuis 2013, la situation s’est aggravée avec l’application, au 1er janvier, de la décision prise par le CSA de ne plus autoriser la diffusion d’extraits courts dans les magazines sportifs – deux sont essentiellement concernés : Télé Foot et Rencontres à XV – d’ailleurs mono-thématiques, ce dont je suis désolé pour la seconde émission.
Si l’on peut comprendre que cette décision se justifie par le souci, bien naturel, d’assurer un point d’équilibre entre l’intérêt public, le respect de la liberté éditoriale des télévisions et la protection de la valeur des droits d’exploitation des compétitions sportives tout en garantissant les mécanismes de financement des activités sportives – nous avons rappelé la place des droits télévisuels dans le financement du football professionnel –, nous devons être tout aussi attentifs, monsieur le ministre, à ce que ce sport populaire ne devienne pas sous-exposé et ne perde ainsi une part de son attractivité. La préservation du caractère populaire du football suppose une large diffusion : c’est essentiel !
Pour faire revenir un public nombreux dans les stades – en grande partie rénovés ou neufs – on ne peut réserver quasi exclusivement les images à un public prêt à payer.
Avec la simple préoccupation, certes légitime, de maximiser ces recettes pour assurer l’équilibre financier des clubs, on peut aussi perdre beaucoup en termes d’intérêt et d’adhésion du plus grand nombre.
Que puis-je répondre à mes concitoyens, monsieur le ministre ?
Et même une triple réponse, monsieur le président.
La question du président Bloche sur la formation des joueurs est essentiellement liée, bien sûr, à l’avenir même du football.
Plusieurs solutions existent afin de réduire les inquiétudes qui viennent d’être évoquées.
La première est la transcription dans notre droit de l’arrêt Bernard de la Cour de justice des communautés européennes afin d’assurer le versement aux clubs formateurs des indemnités qu’ils supportent pour former les joueurs en tenant évidemment compte du coût de ceux qui ne deviendront jamais professionnels.
La seconde est à la fois pratique et financière. Nous avons lancé une réflexion quant à une meilleure reconnaissance des formations dispensées dans ces centres, que ce soit dans le domaine du football ou dans le cadre du double projet que j’évoquais tout à l’heure dans mon intervention liminaire.
Il est impératif que ces formations puissent être qualifiantes, monsieur le président Bloche, et que certains enseignements puissent donc faire l’objet d’équivalences ou de validations.
Ce travail comporte selon nous un triple intérêt : valoriser les jeunes issus de ces centres – je crois que c’est une mission essentielle –, faciliter leur réintégration dans d’autres cursus en cas de non-accès au professionnalisme et, enfin, faciliter le financement des centres de formation dans le cadre de la part hors quota de la taxe d’apprentissage.
J’ajoute que ces trois éléments sont cumulatifs et non exclusifs les uns des autres.
La mise en place de ce que l’on appelle la licence club – c’est votre seconde question – est quant à elle encore récente dans la plupart des ligues professionnelles. Nous manquons donc de recul quant à ses effets, notamment, eu égard aux investissements réalisés.
Vous avez raison de dire que plusieurs licences clubs prennent en compte, d’une part, les actions citoyennes et, d’autre part, les investissements dans les structures.
Cela signifie que des sommes plus importantes sont versées aux clubs qui sont aujourd’hui bien classés sur ces critères au titre des droits télévisuels centralisés par la ligue.
En travaillant sur les aspects citoyens, je me suis aperçu que de très nombreux clubs sont déjà engagés dans des actions de terrain. Pour les mener, et c’est tant mieux, certains ont mis en place des fondations spécifiques, ce qui constitue évidemment un excellent axe.
S’agissant de la question particulière des infrastructures soulevée par le président Bloche, il faut en revanche reconnaître que nous sommes encore en retard.
Les infrastructures sont en effet toujours à la charge des collectivités, les clubs ne souhaitant pas se charger directement de leur gestion et, encore moins, de leur construction. L’exemple de l’Olympique Lyonnais est tout à fait exceptionnel aujourd’hui dans le paysage sportif français – pourtant, il conviendrait sûrement qu’il en inspire beaucoup d’autres : c’est en effet la voie de l’avenir pour le sport professionnel.
Sur ce point, j’exhorte les ligues à être encore « mieux-disantes » et à encourager le financement des clubs qui réalisent les investissements nécessaires.
L’État, de son côté, doit aussi réfléchir aux meilleurs moyens de transformer le modèle économique de ces clubs en mettant les stades au coeur de leur activité – il s’agit du « coeur du réacteur » pour l’ensemble de ces clubs.
Quant à la question de la diffusion gratuite, monsieur le député Deguilhem, je ne sais si je pourrai complètement y répondre même s’il s’agit d’un sujet majeur qui nous tient à coeur.
Vous le savez, mais il faut le rappeler, la France dispose de la liste la plus longue en Europe de retransmissions en clair et donc gratuitement des événements d’importance majeure : la finale de la Coupe du monde de football ou de la Coupe de France, la finale du Top 14, le Tournoi des six nations, une partie de Roland-Garros ou, encore, le Tour de France, qui est le plus regardé.
Il n’empêche que la retransmission de quelques compétitions nous intéresse particulièrement à l’avenir – je pense à l’Euro de basket et à l’Euro 2016 de football.
Ces épreuves ne seront pas diffusées totalement en clair. Il est certes compliqué de modifier le décret qui devait être transmis à la Commission européenne ; en revanche, nous avons évoqué cette question avec plusieurs diffuseurs que j’ai reçus au ministère et qui détiennent les droits sur ces compétitions. Ils sont à l’écoute ou, à tout le moins, font preuve d’une forme de bienveillance à notre égard.
J’espère qu’une partie des matchs sera remise sur le marché afin que des chaînes gratuites puissent les acquérir – exemple très concret : nous l’avons constaté très récemment avec la Coupe du monde de handball.
Vous avez également posé la question de la diffusion des courts extraits.
Sur ce point, le législateur a décidé en 2010 de confier un pouvoir particulier réglementaire au CSA. Ce dernier est naturellement très attaché au droit à l’information et à la capacité des chaînes à diffuser des images sportives, mais votre remarque témoigne bien de la distance qui existe encore entre l’idéal et le réel.

La parole est à M. Yannick Favennec, pour le groupe de l’Union des démocrates et indépendants.

Monsieur le ministre, je souhaite vous interroger sur le régime d’agent de joueurs que la Fédération internationale de football association compte remplacer à partir du 1er avril prochain, par celui d’intermédiaire sportif.
La création de ce statut, qui n’implique de détenir aucune licence pour exercer, suscite en effet des inquiétudes en France alors qu’une nouvelle série d’interpellations est survenue voilà seulement quelques jours à Marseille à propos de transferts présumés frauduleux.
Tout d’abord, cette réforme risque de soulever des difficultés d’application pratique puisqu’une loi régit dans notre pays la profession d’agent et interdit cette activité aux intermédiaires non licenciés.
Ensuite, la multiplication de ces intermédiaires risque de favoriser les recrutements agressifs de jeunes talents, qui seront arrachés de plus en plus jeunes à nos clubs de football professionnels ou amateurs.
Enfin, cette nouvelle réglementation constitue une iniquité majeure par rapport aux agents, qui ont acquis une véritable qualification professionnelle.
Monsieur le ministre, pouvez-vous confirmer à la représentation nationale que les dispositions légales en vigueur primeront toujours sur les nouvelles règles prévues par le comité exécutif de la FIFA ?
Quelles mesures entendez-vous prendre pour faire respecter la loi française ?
Monsieur le député, je vous affirme et vous confirme que l’on ne touchera pas à la licence française, quand bien même la licence serait supprimée sur le plan international. Il s’agit en l’occurrence d’un bien collectif que nous devons absolument préserver.
Par ailleurs, il n’y a pas de solution miracle : pour rendre les transferts transparents et vertueux – ce que nous souhaitons évidemment tous – nous aurons toujours besoin des juges et, avant eux, des enquêteurs afin de faire la lumière sur des pratiques que vous condamnez, que je condamne, et qui existent, comme dans tous les secteurs de l’économie.
Néanmoins, je ne suis pas défaitiste en la matière, je crois que nous devons évoluer.
On a essayé d’interdire aux clubs de payer les agents de joueurs. Que faisaient-ils quand les joueurs refusaient de payer leurs agents, principalement pour des raisons fiscales ? Ils affirmaient que ces agents étaient en fait des agents du club et non des agents des joueurs.
Bref, sauf à obliger les joueurs à avoir un agent et, donc, à le déclarer, il me semble difficile de croire à cette solution.
Aujourd’hui, les clubs peuvent payer les agents Cela n’empêche certainement pas les dérives, mais cela a le mérite de reconnaître la réalité des pratiques.
Il faut utiliser le meilleur outil dont nous disposons, à savoir les organismes de contrôle de gestion. Sûrs, habitués à analyser les comptes des clubs, ces derniers seraient en effet tout à fait compétents pour analyser les sorties d’argent, notamment celles à destination des intermédiaires sportifs.
Je suis prêt à travailler avec la représentation nationale pour aller plus loin dans le sens d’un renforcement de leur pouvoir, ce qui supposera peut-être de faire évoluer notre droit national. En tout cas, je suis à votre disposition en l’espèce.

La parole est à Mme Gilda Hobert, pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.

Je vais revenir sur un sujet que mes collègues ont abordé dans leurs interventions.
Monsieur le ministre, le rapport parlementaire du mois de juillet 2013 contenait de nombreuses propositions, parfois assez audacieuses. Je suis particulièrement sensible à celles concernant le développement du football féminin.
Les premiers matchs de foot féminin datent de la fin du XIXème siècle en Angleterre et en Écosse et du début du XXème siècle en France.
Après une période de débats houleux et de développement en dents de scie, dont une funeste interdiction totale sous le régime de Vichy, il a tout de même fallu attendre la seconde moitié des années 60 pour assister à l’essor de son organisation dans les grands pays européens.
Aujourd’hui, personne ne conteste l’apport du football féminin à ce sport, notamment, en termes d’image. Il fait généralement l’objet d’une appréciation favorable et la Fédération, comme les gouvernements successifs, ont impulsé des réformes utiles.
Pour autant, en France, le statut de joueuse semi-professionnelle n’est autorisé que depuis 2009 et trop rares sont les clubs qui, comme Montpellier ou l’Olympique lyonnais, ont mis sur pied une équipe féminine professionnelle.
Alors que le football professionnel féminin constitue un puissant vecteur de consolidation de sa pratique, il reste l’exception. Si les ressorts de sa promotion existent, ils ne suffisent pas pour assurer sa croissance. À titre d’exemple, on dénombre seulement 60 000 licenciées dans notre pays contre plus d’un million en Allemagne.
Monsieur le ministre, constatant que les démarches fondées sur la seule promotion et le volontariat ne suffisent pas, quelles mesures vous semblent être nécessaires pour que les clubs garantissent de meilleures conditions de développement du football féminin, amateur comme professionnel ?
J’ai évoqué tout à l’heure la réunion, au début du mois de mars, du comité interministériel sur l’égalité et la citoyenneté.
Je compte bien, sous l’autorité du Premier ministre, y intégrer la question du sport en tant qu’outil d’intégration dans les quartiers dits prioritaires et la féminisation du sport dans ces derniers, car la présence des femmes dans certains clubs constituera sans doute une réponse pour l’intégration de certaines populations qui, aujourd’hui, s’interrogent sur leur place dans la République.
En tout cas, vous avez raison, le football est un sport universel, mais pour 95 % de ses pratiquants, soit les hommes. On compte en effet moins de 5 % de licenciées à la Fédération, et cette situation est tout à fait insatisfaisante, je partage votre sentiment.
Pourtant, permettez-moi l’expression, il y a une lumière au bout du tunnel : la Fédération a mis en place – certains diront : enfin – un plan de féminisation extrêmement abouti qui est en train de changer la donne. Nous espérons un doublement du nombre de joueuses entre 2011 et 2015 pour atteindre 10 % des licenciés de notre pays.
La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, que vous avez adoptée, permettra aussi de féminiser les organes dirigeants des fédérations et des ligues régionales – je vous concède qu’il y a encore du chemin à parcourir en la matière. Cela contribuera aussi à changer les mentalités et encouragera la pratique féminine.
Par ailleurs, nous nous plaignons tous, ici, du renchérissement des droits du football, qui empêche la diffusion de celui-ci sur les chaînes gratuites, mais cela peut être, a contrario, une chance extraordinaire pour le sport féminin.
Il faut le noter, les premières diffusions du championnat de France féminin auront lieu, en effet, sur une chaîne de service public. L’exposition médiatique en sera renforcée et confortée.
Telle est la raison pour laquelle le Gouvernement a très vivement soutenu, notamment par des lettres de garantie sur le plan fiscal, la candidature de la France à l’organisation de la Coupe du monde féminine de 2019, pour laquelle nous sommes, comme vous le savez, madame la députée, en concurrence avec la Corée.
Ce serait une formidable exposition, sur tout notre territoire et sur nos écrans, pour le sport féminin en général, et pour le football féminin en particulier. En tout cas, sachez que le ministre des sports que je suis et le secrétaire d’État qui m’est attaché y sont particulièrement attentifs.

Monsieur le ministre, le débat, certes utile, sur le fair-play financier des grands clubs ne doit pas nous faire oublier que ceux-ci ne représentent qu’une toute petite partie du monde du football. Ce monde, comme je l’ai rappelé tout à l’heure, est composé de plus de 2 millions de licenciés, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, issus de tous les milieux sociaux, des grandes villes comme des territoires ruraux. Le football est un réseau incroyable, tissé par des milliers d’associations sportives, de clubs de supporters, et surtout par un nombre incalculable de bénévoles qui partagent et transmettent leur passion du jeu et leur passion des autres.
Ces Français se construisent des souvenirs en commun, des amitiés, qui transcendent leur origine sociale, culturelle, territoriale. Le football est un sport qui véhicule les valeurs nobles que sont la tolérance, le dépassement de soi, le rassemblement et l’amitié. Pour toutes ces raisons, les pouvoirs publics se doivent de soutenir la communauté immense qu’est celle du football. Ils devraient aussi s’appuyer sur ce formidable réseau pour développer et diffuser, encore davantage, les idées de rassemblement et d’engagement citoyen, et pour permettre à la communauté nationale d’évoluer vers un « mieux vivre ensemble ».
Monsieur le ministre, quelles actions concrètes comptez-vous mettre en oeuvre pour renforcer encore le rassemblement de tous les Français ?
Monsieur le député, j’ai beaucoup apprécié la tonalité de votre intervention, pleine de solennité et d’espoir. Vous avez tout à fait raison de dire que le football, et le sport en général, c’est d’abord un tissu. Un tissu de clubs, mais aussi un tissu social, en particulier au niveau local. Le sport professionnel contribue d’ailleurs à cette économie vertueuse, grâce à la taxe introduite par votre collègue Marie-George Buffet sur les retransmissions télévisées.
Le futur comité interministériel sur l’égalité et la citoyenneté, que j’ai déjà évoqué à plusieurs reprises, aura notamment pour objet de structurer toutes les initiatives prises par le monde du sport en matière citoyenne. J’ai d’ailleurs demandé au mouvement sportif de repérer partout en France les bonnes pratiques et les bonnes méthodes, afin que nous prenions modèle sur elles dans l’ensemble de nos quartiers. Je peux vous dire qu’elles sont nombreuses, aussi bien dans les clubs professionnels que sur le terrain des amateurs. Les compétitions sportives locales sont des moments uniques de rencontre et d’échange, et elles reposent elles aussi sur un partage de valeurs. Il nous reste maintenant à les faire vivre et à les mettre en cohérence avec pour objectif la lutte contre les inégalités. Il va de soi que les propositions devront être arbitrées au sein de ce comité interministériel, avant de vous être soumises.
Je voudrais aussi évoquer l’Euro 2016, qui sera un grand moment pour le football. Vous savez déjà que la Fédération française de football tirera 20 millions d’euros qui permettront d’animer nos clubs et d’équiper nos villes. Ce sera, à n’en point douter, un grand événement populaire qui suscitera, nous le savons déjà, de nombreuses prises de licence, auxquelles il faudra répondre. Ce sera un grand mouvement de communion laïque et républicaine autour du sport. Je pense que notre pays est en train de s’armer positivement aujourd’hui, pour répondre aux défis qui nous ont été lancés au début du mois de janvier.
La séance, suspendue à seize heures vingt, est reprise à seize heures vingt-cinq.

L’ordre du jour appelle le débat sur le rapport d’information sur l’évaluation de l’adéquation entre l’offre et les besoins de formation professionnelle.
La Conférence des présidents a décidé d’organiser ce débat en deux parties.
Dans un premier temps, nous entendrons les orateurs des groupes, puis le Gouvernement.
Nous procéderons ensuite à une séquence de questions-réponses, la durée des questions et des réponses étant limitée à deux minutes, sans droit de réplique.
La parole est à Mme Eva Sas.

Le rapport d’information sur l’évaluation de l’adéquation entre l’offre et les besoins de formation professionnelle, rendu par nos collègues Jeanine Dubié et Pierre Morange en janvier 2014, établissait un certain nombre de constats et de recommandations que nous partageons.
J’évoquerai trois points critiques dans le dispositif français de formation, qui me paraissent essentiels et qui, me semble-t-il, font aujourd’hui consensus.
Le premier constat est connu de tous : la formation, en France, ne va pas à ceux qui en ont le plus besoin. Ce sont les personnes les plus diplômées qui bénéficient le plus de la formation professionnelle continue. À l’inverse, les demandeurs d’emploi et les personnes en situation de précarité, notamment celles qui sont en contrat à durée déterminée, ont un accès très limité à la formation. Les rapporteurs notaient ainsi que « chez les actifs occupant un emploi, 66 % des diplômés de niveau supérieur à bac+2 ont suivi au moins une formation dans l’année 2012, contre 25 % des personnes sans diplôme. » Ils ajoutaient : « Ce sont les cadres qui accèdent le plus à la formation : 68 % en 2012, contre 37 % des ouvriers. À taille d’entreprise équivalente, cadres et professions intermédiaires en bénéficient plus souvent que les employés et les ouvriers. »
Les rapporteurs expliquent cet écart par le fait que les formations rapporteraient plus, en termes de gains monétaires, aux salariés déjà bien formés, et que les salariés les moins qualifiés ne sauraient pas aussi bien analyser leurs besoins et rencontreraient plus d’obstacles matériels. Mais, au-delà de ces considérations, il faut surtout souligner que la plupart des entreprises proposent moins de stages, et de plus courte durée, aux salariés les moins qualifiés.
Dans une logique similaire, les rapporteurs notent que les demandeurs d’emploi accèdent encore difficilement à la formation. En 2011, seuls 566 000 demandeurs d’emploi étaient entrés en formation, un chiffre en baisse de 4,5 % par rapport à 2010. Ces stagiaires avaient suivi 648 000 formations, soit 4 % de moins que l’année précédente. En 2011, seuls 20 % des demandeurs d’emploi avaient entamé une formation. Et seuls 12 % des fonds de la formation professionnelle bénéficiaient aux demandeurs d’emploi. Même après la loi de mars 2014, le système continue à reposer essentiellement sur une logique assurantielle. Il n’est donc pas tourné vers les demandeurs d’emploi, qui devraient pourtant être au coeur du dispositif.
Dans son rapport de janvier 2013, la Cour des comptes déplorait même la détérioration du ciblage des dispositifs réservés aux demandeurs d’emploi depuis le début de la crise de 2008. Elle mettait en évidence le fait que les dispositifs de reclassement, notamment le contrat de transition professionnelle, ne bénéficiaient pas aux moins qualifiés, et que les bénéficiaires des contrats de professionnalisation étaient déjà diplômés.
J’attirerai particulièrement votre attention, monsieur le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, sur la question des quartiers prioritaires, pour rappeler que le taux de chômage dans les zones urbaines sensibles était de 45 % pour les jeunes de 15 à 24 ans en 2012. Or s’il est un public qui doit être prioritaire dans notre système de formation, c’est bien celui-là.
Ma question sur ce point sera donc simple. Bien que le constat d’une iniquité dans l’accès à la formation soit partagé par tous, cette iniquité demeure. Adhérez-vous à l’idée selon laquelle les salariés précaires et les demandeurs d’emploi devraient avoir un taux d’accès à la formation supérieur à celui des salariés diplômés ? Si tel est le cas, quelles sont les actions que vous avez entreprises, ou que vous comptez entreprendre, pour aller dans ce sens ?
Le deuxième point que met en exergue le rapport est l’impératif de réformer la gouvernance et de coordonner au mieux les nombreux intervenants du système de formation.
La formation professionnelle continue fait aujourd’hui intervenir l’État, ses opérateurs, les régions, les entreprises, les partenaires sociaux et les chambres consulaires, autant d’acteurs qui participent à sa gestion, ainsi qu’à son financement. Le groupe multipartite animé par Pierre Ferracci en juillet 2008 avait déjà abouti à un consensus clair sur la manière de coordonner ce réseau de formation. On lisait en effet, dans ses conclusions, que « la pertinence de l’échelon territorial régional et la légitimité des conseils régionaux pour l’entretenir ne font pas débat. » La proposition no 10 du rapport de Jeanine Dubié et Pierre Morange confirmait le consensus établi en 2008 par le groupe multipartite sur le rôle central que devait jouer la région dans le système de formation continue et proposait d’achever la décentralisation avec la mise en place d’un chef-de-filat clair pour cet échelon territorial.
Dès lors, une question se pose : comment rendre ce rôle de chef-de-filat effectif ? Il importe, premièrement, de doter la région de moyens suffisants, notamment au regard des publics dont la compétence lui a été transférée à l’occasion de la loi de mars 2014 – les personnes en situation de handicap, les personnes sous main de justice et les Français établis hors de France. Il faut, deuxièmement, renforcer le rôle de la région vis-à-vis des autres parties prenantes, notamment les organismes collecteurs et les entreprises, qui restent les principaux donneurs d’ordre au travers de leurs plans de formation. Quels moyens concrets les régions ont-elles donc aujourd’hui pour exercer ce rôle de chef-de-filat sur la formation continue ?
Le troisième point qui fait consensus, s’agissant de la nécessaire réforme de la formation continue, est la formation tout au long de la vie. Cette idée est déjà largement partagée. La loi du 4 mai 2004 avait déjà mis en place un Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Les conclusions du groupe multipartite de juillet 2008 proposaient également un droit différé à la formation pour ceux qui auraient quitté de façon précoce le système scolaire, reconnaissant ainsi aux personnes sorties précocement du système éducatif un droit à la formation différée financé par l’État.
En 2009, était créé un autre outil au service de la formation tout au long de la vie : le Fonds paritaire de sécurisation des parcours. Et la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle a enfin institué le compte personnel de formation. C’est un premier pas intéressant puisque chacun en est doté dès son entrée dans le monde du travail et jusqu’à son départ à la retraite. De plus, il peut être utilisé sans accord de l’employeur si la formation n’a pas lieu pendant le temps de travail et si celle-ci est qualifiante. Contrairement au droit individuel à la formation, chaque individu peut conserver son compte quelle que soit sa situation et l’utiliser librement. Il reste toutefois nettement insuffisant en termes de dotation horaire puisque ce compte est crédité de 150 heures plafonnées, alors que la plupart des formations nécessitent entre 400 et 1 200 heures. Cette dotation horaire doit donc être abondée par l’ensemble des partenaires – entreprises, branches, OPCA, collectivités, État – pour pouvoir fonctionner réellement.
Comme l’écrivaient il y a tout juste un an mes collègues élus régionaux en charge de la formation, la formation tout au long de la vie « peut être un élément majeur d’une grande ambition de transformation sociale : en donnant à chacune et à chacun les moyens d’avoir prise sur sa propre histoire, en luttant contre les inégalités et les exclusions, en retissant le lien entre les générations, en s’inscrivant dans la perspective d’un vrai partage du travail, en accompagnant la nécessaire transition écologique de notre économie ».
Les étapes que nous venons de voir, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en 2004 au compte personnel de formation dix ans plus tard, démontrent à la fois le consensus autour de cette notion et l’insuffisance des moyens accordés à ce droit pour qu’il soit vraiment effectif.
Plusieurs questions se posent donc à ce stade. Quel bilan tirez-vous des outils déjà mis en place, notamment le Fonds paritaire de sécurisation des parcours et le droit individuel à la formation qui précédait le compte personnel de formation ? Envisagez-vous d’accroître les moyens consacrés à ces outils, notamment par redéploiement des fonds collectés par les OPCA ? Enfin, le droit différé à la formation pour les sorties précoces du système éducatif – évoqué par le groupe multipartite de 2008 – fait-il partie des réformes que vous envisagez pour rendre plus équitable notre système de formation continue ?
Pour conclure, je souhaite préciser que la loi de mars 2014 répond en partie aux enjeux que je viens de rappeler. J’évoquerai tout à l’heure dans ma question les conditions de sa mise en oeuvre, mais il apparaît d’ores et déjà nécessaire d’aller plus loin pour répondre aux trois enjeux principaux dont j’ai fait état : l’accès des moins diplômés et des plus précaires à la formation, les moyens réels donnés aux régions pour coordonner la gouvernance du système de formation et le renforcement des outils au service des citoyens pour exercer réellement leur droit à la formation tout au long de la vie.
Car au-delà des constats partagés depuis maintenant plus de dix ans, la réforme du système de formation reste difficile à mettre en oeuvre. Cette réforme est pourtant cruciale pour réduire les inégalités dans notre pays, organiser les nécessaires transitions de notre économie, notamment les transitions écologiques, et bien entendu lutter contre le chômage qui touche aujourd’hui 10 % de la population active. Pouvez-vous donc nous préciser, monsieur le ministre, si vous comptez poursuivre et amplifier de manière plus ambitieuse la réforme de mars 2014 ?

Monsieur le président, monsieur le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd’hui pour débattre de l’évaluation de l’offre et des besoins en formation professionnelle. C’est un sujet majeur pour notre société, particulièrement en cette période de profondes évolutions socio-économiques et technologiques. Nous avons d’ailleurs eu l’opportunité d’y travailler, il y a tout juste un an, dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
Je rappelle que ce texte avait été précédé, en janvier 2014, d’un rapport d’information de nos collègues Jeanine Dubié et Pierre Morange portant précisément sur « l’évaluation de l’adéquation entre l’offre et les besoins de formation professionnelle ». Ce rapport a permis de poser un diagnostic éclairant sur le fonctionnement du système paritaire et les effets de la décentralisation. Il a également souligné le fait que l’accès à la formation professionnelle est, dans notre pays, très insuffisant et de surcroît inégalitaire.
En effet, selon le rapport, ce sont les personnes les plus diplômées et les plus qualifiées qui accèdent le plus facilement à la formation professionnelle continue. Les chiffres avancés sont éloquents. Chez les actifs occupant un emploi, 66 % des diplômés de niveau supérieur à bac + 2 ont suivi au moins une formation dans l’année 2012 contre 25 % seulement des personnes sans diplôme. Ce sont également les cadres qui accèdent le plus aisément à la formation : ils étaient 68 % en 2012, contre 37 % pour les ouvriers. Il faut ajouter que la taille de l’entreprise accentue ces inégalités.
Quant aux demandeurs d’emploi, ils sont véritablement les parents pauvres de la formation, ce qui est assez paradoxal. Là encore, les chiffres du rapport d’information sont éloquents. En 2012, 566 000 demandeurs d’emploi sont entrés en formation, soit 4,5 % de moins qu’en 2011. Et seuls 12 % des fonds de la formation professionnelle bénéficiaient aux demandeurs d’emploi. Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer cet état de fait, dont la difficulté à analyser les besoins en formation, le coût de la formation, le poids des responsabilités familiales et l’éloignement géographique du lieu de formation.
Le projet de loi adopté le 5 mars 2014 permettra-t-il de lever ces obstacles ? Il est évidemment trop tôt pour le dire, mais nous avions déjà fait part de certaines préoccupations qui, bien sûr, persistent aujourd’hui.
Nous avons approuvé le changement d’approche faisant passer d’une obligation de dépenser à une obligation de former, ainsi que la création d’un compte individuel de formation et la portabilité du droit à la formation. Nous avons également salué l’augmentation du plafond des heures de formation, passant de 120 à 150 heures, même si ces chiffres sont modestes – Mme Eva Sas vient de nous le rappeler – et si, au regard des difficultés réelles et prégnantes dans l’accès à la formation que je rappelais, ces avancées restent timides.
Mais nous avions souligné deux grandes limites à ce projet de loi sur lesquelles je crains fort que celui-ci n’achoppe. La première est la baisse massive de l’obligation de financement de la formation professionnelle par les employeurs, de l’ordre de 2,5 milliards d’euros, soit près d’un tiers. On peut légitimement se demander comment prétendre améliorer l’accès à la formation en en réduisant aussi massivement les moyens.
La seconde est un droit d’opposabilité marginal pour le salarié. Comment peut-on prétendre favoriser l’accès des catégories populaires des personnes les moins diplômées et les moins qualifiées à la formation quand on fait porter sur le seul salarié le poids de la responsabilité de la lutte contre l’illettrisme ?
Quant aux salariés à temps partiel, qui sont à 80 % des femmes, ils seront doublement pénalisés puisque contraints à ne travailler que peu de temps, ils auront très peu d’heures inscrites à leur compte personnel de formation.
L’ensemble de ces réserves, vous le comprendrez, nous laisse sceptiques sur les progrès que l’on peut attendre de cette loi qui vient tout juste d’entrer en vigueur. Pour ces raisons, notre débat aujourd’hui est sans doute précoce. Il peut toutefois être le préalable à un prochain échange, quand nous serons en mesure d’évaluer précisément si les dispositions de cette loi ont pu réduire les inégalités d’accès à la formation, notamment pour celles et ceux qui en ont le plus besoin, ce qui doit rester notre seule boussole.
Je rappellerai enfin pour conclure qu’aux termes de la constitution du 27 octobre 1946, la nation doit : « garantir l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. » Il reste, chacun le mesure, beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre cet objectif.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il y a un an presque jour pour jour, notre assemblée adoptait en première lecture la loi sur la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale. Je remercie nos collègues écologistes de nous donner l’occasion, par ce débat, d’en dresser un premier bilan qui, disons-le, est plutôt positif.
L’accord des partenaires sociaux du 13 décembre 2013 et sa transcription par le Parlement avaient donné lieu à de nombreux débats et de nombreuses inquiétudes, la première étant de savoir si l’année 2014 suffirait pour mettre en place les nouveaux circuits financiers et toute la logistique que suppose le compte personnel de formation. Aujourd’hui, le pari a été tenu, et en ce qui concerne le compte personnel de formation, le site internet « moncompteformation.gouv.fr » est opérationnel depuis le 3 janvier. Au cours du premier mois, il a reçu près de 1,7 million de visites ; 500 000 personnes ont déjà ouvert leur compte et plus de 6 000 projets de formation sont enregistrés.
Comme je l’avais indiqué par anticipation à cette même place, on peut aujourd’hui prendre son smartphone, aller sur son compte, inscrire ses heures DIF, chercher les formations qui nous concernent dans la liste des certifications éligibles et trouver des informations sur les modalités de financement et les interlocuteurs qui peuvent nous accompagner. Demain, n’en doutons pas, des applications numériques nous permettront de trouver la formation adéquate le plus près de chez nous avec, sans doute, comme cela existe pour les hôtels ou les restaurants, des avis des bénéficiaires, des statistiques sur la pertinence de la formation et la réussite à l’issue de celle-ci.
De même, les nouvelles instances de gouvernance de la formation professionnelle et de l’emploi prévues par la loi ont été mises en place. Au niveau national, le CNEFOP – Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle –, qui fusionne le Conseil national de l’emploi et le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie – CNFPTLV – est totalement opérationnel et s’est déjà réuni plusieurs fois, et encore mardi dernier. Il en va de même pour l’instance paritaire nationale des branches professionnelles, le COPANEF, qui a entre autres pour mission d’élaborer les fameuses listes de formations éligibles, dont nous avions longuement débattu lors de la discussion de la loi. Il vient d’y introduire – je tiens à le souligner car c’était fortement attendu – les formations linguistiques qui représentent aujourd’hui un tiers des formations.
Les déclinaisons régionales de ces instances, CREFOP et COPAREF, sont elles aussi installées, à tel point que certains de nos collègues envisagent déjà de les modifier dans le cadre du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Cela paraît un peu précipité – nous verrons cela mardi ou mercredi prochain – d’autant plus que nous avons déjà à assimiler le redécoupage des régions qui va bien évidemment entraîner un changement de périmètre de ces instances.
Enfin, pour la première fois, celles-ci vont permettre d’élaborer, de coordonner et d’évaluer en un seul lieu les politiques d’emploi, de formation, d’orientation et d’accompagnement des demandeurs d’emploi.
Mais le débat d’aujourd’hui porte essentiellement sur la qualité et l’adéquation de l’offre de formation. C’est un vaste sujet qui est apparu tardivement dans le débat parlementaire, porté essentiellement par les sénateurs et repris lors de la commission mixte paritaire.
La solution finalement retenue a été d’imposer aux principaux financeurs d’actions de formation de s’assurer de la capacité des prestataires à dispenser une formation de qualité sur la base de sept critères définis par décret en Conseil d’État, décret que nous avons d’ailleurs examiné et approuvé lors de la séance du CNEFOP qui s’est tenue mardi dernier.
Mais comme j’ai souvent eu l’occasion de le dire, c’est le compte formation en lui-même qui va être porteur d’amélioration de la qualité de la formation et transformer la question de l’adéquation de l’offre à la demande et aux besoins.
En effet, tout un chacun aura à coeur que les heures de formation qu’il aura pu épargner sur son compte personnel soient de la meilleure qualité possible, à la différence du DIF qui permettait de financer tout et n’importe quoi. Au contraire, le compte personnel de formation ne permet de financer que des formations qualifiantes ou certifiantes, ce qui en soit est déjà un gage de qualité.
Mais la qualité, ce n’est pas uniquement la qualité des formateurs et des organismes de formation. C’est aussi suivre une formation adaptée à ses besoins et à son niveau.
Là aussi, le choix fait par notre assemblée d’introduire l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience comme un droit opposable financé dans le cadre du CPF devrait permettre des parcours de formation plus qualitatifs, plus appropriés et mieux ciblés. On pourra, dans un premier temps, valider ses acquis par l’expérience, puis dans un second temps utiliser le même compte pour se former et valider les modules qui manquent.
L’enjeu est donc d’organiser les diplômes, les certifications et la formation en modules, avec des certifications intermédiaires.
La loi du 5 mars 2014 modifie en profondeur le financement du système de formation, en remplaçant une obligation fiscale par une obligation de former. Elle modifie également la gouvernance de la formation professionnelle, en trouvant un nouvel équilibre entre l’État, les régions et les branches professionnelles. Elle modifie enfin l’offre de formation, qui doit être modularisée, et l’organisation même de la formation professionnelle, avec la création du compte personnel de formation – reste à savoir, monsieur le ministre, quand seront ouvertes les négociations permettant de l’étendre aux fonctionnaires et aux travailleurs indépendants. Je n’oublie pas les dispositifs d’accompagnement, notamment l’entretien professionnel et le conseil en évolution professionnelle.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, en dotant chaque salarié d’un compte personnel de formation, dont le financement est garanti collectivement, nous avons mis en place une coresponsabilité qui va progressivement modifier l’offre de formation et améliorer son adéquation aux besoins. Cette période de mutation est engagée. Il est sûrement encore trop tôt pour l’évaluer, mais je propose que nous menions, au deuxième semestre, une mission d’information sur l’application et l’évaluation de la loi du 5 mars 2014, comme nous l’avions fait avec Gérard Cherpion pour la loi de 2009.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, un an à peine après sa promulgation, la loi sur la formation professionnelle montre déjà ses limites. Ce texte devait répondre en particulier aux problèmes des personnes les plus en difficulté, les plus éloignées de l’emploi, c’est-à-dire des demandeurs d’emploi de longue durée. Or les chiffres du chômage sont sans pitié : notre pays comptait 5,52 millions de demandeurs d’emploi à la fin du mois de décembre, et probablement davantage en janvier selon l’ASSEDIC.
Dans le même temps, le ministre du travail annonce un droit réel à une formation qualifiante gratuite. Il reconnaît ainsi que nous avions raison lorsque nous avions dénoncé, lors de l’examen de la loi relative à la formation professionnelle dans cet hémicycle, le fait que les mesures proposées ne répondaient pas aux attentes des publics les plus fragiles. Le compte personnel de formation mis en place par cette loi, en remplacement du droit individuel à la formation, est crédité au prorata des heures travaillées, ce qui en exclut les personnes en dehors de l’emploi depuis longtemps et les travailleurs à temps partiel.
Le ministre du travail propose un plan en faveur des demandeurs d’emploi de longue durée qui repose sur un financement hypothétique, puisqu’il est à la charge des collectivités locales et des partenaires sociaux.
J’en viens aux 220 millions d’euros que vous prélevez, monsieur le ministre, sur le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Sur les bancs de la gauche, on entendait des cris lorsque le précédent gouvernement opérait de tels prélèvements, que j’ai d’ailleurs moi-même dénoncés. Ce prélèvement de 220 millions d’euros empêchera le FPSPP de réaliser une partie de ses actions, pourtant destinées aux exclus de la qualification et de l’emploi. Vous sollicitez une nouvelle fois Pôle emploi en multipliant ses missions, à effectif et budget constants.
Dois-je rappeler, monsieur le ministre, que le budget du ministère du travail est en baisse de 3 % cette année, ce qui montre bien que l’emploi n’est pas une priorité pour le Gouvernement ?
En fait, ce plan en faveur des chômeurs de longue durée est bien loin de la grande cause nationale annoncée par le Président de la République : les mesures annoncées sont ou obsolètes ou réchauffées. Ainsi, l’objectif de 460 000 demandeurs d’emploi bénéficiant d’un accompagnement intensif figurait déjà dans la nouvelle convention entre l’État et Pôle emploi. Faut-il rappeler que cela ne concerne que 20 % des 2,2 millions de personnes concernées ? Permettez-moi, monsieur le ministre, de vous demander de quelle manière les bénéficiaires seront sélectionnés.
Le dispositif de réservation de places de crèche est expérimenté depuis un an et sa mise en oeuvre s’avère particulièrement difficile. Les contrats de professionnalisation sont en baisse constante depuis deux ans et vous annoncez la création de deux nouveaux types de contrats. En dehors de la complexification du dispositif et de la moindre appétence pour les chefs d’entreprise, comment seront-ils financés et accompagnés ?
En fait, monsieur le ministre, dans le contexte catastrophique de l’emploi en France, dont nous ne pouvons pas nous réjouir, l’affaiblissement du pôle ministériel « travail et emploi » du fait de la disparition du secrétariat d’État à la formation professionnelle et à l’apprentissage se fait durement sentir. Le nombre de contrats d’apprentissage continue de baisser : en deux ans de présidence Hollande, c’est un recul de dix ans qu’il faut déplorer. Aujourd’hui, le nombre d’entrées en apprentissage est équivalent à celui de 2005.
S’agissant de la formation professionnelle, le ministre du travail de l’époque nous avait assuré, pendant les débats, qu’il laisserait un mois à son administration pour la publication des textes d’application. Près d’un an plus tard, moins de 50 % de ces textes ont été publiés. Quarante-six mesures réglementaires ont été prises par le Gouvernement, cinquante mesures réglementaires prévues par la loi n’ont pas encore été prises par le Gouvernement, et huit mesures non réglementaires n’ont pas encore été prises. Je vois que vous en doutez, monsieur le ministre. Je cite pourtant les chiffres publiés sur le site internet du Sénat.
Aussi, monsieur le ministre, ce débat met en évidence l’échec de la politique gouvernementale en matière d’emploi. Les contrats de génération en sont une illustration. D’ailleurs, leur financement a presque disparu du budget pour 2015.
Aujourd’hui, monsieur le ministre, la conjoncture s’améliore partout dans le monde grâce à la baisse du coût du pétrole, à la baisse de l’euro, au plan d’investissement de la Commission européenne et à la politique monétaire volontariste de la Banque centrale européenne. Pourtant, notre pays n’en profite pas. Vous devez réorienter votre politique.
C’est en travaillant à la réduction de la complexité du code du travail – les dispositions relatives au compte pénibilité n’en sont qu’un exemple –, en favorisant les accords de développement dans l’emploi, en revenant sur l’interdiction de travailler moins de 24 heures et en déverrouillant le cadenas des 35 heures que l’on résoudra les problèmes de l’emploi.
Monsieur le ministre, mieux vaut un demandeur d’emploi qui travaille à temps partiel, en bénéficiant d’une compensation de salaire et de formations, qu’un demandeur d’emploi éloigné du travail. C’est le défi que nous devons relever de toute urgence.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre système de formation professionnelle s’est construit par réformes successives à partir de 1971 pour répondre aux ambitions multiples qu’il a suscitées. Initialement, il avait vocation à assurer le développement personnel et la promotion sociale des salariés. Il a ensuite évolué, en raison de la crise économique des années 1980 qui a vu le développement d’un véritable chômage de masse, pour devenir un outil d’adaptation aux mutations économiques. La formation professionnelle est alors devenue une mesure de traitement social du chômage. Enfin, depuis 2009, la complexification de la vie professionnelle, de moins en moins linéaire, impose un objectif supplémentaire à notre système de formation professionnelle : la sécurisation des parcours. Mais aujourd’hui, force est de constater qu’en dépit du budget qui lui est consacré, les résultats escomptés ne sont pas à la hauteur des espérances. En effet, le système de la formation professionnelle demeure très complexe, cloisonné et illisible.
Le rapport d’information de janvier 2014 de nos collègues Jeanine Dubié et Pierre Morange, dont je veux souligner l’excellence, a dressé un état des lieux et formulé dix-huit propositions pour améliorer l’accès à la formation professionnelle. Il s’agit notamment de favoriser l’accès à la formation des publics les plus éloignés – salariés peu qualifiés et demandeurs d’emploi –, de simplifier les instances de pilotage, d’accélérer la réforme de l’intermédiation et de réguler plus efficacement l’activité des organismes de formation.
Ce rapport a montré que le système de formation professionnelle était source d’inégalités, puisque les salariés les moins qualifiés et les demandeurs d’emploi n’en bénéficient aujourd’hui que très peu. Ainsi, les faiblesses de notre système de formation initiale ont été mises en évidence. Rappelons que 130 000 jeunes quittent une formation sans qualification chaque année. En outre, le rapport a relevé un autre problème : le système de financement intermédié, à travers des organismes paritaires collecteurs agréés peu transparents, est propice aux conflits d’intérêts.
Toutefois, nombre de dispositions de la loi relative à la formation professionnelle, dont nous avons débattu l’année dernière, ont répondu à certains problèmes soulevés dans ce rapport. Depuis le 1er janvier 2015, tout actif dispose d’un compte personnel de formation – un CPF – qui lui permettra de bénéficier de cours jusqu’à sa retraite. Ce CPF remplace le droit individuel à la formation et permet notamment de bénéficier de formations courtes. Ce nouveau dispositif s’ajoute au congé individuel de formation et devrait faciliter l’évolution professionnelle des salariés.
S’agissant de la jeunesse, la réforme globale de l’apprentissage engagée en 2013 et la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle ont permis de rénover le dispositif existant. L’objectif de créer plus de 500 000 places d’apprentissage d’ici à 2017, annoncé par le Gouvernement en automne dernier, est louable : il s’inscrit dans la continuité de politiques publiques axées sur l’emploi, le travail et la jeunesse à travers la formation professionnelle. Nous ne pouvons que nous en féliciter.
De même, nous saluons la volonté de flécher, à partir de 2015, une plus grande part de la taxe d’apprentissage vers les centres de formation d’apprentis, ainsi que l’augmentation sensible des recettes du compte d’affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage » entre 2014 et 2015, comme nous avons pu le constater lors de l’examen de la mission « Travail et emploi » du projet de loi de finances pour 2015.
Au-delà de ces aspects budgétaires, on peut toutefois s’interroger sur la vision que les jeunes ont de l’apprentissage et de la formation professionnelle en France. Chez nos proches voisins, par exemple en Suisse, l’apprentissage n’est pas considéré comme une voie de garage : ainsi, la proportion de jeunes optant pour ce type de formation est singulièrement plus élevée.
Au-delà des questions d’organisation ou de budget, il est aussi de notre responsabilité d’engager des politiques publiques qui encouragent la formation professionnelle pour les jeunes, mais également pour les moins jeunes, puisque la situation économique actuelle suscite davantage d’interrogations légitimes chez nos concitoyens.
L’époque où l’on n’exerçait qu’un seul métier tout au long de sa vie est bientôt révolue. Les objectifs et les besoins en formation sont en mouvement perpétuel. Il revient donc au législateur de mettre en place des politiques publiques de qualité, afin d’aider le salarié à répondre au mieux aux questions qu’il peut se poser tout au long de sa carrière : comment peut-il évoluer dans son entreprise, voire se reconvertir ou se mettre à niveau ? Que va lui apporter une nouvelle formation ? Si de nouveaux mécanismes ont été mis en place récemment, il reste à instaurer un dispositif permettant d’aider le salarié dans sa réflexion avant de s’engager dans telle ou telle formation. Il nous revient d’accompagner nos concitoyens le mieux possible par le biais de politiques publiques innovantes, claires et précises.

Monsieur le président, monsieur le ministre – je salue également la présence des deux vice-ministres de la formation professionnelle, Gérard Cherpion et Jean-Patrick Gille (Sourires) –, notre système de formation professionnelle ne permet de répondre que de manière imparfaite, sinon insatisfaisante, aux objectifs qui lui sont assignés. La raison en est simple et je pense que vous la connaissez, monsieur le ministre : ce système, créé en 1971, comme votre serviteur,
Sourires
Sourires.

Merci, mon cher collègue !
Or quelques bouleversements sociaux, économiques et technologiques majeurs sont intervenus à l’échelle du pays et de la planète au cours des quarante dernières années. Il est donc devenu urgent de moderniser ce système de formation professionnelle, de l’adapter à un monde ouvert aux échanges et qui évolue à une vitesse impressionnante. La formation professionnelle est au coeur de la valorisation de la ressource humaine, la première richesse de notre nation.
Nous connaissons les points forts du système. Nous en connaissons également les carences, grâce à l’excellent rapport de nos collègues Jeanine Dubié et Pierre Morange, à qui je tiens à rendre hommage, sur l’évaluation de l’adéquation entre l’offre et les besoins de formation professionnelle.
Le financement du système est complexe et opaque – c’est peu de le dire ! Avec le montant impressionnant de 31,3 milliards d’euros, la formation professionnelle fait l’objet d’un effort de financement considérable, sans pour autant permettre un accès équitable à la connaissance, sans véritablement sécuriser les parcours professionnels ni favoriser la promotion professionnelle.
Le système est donc inégalitaire : il pénalise les salariés des petites entreprises par rapport à ceux des grandes, les ouvriers par rapport aux cadres, les femmes par rapport aux hommes et les chômeurs par rapport aux actifs.
Sa gouvernance – vous l’avez souligné dans vos diverses propositions, cher collègue Cherpion – est encore caractérisée par l’éparpillement : État, régions, partenaires du dialogue social, entreprises, organismes de formation continue, tous se marchent sur les pieds, si je puis dire.
En l’absence d’un véritable pilote dans l’avion, les filières de formation sont artificiellement pourvues, parfois au mépris des aspirations personnelles, des spécificités des bassins d’emplois ou des compétences dont la France aurait besoin.
Ces carences ont une conséquence dramatique : chaque année, 400 000 offres d’emploi demeurent sans réponse. Or la formation professionnelle devrait précisément permettre une adéquation entre les profils des candidats et les besoins du recruteur en mettant un terme à cet immense gâchis.
Les deux axes d’action privilégiés par nos collègues Jeanine Dubié et Pierre Morange – mieux prendre en compte la diversité des besoins de formation professionnelle et mieux adapter l’offre de formation professionnelle continue à la demande – sont indispensables pour rénover la formation professionnelle.
Les propositions qu’ils formulent dans leur rapport sont autant de mesures utiles qu’il faudrait également mettre en oeuvre. La question fondamentale qu’ils se posent est de savoir si l’on peut refondre la formation professionnelle, dans notre pays, sans réformer profondément notre démocratie sociale, en particulier le paritarisme. Cette question va d’ailleurs bien au-delà du seul problème de la formation professionnelle ; il est urgent d’y répondre au regard des difficultés rencontrées par les partenaires sociaux – on l’a encore constaté récemment – pour trouver des accords sur des sujets importants pour nos compatriotes.
Nos anciens collègues Nicolas Perruchot et Richard Mallié avaient essayé de répondre à cette question difficile dans le cadre de la fameuse commission d’enquête sur le financement des organisations patronales et syndicales, dont le rapport n’a jamais été publié. Tant que nous n’aurons pas apporté de réponse claire à cette question fondamentale dans un pays qui a besoin de partenaires sociaux puissants – je n’ai pas dit trop puissants –, tant que nous n’aurons pas réformé le paritarisme, précisément pour que les partenaires sociaux soient puissants, nous ne trouverons pas de solution au problème de la formation professionnelle.

La parole est à M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, avant de commencer mon propos, je tiens à excuser l’absence du ministre du travail, François Rebsamen, qui copréside actuellement aux côtés du Premier ministre la Commission nationale de lutte contre le travail illégal. Il sera bien entendu informé de la teneur de nos échanges. Pour ce qui me concerne, ma disponibilité est totale pour répondre à vos questions.
Dans la bataille pour l’emploi que nous menons collectivement au sein du Gouvernement, nous savons que la formation professionnelle est un outil efficace qui répond à un double défi : sécuriser davantage les parcours professionnels et renforcer la compétitivité de nos entreprises. Je m’en tiendrai à ces deux aspects, mais je ne manquerai pas de répondre à M. Cherpion, même si la tonalité critique de son intervention relevait davantage d’une séance de questions au Gouvernement, et de transmettre ses interrogations au ministre du travail.
Permettez-moi tout d’abord de rappeler que budget dédié à la formation en faveur des demandeurs d’emploi s’élève à plus de 5 milliards d’euros chaque année, dont 2 milliards pour les régions. Celles-ci ont donc une responsabilité importante dans le dispositif qui doit se traduire sur le plan budgétaire. La compétence transférée aux régions en matière de formation montre, s’il en était besoin, la priorité qui est la nôtre en ce domaine.
En ce qui concerne les partenaires sociaux, sujet évoqué par M. Richard, le financement des formations gratuites pour les demandeurs d’emploi n’est pas hypothétique. Une enveloppe de 220 millions d’euros a été déterminée contractuellement avec l’État, Pôle emploi et les régions ajouteront leur financement. Même si les demandeurs d’emploi n’ont pas d’heures inscrites en 2015 dans le cadre de leur compte personnel, le dispositif qui implique les partenaires sociaux permettra de créditer 100 heures pour financer les actions de formation. Le plan de lutte contre le chômage de longue durée, que vous sembliez critiquer, monsieur le député – ce qui est légitime au regard de votre inclination politique – ne se limite donc pas à cette seule mesure ; ce n’est qu’un des éléments de réponse du Gouvernement.
Pour répondre aux besoins du marché du travail, lesquels sont à la fois spécifiques et en évolution constante, un certain nombre de décisions ont été prises par le Gouvernement afin de mieux faire coïncider l’offre et la demande de formation, ce qui est l’objet de notre débat.
Dès 2013, le plan « 30 000 formations prioritaires » pour l’emploi a été lancé. Il a été suivi en 2014 par le plan « 100 000 formations prioritaires ».
Pour identifier précisément ces besoins et définir une offre de formation pertinente, le ministre François Rebsamen a réuni les représentants des régions, ainsi que les organisations syndicales et patronales pour mettre en place des formations prioritaires dans des métiers qui offrent des opportunités d’emploi, à court et moyen terme.
Cette méthode de travail repose sur une analyse concertée des besoins et des dispositifs de formation existants. Elle a été déclinée dans chacune des régions avec l’établissement d’une liste des métiers en tension. C’est à partir de ces constats qu’un plan d’action a été développé, avec des objectifs quantitatifs ambitieux afin que l’offre et la demande de formation professionnelle à l’échelle des territoires soient en synergie. Les résultats ont été à la hauteur.
Mais au-delà de cette méthode, c’est l’ensemble du système de formation professionnelle continue que nous avons réformé. La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a apporté plusieurs avancées dans la lignée des préconisations du rapport du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques du 23 janvier 2014, présenté par Mme Jeanine Dubié et M. Pierre Morange. Au nom du Gouvernement, je tiens ici à saluer ce travail parlementaire qui a largement participé à l’élaboration du projet de loi.
À trois égards, la loi du 5 mars 2014 permet de répondre à la nécessité d’une adéquation entre l’offre et la demande de formation.
Premièrement, elle a fait coïncider les besoins individuels de chaque actif avec l’offre de formation qui lui est proposée.
La loi a notamment créé un droit à la formation universel et attaché à la personne tout au long de sa vie active jusqu’à la retraite. C’est le compte personnel de formation – CPF –, issu du dialogue fructueux et des propositions des partenaires sociaux lors des accords nationaux interprofessionnels du 11 janvier et du 14 décembre 2013.
Le dispositif est une nouvelle modalité d’accès à la formation et permet d’accroître le niveau de qualification de chacun tout en sécurisant son parcours professionnel.
Comment fonctionne-t-il ?
Ce compte est alimenté annuellement : 24 heures de droits à la formation jusqu’à un total de 120 heures, puis 12 heures jusqu’à un total de 150 heures. Les heures cumulées sont acquises à la personne, y compris pour des périodes non travaillées. Il revient alors au titulaire du CPF de mobiliser ses heures inscrites. Chaque actif bénéficie ainsi de possibilités réelles de formation qu’il décidera librement de mobiliser tout au long de son parcours professionnel.
Deuxièmement, la loi a fait coïncider les besoins individuels et collectifs dans l’entreprise avec l’offre de formation.
La formation professionnelle doit aussi être un outil mobilisable par les entreprises pour trouver les compétences correspondant à leurs besoins, ce qui correspond à un changement de priorité. C’est pourquoi la loi du 5 mars 2014 considère la formation professionnelle comme un réel investissement au service du développement économique des compétences au sein des entreprises. Elle responsabilise et redonne la main aux entreprises dans la détermination précise de leurs besoins, là où il existait auparavant une « obligation de dépenser » au titre du plan de formation dans les entreprises de plus de 300 salariés. Le système est donc beaucoup plus intelligent, plus vertueux, plus pertinent.
Parce que nous savons que le dialogue social permet une meilleure adéquation des solutions, le rôle des instances des représentants des personnels dans la détermination des besoins de formation est renforcé. La loi incite notamment à la signature d’accords d’entreprise sur les questions de la formation. Le dialogue social dans l’entreprise autour des questions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et de formation professionnelle est donc ainsi rendu plus cohérent.
Enfin, la loi a créé des entretiens individuels entre l’employeur et chacun des employés afin de déterminer conjointement les évolutions professionnelles envisageables, ce qui constitue une évolution positive. C’est désormais au sein même de l’entreprise, en faveur des employeurs et des salariés, que se définiront les besoins de formation et les moyens d’y répondre.
Troisièmement, la loi a permis une meilleure prise en compte des besoins économiques dans la définition des politiques de formation professionnelle. Nous avons cherché à préciser l’offre de formation afin que celle-ci serve les besoins économiques et corresponde à la conjoncture, répondant ainsi aux préoccupations, que nous partageons tous, en termes d’emploi.
Outre les formations sur les compétences de base, le compte personnel de formation ne peut être mobilisé que pour des formations éligibles dont la liste est définie par les branches et les partenaires sociaux.
La liste des formations éligibles dont peut bénéficier le salarié est ainsi composée de la liste des formations définie par la commission paritaire nationale de l’emploi de la branche professionnelle de l’entreprise, à laquelle s’ajoutent une liste régionale et une liste nationale établies par les partenaires sociaux.
Pour les demandeurs d’emploi spécifiquement, la liste est composée d’une liste régionale établie à partir des formations financées par les régions et Pôle emploi, ainsi que de la liste nationale interprofessionnelle, nous pouvons ainsi couvrir l’ensemble du champ de la demande.
Pour la première fois, mesdames, messieurs les députés, ces listes correspondent à des besoins économiques identifiés par les branches et les partenaires sociaux. Elles sont le fruit d’analyses territoriales qui permettent d’articuler des logiques de bassins d’emploi et des logiques sectorielles suivant les besoins des branches, ce qui semble l’évidence même.
Au-delà de la question de l’adéquation de l’offre et de la demande, un grand nombre de recommandations du rapport adopté par le Parlement a été concrétisé par la réforme du 5 mars 2014. Permettez-moi de rappeler quelles ont été ces avancées.
D’abord, la loi porte une exigence forte : rendre accessible aux publics qui en ont besoin une formation qualifiante.
La formation professionnelle doit être accessible plus facilement aux demandeurs d’emploi qui peuvent mettre à profit un temps d’inactivité pour développer leurs compétences grâce au compte personnel de formation.
De plus, la loi favorise l’accès à la formation des salariés des TPE et PME afin qu’elle ne bénéficie pas seulement aux employés de grands groupes. Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels voit ses missions renforcées pour soutenir l’effort de formation dans ces entreprises de petite taille. Dans le cadre du plan de lutte contre le chômage de longue durée présenté lundi 9 février par le ministre du travail, ce sont 220 millions d’euros qui sont prévus à ce titre par les partenaires sociaux.
Toutes les formations qui seront proposées dans le cadre du compte personnel de formation sont qualifiantes et diplômantes.
Ensuite, autre avancée, pour plus d’efficacité, la gouvernance de la formation professionnelle a été simplifiée.
La gouvernance du système de formation professionnelle veille désormais à l’articulation des politiques de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, ce qui est l’évidence même. C’est une organisation nouvelle à laquelle le Parlement est associé.
Une instance de pilotage nationale, le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles – CNEFOP – et de pilotage régional, le CREFOP, ont été mises en place en vue de plus d’efficacité. Ces instances rassemblent tous les acteurs de l’emploi et de la formation en un lieu unique de concertation.
Enfin, la responsabilité des régions est aujourd’hui clairement affirmée. Le processus de décentralisation a été achevé en matière de formation et d’insertion professionnelles. Le service public régional de l’orientation a été créé, renforçant le rôle des régions dans la coordination. Ces dernières doivent se saisir pleinement de cette compétence qui leur a été conférée par la loi.
Nous devons désormais favoriser l’appropriation par les acteurs des avancées permises par la loi du 5 mars 2014.
Les entreprises doivent se structurer en interne et mener une politique de formation articulée avec la stratégie et la gestion prévisionnelle des emplois et des comptes. Dans un contexte de crise économique, la formation professionnelle constitue une formidable opportunité pour les entreprises de consolider et d’augmenter leur compétitivité.
C’est un investissement pour que les compétences de leurs salariés suivent l’évolution de leurs besoins.
Deuxièmement, les salariés et les demandeurs d’emploi doivent se saisir des nouveaux outils que les textes mettent à leur disposition.
Pour le salarié, l’enjeu est de pouvoir choisir, changer, évoluer tout au long de sa carrière : le compte personnel de formation va transformer les parcours professionnels et les pratiques de gestion des ressources humaines. Autonome dans la gestion de son compte, le salarié peut désormais se mobiliser en adéquation avec ses choix professionnels. Quant au conseil en évolution professionnelle, lui aussi créé par la loi du 5 mars 2014, il permet d’accompagner tous ses projets.
Pour le demandeur d’emploi, la mobilisation du compte personnel de formation est un outil qui favorise le retour à l’emploi.
L’enjeu est donc de susciter l’appétence des personnes concernées, qui éprouvent parfois des appréhensions à se saisir de ces nouveaux outils ou qui en ont des représentations négatives. Il nous faut les convaincre.
Enfin, les acteurs publics doivent s’assurer de la qualité de la formation. Il faut, au-delà de la loi du 5 mars, qui comporte des exigences en la matière, proposer des formations de qualité, et d’abord pour ceux qui en ont le plus besoin – donner plus à ceux qui ont moins. La loi a prévu qu’un décret fixe les critères permettant d’atteindre cet objectif de qualité. Issu d’une large concertation avec les partenaires sociaux, ce décret va être soumis pour examen au Conseil d’État ; je réponds ainsi à votre interpellation, monsieur Cherpion.
Les financeurs de la formation que sont les collectivités territoriales, Pôle emploi, l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées, les organismes paritaires collecteurs agréés – OPCA et OPACIF – et l’État sont particulièrement attentifs à cette question. Nous devons collectivement nous assurer que les prestataires de formations dispensent une formation de qualité.
Voilà, mesdames et messieurs, le bilan qu’aurait pu vous présenter M. Rebsamen. Des enjeux, des défis nous attendent encore. Je sais pouvoir compter sur votre mobilisation et sur votre apport. D’ailleurs, certaines préconisations du rapport qui nous intéresse aujourd’hui méritent tout notre intérêt ; je pense par exemple à la création d’un système d’information permettant de relier les différents comptes ou à une information renforcée sur les contrats d’objectifs et de moyens des OPCA.
Si la formation professionnelle permet de sécuriser les parcours professionnels, il est du devoir des pouvoirs publics de s’assurer de la qualité des formations proposées. Une formation de qualité est une formation qui répond aux besoins des employés et des entreprises ; c’est une formation qui répond aux besoins de l’économie du pays ; c’est une formation qui conduit à des résultats. Voilà notre engagement.
D’autres questions ont été posées par les orateurs inscrits ; j’y répondrai éventuellement, en lieu et place de M.Rebsamen, dans quelques instants. Quoi qu’il en soit, je lui transmettrai le contenu de nos échanges, pour sa parfaite information.

Nous en venons aux questions.
Je vous rappelle, chers collègues, que vous disposez de deux minutes pour poser chaque question.
Nous commençons par une question du groupe écologiste. La parole est à Mme Eva Sas.

Merci, monsieur le ministre, pour votre intervention.
Un certain nombre d’interrogations ont en effet été déjà exprimées par les orateurs. Je voudrais notamment en revenir à deux questions auxquelles vous n’avez pas répondu.
D’une part, je voudrais savoir de quelle façon vous souhaitez, ou pouvez, renforcer le rôle de chef de file de la région dans le système de formation. Cela a été évoqué à plusieurs reprises : vu le nombre élevé d’intervenants dans les dispositifs de formation, il serait nécessaire de clarifier le rôle des différents acteurs, notamment celui de la région – qui, selon nous, doit être central.
D’autre part, de nombreux acteurs nous ont fait part de leurs interrogations face au plafonnement à 150 heures de la dotation du compte personnel de formation ; en effet, de nombreuses formations exigent des dotations horaires de 400, voire 1 200 heures. Le plafond actuel vous semble-t-il suffisant pour acquérir des formations véritablement qualifiantes ?
Je voudrais en outre aborder très rapidement la question de la mise en oeuvre de la loi du 5 mars 2014. S’agissant du compte personnel de formation, il nous est remonté du terrain que le fait qu’il faille l’activer sur internet pouvait apparaître comme un frein, ou du moins comme une complexification du dispositif, notamment par rapport à son prédécesseur, le droit individuel à la formation – certes bien insuffisant à nos yeux.
Surtout, je veux abonder dans le sens de ma collègue Jacqueline Fraysse : le vrai problème, c’est que la loi du 5 mars 2014 a ramené à 1 % de la masse salariale – contre 1,9 % auparavant – l’obligation de formation pour les entreprises de plus de dix salariés. Ne risque-t-on pas d’assister à un certain désinvestissement des entreprises à l’égard des actions de formation ? La question avait déjà été posée lors de l’examen du projet de loi relatif à la formation professionnelle. Même si nous manquons de recul, la mesure étant d’application trop récente, je voudrais avoir votre avis sur le sujet.
Madame la députée, je vais essayer de répondre à vos quatre questions en une !
Sourires.
D’abord, c’est vraiment la région le chef de file ; mais il sera sûrement nécessaire de préciser, notamment en liaison avec l’Association des régions de France, les voies et les moyens de ce chef de filât. Je demanderai au ministre Rebsamen son opinion en la matière et je ne doute pas qu’il vous contactera pour vous rassurer sur ce point.
S’agissant du plafond de 150 heures, des assouplissements peuvent être accordés par Pôle emploi ou par les régions, notamment pour des formations courtes. Ce plafond est un objectif, non pas un obstacle à la formation des salariés.
Quant à un éventuel désengagement des entreprises en matière de formation professionnelle à la suite de la réduction de l’obligation légale, cette crainte ne me semble pas fondée, pour plusieurs raisons. D’abord, les entreprises investissent déjà au-delà de l’obligation légale – qui était, comme vous le savez, de 1,6 % ; en effet, l’effort constaté représente aujourd’hui 2,8 % de la masse salariale. Comme je l’ai souligné dans mon propos liminaire, l’enjeu aujourd’hui est, au-delà du taux de contribution, que l’entreprise considère la formation professionnelle comme un réel investissement, au service de sa compétitivité. Les entreprises doivent donc mieux analyser leurs besoins, et définir en conséquence des formations de qualité ; elles en ont les moyens, puisque la loi du 5 mars 2014 a supprimé l’obligation légale de dépenser, qui pouvait, reconnaissons-le, les amener à financer des formations pas toujours en adéquation avec leurs besoins. Aujourd’hui les entreprises ont une obligation bien différente : celle de former « utile » – si vous m’autorisez ce raccourci. Enfin, sur le plan jurisprudentiel, les entreprises ont, au-delà du taux de contribution à la formation professionnelle, l’obligation de renforcer la capacité des salariés à occuper un emploi. Je considère donc que la loi du 5 mars 2014 doit être mise en oeuvre suivant la logique du gagnant-gagnant – telle était en tout cas l’intention du ministre, et aussi celle du législateur.

Nous en venons à une question du groupe SRC.
La parole est à M. Laurent Grandguillaume.

Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, le 26 février 2014 nous adoptions dans cet hémicycle le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. Ce texte avait un objectif clair : réorienter la formation professionnelle vers les publics qui en ont le plus besoin, en clarifiant le dispositif et en améliorant la gouvernance.
Les publics qui ont le plus besoin de formation professionnelle, nous les connaissons : ce sont les chômeurs de longue durée – et ils sont nombreux. Un million de Français ne trouvent pas de travail stable et durable en raison, certes de la crise économique et financière de 2008, mais aussi d’un système de formation inadapté, inopérant et opaque. Dès l’été 2013, l’État, les régions et les partenaires sociaux ont travaillé au développement de formations en lien direct avec les offres d’emploi disponibles. Cet effort a été amplifié en 2014, avec la mise en oeuvre du plan « 100 000 formations prioritaires pour l’emploi ». Le compte personnel de formation, opérationnel depuis le 5 janvier dernier, s’inscrit dans la même logique ; il convient d’ailleurs de saluer le bilan positif du CPF, puisque plus de 500 000 comptes ont d’ores et déjà été activés. J’invite ceux qui nous écoutent à créer leur compte sur moncompteformation.gouv.fr si cela n’est pas déjà fait.
Ce compte, parce qu’il est universel et attaché à la personne, peut être utilisé par les demandeurs d’emploi en fonction des besoins des branches et des territoires. Les projets des demandeurs d’emploi seront ainsi mieux pris en compte, car une formation qui réussit est une formation qui répond au mieux aux projets du demandeur d’emploi. La mise en oeuvre du conseil en évolution professionnelle, au sein notamment de Pôle emploi, des missions locales et de Cap emploi permettra de mieux prendre en considération les aspirations de chaque demandeur d’emploi. En outre, dès lors que le demandeur disposera d’un nombre suffisant d’heures sur son compte personnel de formation pour suivre la formation, son projet sera réputé validé par son conseiller.
À court terme donc, les moyens dédiés par les partenaires sociaux au financement de la formation des demandeurs d’emploi se trouveront largement accrus, ce qui permettra à un plus grand nombre de demandeurs d’acquérir les compétences nécessaires pour occuper un emploi – ce qui est une très bonne chose. À moyen terme, plusieurs dispositions sont prévues pour éviter le défaut de qualification des salariés et leur exposition au chômage : généralisation d’un entretien professionnel tous les deux ans dans l’entreprise pour faire le point sur les compétences, garantie d’accès à la formation pour les salariés peu qualifiés à travers un abondement spécifique de leur compte personnel de formation, droit opposable à se former sur le temps de travail, renforcement de l’accès aux compétences de base, validation des acquis de l’expérience, possibilité d’abondement pour les publics prioritaires.
Notre majorité souhaite aller plus loin et lutter encore plus activement contre le chômage de longue durée. M. François Rebsamen, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a présenté lundi dernier un plan de lutte contre le chômage de longue durée. En tant que responsable d’un groupe de travail interne à la majorité sur cette question, je salue cette mobilisation collective.
Pourriez-vous, monsieur le ministre, nous donner le détail des mesures contenues dans ce plan et préciser comment ce dernier s’articulera avec la récente réforme de la formation professionnelle ?
Monsieur le député, vous avez raison de rappeler que la formation professionnelle des demandeurs d’emploi est un enjeu majeur, sur lequel le Gouvernement – et en particulier M. Rebsamen, que vous connaissez bien – s’est mobilisé dès sa prise de fonctions, avec le lancement d’un premier plan de 30 000 formations prioritaires, puis, en 2014, d’un deuxième plan de 100 000 formations prioritaires. L’objectif, vous l’avez compris, n’est pas de former pour former, mais de rechercher un résultat opérationnel, afin que la formation soit un outil d’optimisation du retour à l’emploi.
La première avancée permise par ces plans est qualitative : à chaque fois, ils ont été mis en oeuvre en concertation avec tous les acteurs, notamment territoriaux, de manière à identifier les besoins de formation dans les métiers porteurs et dans les bassins d’emploi, territoire par territoire.
La deuxième avancée, tout aussi importante, est quantitative : entre 2013 et 2014, ce sont près de 40 000 demandeurs d’emploi supplémentaires qui ont été formés, ce qui leur donne des chances supplémentaires d’intégration professionnelle.
D’autre part, la réforme du 5 mars 2014 pose tout différemment la question de l’accroissement de l’effort. L’un des enjeux de la loi sur la formation professionnelle est en effet de développer le recours à la formation pour ceux qui en ont le plus besoin. Souvent, ceux qui ont été peu ou pas formés par le passé, ou dont les compétences ne sont plus adaptées, se trouvent dans une situation de fragilité presque « endémique » – passez-moi l’expression – sur le marché du travail. La loi du 5 mars permettra de corriger les inégalités dans l’accès à la formation – à condition bien entendu qu’elle soit mise en oeuvre avec la vigueur et l’énergie nécessaires par l’ensemble des partenaires.
En 2015, 260 millions d’euros seront ainsi consacrés à la formation des demandeurs d’emploi par les partenaires sociaux, soit trois fois plus qu’en 2014. La majorité de cette enveloppe, soit 200 millions d’euros, sera utilisée dans le cadre du compte personnel de formation. C’est, j’y insiste, la gratuité de la formation des demandeurs d’emploi qui sera ainsi assurée, comme l’a annoncé François Rebsamen lors du lancement du plan « Nouvelles solutions face au chômage de longue durée ».
Un dernier mot sur le CPF : un mois et demi après l’ouverture du dispositif, nous avons déjà reçu 2,2 millions de visites sur le site, plus de 658 000 inscriptions, plus de 520 000 saisies de droit individuel à la formation et plus de 10 200 projets de formation – ce qui nous laisse entrevoir des perspectives positives.
Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et écologiste.

Depuis le 1er janvier 2015, le compte personnel de formation – que nous avons déjà eu l’occasion de louer ici même – est pleinement opérant. Le Gouvernement a beaucoup oeuvré, ces derniers mois, pour permettre à tout un chacun d’avoir recours à une formation pour se perfectionner, se spécialiser voire, vu la réalité actuelle, changer de voie professionnelle.
Ces dispositifs montreront leur pleine efficacité s’ils sont mieux connus, si l’information est mieux diffusée, s’ils sont mieux expliqués. Ainsi seront-ils effectivement utilisés par le plus grand nombre. Nous saluons – même si d’autres l’ont déjà fait – la mise en place du site internet moncompteformation.gouv.fr, au début de l’année. Il a déjà fait la preuve de son efficience. Chacun peut y accéder et y trouver des informations, par exemple des renseignements sur des formations ou sur ses droits à la formation professionnelle. Toutefois, dans un monde où les informations foisonnent, les indications relatives aux droits des salariés et des jeunes à suivre une formation professionnelle peuvent être noyées dans la masse. En effet, il est difficile, actuellement, pour un employé ou un jeune, d’avoir une information sans devoir aller la chercher.
Ma question est donc la suivante. Monsieur le ministre, quelles actions le Gouvernement envisage-t-il pour sensibiliser l’employé à la possibilité de se former ? Une campagne d’information, peut-être ? Et quels sont les moyens actuellement mis en oeuvre pour que l’information des bénéficiaires soit la plus lisible et la plus accessible possible, notamment au sein des entreprises ?
Vous avez raison, madame la députée, de souligner qu’il n’est de bonne politique possible qui ne soit assumée par ceux qu’elle concerne directement. En l’occurrence, ce sont nos concitoyens salariés et demandeurs d’emploi.
Des dispositifs de nature différente sont prévus. Tout d’abord, sur le plan légal, différents outils ont été conçus pour accompagner le candidat à la formation dans la construction de son parcours professionnel. Ainsi, au sein de l’entreprise, l’instauration d’un entretien professionnel qui doit avoir lieu tous les deux ans permet d’inciter fortement employeurs et salariés à travailler sur les besoins en formation. En dehors de l’entreprise, a été créé le conseil en évolution professionnelle, service gratuit proposé depuis le 1er janvier 2015 par cinq grands réseaux : Pôle emploi l’APEC, les missions locales, le FONGECIF et l’AGEFIPH. Ce service permet de déterminer les besoins des salariés et des demandeurs d’emploi afin que soient construits avec eux les projets de formation les plus pertinents. Voilà pour ce que j’appellerai le socle légal.
Et puis, il y a la communication, que vous appelez de vos voeux. L’enjeu est la capacité des acteurs à s’approprier de manière efficace le nouveau droit dont il est question. Le volet information est, à cet égard, primordial – vous avez raison de le souligner, madame la députée. Dès l’automne dernier, les entreprises ont été invitées à organiser l’information des salariés et, au-delà, le ministre Rebsamen a prévu une grande campagne de communication dans les prochaines semaines – vous l’évoquez dans votre question. Je note cependant que ce nouveau droit a déjà une certaine notoriété si l’on en juge d’après le nombre de comptes créés – je l’ai dit il y a quelques instants. Au-delà de la curiosité naturellement liée à l’ouverture du site, le nombre de créations de compte croît à un rythme presque exponentiel.
Sourires.

Monsieur le ministre, les maisons de l’emploi mises en place dans le cadre du plan de cohésion sociale visaient à optimiser le service rendu aux demandeurs d’emploi et aux entreprises. Elles permettaient en effet de recenser les ressources humaines disponibles, de prévoir les besoins locaux en emplois et de mieux articuler anticipation des besoins et déclenchement des formations.
Le groupe UDI estime qu’il faut faire confiance aux acteurs de terrain. Par leur travail de proximité en faveur des chômeurs les plus en difficulté, par leur connaissance des besoins économiques locaux et par leur capacité à fédérer tous les acteurs d’un bassin d’emploi, ce sont des acteurs incontournables en matière d’accès et de retour à l’emploi. En effet, nous considérons que les dispositifs de soutien public à l’emploi, comme les contrats de génération et les emplois d’avenir – auxquels nous avons d’ailleurs parfois accordé notre soutien car ils permettent de préserver temporairement la cohésion sociale –, ne permettent pas d’apporter une réponse globale et pérenne à la hausse du chômage.
Aussi, monsieur le ministre, nous souhaitons savoir si le Gouvernement est enfin prêt à privilégier les acteurs de proximité en abondant les crédits dévolus aux maisons de l’emploi.
Je vais essayer de vous rassurer, monsieur le député, et de rassurer aussi Arnaud Richard, que vous suppléez. Avec la création de Pôle emploi – par la majorité précédente, vous le savez –, les maisons de l’emploi ont été recentrées sur les actions de coordination de projets territoriaux. À ce titre, leurs missions ont été précisées dans un cahier des charges et l’accent a été mis sur le développement de l’anticipation des mutations économiques. Elles peuvent ainsi conduire différents types d’action qui contribuent à rapprocher les actions de formation des besoins actuels et futurs en emplois et en compétences.
Je voudrais vous donner quelques exemples. Les maisons de l’emploi peuvent mettre en place des actions d’information, de mobilisation et de coordination des acteurs économiques et des partenaires sociaux dans le cadre d’un dialogue social territorialisé. Je partage, à cet égard, votre sentiment : la proximité est un gage de succès en la matière, notamment grâce à l’anticipation des mutations économiques territoire par territoire. Il s’agit de promouvoir au niveau territorial certains métiers porteurs, en tension, comme on dit chez les économistes, qui répondent à une demande forte des employeurs. L’enjeu est donc de favoriser leur attractivité et d’encourager les recrutements grâce au service public de l’emploi.
Les maisons de l’emploi peuvent aussi, autre exemple, accompagner des projets créateurs d’emplois, qui s’inscrivent notamment dans les contrats de développement territorial. Leurs informations ont été très utiles à l’analyse des besoins et au bon ciblage des actions de formation lorsqu’ont été élaborés les plans « 30 000 formations prioritaires » puis « 100 000 formations prioritaires ».
Ajoutons, pour être complets, un mot sur le financement des organisations syndicales et patronales. La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a précisément eu pour objet de couper le lien entre le financement des organisations syndicales et patronales et la formation professionnelle. Un fonds paritaire de financement des organisations syndicales et patronales, transparent, a ainsi été institué. Cela aussi conforte le dispositif global de la politique menée par M. Rebsamen. Le décret d’application – on peut le rappeler ici– a été publié le 28 janvier dernier.
En tout cas, monsieur le député, et je le dis aussi en tant qu’élu local, les missions locales, par leur présence et grâce à leur renforcement, constituent sûrement des outils pertinents de l’action publique, notamment s’il est question d’offrir un avenir aux jeunes. Il s’agit d’être à la hauteur des événements que nous avons connus il y a un peu plus d’un mois aujourd’hui.
Je vous remercie, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, pour votre vigilance, et pour la pertinence de vos questions. Je ne manquerai pas d’en parler à M. Rebsamen, ministre en charge de ces questions.

Merci, monsieur le ministre, pour toutes les réponses que vous avez données au cours de ce débat et du précédent.
Le débat est clos.
La séance, suspendue à seize heures trente-cinq, est reprise à seize heures quarante-cinq.

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (nos 2447, 2498).
Le temps de parole restant pour la discussion de ce texte est de six heures et dix-sept minutes pour le groupe SRC, dont 240 amendements restent en discussion ; une heure et sept minutes pour le groupe UMP, dont 337 amendements restent en discussion ; deux heures et vingt et une minutes pour le groupe UDI, dont 63 amendements restent en discussion ; deux heures et dix minutes pour le groupe RRDP, dont 46 amendements restent en discussion ; une heure et onze minutes pour le groupe écologiste, dont 64 amendements restent en discussion ; une heure et neuf minutes pour le groupe GDR, dont 47 amendements restent en discussion, et trois minutes pour les députés non-inscrits.


Avant que nous mettions fin à notre discussion, à une heure du matin dans la nuit de lundi à mardi, j’avais posé un certain nombre de questions à M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique. J’espérais qu’il y répondrait dès la reprise de nos débats, mais ce n’est pas le cas.
Je rappelle que l’article 49 autorise la cession de la majorité du capital de deux actifs stratégiques pour notre pays, Aéroports de la Côte d’Azur et Aéroports de Lyon. Ces deux sociétés sont, qui plus est, bénéficiaires.
L’aéroport international de Nice, deuxième plate-forme aéroportuaire de France, n’a pas besoin, contrairement à ce qu’indiquent l’exposé des motifs du projet de loi et le rapport de la commission, que l’on vende la majorité de son capital à des acteurs privés afin que ceux-ci y réalisent des investissements patrimoniaux. S’il est désormais le deuxième aéroport international de France, c’est parce que l’État et les collectivités territoriales ont toujours fait le nécessaire pour assurer son développement, mission que nous sommes en mesure de poursuivre. En moins de six ans, nous avons porté le nombre de passagers de cet aéroport de 8,5 millions à 11,6 millions par an, et fait passer de 80 à 110 le nombre de destinations desservies dans le monde. Si l’État peut, aujourd’hui, valoriser cet aéroport, c’est grâce à la collectivité territoriale, aux contribuables locaux, qui ont investi dans une ligne de tramway ayant coûté 750 millions d’euros. Celle ligne traverse l’agglomération d’est en ouest, et dessert les terminaux 1 et 2 de l’aéroport, sans compter la zone d’affaires du Grand Arénas, un centre d’expositions international, ou encore un technopôle. Le Gouvernement veut donc nous spolier.
Orly est la troisième plate-forme aéroportuaire française, après Nice. Je ne comprends pas pourquoi le Gouvernement ne décide pas de la mettre en vente de la même manière.
J’ai entre les mains le rapport public annuel 2015 de la Cour des comptes : il précise que certaines plates-formes de notre pays sont déficitaires, et estime que les investissements des collectivités territoriales risquent d’être remis en cause par la Commission européenne, car ce sont des investissements concurrentiels.
Je ne comprends pas pourquoi vous préférez vendre à un actionnaire majoritaire des intérêts stratégiques qui sont bénéficiaires, plutôt que de mettre en vente des plates-formes aéroportuaires déficitaires comme celles de Dijon et de Dole. Il semble que le Gouvernement préfère les conserver et continuer à compenser leur déficit de fonctionnement.


Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux privatisations des aéroports de Nice et de Lyon. Comme le rappelait lundi dernier le président de notre groupe, André Chassaigne, nous sommes farouchement opposés au projet gouvernemental visant à privatiser la gestion de ces deux aéroports. Ces aéroports comptent parmi les plus importants de notre pays, comme cela a été rappelé il y a quelques instants. Disons-le, ces infrastructures ont une importance stratégique pour la France. En concéder la gestion à des acteurs privés, qui deviendraient majoritaires au capital, fait craindre pour les intérêts du pays.
Les craintes sont également fortes en matière d’aménagement du territoire. Compte tenu de leur importance, il nous paraît essentiel que la puissance publique garde le contrôle de ces deux aéroports afin d’assurer un développement économique, industriel et touristique cohérent et durable pour les territoires concernés. De plus, ces deux aéroports sont aujourd’hui rentables ; la puissance publique reçoit donc des dividendes, qui sont ensuite réutilisés en faveur de la collectivité. Vous nous proposez, en somme, de renoncer à ce qui doit revenir aux citoyens, lesquels ont, par leurs impôts, beaucoup investi pour rendre ces infrastructures attractives.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, à qui la privatisation va-t-elle réellement profiter ? La collectivité publique bénéficie aujourd’hui de cette manne financière ; qui, à l’avenir, en profitera ? Cette question essentielle n’a pas encore été abordée. Ce sera peut-être SNC-Lavalin, mastodonte canadien du génie civil, gestionnaire d’une quinzaine d’aéroports régionaux dans notre pays, et multirécidiviste notoire de la corruption au Canada, en Asie et en Afrique. Cette entreprise a accompagné une société chinoise, par ailleurs massivement implantée dans les paradis fiscaux, en vue de conquérir l’aéroport de Toulouse-Bagnac. Cela pourrait aussi être l’un des traditionnels géants français du BTP que sont Vinci, Bouygues, ou d’autres, qui s’étaient déjà mis sur les rangs lors de l’appel d’offres de Toulouse-Blagnac. Ils sont pourtant coupables d’un hold-up permanent contre les usagers et l’État dans la gestion de ces autres infrastructures de transport que sont les autoroutes, à tel point, monsieur le ministre, que nous examinons la possibilité de les renationaliser.
Bref, vous nous proposez de transférer aux géants du privé les gains qui sont censés revenir à la population. Nous ne pouvons l’accepter. À coup sûr, l’investisseur privé ne sera pas un philanthrope ; il poursuivra son intérêt, à savoir verser des dividendes. Rappelons également que ces deux aéroports font l’objet d’investissements importants, avec les prêts consentis par la Banque européenne d’investissement pour des travaux d’agrandissement et d’amélioration des conditions d’accueil des passagers.
Votre démarche, monsieur le ministre, est celle d’un comptable voulant réaliser une opération financière de court terme en vue d’éponger de manière infinitésimale une dette pharamineuse.

Tout cela, au détriment de l’intérêt général et de l’intérêt à long terme des populations. Il convient donc de revenir sur ce que vous proposez : tel est l’objet de notre amendement.

La parole est à Mme Nathalie Chabanne, pour soutenir l’amendement no 2761 .

Monsieur le ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, si vous me le permettez, avant de commencer mon intervention, je voudrais saluer l’accession à la vice-présidence de l’Assemblée nationale de mon collègue béarnais David Habib.

M. Macron a déjà entendu un autre député béarnais, M. Lassalle, m’adresser les mêmes félicitations !

Oui, mais cette fois, ce n’est pas seulement une Béarnaise qui vous félicite, c’est aussi une collègue du groupe SRC !
Sourires.

Je voudrais revenir à l’exposé des motifs de ce projet de loi. Il précise : « L’entrée de nouveaux investisseurs au capital de ces sociétés aéroportuaires doit permettre à ces sociétés de bénéficier d’une expertise additionnelle et d’une capacité financière accrue, permettant ainsi d’accélérer leur développement ». On y lit également : « L’État veille cependant à disposer, par son rôle de concédant et de régulateur, des leviers adéquats pour atteindre les objectifs qui sont les siens en matière de garantie du service public aéroportuaire, de maîtrise des programmes d’investissements et de contrôle de l’évolution des tarifs de redevances aéronautiques. »
Outre que l’« expertise additionnelle » n’est en rien garantie, les actualités à propos des concessions autoroutières ont jeté une lumière nouvelle sur les conditions dans lesquelles les sociétés concessionnaires d’autoroutes ont été privatisées. Cela doit nous inciter à la plus extrême prudence quant aux garanties dont l’État dispose réellement en qualité de concédant et de régulateur.
Je n’ai pas la chance de faire partie de la commission spéciale, mais j’ai lu dans le compte rendu les précisions que vous avez apportées, monsieur le ministre. Je vous cite : « l’ouverture du capital des sociétés de gestion aéroportuaires diffère profondément de celle des concessions d’autoroutes : en effet, l’ouverture du capital est limitée et un contrat de régulation économique l’encadre. » L’État entend céder les 60 % de parts qu’il détient dans ces sociétés : je ne vois pas en quoi l’ouverture du capital est limitée ! Certes, elle ne sera pas de 100 %, mais les acteurs privés n’en seront pas moins majoritaires.
J’avoue être tout aussi dubitative quant aux contrats de régulation économique qui les encadrent. Dès 2008, la Cour des comptes rendait un rapport intitulé Les Aéroports français face aux mutations du transport aérien, dans lequel elle préconisait d’améliorer le rôle de l’État régulateur. C’était même une recommandation prioritaire. Sans entrer dans le détail, la Cour des comptes visait à la fois les méthodes de fixation des redevances, l’encadrement de leur évolution ou encore la qualité du service. Elle estimait nécessaire de mieux orienter les indicateurs pour prendre en compte les résultats perçus par les passagers et les compagnies, et de ne pas se borner aux simples résultats comptables.
Vous me direz que, depuis ce rapport, nous avons franchi une étape supplémentaire, ne serait-ce qu’avec le contrat conclu par l’aéroport de Lyon et l’État pour les années 2015 à 2019. Certaines clauses sont plus précises que ce qui existait en 2008. Nous sommes cependant loin de la période où l’État concédait un certain nombre de services publics, avec comme seule contrepartie un engagement contraignant sur la qualité du service rendu et sur les prix. Or aucune disposition de ce projet de loi ne renforce les moyens d’action de l’État sur ces concessions aéroportuaires, qui ont été prolongées, en 2005, au-delà de 2040 ; le doute est donc permis quant à leur efficacité.
En second lieu, monsieur le ministre, l’exposé des motifs recèle à mes yeux des contradictions pour le moins inquiétantes. Il affirme que cette mesure permettra à l’État de céder ses participations dans des conditions avantageuses, mais, deux lignes plus bas, concède que l’impact financier ne peut être estimé précisément à ce stade, car la valorisation de la participation de l’État dépendra in fine des offres présentées.
Un grand économiste, prix Nobel d’économie, a donné le 13 janvier une conférence ici même, à l’Assemblée nationale. Il s’agit de Joseph Stiglitz ; je voudrais mettre ses propos en regard des dispositions du projet de loi que nous examinons actuellement. Il a évoqué un certain nombre de réformes que la France pourrait d’ores et déjà engager. Il a également évoqué les privatisations, non pas d’une manière générale, mais telles qu’elles sont envisagées par ce projet de loi. À ce propos, il disait qu’elles ne rendront pas notre pays plus riche, à moins que les actifs soient vendus à des étrangers à des prix supérieurs à leur valeur. Mais, ajoutait-il, ces actifs seront probablement sous-évalués, comme c’est presque toujours le cas en période de ralentissement économique. En conséquence, concluait-il, le pays s’appauvrira, et le bilan financier pour l’État, mesuré de manière appropriée, en sera diminué, même si la dette publique à court terme sera réduite.
En dernier lieu, monsieur le ministre, je vous rappelle que les infrastructures de transport – au même titre que celles de l’énergie – sont stratégiques puisqu’elles concourent à l’aménagement du territoire, politique publique par excellence. Elles constituent aussi un facteur majeur pour l’attractivité et la compétitivité de la France. Enfin, elles sont au coeur de la souveraineté du pays. La maîtrise publique de ces infrastructures stratégiques doit donc être garantie pour éviter la perte de souveraineté que les Grecs, par exemple, ont subie avec le port du Pirée, ou les Portugais, avec leurs aéroports et leurs infrastructures électriques. En transférant au secteur privé la majorité du capital de ces sociétés aéroportuaires, l’État prend le parti de perdre le contrôle d’infrastructures stratégiques.
Pour toutes ces raisons, monsieur le ministre, je considère que la cession de ces aéroports est prématurée. Elle doit, dans tous les cas, être accompagnée de meilleures garanties. Dans ces conditions, nous proposons la suppression de l’article 49.

La parole est à Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique de la commission spéciale, pour donner l’avis de la commission sur ces amendements de suppression.

Je tiens d’abord à rappeler l’important travail réalisé au sein de la commission spéciale, laquelle a adopté un certain nombre d’amendements visant à renforcer le rôle du Parlement dans les opérations en capital et à les encadrer.
Premièrement, les seuils au-delà desquels un transfert en capital doit faire l’objet d’une autorisation du Parlement ont été abaissés de 150 à 75 millions d’euros pour le chiffre d’affaires et de 1 000 à 500 pour le nombre de salariés, afin d’élargir le champ des entreprises concernées.
Deuxièmement, l’adoption d’un amendement à l’article 49 a permis de soumettre à une autorisation du Parlement les opérations de transfert de capital des sociétés de gestion des aéroports et des sociétés autoroutières.
Le cumul de ces deux éléments fait qu’une opération comme celle de Toulouse n’aurait pas pu être réalisée comme elle l’a été, ce qui devrait satisfaire plusieurs d’entre vous. Pour ce type d’opérations, il faudra donc une autorisation du législateur.
Ensuite, il nous a été reproché de vendre aux plus offrants. Les auditions nous ont conduits au même constat. Le premier jour de la discussion de ce texte en séance, j’ai d’ailleurs parlé de mise aux enchères. Il est effectivement regrettable que ce soit là le seul critère d’attribution des participations de l’État en cas de privatisation. C’est pour cette raison que nous avons amendé le texte sur ce point également : désormais, la préservation des intérêts essentiels de la nation devra figurer dans le cahier des charges transmis à la Commission des participations et des transferts. Lundi, par l’adoption d’un amendement portant article additionnel après l’article 43 B, nous avons étendu ce critère à l’ensemble des opérations de transfert de capital.
Enfin, l’amendement adopté en commission a également introduit la condition, pour les candidats à l’acquisition des participations de l’État, de disposer d’une expérience dans la gestion aéroportuaire. Ainsi, des sociétés purement financières ou des fonds d’investissement ne pourront pas se porter acquéreurs : seuls pourront le faire les entreprises ayant la capacité de gérer des aéroports. Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à ces amendements de suppression. Dans sa nouvelle rédaction, améliorée lors de l’examen en commission, l’article 49 peut être voté.

La parole est à M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, pour donner l’avis du Gouvernement.
Je tiens à clarifier à mon tour les points soulevés lundi par les orateurs inscrits sur l’article.
Par le présent article, il est demandé au Parlement l’autorisation de procéder à une ouverture du capital, en l’espèce à la cession d’une part majoritaire de deux aéroports, ce qui ne relève pas de la même logique que les précédents articles. L’article 49 s’inscrit dans la volonté de l’État de gérer activement son portefeuille.
Je tiens à remettre ce débat en perspective. Nous avons eu l’occasion de discuter de l’ouverture du capital d’une société de défense dans la perspective d’un rapprochement européen ; nous avons débattu lundi de son intérêt stratégique et de ses finalités. En l’espèce, l’État visait, non pas à faire rentrer des fonds, mais plutôt à mener une opération industrielle et stratégique. Dans le cas du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies – le LFB –, nous avons également discuté de la possibilité pour l’État de faire entrer un actionnaire public au capital pour accompagner le développement et les investissements d’une entreprise qui n’a pas vocation à diversifier son portefeuille d’actifs.
En l’espèce, nous parlons de privatisations destinées à libérer de l’argent, lequel servira à appliquer notre doctrine de l’État actionnaire, le « et-et » : et désendetter, et réinvestir dans d’autres domaines prioritaires, comme le logement intermédiaire ou encore l’industrie – nous l’avons fait par exemple pour PSA. Il s’agit donc bien de libérer du capital pour l’État en cédant sa part dans les aéroports de Nice et de Lyon.
Je tiens également à lever une ambiguïté contenue dans les propos tenus aujourd’hui par M. Estrosi et lundi soir par M. Cherki : je vous confirme que, lors d’une telle opération, il est préférable que l’actif soit rentable. En effet, il est possible de privatiser ou d’ouvrir le capital d’un actif qui perd de l’argent, mais généralement il y a assez peu d’acheteurs ou, en tout cas, on le fait à un fort mauvais prix. C’est du bon sens ! En l’occurrence, la rentabilité des actifs est l’un des éléments de notre choix.
Puisqu’il s’agit de sujets financiers, je tiens à préciser qu’il ne s’agit pas de brader des bijoux de famille – comme le craint M. Chassaigne –, et ce pour plusieurs raisons. D’abord, nous ouvrons le capital des sociétés de gestion, mais en aucun cas celui des actifs eux-mêmes, qui restent à la main de l’État. Ensuite, brader les bijoux de famille signifierait mal les vendre : en l’espèce, tout ou partie du capital de la société de gestion détenu par l’État serait vendu dans de mauvaises conditions. Or tel n’est pas le cas. S’agissant de la cession d’une part non majoritaire du capital de l’aéroport de Toulouse – bien que le décret pris par mon prédécesseur autorisât à en vendre jusqu’à 60 % –, nous avons valorisé la part de l’État à hauteur de 308 millions d’euros pour un actif sur lequel nous percevons 1,2 million d’euros de dividendes. Reconnaissez-le, ce n’est pas vendre un actif dans de mauvaises conditions, ni le brader ! Au contraire, c’est bien le vendre et le valoriser, pour pouvoir réinvestir dans des actifs plus utiles – j’y reviendrai.
Ensuite, M. Estrosi a soulevé des points importants sur les intérêts des collectivités territoriales. Premièrement, je tiens à dire que tous les acteurs locaux ont été informés par moi-même ou par mon cabinet avant que le projet de loi ne soit rendu public.
Il est important que je le dise, car il a été insinué que cela n’avait pas été le cas.
Deuxièmement, les collectivités territoriales sont libres de choisir de monter au capital, de vendre avec l’État ou de rester au capital en participant à la confection du cahier des charges. Vous dites, monsieur Estrosi, que nous priverions la ville de Nice de dividendes : c’est vrai seulement si vous décidez de vendre avec l’État, mais en aucun cas si cette opération se fait et que vous décidez de rester actionnaire. Contrairement à ce que vous avez dit, d’autres acteurs aujourd’hui au capital, comme la chambre de commerce et d’industrie, m’ont d’ores et déjà indiqué qu’ils ne s’opposaient pas à cette opération mais qu’ils souhaitaient inscrire des conditions dans le cahier des charges, ce à quoi nous allons travailler.
Nous l’avons dit lors de l’opération de Toulouse, la seule condition est la suivante : si des collectivités territoriales ou des acteurs aujourd’hui au capital souhaitent codéfinir le cahier des charges avec les pouvoirs publics, elles ne peuvent pas elles-mêmes se porter candidates. Soit elles décident de se porter candidates au rachat dans le cadre d’un consortium, ce qui est tout à fait possible, soit elles décident de participer à la confection du cahier des charges, auquel cas elles sont soumises à une exigence de neutralité. Ainsi, nous ne bradons pas les investissements des collectivités territoriales. Vous avez rappelé à juste titre les investissements réalisés par la ville de Nice, monsieur Estrosi, mais je tiens à rappeler pour le bon ordre de ce débat que la ville n’a pas été la seule à investir : l’Europe et le Gouvernement l’ont fait aussi.
Le Gouvernement prend la décision de vendre, car il ne s’agit pas de situations où le capital de l’État est le mieux employé. S’agissant des aéroports de province, nous avons longuement discuté de la pertinence de conserver un capital intégralement public ou d’ouvrir le capital aux acteurs privés. Nous n’avons pas ici le monopole de ce genre de décisions : les villes de Bruxelles, Copenhague, Düsseldorf, Hambourg ou Londres ont pris la décision, sans être pour autant moins bien gérées, d’ouvrir tout ou partie de leur capital au secteur privé. D’autres villes ont fait le choix inverse. En tout état de cause, la rentabilité de l’aéroport de Toulouse montre que cette opération n’est en aucun cas comparable à une vente forcée, comme celle du port du Pirée ou d’autres actifs en Grèce. Il s’agit d’une vente assumée par le Gouvernement…
…d’un actif rentable et non d’une vente forcée dans une situation d’urgence, donc dans de mauvaises conditions et à un mauvais prix.

Par ailleurs, je m’inscris en faux contre la comparaison de ces ouvertures de capital avec la gestion des sociétés concessionnaires d’autoroutes. La Cour des comptes et l’Autorité de la concurrence ont toutes deux dénoncé la mauvaise régulation de l’équilibre des contrats de ces sociétés pendant ces dernières années. Vous avez d’ailleurs contribué à la corriger en donnant plus de pouvoirs à une nouvelle autorité administrative indépendante, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières – l’ARAFER –, qui pourra contrôler les prix, les travaux et l’équilibre économique de ces contrats. On pourra discuter de mesures permettant d’aller plus loin, mais d’ores et déjà…
…une négociation est un cours et un groupe transpartisan s’est réuni avec plusieurs de vos collègues, monsieur le député Carvalho. En l’espèce, pendant près de dix ans, l’équilibre de ces contrats a été mal régulé et le pouvoir économique laissé aux sociétés concessionnaires était important.
Pour ce qui concerne les aéroports, je tiens à rappeler que la cession d’une part minoritaire du capital – dans le cas de Toulouse – ou de son intégralité – dans le cas de Nice et de Lyon – va de pair avec le maintien et le renforcement des pouvoirs de l’État ; De fait, celui-ci conserve la propriété des infrastructures ; il dispose de pouvoirs de sanction allant jusqu’à la déchéance du contrat de concession en cas de manquement ; il demeure pleinement régulateur et, à ce titre, approuve chaque année les tarifs des redevances d’aéroports et veille à ce qu’ils évoluent de façon raisonnable – j’insiste sur ce point. L’État a donc déjà la capacité de réguler l’ensemble des équilibres économiques des sociétés de gestion publique – c’est d’ailleurs ce que constatent leurs actionnaires.
Enfin, et ce n’est pas le moindre argument, toute ouverture de ligne est à la main de la Direction générale de l’aviation civile. À cet égard, monsieur Estrosi, je partage votre préoccupation, qui a également été exprimée, mais dans un but opposé, par le maire de Lyon : le sujet sensible, pour ces aéroports, ce sont les ouvertures de ligne. Sur ce point, l’article ne change rien, car c’est la DGAC qui en décide.
Discuter du développement de ces aéroports revient à débattre de l’État régulateur, par le truchement de la DGAC et des autorisations d’ouverture de ligne. L’arbitrage entre les intérêts de ces aéroports régionaux et les intérêts d’Air France – car c’est bien de cela qu’il s’agit – ne relève pas du présent article ; c’est un autre débat. Les décisions prises par la DGAC ont plutôt contribué jusqu’à présent à éviter que des compagnies étrangères, en particulier du Golfe, n’ouvrent trop facilement des lignes sur les aéroports de proximité. Je ne vous contredirai pas sur ce sujet, monsieur le député, mais les dispositions proposées ne changeront rien, car la DGAC décidera de ces ouvertures.
Pour toutes ces raisons, ces opérations diffèrent profondément de celles qui sont liées à l’ouverture du capital des sociétés d’autoroutes. Je ne peux donc pas laisser dire qu’il s’agirait d’une opération comparable. En précisant la rentabilité, le cadre et la philosophie générale de ces opérations, je tenais à démontrer que l’État reste régulateur des prix et décideur des ouvertures de lignes, lesquelles n’affecteront donc pas les intérêts essentiels auxquels plusieurs d’entre vous sont attachés. Voilà les éléments que je voulais préciser en réponse aux interventions sur l’article et qui me conduisent à émettre un avis défavorable aux amendements de suppression.

Monsieur le ministre, vous savez qu’il s’agit d’un sujet qui me tient tout particulièrement à coeur, et sur lequel je pense que la prudence – nécessaire – ne veut pas dire immobilisme. C’est pourquoi, même si, bien entendu, le groupe SRC soutiendra la proposition que vous faites, je souhaite rappeler ici quelques éléments nécessaires à propos de la prudence que je viens d’évoquer.
Certaines infrastructures sont d’une importance stratégique pour le pays : celles qui touchent aux communications, aux télécommunications, à l’énergie et, physiquement, les infrastructures aéroportuaires, dont nous parlons ici, parce qu’elles nous relient au monde. Je pense qu’elles sont aujourd’hui absolument nécessaires pour la souveraineté du pays et pour la façon dont il est relié au monde.
Dès lors, la manière dont nous organiserons, à l’avenir, notre schéma d’infrastructures, doit être examinée. Cette question est en lien avec le rapport que le Gouvernement m’a demandé, il y a maintenant quelques mois, sur la compétitivité du transport aérien français. En effet, je ne pense pas que l’on puisse déconnecter la question de nos compagnies de celle de nos infrastructures. Celles-ci sont fondamentales : le pavillon français, qu’il soit d’ailleurs représenté par des compagnies dont le capital appartient totalement à l’État ou seulement en partie, est ce qui nous relie au monde – et il dépend de nos infrastructures de transport.
Si je soutiens aujourd’hui votre proposition, et si j’ai dit que la prudence ne voulait pas dire immobilisme, c’est parce que les garanties que vous apportez s’agissant des modalités d’ouverture du capital permettent de ne pas mettre en place des schémas qui risquent d’être néfastes aux intérêts du pays. J’en cite un : la conjonction, d’une part, de l’impossibilité de conserver la même position en matière d’ouverture de lignes et, d’autre part, de l’acquisition par certaines compagnies du capital des sociétés exploitant nos infrastructures aéroportuaires.
Car si nous bénéficions aujourd’hui, par l’intermédiaire de la Direction générale de l’aviation civile, de la position de l’État en matière de droits de trafic supplémentaire, il s’agit d’une position difficile à tenir. Elle revient en effet à dire non à des droits de trafic sollicités tant pour l’aéroport de Nice que pour celui de Lyon. Ce dernier est aujourd’hui soumis à de multiples demandes : je pense en particulier à celles émanant d’Emirates, qui souhaite ouvrir de nouvelles lignes, auxquelles je pense que nous avons raison de nous opposer, tant la concurrence est totalement déloyale entre les compagnies qui sont subventionnées de A jusqu’à Z et celles qui portent le pavillon français et ont à supporter de lourdes charges.

Mais si demain il devenait impossible de bloquer les droits de trafic et que, dans le même temps, le capital des sociétés exploitant une infrastructure aéroportuaire tombe aux mains de sociétés liées aux compagnies subventionnées dont je viens de parler, alors on pourrait voir des centres d’activité basculer, des lignes changer et des liaisons s’opérer ailleurs.
Pour cette raison, je veux, monsieur le ministre, appeler votre attention sur la façon dont nous considérons, aujourd’hui, nos infrastructures aéroportuaires. Il nous faut garder, bien entendu, la maîtrise des concessions : c’est ce que permet votre proposition. Il nous faut faire en sorte que l’État demeure le régulateur. De ce point de vue, vous me permettrez de glisser qu’il doit être régulateur à Nice, à Lyon, mais aussi à Paris. Or la façon dont se bâtit le prochain contrat de régulation économique ne permet pas, notamment, de mettre la compagnie nationale française, Air France, en situation d’affronter les défis auxquels elle fait face en termes de compétitivité.
Je souhaite ouvrir cette parenthèse, car le sujet est important : je n’imagine pas que le gestionnaire d’aéroport puisse aller bien quand la compagnie nationale va mal. Les deux sont liés et doivent conclure un pacte. Or les propositions qui sont faites aujourd’hui pour le prochain contrat de régulation économique ne sont pas bonnes, à cet égard, pour l’avenir du secteur. Elles ne sont pas non plus bonnes sur le plan économique, et là je suis totalement d’accord avec vous : quand un aéroport va bien, il attire forcément des investisseurs. Et attirer des investisseurs en tout gardant la maîtrise de la concession et en conservant des pouvoirs de régulation – à cet égard, vous avez clairement posé les limites – ne pose aucun problème, tout en sachant que la rentabilité des actifs ne doit pas peser sur la compétitivité de nos compagnies.
Quand je dis cela, vous savez que je pense beaucoup plus aux plates-formes parisiennes qu’à celles sur lesquelles porte notre débat d’aujourd’hui.
Voilà ce que je souhaitais dire, monsieur le ministre. Il me semble que toutes les interventions ont montré la nécessité de prendre des précautions que vous avez à votre tour exposées une à une. Ce faisant, nous garderons la maîtrise de ce qui est essentiel, à savoir la régulation, par exemple en laissant n’importe quelle ligne s’ouvrir sur notre territoire.
Compte tenu de l’amendement adopté par la commission, je ne pense pas qu’il soit possible que nous perdions ce contrôle. Quoi qu’il en soit – je souhaitais appeler votre attention sur ce point, notamment pour l’avenir –, les aéroports ne sont pas un capital neutre pour la souveraineté de l’État.

Il y va de l’avenir de la façon dont nous sommes reliés au monde. Il faut donc doser la façon dont ouvrirons le capital. Il me semble que le texte que vous nous proposez aujourd’hui permet de le faire. Je tiens à le dire car nous ouvrons, en même temps, une possibilité dont je ne souhaite pas qu’elle nous amène, demain, à perdre le contrôle de plates-formes aéroportuaires qui seront vitales pour la place de la France dans le monde.
Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe SRC.

Dans le débat que nous avons sur ces amendements de suppression de l’article 49, je dois dire que je ne suis pas du tout convaincu par les arguments qui militent en faveur de la privatisation des deux aéroports – celui de Nice, qui est le deuxième aéroport français, et celui de Lyon, qui est le quatrième. Je ne suis pas non plus convaincu par les balises qui sont proposées par Mme la rapporteure ou par M. le ministre, qui distingue la gestion de la société et les actifs, lesquels restent publics. Je pense que l’un va avec l’autre. Un certain nombre de précédents, notamment dans le domaine autoroutier, devrait nous alerter et nous pousser à faire preuve de prudence.
Il en va de même de la gestion non maîtrisée de la privatisation de l’aéroport de Toulouse. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’à mes yeux, il ne faut pas vendre un outil public essentiel à une politique d’aménagement du territoire, laquelle doit, encore et toujours, procéder de l’État. La seule justification de la privatisation des aéroports de Nice et de Lyon qui nous est proposée aujourd’hui se résume, en réalité, à une décision qui m’apparaît comme comptable. Elle traduit une volonté de rechercher, par la vente d’actifs, à réaliser des recettes et, je ne peux pas l’oublier, de s’inscrire aussi dans l’orthodoxie budgétaire européenne. J’ai en tête, comme vous sans doute également, mes chers collègues, mais il vaut mieux le souligner ici en séance publique, qu’il s’agit à l’évidence d’une réforme structurelle qui est attendue par Bruxelles. Je rappelle que Bruxelles ne supporte pas le système français de concessions.
J’ai également en tête les barrages hydroélectriques, tout autant que les concessions dans le domaine aéroportuaire. En citant tout à l’heure le cas de la privatisation de la plate-forme de Toulouse, je voulais souligner que, du point de vue de l’aménagement du territoire, du développement durable, de l’attractivité économique et du développement territorial, l’acquisition par le conglomérat sino-canadien de cette plate-forme vise à créer un hub qui va accueillir, à l’horizon de 2030, 18 millions de passagers, soit 10 millions de plus qu’aujourd’hui. Or cet aéroport se trouve au coeur de la métropole toulousaine. Quels moyens se donne l’État, à travers la puissance publique, de maîtriser les nuisances et de lutter contre elles ? Quels moyens accordera-t-il, au travers de la desserte par cet aéroport, à la politique de développement et à l’équilibre des territoires ?
Je pense, pour ma part, que nos territoires sont exposés, par la privatisation, à un double risque : soit l’arrivée d’investisseurs de court terme, qui ne permettra plus à l’État, aux collectivités et aux CCI de conduire une politique industrielle, d’attractivité économique et d’aménagement du territoire, soit l’implantation d’investisseurs stratèges, comme à Toulouse. Dans ce dernier cas, cette implantation n’est pas le fruit du hasard, parce que s’y trouve implanté le fleuron industriel de la France et de l’Europe : l’Aérospatiale. Ce sont les raisons pour lesquelles j’indique que, pour ma part, en tant député du Mouvement républicain et citoyen, je voterai les amendements de suppression de cet article.
Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes UMP et UDI.

Monsieur le ministre, je trouve intéressant de vous prendre en flagrant délit : vous avez proféré un certain nombre de contre-vérités,…

…sans être allé jusqu’au bout des réponses aux questions que nous vous avons posées.
Vous avez d’abord essayé de laisser croire à la représentation nationale que vous avez parlé du projet à tous les partenaires qui constituent le capital de la société aéroportuaire.
Eh bien, je veux que tous ceux qui siègent sur les bancs de cette assemblée, qu’ils soient également élus locaux ou seulement élus de la nation, sachent que le maire de Nice, président de la première métropole créée en France, et qui regroupe 49 communes,…

…s’est vu donner un coup de fil par le ministre de l’économie et de l’industrie, M. Macron, un samedi soir à dix-huit heures quinze, pour lui dire de manière lapidaire, en trois minutes : « Je vous informe que mercredi matin prochain, je mettrai en vente, sans discussions ni négociations possibles, votre plate-forme aéroportuaire. » Voilà le sens du dialogue et de la concertation dont fait preuve le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique.
Oserez-vous, monsieur le ministre, dire le contraire ? Regardez-moi dans les yeux : oserez-vous dire le contraire ?
Vives exclamations sur les bancs du groupe SRC.

La réalité est celle-là. Je veux que les élus du peuple qui ont le sens de la démocratie et de la République…

…sachent quel est le fond votre personnalité. Ces mots figureront au Journal officiel.

Et vous ne pourrez pas faire la démonstration inverse.
Ne me tutoyez pas, monsieur le député !

Monsieur le président, demandez à M. Le Roux de se taire ! C’est une honte !

Lorsque j’étais ministre et que vous m’avez à plusieurs reprises demandé des entretiens, vous les avez obtenus en moins de trois jours.

Deuxièmement, vous avez osé parler de gestion active du capital. Or, si j’étais très défavorable à la vente de notre réseau autoroutier…

…je considère que le texte, tel qu’il a été voté, a été très mal géré, tant par les gouvernements de droite que par les gouvernements de gauche. Vous le voyez, je suis très serein et très honnête sur ce sujet ; je le dis très clairement.
Ce texte avait au moins un mérite, tout le monde en conviendra : une contrepartie était prévue à cette vente des autoroutes.

Ceux qui devaient devenir propriétaires du réseau autoroutier devaient reverser chaque année au Gouvernement, sur un fonds spécifique, une part de leurs dividendes, afin qu’ils soient réinvestis dans la modernisation des moyens de transport de notre pays, ce qui n’a jamais été fait.
Exclamations sur les bancs du groupe SRC.

Les gouvernements de droite et de gauche ont donc autant péché les uns que les autres.
À la limite, je veux bien, monsieur le ministre, mais alors précisez dans ce texte, comme on l’a fait pour les autoroutes, dans quoi vous allez injecter l’argent pour faire de la gestion active de ce capital.
La réalité, c’est que vous ne prévoyez pas de gestion active : vous êtes obligé de répondre à une injonction de Bruxelles, et, avec l’argent que vous allez récupérer, vous pourrez simplement essayer de vous rapprocher d’un niveau de déficit vous permettant de présenter une copie peut-être acceptable par Bruxelles, sans pouvoir l’utiliser de manière active pour répondre aux besoins de notre pays.
Si vous voulez libérer cet argent pour le réinvestir, je vous offre l’opportunité de le faire et de proposer un amendement gouvernemental en ce sens. Voilà trente ans que nous attendons que l’État finance une ligne de TGV entre Marseille et Nice. Précisez dans ce texte que la vente de l’aéroport de Nice sera un investissement actif, qui permettra en contrepartie de financer cette ligne de TGV.

Je n’ai pas le sentiment que ce soit dans vos intentions. En tout cas, c’est un élément de plus que vous ne souhaitez pas aborder, pas plus que vous ne voulez dire de quelle manière vous utiliserez l’argent tiré de la vente d’un aéroport qui a été valorisé par les collectivités.
Vous avez laissé entendre à l’Assemblée que, si des infrastructures avaient valorisé l’aéroport, c’est parce qu’il y avait eu des participations de l’Union européenne et de l’État. Oui, il y a eu des participations extrêmement généreuses, mes chers collègues. Sachez par exemple que, pour la ligne de tramway en cours de construction,…

…qui représente 750 millions d’euros d’investissement, l’État en apporte généreusement 50 et la collectivité plus de 550, voire 560.

Vous voyez donc que c’est une vente qui se fait aux dépens de l’État.
Par ailleurs, l’aéroport international de Nice ne se trouve pas au coeur de n’importe quel territoire. Il est au coeur du périmètre d’une opération d’intérêt national, ce qui n’est d’ailleurs pas le cas de celui de Lyon.
Cette opération d’intérêt national, qui a vu le jour il y a cinq ou six ans, en matière d’éco-industrie, de croissance verte, d’université, de formation et d’implantation d’entreprises ayant investi, comme IBM, Cisco, Veolia, GDF-Suez, des pépinières d’entreprises, des incubateurs, a été planifiée parce qu’il y avait une stratégie de la collectivité et de l’État et non pas parce qu’il y avait un actionnaire majoritaire ayant d’autres intérêts que l’attractivité du territoire.
Si nous sommes en train d’aménager le pôle multimodal, avec une gare ferroviaire, une gare de tramway, une gare routière et des infrastructures routières, ce qui en fait le plus performant d’Europe en coeur d’agglomération et en coeur d’opération d’intérêt national, c’est parce que c’est la collectivité qui a réalisé les plus gros investissements, ce qui permet aujourd’hui à l’État de spolier l’acteur local en en tirant le meilleur parti sur le dos du contribuable local.
Monsieur le ministre, vous nous avez expliqué que, si elle le voulait, la collectivité pouvait devenir propriétaire d’une partie de l’aéroport. Nous avons déposé un amendement pour lui permettre de disposer d’un droit de préemption, il a été refusé au titre de l’article 40. Il serait intéressant que vous déposiez vous-même en séance un tel amendement.
En outre, c’est bien un fusil à un seul coup. Vous avez parlé du dividende retiré chaque année par l’État. Moi, je vous parle de celui qui ne sera plus jamais récupéré par l’État. Lorsque vous préparez le projet de loi de finances qui est présenté devant le Parlement, vous comptez dans les recettes celles de Lyon, de Nice, d’autres plateformes et d’autres actifs de l’État. L’année prochaine, vous ne pourrez plus le faire puisque vous ne serez plus propriétaire de ces participations. C’est à tout jamais que c’est terminé.
Dernier argument, vous avez dit tout à l’heure que c’était la DGAC qui protégeait Air France et évitait qu’un certain nombre d’autres compagnies aériennes ne viennent lui faire concurrence.
Or, lorsqu’il y a des demandes d’ouverture de lignes, de la part d’Emirates, par exemple, entre les Emirats et l’aéroport international de Nice, c’est la DGAC, associée à Aéroports de Paris, qui fait un blocus, non pas pour empêcher qu’il y ait de nouvelles lignes en direction de la France afin de protéger Air France mais pour les faire ouvrir au bénéfice de Paris, contre Nice. C’est donc que vous jouez Paris contre Nice. Voilà pourquoi vous ne voulez pas vendre Paris, pour continuer à être complice de la DGAC et d’Aéroports de Paris.
Je me demande d’ailleurs si Aéroports de Paris ne serait pas d’accord avec vous pour déposer une offre et faire de l’aéroport de Nice et de celui de Lyon leur petit hub régional, ce qui leur permettra de récupérer les grandes lignes des compagnies aériennes étrangères en faisant simplement une petite redistribution régionale. D’ailleurs, lorsqu’Air France ferme le mois prochain la ligne entre Nice et Tel Aviv, alors que les avions qui font l’aller-retour tous les jours sont pleins, au bénéfice de compagnies low cost comme easyJet, ce n’est pas Air France que l’on défend, ce sont au contraire des compagnies aériennes étrangères, avec la DGAC.
Voilà un argument de plus que vous avez essayé de défendre et qui tombe, monsieur le ministre. En tout cas, je pense avoir fait la démonstration devant la représentation nationale que pas un seul de vos arguments ne tenait, et je me repose la question que je me suis posée lundi soir : quelqu’un ne serait-il pas passé par votre bureau pour choisir par avance celui qui pourrait être le repreneur de l’actif majoritaire de l’aéroport de Nice et de celui de Lyon, ce qui, quelque part, constituerait une sorte de délit d’initié ?
Exclamations sur plusieurs bancs du groupe SRC.

D’abord, mes chers collègues, il faudrait que vous preniez l’habitude, lorsque nous nous exprimons, de nous écouter en silence, comme nous le faisons.
Exclamations sur plusieurs bancs du groupe SRC.

Cela fait tout de même une demi-heure que nous vous écoutons. Nous n’avons pas dit un mot. Chacun ici a le droit de s’exprimer, et ce n’est pas parce que l’on est président du groupe socialiste que l’on doit avoir une plus grande gueule que les autres.

Je vous demande d’abord simplement, monsieur Le Roux, d’être correct, parce que vous avez été incorrect vis-à-vis du député-maire de Nice,…

…et je vous demande de bien vouloir nous autoriser à nous exprimer dans le Parlement de la France.

Sur la méthode, monsieur le ministre, je suis tout à fait d’accord avec ce qu’a dit tout à l’heure Christian Estrosi. Vous nous avez informés, dites-vous. C’était vraiment une information minimale. Un coup de fil aux différents actionnaires, on pouvait s’attendre à mieux alors que votre majorité passe son temps à parler de démocratie participative.

Monsieur Le Roux, je ne m’adresse pas à vous, vous n’êtes pas encore ministre. Restez donc à votre place de président du groupe socialiste, ça suffit.

Plutôt qu’une simple information un samedi soir, une concertation avec les différents intéressés aurait évidemment été préférable. Il n’est pas encore trop tard pour qu’elle ait lieu, dans la mesure où, si l’on supprime l’article 49, on pourra en organiser une plus tard.
Bref, sur la méthode, ce n’est pas l’image que vous avez voulu donner de vous. Vous avez voulu donner l’image de quelqu’un qui écoutait, on l’a vu d’ailleurs par exemple à propos des notaires. Vous avez reconnu dans cet hémicycle que vous vous étiez trompé. Faute avouée est à demi pardonnée. Vous pouvez très bien expliquer ce soir ici qu’une fois de plus, vous vous êtes trompé.

Sur la stratégie, les grandes plates-formes aéroportuaires sont effectivement des points stratégiques importants non seulement pour notre pays mais également pour nos régions, et, nous vous l’avons dit tout à l’heure, peut-être encore plus pour notre région que pour d’autres. Lyon est un carrefour ferroviaire, un carrefour routier et un carrefour aéroportuaire. Nous sommes, nous, un carrefour aéroportuaire. Nous sommes au bout de la France et, grâce à notre aéroport, nous sommes au coeur de l’Europe. Le développement économique, touristique et, aujourd’hui, industriel n’a été possible que grâce à l’aéroport de Nice et au fait que, de concert, tous les acteurs économiques et politiques se sont mobilisés pour le développer. Demain, si cet aéroport est vendu à un groupe, quel qu’il soit, la question pourra évidemment être posée, et malheureusement en termes négatifs.
Vous nous avez expliqué que l’ouverture des lignes était dans les mains de la DGAC, mais nous ne le savons que trop, et ce n’est pas simplement dans ses mains. Comme l’a rappelé Christian Estrosi, ADP n’est pas loin derrière pour bloquer les ouvertures de ligne. On a vu des ouvertures de lignes être bloquées, ou même des transferts de lignes sur Paris, à la demande de la DGAC et d’Aéroports de Paris.
Croyez-vous que, dans un système où l’actionnaire principal serait non plus public mais privé, et qui plus est, peut-être, un groupe étranger, et même un groupe des Émirats, la DGAC serait plus complaisante vis-à-vis d’un groupe étranger émirati que d’un aéroport public qui est entre les mains de l’État et des collectivités territoriales ? Nous serions alors soumis à la double peine, monsieur le ministre ! Je vous mets donc en garde parce que c’est extrêmement grave, ce qui est en train de se passer.
Nous vous l’avons dit lundi soir en nous exprimant sur l’article, l’ensemble des décideurs politiques de notre département, tous les maires du département, tous les élus, de droite comme de gauche, vos amis au conseil municipal de Nice, vos amis au conseil métropolitain de Nice-Côte d’Azur ont voté contre la privatisation de l’aéroport. Vous devez tout de même comprendre, mesdames, messieurs du groupe socialiste, que cela signifie quelque chose. Nous nous opposons aux socialistes sur le terrain sur la plupart des sujets et, là, nous sommes unanimement pour le maintien du statu quo et contre la privatisation, contre votre politique. Vos collègues socialistes – je ne parle même pas des communistes ou des Verts, qui sont sur la même ligne – osent dire qu’ils sont contre la politique du Gouvernement dans ce domaine. Telle est la réalité sur le terrain.
Vous êtes dans une totale contradiction. Les États-Unis d’Amérique, à qui l’ultralibéralisme ne fait pas peur, je crois que nous pouvons partager ce point de vue sur tous les bancs de l’Assemblée nationale, ont refusé la privatisation de leurs aéroports. Tous les aéroports américains sont publics. Pourquoi ? Parce que les Américains ont compris que ces plates-formes étaient stratégiques et qu’on ne vendait pas ce qui est à ce point stratégique.
Monsieur le ministre, je m’attendais à une autre réponse de votre part. Franchement, nous sommes interloqués de voir à quel point la représentation nationale mais aussi, au-delà, le point de vue des élus comptent peu. Les conseils municipaux ont été renouvelés il y a un an, avec des majorités, des oppositions. Vous ne tenez compte ni des uns ni des autres, ce n’est tout de même pas mal. En matière de démocratie, on peut faire beaucoup mieux.
Finalement, cette vente, elle sert à quoi ? Elle sert à remplir les caisses de l’État.

C’est bien de cela qu’il s’agit ! Or, cette solution, c’est un fusil à un coup. J’espère, monsieur le ministre, que vous répondrez à ma question : puisque vous cherchez de l’argent au point de vouloir vendre les aéroports de Nice et de Lyon, pourquoi ne vendez-vous pas Aéroports de Paris ? Pourquoi, monsieur Le Roux, n’êtes-vous pas favorable à la vente d’Aéroports de Paris ?

Je croyais que vous ne vous adressiez pas à moi, mais je vais vous répondre !

…parce que nous considérons qu’il s’agit d’un équipement stratégique, madame le rapporteur ! Monsieur le ministre, pourquoi deux poids et deux mesures ?
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.

J’ai des questions concrètes à poser au ministre, même si je ne suis pas directement concerné, en tant qu’élu parisien. Si je vois bien la pertinence budgétaire qu’il y a pour l’État à se séparer d’actifs, je n’en vois pas la pertinence économique. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions, et c’est pourquoi j’écoute le débat avec beaucoup d’attention. Certains des arguments, échangés de part et d’autre, méritent d’être creusés.
Je rappelle qu’aucun modèle économique n’est présenté dans l’étude d’impact. Alors moi, j’ai une question à poser :est-ce que l’actuelle concession de ces sociétés publiques, 100 % publiques, a été mal exécutée ? Est-ce que, du point de vue du fonctionnement du service public aéroportuaire, les usagers sont mal considérés ? Y a-t-il des problèmes qui nécessiteraient que, la gestion publique étant défaillante dans l’exécution des modalités du contrat de concession de service public, on la confie à d’autres, et au privé ? Je ne vois rien dans l’étude d’impact qui le dise. D’ailleurs, personne, à aucun moment, n’est intervenu pour dire qu’il y avait un problème dans le fonctionnement, ou que le public ne savait pas faire fonctionner cet équipement.

Deuxièmement, cet aéroport est rentable. C’est ce qu’a dit M. Estrosi, et vous ne l’avez pas contredit sur ce point, monsieur le ministre. Non seulement il est rentable, mais les excédents qu’il dégage, une fois les dividendes reversés aux différents actionnaires, sont suffisamment importants pour autofinancer son développement. J’attends donc des réponses à ce sujet. Estime-t-on qu’il faille faire de tels investissements dans les années à venir que les actuels détenteurs du capital de cette société publique ne seraient pas en mesure de les faire et rechercheraient donc un actionnaire privé, parce qu’ils préféreraient ne pas avoir recours à l’emprunt ? Cela répondrait à un modèle économique. Nous n’avons pas eu de réponse à cette question.
En fait, on peut envisager la cession d’un actif public à une société privée dans trois cas de figure, qui relèvent d’autre chose que de la gestion des bijoux de famille : premièrement, dans le cas où le public gère mal ; deuxièmement, quand les investissements sont tels que le public veut faire d’autres arbitrages ; troisièmement, quand le déficit est si grand que cela signifie que le public ne sait plus gérer et qu’il faut faire appel à un autre mode de gestion pour redynamiser la société. Mais il n’y a rien de cela pour l’aéroport de Nice. Vous dites, avec beaucoup de franchise, monsieur le ministre, qu’il s’agit d’une forme de gestion des participations de l’État et que, comme il n’est pas stratégique pour l’État de détenir 60 % du capital de la société publique des aéroports de Nice et de Lyon, autant s’en séparer pour créer des recettes, lesquelles viendront soit combler le déficit, soit augmenter les participations publiques de l’État ailleurs.
Soit, cela peut se discuter. Mais, dans ce cas-là, si l’État veut céder ses 60 %, pourquoi ne cherche-t-il pas d’abord à voir si des actionnaires publics peuvent entrer dans le capital ? À mon sens, la vraie question est celle de la forme publique de la gestion publique d’un aéroport rentable. Si l’État ne souhaite plus posséder 60 % du capital dans une société publique qui gère l’aéroport de Nice, alors une question fondamentale se pose, qui a été posée par notre collègue Estrosi : pourquoi ne pas permettre à des collectivités locales d’user d’un droit de préemption ? Le paradoxe serait qu’à partir du moment où l’État ne veut plus gérer un équipement public, il faudrait le donner au privé, alors qu’il est rentable ! Or, dans ce cas, un arbitrage aura lieu et il est évident que le privé retirera une partie de ses dividendes pour lui et qu’il les versera aux actionnaires, car ce ne sont pas des oeuvres philanthropiques. Je ne vois pas pourquoi ces dividendes n’iraient pas à une collectivité publique locale, ni pourquoi on mettrait fin à la gestion publique de cet aéroport, alors même qu’il s’autofinance par ses excédents de gestion.
Pour moi, élu de gauche, indépendamment de toutes les autres questions qui ont été posées, je ne comprends pas cela. Avec tout le respect que j’ai pour vous, monsieur le ministre – même si je ne suis pas toujours d’accord avec vous, je reconnais votre rectitude, votre combativité et votre ardeur à défendre vos positions –, il y a là une chose que je ne comprends pas. Depuis le début de la discussion législative, vous nous dites que vous êtes là pour combattre la rente. Eh bien moi, je dis qu’offrir au privé la gestion d’un équipement public rentable qui dégage régulièrement et substantiellement des excédents, c’est offrir une rente au privé.

Je voudrais revenir sur les garanties que vous avez évoquées, monsieur le ministre. Je voudrais d’ailleurs remercier le président Le Roux d’avoir insisté sur ce point. Je vais prendre un exemple concret : celui de l’aéroport de Toulouse, que je connais un petit peu. Vous avez indiqué, dans un grand quotidien régional le 5 décembre dernier, qu’il y a eu une cession de 49,9 % des parts de la société de l’aéroport et qu’il y a une option de vente sur 10,1 % de ces parts. Si l’État décidait de vendre les 10,1 %, ce ne serait plus la puissance publique qui aurait la main sur la société de l’aéroport de Toulouse. Vous dites dans cette interview que le Gouvernement n’a pas l’intention d’exercer l’option, et je vous remercie de l’avoir précisé.
Le problème, c’est que lorsque l’on lit attentivement le cahier des charges, cette option peut être exercée pendant une durée de trois ans, qui peut être prolongée de six mois. Je souhaite que dans trois ans et six mois vous soyez toujours ministre de l’économie, de sorte que votre parole puisse être tenue, mais en tout état de cause, aujourd’hui, la garantie que vous nous proposez à Toulouse ne repose que sur votre parole. Rien ne dit que vos successeurs – même si, encore une fois, je souhaite que vous puissiez, vous, tenir cette parole – la tiendraient. Cela nous pose donc aujourd’hui un problème qui est un cas d’école très concret, puisque le contrat est d’ores et déjà en négociation avec les investisseurs mentionnés.
Aujourd’hui, les garanties que vous nous proposez sur cette option de vente – ce « put » – inscrite au contrat ne reposent que sur votre parole. Une garantie de ce type n’est pas suffisante pour la représentation nationale, pour faire en sorte que les sociétés dont vous parlez puissent toujours avoir un actionnaire majoritaire qui soit la puissance publique sous toutes ses formes – pas forcément l’État, comme l’a dit notre collègue Cherki –, qui assure l’intérêt général d’un territoire et de son développement économique. Ce point est extrêmement important. Je serais rassurée au sujet de l’aéroport de Toulouse si vous nous disiez aujourd’hui que vous enlevez l’option de vente qui figure au contrat.
Faisons un petit calcul de coin de table : cette option de vente vaut entre 10 et 15 millions d’euros ; au lieu de payer 308 millions d’euros, l’investisseur paierait 298 ou 293 millions d’euros. Un certain nombre de banquiers conseil ont travaillé sur ce dossier et ils savent parfaitement fixer le prix d’une option de vente ou d’un « put », avec la maturité qui va bien. Si vous nous dites aujourd’hui que vous retirez cette option de vente, nous aurions la garantie que la société de Toulouse restera bien sous contrôle public, et uniquement sous contrôle public.

Je souhaiterais revenir sur quelques points et apporter des précisions. Plusieurs inexactitudes ont été formulées au cours de ce débat, particulièrement dans les dernières interventions. Tout d’abord, on ne privatise pas des aéroports, mais des sociétés de gestion, ce qui n’est pas exactement la même chose.

Les infrastructures, l’équipement public, restent la propriété de l’État ou des collectivités. Ce n’est pas la même chose.

Deuxièmement, vous avez dit, monsieur Estrosi, quelque chose d’inexact, alors qu’en tant qu’ancien ministre, vous auriez pu connaître les textes et la loi. Ce n’est pas le ministre qui décide de la privatisation de la société de gestion de l’aéroport de Nice, mais c’est la loi. Si nous regardons le cadre juridique, dont nous avons beaucoup parlé lundi soir et dont nous parlons de nouveau depuis dix-heures, nous voyons bien que cela relève du domaine de la loi. Il existe des critères – un chiffre d’affaires supérieur à 150 millions d’euros ou encore le nombre de salariés – qui sont inscrits dans la loi.

Ce sont justement ces critères que nous avons changés, en élargissant les compétences du Parlement.

C’est surtout vous qui n’écoutez pas ce que je dis, monsieur Estrosi ! Ce n’est pas le ministre. Le ministre vous a consulté,…

…et c’est le Parlement qui légifère. L’autorisation donnée par la loi d’ouvrir les transferts de capital, c’est le Parlement qui la donne. Pour Toulouse, comme nous l’avons dit, cela relevait du domaine du décret. À partir du moment où cette loi sera votée, la situation qui s’est produite à Toulouse ne pourra plus se reproduire, ce sera la loi telle que nous allons la voter.

Troisièmement, le raisonnement que nous avons tenu aussi bien lors des auditions qu’en commission spéciale, repose justement sur la nécessité d’examiner les conséquences, en termes de prérogatives de l’État, de ce transfert de capital des sociétés de gestion. Je rappelle qu’elles interviennent dans la gestion courante et que, même pour les investissements effectués dans les aéroports, l’État, par le biais d’un conseil de surveillance, a un rôle déterminant, avec les collectivités publiques.
Comme l’a dit le ministre tout à l’heure, l’État reste propriétaire des infrastructures et des équipements. C’est cela qui est important. Il garde son rôle de régulateur, avec la fixation des tarifs et les ouvertures de lignes.
Par conséquent, avec tous ces éléments, nous avons conclu que l’État conservait un nombre de prérogatives important, parmi lesquelles des prérogatives essentielles pour l’avenir de ces équipements. C’est pour ces raisons que nous avons considéré que nous pouvions être favorables à cette disposition.
Au cours du travail mené en commission spéciale, nous avons tiré les enseignements de l’opération de Toulouse, que nous avons regrettée, en élargissant le rôle du Parlement – je le répète une dernière fois pour M. Estrosi – et en prenant en compte les intérêts essentiels de la nation. En tant que ministre de la République, monsieur Estrosi, vous devriez être le premier à savoir que l’intérêt national et l’intérêt d’une ville ou d’un territoire, ce n’est pas exactement la même chose. Nous sommes ici comme élus de la nation ou ministre de la République, en charge des intérêts de la nation et non pas d’intérêts particuliers.

Voilà les raisons pour lesquelles nous sommes défavorables aux amendements de suppression.

Je ne réagirai même pas aux propos de Mme le rapporteur, qui me paraît peu digne d’assumer le rôle qui est le sien.
Protestations sur les bancs du groupe SRC.
Mêmes mouvements

car lorsqu’un texte de loi est présenté au conseil des ministres, il est d’abord rédigé par le ministre. Si vous avez un jour vocation à être ministre, madame le rapporteur, je crains le pire pour l’intérêt de la nation !

Vous venez de dire que la commission elle-même a regretté l’opération de Toulouse. Pourquoi la regretter et être à ce point enthousiaste pour l’opération de Nice et de Lyon, qui est pire, puisqu’il s’agissait, dans le cas de Toulouse, d’une vente à un actionnaire minoritaire quand nous discutons ici d’une vente à un actionnaire majoritaire ?
Notre collègue Pascal Cherki a posé un problème extrêmement concret et je veux, pour ma part, faire à nouveau référence au rapport public annuel de la Cour des comptes paru en 2015. Vous y trouvez au tome II, pages 401 et suivantes : « Un exemple d’investissements publics locaux mal planifiés : les aéroports de Dole et de Dijon ».

Pourquoi, alors que la Cour des comptes considère qu’à aucun moment il n’est question de stigmatiser les aéroports de Nice et de Lyon, n’avez-vous pas projeté de vendre les deux autres aéroports, voire celui d’Orly ou de Charles-de-Gaulle ?
Enfin, il est une question que je vous ai posée plusieurs fois, monsieur le ministre, et à laquelle vous n’avez pas répondu : conformément au code général des collectivités territoriales, qui prévoit la possibilité de consultations référendaires, les électeurs de la cinquième ville de France sont invités, le 19 février prochain, à se prononcer sur la vente de leur aéroport. C’est une consultation, elle est prévue par la loi votée par le Parlement. Je vous demande si vous tiendrez compte du résultat des urnes, ou si vous n’en tiendrez pas compte.

Pourquoi n’avez-vous pas organisé un référendum local sur l’enfouissement de la ligne 2 du tramway ?

Je veux savoir si, au-delà de ne respecter ni les élus locaux ni les parlementaires – que vous n’avez jamais consultés, contrairement à ce que vient de dire Mme la rapporteure thématique –, vous n’allez pas plus tenir compte des citoyens français à travers la consultation des citoyens de la ville de Nice. La réponse est facile, elle tient en trois lettres : oui ou non.

Je trouve bien à propos que M. Estrosi soit attentif aux rapports de la Cour des comptes. Il est en effet bien placé, en tant que maire de la ville de Nice, pour connaître les recommandations qu’elle a faites dernièrement sur la gestion des collectivités. Les seuls qui peuvent s’estimer lésés par le débat que nous menons, ce sont les contribuables de la ville de Nice, qui ont payé 100 000 euros pour une campagne faite par leur maire contre l’ouverture du capital de cet aéroport, campagne qui s’est faite sur la base d’arguments erronés, on le voit bien.
Mais notre débat est essentiel en ce qu’il porte sur les garanties apportées par le Gouvernement et par la commission. Ne laissons pas dire n’importe quoi : vous dites, mon cher collègue, que le capital d’Aéroports de Paris n’est pas ouvert, mais c’est totalement faux puisqu’il est détenu aujourd’hui à 50,6 % par l’État, l’autre partie du capital étant détenue par Schiphol, Vinci, Predica, des investisseurs individuels et les salariés. C’est pourquoi je dis au ministre que le Gouvernement est au pied du mur : il doit montrer aujourd’hui, à travers Aéroports de Paris, qu’il apportera demain les mêmes garanties pour les aéroports de province. C’est pourquoi je veux revenir sur le contrat de régulation économique : il est important de montrer, monsieur le ministre, que l’État demeure présent, même après une ouverture du capital. Celle-ci est maîtrisée, et elle fera même l’objet d’un débat à l’Assemblée.

Votre argument est très bon : gardons 50,6 %, comme à Paris ! Vous venez enfin de dire quelque chose d’intéressant !

Je vous remercie de le souligner, monsieur Estrosi. J’essaye depuis tout à l’heure de vous dire qu’il n’y a absolument aucun risque à l’ouverture du capital telle qu’elle est prévue pour l’aéroport de Nice et pour l’aéroport de Lyon dès lors que le ministre conserve à l’État, comme il s’y est engagé, le rôle de régulateur qu’il doit avoir sur les infrastructures stratégiques.

Tout le reste n’est qu’une campagne locale dont on voit bien qu’elle est ici relayée par ceux qui peuvent avoir un petit intérêt politique à mettre en cause ce que nous mettons en place. Cela me fait légèrement sourire que les partisans de l’économie administrée soient aujourd’hui de votre côté, d’autant plus que nous prenons toutes les précautions quant à l’ouverture du capital.
Il est procédé au scrutin.

L’amendement no 1475 est retiré.

La parole est à M. Richard Ferrand, rapporteur général de la commission spéciale.

Je regrette que M. Salles nous prive d’un moment de bravoure…J’ai entendu notre collègue Christian Estrosi mettre en cause sans motif la personnalité du ministre, puis la compétence de la rapporteure thématique ; ensuite, sur tous les tons, on nous a expliqué que la privatisation des sociétés de gestion des aéroports était un véritable scandale.

Au point d’ailleurs que M. Salles vient de se dispenser de nous donner connaissance de l’amendement qu’il a pourtant signé…
Sourires.

… et qui est ainsi rédigé : « Le transfert au secteur privé de la majorité du capital des aéroports régionaux et des aérodromes est autorisé. »
« Ah ! » sur les bancs du groupe SRC.

Comme si cela ne suffisait pas, il est même indiqué : « L’État ou l’autorité en charge du transport aérien publie chaque année un calendrier des projets et décisions de transfert au secteur privé des aéroports. » Quand on se permet de mettre en cause soit la personnalité, soit les compétences de ses interlocuteurs, l’on fait attention de ne pas être soi-même signataire d’un amendement totalement à rebours des propos que l’on vient de tenir. Car sinon, après, les leçons de dignité données devant la représentation nationale, on peut se les garder.

Monsieur le rapporteur général, vous avez la possibilité de vous exprimer à tout moment lors de l’examen des amendements, mais il n’y a pas en principe d’intervention sur un amendement retiré. Je vous avais donné la parole pour que vous puissiez apporter un complément d’information.

La parole est à M. Rudy Salles, qui aura à coeur de ne pas relancer une quelconque polémique au sein de cet hémicycle.

Il n’échappera à personne ici que les groupes parlementaires font cosigner à leurs membres un certain nombre d’amendements de façon à pouvoir les faire défendre en séance si leur auteur est absent.
Exclamations sur plusieurs bancs du groupe SRC.

C’est vrai aussi pour le groupe socialiste, je pourrais en donner des exemples.
Il ne vous aura pas échappé non plus, mes chers collègues, que son auteur, M. Fromantin, est un élu de la région parisienne, et qu’il n’a donc pas forcément la même vision que la mienne : la sienne est très « Aéroports de Paris ».
Deuxièmement, je ferai remarquer que M. Fromantin n’est pas venu en séance cet après-midi.
L’amendement no 1791 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
L’amendement no 1792 , accepté par le Gouvernement, est adopté.

La parole est à Mme Laurence Abeille, pour soutenir l’amendement no 1307 .
L’amendement no 1307 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.


Monsieur le ministre, vous avez une opportunité extraordinaire pour réaliser une immense réconciliation nationale. M. Bruno Le Roux – je regrette qu’il ne soit plus dans l’hémicyle –…

… affirmait, il y a quelques minutes, que nous avions une attitude de défense de petits intérêts locaux, alors que nous ne cessons de défendre d’abord les intérêts de la nation. Je rappelle, et cela intéressera peut-être les membres du groupe socialiste, que le président socialiste du conseil régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur, M. Michel Vauzelle, s’est totalement associé à notre démarche d’opposition à la vente de l’aéroport de Nice à un actionnariat privé majoritaire. Vous voyez que c’est l’unité nationale, non pas sur un petit intérêt local mais au niveau de la troisième région de France, où toutes les énergies se sont fédérées pour défendre le même objectif.
M. Le Roux s’est totalement contredit puisqu’il a essayé d’expliquer qu’Aéroports de Paris était exactement dans la même situation que le nôtre, l’État y étant actionnaire majoritaire. Comme ce que vous souhaitez avant tout, c’est remplir les caisses de l’État pour baisser les déficits qui sont les vôtres et essayer de présenter une copie plus acceptable à Bruxelles, je vous propose, d’une part, de déposer vous-même un amendement qui donnerait un droit de préemption à la collectivité, ce qui nous permettrait de racheter une part du capital détenu par l’État – 10 % par exemple –, et, d’autre part, à travers notre amendement à l’alinéa 7, de remplacer le mot : « majorité », par le mot : « minorité ». Cela vous donnerait l’occasion de vendre au privé 49,9 %, plus 10 % racheté par la collectivité. Ainsi, vous seriez en mesure d’encaisser ce que vous cherchez à tout prix : la valeur de 60 % du capital.
Ce serait une grande avancée qui permettrait à tous ceux qui se sont prononcés, lors du dernier scrutin public, pour la privatisation de ces deux plates-formes aéroportuaires d’avoir gain de cause puisqu’il y aurait bien vente à un partenaire privé. Nous aurons ainsi trouvé un modèle qui rassemble tout le monde tout en permettant à la collectivité de garder, autour de la table du conseil de surveillance, la maîtrise des initiatives sur la politique à conduire en matière d’aménagement du territoire, de développement économique, mais aussi d’intérêts stratégiques pour la nation française, parce que c’est également de cela qu’il s’agit.
Avis défavorable. Si vous m’y autorisez, monsieur le président, je répondrai sur les différents points soulevés.
Tout d’abord, monsieur Estrosi, si l’avis du Gouvernement sur cet amendement est défavorable, c’est parce que la mesure que vous proposez relève en fait du pouvoir réglementaire et que nous n’avons, en quelque sorte, pas besoin de demander l’autorisation du législateur pour vendre une part minoritaire de la société de gestion.
Je tiens aussi à préciser qu’en aucun cas la cession de parts, minoritaires ou majoritaires, d’une société de gestion ne peut venir en déduction du déficit public. Je regrette de vous annoncer ce qui est peut-être une mauvaise nouvelle pour un grand nombre d’entre vous d’entre vous, mais les règles maastrichtiennes ne le permettent pas : le produit d’une telle vente peut en effet venir en déduction de la dette, mais pas, je le répète, du déficit public.
Ces arbitrages ont deux objectifs. La cession d’actions de sociétés de gestion a d’une part pour but, comme je m’en suis justifié tout à l’heure, de procéder au désendettement, qui fait partie de notre objectif – si vous n’aviez pas ajouté 600 milliards d’euros de dettes, peut-être serions-nous dans une autre situation et disposerions-nous d’une autre latitude.
« Eh oui ! » sur les bancs du groupe SRC.
D’autre part, il s’agit aussi de réinvestir dans nos priorités, c’est-à-dire de pouvoir sauver des entreprises comme PSA – ce dont nous pouvons tous nous féliciter – et d’établir un rapport de forces avec des actionnaires privés peu coopératifs, comme dans le cas d’Alstom, etc. En l’espèce, je n’ai aucun doute, au vu des analyses réalisées, que l’argent de l’État soit mieux utilisé à ces fins que s’il reste immobilisé dans les actifs que sont les sociétés de gestion, pour toutes les raisons que j’exposais tout à l’heure.
Le droit de préemption s’est heurté, comme vous l’avez vous-même rappelé, à la barrière de l’article 40 de la Constitution. En effet, si nous octroyons aux collectivités locales un droit de préemption, nous contrevenons à notre devoir constitutionnel de défendre les intérêts patrimoniaux de la nation et des citoyens, car nous réduisons la valeur de ces actifs au bénéfice d’une collectivité locale. De même que le droit de préemption ne pourrait être attribué à un tiers, il ne peut l’être à une collectivité locale. Il faudrait, dans le cas contraire, en compenser la valeur, ce qui n’est pas possible.
Quant au référendum, vous connaissez le caractère légalement douteux de l’initiative que vous avez prise. Vous avez en effet eu ce débat avec le préfet, qui a décidé de ne pas déférer – je pense qu’il a eu raison et nous l’avons d’ailleurs encouragé. Il est normal qu’il y ait un débat démocratique. Mais ne faites pas croire à la représentation nationale que ce référendum pourrait avoir quelque valeur contraignante que ce soit sur le plan légal. Le Gouvernement tiendra compte de ses résultats comme il le doit, c’est-à-dire avec la considération qu’il doit à tous les citoyens français : il examinera donc le taux de participation et les résultats de ce référendum et en tirera toutes les conséquences qu’il doit en tirer – ni plus, ni moins.
Monsieur Laurent, j’ai essayé tout à l’heure de clarifier les éléments relatifs à la contrainte bruxelloise, qu’il ne faut pas surdéterminer. J’ai souligné – et je le répète également à l’attention de M. Cherki – que nombre de sites ont fait le choix de recourir à des sociétés de gestion totalement publiques, d’autres à des sociétés de gestion privées. Ce n’est pas sous la pression bruxelloise que nous agissons, mais parce que, compte tenu de notre portefeuille d’actifs, c’est un choix pertinent que de procéder à ces ouvertures de capital et à ces privatisations, auxquelles nous ne voulons pas procéder pour d’autres actifs. Cette question pourrait donner lieu à un débat exhaustif, que du reste nous aurons sans doute en temps voulu.
En tout cas, je le répète, nous n’agissons pas sous la pression de quiconque et une telle opération n’a aucun impact sur les déficits. Elle pourrait toutefois en avoir un sur la dette et le Gouvernement souhaite donc mettre en place un programme permettant de céder des actifs afin, d’une part, de se désendetter à la hauteur de ce qui a été voté dans le projet de loi de finances et, d’autre part, à parité, de pouvoir réinvestir. Je confirme ici pleinement, à l’attention de M. Salles, que la DGAC applique en effet une politique constante de contrôle des ouvertures de lignes et qu’elle la maintiendra.
Pour ce qui concerne ADP et en réponse à votre dernière question, monsieur Estrosi, un distinguo s’impose. Le président Le Roux a rappelé des chiffres tendant à montrer que, d’une part, et contrairement à ce que vous laissiez entendre, monsieur le député, le capital d’ADP est déjà largement ouvert à des financiers comme Predica, à des sociétés étrangères comme Schiphol et à des sociétés privées comme Vinci, avec une part légèrement majoritaire de l’État. La véritable différence entre ADP et les aéroports que nous évoquons est cependant qu’ADP est, de par la loi, propriétaire des terrains et des bâtiments.
Si nous allions dans votre sens, je ne serais pas cohérent avec ce que je vous ai dit moi-même : à Nice comme à Lyon, nous ne cédons nullement les infrastructures, mais seulement la société de gestion et c’est là que se situe la différence fondamentale avec le cas d’ADP.
Monsieur Cherki, bien que j’avoue n’avoir pas suivi tous les linéaments de votre raisonnement, je tiens à préciser à votre attention, ainsi qu’en réponse aux propos de M. Estrosi, que les directives européennes font obligation aux sociétés de gestion d’aéroports de s’autofinancer. Les dépenses réalisées sur les aéroports ne sont donc financées ni par l’État, ni par les collectivités, mais par la société de gestion, les passagers et les compagnies aériennes, mis à contribution par le biais des différentes logiques tarifaires.
Oui, les deux sociétés dont le capital est aujourd’hui ouvert sont donc des sociétés bien gérées et c’est précisément parce qu’elles ont une valeur que nous avons fait ce choix. Nous sommes en effet convaincus que nous pouvons en tirer une valeur supérieure à la rentabilité même que nous en percevons sous forme de dividendes, car nous avons, comme je l’ai dit tout à l’heure, la capacité de les réguler de manière satisfaisante et parce que l’État actionnaire n’a pas décidé et n’est pas en mesure d’appliquer un programme ambitieux d’investissement dans ces sociétés de gestion.
À Toulouse, les Chinois se sont engagés, aux termes du contrat qui nous lie à eux et qui les lie aux différents partenaires publics, à réaliser 850 millions d’euros d’investissements sur la durée de la concession de 32 ans, soit 26,5 millions d’euros par an – ce que l’État n’a jamais fait en tant que coactionnaire de la société de gestion.
Il faut, à cet égard, choisir ses priorités et je tiens donc à redire l’intérêt économique de ces cessions assorties d’engagements portant sur un plan de financement pluriannuel.
Je souhaiterais également insister, malgré l’absence de M. Cherki – sur le distinguo qu’il conviendrait de faire entre la rentabilité et la rente. Nous traquons la rente, mais pas la rentabilité, sous peine d’avoir collectivement un problème avec notre économie. Nous souhaitons donc avoir des actifs rentables, mais nous cherchons à lutter contre les effets de rente. Je pourrai m’entretenir sur ce point avec M. Cherki lorsqu’il sera de retour.
Pour ce qui est de l’aéroport de Toulouse, je tiens à apporter, bien qu’elle aussi ait quitté l’hémicycle, des clarifications sur les points que Mme la rapporteure générale a très légitimement soulevés. À Toulouse, donc, je me suis en effet engagé à ne pas exercer l’option de cession des 10 % supplémentaires. La question est de savoir si nous pouvons aller plus loin en apportant par la loi une garantie, mais l’analyse des contraintes constitutionnelles auxquelles nous sommes soumis montre que ce n’est pas possible, compte tenu d’un élément préalable.
De fait, avec un décret signé par mon prédécesseur et dont j’ai accompagné l’exécution en juillet 2014, l’État a lancé un processus ouvrant le capital à 60 %. La loi permettait alors de le faire, mais les mesures que vous avez adoptées depuis lors ne le permettront plus : la valeur des cessions se situera alors sous ce seuil et il faudra recourir à la loi pour autoriser l’ouverture de capital, y compris pour un aéroport comme celui de Toulouse.
Alors donc que l’ouverture du capital pouvait atteindre 60 %, une première option à hauteur de 49,9 % a été actée. Le Gouvernement s’engage très clairement à ne pas céder 10 % de plus – nous ne pouvons aller plus loin. Si nous revenions sur cette décision par la loi et ramenions le seuil de cessions à 49,9 %, nous démonterions toute l’opération et placerions l’État devant un contentieux. Nous porterions alors une responsabilité qui aurait un coût pour le contribuable, ce que nous ne souhaitons pas. Je ne peux donc faire plus que réitérer l’engagement que j’ai déjà pris au nom du Gouvernement, mais il me semble qu’il était important de le faire.
Monsieur Le Roux, je partage votre souci quant aux contrats de régulation économique relatifs notamment aux deux aéroports parisiens et je tiens à rappeler l’engagement que de tels contrats prennent pleinement en compte les nécessités de la première compagnie française. Nous avons en effet le devoir de l’accompagner et je ne puis donc que souscrire à vos propos. Il était important de clarifier les choses.
Enfin, monsieur Estrosi, permettez-moi de vous dire que je vous ai toujours répondu avec courtoisie. Je vous ai ainsi répondu tout à l’heure parce que vous aviez dit lors de la dernière séance une contrevérité en indiquant que je n’avais pas eu la courtoisie de prendre contact : j’ai donc rappelé que c’était faux. Vous m’avez ensuite pris à partie d’une manière insultante, une première fois, en me demandant de vous regarder dans les yeux pour que nous puissions commenter nos perceptions respectives d’une conversation. Ce n’est pas à la hauteur de nos débats. De fait, je n’ai pas eu la même perception que vous de cette conversation et il me semble que, depuis le début de nos échanges, vous avez montré de manière constante que le manque de courtoisie était plutôt dans votre camp.
Deuxièmement, je ne peux pas accepter que vous laissiez entendre qu’il y aurait eu une quelconque magouille ou combine, ou que quelqu’un serait passé dans mon bureau.
Permettez-moi de vous dire deux choses. Tout d’abord, je veux saluer votre passion naissante pour l’aéroport de Nice : nommé en juin 2014 à son conseil de surveillance, vous n’êtes pas venu à la réunion de juillet de ce conseil, ni à celle de septembre et, à celle de décembre, vous êtes venu quinze minutes pour prononcer un discours qui ne concernait pas l’ordre du jour. Sans doute avez-vous besoin de montrer ici à vos concitoyens que le sujet vous préoccupe car, au quotidien, il vous a moins préoccupé.
Le second point est le suivant : peut-être avez-vous été habitué, en d’autres temps, à certaines pratiques au sommet de l’État, mais elles n’ont plus cours.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

Monsieur le ministre, votre mise en cause de M. Estrosi n’est pas convenable – pardonnez-moi de vous le dire !
Protestations sur les bancs du groupe SRC.

…il ne me semble pas indispensable de poursuivre les échanges sur ce ton.

En deuxième lieu, force est de constater – et c’est, au fond, ce qui abîme ce débat – que l’ouverture du capital de l’aéroport de Toulouse s’est faite dans les pires conditions, tant la signature de l’État s’est dégradée ces derniers mois du fait des décisions irrationnelles prises à propos d’Écomouv’…

…et des affichages surréalistes exprimés à plusieurs reprises par le Gouvernement – en tout cas par Mme Royal – sur le dossier autoroutier, même si d’autres membres du Gouvernement ou de l’exécutif ont pu exprimer des positions plus raisonnables et plus rationnelles.
Pour ce qui est de la privatisation des autoroutes,…des aéroports…

…de Lyon et de Nice, je tiens à préciser – en tant que député rhônalpin lorsqu’il s’agit de Lyon, en tant que député lorsqu’il s’agit de Lyon et de Nice – qu’il ne sera pas dit dans cet hémicycle qu’un député de droite ne peut pas être favorable à la privatisation d’autoroutes, à la privatisation d’aéroports.
Je suis favorable à la privatisation des aéroports de Lyon et de Nice et, si judicieuses que puissent être souvent les interventions de M. Estrosi, j’assume sur ce sujet ma position et mon expression différentes.
De telles plates-formes aéroportuaires sont assurément un enjeu important pour l’aménagement du territoire et pour l’intérêt national, mais je n’ai jamais considéré que le fait qu’une entreprise fût détenue par des capitaux privés était automatiquement contraire à l’aménagement du territoire et à l’intérêt national. Et parce que je crois que d’autres gouvernements auraient pu prendre hier une telle décision – il importe en effet de faire circuler les actifs publics et, quand les conditions s’y prêtent, de pouvoir les céder dans une stratégie de désendettement –, parce que je pense que d’autres gouvernements, y compris de notre sensibilité politique, pourraient prendre demain pour ces plates-formes et pour d’autres une décision semblable, je souhaite dire, en tant que député membre de l’UMP – et sans engager mon groupe, dont je connais la position –, qu’il me paraît rationnel, raisonnable et conforme à l’intérêt des territoires et de la nation de vendre des parts majoritaires de ces deux plates-formes aéroportuaires à un actionnariat privé.
Mme Sandrine Mazetier remplace M. David Habib au fauteuil de la présidence.

Monsieur le ministre, les propos qui ont été les vôtres et qui sont une fois de plus assez déplacés,…
Rires et exclamations sur les bancs du groupe SRC

…montrent bien que vous n’avez jamais été confronté au suffrage universel,…

…et que vous n’avez jamais assumé la moindre responsabilité d’élu local !

Les collaborateurs qui sont assis derrière vous n’ont pas été en mesure de vous apporter les bonnes informations, ce qui vous amène à dire des choses erronées : il faut savoir que les maires, qui siègent de droit dans de multiples conseils d’administration,…

…sont représentés par des maires adjoints qui siègent en leur lieu et place dans ces conseils d’administration – il y a suffisamment de présidents d’exécutifs ce soir pour savoir que cela fait partie de l’organisation de la république !

J’ai un maire adjoint de très grande qualité, chargé du développement durable et de l’aménagement du territoire qui siège de droit au conseil de surveillance. Jamais la place du maire n’a été vide au conseil de surveillance ! J’ai d’ailleurs toujours participé aux réunions préparatoires pour que mon maire adjoint porte la parole du maire de Nice – cela dit pour vous donner une petite leçon,…
Rires sur les bancs du groupe SRC

…au cas où, un jour, vous seriez tenté d’avoir le courage d’affronter le suffrage universel et d’exercer une responsabilité locale. Je n’ai pas le sentiment que vous en preniez le chemin et le souvenir que vous laisserez de votre passage dans cet hémicycle ne favorisera sans doute pas votre accession par le suffrage universel à une responsabilité locale !

Enfin, monsieur le ministre, vous parlez de consultation et de concertation : n’allons pas plus loin, car vous savez très bien comment cela s’est passé ! Depuis que ce texte a été présenté en conseil des ministres il y a deux mois, le ministre a-t-il reçu une seule fois dans son bureau le président de la chambre de commerce et d’industrie, le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire de la ville et le président de la métropole, qui sont actionnaires, pour discuter tranquillement et gentiment de la manière dont ce texte pourrait être rédigé ? En aucun cas vous ne l’avez fait ! Vous n’y avez jamais consenti alors que cette demande vous a été formulée à de multiples reprises.
C’était aussi pour moi l’occasion d’apporter un farouche démenti : je ne veux pas que vous laissiez croire, en dépit de l’élan populaire que vous avez suscité parmi les vôtres par ces fausses déclarations, que le ministre que vous êtes aurait accepté un dialogue.

Grâce à la mobilisation des huissiers, des notaires, des avocats et de bien d’autres encore, vous avez accepté de reconnaître qu’un certain nombre d’erreurs avaient été commises et vous avez reculé.
Il y aura, au-delà du président de la région, du président du département, des maires de la métropole de Nice Côte d’Azur et du département des Alpes-Maritimes, une mobilisation d’une grande part de la population, qui sont des citoyens français.
Si j’en crois la réponse un peu concrète que vous venez de formuler en disant que vous étiez prêt à tenir compte de la manière dont s’exprimeraient les Niçoises et les Niçois le 19 février prochain, j’ose espérer que vous reviendrez sur votre position en deuxième lecture – position qui, aujourd’hui, reste inflexible.
Avec cet amendement, je vous tends la main en vous disant tout simplement que c’est l’intérêt de l’État, qui a tout à y gagner.
Vous me disiez que la différence avec Paris, c’est que Paris était propriétaire des terrains : puis-je rappeler simplement que ces terrains étaient propriété des Niçois ? En 1935, le maire de Nice de l’époque en a fait cadeau à l’État pour que celui-ci, en partenariat avec les collectivités locales, y aménage la plate-forme aéroportuaire.
Tous les terrains permettant à l’aéroport de fonctionner sont propriété de la collectivité puisque ce sont ceux sur lesquels nous aménageons les places de stationnement pour les automobiles, les gares routières pour les transports routiers, la ligne de tramway ou encore la nouvelle gare ferroviaire, aujourd’hui en chantier.
Ces terrains, qui participent du bon fonctionnement de l’aéroport et de sa valorisation, sont propriété de la collectivité. Voilà un argument en réponse à celui que vous avez voulu soulever concernant la propriété des terrains par l’aéroport de Paris : nous voyons bien que nous sommes dans une situation quasi équivalente !

Trois points, monsieur le ministre. Premier point concernant la situation d’ADP : la participation publique dépasse les 51 %, ce qui va totalement dans le sens de l’amendement déposé par Christian Estrosi. Je ne vois donc pas comment vous pouvez trouver bonne la situation d’ADP et refuser la même à l’aéroport de Nice.
Deuxième point : vous avez eu la maladresse de dire au maire de Nice qu’il ne siégeait pas ou n’était pas présent aux réunions du conseil de surveillance de l’aéroport de Nice Côte d’Azur. Il vous a répondu sur ce point ; j’ajoute que deux membres de l’exécutif de la métropole siègent également en permanence, à savoir le président de la commission économique et le président de la commission du tourisme et des relations internationales. Le maire de Nice et le président de la métropole sont donc représentés : par conséquent, la présence de la métropole n’a fait défaut à aucune séance du conseil de surveillance de l’aéroport.
De la même façon, le préfet des Alpes-Maritimes, également membre de droit de ce conseil de surveillance, vient assez rarement : il ne me viendrait pourtant pas à l’idée de dire que l’État n’est pas présent au conseil de surveillance quand le préfet n’est pas là ! Il faut quand même recadrer ce débat !

Troisième point : vous avez dit tout à l’heure à propos du référendum qui se déroulera à Nice jeudi prochain que vous en tiendriez compte, « ni plus, ni moins ». J’aimerais savoir ce que cela veut dire !
Il est procédé au scrutin.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants: 39 Nombre de suffrages exprimés: 38 Majorité absolue: 20 Pour l’adoption: 10 contre: 28 (L’amendement no 1163 n’est pas adopté.)
L’article 49, amendé, est adopté.

Je suis saisie d’un amendement no 2812 rectifié portant article additionnel avant l’article 50, qui fait l’objet d’un sous-amendement no 3181 .
La parole est à M. le ministre, pour soutenir cet amendement.
Cet amendement vise à adapter les contraintes de la loi de programmation militaire – la LPM – qui, pour la période 2014 à 2019, a prévu un niveau de recettes exceptionnelles important, encore rehaussé par le projet de loi de finances pour 2015, la principale source de ces ressources exceptionnelles étant la cession des bandes de fréquences 700 mégahertz ; plusieurs questions d’actualité ont permis de clarifier ce point, et cela a été fait tant par le ministre de la défense, le ministre des finances que par moi-même.
Or il existe aujourd’hui un risque que l’encaissement du produit de cette cession n’intervienne pas à la date initialement prévue par la loi de programmation militaire, pour une raison simple : cet encaissement, afin de préserver les intérêts patrimoniaux de l’État, doit pouvoir se faire dans les meilleures conditions. Un processus est prévu par la loi, sous le contrôle de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP, qui a d’ores et déjà commencé mais qui fait courir le risque de chevaucher l’année 2015.
Le ministère de la défense serait dès lors dans l’incapacité de régler ses fournisseurs en 2015, ce qui aggraverait encore le report de charges et pourrait finir par compromettre la soutenabilité budgétaire de certains programmes d’armement, qui sont calibrés au plus juste des besoins pour assurer les contrats opérationnels prévus par le Livre blanc et discutés lors du vote de la loi de programmation militaire.
Pour se prémunir contre ce risque et dans le respect de la LPM, qui avait identifié les produits de cession de participations publiques comme l’un des moyens de pallier les aléas sur les recettes exceptionnelles, le Président de la République et le Gouvernement ont décidé de permettre la création de sociétés dotées majoritairement ou exclusivement de capitaux publics et dont l’objet sera d’acquérir auprès du ministère de la défense des équipements militaires pour les lui relouer, sur le modèle de ce que l’État a déjà autorisé pour l’immobilier de bureau ; c’est bien ce modèle qui est ici retenu.
Le présent amendement ne préempte pas les décisions qui pourront être prises quant aux caractéristiques des sociétés, notamment en termes de capitalisation ou de rémunération des capitaux investis ; c’est un travail qui est en cours.
En revanche, il permet, en exigeant que les contrats entre l’État et la SPV – Special Purpose Vehicle ou société de projet – comportent diverses clauses protectrices, d’offrir des garanties fortes quant au respect de la continuité du service public de la défense.
Il s’agit ici en particulier, d’une part, de donner au locataire qu’est le ministère de la défense des garanties et droits étendus sur la libre disposition exclusive et sans interruption du matériel loué ; d’autre part, de transférer au locataire la responsabilité de l’intégralité des opérations d’entretien, de maintenance et de réparation, lui permettant de s’assurer et de contrôler la disponibilité du matériel en toutes circonstances et, enfin, de placer le matériel loué sous l’entière autorité du locataire en matière de sécurité.
Cet amendement permet aussi de lever certains verrous législatifs qui pourraient, sinon, faire obstacle à la constitution des sociétés de projet. Est ainsi autorisée, pour le préciser de la manière la plus claire possible, la cession d’équipements militaires qui ne sont pas inutiles aux armées, ce qui permettra d’éviter la contestation de l’appartenance de ces équipements au domaine privé de l’État ou l’invocation de l’article L. 3211-17 du code général de la propriété des personnes publiques, qui semble y faire obstacle ; c’est pourquoi ce point est explicitement visé dans le présent amendement.
Est également prévu, eu égard aux délais extrêmement contraints puisqu’il s’agit de faire face aux prochains mois, que les sociétés de projet puissent échapper à certaines règles applicables aux sociétés de financement, notamment à l’obligation d’obtenir un agrément préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L’amendement leur offre ainsi la possibilité de recourir à l’emprunt à long terme.
Enfin, cet amendement ne ferme pas la porte à une solution pragmatique de financement au profit du ministère de la défense, dans l’attente de l’intervention des recettes exceptionnelles prévues par la LPM. C’est donc bien le problème du décalage de la cession des fréquences 700 mégahertz qui est à la base même de la démarche du Gouvernement.

La parole est à M. Jean-François Lamour, pour soutenir le sous-amendement no 3181 .

Monsieur le ministre, vous nous présentez de manière très technique cet amendement ; mais celui-ci signe une forme d’échec des ressources exceptionnelles dans l’architecture générale de la loi de programmation militaire et, en particulier, de l’exercice 2015. En effet, tel que vous nous le présentez, c’est un dispositif technique comme un autre ; mais c’est surtout l’échec, vous l’avez reconnu vous-même, de la vente des fréquences 700 mégahertz.
À peine avait-il annoncé l’exécution du budget 2015 que le ministre nous expliquait que, de toute façon, ces fréquences ne seraient vendues ni en 2015, ni en 2016, et qu’il faudrait peut-être attendre 2017 pour qu’elles le soient !
Rappelons simplement, parce que l’histoire de ces ressources exceptionnelles est importante, que sur l’exercice 2014, nous avions utilisé le plan d’investissements d’avenir. Vous êtes fin connaisseur, monsieur le ministre, de ces besoins d’investissements dans notre pays ; mais savez-vous à quoi a servi ce plan d’investissements d’avenir ? Simplement à payer les salaires des employés du Commissariat à l’énergie atomique !

Si ! C’était l’unique destination de ce PIA : je pense qu’on aurait pu l’utiliser d’une meilleure façon !
Ces sociétés de projet, par elles-mêmes, posent problème ; cela fait six mois que vous nous en parlez, mais nous n’avons strictement aucune information précise sur les matériels – on sait juste que cela concernera les Atlas et les frégates multimissions, les FREMM, mais on ne sait pas quelles seront les autres cibles –, ni sur la rémunération de ces projets, leur réassurance ou le moment où l’État pourra se réapproprier ce matériel.
Je rappelle simplement qu’une société de projet sert à acheter du matériel à l’armée pour ensuite le lui louer : vous avouerez que c’est assez difficilement compréhensible pour nos soldats ! Mais nous n’avons strictement aucune information, et c’est d’ailleurs l’objet du sous-amendement que j’ai déposé : nous devrions être informés avant de pouvoir débattre de la bonne efficacité de ces sociétés de projet.
Le vrai problème, monsieur le ministre, c’est de construire le budget de la défense à partir de ressources exceptionnelles. C’est un peu comme si on demandait à l’éducation nationale ou au ministère de la justice de vendre une partie de leurs biens immobiliers pour constituer leur budget. Demande-t-on à l’éducation nationale de contracter avec des partenaires privés pour consolider un exercice budgétaire, par exemple pour payer les enseignants ? Non !
À un moment où plusieurs milliers de nos soldats sont projetés sur des théâtres d’opérations extérieures et où, dans le cadre de l’opération Sentinelle, dix mille d’entre eux sont déployés sur notre territoire pour protéger les citoyens français, je m’interroge sur la pertinence de ce recours à des ressources exceptionnelles dans la construction budgétaire imposée par la LPM. J’espère que la révision de la LPM, qui aura lieu au cours du deuxième trimestre de cette année, sera l’occasion de réexaminer la pertinence de ce recours à des ressources exceptionnelles pour le budget de la défense.
Il est un autre élément qui m’inquiète beaucoup, monsieur le ministre, c’est l’incohérence de la position gouvernementale. Il y a deux jours encore, votre collègue Christian Eckert expliquait à la commission des finances qu’il y avait un plan B : apparemment, il croit si peu à ces sociétés de projet qu’il envisage déjà des solutions alternatives. Cela ne laisse pas d’inquiéter le monde militaire. Où est la vérité ? Est-elle dans ce que vous venez de nous exposer, à savoir qu’il n’y a pas d’autre solution que ces sociétés de projet, ou existe-t-il d’autres solutions ?
Je vous en soumets une, monsieur le ministre : il faut rebudgétiser ces ressources exceptionnelles. Je comprends d’autant moins votre opposition au principe de cette rebudgétisation que la constitution d’une société de projet à capital public accroît la dette publique au sens des critères de Maastricht. On peut certainement trouver des solutions plus simples à un problème provisoire, puisque vous dites que ces fréquences seront vendues. On pourrait ainsi imaginer que l’Agence des participations de l’État, au travers d’un compte d’affectation spéciale, mette en place une tuyauterie permettant à un fonds de concours d’alimenter le budget de la défense. Vous êtes un suffisamment fin connaisseur de ces techniques de financement pour nous éviter de recourir à cette solution des sociétés de projet.
Ce n’est pas que je sois par principe opposé à la constitution de telles sociétés : je veux simplement que le Parlement soit tenu parfaitement informé de ces opérations, et c’est précisément l’objet de ce sous-amendement.
Au-delà de la question de ces sociétés de projet, il nous faut trouver les moyens d’assurer à nos armées et à nos militaires une dotation budgétaire de la LPM stable et lisible. Selon le général de Villiers, chef d’état-major des armées, la LPM est déjà un costume très étroit auquel il ne doit pas manquer un euro. Je crains que la constitution de ces sociétés de projet, qui se traduira mécaniquement par des dépenses de fonctionnement supplémentaires, ne rende le costume trop étroit pour nos armées.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement et le sous-amendement ?

Il est favorable à l’amendement et au sous-amendement. Nous pensons comme M. Lamour qu’il est important d’associer le Parlement à cette démarche, et nous jugeons comme le Gouvernement qu’il est indispensable d’assurer au ministère de la défense les équipements nécessaires au respect de la loi de programmation militaire.
J’émettrai un avis favorable à votre sous-amendement, monsieur Lamour. Il est important en effet que toutes les clarifications soient apportées. Je vous remercie de la précision de vos questions, et je peux d’ores et déjà y répondre avec la même précision.
On ne peut pas parler d’échec de la vente des fréquences de 700 MHz.
C’est précisément pour éviter qu’elle ne se traduise par un échec et pour maximiser la valeur de cession que nous avons le souci que cette vente se fasse dans de bonnes conditions. L’échec aurait été de précipiter la vente, car on aurait alors risqué de casser de la valeur. Le Gouvernement a préféré prendre tout le temps nécessaire pour préserver la valeur patrimoniale de ces fréquences.
Je ne dis pas qu’il sera impossible de les vendre d’ici à la fin de l’année, mais il faut être réaliste : cela sera au moins très difficile si on ne veut prendre aucun risque d’exécution budgétaire. En revanche, la cession est tout à fait faisable en 2016.
Compte tenu, d’une part des engagements budgétaires du Président de la République, du Premier ministre et du ministre de la défense, et d’autre part de ce que vivent nos soldats et de l’exposition qui est aujourd’hui celle de nos armées, et que vous avez eu raison de rappeler, la moindre incertitude n’est pas tolérable. C’est pourquoi le Gouvernement a fait le choix d’acter, non pas un échec, mais une incertitude calendaire, et d’y apporter une solution qui elle, ne comporte aucune incertitude : c’est le cas de cette société de projet, dont le seul objet est de pallier le report d’une ressource exceptionnelle.
C’est sur ce point que je voudrais apporter quelques précisions dont vous me pardonnerez le caractère quelque peu technique. Une société de projet n’est pas une dépense à comptabiliser dans le déficit public au sens maastrichtien.
À coup sûr c’est de la dette, et cela sera reconnu comme tel selon les critères de Maastricht. C’est là un point indiscutable, et il n’est pas possible d’envisager un fond de concours qui abonde le budget de la défense grâce à des cessions de participation. En effet, le budget de la défense, c’est de la dépense maastrichtienne, qui vient consolider le déficit annuel.
En revanche, l’achat ou la cession d’actifs n’a pas d’impact sur le déficit public. Quand on crée une société de projet, on peut la capitaliser avec des cessions d’actifs, et c’est ce que nous comptons faire en l’espèce.
Les ressources qui seront tirées de la cession de 55 % d’une société de gestion d’un aéroport de région…
Tel n’est pas mon souhait : si je cite cet exemple, c’est qu’il montre la cohérence de notre politique.
Ce sont ces fonds qui serviront à capitaliser cette société de projet, et non pas des crédits destinés à la dépense courante du ministère. Voilà le distinguo qu’il faut faire.
On ne peut donc pas mettre en place la tuyauterie que vous évoquez, c’est-à-dire vendre des titres pour financer du budget courant. En revanche, on peut tout à fait vendre des titres pour capitaliser une société de projet, et c’est ce que nous proposons.
Mes propos ne remettent pas en cause la cohérence de ceux de mon collègue Christian Eckert : il existe bien un plan B, nous le connaissons et l’avons longuement étudié, mais c’est le calendrier de son exécution qui est incertain. Or nous ne voulons qu’aucune incertitude à court terme ne subsiste quant au calendrier d’exécution d’ici la révision de la LPM, soit cet été, et c’est pourquoi nous mettons en place cette société de projet.
Je ne saurais dire aujourd’hui si elle aura un caractère provisoire. Ce qui est sûr, c’est que les ressources exceptionnelles, quand elles arriveront, pourront s’y substituer, et qu’elles relèvent d’un traitement budgétaire plus classique. Il s’agit simplement de résoudre l’aporie face à laquelle nous sommes sans laisser subsister la moindre incertitude.
Cette solution me semble tout à fait de nature à apaiser la préoccupation que vous venez de manifester et que le Président de la République a faite sienne après que mon collègue Jean-Yves Le Drian la lui a exposée. Nous voulons qu’il n’y ait aucune ambiguïté possible quant à l’engagement de l’État et au respect de la parole présidentielle sur ce point.
S’agissant des crédits du PIA, ils ont servi au financement du CEA, du CNES et d’autres opérateurs.
Enfin, et pour être parfaitement transparent avec vous, je voudrais ajouter que les 2,2 milliards d’euros que nous pourrions tirer des cessions de participations de l’État en 2015, qui pourraient éventuellement être complétés par la levée de dettes ou de participations minoritaires dans d’autres structures, devraient nous permettre de constituer deux sociétés totalement publiques. L’une permettra d’acheter trois frégates multi-missions, ou FREMM, et l’autre quatre Airbus A400M.

L’amendement gouvernemental vise à autoriser le ministre de la défense à procéder à l’aliénation de biens et droits mobiliers se rapportant à des matériels militaires alors que ceux-ci continuent à être utilisés par ses services ou ont vocation à l’être, dans le cadre d’un contrat de location avec une société à participation publique majoritaire.
Cet amendement appelle d’abord une remarque de forme, que nous avons déjà maintes fois répétée depuis le début de ces débats. Le projet de loi initial comportait 106 articles. À l’issue de la commission spéciale il a doublé de volume et comporte désormais 208 articles. Depuis trois semaines, de nombreux articles additionnels ont été votés, notamment l’amendement autorisant le Gouvernement à créer une société de projet pour le canal Seine-Nord, celui de M. Brottes sur les relations commerciales ou l’amendement gouvernemental ouvrant la possibilité d’exercer les missions des mandataires judiciaires à d’autres professionnels, pour ne citer qu’eux.
Or aucune de ces dispositions n’a fait l’objet de l’étude d’impact qui aurait dû être menée préalablement au dépôt de nombre de ces amendements, notamment de ceux du Gouvernement, ce qui pose un problème majeur sur le plan constitutionnel. Le Gouvernement ne s’est toujours pas prononcé sur ce point.
Il ne s’agit certes pas de contester le droit pour le Gouvernement de déposer des amendements. Mais le nombre de ces amendements, et surtout leur impact budgétaire nous amènent à considérer que nous sommes là face à un cas d’inconstitutionnalité.
Quant au fond, les députés UMP ne sont pas opposés au principe du recours à des sociétés de projet. Mais si celles-ci peuvent être dans bien des cas un bon outil de gestion et de rationalisation des dépenses publiques, ce n’est certainement pas dans le domaine de la défense, domaine régalien par excellence.
Certes la solution peut être séduisante à court terme, car ces 2,2 milliards font cruellement défaut à nos militaires, à un moment où nos forces armées sont engagées sur un certain nombre de théâtres extérieurs, et ce n’est pas l’opposition qui vous dira le contraire.
Mais cette solution n’est là que dans l’attente de percevoir le produit de la vente des fréquences des 700 MHz. Elle laisse entier le problème du probable non-respect du budget de la défense pour 2015 en raison du coût des OPEX.
La solution que vous proposez aura donc des incidences de long terme sur des enjeux aussi fondamentaux que l’intérêt supérieur de la nation, la sécurité et la place de la France dans le monde, sans oublier l’emploi dans l’industrie de la défense.
Personne ne contestera que la défense doive rester le secteur régalien par excellence. Il s’agit d’un des piliers de l’État, qui fonde la souveraineté nationale. Or vous souhaitez par cette disposition pouvoir vous séparer d’outils essentiels à l’exercice de notre souveraineté nationale.
Le vrai problème, monsieur le ministre, mes chers collègues, c’est que le budget de la défense subit des coupes budgétaires sans précédent.

Nous n’avons cessé, à l’occasion de l’examen de chaque PLF comme de la loi de programmation militaire, de vous alerter sur les réalités financières d’un budget de la défense qui n’est pas à la hauteur des enjeux.

Je comprends votre malaise, mais vous devriez écouter au lieu de vociférer.

La bonne affaire d’aujourd’hui sera la faillite de demain. La défense nationale mérite mieux que d’être une défense à crédit. Le budget de la défense, ce n’est pas le crédit municipal.
Nous refuserons donc de voter cet amendement, qui revient à déposséder l’État de ses actifs stratégiques.
Nous voterons en revanche le sous-amendement de notre collègue Jean-François Lamour, qui vise, lui, à ce que le Parlement soit informé des modalités d’exécution de votre projet : c’est bien le minimum.

Nous nous opposons bien sûr à l’adoption de cet amendement du Gouvernement qui vise à mettre en oeuvre un dispositif de cession-relocation d’équipements militaires.
Les sociétés de projet à qui sont cédés les équipements sont des instruments de financement, des véhicules financiers classiques qui, dans le civil, correspondent aux sociétés de leasing.
Cette opération de financement de la LPM soulève une réelle difficulté. La défense ne peut en effet être traitée comme n’importe quelle industrie. Trouvez-vous digne de notre nation que la Marine arme quelques bateaux, avions ravitailleurs ou logistiques neufs dont elle ne serait pas propriétaire ? Ce sont des engins qui, doit-on le rappeler, ont vocation à intervenir dans le cadre d’opérations extérieures – et, éventuellement, à ne pas revenir. La politique de notre pays ne peut être financée par des sociétés de leasing, même s’il s’agit de répondre à une situation comptable négative.
Du reste, dans un domaine où le temps est important puisque le lancement d’un projet de matériel implique d’envisager son utilisation pendant cinquante ans, nous nous interrogeons sur l’efficacité d’une telle opération. Comment les sociétés de projets pourraient-elles nous apporter la pérennité et la solidité que nous sommes en droit d’attendre ?

Bien entendu, je voterai et l’amendement et le sous-amendement présenté par notre collègue Lamour.
Je n’interviendrai pas sur la création de cette société de projet mais je tiens à évoquer la question des ressources exceptionnelles prévues à hauteur de 7,7 milliards dans la LPM.
On en comptait 1,55 milliard dans le PIA – lequel n’a pas financé des dépenses de fonctionnement…

Non ! Cette somme a financé des expériences d’observation spatiale du CNES et des travaux de modernisation de notre recherche sur les énergies nucléaires au CEA.

Ne polémiquons pas là-dessus.
Le budget des autres ressources exceptionnelles s’élèvera à 3,7 milliards dès lors que la cession des fréquences de 700 MHz sera effective.
Il existe en effet un décalage entre ce qui était prévu lors de la préparation de la LPM et la situation présente.
Après une rencontre entre l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP, et l’Agence des participations de l’État, l’APE, nous savons fort bien – je vous renvoie au rapport sur le programme 146 que j’ai rédigé sur l’équipement des forces – que la mise sur le marché de ces fréquences, aujourd’hui, n’est pas raisonnable.

Tout d’abord, il convient de procéder à un certain nombre de mises aux normes européennes, ce qui ne sera possible qu’au mois de novembre 2015.
Ensuite, si nous avions aujourd’hui l’autorisation de les mettre sur le marché, nous ne pourrions en tirer 3,7 milliards. Le décalage est patent.
La solution proposée par le Gouvernement est sans doute la seule à même de fournir à nos armées les équipements dont elle a besoin – nous le constatons tous les jours.
Les membres de la commission de la défense sont sans doute tous d’accord à ce propos : les fonds doivent arriver au plus tard aux mois de septembre ou d’octobre 2015.
La société de projet est le vecteur nécessaire qui a été retenu pour parvenir à la réalisation de ces objectifs.

Madame la présidente, monsieur le ministre, j’ai beau essayer de réfléchir au sens de cet amendement, je trouve qu’il est tout de même relativement cocasse, voire invraisemblable.

Il est en effet invraisemblable que nous décidions en quelque sorte de lisser l’endettement et les déficits budgétaires à travers une société de projet, à un prix et à un coût absolument extraordinaires.
Nous allons décider de vendre des A400M, des bâtiments de la Marine nationale ou je ne sais quel autre outil militaire pour les louer ensuite. Mais à quel prix ? Quel sera le coût de location, pour le budget de la République, d’un matériel militaire qui, pour l’instant, nous coûte – si je puis dire, au titre de l’accès au marché pour l’État et pour la France – environ 1 % ou 1,5 % ?
Selon les premières indications qui me sont données par les industriels français, compte tenu des nécessités d’assurance – à la différence des sociétés de projet, qui devront faire appel à une société d’assurance, l’État est en effet son propre assureur –, compte tenu des coûts financiers divers et variés et compte tenu, enfin, de la rémunération du capital, le coût de la location du matériel s’élèvera autour de 9 % à 10 % par an et sera donc neuf fois plus cher que le coût d’un endettement supplémentaire.
Le financement de 2 milliards pour assurer l’équipement des armées à travers les sociétés de projet ne coûtera donc pas 1 % ou 1,5 % mais 8 %, 9 % ou 10 %.
Ce système est donc totalement invraisemblable et correspond purement et simplement à de la cavalerie budgétaire. Il consiste à ne pas assumer ce que nous devons faire : revoir la LPM et repenser notre format d’armée qui vit sur un mythe ou une idée qui, malheureusement, n’est plus d’actualité, selon lesquels nous serions encore une puissance militaire globale.
Or, au lieu de réfléchir à une nouvelle organisation de nos armées, nous avons procédé depuis des années, notamment ces dernières années, à leur réduction homothétique. Nous avons donc réduit le tout en accentuant progressivement les trous capacitaires.
Eh bien, je préférerais largement que nous reposions et refondions la LPM en nous interrogeant sur ce que la France peut financer !
Je ne ferai pas partie de ceux qui demanderont une augmentation du budget de la défense compte tenu de la situation de nos finances publiques. En revanche, nos armées doivent pouvoir construire un modèle tenable à partir du budget qui leur est alloué chaque année par la République française.
Cela repose sur deux idées simples.
Première idée : nous devons avoir le courage de dire que nous ne sommes plus une puissance militaire globale, nous ne sommes plus capables d’être une nation cadre…

Non, nous ne sommes plus une nation cadre. Nous ne sommes plus capables de mener une opération militaire seuls puisque même lorsque nous allons au Mali – une opération de 3 000 hommes –, nous sommes obligés de faire appel aux Américains et aux autres pour la mener !

Deuxième idée : nous devrions nous interroger aussi sur le niveau des crédits affectés au nucléaire. Nous continuons en effet à préserver deux composantes…

… alors que nous savons très bien que ce secteur requerra une augmentation de crédits de 15 % par an.
Lorsque l’on observe une courbe sur dix ans, le modèle d’armée auquel nous parvenons est invraisemblable puisque le nucléaire représentera près de 40 % des crédits d’équipement.
Il serait donc temps que le chef de l’État ait le courage de remettre à plat l’ensemble de l’organisation militaire de notre pays pour faire en sorte que nous puissions financer ce dont nous avons besoin, c’est-à-dire une armée conventionnelle capable d’intervenir en autonomie stratégique totale sur des opérations de type malien.

Si vous voulez voter un amendement qui coûtera une fortune au budget de la République, votez celui-ci !
Nous devrions avoir le courage de regarder les choses en face plutôt que de faire financer à prix d’or des ressources exceptionnelles que nous n’avons pas aujourd’hui.
Comme vous, je pense qu’il ne serait pas raisonnable de mettre des fréquences sur le marché lorsque nous ne pouvons pas en tirer le meilleur prix.
Lorsque j’étais au Gouvernement, j’ai quant à moi refusé de vendre des biens immobiliers lorsque le marché n’était pas porteur – malheureusement, depuis, il ne s’est pas redressé.
Je pense également que nous avons besoin de regarder les choses en face : plutôt que de rester figer sur une solution extrêmement coûteuse pour les finances publiques, repensons notre loi de programmation militaire afin d’éviter de tels mécanismes financiers qui, de toute évidence, ne tiennent pas la route.

Je vous remercie de votre réponse très précise, monsieur le ministre. Je note cependant deux incohérences dans vos propos.
Premièrement, vous nous expliquez que vous avez intégré la vente de ces fréquences dans l’exercice 2015 alors que vous saviez vous-même, avant la présentation de ce projet dans la loi de finances pour 2015, qu’elles ne seraient pas vendues en 2015.
Au-delà de la problématique technique, encore une fois, cela soulève ce vrai problème qu’est celui des ressources exceptionnelles. Il ne faut pas jouer comme cela avec une sorte de variable d’ajustement et avec un dispositif de financement qui ne fonctionne pas avant même que vous l’ayez présenté en conseil des ministres. Il faut nous répondre à ce propos, monsieur le ministre !

Notre collègue l’a dit lui-même : avant même que cela ne soit inscrit dans le PLF, l’ARCEP savait que ces fréquences de 700 MHz n’étaient pas vendables, ni en 2015 ni, très certainement, en 2016.
C’est la première incohérence que je voulais mettre en évidence et la grande faiblesse de la LPM, en particulier de cet exercice budgétaire de 2015.
Deuxième incohérence : vous dites que ces fréquences seront vendues au meilleur prix mais quid des participations de l’État ? Vous êtes obligés de les vendre puisque vous devez capitaliser les deux sociétés de projet à hauteur de 2,2 milliards et qu’il s’agira uniquement d’argent public. Vous êtes donc obligés de les vendre. À quel prix ? Au meilleur prix ? Non ! À celui que l’on voudra bien vous donner sous la contrainte. Voilà encore un témoignage de la faiblesse du dispositif des ressources exceptionnelles.
À la différence de notre collègue Hervé Morin, je voterai votre amendement, monsieur le ministre, parce qu’il faut explorer toutes les possibilités, mais je le ferai avec beaucoup d’interrogations. Or, aujourd’hui, malgré vos efforts, vous ne les avez pas levées.
Je vous remercie de la technicité de votre réponse mais je pense qu’il existe d’autres moyens de financer le budget de nos armées alors que, vous l’avez dit vous-même, elles sont extrêmement sollicitées – et ce n’est pas près de s’arrêter lorsque l’on écoute le ministre Le Drian.
J’ajoute que vous avez sans doute une bonne nouvelle à nous annoncer – peut-être pas ce soir, mais lundi – avec la vente des Rafale et des frégates FREMM aux Égyptiens. Voilà des ressources que je ne qualifierai pas d’exceptionnelles mais qui abonderont le budget de l’État.
Il faut en terminer avec ces ressources exceptionnelles. Au-delà du débat important que nous avons ce soir, je le dis devant la présidente de la commission de la défense, il faut que nous utilisions le trimestre de revoyure de la LPM pour en finir définitivement avec ces ressources exceptionnelles.

Je tiens tout d’abord à soulever un point de méthode. Nous nous apprêtons à décider un aménagement de la loi afin de permettre ces sociétés de projet, dont nous ne connaissons pas l’ensemble des contours.
Bien évidemment, comme nous l’avons toujours fait, et bien avant le vote de la LPM, les commissions de la défense et des finances vérifieront que ce que nous avons voté dans la LPM a été respecté.
La LPM est en effet composée de deux types de crédits : les crédits budgétaires habituels et les fameuses recettes exceptionnelles – qui ne sont d’ailleurs pas si exceptionnelles que cela puisqu’elles figuraient déjà dans la LPM précédente.

Comme vous le savez, monsieur Lamour – M. Morin le sait aussi –, ces recettes n’ont pas été obtenues en temps voulu mais en fin de gestion.
Notre défense et nos armées ont besoin d’équipements – puisque c’est la question qui se pose est celle de la fourniture des équipements, nous sommes tous d’accord sur ce point.
Je vous rappelle simplement quelques chiffres du rapport du 10 juillet 2013 de MM. Fromion et Rouillard. L’écart d’exécution de la LPM précédente s’élevait à 5,550 milliards. Pourquoi ? Tout simplement parce que les recettes exceptionnelles n’étaient pas au rendez-vous à la date prévue. Sur ce point, monsieur Lamour, je vous rejoins.
Je peux également donner un autre exemple. Dans la LPM précédente à celle que vous avez exécutée, monsieur Morin, vous avez hérité d’une « bosse » budgétaire de 4 milliards – je me souviens de vos propos du mois d’octobre 2008.

Absolument : 6 milliards par an. Voilà la réalité de nos deux précédentes lois de programmation militaire !
Compte tenu des mésaventures qu’ont connues ces deux lois de programmation militaire, la position du Président de la République, ainsi que du ministre de la défense et des commissions parlementaires concernées est claire : nous voulons que cette loi de programmation militaire soit appliquée à la lettre, et à l’euro près.

Sur ce point, je crois que nous sommes d’accord. Par conséquent, nous ne pouvons pas faire un autre choix, aujourd’hui, que de créer ces sociétés de projet. Il est vrai que ce n’est pas une solution orthodoxe du point de vue budgétaire…

…mais nous devons la tenter.
Permettez-moi aussi de faire un peu d’histoire. C’est l’amiral Jean-Louis Battet qui, en 2003, voulait acheter des FREMM en partenariat public-privé. La ministre de la défense de l’époque, Michèle Alliot-Marie, l’avait également envisagé, mais les arbitrages budgétaires n’avaient pas été en sa faveur et elle n’avait pu le faire.
Au bout du compte, que s’est-il passé ? On a fait comme d’habitude : on a réduit les cibles et on a augmenté le coût unitaire de chacun des bâtiments. Au bout du compte, on a eu moins de bâtiments, pour la même somme et pour le même investissement. Telle est la réalité de nos lois de programmation militaire et des décisions qui ont été prises par le passé. J’espère que nous ne reproduirons pas cela. En tout cas, nous nous donnons les moyens de ne pas le reproduire.
La société de projet est un plan de sécurisation de la loi de programmation militaire – je vous dis clairement les choses comme je les vois – qui permettra au ministre de la défense d’appliquer pleinement les décisions du Président de la République, du Livre blanc et de la loi de programmation militaire. Des conditions ont été posées, qui sont en partie énumérées dans le texte que nous examinons. Il faudra veiller à les respecter.
Nous exécuterons un contrôle sur pièces et sur place, en vertu du pouvoir que nous nous sommes donné dans la loi de programmation militaire. Je pense au maintien en conditions opérationnelles des matériels – MCO – qui doit être assuré par l’État…

… aux assurances, qui doivent, elles aussi, être gérées par l’État – je crois que nous sommes d’accord avec le ministre sur ce point. Je songe aussi à la formation des personnels, notamment pour les matériels nouveaux, et à la durée de ces sociétés de projet, lesquelles doivent selon moi être inscrites dans la durée, au maximum pour le temps de la loi de programmation militaire. À charge ensuite, pour le Parlement, de faire un bilan de ces sociétés de projet, si elles se constituent, et de voir s’il faut les reconduire – le Parlement est tout à fait libre de ne pas le faire.
Ce n’est donc pas un changement de modèle que nous proposons…

…mais bien un palliatif – c’est ainsi que je conçois les choses – qui permettra à la loi de programmation militaire d’être totalement tenue, et à l’euro près.
« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe SRC.

En tant que rapporteur spécial du budget opérationnel de la défense pour la commission des finances, je confirme que cet amendement relatif aux sociétés de projet est important, puisque c’est le seul moyen de respecter la loi de programmation militaire et son budget fixé à 31,4 milliards d’euros par an. Cet objectif a été confirmé par le Président de la République et il faut donc que ces 2,2 milliards d’euros soient dans les caisses de l’État dès le mois d’octobre, et donc que les sociétés de projet soient en état de fonctionnement dès le mois de juin.
J’ai rédigé un rapport sur la loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019. L’article 3 de cette loi de programmation prévoyait, pour l’année 2015, 1,77 milliard d’euros de recettes exceptionnelles. Depuis, ces montants ont augmenté de 500 millions d’euros, pour des raisons sur lesquelles je ne reviens pas. Les recettes exceptionnelles étaient bien ciblées et cernées : elles pouvaient être constituées de l’intégralité du produit de cessions d’emprises immobilières, de redevances versées par des opérateurs au titre des cessions de fréquences – tout cela a déjà été largement évoqué – ou d’un nouveau programme d’investissement d’avenir, option qui n’a pas été retenue.

J’ajoute que les ventes et les exportations ne sont pas intégrées dans la loi de programmation militaire comme une possibilité de recettes exceptionnelles, ce qui fait tomber l’argument des ventes que nous pourrions conclure la semaine prochaine avec l’Égypte ou d’autres pays, comme l’Inde ou le Qatar.
Le problème, c’est que certaines de ces recettes exceptionnelles, et notamment celles qui sont liées à la vente de bandes de fréquence, ne vont pas être au rendez-vous. Je voudrais signaler à Jean-François Lamour – et il s’en souvient très bien – que l’équilibre financier de la loi de programmation militaire pour les années 2009 à 2014 reposait déjà sur la vente de fréquences hertziennes, laquelle n’avait pas eu lieu à temps, puisque le calendrier prévu n’avait pas été respecté…

…si bien que la mission « Défense » n’avait pu bénéficier de ces ressources qu’à la fin de l’année 2011 – je pense notamment aux bandes RUBIS et FELIN.

Cela avait occasionné, monsieur Lamour, des décalages et des reports de programmes, au détriment de l’équipement des forces ou du maintien en condition opérationnelle de ces mêmes équipements. Compte tenu de l’engagement de nos forces en ce moment, un tel cas de figure ne peut être envisagé dans la loi de programmation actuelle. Avec la cession de la bande des 700 MHz, le ministère de la défense s’expose au même problème de non-respect du calendrier. Cette incertitude a d’ailleurs été confirmée par le rapport Charpin, qu’en tant que rapporteur spécial, et du fait de nos pouvoirs de contrôle, nous avons pu obtenir.
Cela conduit donc à revenir à la dernière hypothèse envisagée dans la loi de programmation militaire, à savoir, « le cas échéant, le produit de cessions additionnelles de participations d’entreprises publiques ». Nous y sommes, puisque c’est précisément par le mécanisme des sociétés de projet – M. le ministre l’a dit – que nous allons orienter les recettes de l’État liées à des cessions additionnelles de participations d’entreprises publiques, pour satisfaire cette clause prévue dans la loi de programmation militaire, et qui est parfois qualifiée de « clause de sauvegarde ».
Le vote de cet amendement est indispensable, en droit, pour permettre la mise en oeuvre des sociétés de projet. Dès lors que nous sommes convaincus, et je pense que nous le sommes tous, au fond de nous-mêmes, de la nécessité d’exécuter entièrement le budget de la défense, écarter cette hypothèse reviendrait à sortir de la trajectoire financière de la loi de programmation militaire, à reporter les programmes d’équipement des forces, à affaiblir l’activité des industriels ou à retarder les paiements à leur égard, à entamer le moral de nos soldats, qui font bloc avec leurs chefs…

…et qui font confiance au chef des armées sur cet engagement. Le ministre de la défense répète souvent : « La loi de programmation militaire, toute la loi de programmation militaire, rien que la loi de programmation militaire ».
En conclusion, et pour vous répondre, monsieur Hetzel, je suis allé écouter mardi, en commission des affaires étrangères, le chef d’état-major des armées, que vous avez évoqué tout à l’heure. Il a dit qu’il fallait passer par les sociétés de projet et qu’il n’y avait pas de plan B.
Exclamations sur les bancs des groupes UMP et UDI.

Comme l’a dit M. le ministre, si ce plan B existe, il est théorique et, en tout cas, il a été rejeté par le Président de la République lors du dernier Conseil de défense.
Monsieur Morin, la cavalerie budgétaire, ce serait d’accroître le report de charges, qui s’élève déjà à 2,5 milliards d’euros. Prétendre payer les commandes pour 2016, ce serait le porter à 5 milliards d’euros. Pour le coup, ce ne serait pas une bonne pratique au plan financier. Et cela reviendrait à ne pas respecter l’objectif des 31,4 milliards d’euros.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SRC.

La gymnastique financière, en matière de défense, n’est pas nouvelle, effectivement. Ainsi qu’a pu le dire Mme Adam, on a connu la période où l’on poussait la bosse budgétaire et où la ministre, Mme Alliot-Marie, cherchait toutes les solutions possibles pour essayer de financer la loi de programmation, sans parvenir à le faire.

…et on peut espérer qu’il ne s’agit là que d’une solution transitoire. En tous les cas, c’est une façon de respecter totalement la loi de programmation militaire, de la sanctuariser, de la respecter, de la valider, de faire en sorte qu’elle ne fasse plus l’objet d’aucune discussion.
Néanmoins, cela ne doit pas nous dispenser d’une réflexion sur la loi de programmation militaire…

…et sur les moyens financiers nécessaires pour arriver à faire une loi de programmation militaire qui respecte la signature qu’a apposée le chef de l’État lors du sommet de l’OTAN au Pays de Galles au mois de septembre 2014. Il a alors validé le fait que les vingt-huit pays de l’OTAN devaient très rapidement consacrer 2 % de leur PIB au budget de la défense…

…et 20 % de celui-ci à la recherche et développement et aux investissements.
Or, si l’on consacre bien 20 % de nos dépenses militaires à la recherche et développement et aux investissements, en revanche, on ne respecte pas, à l’heure actuelle, la règle relative aux 2 % du PIB. Il faut donc, lors du vote de la prochaine loi de programmation militaire, que nous nous donnions pour objectif de respecter l’engagement pris par le chef de l’État lors du sommet du Pays de Galles. Nous devons faire les efforts financiers nécessaires, parce qu’il ne suffit pas de dire que l’on est en guerre contre le djihadisme, il faut aussi s’en donner les moyens…

…et donner les moyens à nos militaires d’intervenir comme ils le font avec brio, non seulement sur notre flanc sud, mais aussi sur le flanc est, où de nouvelles menaces pèsent désormais.
« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe SRC.
Le sous-amendement no 3181 est adopté.
L’amendement no 2812 rectifié , sous-amendé, est adopté.

Prochaine séance, ce soir, à vingt-deux heures :
Suite de la discussion du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
La séance est levée.
La séance est levée à vingt heures vingt-cinq.
La Directrice du service du compte rendu de la séance
de l’Assemblée nationale
Catherine Joly