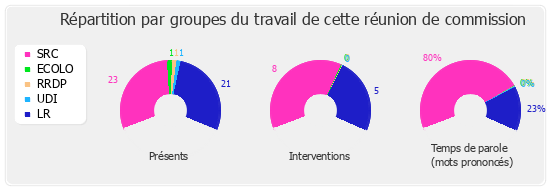Commission des affaires étrangères
Réunion du 16 décembre 2015 à 9h30
La réunion
– Examen de la proposition de résolution relative au Conseil européen des 17 et 18 décembre 2015
Audition de M. Didier Chabert, sous-directeur Moyen-Orient au ministère des affaires étrangères et du développement international, sur la situation du Yémen.
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Monsieur Chabert, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour évoquer la dramatique situation du Yémen. Cette réunion se déroule à huis clos, nos échanges seront donc aussi libres que possible.
Le 26 mars dernier, l'Arabie saoudite a pris la tête de l'opération « Tempête décisive » au Yémen, à laquelle participe une coalition de pays arabes : les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar, l'Égypte, le Maroc, la Jordanie, le Soudan et le Pakistan. Cette coalition a bombardé les positions des milices houthistes qui s'étaient emparées de la capitale Sanaa en septembre 2014, avaient renversé le président Hadi et progressaient vers le sud et le port d'Aden.
Or neuf mois après le début de l'opération, la situation est particulièrement alarmante, sur tous les plans. Sur le plan humanitaire, le conflit a fait depuis son déclenchement près de 6 000 morts et 28 000 blessés, principalement des civils. L'ampleur des destructions est considérable, alors que le pays figure déjà parmi les plus pauvres au monde. Vous nous direz comment la France participe à l'assistance humanitaire qui doit être apportée aux 21 millions de personnes qui, selon l'ONU, en ont un besoin urgent.
Au point de vue militaire et politique, le rapport de forces sur le terrain ne semble pas s'être rééquilibré au profit des soutiens du président Hadi. Les Houthis, alliés à l'ancien président Saleh, ont mené une contre-offensive dans le sud du pays en novembre. Aucun camp ne semble en mesure de l'emporter, et comme en Libye, ce sont les groupes terroristes qui en sont les premiers bénéficiaires. Nous serons particulièrement attentifs à ce que vous nous direz d'al-Qaida dans la péninsule arabique (AQPA), qui combat les Houthis et consolide son assise territoriale, tandis que les attentats revendiqués par Daech se multiplient.
Hier ont débuté en Suisse des pourparlers entre les parties au conflit, en vue de définir un plan de sortie de crise et à mettre en oeuvre la résolution 2216 du Conseil de sécurité. Ils s'accompagnent d'un cessez-le-feu de sept jours. Ces pourparlers ont-ils, selon vous, quelque chance d'aboutir là où les précédentes tentatives ont échoué ?
La crise yéménite semble se polariser selon une logique binaire Nord-Sud qui pourrait menacer l'intégrité du pays, mais surtout – et c'est le plus dangereux – selon une logique confessionnelle opposant chiites et sunnites. Aussi serons-nous particulièrement attentifs à ce que vous pourrez nous dire du rôle des puissances régionales, plus particulièrement de l'Arabie saoudite et de l'Iran. La rivalité qui les oppose ne risque-t-elle pas d'accentuer la polarisation confessionnelle du conflit ? Quel crédit accordez-vous à ceux qui accusent les houthistes d'être instrumentalisés par l'Iran ?
La crise yéménite est complexe, comme l'est ce pays. Peuplé de vingt-deux à vingt-six millions d'habitants – 40 à 50 % de la population de la péninsule arabique –, il représente un enjeu important pour la stabilité régionale.
Pour comprendre la situation actuelle, il faut remonter à la crise profonde qui a marqué la fin de la période du président Saleh. Celui-ci a pris le pouvoir en 1978, au moment de la partition du pays qu'il a ensuite mené à la réunification. Son régime, fortement présidentialisé et marqué par l'emprise des services de sécurité sur le pays, a subi l'usure du pouvoir pour tomber victime du « printemps arabe ». En 2011, une série de manifestations ont secoué le pays, conduisant à un moment de forte instabilité ; la crise a été résolue grâce à une initiative du Conseil de coopération du Golfe (CCG), dite « initiative du Golfe », qui a imposé une solution de compromis reposant d'une part sur l'éviction du président Saleh, et d'autre part, sur la mise en oeuvre d'une transition politique. Celle-ci devait être conduite par le vice-président Hadi et amener à une révision constitutionnelle, puis à un processus électoral permettant d'élire un nouveau parlement et un nouveau président. Le président Hadi a été élu avec sept millions et demi de voix ; ce score flatteur doit être relativisé dans la mesure où il s'agissait du seul candidat, mais le processus de transition a indéniablement bénéficié du soutien de la population yéménite, ainsi que d'un appui régional et international. S'est ainsi créé un groupe de soutien animé par les pays du Golfe à l'initiative de cette transition, et un groupe appelé le G10 qui réunissait, aux côtés des pays du Golfe, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, mais aussi l'Allemagne et l'Union européenne. Le soutien international s'est notamment appuyé sur un groupe de donateurs co-piloté par l'Arabie saoudite et le Royaume-Uni, qui cherchait à renforcer la transition politique par un projet de développement économique. Un ensemble cohérent de mesures s'est ainsi mis en place en 2011, avec une vraie logique devant conduire à la stabilisation du pays autour d'institutions démocratiques.
Dans un premier temps, la solution semblait fonctionner : les discussions politiques ont été lancées sous l'égide des Nations unies et les principaux acteurs du processus ont commencé par jouer le jeu. Il s'agissait tout d'abord des autorités légitimes : les structures étatiques dirigées depuis 2011 par le président Hadi et le gouvernement formé sous son autorité. Les Houthis – deuxième grand acteur, à l'origine de la crise récente – sont les adeptes d'une variante du chiisme qui ne reconnaît que cinq imams, là où les chiites iraniens en reconnaissent douze, et qui refuse l'imam caché. Jusqu'à une période récente, leur doctrine et leurs pratiques religieuses se rapprochaient bien plus de celles des sunnites. Tous les chercheurs qui ont travaillé sur le Yémen le notent : il n'était pas rare, il y a quinze ans, de voir des Houthis prier dans des mosquées sunnites, et inversement – une situation impensable ailleurs. La pratique religieuse au Yémen était peu différenciée et le pays apparaissait comme un espace relativement apaisé sur le plan religieux. L'ancien président Saleh était le troisième acteur d'une transition politique qui reposait en grande partie sur son éviction. En 2011, il était au pouvoir depuis près de vingt-cinq ans et apparaissait en décalage avec les aspirations de la nation ; il avait été ciblé par la population, et notamment par la jeunesse. Mais il avait eu le temps et la volonté d'imprimer sa marque sur les services de sécurité et les principales unités de l'armée, qui étaient entièrement sous son contrôle. Or la transition politique a commis une erreur majeure : elle n'a pas imposé le départ de l'ancien président du Yémen. Il a été destitué, mais est resté au pays, conservant le contrôle sur les appareils de sécurité et sur les unités les plus efficaces de l'armée. Saleh était donc un acteur censé être marginalisé sur le plan politique, mais incontournable sur le plan sécuritaire. Un autre acteur est essentiel pour notre sécurité et pour les intérêts français au Yémen : AQPA, groupe terroriste bien implanté dans le pays. Jusqu'à une période récente, la principale base territoriale d'al-Qaïda se trouvait au Yémen ; depuis la crise qui s'est ouverte il y a plus d'un an, al-Qaïda a consolidé ses positions dans un contexte de chaos et de guerre civile, étendant son jeu d'alliances et son emprise territoriale. Il existe enfin un cinquième acteur, très récent et encore marginal, mais qui s'impose par l'aspect spectaculaire de son action : Daech, qui a commis des attentats d'une violence extrême à Sanaa, Aden et Ta'izz. Aujourd'hui, l'État islamique essaie de s'implanter au Yémen et y possède des cellules actives ; mais il n'y contrôle pas encore de territoires.
Ce tableau déjà sombre s'est encore dégradé à partir de l'automne 2014 sous l'effet d'une crise provoquée par des Houthis qui ont brutalement renversé le gouvernement du président Hadi. Les Houthis portent la plus grande, mais non l'entière responsabilité dans la crise actuelle au Yémen. Le centre de leur pouvoir politique et religieux se trouve dans la région de Sa'dah, où ils disposent d'une base tribale extrêmement forte. À partir de 2012, des madrasas salafistes dont les liens avec al-Qaïda deviennent vite évidents se sont implantés dans ce sanctuaire houthi. À partir de 2013, les Houthis ont décidé de les liquider, balayant les salafistes et les unités d'al-Qaïda qui cherchaient à s'implanter dans le Nord, ainsi que les tribus qui soutenaient cette pénétration. Les Houthis se sont soudain aperçus qu'ils étaient capables, militairement, d'imposer leur loi dans le nord du pays. Ils en ont profité pour nettoyer les abords de leur sanctuaire. Lorsqu'il ne restait plus rien pour s'opposer à l'avancée de la force militaire houthie sur Sanaa, les négociations politiques sur la transition ont été interrompues : estimant que le pouvoir leur tendait les bras, les Houthis ont renversé le gouvernement. Ce coup d'État repose sur d'importantes raisons politiques, mais les erreurs d'appréciation commises par le président Hadi ne le justifient pas. Ensuite, les Houthis ont glissé sur le plan incliné de la victoire : ayant pris Sanaa – une ville d'un million et demi d'habitants – en trois jours et quasiment sans pertes, ils sont descendus vers le sud. En quelques semaines et sans difficultés, ils sont arrivés à Ta'izz, la troisième ville du pays ; ils l'ont occupée, puis ont continué vers Aden. Celle-ci était sur le point de tomber quand l'Arabie saoudite a pris la décision de monter la coalition – une décision à laquelle personne ne s'attendait. Pour prévenir la prise de contrôle totale du Yémen par les Houthis – hors territoires aux mains d'al-Qaïda –, elle a essayé de fédérer une palette très large de pays sunnites autour du président Hadi, que l'Arabie saoudite et la communauté internationale considèrent comme l'autorité légitime du pays. Cette coalition – qui a réussi à bloquer l'avancée houthie, à reprendre Aden et à progresser – se distingue par son aspect hétéroclite. En effet, l'Arabie saoudite a réussi à obtenir le soutien de pays aussi différents que la Turquie, l'Égypte, le Pakistan ou le Qatar, dont certains entretiennent avec elle des relations problématiques. Peu d'entre eux ont réellement participé aux opérations au Yémen ; les Égyptiens se sont ainsi montrés très réticents à envoyer des troupes au sol et l'aide du Qatar a été marginale. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont été les deux piliers de l'intervention : les Saoudiens ont agi sur mer et dans les airs, et les Émirats seuls se sont engagés de manière concrète et efficace au sol.
Une guerre civile est toujours tragique, surtout dans un pays aussi morcelé et aussi pauvre que le Yémen, qui n'a pas achevé sa gestation politique. Sur le terrain, la situation ne s'est pas clarifiée. La ligne de front s'est aujourd'hui à peu près stabilisée, reproduisant curieusement, à peu de choses près, l'ancienne division Nord-Sud. La coalition n'arrive plus à progresser, voire recule légèrement ; le temps est donc venu de négocier. Dès le début du conflit, nous avons défendu la position que porte aujourd'hui la résolution 2216. Celle-ci affirme le principe de soutien aux autorités légitimes du Yémen, les seules à avoir été élues – le président Hadi – et la nécessité de déposer les armes et d'évacuer les territoires occupés. Elle pointe du doigt la responsabilité houthie dans la crise, mais appelle également à un dialogue politique inclusif et à un effort de réconciliation nationale. Nos amis du Golfe doivent comprendre qu'il faut associer les Houthis à la recherche d'une issue politique au conflit. Quoi qu'on pense du rôle qu'ils ont joué dans le déclenchement de la crise, s'ils sont aujourd'hui un élément majeur du problème, ils doivent également être un élément de la solution de demain. Les négociations se sont formellement ouvertes hier et vont vraiment démarrer aujourd'hui, à Bienne, près de Bern. Il s'agit de négociations de la dernière chance car il n'y a ni plan B, ni plan C. Il y a quelques mois, l'envoyé spécial des Nations unies, Ismail Ould Cheikh Ahmed, avait déjà tenté de lancer une première série de négociations à Genève ; son échec a laissé des traces dans les relations entre les protagonistes et a fragilisé la crédibilité de l'envoyé spécial. Si les négociations qui reprennent après des mois de tractation échouent à nouveau, il faudra des mois pour être en mesure de proposer une nouvelle phase de dialogue.
Ce conflit militaire a des implications humanitaires importantes. La crise alimentaire n'a pas été aussi aiguë qu'on l'avait craint, mais la guerre met à mal le fonctionnement des hôpitaux et des écoles, et l'approvisionnement des services publics. Se profile une vraie catastrophe humanitaire qui touche, selon les estimations, entre trois et huit millions de yéménites. Il faut mettre un terme à cette situation. Le Yémen est situé dans une région fondamentalement instable, traversée de crises multiples aux implications stratégiques majeures pour la France : l'Irak, la Syrie, les tensions croissantes entre le monde sunnite et le monde chiite. Dans ce contexte, il est important de résoudre la crise yéménite car nous n'avons aucun intérêt à maintenir un sujet de discorde supplémentaire entre l'Arabie saoudite et l'Iran, ni à voir la sanctuarisation des bases territoriales d'al-Qaïda, ni à laisser l'État islamique s'implanter dans un nouveau pays, y créant des bases supplémentaires.
Dans la mesure où l'on ne voit pas d'issue militaire au conflit, la situation apparaît assez sombre ; mais les négociations en Suisse font naître l'espoir d'aboutir à une solution politique. En effet, de 2012 à 2014, le dialogue politique a réellement existé au Yémen : toutes les parties – Houthis, al-Islah, les partisans d'Hadi et de Saleh – étaient assises à la table, et toutes ont entériné les conclusions de la conférence de dialogue national. Le processus de transition politique a fonctionné jusqu'en 2014. Pour y revenir, il faut comprendre ce qui l'a fait dérailler, donc se pencher sur les motivations politiques des acteurs qui ont conduit à l'échec du processus. Il faut notamment comprendre les attentes des Houthis. Depuis le début des négociations, un cessez-le-feu a été décrété pour une période de sept jours, tacitement renouvelable s'il est bien respecté par les parties. Mais nous sommes au début d'un long chemin, car un cessez-le-feu doit s'accompagner de mesures de confiance et de garanties de sécurité. Le dialogue politique sous l'égide de l'envoyé spécial des Nations unies est indispensable, mais il faut avoir conscience que ce processus va durer des mois. Il faut traiter toute une série de points politiques : la Constitution, le calendrier électoral, la reconduction ou non du président Hadi. Celui-ci a beau avoir été élu avec des scores extraordinaires, son mandat est arrivé à échéance en août 2014 et il faut résoudre ce problème constitutionnel. Il faut surtout comprendre les intérêts des Houthis et les raisons qui peuvent les amener à abandonner le pouvoir et à renoncer à la force armée. Il faut réfléchir au partage des ressources, au découpage des régions, à l'équilibre entre pouvoir central et fédéral. Ces questions techniques et pointues ne seront pas résolues pendant cette semaine de négociations en Suisse. Si elle permet simplement de rétablir le contact et d'identifier les sujets sur lesquels il faudra travailler, sur le plan intérieur, pour arriver à un gouvernement de réconciliation nationale, ce sera déjà très positif.

Il est un aspect du problème que vous n'avez que peu abordé : la guerre par procuration que se livrent les Saoudiens et les Iraniens à l'occasion du conflit yéménite. Pouvez-vous nous éclairer sur le rôle de l'Iran par rapport aux Houthis ? On entend à ce propos des choses contradictoires.
L'intervention militaire saoudienne, avec ses bombardements massifs et brutaux, a créé une situation humaine terrible – vingt millions de personnes n'ont plus rien à manger ni à boire – et un terrain d'atterrissage pour Daech. Or la France n'a pas exprimé de position claire sur le sujet. Les liens entre la France et l'Arabie saoudite se sont considérablement renforcés ces derniers mois, au fil des contrats d'armement. Est-ce la bonne politique à mener ? Cette intervention saoudienne est-elle positive ? Ou au contraire, ne faudrait-il pas éviter ces guerres par procuration entre chiites et sunnites, qui enflamment la région et favorisent le développement du terrorisme qui vient ensuite nous frapper ? Après la Syrie, le Yémen et la Libye sont les cibles des organisations terroristes qui cherchent à créer une situation de guerre civile en Europe. C'est dans ce contexte qu'il faut penser notre politique à l'égard de l'Arabie saoudite et de l'Iran. Or la ligne défendue par notre pays semble loin d'être visionnaire ; les contrats d'armement auxquels se limite notre politique sont utiles à court terme, mais plutôt que de régler le problème, ils risquent au contraire de l'aggraver.

L'Iran se dit favorable à la paix, mais son attitude envers les Houthis est problématique.
L'Arabie saoudite a annoncé la coordination de trente-quatre – et bientôt quarante-quatre – pays sunnites, de l'ouest de l'Afrique jusqu'au Moyen-Orient. Cette alliance sunnite peut-elle être efficace dans le conflit yéménite ?

L'Iran représente le point central du tableau. La dernière fois que nous vous avons entendu, vous avez souligné que la crise yéménite représentait, pour ce pays, une aubaine : il avait intellectuellement soutenu la rébellion houthie, mais son engagement militaire était resté congru. L'Iran conserve-t-il toujours cette attitude ? Il ne faudrait pas tomber dans le piège de la propagande saoudienne qui dénonce la volonté d'hégémonie de l'Iran.
Le Yémen est à l'origine formé à partir de deux États distincts ; la résolution du conflit ne peut-elle pas passer par un retour à cette partition ? L'opposition entre le Nord et le Sud semble sempiternelle et structurelle.
Enfin, je m'interroge sur l'attitude de la France ; pouvez-vous l'expliciter ? Vous avez souligné que nous souhaitions une négociation et que les pourparlers en cours représentaient une dernière chance ; mais notre ambassadeur au Yémen et son attaché militaire, rapatriés à Ryad, se posent des questions sur la position de l'Arabie saoudite. La France doit-elle suivre celle-ci sur ce dossier ou s'en départir ?

Vous avez mentionné la nécessité d'associer les Houthis au dénouement de la crise. Pouvez-vous développer les pistes que vous avez évoquées ?
S'agissant de l'implication de l'Iran aux côtés des Houthis, quelques experts du Hezbollah sont venus à Sa'dah leur apporter des conseils, en amont de la crise. Mais nous n'avons jamais eu vent d'un véritable soutien militaire. En 2013, un cargo a été intercepté au large du Yémen, portant des armes en provenance de l'Iran ; mais il n'a jamais été établi que ces armes étaient destinées au Yémen. Elles étaient probablement acheminées vers la corne de l'Afrique, notamment la Somalie. Il y a eu des soupçons, mais jamais aucune certitude. Globalement, nous n'avons noté aucun signe d'un engagement fort de l'Iran aux côtés des Houthis. Jusqu'au moment où ceux-ci ont pris Sanaa, il s'agissait pour l'Iran d'un théâtre périphérique ; à partir de cet événement, l'Iran, notamment par la bouche de M. Velayati, a développé une rhétorique consistant à dire qu'il contrôlait désormais quatre capitales arabes – un discours exceptionnel pour calmer les tensions dans la région… Depuis, nous n'avons pas noté davantage de signes d'un engagement effectif de l'Iran aux côtés des Houthis, comme en Irak où le général Soleimani parade toutes les semaines, ou en Syrie. L'Iran a semblé tester l'Arabie saoudite sur le Yémen : un avion de Mahan Air a été contraint de faire demi-tour parce que les avions de la coalition ne l'ont pas laissé atterrir à Sanaa. Un cargo destiné au port d'Hodeïda a lui aussi préféré rebrousser chemin. Mais les Iraniens n'ont pas insisté. Pour eux, il s'agit d'un effet d'aubaine : avec un investissement minime, ils ont désormais une épine forte dans le pied de l'Arabie saoudite.
Peut-on dire que l'intervention de l'Arabie saoudite a produit des effets pires encore que la prise de contrôle du pays par les Houthis ? C'est une vraie question : une guerre a forcément des effets terribles pour la population, mais l'avancée des Houthis jusqu'à Aden a provoqué le délitement des institutions d'État, notamment des unités militaires loyalistes localisées dans l'est du pays, qui contenaient la poussée d'al-Qaïda. Selon nos informations, ces unités, qui ont pendant des années bloqué al-Qaïda dans les recoins de l'Hadramaout, ont donné leurs armes aux tribus locales et sont parties. L'armée étant en train d'exploser face aux Houthis, ils n'avaient pas envie de mourir pour rien. Les tribus locales ont dû choisir entre les Houthis – mais les tribus sunnites de l'Hadramaout n'avaient aucune envie de les rallier – et al-Qaïda. En constatant la poussée d'al-Qaïda le long de la côté – l'organisation a pris le port important d'Al Moukallâ –, nous avons eu le sentiment que le pays allait être partagé entre les Houthis et les terroristes, sans aucune force intermédiaire. La coalition a bloqué l'avancée des Houthis et a repris Aden ; l'action et l'argent saoudiens ont permis de récupérer des tribus qui étaient sur le point de faire allégeance à al-Qaïda, notamment dans la région centrale de Ma'rib – très importante car très peuplée et abritant les champs pétroliers. Alors qu'elles appelaient al-Qaïda à l'aide pour tenir face aux Houthis, l'arrivée des Saoudiens et des Émiriens a changé la donne, remettant en scène les forces yéménites loyales au président Hadi et à son gouvernement. On ne sait pas si cette loyauté est durable ou si elle tient aux soldes versées par les Saoudiens ; mais aujourd'hui, il y a de nouveau une alternative aux Houthis et à al-Qaïda. Au début de l'intervention, al-Qaïda avait cessé de progresser, mais depuis que la coalition connaît de nouvelles difficultés, elle a repris du terrain, prenant notamment les villes de Dja'âr et de Zinjibar, sur la côte au nord-est d'Aden, qu'elle n'avait pas occupées auparavant. Il faut trouver un accord politique car tant qu'il n'y en aura pas, les forces houthies et celles de la coalition se battront entre elles et ne combattront pas al-Qaïda. Tant que la guerre se poursuit, le terrorisme va prospérer au Yémen.
La France a fait les choix qui s'imposaient à la communauté internationale, exprimés de manière claire et lisible dans la résolution 2216. Équilibrée, cette résolution rappelle la responsabilité première des Houthis dans la crise actuelle et souligne qu'ils devront rendre leurs armes lourdes et libérer la capitale pour que le gouvernement puisse y revenir. Mais elle prévient aussi les pays du Golfe, avec lesquels nous entretenons des relations d'amitié, qu'il ne faut pas jeter les Houthis dans les bras de l'Iran. Il faut considérer cette crise comme interne au Yémen : moins il y aura d'acteurs extérieurs qui s'impliqueront, plus on laissera les parties yéménites discuter entre elles de l'avenir du Yémen, et plus le processus aura de chances de réussir. Pour cela, il faut que les Houthis fassent partie de la solution, tout comme ils font aujourd'hui partie du problème. En effet, même s'ils sont vaincus militairement – ce qui est loin d'être le cas –, les zaïdites représentent tout de même 40 % de la population yéménite. Certes, les Houtis en tant que tels ne pèsent que 20 à 25 %, mais les autres zaïdites ont des affinités avec leur cause. Il faudra donc prendre en compte leurs préoccupations d'une manière ou d'une autre. La résolution 2216, dans laquelle nous avons joué un rôle actif, me paraît refléter cet équilibre qui doit être celui de la France. Nous avons soutenu les autorités légitimes du Yémen car on ne peut pas voir un pays basculer dans le chaos, comme la Somalie ou l'Afghanistan : plus d'autorités légitimes, un morcellement tribal, cent ou deux cents acteurs sans aucune cohérence… L'idée de bâtir autour du président Hadi a fait consensus au sein de la communauté internationale, tout comme celle de ne pas le laisser s'enfermer dans une logique guerrière et dans la croyance qu'il pourra reprendre le pouvoir par les armes. Tout en le soutenant, nous essayons de l'orienter vers une solution politique. Notre position m'apparaît donc très équilibrée.
En ce qui concerne l'aspect humanitaire de la crise, il y a eu un moment d'extrême inquiétude car le Yémen est un pays difficile d'accès. Il est impossible de passer par l'Oman car le territoire de l'autre côté de la frontière est tenu par al-Qaïda, et la frontière saoudienne est le théâtre de combats avec les Houthis. Seuls les ports semblaient adaptés pour acheminer l'aide humanitaire. Celui d'Aden est resté pendant longtemps bloqué, les Houthis n'en ont été chassés qu'après plusieurs mois de combats violents. Or on ne fait pas arriver des cargos d'aide humanitaire dans un port soumis à des bombardements constants ! Les agences humanitaires, qui avaient installé leur base logistique à Djibouti, devaient trouver des points d'entrée. Aujourd'hui, le port d'Aden est à peu près sécurisé et elles peuvent y travailler ; un accord implicite a été trouvé pour que l'aide qui entre par ce port ne serve pas uniquement les zones sous contrôle de la coalition, mais puisse accéder au Nord, et celle qui entre par le port d'Hodeïda, contrôlé par les Houthis, puisse être diffusée dans les zones aux mains de la coalition. L'aide humanitaire est aujourd'hui rétablie. Dans ce dossier, nous avons joué un rôle de médiateur : le contact entre la coalition et les agences des Nations unies qui pilotent l'aide humanitaire au Yémen – le Haut Commissariat aux réfugiés (HCR), le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) – étant très difficile, nous avons utilisé nos bonnes relations avec l'Arabie saoudite pour aider au rétablissement de la coordination.
Quel est le bilan de l'action de la coalition ? Dans cette guerre, comme dans tout conflit, les responsabilités sont partagées. Les trois à six mille morts, dont beaucoup de civils, ont été causés par les bombardements de la coalition, mais aussi par les obus et les missiles tirés par les Houthis et par les forces de Saleh. Malheureusement, la guerre tue et l'objectif est d'y mettre un terme le plus vite possible. Il est difficile de pointer du doigt un camp plutôt qu'un autre ; l'imbrication des civils et des combattants explique que certaines frappes de la coalition aient atteint des écoles ou des bâtiments civils dans les zones tenues par les Houthis. Je n'ai malheureusement aucun doute que les Houthis ont installé des centres de commandement dans des zones qu'ils savaient jouxter des bâtiments civils. Cette guerre est compliquée ; si l'on veut arriver à une solution, il ne faut à ce stade diaboliser personne. Quand le conflit sera terminé, la justice devra faire son oeuvre. L'impunité est exclue pour les crimes commis dans le cadre de cette guerre ; mais il y a un temps pour la recherche de la paix et un temps pour les poursuites pénales. Aujourd'hui, la priorité nous semble de promouvoir le dialogue politique.

Il me semble contradictoire de prôner un dialogue interne tout en prenant parti de fait pour une coalition externe. Nous approuvons l'intervention de l'Arabie saoudite en faveur de l'autorité légitime, mais il s'agit d'une puissance extérieure qui s'appuie sur une coalition de pays étrangers. Loin de moi l'idée d'absoudre l'une ou l'autre des parties de ses responsabilités dans la décomposition du pays, mais les logiques qu'elles suivent sont différentes. D'un côté – l'attitude réservée de l'Iran le confirme –, il s'agit d'une logique interne, proprement yéménite, où 40 % de la population demandent l'accès aux pouvoirs, aux ressources, aux richesses et aux postes de commandement et de décision du pays, dont ils étaient exclus. De l'autre, il y a une ambiguïté bien plus inquiétante : la coalition de puissances étrangères soutient un président légitime, mais qui ne tient qu'à un fil, et s'appuie sur des tribus capables de changer d'allégeance selon le montant du chèque – vivier potentiel du terrorisme d'al-Qaïda. La situation est complexe et ce n'est sans doute pas à la France d'y trouver la solution. Je suis convaincu de la nécessité, via un processus qui commence à Bern et qu'il faudra prolonger, de trouver les modalités d'un règlement politique interne. Mais je voulais attirer l'attention sur cette contradiction.
Vous avez raison. Cependant aux yeux du droit international, l'action de la coalition au Yémen est parfaitement justifiée. La base juridique est la même que celle de la coalition internationale en Irak : une lettre d'invitation des autorités légitimes à intervenir sur le territoire national. On peut penser tout ce qu'on veut du président Hadi et du rôle de l'Arabie saoudite, mais sur le plan de la stricte légalité internationale, la coalition n'a été contestée ni par le secrétaire général des Nations unies, ni par le Conseil de sécurité, ni dans la résolution 2216.
Si la coalition n'était pas intervenue, le jeu était fait : les Houthis auraient pris le contrôle du pays. Or ils ne représentent que 40 % de la population et n'auraient jamais tenu au pouvoir. Le pays était en train de sombrer dans le chaos, on voyait se réveiller les luttes tribales – notamment dans la région de Ma'rib. Pour toute une partie du pays, il n'était pas question d'admettre la domination des Houthis. Vraisemblablement, c'est la maladresse du président Hadi et de l'ancien envoyé spécial de l'ONU, Jamal Benomar, qui a fait sortir les Houthis de leurs gonds. Ils avaient participé à la conférence de dialogue national et en avaient approuvé les conclusions ; un comité de rédaction travaillait à une Constitution. Mais le choix du dessin des régions par le président a fait basculer la situation, la région donnée aux Houthis ne leur donnant accès ni à la mer ni aux ressources. C'est pourquoi il est important de réfléchir à ce qu'on peut leur proposer en matière de régionalisation, de partage des ressources et de postes au gouvernement. Ils étaient invités dans le gouvernement de réconciliation nationale, mais il faut considérer les postes qu'ils souhaitent avoir et la manière dont ils veulent être représentés dans les institutions. Il faut également leur donner les garanties de sécurité : s'ils lâchent leurs armes lourdes, quittent la capitale et rentrent dans le Nord, quelle garantie auront-ils qu'une fois que le gouvernement légitime sera revenu à Sanaa et aura reconstitué l'armée, il n'ira pas leur faire la peau grâce aux financements saoudiens ? Ils doivent donc bénéficier de mesures de confiance. Le partage des institutions et des territoires doit être clair et donner satisfaction à tout le monde, notamment aux Houthis. C'est pourquoi le processus ne peut qu'être long car il s'agit de parler du partage des régions, d'association au pouvoir et de lois électorales dans un pays ravagé aux intérêts multiples. Tout ne pourra pas être résolu en quelques jours à Genève ; il faudra mettre en place des groupes de travail et organiser une discussion interne au pays. Il faut identifier les éléments qui ont fait dérailler le train, alors qu'on avait le sentiment que les choses avançaient dans la bonne direction. On voyait bien que le président Hadi essayait de faire glisser le calendrier électoral pour rester six mois de plus au pouvoir ; mais ces petits jeux n'étaient pas dramatiques. Les solutions semblaient se mettre en place lorsque, tout d'un coup, la table a été renversée : pourquoi ? Pendant deux ans et demi, les yéménites ont été capables de discuter de manière productive ; il faut revenir à cette situation.
Information relative à la commission.
Au cours de sa réunion du mercredi 16 décembre 2015 à 9h30, la commission des affaires étrangères a nommé :
– Mme Chantal Guittet, rapporteure sur la proposition de résolution relative au Conseil européen des 17 et 18 décembre 2015 (sous réserve de son adoption par la commission des affaires européennes).
Examen de la proposition de résolution relative au Conseil européen des 17 et 18 décembre 2015 (sous réserve de son adoption par la commission des affaires européennes).

Nous allons procéder maintenant à l'examen de la proposition de résolution relatives au Conseil européenne des 17 et 18 décembre 2015, celle-ci ayant été adoptée par le mardi 15 décembre par la commission des affaires européennes.

La commission des affaires étrangères suit avec une grande attention les sujets européens, notamment en amont des Conseils. Mais s'il a semblé utile de rapporter cette proposition de résolution relative au Conseil européen qui se tiendra demain et après-demain, c'est que celui-ci traitera de sujets qui ont mobilisé notre commission au cours des dernières semaines.
La proposition de résolution déposée par Philippe Cordery et adoptée hier par la commission des affaires européennes regroupe des positions fortes que l'Assemblée nationale a déjà eu l'occasion d'exprimer dans un texte unique, clair et précis. Tout en réaffirmant l'importance de l'échelon européen pour affronter notre monde, elle pointe les mesures opérationnelles qu'il convient de prendre pour que l'Europe nous protège : sécurité des citoyens par la lutte contre le terrorisme, accueil des réfugiés demandant asile et protection, maîtrise des flux migratoires économiques et efficacité de la construction économique et monétaire.
La résolution invite à saisir les négociations en cours avec le Royaume-Uni comme une opportunité de redéfinir les ambitions et les moyens de l'Union économique et monétaire et de l'espace de justice et de sécurité pour mettre en pratique, de manière intelligente, l'Europe différenciée qui est la seule forme d'Union européenne possible. Elle suggère que, dans ce cadre, la Commission européenne remette d'ici le mois d'octobre 2016 trois rapports évaluant les coûts économiques et sociaux de la suppression de l'espace Schengen, de la zone Euro et des actions communes en matière de défense, pour faire émerger des propositions en vue d'un approfondissement dans ces trois domaines, auxquels la résolution consacre l'essentiel de ses points.
En matière de lutte contre le terrorisme, nous devons trouver des réponses efficaces sans remettre en cause les valeurs démocratiques, alors que les menaces sont multiformes et difficiles à appréhender, comme le montre la propagande radicale via Internet. La lutte contre le terrorisme fait partie intégrante de la politique étrangère de l'Union européenne, comme l'a souligné le Conseil des affaires étrangères du 9 février 2015, et des décisions importantes doivent être mises en oeuvre au sein de l'Union pour renforcer nos moyens de défense. L'agenda européen pour la sécurité présenté par la Commission européenne le 28 avril dernier place la lutte contre le terrorisme et contre la radicalisation au coeur de cette nouvelle stratégie.
Pour la première fois, la France a fait jouer la clause de l'article 42.7 du traité de l'Union qui instaure une solidarité européenne en cas d'agression armée. Il convient de souligner l'engagement des Allemands qui ont autorisé l'envoi de troupes et la fourniture de matériel militaire pour lutter contre Daech en Syrie. Nous connaissons trop les limites de la participation de nos partenaires dans l'effort de protection de l'Europe que la France a entrepris depuis des mois pour nous satisfaire de mesures symboliques. Tout en se réjouissant de la réponse de nos partenaires quant à l'application de l'article 42.7, le texte émet aussi le souhait que les dépenses militaires et de sécurité nationale – qui servent à assurer la sécurité de toute l'Union – ne soient pas prises en compte dans le calcul des déficits publics de chaque État membre.
La lutte antiterroriste exige une coopération et une interconnexion accrues pour suivre les personnes comme les mouvements financiers. La proposition de résolution en appelle à la pleine mobilisation des instruments en vigueur pour lutter contre le terrorisme, la criminalité organisée et la cybercriminalité et contient plusieurs points relatifs à l'accès, à l'échange et au traitement de l'information.
La commission Libertés publiques du Parlement européen a adopté, le 10 décembre, la directive sur le fichier des passagers aériens, dit PNR – passenger name record –, acceptant le compromis mis au point quelques jours auparavant par le Conseil des ministres. La directive prévoit un contrôle sur les vols internationaux et internes à l'Union européenne et permet de conserver les données personnelles des passagers durant six mois, puis jusqu'à cinq ans de manière masquée. Le Parlement européen devrait se prononcer prochainement en séance plénière pour permettre à ce dispositif d'être opérationnel début 2016. C'est l'aboutissement de quatre ans de discussions et il faut s'en réjouir.
Pour prévenir les attaques terroristes, il est indispensable de renforcer les échanges d'information entre les services de police et les systèmes judiciaires européens. Tout doit être mis en oeuvre pour rendre Europol et Eurojust plus réactifs et capables de coopérer étroitement avec les autorités nationales. L'Union européenne dispose de plusieurs instruments pour faciliter les échanges d'information entre États membres, agences et institutions. Europol a été renforcé dans le cadre de l'accord informel signé le 26 novembre 2015 entre États membres ; il faut développer les échanges d'information entre services de renseignement de l'Union, notamment à travers l'interconnexion de bases de données appropriées.
Naturellement, la proposition de résolution rappelle la nécessité de concilier mesures de sécurité et respect des droits. Elle insiste aussi sur la nécessité de mettre l'accent sur la prévention et la dé-radicalisation, grâce à la construction d'un contre-discours de tolérance.
Le texte pointe également la question du financement du terrorisme. L'Europe demeure en effet trop timorée dans la lutte contre ces financements et il conviendrait que le Conseil européen affirme cet objectif majeur de tarissement des flux. Le paquet législatif adopté en mai 2015 a permis de réviser le cadre applicable à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour proposer une approche fondée sur les risques, plus efficace et conforme aux recommandations du groupe d'action financière (GAFI). Mais pour aller plus loin, il faudrait harmoniser les compétences des cellules nationales de renseignement financier. L'Union européenne pourrait enfin exploiter la possibilité offerte par les traités de geler les avoirs liés au terrorisme sur son territoire.
Concernant la crise migratoire, la proposition de résolution appelle à accélérer la mise en oeuvre concrète des mesures déjà décidées, notamment sur la relocalisation des réfugiés. Le texte salue l'accord trouvé au Conseil européen sur le mécanisme permanent pour une relocalisation des personnes ayant besoin d'une protection internationale, mais appelle à le rendre pleinement effectif, ainsi que la proposition d'activation d'un mécanisme de répartition d'urgence. Les auditions que nous avons conduites au sein de cette commission ont montré que la mise en oeuvre de ces mesures reste très insatisfaisante, alors que la France s'est beaucoup engagée pour élaborer ces compromis qui permettent à la fois de faire face dignement à l'afflux de demandeurs d'asile, d'en limiter le nombre et de contenir l'immigration économique. Deux hot spots seulement sont réellement opérationnels aujourd'hui et la relocalisation ne fonctionne pas.
Des efforts considérables sont également nécessaires pour améliorer les mécanismes de contrôle aux frontières extérieures de l'Union. Il faut, là encore, se doter de moyens juridiques opérationnels. La Commission européenne vient de présenter un projet de législation sur les gardes-frontières, qui modifiera le règlement de l'Agence Frontex afin de donner à celle-ci une plus large autonomie d'action et le pouvoir d'agir de son propre chef en cas d'urgence, et créera un véritable corps de gardes-frontières autonomes. La proposition de résolution soutient ce projet qui ne sera pas facile à mettre sur pied.
Il s'agit aussi de consolider l'espace Schengen qui représente un acquis fondamental pour les citoyens et qui, à défaut de révision ciblée, pourrait être durablement remis en cause. À long terme, les flux migratoires que connaît l'Europe sont appelés à se développer. C'est pourquoi il faut insister sur l'importance de la politique de voisinage qui devra aller au-delà des impératifs de sécurité pour proposer des initiatives en faveur du développement des pays limitrophes. La proposition de résolution insiste sur la mise en oeuvre rapide des propositions du sommet de La Valette.
Enfin, comme d'autres propositions adoptées par l'Assemblée nationale, ce texte soutient l'objectif d'un nouveau paquet législatif sur l'asile visant à instaurer de véritables règles communes en la matière et appuyé par la création d'un Office européen pour la protection des réfugiés.
La résolution aborde enfin le problème du « Brexit ». Il faut saisir l'opportunité des négociations avec le Royaume-Uni pour jeter les bases d'une union différenciée efficace, que le Président de la République a appelée de ses voeux. Nous devons permettre à chaque pays d'aller ou non plus loin, sans détricoter les traités ni remettre en question ce qui fait l'originalité et la force du modèle européen.
David Cameron a transmis une lettre présentant les quatre volets de négociation dans la perspective du référendum annoncé, à laquelle le président Donald Tusk a répondu le 7 décembre dernier. Contrairement à ce que souhaitait le Premier ministre britannique, il n'y aura pas d'accord au Conseil européen de décembre, l'échéance étant désormais fixée à février. On peut regretter le souhait du Royaume-Uni de revenir sur le principe d'une union sans cesse plus étroite des peuples et débattre des moyens de mieux associer les parlements nationaux – car sur le principe nous y sommes évidemment favorables –, mais deux demandes sont problématiques.
La première, qui cristallise les tensions, est celle de la restriction de l'accès aux prestations sociales des immigrés européens au Royaume-Uni pendant quatre ans. Elle heurte clairement les principes de libre-circulation et de non-discrimination. La seconde est celle de l'articulation entre la zone euro et les États qui n'en sont pas membres : il s'agit d'un enjeu important, mais il n'est pas question de donner aux non-membres un droit de regard sur l'Union économique et monétaire. Des solutions pragmatiques ont toujours été trouvées, comme par exemple pour l'union bancaire. Fixer un principe général est dangereux car ceux qui sont restés à l'écart de la monnaie unique ne doivent pas empêcher les autres États d'aller vers plus d'Europe. La proposition rappelle cette ligne rouge des négociations et en appelle à un nouveau compromis de Luxembourg équilibré.
Car – c'est le dernier thème abordé par la proposition de résolution – les États appartenant à la zone euro doivent au contraire réaffirmer leur volonté de franchir une nouvelle étape dans l'intégration économique et politique, qui aille au-delà d'une réaction à la crise. L'Union économique et monétaire doit protéger les citoyens et être un facteur de progrès ; cela suppose d'en résorber les dysfonctionnements, sur un plan non seulement monétaire, mais aussi économique et social, et en matière de gouvernance.
Les pays de la zone euro ont fait le choix de partager leur souveraineté monétaire, renonçant à l'arme de la dévaluation unilatérale, sans pour autant se doter de nouveaux instruments économiques, sociaux, fiscaux et budgétaires communs. Il faut donc franchir une nouvelle étape qui consacre le principe de responsabilité budgétaire tout en assurant une véritable coordination macroéconomique et des mécanismes de solidarité. C'est un défi énorme et sans doute le Conseil européen de cette semaine ne parviendra-t-il pas à faire émerger un consensus. Néanmoins, la proposition de résolution réaffirme le soutien à cette ambition.
En conclusion, je vous propose d'adopter cette proposition de résolution sans modification. Elle est guidée par un souci d'efficacité face aux menaces et aux défis extérieurs comme intérieurs – un principe sur lequel nous pouvons largement nous retrouver.

Cette résolution aborde plusieurs points auxquels nous sommes attachés. Elle contribue ainsi à exprimer l'état d'esprit des parlementaires avant ce Conseil européen et permet – même si l'on reste dans la tradition européenne du consensus – de mieux faire comprendre la position des citoyens. Car ce qui nous intéresse avant tout, c'est ce que pensent les Français et les Européens. Dans une démocratie, c'est à eux qu'il appartient de lancer les idées qu'il faut ensuite coordonner et mettre en oeuvre au niveau européen, et non l'inverse.
Sur ces points, la résolution contient beaucoup d'avancées. La situation actuelle – les attentats, la vague d'immigration – nous oblige à la réflexion et nous amène à prendre des mesures nouvelles. C'est au gré des événements que les choses évoluent, mais nous devrions essayer d'anticiper : si l'enveloppe de l'espace Schengen est bien pensée pour le marché intérieur, c'est de son côté extérieur qu'il faut désormais se préoccuper. Du point de vue militaire, les pays européens sont coiffés par l'OTAN, mais l'Europe a son indépendance et doit penser à sa politique de voisinage, comme l'indique la résolution.
En matière d'immigration, faudra-t-il un jour aller encore plus loin dans l'intégration européenne ? Quelle est la part de subsidiarité par rapport aux États ? Ainsi, heureusement que Frontex commence à agir dans les « points chauds » car on avait complètement délégué ces problèmes aux États. Il suffisait à l'Europe de donner de l'argent et des directives, et les États devaient se débrouiller. Pourtant, il s'agit bien d'un problème européen.
Cette résolution fait très attention à ne pas discriminer les pays hors de la zone euro pour continuer à les intégrer ; mais elle laisse curieusement de côté les pays membres de cette zone qui, s'ils ont envie d'aller plus loin, devraient pouvoir le faire. Cette culture du compromis et du consensus permanent, devenue l'alpha et l'oméga de l'Europe, n'a pas que des avantages, et il faut pouvoir revenir sur ces règles de fonctionnement. Il n'y a pas de vérité absolue et définitive.
Enfin, la taxe sur les transactions financières (TTF) peut être créée quelle que soit la monnaie.

Ouvrez les yeux : ce projet de résolution est dangereux ! Il est légitime de vouloir renforcer la coopération entre États, mais nous sommes dans une fuite en avant permanente et refusons de regarder la réalité en face. L'échec de Schengen ne sera pas dépassé par la création d'une pseudo-police extérieure ; il est impossible de contrôler les frontières extérieures de l'Union, notamment de la Grèce – voire de la France, surtout en Guyane. Il faut changer de logiciel, même si certains dispositifs tels que le service d'information Schengen sont bien pensés ; ce système reste toutefois mal alimenté par les États, notamment sur les fiches S dont nous sommes les seuls à disposer.
Plus grave encore : plutôt que de se demander quel serait le coût de la suppression de la monnaie unique, interrogeons-nous sur celui de son maintien ! Cette petite utopie nous a coûté 25 % du PIB français. Aller toujours plus loin dans l'intégration, c'est poursuivre la dévaluation interne – que vous, mesdames et messieurs les membres du Parti socialiste, ne cessez de dénoncer. Si vous ne pouvez pas jouer sur les taux externes, vous jouerez sur le niveau des pensions et sur la dépense publique. Vous êtes dans un total aveuglement. Je ne suis pas d'accord en tout avec les Anglais, mais ils sont les seuls à avoir le sens de la réalité et des responsabilités en Europe. Continuer avec ce logiciel des années 1960, c'est aller à l'échec certain et mettre en péril la notion même de coopération européenne. De grâce, ouvrez les yeux : ces utopies détruisent l'Europe !
Je voterai contre cette résolution. Je respecte les opinions des autres et le débat continuera, mais il est grave d'aller toujours dans le même sens. Les Britanniques posent les vrais problèmes et ils ont raison.

Chaque point de cette résolution mérite un vaste débat. Comme je l'ai dit dans le cadre de l'échange que nous avons eu avec les secrétaires d'État français et allemand aux affaires européennes, je trouve regrettable pour le projet européen qu'il faille une menace de « Brexit » pour qu'on envisage de revoir les politiques publiques européennes. Nous sommes pourtant nombreux à être favorables à un projet européen ambitieux, qui parle d'emblée aux gens, mais devoir démontrer l'opportunité des politiques par leurs coûts économiques et sociaux – donc par la négative – en montre l'essoufflement. Je soutiendrai cette proposition de résolution, qui contient plusieurs avancées, mais je suis très inquiète quant à l'avenir de l'Union.
Par ailleurs, le secrétaire d'État allemand a prévenu que dans le cadre de la négociation très dure qui s'annonce avec les Britanniques, il faudrait faire des concessions. Je crains donc la victoire d'une ligne moins pro-européenne que celle que nous souhaitons.

Je regrette que cette résolution soit si hétérogène : on peut adhérer à certains points, mais non à d'autres, ce qui me conduira personnellement à m'abstenir. Le texte exonère ainsi la France, comme tout autre État participant à la défense générale de l'Union, d'intégrer ses dépenses militaires au calcul des déficits publics : une mesure de bon sens. Avec les Britanniques – qui ne font pas partie de la zone euro –, nous sommes les seuls à nous battre en première ligne pour la défense des valeurs de l'Union européenne auxquelles nos partenaires n'adhèrent que du bout des lèvres, et avec le minimum de frais. Il est aberrant que la Commission européenne fasse toujours semblant de considérer que nous sommes, sur ce point, à égalité. On ne peut donc qu'être favorable à cette mesure, comme à la création du fichier PNR ou au renforcement du contrôle aux frontières extérieures, à travers la création d'un corps de gardes-frontières.
En revanche, il est absurde de désigner du doigt le Royaume-Uni : ce pays mène sa politique et il en a le droit. Il ne fait pas partie de la zone euro, et nous n'avons pas à porter de jugements sur ses choix. C'est là une faiblesse de cette résolution. Mêler ainsi différents sujets est un moyen certain pour éviter que nous la votions !

Je voudrais réagir à l'intervention de M. Myard. Cette résolution contient beaucoup de points positifs dont je regrette, moi aussi, qu'ils ne soient évoqués qu'en conséquence ou en prévision de crises. Ainsi, la non-prise en compte des dépenses de défense dans le calcul des déficits comme la volonté d'envisager un agenda européen un peu plus ambitieux et intégrateur – notamment sur les questions fiscales et sociales – sont à saluer.
Les membres de la famille politique de Jacques Myard sont favorables à la fois à des restrictions à la liberté de circulation des individus et à davantage de dérégulation et de liberté de circulation des biens, des marchandises et des capitaux. C'est toujours dans sa famille politique qu'on trouve les meilleurs partisans d'une grande zone de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne, qu'ils veulent continuer à ouvrir à tous les vents – aux capitaux, aux biens et aux marchandises ; mais les mêmes réclament que l'on ferme les frontières aux individus. Cette contradiction, monsieur Myard, nourrit la désaffection pour le projet européen et prive celui-ci de toute existence. Si l'on ne va pas vers plus d'Europe, plus de social et plus de convergence fiscale, on ne fait pas grand-chose.

Monsieur Hamon, je suis surpris de votre remarque car ce n'est pas moi qui ai acté dans les traités de Maastricht et de Lisbonne, sur l'insistance de l'Allemagne, la totale liberté de circulation des capitaux. Vous l'avez voté ; il est donc paradoxal que vous vous interrogiez aujourd'hui sur ces points. Je suis d'accord avec vous : la dérégulation de la finance internationale est un vrai problème car les États sont ballotés par les mouvements de capitaux. Mais balayez devant votre porte : vous l'avez voulu !

Il faut avoir beaucoup de courage pour croire aujourd'hui à l'Europe, et une certaine dose d'inconscience pour travailler encore à ce projet. Estelle Grelier s'étonne qu'on ne réagisse qu'à la prise de position britannique ; je regrette pour ma part que la France n'ait pas un de Gaulle ou une Thatcher qui tape du poing sur la table, car c'est le seul moyen de faire avancer l'Europe ! Nous sommes capables d'aller à l'encontre de la volonté du peuple : quand celui-ci vote non au traité de Lisbonne et que l'Assemblée le corrige, il ne faut pas s'étonner qu'il ne se reconnaisse pas dans l'Europe !
L'Europe ne se définit aujourd'hui que par rapport à une position défensive. À l'origine, elle procédait d'une volonté de paix, d'harmonisation économique et de lutte contre le chômage – Maastricht promettait ainsi, grâce à la monnaie unique, la fin du chômage européen. Aujourd'hui, l'Europe ne pense qu'à défendre ses frontières, tout en se couchant à Calais. Ouvrez donc les vannes à Calais et on verra comment réagiront les Anglais ! C'est nous qui sommes en première ligne. Sous la présidence d'Axel Poniatowski, notre commission avait reçu le ministre des affaires étrangères polonais ; nous étions scandalisés par son intervention, mais lorsqu'un député lui a reproché d'acheter des F-16 plutôt que des Rafale, il a répondu que son pays n'était pas entré dans l'Europe pour construire un ensemble politique, mais pour faire des affaires. Il faut dire les choses telles qu'elles sont et poser la vraie question : qu'est-ce que l'Europe aujourd'hui ? Je souhaite qu'un jour on tape du poing sur la table, car c'est ainsi qu'on pourra faire avancer les choses, et non en se couchant en permanence.

On peut remercier Philip Cordery et Estelle Grelier pour leur travail sur cette résolution qui nous permet d'avoir ce débat.
Monsieur Luca, la résolution est en effet hétérogène, mais elle se calque sur l'ordre du jour du Conseil européen dont elle reprend les points les plus importants, tels que les négociations avec le Royaume-Uni.
Monsieur Myard, vous avez le mérite de la constance. Vous avez évoqué le coût de la suppression de l'euro ; mais, même si j'en doute, ce pourrait éventuellement être un coût négatif !
Je suis d'accord avec Estelle Grelier : il est dommage de ne réagir qu'aux crises, sans être capables de mener une réflexion approfondie et continue sur l'évolution que l'on souhaite imprimer à l'Europe.
En ce qui concerne Schengen, les propositions du Conseil européen sur la maîtrise des frontières extérieures et la réforme de l'agence Frontex ont été rendues publiques hier. La maîtrise des frontières est une question qui se pose tant à l'Europe qu'à chaque pays. Pour le moment, l'agence n'était pas autonome et n'avait pas de compétences dans la mesure où elle dépendait de la décision de chaque État. Puisqu'on a du mal à surveiller nos frontières, il faut créer une compétence européenne dans ce domaine afin de disposer enfin d'une agence dotée de vrais moyens et ayant à sa disposition un corps de garde-frontières qui puisse réagir de façon rapide et efficace. Les vérifications aux frontières seront désormais systématiques et permettront une consultation élargie des bases de données.
Je vous propose de voter cette résolution. Philip Cordery souhaite que l'on suive avec attention les réunions du Conseil européen pour réagir à son agenda et faire entendre la position de la France.
La Commission adopte la proposition de résolution européenne sans modification.
La séance est levée à onze heures.