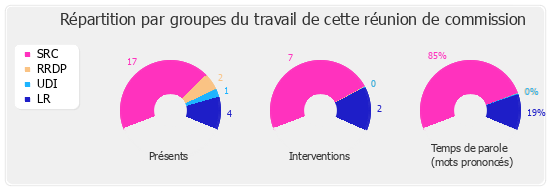Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Réunion du 16 décembre 2015 à 11h00
La réunion
La Commission entend M. Pascal Duchadeuil, président de la cinquième chambre de la Cour des comptes, sur le rapport d'enquête réalisé par la Cour, en application du 2° de l'article 58 de la loi organique relative aux lois de finances, sur les zones de revitalisation des territoires.

Je souhaite la bienvenue à M. Pascal Duchadeuil, président de la cinquième chambre de la Cour des comptes. En effet, nous examinons aujourd'hui le rapport que vous nous avez transmis au début du mois sur le bilan des conventions et des crédits de revitalisation des territoires. Cette enquête a été réalisée à la demande de notre commission, et plus précisément à l'initiative de notre rapporteur spécial, Christophe Castaner. Il s'agit du second volet d'une enquête dont le premier, que nous avait présenté le président Guy Piolé le 3 décembre 2014, avait consisté en un bilan des aides de l'État aux territoires concernés par les restructurations des armées.
C'est la dernière des cinq enquêtes que nous avions demandées fin 2013 à la Cour des comptes, en application des dispositions du 2° de l'article 58 de la loi organique relative aux lois de finances. Je rappelle qu'en application de ces dispositions et suite à nos demandes présentées fin 2014, nous avons déjà reçu le 14 octobre, un rapport sur les contributions internationales de la France 2007-2014, ainsi qu'un rapport procédant à un bilan d'étape du transfert de services de l'INSEE à Metz.
Nous n'attendons donc plus que le rapport demandé à la Cour à l'initiative de Christine Pires Beaune sur les pistes de rationalisation de l'organisation territoriale en ce qui concerne les groupements sans fiscalité propre – SIVU, SIVOM et syndicats mixtes.

Le rapport devrait être rendu en juin 2016, afin que nous puissions intégrer le résultat des travaux de la Cour au projet de loi de finances pour 2017. Il était également convenu que nous fassions un point d'étape en début d'année 2016.
Je suis accompagné pour vous présenter le rapport de la Cour par M. Gilles Pierre-Lévy, qui en a été le contre-rapporteur, ainsi que par deux des rapporteurs, M. Pierre Rolland et Mme Mylène Girard.
Les conventions de revitalisation sont un dispositif original. Codifiées au code du travail, elles s'imposent aux entreprises de mille salariés et plus qui procèdent à des licenciements collectifs, ainsi qu'aux entreprises volontaires d'au moins cinquante salariés qui appartiennent à un groupe de plus de mille salariés.
Ce dispositif vise donc essentiellement à soutenir l'activité économique des territoires mis en difficulté par des licenciements. Le principe en est que les entreprises concernées doivent verser une contribution, destinée à revitaliser le bassin d'emploi touché, en atténuant l'effet des licenciements.
La convention doit être signée dans un délai de six mois à compter de la notification du plan de sauvegarde de l'emploi. À défaut, l'entreprise est tenue de verser au Trésor public une contribution équivalant à quatre fois la valeur mensuelle du SMIC par emploi supprimé. Plus fondamentalement, la loi encadre le montant de la contribution de l'entreprise entre un plancher de deux fois et un plafond de quatre fois la valeur mensuelle du SMIC par emploi supprimé. Entre ces seuils, c'est le préfet de département qui a la responsabilité de fixer le montant applicable à l'entreprise.
Le fait générateur de l'obligation de conventionner pour les entreprises de plus de mille salariés est donc le fait de procéder à un licenciement collectif qui affecte par son ampleur le bassin d'emploi dans lequel elles sont implantées, sachant que le préfet dispose d'un délai d'un mois à partir de la validation du plan de sauvegarde de l'emploi pour faire savoir à l'entreprise si elle est ou non soumise à l'obligation de revitalisation.
Il est important de souligner ici que les fonds versés, s'ils concourent à la politique publique de l'emploi, ne sont en aucun cas des fonds publics. Ils sont mis à disposition par l'entreprise pour revitaliser le territoire et demeurent sa propriété jusqu'à la fin de la mise en oeuvre de la convention. Ce sont donc des fonds privés : c'est l'entreprise, et non les acteurs publics, qui décident in fine de l'usage de ces fonds, et si, d'aventure, il se trouvait qu'à la suite d'un changement dans la procédure, l'État prenne la main sur ces fonds, le risque serait qu'ils soient requalifiés en aides d'État.
Ce dispositif est d'une ampleur relativement limitée, mais donne des résultats réels. De 2002 à 2014, environ 1 400 conventions de revitalisation ont été signées, représentant un total de plus de 700 millions d'euros de contributions d'entreprises. En moyenne, 100 à 120 conventions sont signées chaque année, pour une contribution moyenne d'environ 50 millions d'euros et un objectif de création d'emplois se situant entre 10 000 et 12 000 emplois par an.
L'utilité du dispositif est reconnue par l'ensemble des acteurs locaux. Il présente l'intérêt de permettre un travail partenarial entre l'ensemble des intervenants, et donne la possibilité aux entreprises et aux parties prenantes locales de s'approprier cette démarche de revitalisation.
Pour autant, la Cour, dans son instruction, a relevé un certain nombre de difficultés. La première tient au fait que les pratiques locales sont diverses, ce qui ne favorise pas une mobilisation toujours optimale des services de l'État, lesquels peinent à identifier, parmi la multiplicité des intervenants, un chef de file susceptible de prendre en charge le pilotage et d'être l'interlocuteur des entreprises concernées.
L'implication des entreprises peut également être variable. Dans la grande majorité des cas que nous avons étudiés, les entreprises se sont engagées dans le processus de revitalisation. Cependant, lorsqu'elles quittent le territoire ou lorsqu'elles sont rattachées à des groupes étrangers, cette implication peut être réduite et se limiter au simple versement de la contribution.
Il faut également souligner la faiblesse du pilotage national liée au manque de fiabilité des outils de suivi. Ce pilotage est d'autant plus complexe que les parties prenantes sont très nombreuses, incluant plusieurs services de l'État, des acteurs économiques, les collectivités locales, soit parfois une trentaine d'acteurs, qui peuvent être amenés à se prononcer sur un projet de convention, ce qui à la fois crée les conditions favorables au développement de synergies locales mais comporte aussi un risque d'alourdissement des processus. Les comités de suivi et les comités d'engagement peuvent notamment être trop importants. Ce n'est pas toujours un bon signal pour les entreprises qui peuvent se sentir engagées dans un rapport de force déséquilibré.
Dans ce contexte, on observe que les délais administratifs sont trop courts pour l'État, qui n'a qu'un mois pour justifier sa décision d'assujettissement à l'obligation de revitalisation. Cela suppose qu'il dispose de données actualisées lui permettant notamment de démontrer et de mesurer l'impact des licenciements sur le territoire ; or, ce n'est pas toujours le cas compte tenu de la multiplicité des sources et du manque de coordination des services. Nous avons ainsi pu constater le cas de deux entreprises qui avaient échappé à l'obligation d'assujettissement simplement parce que les délais avaient été dépassés. C'est la raison pour laquelle la direction responsable, à savoir la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) a engagé une réflexion sur l'allongement du délai dont disposent les services de l'État pour décider de l'assujettissement des entreprises.
On constate par ailleurs la quasi-absence d'études d'impact, dont la réalisation pourrait être déléguée à l'entreprise mais ne l'est que très rarement. C'est une des faiblesses de la procédure car cela fragilise la motivation de la décision d'assujettissement du préfet et, partant, augmente le risque de recours. Si le taux de recours reste faible – il était en 2014 de 5,5 % pour les recours hiérarchiques et de 1,6 % pour les recours contentieux –, il est néanmoins en progression, et les tribunaux administratifs ont annulé plusieurs décisions d'assujettissement rendues par les préfets pour défaut de motivation et insuffisance de la démarche contradictoire.
En ce qui concerne à présent à la mise en oeuvre concrète de ces conventions de revitalisation, il faut s'arrêter un instant sur le rôle des prestataires et sur les conditions dans lesquelles ils remplissent leur mission. Dans sept cas sur dix en effet, les entreprises ont recours à un cabinet de conseil pour les assister dans la mise en oeuvre de la convention. La définition de la mission confiée à ces prestataires apparaît parfois insuffisante mais le problème essentiel est surtout celui de la rémunération de ces cabinets : la Cour a ainsi constaté d'importants écarts de rémunération, les frais de conseil pouvant aller de 6 % à plus de 30 % du coût global de la convention. Ces écarts sont encore plus importants – de un à neuf – si l'on rapporte les coûts d'intervention des prestataires aux objectifs de création d'emplois. Afin de corriger cette situation, la DGEFP s'est engagée à mettre en oeuvre un suivi plus resserré de l'action des prestataires en définissant un référentiel permettant notamment de mieux préciser les conditions de rémunération.
Une autre question latente est celle de la mutualisation des fonds, qui concerne environ une convention sur cinq, l'idée étant de mettre en commun les financements mis à disposition par plusieurs conventions sur un même territoire, pour accroître l'effet de levier des actions de revitalisation, optimiser le suivi et la coordination des conventions, éviter la concurrence entre territoires, et atteindre enfin un niveau de financement permettant de dépasser un simple objectif de création d'emplois au profit d'une logique plus large de dynamisation du territoire.
Le coût de la mutualisation est inférieur à celui du recours aux prestataires, généralement plafonné entre 9,5 % et 15 % des contributions versées. Des difficultés peuvent surgir en revanche de l'absence de cadre juridique précis dans lequel s'opère la mutualisation. Ainsi, si le préfet, dans le cadre de cette mutualisation, se trouve en position de décider du fléchage des financements, il peut exister un risque de requalification des aides accordées en aides d'État. Je peux citer deux cas, en Ille-et-Vilaine et en Île-de-France, dans lesquels, pour éviter ce risque, des associations ont été créées, composées uniquement de personnes privées. Là encore, la DGEFP a créé un groupe de travail pour définir un montage type permettant de sécuriser le recours à ces structures de mutualisation.
Pour ce qui concerne enfin les effets de ces conventions sur l'emploi, au plan national, le taux de réalisation par rapport aux objectifs d'emplois créés est de l'ordre de 85 %, ce qui est satisfaisant. La réalité que recouvre cette moyenne mérite néanmoins d'être questionnée : elle ne correspond à rien de ce qu'ont révélé nos études, qui ont fait apparaître en revanche des écarts de performance très importants, allant du simple au triple. La véritable difficulté est que l'on manque d'une évaluation systématique et de bilans types de ces conventions de revitalisation, les indicateurs de performance servant à l'évaluation n'étant guère harmonisés.
La circulaire de 2012, qui fonde cette mesure de performance, distingue les emplois créés, les emplois maintenus, les emplois prévisionnels ou programmés ainsi que des « équivalents emploi » – par exemple des frais d'études divisés par le montant du SMIC. En réalité, parmi ces indicateurs de performance, les emplois créés sont les seuls qui correspondent véritablement à de la création d'emploi. Or, on constate des effets de substitution, notamment lorsque les conventions permettent le recrutement de publics éligibles au détriment d'autres personnes qui auraient été embauchées sans les incitations financières. Il existe également des effets d'aubaine, et il est difficile de déterminer si les emplois créés ne l'auraient pas été sans la convention.
De surcroît, mesurer de manière pertinente l'efficacité du dispositif nécessiterait son évaluation sur la durée. Or, on néglige trop souvent ce facteur temps lorsque l'on évalue la capacité d'une convention à créer des emplois pérennes. L'ensemble des acteurs de terrain que nous avons interrogés estiment qu'il faudrait au moins deux ou trois ans après la clôture du dispositif pour en apprécier l'efficacité réelle.
En définitive, les conventions de revitalisation sont un dispositif original, dont le coût reste mesuré, puisque nous avons estimé que le coût moyen par emploi créé se situait entre 2 500 et 9 000 euros. Si l'on identifie aisément les avantages qu'il offre en permettant la mise en oeuvre d'une politique qui responsabilise l'entreprise qui licencie, met à la disposition du territoire des moyens financiers qui s'ajoutent à l'effort budgétaire des collectivités publiques et favorise le dialogue entre l'ensemble des responsables économiques d'un bassin d'emploi sinistré, la disparité des situations sur les territoires fait apparaître des difficultés, tant en ce qui concerne les entreprises, qui peuvent percevoir la contribution à la revitalisation du territoire comme une simple taxation et ne pas s'impliquer dans le processus – cas qui demeure heureusement fort marginal – qu'en ce qui concerne l'État, dont les services déconcentrés manquent d'outils de pilotage.
La Cour conclut donc à l'existence de marges de progression, pour améliorer la gestion du dispositif. Le rapport comporte ainsi un certain nombre de recommandations techniques, qui portent essentiellement sur les délais de négociation, la détermination des indicateurs, le référentiel de coût pour les prestataires et la définition des structures juridiques qui permettraient de sécuriser les opérations de mutualisation.

Élu dans un département, la Loire, très concerné par ces conventions de revitalisation et qui a expérimenté la mutualisation, j'ai pu constater que les entreprises concernées jouaient en général le jeu, y compris les grands groupes étrangers qui quittent un territoire et ne lésinent pas sur les moyens pour financer ces conventions de revalorisation. Néanmoins, il est fréquent qu'a posteriori elles estiment que l'argent n'a pas toujours été bien utilisé. Ceci nous ramène à la question de la gouvernance et au fait que les territoires en conversion souffrent souvent d'un déficit d'ingénierie économique. Ne serait-il pas pertinent dans ces conditions d'organiser cette ingénierie au niveau régional, compte tenu du rôle que joueront désormais, au sein des nouvelles régions, les préfets de région en matière de développement économique ?
Raisonner bassin d'emploi par bassin d'emploi ne facilite pas la mutualisation car, dans le cadre d'une convention de revitalisation, une entreprise située sur le territoire d'une intercommunalité ne peut accompagner la création d'entreprises dans l'agglomération voisine. Cela introduit de la rigidité dans le système, rigidité moins imputable à l'État qu'aux maires, qui revendiquent l'usage de l'argent versé pour leur commune, y compris pour financer des actions n'ayant rien à voir avec l'emploi.
Nous avons expérimenté, avec l'ancien préfet de région, le transfert d'une convention de revitalisation de l'Isère au Rhône, mais cela nous plaçait à la limite de la requalification en aide d'État, ce qui impliquait donc de prendre toutes les précautions nécessaires. D'où la nécessité, sans doute, d'impliquer davantage les régions, a fortiori puisque les conseils généraux et les agences départementales vont disparaître.
En ce qui concerne les prestataires, se pose non seulement la question du coût et des abus de facturation mais également celle de la qualité des prestations fournies, car on a parfois l'impression que leur travail s'apparente surtout à une forme de « copier-coller » à partir de modèles types de convention.
Il est clair que les comités de suivi sont pléthoriques, d'autant que, parmi les participants, tous n'ont pas les mêmes intérêts. Il me semble qu'il faut, quoi qu'il en soit, y associer les représentants des salariés, car non seulement c'est de leur avenir qu'il s'agit, mais ils peuvent en outre se montrer très constructifs dans leurs exigences en matière de conditions de sortie. En revanche, élargir ces comités à des élus qui n'ont pas la compétence économique est contreproductif, ce qui, je crois, est aussi l'avis de la Cour.
Il me semble que vous préconisez également la mise en place d'un dispositif « normé », impliquant de se conformer à des sortes de bilans types et à des niveaux d'exigence standardisés.
Par ailleurs, puisque les fonds de revitalisation sont des fonds privés, qui ont donc l'avantage de ne pas être notifiés à Bruxelles, pourriez-vous nous indiquer comment ils pourraient être conjugués à des financements publics, lesquels sont toujours notoirement insuffisants ?
J'insiste enfin sur le fait que, si les grands groupes financent bien volontiers la revitalisation, car elle contribue à la paix sociale, nous ne pouvons qu'être d'accord avec eux lorsqu'ils considèrent que ce n'est pas en finançant la création d'épiceries, de bars-tabacs ou de services à la personne que l'on revitalise un bassin industriel et qu'il est donc fondamental que ces fonds soient prioritairement affectés à la reconstitution d'emplois industriels.

Pour m'être impliqué dans le dossier de revitalisation de la base aérienne 102 Dijon-Longvic, je peux confirmer la bonne mobilisation des acteurs, mais je déplore que l'on s'attache avec ces conventions à gouverner les effets davantage que les causes. En effet, les moyens affectés à la sauvegarde de l'emploi dans la loi de finances, à travers le programme 103 de la mission Travail et emploi qui doit accompagner les mutations économiques, sont notoirement insuffisants et, de surcroît, en diminution. Ils ne permettent ni la mise en oeuvre d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) solide, ni l'élaboration de véritables diagnostics territoriaux, qui permettraient d'apporter des réponses pérennes.
Malgré la mobilisation des services de l'État et la bonne volonté de chacun, si les moyens ne sont pas au rendez-vous on ne peut espérer un développement durable du territoire, qui se fonde à la fois sur l'industrie et les TPE mais aussi sur un meilleur fléchage de la commande publique en direction des entreprises locales.
Enfin, je sais d'expérience que le montage de ces dossiers de revitalisation peut être extrêmement long, compte tenu du nombre d'acteurs impliqués et des différentes collectivités qui doivent se mobiliser. Cette lenteur est un frein pour les investisseurs, qui ont besoin de lisibilité et de réactivité.

Pour avoir été présidente d'une maison de l'emploi et pour être aujourd'hui élue dans un territoire qui a souffert de la désindustrialisation, j'ai eu à traiter de plusieurs conventions de revitalisation et ai donc eu affaire à différents cabinets de conseil. On ne m'expliquera pas la disparité dans les tarifs qu'ils pratiquent, d'autant que, souvent, la performance n'est guère au rendez-vous. Je souscris à ce qu'a dit Jean-Louis Gagnaire : les prestataires oublient même parfois d'adapter les conventions types qu'ils proposent aux territoires sur lesquels ils interviennent.
Je considère ensuite que les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ne sont pas suffisamment vigilantes sur le respect des mesures d'application des conventions de revitalisation, dès lors que leur mise en oeuvre est confiée à un prestataire qui, tous les trois mois, organise des réunions de situation où sont annoncées des créations d'emploi. Sauf que, souvent, un trimestre ne s'est pas écoulé que les emplois ont été remis en question, car il s'agissait de simples effets d'aubaine.
Nous devons nous donner les moyens de contrôler l'application dans le temps de ces conventions afin que les fonds soient fléchés vers de la création d'emplois durables. Je vois avec satisfaction que figure parmi vos préconisations la désignation d'un chef de file opérationnel au sein des services de l'État. C'est en effet l'État qui doit reprendre la main.

Je suis, comme Jean-Louis Gagnaire, élu dans la Loire, département dans lequel résistent encore quatre mille PME industrielles mais où les grands groupes – à part Michelin ou Nexter – ont quasiment disparu. La question de la revitalisation des territoires y revêt donc une importance toute particulière, sachant qu'entre 2008 et 2010, s'y sont succédés des plans de sauvegarde de l'emploi qui pouvaient concerner jusqu'à six cents salariés chaque année.
Nous avons expérimenté, dans l'agglomération stéphanoise la mutualisation des conventions de revitalisation, suite aux fermetures d'Akers, de Siemens et de ThyssenKrupp. Cela s'est avéré une bonne formule, même s'il conviendrait d'assouplir les règles concernant le périmètre géographique d'application de ces conventions et de mieux cibler l'attribution des fonds, afin qu'ils bénéficient véritablement aux PME industrielles.
Je confirme que l'on ne peut mesurer l'effet réel de ces conventions en matière de revitalisation des territoires qu'au bout de plusieurs années, ce qui implique un suivi dans le temps.
Enfin, la gouvernance doit absolument être améliorée, compte tenu de la multiplicité des acteurs qui interviennent au nom de l'État, qu'il s'agisse du préfet de département, du préfet de région, de la DIRRECTE, de Pôle emploi, du secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR), voire du commissaire au redressement productif. Que préconisez-vous en termes de pilotage de l'action de l'État sur le terrain ? À qui doit-il être confié ?

Les élus de terrain insistent beaucoup sur l'importance de combiner d'emblée les plans de sauvegarde de l'emploi et les conventions de revalorisation. En effet, quand un plan de sauvegarde ne se déroule pas dans de trop mauvaises conditions, les entreprises ont tendance, une fois les risques de convulsions sociales écartés, à être moins sensibles au devenir du territoire et sont donc moins enclines à s'impliquer dans sa revalorisation.
Il importe également de prendre en compte les friches industrielles qui couvrent parfois une part importante du bassin d'emploi.
Enfin, il me semble que la mutualisation a aussi ses limites, dans la mesure où les emplois créés grâce aux fonds de revalorisation ne seront pas nécessairement créés partout où le besoin s'en fait sentir, ce qui inquiète les élus de territoires où, comme chez moi, le chômage est très important.
Je puis en revanche témoigner que la gestion et le suivi des conventions mises en oeuvre dans le Maine-et-Loire nous donnent pleine satisfaction grâce à une collaboration efficace entre la préfecture et la DIRRECTE.
J'ai le sentiment que le rapport de la Cour fait écho à vos expériences. C'est notamment le cas sur la question du périmètre des conventions de revitalisation, beaucoup d'entre vous contestant sa limitation au bassin d'emploi. On peut en effet envisager une stratégie de développement à l'échelle régionale, mais les difficultés seront d'autant plus grandes que les particularités territoriales seront nombreuses, induisant des exigences différentes. Il y a donc incontestablement une réflexion à mener sur la définition du périmètre optimal.
Beaucoup d'entre vous ont également abordé le problème des prestataires. Dans les conventions que nous avons étudiées, la qualité des prestations n'est jamais détaillée, pas plus que ne l'est le nombre de jours-hommes qu'ont nécessité les différentes actions. C'est pourquoi la démarche de la DGEFP, qui envisage de mettre en place un cadrage du rôle des prestataires, précisant les critères de rémunération et la définition de leur action, me paraît indispensable.
La problématique est la même pour l'outil d'évaluation qu'est le bilan type. Nous sommes à l'heure actuelle dans l'incapacité de mesurer une valeur aussi simple en apparence que le nombre d'emplois créés, car l'expression recouvre une réalité hétérogène. Il faut donc améliorer le bilan type actuel qui ne dit rien de la nature des emplois concernés, de leur qualité, de leur coût, de la branche ou du secteur auxquels il appartiennent. Là encore, la DGEFP, qui a reçu très positivement l'ensemble de nos suggestions, s'est engagée à l'améliorer.
Vous vous interrogez sur la possibilité d'associer les fonds privés de la revitalisation aux fonds publics du programme 103, par le biais, par exemple, de fonds de concours. Je crains qu'en l'état actuel du droit communautaire cela ne soit pas possible, car cela reviendrait à s'exposer au risque d'une requalification en aides d'État.
Vous avez confirmé ce que nous avions constaté sur la durée des conventions. Toutes celles que nous avons étudiées ont connu un dépassement.
En matière de pilotage et de gouvernance, il n'appartient pas à la Cour de déterminer un cadre type. Il ne serait d'ailleurs pas nécessairement pertinent de définir un cadre trop contraignant s'appliquant à l'ensemble des conventions, l'intérêt de la démarche de revitalisation étant précisément de se fonder sur des réalités territoriales. En revanche, il nous semble nécessaire que la mobilisation des services de l'État soit rationalisée.
Pour ce qui concerne la mutualisation, il convient de recenser les bonnes pratiques et les schémas juridiques qui ont pu être déjà élaborés. Sur ce point encore, la DGEFP a lancé une réflexion spécifique. La Cour des comptes entend suivre les résultats de ces travaux, à travers le recadrage des circulaires et autres bilans types que la DGEFP s'est engagée à produire.

Je constate une grande convergence entre l'expérience de terrain qu'ont les parlementaires et les conclusions de la Cour des comptes.

Sans vouloir défendre les régions à tout prix, j'insiste sur le fait que, compte tenu des compétences et des moyens qui leur sont dévolus par la loi, dans le cadre notamment des schémas régionaux de développement économiques, elles doivent être impliquées, comme l'État, dans les conventions de revitalisation. Si ce dernier conserve des compétences régaliennes et si les questions d'emploi demeurent de son ressort, force est de constater, à travers notamment l'affaiblissement des DIRRECTE, une forme de « dévitalisation » de ses services déconcentrés. L'argent se trouve dans les régions, ce qui rend nécessaire un copilotage.

J'ai une opinion un peu différente car les enjeux de la revitalisation ne sont pas les mêmes pour la région ou pour les bassins d'emploi. Si le champ d'application des conventions est demain étendu aux départements, voire aux régions – désormais gigantesques –, on peut craindre en effet que les conventions passées en compensation des pertes d'emploi qu'à subies un territoire servent à en revitaliser un autre, accélérant la désindustrialisation du premier. Le territoire doit selon moi rester la clef d'un développement économique équilibré.

Je partage cet avis. J'ajoute que, si dans le domaine de la santé, la réalisation d'économies passe d'abord par la prévention, il en va de même pour les entreprises. Plus les analyses seront faites en amont, moins il sera nécessaire de faire appel à des fonds publics ou privés. Or, en l'occurrence, les mécanismes d'alerte ne fonctionnent pas bien, alors qu'il est beaucoup plus compliqué d'agir lorsque l'on a laissé la situation se dégrader. Les élus et les préfets notamment, qui connaissent les procédures et les outils à mobiliser, doivent être sollicités très en amont.

Il me reste à vous remercier, monsieur le président, pour ce travail qui doit nous aider à mieux évaluer les politiques de revitalisation.
Membres présents ou excusés
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Réunion du mercredi 16 décembre 2015 à 11 heures
Présents. - M. François André, M. Jean-Marie Beffara, Mme Karine Berger, M. Gilles Carrez, M. Alain Claeys, M. Romain Colas, M. Charles de Courson, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Olivier Faure, M. Jean-Louis Gagnaire, M. Joël Giraud, M. Marc Goua, M. Laurent Grandguillaume, Mme Arlette Grosskost, M. Régis Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Jean-François Mancel, M. Pierre-Alain Muet, Mme Christine Pires Beaune, Mme Valérie Rabault, Mme Monique Rabin, M. Pascal Terrasse, M. Michel Vergnier
Excusés. - M. Guillaume Bachelay, M. Dominique Baert, M. Xavier Bertrand, M. Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, M. Jean-Pierre Gorges, M. Jean-François Lamour
Assistait également à la réunion. - M. Alain Calmette