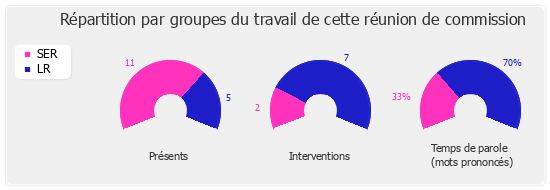Commission des affaires étrangères
Réunion du 25 octobre 2016 à 17h00
La réunion
La séance est ouverte à dix-sept heures.

Nous recevons cet après-midi M. Jérôme Bonnafont, directeur d'Afrique du Nord et du Moyen Orient au ministère des affaires étrangères, pour une réunion fermée à la presse et centrée sur trois sujets : l'Irak, la Syrie et l'initiative française de paix au Proche Orient.
En ce qui concerne l'Irak, l'actualité est dominée par le début de l'offensive des forces irakiennes en vue de libérer Mossoul. Sur le plan diplomatique, qui relève de votre compétence, monsieur le directeur, notre pays a accueilli jeudi dernier une réunion ministérielle pour la stabilisation de Mossoul, qui a rassemblé vingt-trois pays et les organisations internationales compétentes. Vous nous expliquerez peut-être ce que signifie « stabiliser », s'agissant d'une ville qu'on attaque… En tout cas, vous pourrez nous éclairer sur les relations et les tensions entre les acteurs régionaux. Comment le partage des rôles entre Bagdad et le Kurdistan irakien a-t-il été négocié ? Nous savons aussi qu'il y a des tensions diplomatiques fortes – c'est le moins qu'on puisse dire – entre l'Irak et la Turquie à propos de la participation de cette dernière à la reconquête de Mossoul.
S'agissant de la Syrie, vous pourrez nous présenter l'état des négociations entre la Russie et les autres membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies en vue de parvenir à un cessez-le-feu à Alep, en nous rappelant les principaux points de divergence. Par ailleurs, il serait intéressant que vous nous présentiez le positionnement des différents États de la région sur ce dossier. Là encore, le jeu de la Turquie suscite des interrogations, dans la mesure où ce pays se bat sur deux fronts : contre Daech, mais aussi contre les forces kurdes avec lesquelles les États-Unis sont alliés en Syrie et en Irak.
Au Proche-Orient, la situation est toujours aussi inquiétante, et le face-à-face entre Israéliens et Palestiniens, arbitré par les seuls États-Unis, semble avoir montré ses limites. La conférence de Paris de juin dernier avait pour but de changer de méthode en mobilisant la communauté internationale. Quels ont été ses résultats ? Une autre conférence sur le sujet serait à nouveau organisée à Paris, avant la fin de l'année nous dit-on. Pourriez-vous nous donner des précisions sur son calendrier, ses participants et son ordre du jour ? Le succès ou l'échec de l'initiative française dépendra sans doute aussi du résultat de l'élection présidentielle américaine. Selon vous, dans l'hypothèse d'une victoire d'Hillary Clinton, la France trouvera-t-elle, chez les Américains, de véritables alliés pour faire aboutir son initiative ?
Enfin, vous m'avez fait savoir que vous pourriez aussi faire un point sur l'élection présidentielle au Liban. Il semblerait qu'il soit enfin possible de sortir du blocage politique qui sévit depuis 2014 dans ce pays qui nous est cher.
Je remercie votre commission de me recevoir pour cette audition.
Nous avons effectivement organisé à Paris deux réunions importantes sur l'Irak : la première a rassemblé, le 20 octobre dernier, vingt-trois pays et trois organisations internationales sur le thème de l'organisation de Mossoul après Daech ; la deuxième, qui est en train de s'achever en ce moment, réunit les ministres de la défense du « petit groupe » – small group – de la coalition internationale, c'est-à-dire les États de la coalition qui participent aux opérations militaires aux côtés des forces armées irakiennes.
La première réunion avait pour fonction de traiter un certain nombre de questions de nature politique que la victoire militaire sur Daech à Mossoul allait soulever immédiatement.
Il s'agissait, premièrement, de questions humanitaires : dans la mesure où l'offensive militaire sur Mossoul va très probablement provoquer des déplacements de population très importants – l'Organisation des Nations unies (ONU) parle de plusieurs centaines de milliers de personnes –, il faut naturellement être prêt à les recueillir dans des conditions adéquates.
Deuxièmement, il était nécessaire d'obtenir des engagements politiques de la part du gouvernement irakien, avec lequel nous avons coorganisé cette réunion. D'une part, il fallait s'assurer qu'il y aurait un accord politique avec les Kurdes sur la façon d'organiser l'offensive. Cet accord politique avait été annoncé par le premier ministre irakien, M. Al-Abadi, au Président de la République au cours de leur entretien à New York il y a quelques semaines. Depuis lors, il a été confirmé par M. Al-Abadi, ainsi que par son ministre des affaires étrangères, M. Al-Jaafari, au cours de ladite conférence. D'autre part, nous avions besoin d'assurances sur le rôle des différents groupes armés qui participent aux combats, qu'il s'agisse des forces armées irakiennes, des Kurdes, ou des milices populaires. Nous voulions notamment que le gouvernement irakien s'engage à ce que ni les Kurdes ni les milices populaires – qui sont exclusivement chiites – n'investissent la ville et n'en prennent le contrôle après l'éviction de Daech, et à ce que soit installée dans la ville une forme de gouvernance respectueuse des populations civiles. De ce point de vue, les propos tant de M. Al-Abadi depuis Bagdad que de M. Al-Jaafari pendant la conférence ont visé à donner ces assurances aux États rassemblés à Paris.
Troisièmement, il fallait mener une discussion sur les conditions de la « stabilisation » de Mossoul, terme qui relève en effet du jargon diplomatique et signifie le retour à un ordre civil normal, avec la fourniture des services publics et le bon exercice des fonctions régaliennes de maintien de l'ordre, dans le respect des populations. À cet égard, il doit y avoir à la fois une mobilisation internationale afin d'apporter les ressources nécessaires au gouvernement irakien et aux différents participants et un engagement du gouvernement irakien à ce que cela soit fait dans de bonnes conditions.
La réunion d'aujourd'hui des ministres de la défense du « small group » avait pour objectif, d'une part, de partager les plans opérationnels entre ministres de la défense – n'ayant pas participé à cette réunion, je n'entrerai pas davantage dans le détail – et, d'autre part, de maintenir la mobilisation de la coalition pour la poursuite des opérations contre Daech une fois Mossoul libérée. Un certain nombre de questions se posent sur ce qu'il convient de faire lors de l'offensive sur Mossoul. Il faut notamment régler la question, absolument capitale, des civils, c'est-à-dire limiter les pertes civiles et s'assurer qu'il n'y aura pas de représailles et, dans le même temps, s'assurer que les combattants de Daech ne profiteront pas du départ des civils pour se dissimuler parmi eux et rejoindre d'autres fronts, en particulier à Rakka en Syrie. C'est la question de la dispersion des combattants, que le Président de la République a évoquée récemment. Il faut donc s'assurer que les opérations militaires sont conduites de telle manière que l'on réduise effectivement la menace de Daech. À défaut, il faudra reprendre le travail ailleurs. Enfin, il y avait, je l'ai dit, la question de l'administration de la ville de Mossoul.
La réunion a permis de constater qu'une question se pose à propos de la relation entre la Turquie et l'Irak, ainsi que vous l'avez indiqué. Elle a une dimension structurelle, à savoir la présence non désirée par les autorités irakiennes de troupes turques sur le territoire irakien, et une dimension conjoncturelle, à savoir la volonté affichée par les Turcs de participer aux opérations militaires. Les Irakiens ont une fois de plus marqué leur opposition sur ces deux points, tandis que les Turcs ont une fois de plus affirmé qu'ils étaient déterminés à rester en Irak le temps qu'ils le jugeraient nécessaire et à participer aux opérations. Les Américains et les Turcs, d'une part, et les Européens et les Turcs, d'autre part, mènent en ce moment même d'intenses discussions à ce sujet afin de trouver une solution qui soit respectueuse de la souveraineté de l'Irak. Pour le gouvernement français, l'objectif essentiel est de rétablir l'Irak dans la plénitude de sa souveraineté, de faire en sorte que son intégrité territoriale soit pleinement respectée. À cet égard, je vous signale que, lors de leur entretien à New York, le premier ministre Al-Abadi a indiqué au Président de la République qu'il voulait conduire, avec le président du gouvernement régional kurde, M. Barzani, un dialogue sur l'avenir du Kurdistan au sein de l'Irak.
S'agissant de la Syrie, l'ensemble des éléments que vous a indiqués le ministre des affaires étrangères, M. Jean-Marc Ayrault, lorsque vous l'avez auditionné à la fin du mois dernier, restent d'actualité.
Vous avez pu observer que, après trois jours de trêve, le régime et ses alliés ont repris leurs bombardements sur Alep et leurs offensives sur un certain nombre de villes assiégées, notamment Hama. Les troupes à l'offensive comptent 20 000 à 30 000 hommes. Elles sont en partie syriennes et iraniennes, mais comprennent aussi des forces du Hezbollah, des milices populaires et des milices chiites rassemblées par l'Iran, et bénéficient d'un appui aérien russe dont vous connaissez l'ampleur. En face, il y a, pour autant que l'on sache, environ 10 000 insurgés.
L'un des débats politiques les plus sensibles porte sur le nombre et l'emprise des combattants du Jabhat al-Nosra – qui s'appelle désormais Jabhat Fatah al-Cham – au sein de ce groupe. D'après les Russes, 90 % des insurgés sont issus d'al-Nosra ou y sont affiliés. Selon les estimations de M. Staffan de Mistura, envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, 500 à 800 combattants sur 10 000 appartiennent à al-Nosra. Quant aux sources dont nous disposons, elles nous indiquent un nombre inférieur à 500.
Ce débat est important, car la discussion sur le cessez-le-feu, qui n'a pas vraiment repris ces derniers jours, portait sur le point de savoir comment les djihadistes de l'ex-al-Nosra pouvaient être évacués d'Alep, de telle sorte que les bombardements s'arrêtent. Notre position était que l'arrêt des bombardements constituait un préalable à toute discussion sérieuse sur ce point, alors que les Russes et le régime syrien disaient que les bombardements ne pourraient s'arrêter qu'après une telle évacuation. Ceux-ci ont accepté de suspendre les bombardements trois jours, mais, pendant ces trois jours, l'aide humanitaire n'a pas pu accéder à Alep, les civils n'ont pas pu en partir, et les combattants ne l'ont pas davantage quittée, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'accord sur les modalités d'une opération de cette nature.
Dès lors, nous nous trouvons face à une situation extrêmement difficile : les Russes et le régime syrien accusent l'ex-al-Nosra de prendre en otage les populations civiles, tandis que l'opposition refuse toute évacuation tant qu'il n'y aura pas de garanties concernant, d'une part, le traitement de ceux qui partent et, d'autre part, l'administration de la partie orientale de la ville après le départ des troupes. En réalité, on n'est nulle part, et l'offensive du régime appuyé par la Russie se poursuit. Son objectif est la reconquête de la partie orientale de la ville, les Syriens appliquant une méthode qu'ils utilisent fréquemment depuis quelque temps : ils coupent la poche de résistance en deux, empêchent les accès des uns et des autres et réduisent ladite poche en deux temps.
Comment se positionnent les différentes parties ?
La Turquie a lancé une offensive contre les parties du territoire syrien occupées par les Kurdes du Parti de l'union démocratique (PYD), avec l'objectif de casser la puissance militaire de celui-ci, qu'elle estime organiquement lié au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Dans le même temps, elle a intensifié ses opérations contre Daech, tant en Syrie que sur son propre territoire. Son opposition à Daech est manifeste depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois. Elle a aussi repris contact avec la Russie, après une brouille longue et très dure. Elle a donc adopté une autre politique, qu'il est cependant difficile de décrire avec précision, car certains de ses aspects sont en mutation depuis la tentative de coup d'État avortée de juillet dernier.
Pour ce qui est des États du Golfe, le Qatar et l'Arabie saoudite ont participé aux discussions de ces derniers jours à Lausanne, aux côtés des États-Unis et de la Russie, à propos de la séparation entre l'ex-al-Nosra et les autres groupes, mais celles-ci n'ont pas abouti à un accord. Les Émirats arabes unis sont, quant à eux, plutôt en retrait dans ces discussions.
Quelle est notre propre position ?
Premièrement, nous continuons à rappeler, ainsi que le Président de la République et le ministre ont eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises, que l'arrêt des bombardements est un préalable absolu. Les bombardements de structures civiles, en particulier d'hôpitaux et de lieux dans lesquels il n'y a pas de présence militaire, sont évidemment contraires au droit humanitaire et, même, constitutifs de crimes de guerre, ainsi que l'a rappelé le Secrétaire général de l'ONU.
Deuxièmement, nous rappelons que l'accès de l'aide humanitaire aux zones assiégées – le régime assiège actuellement quelque seize villes, où vivent 850 000 habitants – est également une obligation internationale que le régime doit accepter sans aucune précondition ni restriction. M. Staffan de Mistura et le coordonnateur de l'action humanitaire de l'ONU en Syrie continuent à donner chaque jour la liste très précise des refus d'accès à l'aide humanitaire ou des possibilités d'accès sporadiques.
Troisièmement, nous rappelons sans cesse qu'il n'y aura pas de solution militaire à ce conflit, et que la seule solution, c'est la reprise d'un dialogue politique. Je me réfère à ce que le ministre a eu l'occasion de vous dire le mois dernier à ce sujet. Les développements de ces dernières semaines montrent que les Syriens du régime, avec l'appui, entre autres, des Russes et des Iraniens, arrivent à réduire une partie de l'opposition modérée, mais que, d'une part, ils laissent entier le problème de Daech, qu'ils n'attaquent pas, et que, d'autre part, plus les combats et les bombardements se poursuivent, moins il sera possible de rétablir un dialogue politique normal.
J'en viens à la situation au Liban. Un accord inattendu est intervenu récemment entre M. Saad Hariri et le général Aoun pour que le Courant du futur soutienne ce dernier à l'élection présidentielle. Le Hezbollah a déclaré qu'il donnait, lui aussi, son appui à la candidature du général Aoun, et un certain nombre d'autres groupes politiques importants ont annoncé leur soutien à ce développement. Il est donc possible, sinon probable, qu'un nouveau tour de scrutin ait lieu au parlement libanais le 31 octobre prochain et qu'un président de la République soit élu à cette occasion, après une vacance de deux ans à la tête de l'État libanais.
Il est encore trop tôt pour savoir avec certitude si cela se fera ou non et pour exprimer publiquement des positions à ce sujet. Il est cependant certain que, si cet accord pour l'élection présidentielle s'accompagne d'un accord sur la formation d'un gouvernement qui puisse fonctionner, alors c'est une nouvelle perspective qui s'ouvre pour le Liban, tout à fait positive à trois égards.
Premièrement, en termes économiques et financiers. Le pays traverse une mauvaise phase du fait de la paralysie des institutions. La reprise d'un fonctionnement institutionnel normal permettra à la fois une mobilisation financière au profit du Liban et une reprise de l'activité économique.
Deuxièmement, en termes de sécurité. Pendant ces mois de vacance institutionnelle, les partis politiques se sont entendus pour que les services de sécurité continuent à fonctionner de manière minimale, notamment pour lutter contre Daech et les autres groupes djihadistes. Néanmoins, il va de soi que ces accords, en quelque sorte « intérimaires », gagneront à être consolidés par l'existence d'un gouvernement qui soit en mesure de reprendre un dialogue de sécurité normal avec l'ensemble des partenaires du Liban.
Troisièmement, au regard de la question de la « dissociation », pour reprendre ce joli terme utilisé par les Libanais. Il s'agit de faire en sorte que le Liban ne subisse pas le contrecoup de la crise syrienne ou, en d'autres termes, que les divisions entre les différents partis libanais sur la question syrienne n'aient pas d'impact sur fonctionnement interne du Liban.
Je termine par l'initiative française pour relancer le processus de paix au Proche-Orient. Nous avons effectivement organisé une conférence le 3 juin dernier, qui a rassemblé vingt-neuf États et organisations internationales, afin de réaffirmer, de façon extrêmement solennelle, que la solution des deux États était la seule solution à laquelle la communauté internationale pouvait donner son appui dans une perspective de règlement de la question israélo-palestinienne. Pourquoi cette conférence ? Tout simplement parce que l'absence de négociation, la poursuite de la colonisation à un rythme accéléré et le blocage de tout progrès entre Israéliens et Palestiniens est en train de creuser un fossé entre les deux parties, ce qui rend de plus en plus difficilement concevable la mise en oeuvre, à terme, de cette solution des deux États. Il était donc important que la communauté internationale dise à Israël et à la Palestine qu'il était temps de se remettre à la table des négociations.
Lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le Président de la République a réaffirmé l'objectif d'une grande conférence à la fin de l'année, et le ministre a rassemblé les envoyés spéciaux des pays qui avaient participé à la conférence du 3 juin, participé à une réunion des bailleurs de fonds et rendu compte des progrès accomplis au Quartet, c'est-à-dire au Secrétaire général des Nations unies, au ministre russe des affaires étrangères, au secrétaire d'État américain et à la Haute Représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
Ces progrès sont de deux ordres. D'une part, un certain nombre de groupes de travail, mis en place à la suite de la conférence du 3 juin, ont travaillé, premièrement, sur la consolidation des institutions de l'État palestinien, deuxièmement, sur la construction d'un appui économique à l'État palestinien lorsqu'il y aura un accord et, troisièmement, sur les sociétés civiles, point auquel les Suédois, en particulier, sont très attachés. Une conférence de bilan réunira après-demain, 27 octobre, à Paris, les envoyés spéciaux des pays participants, sous la présidence de M. Pierre Vimont, envoyé spécial du ministre sur cette question.
D'autre part, il faut travailler sur les paramètres, en particulier sur le statut de Jérusalem, la question des réfugiés, la question des frontières et la question de la colonisation. C'est évidemment un sujet très compliqué. Là encore, M. Pierre Vimont va engager une série de contacts avec les partenaires de la région et les partenaires occidentaux pour voir comment aborder la question des paramètres dans le cadre de la conférence.
Quelle est la perspective ?
Je reprends une remarque que fait souvent le ministre : la question israélo-palestinienne, qui était, disait-on usuellement, passée au deuxième plan des préoccupations de la communauté internationale, est remise au premier plan grâce à cette initiative, qui remobilise les diplomaties des pays arabes, des pays européens, des États-Unis et d'Israël autour de la reprise des négociations entre les deux parties. On ne doit pas se faire d'illusions, ni s'imaginer que cela sera facile : la période électorale aux États-Unis ne simplifie pas les choses ; nous sommes face à un gouvernement israélien qui dit et répète qu'il n'acceptera que des négociations bilatérales et sans précondition avec les Palestiniens ; nous sommes face à une Autorité palestinienne affaiblie du point de vue politique et financier, dont la capacité d'action est réduite, compte tenu de la situation dans laquelle elle se trouve.
Dans les prochaines semaines, les groupes de travail vont poursuivre leurs travaux afin d'élaborer, en quelque sorte, le « paquet d'accompagnement » d'une reprise des négociations, et nous allons poursuivre notre travail sur les paramètres, en vue d'organiser, d'ici à la fin de l'année, une conférence qui rassemblerait la communauté internationale autour des parties. L'objectif est non pas tant de relancer la négociation entre les parties devant la communauté internationale – car nous savons que les Israéliens ne veulent pas d'une telle négociation – que de faire en sorte qu'Israéliens et Palestiniens soient face à face dans une logique et un parcours de reprise de la négociation. C'est un peu indirect et contourné, mais c'est la voie que nous cherchons à explorer, notamment avec les Américains, pour remettre cette question à l'ordre du jour.

Concernant le Liban, l'accord entre M. Hariri et le général Aoun n'est-il pas la marque d'un retrait de l'Arabie saoudite ? M. Hariri a tout de même eu quelques démêlés avec l'Arabie saoudite.
À propos de l'Arabie saoudite, d'ailleurs, vous n'avez rien dit au sujet du Yémen. Or le conflit au Yémen soulève de multiples problèmes, y compris celui du soutien que nous apportons parfois à l'Arabie saoudite. La question est de savoir jusqu'où on va en la matière.
En ce qui concerne l'affaire irakienne, vous avez relevé à juste titre les difficultés avec la Turquie. Hier, certains d'entre nous sont allés à la résidence de l'ambassadeur d'Iran écouter M. Alaeddin Boroujerdi, président de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du parlement iranien. On voit très bien qu'il y a actuellement des tensions fortes et que cela aura des conséquences à l'avenir sur tous les plans.
S'agissant de la Syrie, vous avez indiqué que, selon M. Staffan de Mistura, il y aurait, au sein des 10 000 insurgés, à peine un millier de combattants du Jabhat Fatah al-Cham, qui serait la reconduction du Jabhat al-Nosra. Mais qui sont donc les autres ? Vous n'allez tout de même pas nous dire que ce sont ces braves démocrates que l'on croise dans les salons parisiens, notamment au Hilton ! Cela ne tient pas la route un instant ! Pour ma part, je ne confierais pas mes intérêts à ces insurgés ! Ces gens ne seraient pas des islamistes ? Je n'en crois pas un mot ! Je vous le dis comme je le pense.
En Syrie, on est actuellement dans l'impasse. Et je ne vois pas très bien comment on va faire à Rakka, qui serait l'étape suivante après Mossoul. La question d'un engagement des Français au sol se pose. Nous avons déjà des batteries d'artillerie engagées à Mossoul.

C'est une de trop ! Cela soulève un problème : pouvons-nous nous engager ainsi sur le terrain alors que nous sommes engagés ailleurs ? Comment allons-nous faire pour coordonner tout cela ? Je crains fort que nous n'ayons pas vraiment la capacité de peser sur l'ensemble de ces conflits.

Il a effectivement été très peu question du Yémen. J'aimerais savoir, si c'est possible, quel est exactement notre engagement et quelle est notre position actuelle sur ce dossier.
D'après les informations dont je dispose, la cellule de crise du Quai d'Orsay aurait été contactée à plusieurs reprises par des familles de Français djihadistes engagés au Moyen-Orient et se serait occupée de les rapatrier en France. Est-ce vrai ou est-ce une fausse information ?
Je rejoins en partie mon collègue Jacques Myard : si je schématise votre présentation – veuillez m'en excuser –, les Irakiens et les Américains ont en face d'eux de vrais terroristes et des djihadistes, alors que les Syriens et les Russes ont en face d'eux des innocents et des gentils. J'ai, moi aussi, beaucoup de mal à croire que, sur 10 000 combattants, il y ait à peine un millier de vrais terroristes et que les autres soient de gentils démocrates. D'où tenons-nous ces chiffres ? Qui nous informe réellement ? Pour être clair, la France dispose-t-elle de ses propres moyens de renseignement sur ce point ? Ou bien reprenons-nous tout simplement ce que nous donnent les Américains ou d'autres pays ? Lors de l'audition du ministre des affaires étrangères il y a trois semaines, j'ai eu l'impression que nous étions, comme on dit dans le Midi, « à la ramasse » pour obtenir des informations. Le ministre nous a lui-même indiqué qu'il attendait que les Américains lui communiquent un certain nombre d'informations.

J'appartiens à la majorité mais, comme mes deux collègues de l'opposition qui viennent de s'exprimer, je trouve que l'analyse et le chiffrage des acteurs – si j'ose dire – du drame d'Alep semblent totalement fantaisistes. Peut-être ces éléments sont-ils manipulatoires d'ailleurs, même si l'intention ne vient pas du Quai d'Orsay. Dans cette distinction entre les bons et les méchants, les premiers sont forcément les rebelles qui, quand ils sont triés, le sont d'une façon absolument farfelue. On connaît les deux branches d'al-Qaïda en Syrie ; on n'ignore pas le rôle que jouent l'Arabie saoudite et le Qatar dans leur financement ; on sait très bien qu'il y a absolument de tout parmi ceux que vous continuez à appeler les rebelles ou les insurgés. Il y a eu de nombreuses reconversions mais elles se sont opérées dans le mauvais sens, c'est-à-dire en faveur du djihadisme. Vous ne l'avez pas dit vous-même aujourd'hui, mais certains représentants du Quai d'Orsay prétendent qu'il n'y a plus de djihadistes à Alep. C'est totalement insupportable, étant donné la situation.
Dans le même temps, on entend dire que M. Poutine doit être traduit devant la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye alors qu'on ferme les yeux sur les agissements de nombreux chefs d'État dont on pourrait parler. Mais je préfère ne pas en parler, pas plus que de la CPI. Malheureusement, la continuité de l'incohérence de la politique syrienne de la France depuis plus de dix ans nous fait très mal. Certains d'entre nous et nombre d'observateurs aimeraient que vous ayez raison mais restent persuadés que vous persistez dans l'erreur.

Ma question tangente celles de mes trois collègues qui viennent de s'exprimer. Monsieur le directeur, comment pouvez-vous nous expliquer qu'il faut arrêter net tout bombardement sur Alep où il n'y aurait que des modérés ? Il n'y a pas de modérés dans une guerre, il y a des belligérants de part et d'autre. En Syrie, des factions affrontent une armée constituée, l'armée syrienne et ses alliés. Il y a, de part et d'autre, des gens qui se font la guerre, et on ne se fait pas la guerre modérément. Penser le contraire relève d'une démarche purement intellectuelle. Dans l'horreur, tout le monde s'égale. Ceux qui prônent l'arrêt immédiat des bombardements sur Alep trouvent formidable le fait que nous ayons un porte-avions d'où partent des milliers de frappes vers Mossoul. Effectivement, nous avons envoyé une batterie de canons Caesar, ce qui se fait de plus performant au monde en la matière. Je ne comprends pas que vous puissiez avoir une vision aussi binaire de ce qui se passe dans ce monde.
Je voudrais aussi appuyer la question de mon collègue Mariani. La coalition est aux portes de Mossoul où il y a plusieurs centaines de ressortissants français. Certains vont y rester et d'autres seront faits prisonniers. Qu'a-t-on envisagé pour ces derniers ? Pour autant que je sache, nous n'avons aucun accord avec l'Irak. Les Turcs nous renvoient très gentiment les Français qu'ils capturent. Que font faire les Irakiens ? Vont-ils les garder ou s'en séparer ? J'opterais plutôt pour la deuxième solution.

Tout d'abord, j'aimerais dire que je ne comprends pas bien la question de notre collègue Mariani sur l'implication des services du Quai d'Orsay dans le rapatriement de djihadistes français. Plusieurs consulats de cette région s'occupent de cela depuis des années et s'occupent de djihadistes plus ou moins repentis qui demandent l'aide des services du Quai d'Orsay. C'est bien normal. Au passage, je signale que nos diplomates en retirent un acquis d'expérience, un savoir-faire en faisant des entretiens personnalisés avec chacun de ces djihadistes repentis qui passent par vos services. Ils établissent des fiches, dont ils alimentent les services, pour essayer de définir le profil de ces jeunes Français sur le point de revenir. Cela existe depuis longtemps et je ne sais pas s'il y a quelque chose de nouveau dans ce domaine.
Ensuite, je voudrais revenir sur le conflit syrien. Je ne suis pas l'avocat de M. Bonnafont, mais je voudrais dire que je n'ai pas trouvé son exposé binaire. Il règne une confusion extrême dans cette région et en particulier en Syrie. Pour alimenter le débat, je voudrais raconter ce que j'ai vu de mes propres yeux dans le sud du Liban où j'étais allé rendre visite à un régiment de parachutistes de Tarbes. Les parachutistes se trouvaient sur la ligne de démarcation entre le Liban et Israël, à quelques kilomètres du Golan. J'entendais les tirs de canon échangés entre le Hezbollah et Jabhat al-Nosra. En vertu de l'adage « les ennemis de mes ennemis sont mes amis », Israël soutient quasi explicitement Jabhat al-Nosra dont les blessés sont soignés dans les hôpitaux israéliens. Si cela n'ajoute pas à la confusion ! Si cela n'incite pas à ne pas être binaire ! C'est une mosaïque épouvantable et indébrouillable, si j'ose dire. Je ne plaide pas pour une binarité que je n'ai d'ailleurs pas sentie dans l'exposé de M. Bonnafont.

Monsieur le directeur, êtes-vous sûr que dans la délégation syrienne, reçue la semaine dernière à l'Assemblée nationale et à l'Élysée, il n'y avait pas d'anciens membres de Jabhat al-Nosra qui auraient porté le fusil et se seraient livrés au djihadisme ou à des opérations de guérilla ?
La France et d'autres pays ont proposé de saisir la CPI au sujet des bombardements effectués à Alep par Bachar Al-Assad et Vladimir Poutine. Et nous nous engageons à Mossoul. Rappelons qu'en 2004, 200 marines sur les 15 000 engagés et 2 000 civils ont été tués lors des combats de Falloujah. Il n'y a pas de raison que les opérations soient beaucoup plus faciles à Mossoul. Nous allons donc intervenir avec des avions de chasse, embarqués ou non, et les fameux canons Caesar. N'allons-nous pas être amenés à frapper, involontairement, des écoles et des hôpitaux dans lesquels se seront réfugiés les méchants ? Étant un peu binaire, je crois qu'il y a des bons et des méchants dans ce monde, sinon on ne sait plus trop où on en est. N'allons-nous pas être amenés à commettre nous aussi des actions de guerre qui pourraient nous renvoyer un jour devant la CPI – peut-être pas à l'initiative de M. Poutine parce qu'il n'est pas méchant ?
Je n'avais pas prévu de parler du Yémen qui n'était pas à l'ordre du jour mais, puisque quelques questions ont été posées, je peux rajouter ce point.
Suite à l'offensive des Houthis, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution qui rappelle plusieurs choses : il y a au Yémen un gouvernement légitime qui doit être respecté ; il s'agit d'un gouvernement transitoire puisque de nouvelles élections doivent être organisées ; la communauté internationale soutient ce gouvernement légitime et rejette l'offensive des rebelles Houthis.
Nous entretenons un dialogue quotidien avec l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, un Mauritanien, qui a été nommé pour conduire des négociations entre les Houthis et le gouvernement yéménite. Ces négociations visent, d'une part, à instaurer une trêve, et, d'autre part, à créer les conditions d'un dialogue politique. Notre ligne d'action consiste à rappeler deux choses : la légalité ; le fait que le Yémen ne pourra sortir de cette impasse que par la négociation politique et non par une solution militaire. Le ministre a eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises sur ce point.
Il y a quelques jours, nous avons reçu l'envoyé spécial à Paris. De cet entretien nous avons compris qu'il faisait porter la responsabilité première de l'échec des négociations sur les Houthis. C'est ainsi. Pour quelles raisons ? Les Houthis voient bien ce qu'ils perdraient à arrêter les opérations militaires mais ils ne voient pas ce qu'ils gagneraient à entrer dans un jeu politique normal : ils représentent une minorité dans le pays et il est plus agréable pour eux d'exercer le pouvoir, y compris en se battant, que d'y renoncer (ndr : dans l'intervalle, le président légitime, Adb Rabbo Mansour Hadi, a rejeté également le plan de paix des Nations Unies…).
Interrogé sur l'existence d'autres acteurs dans ce jeu, l'envoyé spécial nous a cité l'ancien président, Ali Abdallah Saleh, et l'Iran. Ali Abdallah Saleh dispose de moyens financiers, politiques et militaires considérables, et il alimente la rébellion alors qu'il luttait de façon extrêmement déterminée contre les Houthis quand il était président. Quant à l'Iran, il profite de l'occasion pour envoyer des armes aux rebelles de façon à coincer l'Arabie saoudite et sa coalition au Yémen pendant que d'autres conflits se déroulent ailleurs.
Pour l'envoyé spécial, l'Arabie saoudite a accepté des choses qui – de ce que nous avons compris – étaient inespérées selon lui. Voilà la présentation que nous a faite l'envoyé spécial de l'ONU dont chacun sait que son rôle de médiateur lui impose de ne pas prendre parti.
Ne déduisez pas de mon propos que les opérations militaires nous satisfont. À plusieurs reprises, le ministre a exprimé notre condamnation d'un certain nombre de bombardements, notamment de celui qui a été effectué au moment des funérailles d'un dignitaire à Sanaa et qui a conduit à un bilan humain extrêmement lourd. Le gouvernement d'Arabie saoudite a d'ailleurs annoncé une enquête, ce qui représente un développement important.
En résumé, notre action au Yémen est simple : pousser les parties à conclure un accord le plus rapidement possible. Nous parlons à tout le monde, que ce soit avec les Houthis, les partisans du président Saleh, le gouvernement ou nos partenaires. Notre ambassadeur au Yémen, qui est en résidence à Riyad, passe son temps à faire la navette. Il faut qu'un accord intervienne très vite parce que le Yémen est un pays extrêmement pauvre et vulnérable : al-Qaïda et Daech profitent des circonstances pour consolider leurs implantations et faire de ce pays un nid d'aigles dans lequel ils pourront se réfugier le moment venu. Nous avons donc toutes les raisons de vouloir qu'au Yémen les opérations militaires se terminent et que la négociation politique connaisse un résultat positif.
Concernant le Liban, Saad Hariri avait essayé de nouer avec Sleiman Frangié une alliance un peu particulière compte tenu des relations entretenues par ce dernier avec la Syrie. Saad Hariri pensait que cette alliance aurait le soutien du Hezbollah et de l'Iran, ce qui n'a pas été le cas, alors que l'Arabie saoudite avait indiqué qu'elle n'avait pas de raison de ne pas accepter un accord noué par les Libanais. Face à cet échec, Saad Hariri a décidé de reprendre les négociations avec Michel Aoun, il y a quelques semaines, et ils sont parvenus à cet accord.
Qu'en disent les puissances régionales ? Vous posez la question à juste raison. Nous avons interrogé l'Iran comme vous l'avez peut-être fait vous-mêmes hier à l'occasion de la visite de M. Alaeddin Boroujerdi, le président de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien. L'Iran a confirmé son soutien au général Aoun et le résultat positif d'une élection présidentielle. C'est un développement important dont nous verrons l'issue le 31 octobre. Quant à l'Arabie saoudite, elle a reconfirmé qu'elle ne mettrait pas de veto à une formule recueillant l'accord des Libanais.
Dans un deuxième temps, une autre question se posera : avons-nous l'assurance qu'il y aura un gouvernement capable de reprendre rapidement en main les affaires du pays, compte tenu de la période intérimaire s'étendant jusqu'aux élections législatives qui doivent avoir lieu en juin prochain ? Comment organiserons-nous le soutien international à l'action de ce gouvernement, en particulier en matière de rétablissement économique et financier ? Ce double chapitre s'ouvrira après le 31 octobre : travail intérieur de Saad Hariri pour former rapidement un gouvernement efficace avec l'appui des parties qui ont permis l'élection du général Aoun ; travail de la communauté internationale pour apporter au Liban le soutien dont il aura besoin.
La situation entre l'Irak et la Turquie est extrêmement tendue et dangereuse, je ne peux que vous le confirmer. Le ministre était hier en Turquie où il a abordé cette question avec ses interlocuteurs pour voir dans quelle mesure on peut clarifier les choses et assainir cette situation.
Sur la Syrie, je suis alimenté d'informations qui viennent de nos services de renseignement, de la direction du renseignement militaire (DRM), de nos ambassades des pays alentours et des interlocuteurs de toute sorte et de toutes origines que nous pouvons avoir, qu'ils soient Libanais, Saoudiens, Turcs, Syriens émigrés ou autres. On peut considérer que la France ne dispose pas d'une capacité d'analyse autonome. Ma conviction est que la France dispose d'une capacité d'analyse autonome qui lui permet de dire avec une grande vraisemblance que ce qui est en train de se passer à Alep n'est pas un assaut du régime et de ses soutiens – l'Iran, le Hezbollah et la Russie – contre des terroristes. Non, ce n'est pas cela qui se passe, ce n'est malheureusement pas cela qui se joue.
Prenons un élément que vous connaissez : l'objectif des frappes russes et syriennes au cours de ces derniers mois. Nos statistiques nous montrent qu'entre 70 % et 90 % de tirs ne visent pas Daech ou l'ex-Jabhat al-Nosra. Ce sont des informations. Vous pouvez dire que ce sont des mensonges, de la polémique mais ce sont les informations que nous donnent ceux qui, dans l'appareil d'État, sont chargés par la République de regarder ce qui se passe. C'est ainsi.
Prenons un deuxième élément : le choix stratégique effectué ces derniers temps par le régime et ses alliés. Ils auraient pu décider d'aller vers Rakka, considérant que la prise de cette ville était prioritaire. Tandis que la coalition en Irak reprendrait Mossoul, la coalition « menée par les Russes » aurait repris Rakka. En fait, il a été décidé de laisser Rakka tranquille et d'aller prendre Alep.
On a le droit de considérer que des gens qui, depuis cinq ans, se battent contre un régime de la nature de celui de Bachar Al-Assad ne sont que des terroristes. Ce n'est pas du tout la position du Gouvernement, ni ce que nous retenons des observations de terrain.
Prenons d'autres chiffres, désagréables, qui nous viennent de l'ONU : le conflit a fait entre 300 000 et 400 000 morts ; dans 90 % des cas, ces morts ont été causées par le régime.
Pas du tout, monsieur le ministre, ce sont les chiffres de l'ONU. Vous pouvez critiquer l'ONU, ce sont ses chiffres. Parmi les 250 000 disparus répertoriés, il y a des Français et, pour l'un d'entre eux, une procédure judiciaire a été engagée. Ces 250 000 personnes ont disparu, sans laisser de trace, dans les prisons du régime. Quant aux réfugiés, sunnites dans leur écrasante majorité, ils sont quatre millions à avoir fui le régime. Ils n'ont pas fui Daech ou l'ex-Jabhat al-Nosra, ils ont fui le régime. Ils se répartissent de la manière suivante : 1,2 million au Liban, ce qui entraîne les conséquences que vous connaissez ; 1,2 million en Jordanie ; 2 millions en Turquie ; des centaines de milliers en Europe, au Canada, etc. Enfin, il y a entre 6 millions et 8 millions de personnes déplacées. Ces personnes ne peuvent plus habiter chez elles, pour des raisons qui ne tiennent ni à Daech ni à Jabhat al-Nosra.
Tous ces faits disent que, depuis cinq ans, la population syrienne est soumise à un régime politique qu'elle rejette à une écrasante majorité.
Non, ce n'est pas la guerre, monsieur le ministre, c'est le régime politique. Cela a commencé en 2011, je vous le rappelle, par des manifestations parfaitement pacifiques qui ont été réprimées dans le sang. Tous les alliés arabes de Bachar Al-Assad lui ont conseillé de négocier avec les manifestants et d'organiser un semblant d'évolution politique. Jamais, a-t-il répondu à tous. Et il a lancé la répression aveugle qui a conduit à la situation actuelle.
Il existe une opposition dont vous dites qu'elle est constituée de salonards parisiens. Je vous laisse la responsabilité de cette affirmation. Cette opposition, rassemblée dans une coalition compliquée à mettre en place, s'est dotée d'un document politique qui exprime l'aspiration à une Syrie unie qui respecte ses minorités et les croyances de chacun. C'est un document politique extrêmement important.
Pour notre part, nous avons conduit notre politique selon deux principes : concentration de nos moyens militaires sur Daech ; absence totale de complaisance à l'égard de l'ex-Jabhat al-Nosra, groupe listé parmi les organisations terroristes par l'ONU. Au sein du groupe international de soutien, nous avions même commencé à faire avec la Jordanie un travail visant à trouver un consensus sur la nature de chacun des groupes. Les Russes et les Iraniens n'ont pas voulu poursuivre ce travail, ce qui est assez dommage.
En ce qui concerne la CPI, nous avons engagé une réflexion sur ces crimes de guerre commis à Alep. Là encore, l'expression est celle du secrétaire général de l'ONU et non pas la nôtre. Bombarder systématiquement des infrastructures civiles dans une ville, cela s'appelle un crime de guerre et non un acte de guerre. Ce crime est condamné par les conventions de Genève et donne lieu à des poursuites devant la CPI. Nous avons engagé une réflexion qui n'est pas évidente : d'une part, la Syrie n'est pas partie aux statuts de la CPI ; d'autre part, un ou même deux pays opposeront leur veto au conseil de sécurité sur cette hypothèse. Il faut réfléchir à la manière de s'y prendre.
S'agissant d'une éventuelle mise en cause de la France devant la CPI, je vous rappelle ce que le ministre et d'autres membres du Gouvernement ont eu l'occasion de vous dire à plusieurs reprises sur les règles d'engagement de nos forces dans le combat contre Daech. Ces règles sont extraordinairement rigoureuses en ce qui concerne l'attention portée à éviter des pertes civiles, à éviter des objectifs civils, y compris dans l'hypothèse où il y aurait une « prise en otage » de la part des groupes terroristes.

Je vous ai écouté avec grand intérêt mais permettez-moi d'avoir quelques doutes.
Il faut en effet prendre en compte les manipulations qui peuvent venir des uns et des autres. De l'aveu même du chef des services secrets turcs (le Millî İstihbarat Teşkilatı ou MİT), la Turquie a livré l'équivalent de 2 400 camions d'armes aux insurgés. Les journalistes qui ont rapporté cette déclaration ont ensuite été réprimés.
Face à une guerre civile qui se prolonge et des interférences de cette nature, permettez-moi d'être extrêmement prudent et de ne pas avoir les convictions que vous venez de nous asséner. Je vous le dis en toute amitié.

Devant cette commission, un ministre n'a pas nié que nous avions donné un coup de main à Jabhat al-Nosra, notamment en lui fournissant des fusils d'assaut Famas.

Pouvez-vous nous dire un mot du rôle des consuls dans le rapatriement de djihadistes français ?
Excusez-moi, j'avais compris à tort que la question de M. Mariani était relative au seul Yémen. Je ne peux pas vous donner d'informations plus précises que celles contenues dans le propos de M. Glavany. Je m'engage, si vous le souhaitez, à vous apporter une réponse écrite dans les plus brefs délais.

Il me reste à vous remercier au nom de tous mes collègues, monsieur le directeur. Nous aurons sans doute l'occasion de vous réinviter très bientôt.
La séance est levée à dix-huit heures.