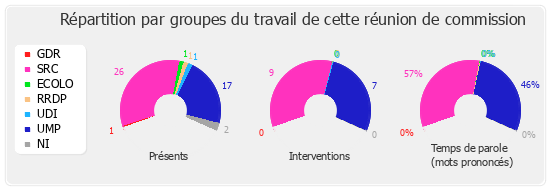Commission des affaires étrangères
Réunion du 13 novembre 2013 à 9h00
La réunion
La séance est ouverte à neuf heures cinquante-cinq.

Nous recevons aujourd'hui MM. Hubert Védrine et Lionel Zinsou, que je remercie d'avoir accepté notre invitation, pour une audition essentiellement consacrée aux questions économiques africaines.
Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici, vous a confié il y a quelques mois, messieurs, une mission de réflexion « sur la rénovation de la relation économique bilatérale entre la France et l'Afrique, sur la base d'un partenariat économique mutuellement bénéfique ». Vous y travaillez actuellement avec Jean-Michel Severino, Tidjane Thiam et Hakim El Karoui. Vous n'avez pas encore tout à fait achevé vos travaux. Nous ne vous demanderons pas la primeur de vos conclusions, mais votre analyse tombe à point nommé pour nous permettre de prolonger notre propre réflexion sur le sujet.
La semaine dernière, Noël Mamère et Michel Zumkeller nous ont présenté leur rapport d'information sur les pays émergents d'Afrique anglophone. Ils concluent à la nécessité impérieuse de rééquilibrer notre relation bilatérale avec cette partie de l'Afrique, que notre diplomatie a négligée jusqu'à présent. Ils nous ont montré que certains pays, tels le Nigeria, le Kenya, le Ghana, et l'Afrique du Sud dans une moindre mesure, se trouvent depuis plusieurs années dans une dynamique économique très porteuse qui va modifier le visage du continent. Ils nous ont dit que sur tous les plans - politique, commercial, économique – la France était assez mal placée et qu'elle perdait des parts de marché. Mais ils ont aussi souligné que ces pays sont fortement demandeurs de meilleures relations avec la France, perçue comme pouvant jouer un rôle de passerelle entre des régions africaines qui se connaissent peu. Des opportunités importantes existent donc que notre pays devrait savoir saisir en cessant d'ignorer la moitié du continent. Les choses semblent heureusement être en train de commencer à changer ; vous nous direz ce que vous en pensez.
M. Hubert Védrine présentera son analyse de l'état des relations économiques entre la France et l'Afrique, avant que M. Lionel Zinsou, que l'on sait être un « afro-optimiste » résolu, ne trace le portrait de l'Afrique de demain telle qu'il l'envisage.
Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici, nous a demandé de réfléchir à l'état des relations économiques entre la France et l'Afrique et à leurs perspectives. Notre approche est donc strictement économique : nous n'avions pas mission de réfléchir au bilan des controverses des dernières années relatives à la "France-Afrique", ni aux relations diplomatiques France-Afrique. Notre travail se poursuit. La date butoir qui nous est fixée est celle du Sommet de l'Élysée de début décembre consacré à la sécurité et à la paix en Afrique.
Notre diagnostic recoupe de nombreuses autres analyses : quelques cas particuliers mis à part, les entreprises françaises ont perdu beaucoup de parts de marché, depuis vingt ans, dans cette Afrique francophone où elles étaient historiquement très implantées. En même temps nos entreprises n'ont pas encore réussi à décoller en Afrique anglophone ou en Afrique lusophone, mis à part Total en Angola, et le groupe Bolloré en Afrique de l'Est. Ces grands groupes exceptés, les parts de marché des entreprises françaises restent très faibles. Pourquoi ? Nous avons analysé les causes de cette situation.
Pendant que nous demandions sans fin en France s'il était moral de continuer à avoir une "politique africaine" dans les pays où la France était historiquement très bien implantée, de nombreuses puissances ont développé une politique africaine. C'est manifeste de la part de la Chine, de l'Inde, du Brésil (souvent anti-françaises, au moins dans la rhétorique) et d'autres. Pour l'instant, il n'y a presque plus de politique russe en Afrique mais cela changera peut-être. La politique américaine existe, avec comme priorité la sécurité. Ces politiques sont utilitaristes : les puissances qui les mènent ne s'intéressent pas à "l'Afrique" en tant que telle, elles se demandent où sont leurs intérêts vitaux en Afrique et où, par exemple, leur sécurité est engagée, par exemple en Somalie et, au-delà, sur la circulation maritime vers le canal de Suez. On note encore des politiques africaines turque, israélienne, ou encore celles menées par plusieurs Émirats.
Le paradoxe est donc que la France, toute à ses controverses sur sa politique africaine, est restée à l'écart d'un mouvement de fond. Les Occidentaux ont perdu globalement leur monopole de pouvoir et d'influence sur le monde, la concurrence s'est généralisée et, même en Afrique, des États conduisent maintenant des politiques ambitieuses, souvent en rivalité entre eux. C'est le cas de l'Afrique du Sud, du Nigeria et de certains pays du Maghreb. Le Maroc mène ainsi une politique africaine très dynamique, conçue à l'origine pour contrebalancer l'influence diplomatique algérienne mais qui est devenue économique. Ainsi, la Royal Air Maroc, les banques marocaines et l'Office Chérifien des Phosphates ont-ils tous une stratégie africaine ambitieuse, qui visait à l'origine l'Afrique de l'Ouest, et qui s'est ensuite élargie.
Concernant l'avenir de l'Afrique, certains se déclarent « afro-optimistes ». Un débat se poursuit au sein de notre Commission à ce sujet. Et de fait, en raison de sa population, des ressources prodigieuses de son sous-sol et de l'amélioration, en dépit de tout, du niveau de vie des peuples et de la gouvernance, le potentiel de l'Afrique est considérable ; certains pays partis de très bas, telle l'Éthiopie, deviennent des pré-émergents ! Toutefois, la plupart des pays africains n'ont pas encore réussi à transformer une économie « de sous-sol » et de rente, en une économie durablement développée. Le même constat vaut d'ailleurs pour la Russie, qui ne parvient pas à transformer les produits de la vente du gaz et du pétrole en une économie moderne.
On peut avoir des points de vue contrastés sur l'Afrique. Mais les considérations sur le grand potentiel du continent l'emportent. Nous avons distingué, pour établir notre bilan, les zones d'influence traditionnelles où nous avons perdu du terrain, des autres ; mais lorsqu'on réfléchit au potentiel futur de l'Afrique, ce clivage n'est pas opérationnel.
Dans les pays dans lesquels nous avons perdu du terrain, la concurrence nouvelle n'explique pas tout. Beaucoup d'entreprises françaises, qui y étaient traditionnellement présentes, se considéraient en terrain conquis, et jugeaient que les marchés devaient leur revenir automatiquement ou invoquaient des raisons telles que « Nous avons rendu service aux Africains sur tel point ou sur tel autre (la sécurité), ils doivent nous renvoyer l'ascenseur ». Rien ne se passe plus de la sorte : désormais, les Africains nous mettent aussi en concurrence. Cependant nos interlocuteurs africains nous ont aussi fait comprendre qu'ils n'ont aucune envie de se retrouver en tête-à-tête avec les Chinois.
Nous avons constaté un fort intérêt pour l'état d'esprit qui anime notre commission, très éloigné des convulsions franco-françaises sur la politique africaine ; ils souhaitent que l'on prenne l'Afrique telle qu'elle est et, plus encore, telle qu'elle sera. Dès lors, les Africains sont très contents que nos entreprises soient présentes sur le continent et, si elles parviennent à devenir plus compétitives, à concurrencer celles des autres pays. En revanche, la restauration des chasses gardées historiques de la France est inenvisageable.
Nous avons centré nos travaux sur les entreprises, sur ce qui les conduit à être présentes ou non en Afrique, à y investir ou non et sur ce qui favorise le succès de leur développement. Notre rapport posera un diagnostic qui ne comportera pas de révélation pour les spécialistes, mais il n'est pas inintéressant que les choses soient dites ainsi de façon synthétique et claire. Nous présenterons aussi des préconisations aux autorités françaises et aux entreprises pour améliorer notre présence en Afrique – ce seront des recommandations d'ordre administratif, technique, fiscal et financier – ; ainsi que des suggestions à nos partenaires africains, pour débattre ensemble, par exemple sur l'avenir de la zone franc, une question qui concerne eux et nous. Il ne s'agit pas de nous poser en donneurs de leçons, mais de réfléchir à partir de nos intérêts croisés. Tel est l'état d'esprit dans lequel a travaillé la commission.
Notre rapport sera rendu public selon un calendrier qui sera déterminé en fonction de la préparation du Sommet de l'Élysée des 6 et 7 décembre et qui sera précédé le 4 d'une journée consacrée à l'économie, à laquelle participeront des chefs d'Etat, les ministres compétents, des financiers et des banquiers. Le Sommet proprement dit sera consacré en premier lieu à la sécurité en Afrique et à l'économie.
Je le redis, nous n'avions pas à traiter les questions spécifiquement politiques ou de sécurité, dont je connais l'extrême importance. Tel n'était pas notre mandat. Cela nous a permis de nous projeter dans l'avenir pour repenser le partenariat futur entre la France et l'Afrique. Il aura bien sûr des conséquences politiques selon la politique économique menée et selon que nos entreprises réussiront ou échoueront. À cet égard, un sujet de grande importance demeure en suspens que nous mentionnons sans trancher car cela ne relève pas de nous : celui de la facilitation des visas économiques. Nos préconisations à cet égard seront claires, mais la suite qui leur sera donnée dépendra de l'arbitrage gouvernemental, et bien sûr donc aussi du Quai d'Orsay et du ministère de l'intérieur.
Comme trois autres membres de la commission, je suis binational : complètement français et complètement africain, puisqu'à la fois citoyen français – et fonctionnaire en disponibilité – et citoyen béninois. Je prendrai le point de vue africain pour donner un regard sur l'enrichissement considérable possible des relations, notamment économiques, entre l'Afrique et la France.
D'abord, l'Afrique se pense vraiment une. J'avais été auditionné par M. Noël Mamère alors qu'il élaborait son rapport consacré à la présence française en Afrique anglophone. Il souhaitait savoir si j'estimais la présence française dans cette région suffisante ; la réponse est probablement « oui » en termes d'investissements et de capital sur place, car cette présence est plus significative qu'on ne le pense. Mais l'Afrique ne se demande pas si elle est francophone ou anglophone : elle se pense une. Il existe maintenant des groupements de pays africains qui font que la fragmentation du continent en 54 États a perdu de sa signification : l'Afrique commence à se rassembler en zones monétaires, en unions douanières et en zones de développement concerté. La région africaine qui se développe déjà à un rythme impressionnant est le corridor reliant Lagos à Abidjan, qui va devenir une mégalopole à cheval sur cinq États. Les entreprises multinationales s'intéressent à cet ensemble de près de 100 millions d'habitants, anglophones et francophones, au potentiel considérable, dont la croissance moyenne est déjà à deux chiffres dans certaines agglomérations, et en tout cas jamais inférieure à 8 % pour cette bande du littoral d'Afrique occidentale. Il en est de même en Afrique de l'Est, où le rassemblement de l'Ouganda, de la Tanzanie et du Kenya, prolongé par l'Éthiopie et le Rwanda est en passe de devenir une entité unique dans laquelle la circulation des hommes, des marchandises et des capitaux se fait beaucoup plus facilement. Il faut donc raisonner en des termes différents de ceux qui ont prévalu quand la Conférence de Berlin de 1885 a défini les frontières sur le continent.
Dans ce cadre, les langues sont une richesse plus qu'autre chose, et l'on trouve toujours le moyen de se parler, que ce soit en français, en anglais, en yoruba ou en créole mâtiné de l'une ou l'autre langue. En bref, il n'y a plus aucun obstacle à la communication et de nouvelles entités régionales se forment, mais l'Afrique est une. L'obsession marocaine, la préoccupation tunisienne et un axe majeur du développement économique égyptien, c'est tout ce qui se passe au sud du Sahara. Des échanges multiples sont possibles entre la France et l'Afrique subsaharienne par l'intermédiaire des pays du Maghreb. C'est déjà la réalité en matière bancaire, puisque les banques marocaines sont devenues les premières banques de la zone franc, devant les banques françaises ; c'est aussi une réalité en matière de transports, d'exportations des produits manufacturés et surtout d'hommes. Ce disant, je parle aussi bien de l'influence que peuvent avoir les oulémas marocains sur l'islam de l'Afrique de l'Est que de la formation des ingénieurs des télécommunications. Comme chacun le sait, une révolution des télécommunications s'est produite en Afrique, que l'on peut interpréter comme une métaphore de l'explosion de la croissance africaine. Cette révolution s'est faite avec des Africains dont beaucoup ont été formés par Maroc Télécom, davantage qu'à Palaiseau, mais avec un ensemble de normes techniques très proche. En résumé, l'Afrique se veut une, mais elle se regroupe, de manière pragmatique, en ensembles économiques pertinents.
Ainsi, la Communauté des États d'Afrique occidentale (CEDEAO) a montré être un acteur politique important au moment de l'affaire malienne. C'est qu'elle rassemble 300 millions d'habitants et a un produit intérieur brut de 300 milliards de dollars, une dimension pertinente pour les marchés et, demain, pour l'industrialisation. Ces chiffres sont très éloignés de ce que serait l'addition de forces isolées. Pour ne donner qu'un exemple, le seul Bénin, avec ses 10 millions d'habitants et un PIB de 6 milliards de dollars, ne peut rien construire en matière industrielle. La CEDEAO, union douanière, a, elle, la taille critique. Les entreprises françaises doivent s'intéresser à l'émergence de ces groupements de pays ; les grands groupes commencent de le faire, mais c'est moins facile pour les PME. Nous devons montrer ce qu'est la réalité africaine aujourd'hui : un continent unique, qui regroupe déjà des marchés fragmentés au sein d'entités régionales fortes.
Tout ce que la France fait déjà et tout ce qu'elle peut faire de plus pour encourager cette gouvernance complexe sera bienvenu. Cela revient à faire converger les normes et les politiques communes, comme l'a fait l'Union européenne, mais avec des pays qui ont commencé de le faire depuis beaucoup moins longtemps et qui ont été séparés pour de multiples raisons. C'est compliqué, et tout ce que nous pouvons faire pour encourager cette nouvelle gouvernance doit tenir compte aussi de ce que l'Afrique se revendique comme une – une revendication fondamentale cinquante ans après la création de l'Union africaine – mais aussi efficace et pragmatique dans ses regroupements régionaux.
On doit pouvoir rendre le développement de l'Afrique plus inclusif et plus durable, et la France porte ses valeurs. La croissance africaine est incontestablement très forte. Cela a longtemps été nié, mais le consensus se fait à présent pour l'admettre ; en réalité, compte tenu des activités informelles, tous les économistes concernés considèrent que la croissance africaine est même sous-estimée. Être « afro-optimiste » est maintenant dans l'air du temps alors que, quand le terme « afro-optimisme béat » a été inventé par un journaliste, il y a dix ans, c'était par dérision : « Quelle cécité ! Ne voyez-vous rien des pandémies persistantes, de l'augmentation de la misère, de la mauvaise gouvernance, de la corruption ? ». Aujourd'hui, il faut admettre que la croissance économique de l'Afrique, depuis quinze ans, est forte, soutenue, qu'elle s'accélère, et surtout qu'elle est devenue endogène. Ne le serait-elle pas que l'Afrique aurait pris de plein fouet la crise de 2009. Or, cette année-là, son PIB a augmenté de quelque 3 %. Mieux : en 2012, alors que l'Union européenne – qui est de l'Afrique le principal bailleur de fonds, le principal client et le principal fournisseur, celle, aussi, qui permet à la diaspora africaine ces retours d'épargne fondamentaux pour la croissance africaine –, est en crise, la croissance de l'Afrique s'accélère : selon le FMI, elle va passer de 4 % à 6 % en 2014. En d'autres termes, c'est désormais un cliché d'attribuer la croissance de l'Afrique à ses matières premières : la croissance est devenue endogène, elle est due à la consommation de la classe moyenne africaine. L'Afrique est devenue un grand marché – pas très grand sans doute, puisqu'il représente 3 % des débouchés mondiaux, mais un marché croissant, ce qui est important pour les entreprises, notamment françaises.
Mais cette croissance indubitable n'est pas forcément un développement. La croissance per capita est réelle : même avec une croissance démographique de 2,8 % à l'échelle du continent, on peut distribuer les fruits de la croissance lorsque la richesse augmente de 6 %. Mais l'enrichissement par tête doit être corrigé des inégalités, de l'impossibilité de faire entrer les jeunes sur le marché du travail et d'une place accordée aux femmes inégale selon les lieux. Ainsi, au Bénin, la société est matriarcale dans le Sud animiste et chrétien, mais des problèmes d'inclusion des femmes se posent au Nord qui est plus proche de la tradition musulmane. D'autre part, la question lancinante de l'inclusion des jeunes sur le marché du travail est un problème politique majeur, qui provoquera des révolutions ailleurs que dans les pays arabes : il y en aura en Afrique subsaharienne où les chances d'accès à l'emploi des jeunes est inversement proportionnelle à leurs diplômes, alors que les diplômés sont de plus en plus nombreux.
Le développement en Afrique doit être inclusif et la France porte ces valeurs. L'image des entreprises françaises est très grandement améliorée au regard de ce qu'elle était à l'époque « impériale » – selon le mot de Jacques Marseille, « impérialiste » selon le terme des intellectuels des années 1960 et 1970. Les entreprises françaises se sont fait la réputation d'être porteuses de la responsabilité sociale et environnementale ; d'ailleurs, les projets qui peuvent bénéficier de l'aide française au développement doivent désormais comporter des composantes environnementales. Or, l'Afrique est désormais capable de grands progrès en matière de nutrition mais son agriculture devra être doublement verte. Une révolution agricole sera nécessaire parce que l'agriculture africaine a souffert d'une incroyable pénurie de capitaux due à la politique de la Banque mondiale et à la philosophie qui sous-tendait l'aide multilatérale. Cela doit changer radicalement. Mais cette révolution à venir créera des problèmes environnementaux dans un contexte de dérèglements climatiques destructeurs. Nous appuierons les entreprises françaises qui, en matière d'urbanisation ou d'agriculture, portent des valeurs et des méthodes propres. Elles ont une offre adaptée, qu'il faudra regrouper et faire interagir avec les ONG, les ONG locales et les collectivités locales. En effet, dans ce que la France fait le mieux, il y a coopération territoriale décentralisée, très efficace en termes de gouvernance et, parce que la population locale exerce un contrôle permanent, beaucoup moins menacée par la corruption que ce qui peut parfois s'observer au niveau des États. Notre rapport comportera des propositions à ce sujet.
Des progrès doivent être accomplis en matière de financements. Même si la révolution en cours depuis une quinzaine d'années tient pour beaucoup au fait que l'Afrique est mieux financée qu'elle ne l'a été pendant longtemps – grâce à l'aide publique, au désendettement qui a fait chuter sa dette publique à 25 % de son PIB au lieu des 125 % du début des années 2000, et à la diaspora qui apporte à l'économie africaine un financement égal à celui de l'aide publique au développement –, l'Afrique continue d'avoir besoin de capitaux, car la couverture des besoins suppose le développement de secteurs très intensifs en capital. Nous proposerons donc des mesures techniques, qui commencent à faire consensus mais pour lesquelles la France pourrait être pionnière et sur lesquelles les entreprises françaises ont beaucoup à apporter.
Le secteur d'activité le plus intensif en capital est l'agriculture, le besoin principal ; le deuxième est celui de l'énergie. L'Afrique est en panne d'énergie pour une mauvaise raison – le manque d'investissement – et pour une bonne raison – la surchauffe économique : lorsque la croissance est de 5 % en volume, l'augmentation en valeur est de 12 % et la demande d'électricité croît de 15 %. Malheureusement, l'énergie est un secteur très intensif en capital, mais pas en travail, et il en est de même pour les infrastructures de la mobilité. On le sait, une révolution des télécommunications s'est produite, telle que l'on compte à présent 500 millions d'abonnés pour un milliard d'habitants en Afrique ; les projections laissaient envisager de 10 à 20 millions d'abonnés ! Mais les télécommunications sont si rentables et si vite rentables que l'on peut en financer les infrastructures sans recourir à des innovations financières. Cela n'est vrai ni pour la route ni pour les ports ni pour les centrales électriques ni pour l'hydraulique ; là, il faut prendre en compte toutes les externalités, ce qui entraîne de multiples complications. C'est pourquoi nous ferons des propositions relatives aux secteurs correspondant aux besoins les plus urgents, secteurs qui permettront que l'Afrique passe de la croissance au développement inclusif.

Chacun fera la part des choses entre « afro-optimisme » et « afro-optimisme béat ». J'ai moi-même tendance à l'afro-optimisme en matière économique, mais il est vrai que sur les plans politique, de sécurité et de gouvernance, les choses sont un peu moins claires.
Les grandes entreprises françaises continuent de remporter des marchés importants en Afrique – Alstom a ainsi signé il y a quelques semaines un contrat de quelque 5 milliards d'euros en Afrique du Sud –, mais cela n'empêche pas que nous perdions des parts de marché. Noël Mamère et Michel Zumkeller évoquaient notamment dans leur rapport un manque de soutien au financement des exportations, à la différence de ce que fait l'Allemagne pour ses entreprises. On entend aussi beaucoup dire que nos entreprises ne peuvent faire front à la concurrence des entreprises chinoises qui bénéficient, elles, de financements publics illimités. Le rapport abordera-t-il cette question ? Que pouvons-nous faire à ce sujet dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dont la Chine est maintenant membre ?

Je suis pour ma part « afro-réaliste » ; je suis très heureux de l'optimisme qui s'est manifesté, dont je pense qu'il se vérifiera à terme. Mais comment améliorer nos relations avec l'Afrique dans l'immédiat, tant en matière économique que de sécurité ? Il paraît difficile de continuer à entretenir des rapports de co-développement, pour ne pas dire d'aide au développement, avec un continent qui nous a été décrit en phase de formidable croissance. Il nous faut donc inventer un nouvel équilibre. On a ainsi le sentiment que dans les accords de partenariat économique avec l'Europe, les États africains jouent parfois sur les deux tableaux. Pour être efficace et tenir compte de la diversité des situations, ne convient-il pas de sectoriser les approches selon que l'on s'adresse aux pays émergents tels l'Afrique du Sud ou le Nigeria, les pays d'Afrique francophone, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord ? Que recommanderez-vous à ce sujet ?

Je me réjouis du retour de l'Afrique sur la scène mondiale car c'est là que se jouera le destin de la France et des autres nations européennes. La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui tient à l'erreur stratégique qui a consisté pour Bruxelles et l'OTAN à garder le regard braqué sur l'Elbe et la Vistule en attendant les chars soviétiques alors que le Mur de Berlin était tombé ; et notre diplomatie, tournée qu'elle était vers Bruxelles et l'OTAN, a délaissé le continent africain. Le temps n'est plus de mettre tous nos oeufs dans le panier bruxellois : nous devons réorienter notre politique en dépêchant en Afrique nos meilleurs diplomates et en redirigeant nos crédits de coopération vers ce continent. Ces choix s'imposent, et vite.
Par ailleurs, l'Afrique est sans doute une, mais de fortes différences sont néanmoins perceptibles ; pour ne parler que du Nigeria, chacun sait que les tensions sont extrêmes entre Haoussas et Yorubas.
Enfin, la diaspora envoie beaucoup de fonds en Afrique ; ne pourrait-on, pour favoriser là-bas la création de micro-entreprises, canaliser cette épargne par le biais de plans d'épargne entreprise ?

L'Afrique est une mais elle est aussi très diverse. Ainsi, comment analysez-vous la situation de Madagascar, connu pour être l'un des pays les plus pauvres du monde ? A-t-il une chance de resurgir à moyen terme ?

La réorientation réussie de l'aide publique au développement suppose de mieux articuler les aides françaises, européennes et multilatérales vers l'Afrique. On se félicitera donc que Jean-Michel Severino soit membre du groupe d'experts de l'ONU chargé de définir les objectifs du développement pour l'après-2015 ; il serait bon que nous puissions influencer la nouvelle donne.
Il paraît très difficile de distinguer développement inclusif, gouvernance et accès aux droits. Ainsi, accorder davantage de micro-crédits aux femmes dans l'agriculture sans leur donner accès à la propriété de la terre, c'est constituer une force de travail sans droits. Toute croissance durable et juste implique la prise en compte des droits fondamentaux.

Lorsque, en 2010, Nicole Ameline, Michel Terrot, Jean-Paul Dupré et moi-même avons élaboré, au nom de la Commission des affaires étrangères, le rapport d'information relatif à l'aide au développement, nous étions « afro-fanatiques » plus qu'« afro-optimistes », et nous ne vivons pas dans la repentance post-coloniale. Dans son excellent rapport, Noël Mamère cite le célèbre ouvrage de René Dumont, L'Afrique noire est mal partie. Je suis ravi d'entendre que les 2 milliards d'habitants qui la peupleront en 2050 sont promis à un avenir plus favorable. Cependant, il n'y a pas une Afrique mais plusieurs : l'une se développe pendant que l'autre, l'Afrique subsaharienne, souffre. L'aide au développement doit lui aller en priorité, mais sous forme de dons, plutôt que de prêts que les pays considérés ne peuvent rembourser. Elle doit aussi être plus nettement identifiée comme une aide française, les circuits multilatéraux étant décidément opaques. À cela s'ajoute la question des aides liées et des aides déliées ; les Anglo-Saxons sont très favorables aux secondes… mais ne pratiquent que les premières si bien que nous, qui respectons le principe des aides déliées, disparaissons des marchés africains. Vous avez d'ailleurs cité comme l'une des explications à l'amélioration de la situation économique de l'Afrique le désendettement, sans mentionner l'importance de l'annulation de la dette consentie par la France, qui doit être prise en compte dans notre effort global d'aide au développement.
Certains pays africains, tel le Gabon, vivent encore dans une économie de la rente. C'est aussi le cas du Nigeria qui a des richesses pétrolières extraordinaires mais qui importe de l'essence, faute de pouvoir raffiner son pétrole. Devrions-nous aller y installer des raffineries ? Je ne suis pas certain que chacun, en Seine-Maritime, apprécierait cette idée.
Enfin, l'évolution démographique du continent entraînera obligatoirement des mouvements migratoires, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Afrique. J'aurais aimé que vous abordiez ce sujet.

Il n'est pas de mutation démographique et économique qui ne se traduise par des évolutions politiques et institutionnelles. Quelle sera selon vous l'évolution des pouvoirs en Afrique ? Qu'adviendra-t-il des frontières tracées en 1885 ?

Votre approche est donc strictement économique. Mais, étant donné la situation au Mali et au Sahel, peut-on véritablement se dispenser d'une réflexion coordonnée englobant aussi les enjeux de défense et de sécurité ?
La transition énergétique en Afrique présente-t-elle des aspects spécifiques ? Quelles seront la part du secteur public et celle du secteur privé ? Comment intervenir ? Pourra-t-on aborder ces questions dans le cadre de la Conférence Paris Climat 2015 (COP21) consacrée à la lutte contre le réchauffement climatique ?

Le Sommet franco-africain des 6 et 7 décembre sera précédé, le 5 décembre, par des réunions entre les ministres des finances d'une part, les ministres des affaires étrangères d'autre part. Le Sommet proprement dit traitera de sécurité, de développement économique et de changement climatique. Cela permettra d'envisager l'articulation de ces différents sujets.

Vous entendre, messieurs, donne le sentiment que l'on avance à pas de géant. En finir avec la repentance sur le colonialisme est une bonne chose, car on ne peut progresser qu'en ayant purgé le passé. J'aimerais davantage de précisions sur l'incidence des relations économiques qu'entretiennent les PME française, plus nombreuses qu'on ne l'imagine, avec les pays africains. Vous avez par ailleurs mentionné la coopération des collectivités territoriales de toutes tailles ; je sais les partenariats engagés, par exemple, avec les maisons familiales rurales. Peut-on mesurer l'ampleur de ces initiatives ?

Comme Jacques Myard, je pense que nous devons redéfinir notre stratégie, puisque notre commerce est encore largement orienté vers l'Europe alors que, selon l'OCDE, 90 % de la croissance, d'ici à 2020, se fera hors de l'Union européenne, en Afrique notamment. Pensez-vous que l'Afrique sera le nouvel atelier du monde ? Envisagez-vous pour les pays africains un développement similaire à celui des pays du Sud-Est asiatique ? Si oui, dans quel délai ? Que proposerez-vous en matière de micro-financement ?

Ce qui nous a été dit donne envie de lire le futur rapport. Nous vous avons entendu souligner la concurrence généralisée à l'oeuvre en Afrique et, pendant que la France ferme ses consulats, la presse turque annonce l'ouverture de 30 ambassades, Turkish Airlines celle d'autant de liaisons aériennes avec l'Afrique, et la Turquie a organisé un sommet de coopération turco-africaine avec la participation d'une trentaine de pays. Il est temps, en effet, de changer notre mode de réflexion, d'en finir avec la repentance, l'aide au développement et les situations de rente pour en venir à un développement économique fondé sur une coopération d'égal à égal avec des nations que l'on respecte en ne les traitant pas comme des pays sous-développés auxquels il faut faire des dons. Pour autant, passer du pessimisme absolu à l'optimisme complet serait une autre idée fausse : non seulement les jeunes Africains n'ont actuellement pas d'emplois mais l'explosion démographique portera à 2,5 milliards le nombre d'habitants d'un continent sans infrastructures et sans davantage d'emplois. Si l'on admet que l'Afrique comptera sous peu 550 millions de jeunes gens âgés de 15 à 25 ans à la recherche d'un emploi et que 10 % d'entre eux le chercheront quelque part sur l'autre rive de la Méditerranée, c'est à l'immigration potentielle de 50 millions de personnes qu'il faut s'attendre, soit l'équivalent de la population d'un grand État européen. Voilà pourquoi nous devons réfléchir autrement.
J'observe par ailleurs que le tropisme militaire a prévalu, et beaucoup trop, au détriment de notre présence économique en Afrique. Il y a certes des problèmes de sécurité, mais le déséquilibre est patent, dans la politique africaine de la France, entre ce qui relève du gendarme et ce qui relève de l'économique, et cela se fait au bénéfice de nos concurrents qui, eux, ne s'embarrassent pas de considérations de défense. D'autre part, notre tropisme vers les anciens pays de l'empire colonial ou d'Afrique occidentale nous a fait ignorer des États qui, tels le Ghana, ont une croissance de 14 % l'an, ou encore la Tanzanie et le Kenya. Je me réjouis de ce que nous venions de redécouvrir le Mozambique.
Enfin, notre collègue Jacques Myard a raison : il faut en finir avec l'époque de la Coloniale et revoir le personnel diplomatique que nous détachons en Afrique au lieu que, comme je l'ai constaté, les plus doués de nos diplomates soient systématiquement dirigés vers Washington, Pékin ou Moscou. Le Quai d'Orsay et Bercy doivent faire de l'Afrique une priorité, et cela doit se traduire dans les affectations.

Nous avons reçu le directeur d'Afrique et de l'Océan indien au ministère des affaires étrangères, et son exposé passionnant ne nous a vraiment pas donné le sentiment que nous avions à faire à un diplomate de second rang.

Je me demande s'il n'aurait pas été plus intéressant encore d'entendre nos invités une fois publiées les recommandations de la mission d'information.
Sur le fond, si l'économie africaine progresse incontestablement, comme en témoignent le taux de croissance du continent et le PIB per capita, on sait les deux préalables au développement humain : l'éducation et la santé. Or, dans ces deux domaines, les progrès sont infimes au regard de la progression du PIB – à voir l'état de certains hôpitaux et la difficulté à faire progresser le taux de scolarisation, on a même l'impression d'un recul. C'est pourtant à ces deux secteurs qu'est destinée l'aide au développement. Comment mettre fin à ce paradoxe ?

Tout en partageant l'afro-optimisme exprimé, il me faut évoquer un danger qui fragilise sérieusement certains États africains trop démunis pour y faire face : la drogue. Depuis une dizaine d'années, les cartels colombiens déversent leurs marchandises en Afrique, principalement en Guinée-Bissau, et le Cap-Vert devient pour eux une nouvelle proie stratégique. Cette économie parallèle nourrit les adversaires du développement potentiel de ces États. La dose de crack vaut 2 euros à Conakry et l'État n'a pas la capacité de faire cesser ce trafic. Il en résulte que le Mali, le Niger, le Burkina Faso et d'autres pays de la zone se retrouvent en difficulté, se voyant proposer un ordre par les groupes mafieux mêmes qui instaurent le désordre.
Je souhaite d'autre part souligner le considérable potentiel de développement permis par la francophonie – le Maroc l'a parfaitement compris. Les cours en ligne ouverts à tous – les MOOC – peuvent donner accès au savoir, du secondaire au supérieur, y compris pour des travaux de recherche, et permettre la transmission des connaissances dans tout l'espace francophone. Cet outil extraordinaire doit être mis au service d'une stratégie économique offensive, elle-même couplée avec une révision de la politique des visas, car la création de filières comme celle des énergies renouvelables suscitera une demande de formations. Votre rapport traitera-t-il de ces questions ?

Nous nous accordons tous pour penser que le XXIème siècle doit être celui de l'Afrique. Cela implique une union politique ayant des prolongements en matière de politique étrangère et de défense ; j'espère qu'il en ira ainsi, car je ne suis pas certain que l'Afrique soit réellement une aujourd'hui. Certains jugent que les coopérations décentralisées bilatérales devraient être un axe fort de l'aide au développement. Y croyez-vous vraiment ? À quelle échéance ? Étant donné la rudesse de la concurrence, quelle sera la place de la France ?

Je vous remercie, messieurs, pour votre approche salutairement pragmatique qui satisfait les amoureux de l'Afrique que nous sommes. Comment s'articule-t-elle avec la réflexion, parfois verbeuse, en cours sur « l'après 2015 » des Objectifs du millénaire pour le développement ?

Je partage le point de vue de notre collègue François Loncle selon lequel il ne peut y avoir développement économique sans développement de l'éducation et de la santé – et, ajouterai-je, de la sécurité. Le Bénin a été l'un des premiers pays à instaurer une TVA, mais pensez-vous que les pays africains ont affecté autant qu'il l'aurait fallu du produit de ces taxes à la sécurité ? L'évolution du Mali fait s'interroger.
Je partage sans réserve le point de vue selon lequel il ne peut y avoir de croissance sans développement endogène. Mais alors, comment amplifier le financement des collectivités locales, des PME et des TPE ?

Enfin une bonne nouvelle : l'Afrique se veut une ! J'en accepte l'augure, mais il n'en reste pas moins que le Soudan s'est fractionné, que le Sahara occidental revendique son autonomie, que le Nord du Mali est en proie à un mouvement séparatiste et que la question de la Casamance n'est pas réglée. Autant le dire, je ne suis pas persuadé que la fragmentation de l'Afrique soit achevée à ce jour.
Sur un autre plan, il n'est pas de souveraineté qui ne soit aussi monétaire. Quelles sont, selon vous, les étapes pour parvenir à la souveraineté monétaire en Afrique ?

Vous l'aurez compris, cette audition est de celles où nous souhaitons aussi être entendus par les personnalités que nous auditionnons… C'est pourquoi j'ai pensé, monsieur Loncle, qu'il serait intéressant que M. Hubert Védrine et M. Lionel Zinsou nous entendent avant que la mission de réflexion ait achevé son rapport. Mais nous ne nous interdirons pas de les recevoir à nouveau, le cas échéant, une fois celui-ci publié.
Je ne doute pas que vous serez intéressés par la lecture de notre rapport, que nos échanges auront d'ailleurs enrichi. Mais vous serez aussi déconcertés, car il ne répondra pas à la plupart de vos questions. Il faut rappeler notre mission. Il ne s'agissait pas pour nous de traiter en historiens ou en philosophes de la validité des controverses sur l'histoire. Nous ne sommes pas davantage chargés par l'Union africaine de faire un rapport sur l'avenir de l'Afrique, et sur toutes les politiques qu'il faudrait y mener. Quand nos interlocuteurs africains nous disent que l'Afrique est une, nous prenons note de ce qui nous est dit, qui traduit une ambition, une volonté, même si la réalité est plus nuancée.
Notre mission était de suggérer les mesures qui permettraient que la France cesse de perdre du terrain sur le plan économique – il ne s'agit pas d'aide, ce n'est pas un rapport caritatif – dans des pays qui étaient liés à elle depuis longtemps, et n'en gagne ailleurs alors que d'autres puissances concurrentes, nombreuses, y sont présentes et ne s'embarrassent pas des questions théoriques. On sait que, même si elles ne sont pas homogènes, des évolutions considérables se produiront dans une Afrique en mouvement ; il serait désastreux que la France n'y participe pas pleinement.
La plupart des Africains, nos malheureux amis sahéliens exceptés qui en ont absolument besoin, ne demandent plus tellement d'aide au développement. En dépit de la place que celle-ci a occupée pendant très longtemps dans le débat politique français – en fait on s'intéressait beaucoup plus à "l'aide" qu'au développement, car elle était la réponse à un remords –, on n'a jamais pu démontrer qu'elle garantisse à elle seule le développement. Mais ce débat historique et politique est, pour nous, dépassé. Vous constaterez ainsi, à la lecture du rapport que nous parlons très peu de l'Europe, parce qu'il ne nous a pas été demandé de repenser les politiques publiques et donc leur articulation EuropeEtats membres qui est un autre sujet. Je partage ce qui a été dit sur la nécessité de réorienter et de mieux identifier l'origine de cette aide européenne, mais ce n'était pas davantage le sujet dont nous devions traiter. Disons-le : nous parlons affaires, entreprises, investissements. Il nous revient de définir comment faire pour que les entreprises françaises soient présentes en Afrique, qu'elles ne se reposent plus sur des rentes périmées, et qu'elles redeviennent compétitives, quel que soit l'environnement linguistique. Sur ce dernier point, je rappelle que j'avais lancé, lorsque j'étais ministre, des initiatives visant à la convergence des politiques française, britannique et belge en Afrique. Mais, je le redis, il s'agit cette fois d'enrayer l'effondrement des entreprises françaises dans les zones francophones, et de les rendre plus dynamiques et conquérantes dans les autres. Sans opposition artificielle, les Africains avec lesquels nous nous sommes entretenus sont enchantés par cette approche, car les convulsions franco-françaises sur l'Afrique les ont lassé. Ce qu'ils veulent, ce sont des partenaires français présents, compétitifs, dynamiques, énergiques, sans complexes.
Nous avons pris note de ce qui a été dit, et plusieurs de vos observations pourront améliorer le rapport, et nous vous en remercions.
Les questions posées, parce qu'elles reflètent de fortes convictions, sont beaucoup plus intéressantes que les réponses qu'elles appellent. Oui, c'est une erreur stratégique d'avoir délaissé l'Afrique, mais c'était aussi probablement pour la France et les entreprises françaises une manière d'affirmer leur modernité : le passé impérial est une chose, mais la croissance économique se jouera ailleurs, l'Europe de l'Est et l'Asie sont prioritaires… Cette approche a peut-être valu davantage en France que pour des pays qui n'avaient pas de passé colonial ou pour des pays du Sud qui se sentent une solidarité avec l'Afrique pour ne pas avoir été des puissances coloniales. Cela dit, il est un délaissement bien plus grave : le fait que les organismes multilatéraux aient désarmé les financements de l'agriculture africaine. Jim Yong Kim est d'ailleurs en train de faire une revue stratégique des politiques de la Banque mondiale qu'il préside. La France doit peser dans la réflexion en cours sur le redéploiement des aides pour retrouver les vraies priorités ; elles sont forcément d'ordre agricole, liées à la nutrition, à la sécurité alimentaire, à la transition énergétique et à la préservation de l'environnement.
Oui, le financement en capital des PME est le chaînon manquant qui permettrait le développement d'une économie endogène inclusive. Notre collègue Jean-Michel Severino s'est lancé à corps perdu dans le financement du capital investissement de PME africaines ; il fait oeuvre de pionnier et ses initiatives seront soutenues dans le rapport. La question a aussi été posée de savoir si la collecte massive d'épargne de la diaspora africaine – 60 milliards de dollars – ne permettrait pas la création de plus nombreuses petites entreprises locales si elle était mieux organisée. Certaines banques, marocaines et sénégalaises notamment, ont commencé cette intermédiation financière, mais elle est encore balbutiante. Actuellement, ces fonds financent plus de logements et d'aide à la consommation, au demeurant très nécessaires, que d'emplois, mais la tendance est bien à rendre ces flux plus productifs. Le micro-crédit, responsable à lui seul d'un point de la croissance africaine, a une importance fondamentale. Mais quand une PME de 10 personnes a besoin de 50 000 euros pour décupler le nombre de ses employés, c'est trop pour du micro-crédit, qui s'arrête en deçà du micro-capital. Une réflexion approfondie est nécessaire à ce sujet.
Comme d'autres pays africains, Madagascar a eu le malheur de subir une révolution plaquée de l'extérieur. Comme cela fut le cas dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, ce régime a passablement détruit son économie et un peu son système éducatif, gâchant ainsi une partie de ses chances immenses. Reste aussi en suspens la question du « vouloir vivre ensemble ». Je ne sais si c'est le pays à propos duquel il faut être le plus optimiste, bien que ses capacités de croissance soient très fortes et qu'il soit situé dans une zone au moins aussi dynamique, sinon davantage, que la zone Atlantique. Pour Madagascar, l'aide internationale est vraiment cruciale. Cela étant, on constate un progrès de la règle de droit. Certes, les élections ne sont pas toujours la démocratie – mais quand il n'y en a aucune, chacun sait à quoi s'en tenir ! Peut-être les deux candidats qui s'affronteront à Madagascar ne sont-ils que l'ombre de ceux qui auraient dû se présenter, mais il y aura quand même un renouvellement du personnel politique. D'une manière générale, la règle de droit progresse partout – et, comme vous l'avez souligné, le capital et le travail ne sont pas les seuls facteurs de production, il y a aussi la culture et la règle de droit, sujets que la France porte assez naturellement.
La réflexion sur les objectifs du millénaire après 2015 est plutôt du ressort de Jean-Michel Severino. Une bonne surprise : un plus grand nombre de pays que prévu – Ethiopie et Niger compris – atteignent un nombre d'objectifs plus important que prévu. C'est une satisfaction, mais cela ne suffit pas. Prenons pour exemple la réduction de la pauvreté extrême, objectif central. Certains pays inattendus se rapprochent de cet objectif, mais comment cette évolution se traduit-elle sur le plan social ? Au Bénin, la pauvreté diminue, mais les pauvres sont de plus en plus nombreux. Il faut dynamiser les objectifs pour réduire et la pauvreté et le nombre de pauvres, car la croissance démographique change tout. Au moment de l'indépendance, le Bénin comptait un tout petit peu plus de 2 millions d'habitants, dont les deux tiers vivaient au-dessous du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'un tiers. C'est un immense succès qui induit l'effondrement du taux de mortalité infantile, l'amélioration des rations caloriques, l'alphabétisation de 90 % des enfants. Mais, depuis l'indépendance, la population béninoise est passée de 2 à 10 millions d'habitants. Il en résulte que, alors même que le taux de pauvreté a été divisé par trois, un tiers de ces 10 millions de personnes forme une cohorte d'exclus deux fois plus nombreux que ne l'étaient les deux tiers d'une population de 2 millions d'individus. En d'autres termes, les objectifs du millénaire doivent être incarnés, il faut mesurer ce que cela signifie sur place. Être « afro-optimiste » en Afrique est une situation impossible, comme l'ont souligné les orateurs qui se sont déclarés « d'abord afro-réalistes ». Il ne s'agit pas de nier l'évidence : le plus grand bidonville du monde se trouve à Nairobi, le deuxième à Lagos, et les bidonvilles de Cotonou ne cessent de grossir. Mais, je l'ai dit, cela ne signifie pas l'absence de progrès. Les objectifs du millénaire doivent être pensés dans leurs deux composantes car il est bien de réduire la pauvreté, mais si, dans le même temps le nombre de pauvres, loin de décliner, s'accroît, des problèmes politiques insolubles ne vont pas tarder à surgir.
Il faudra notamment créer des millions d'emplois pour la jeunesse – et des emplois industriels. En effet, la révolution agricole à venir conduira, comme ce fut le cas dans la France d'après 1945, à la fois à un enrichissement considérable du continent et à un exode rural massif, car les agricultures très riches se font sans bras. Les organisations régionales donneront la taille de marché nécessaire à l'industrialisation qui créera les emplois et qui permettra notamment l'entrée dans l'emploi des personnes non qualifiées.
L'Afrique a créé une organisation en vue de son union, qui est en construction progressive. Je n'ignore ni le tribalisme, ni l'artifice des frontières, ni la multiplicité des langues. Il n'empêche : la France a obtenu les voix de 52 États africains, deux États s'abstenant, pour que l'Union africaine soumette au Conseil de sécurité de l'ONU la résolution qui a permis l'intervention au Mali – et le Sud-Soudan a voté comme le Soudan. Certes, cette construction est complexe, mais le coût de l'absence d'union est aussi élevé pour l'Afrique que le serait celui de la « non Europe » pour les pays membres de l'Union européenne. C'est pourquoi l'Afrique se dote d'organisations régionales pragmatiques qu'il ne faut pas ignorer tout en essayant de faire l'unité du continent sur certains plans.
L'appareil diplomatique français est, dans l'ensemble, assez exceptionnel, et extraordinairement dévoué, notamment aux entreprises maintenant.
Les coopérations décentralisées sont d'une extrême qualité, et elles n'ont pas été remises en cause par temps de crise. Les partenariats d'école à école et l'action des maisons familiales rurales témoignent d'une générosité des populations et d'une solidarité qui doivent être appréciées à leur juste mesure au regard de certaines manifestations de racisme. Leurs résultats sont enthousiasmants. Cette forme de coopération, dans laquelle la France est très en avance, est complémentaire de celle de l'État, qui la favoriserait en jouant un rôle de facilitateur et de coordinateur. Ces coopérations ne sont pas encore quantifiées.
Oui, les entreprises françaises connaissent un problème de financement des projets à l'export, et pas seulement vers l'Afrique, alors que la Chine finance ces projets abondamment, très rapidement et très efficacement – mais non sans demander de très pesantes contreparties. Elle finance les équipements et les infrastructures dont les États ont tellement besoin à des taux convenables – encore qu'ils soient globalement supérieurs aux taux de l'aide française au développement et de l'aide multilatérale – mais, en contrepartie, elle sort d'un environnement concurrentiel normal pour l'acquisition des ressources naturelles des pays concernés. Il vaut mieux, et de beaucoup, passer un appel d'offres pour financer un port en eau profonde et la voie ferrée allant jusqu'à la mine, puis un appel d'offres distinct pour attirer des capitaux vers la mine, que de passer un accord global en quelques mois, qui sera apprécié pour sa rapidité car il donnera des résultats électoralement bénéfiques mais qui aura pour effet que le pays aura aliéné ses ressources naturelles pour de la roupie de sansonnet. On peut certes critiquer la France et les organisations multilatérales de mettre trois ans à définir des accords que la Chine conclut en trois mois, mais cette vision de court terme conduit à des accords ruineux à long terme, ce que l'on ne dit pas suffisamment.
Il serait inacceptable pour les États africains d'en revenir aux aides liées. Toutefois, dans les faits, la Chine et les pays non membres de l'OCDE pratiquent bel et bien l'aide liée, ce qui donne aux entreprises françaises l'impression d'un biais anti-concurrentiel. Pour autant, rien n'empêche d'inclure dans les appels d'offres des clauses relatives aux normes sociales et environnementales qui, de fait, redonnent leurs chances à ceux qui ne sont pas les moins-disant financièrement mais qui sont mieux-disant sur ces plans. Est-ce indifférent pour les populations ? Aucunement ; c'est au contraire fondamental. Partout, en Afrique, on assiste à des grèves et à des rebellions contre ceux qui, après avoir emporté des marchés parce qu'ils sont les moins-disant sur le plan social, ne créent pas d'emplois puisqu'ils importent et la main d'oeuvre et toutes les consommations intermédiaires. La Chine est en train de s'aliéner les opinions publiques africaines : faire venir la main d'oeuvre, parfois carcérale, dans des pays où la question de l'emploi est fondamentale, est insupportable.
Il en va de même pour le respect de l'environnement et pour les droits fondamentaux, dont celui de l'accès à la terre – une question de fond dans l'immense majorité des régions d'Afrique qui n'ont pas pour tradition le respect du droit des femmes à l'accès à la propriété. Mais il y a pire que cela : on peut exproprier les populations pour créer des latifundia. On connaît des exemples chinois, coréens, saoudiens et indiens – mais dans ce dernier cas, les choses sont plus ambiguës – malheureux, en Éthiopie et surtout à Madagascar, qui a ainsi été ravagé. C'est revenir aux compagnies concessionnaires et presque au travail forcé – pratique abhorrée qui, après l'esclavage, a fait le plus grand nombre de victimes sur le continent – sans parler des conséquences de ces cultures industrielles sur l'écosystème local. La France, en mettant l'accent sur les normes sociales et environnementales, récupérera probablement une part de certains appels d'offres et elle ramènera des gens à la raison en faisant la promotion de projets respectueux des populations. Il est insensé de penser que l'on assure sa sécurité alimentaire dans le Golfe persique ou en Chine, avec une sorte d'obsession de l'approvisionnement, en reconstituant le système des compagnies concessionnaires de la fin du XIXème siècle.
L'Afrique est-elle en train de devenir l'atelier du monde ? On en voit les prémices là où la Chine a décidé que cela commencerait : en Afrique de l'Est, là où se sont ouvertes les premières zones franches sur la côte de l'Océan indien, avec les premières organisations de milliers de salariés délocalisés en Ethiopie. C'est une forme de l'atelier du monde qui créera de nombreux emplois industriels ; mais le modèle retenu – l'importation des matières premières et le retour des produits finis vers le pays initiateur du projet – peut être porteur de croissance, mais non de développement. Ce qui le sera, c'est la couverture des besoins de proximité et des besoins d'équipement des classes moyennes : l'Afrique sera d'abord l'atelier d'elle-même, et c'est ce qui se passe dès maintenant, partout, qu'il s'agisse d'agro-alimentaire, de matériaux de construction ou de produits pharmaceutiques.
L'Afrique atelier du monde est aussi en préparation dans les pays qui, tels le Maroc ou la Tunisie, ont de 10 à 15 ans d'avance. Avec Safran, Renault, Aerolia, on assiste au début du partage de la chaîne de valeur ajoutée et à l'émergence du concept de co-localisation. Trois formes d'ateliers du monde sont en gestation. La première est une exploitation invraisemblable, rudimentaire, nombreuse et prédatrice. La deuxième est un modèle beaucoup plus sain, endogène et national, assorti à un grand développement des capitaux locaux et dans lequel les entreprises françaises ont heureusement leur place. Mention a été faite de l'impôt et du secteur informel ; les États ne peuvent lever l'impôt parce que l'activité est, précisément, trop informelle ; elle se formalisera progressivement ; quant aux États, ils doivent comprendre, et certains l'ont fait, qu'il faut offrir des services aux entreprises avant de commencer à les ruiner en impôts et en bureaucratie. Mais, déjà, l'atelier du monde porteur de développement est partout en Afrique. Enfin, l'atelier du monde du troisième type, c'est la co-localisation, déjà présente au Nord et au Sud du continent et qui ne fait que s'amorcer dans la zone intertropicale.

Messieurs, je vous remercie. Ce fut un échange passionnant et nous lirons votre rapport avec attention.
La séance est levée à onze heures trente