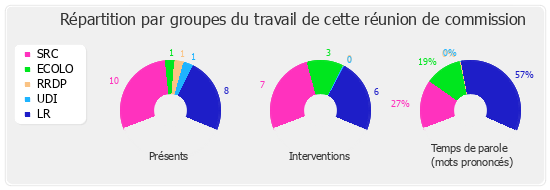Commission d'enquête relative aux moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier
Réunion du 23 mars 2016 à 19h15
La réunion
La séance est ouverte à 19 heures 05.
Présidence de M. Georges Fenech.
Audition, ouverte à la presse, de Mme Céline Berthon et de M. Jean-Luc Tartavull, respectivement secrétaire générale et secrétaire général adjoint du Syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN), et de M. Thierry Clair, secrétaire national de l'UNSA-Police.

Avant, madame et messieurs, de vous passer la parole pour un exposé liminaire, je vous informe que cette audition, ouverte à la presse, est également retransmise sur le portail vidéo de l'Assemblée nationale, où elle pourra être consultée pendant plusieurs mois. La Commission pourra décider de citer dans son rapport tout ou partie du compte rendu de cette audition.
Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relatif aux commissions d'enquête, je vous demande de jurer de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Mme Berthon, M. Tartavull et M. Clair prêtent successivement serment.
Votre commission d'enquête, devant laquelle nous vous remercions de nous permettre d'intervenir, poursuit un but noble et sain : informer et faire le point sur ce qui s'est passé – ou qui ne s'est pas passé. Comme lors des autres commissions d'enquête auxquelles nous avons participé, nous sommes très attentifs, en tant que représentants des chefs de police, à ce qu'elles ne se transforment pas en recherche de telle ou telle responsabilité, voire en accusation ou en procès. Les attentats dramatiques qui ont suscité la création de cette commission ont touché des femmes et des hommes, à qui nous pensons avant tout ; de même, les services de renseignement, d'intervention et d'investigation et même de la police du quotidien se composent de femmes et d'hommes, qui ont fait le choix de servir la sécurité de la France et qui éprouvent la douleur, la peine et l'impuissance de n'avoir pu faire mieux.
Le SCPN est le syndicat majoritaire des commissaires de police. À ce titre, la menace du terrorisme et de la radicalisation islamistes nous a frappés de plein fouet en janvier 2015, mais nous y avions déjà été abondamment sensibilisés dans tous les services de police, et nous avons eu l'occasion d'alerter sur son ampleur en France, en lien avec le contexte international. Au lendemain des attentats de janvier, la Fédération autonome des syndicats du ministère de l'intérieur (FASMI) à laquelle nous appartenons – comme l'UNSA-Police – et qui représente tous les métiers et tous les personnels – gardiens de la paix, gradés, officiers, commissaires, personnels administratifs et scientifiques de la police nationale – a adressé par écrit à notre administration et au ministre des propositions d'amélioration concernant l'évolution indispensable de notre organisation, de nos schémas tactiques d'intervention, de nos moyens de protection et d'équipement et de nos moyens juridiques d'intervention.
Si cette menace a été entendue, elle n'a pris corps pour le plus grand nombre que lorsque notre pays a hélas été frappé de nouveau, plus massivement encore, dans la nuit du 13 novembre. Nous avons alors rappelé à nos autorités de tutelle et à l'ensemble des directeurs de services quelles sont les attentes des policiers de terrain, de tous corps et de tous grades : disposer des moyens d'action nécessaires en matière de renseignement, d'intervention mais aussi de police du quotidien pour faire face à cette menace dont nous sommes convaincus qu'elle peut se concrétiser en tous points du territoire. C'est pourquoi il est essentiel de donner à la police et aux services de renseignement les moyens de ne pas être impuissants. Ces moyens sont juridiques – l'utilisation de l'arme à feu, par exemple, fait actuellement l'objet d'un projet de loi au sujet duquel le SCPN a présenté plusieurs propositions – mais portent aussi sur l'équipement en armement et en protection, ou encore sur les méthodes de travail. Il est vrai que plusieurs mesures législatives prises au cours de l'année passée ont permis de renforcer les capacités des services de renseignement, et qu'un projet visant à renforcer celles des services d'investigation est en cours d'examen.
Nous avons formulé toutes ces propositions de manière constructive, convaincus que la question de la coordination et de la collaboration entre les services est au coeur de la problématique. Nous savons depuis bien longtemps que tout ce qui nous désunit fait le jeu des malfrats et de l'adversaire, lequel est aujourd'hui si puissant qu'il est hors de question de se perdre en guerres fratricides. Nous avons toujours défendu tous les vecteurs d'une meilleure coordination entre services, qu'ils relèvent de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ou encore de la gendarmerie nationale.
L'UNSA-Police représente des gradés et gardiens – autrement dit, le corps d'encadrement et d'application – de la police nationale. La question des moyens mis en oeuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme est plus que jamais d'actualité. L'implication de tous les acteurs de l'État est nécessaire et celle des policiers, que nous représentons, est particulièrement importante. Depuis les événements du 7 janvier 2015, l'État a pu compter sur l'engagement sans faille des policiers, gardiens de la paix publique et des libertés – engagement qu'une grande partie de la foule manifestant le 11 janvier 2015 a d'ailleurs salué. Nous gardons tous en mémoire les vigoureux applaudissements qui ont accueilli le passage des forces de police à cette occasion, et les accolades nombreuses que les citoyens ont données aux policiers. Ces symboles forts participent d'un élan spontané de solidarité nationale. Nous avons en effet assisté à un réel rapprochement entre la police et la population. Si, par leurs actes ignobles et abjects, les terroristes ont cherché à diviser entre elles les différentes composantes de notre société, ils ont en fait rapproché la population de sa police, de son armée et de ses institutions.
Au cours des semaines qui ont suivi les attentats de janvier, l'engagement des policiers a été total. Une prise de conscience générale a gagné nos rangs ; certains de nos collègues ont interrompu leurs congés sans même avoir été contactés par l'administration. Chacun a fait preuve d'une vigilance accrue. Deux éléments nouveaux sont apparus, en effet : tout d'abord, les policiers intervenant dans de telles situations se trouvent en face d'individus déterminés qui ne cherchent pas la fuite, comme c'est le cas dans des affaires de droit commun, mais dont l'objectif est de tuer un maximum de personnes jusqu'à se transformer parfois eux-mêmes en kamikazes. D'autre part, les policiers constituent des cibles car ils représentent l'État : nos collègues Ahmed Merabet et Clarissa Jean-Philippe ont été assassinés au seul motif qu'ils portaient un uniforme et une inscription.
Pour tenir compte de cette situation nouvelle, notre organisation syndicale a revendiqué des moyens de protection individuelle et collective supplémentaires – tout un équipement de gilets pare-balles lourds, de casques et visières pare-balles, de boucliers pare-balles – ainsi que des moyens d'intervention renforcés – notamment des armes collectives – et la possibilité pour les policiers qui le souhaitent de rester armés en dehors de leurs heures de service. Certains de nos collègues, en effet, ont manifesté quelque crainte de rentrer chez eux, compte tenu de leur lieu d'habitation. Enfin, nous avons revendiqué l'adaptation des règles d'utilisation des armes afin que leur cadre juridique soit non contestable.
Dès janvier 2015, il s'est produit dans les services une intensification des habilitations à utiliser des armes collectives, en particulier des armes d'épaule. Les stages de tir et de maniement de ces armes ont d'ailleurs suppléé la plupart des autres stages, devenant la priorité de la formation continue entre janvier et mars 2015. Le plan BAC-PSIG, actuellement en cours de déploiement, consiste notamment à doter les services de fusils d'assaut HK G36 et de casques et boucliers pare-balles ; nous attendons l'annonce de véhicules supplémentaires. Quoi qu'il en soit, notre organisation syndicale sera vigilante quant au respect du calendrier de livraison.
L'UNSA-Police approuve toutes ces dispositions mais estime qu'elles doivent s'étendre à d'autres services. Certes, il n'est pas nécessaire qu'un policier soit équipé comme un fantassin pour exercer des missions de police générale et quotidienne – et par exemple intervenir en cas de différend familial, de vol à l'étalage ou encore d'accident de la circulation. Il doit cependant avoir à sa disposition les outils lui permettant de riposter à toute éventualité. Toutes les circonscriptions de police ne sont pas dotées d'une brigade anti-criminalité (BAC) et, là où ces brigades existent, elles ne couvrent pas toujours tous les créneaux horaires. Les équipements de la BAC doivent donc être étendus à l'ensemble des services d'intervention – au moins dans le cadre des stages de formation, qui viennent de débuter. Les efforts légitimement consentis au bénéfice des services prioritaires ou spécialisés ne doivent pas faire oublier la police du quotidien, qui peut être confrontée à tout moment à des actions terroristes isolées ou concertées.

Le 22 décembre 2014, le Premier président de la Cour des comptes a adressé au ministre de l'intérieur, M. Cazeneuve, et à la garde des sceaux de l'époque, Mme Taubira, un référé selon lequel la répartition territoriale des effectifs de police et de gendarmerie serait déséquilibrée par rapport au nombre et à la gravité des faits à traiter. Je cite : « il n'est pas rare que les deux forces » de police et de gendarmerie « se disputent l'attribution des affaires complexes », notamment en matière judiciaire. Les principales directions de la police sont « organisées de façon distincte et cloisonnée ». « Nombreuses sont les occasions pour les services de police et les unités de gendarmerie d'enquêter d'initiative sur les mêmes « cibles ». Or, « bien que le principe en soit posé par le code de procédure pénale, le partage du renseignement, clé de voûte du métier des enquêteurs judiciaires, reste rare et alimente les rivalités. (…) Les relations concurrentielles entre les deux forces ont suscité le projet, annoncé au début de 2014 par le ministre de l'intérieur avant d'être retiré, de créer une « structure commune » à la police et à la gendarmerie, destinée à lutter contre la criminalité organisée et le terrorisme en Corse. (…) Un protocole cadre de répartition des compétences judiciaires, commun aux deux forces de sécurité, pourrait être conclu avec le ministère de la justice puis décliné à travers des protocoles locaux conclus avec les parquets ».
Autrement dit, cette question n'est pas nouvelle ; elle remonte à l'existence même des deux forces. Le point de vue de la Cour des comptes concernant la rivalité et l'insuffisance du partage d'informations est-il fondé ? Peut-on améliorer l'organisation actuelle, voire aboutir à l'unité des deux corps ?
C'est un vaste sujet qui, selon moi, est sans rapport avec la question des attaques terroristes. La Cour des comptes fonde son point de vue sur des enquêtes criminelles, évoque un projet d'organisation des services de police et de gendarmerie en Corse et fait référence à la répartition territoriale des compétences. Or, rien de tout cela n'a dysfonctionné lors des attaques terroristes de 2015.

Le 7 juillet 2015, M. Jean-Michel Fauvergue, chef du RAID, déclarait à la presse que l'on « ne peut plus se permettre une guerre des services » entre police et gendarmerie. Compte tenu de « l'évolution de la menace, on a besoin de tous les opérateurs ». De fait, la question du partage de l'information a été souvent posée, au point que M. Cazeneuve lui-même a dû taper du poing sur la table pour que les informations circulent davantage. Il ne s'agit donc pas uniquement de criminalité de droit commun, mais aussi de terrorisme.
Dans la majorité des cas, le partage d'informations, sous l'autorité du parquet, fonctionne. À Creil, où j'étais en poste auparavant, les services de police et la gendarmerie tenaient tous les deux mois une réunion de coordination sur les problématiques liées à la zone de sécurité prioritaire (ZSP), étant entendu que la règle d'intervention était la suivante : le service le mieux placé pour intervenir sur une affaire s'en charge. La coordination et le partage de l'information ne signifient pas qu'il faut nécessairement fusionner. Les guerres fratricides existent également au sein d'un même service ; elles sont inhérentes à la nature humaine. Il est aussi arrivé – même si ce n'est pas le cas aujourd'hui – que les responsables administratifs et politiques dépassent le cadre d'une saine émulation pour entrer en concurrence, ce qui ne saurait tenir lieu de pratique de management.
Toutefois, il n'est pas selon nous prioritaire de réorganiser les services. La détection des doublons se fait de manière construite et apaisée lors du pré-positionnement des forces d'intervention. Il est évidemment hors de question pour un service de police prêt à intervenir en cas d'attaque de faire attendre les victimes au motif que le site relève de la compétence ratione materiae d'une unité de gendarmerie, et inversement. C'est au service le mieux placé géographiquement d'intervenir ; reste à déterminer à qui, de la police ou de la gendarmerie, incombe la direction de l'opération en fonction de la zone d'action. Il peut certes se produire des tensions lorsque le nombre insuffisant d'affaires à traiter pousse les différents services à entrer en concurrence pour être saisis, mais nous constatons plutôt le contraire : les magistrats peinent souvent à trouver un service qui accepte une saisine, notamment en matière de délinquance économique et financière.
Autrement dit, il convient de ne pas généraliser le constat formulé dans le référé de la Cour des comptes, auquel le ministre a d'ailleurs répondu de manière assez construite en précisant que la pluralité des acteurs ne se traduit pas forcément par un doublonnage toxique ou une course à l'échalote.
J'ajoute qu'en matière de renseignement, d'immenses progrès ont été accomplis ces dernières années afin d'intégrer les forces au sein du service central du renseignement territorial, la logique de concurrence ayant du même coup disparu ou presque. S'il demeure sans doute çà et là des problèmes d'ordre humain, les oppositions systémiques entre institutions n'existent plus car, outre le fait qu'il y a suffisamment de travail pour l'ensemble des services, c'est l'intérêt général qui prime.

Avez-vous été consultés au sujet du nouveau schéma national d'intervention des forces de sécurité intérieure, qui est en cours d'élaboration sous l'autorité du ministre de l'intérieur ?
Pas encore. Il n'a été présenté que très récemment aux directions générales de la police et de la gendarmerie qui, l'une et l'autre, semble exprimer leur satisfaction. Il semble que l'on a donc réussi à trouver un équilibre intelligent de partage des compétences sur l'ensemble du territoire national en vue d'intervenir le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions.

Quel jugement les commissaires portent-ils sur la coordination au quotidien des services de police avec les militaires mobilisés dans le cadre de la force Sentinelle ?
Ma deuxième question porte sur la remontée des informations en matière de lutte contre le terrorisme. Comment les choses se passent-elles concrètement en cas de dépôt d'une main courante en commissariat ? Y a-t-il des pistes d'amélioration ?
Ensuite, plusieurs exemples récents ont montré que le respect du contrôle judiciaire est plutôt aléatoire, pour dire le moins. Il semble qu'en cas de carence, lorsque le contrôle n'est pas effectué en commissariat ou à la gendarmerie, l'information met parfois jusqu'à plusieurs semaines avant de remonter aux services de renseignement. Des mesures et circulaires ont-elles été prises pour renforcer le contrôle judiciaire, en particulier lorsqu'il concerne des personnes liées à l'islam radical et au terrorisme ?
Enfin, l'équipement des BAC et des PSIG – les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie – est en cours, et nous sommes autant que vous soucieux du respect du calendrier fixé : il devrait être achevé à la fin juin, soit peu avant la remise de notre rapport. À ce stade, ce plan suit-il normalement son cours ? Estimez-vous que cet équipement, tant en termes d'armement que de protection, correspond aux attentes des personnels ?
Les centaines de commissaires avec lesquels nous sommes en lien nous ont transmis de leur propre initiative ou sur demande des informations concernant la coordination avec la force Sentinelle qui ont évolué au fil du temps. La première phase s'est caractérisée par une certaine instabilité, voire des difficultés, et pour cause : les services de police n'ont pas, en temps normal, de contacts à cette échelle avec les forces armées. En janvier et plus encore en novembre, les patrouilles ont été déployées dans un contexte où il fallait déterminer si d'autres commandos s'apprêtaient à commettre des tueries çà et là. En pratique, certaines patrouilles militaires dynamiques ont été déployées sans que les commissaires et les préfets compétents dans la zone concernée en aient été avisés. À cette phase initiale, au cours de laquelle certains de nos adhérents ont eu le sentiment que l'on mettait la charrue avant les boeufs en dispersant des patrouilles sans leur donner de but précis ni les coordonner avec les forces de police, a succédé une deuxième phase où, hormis quelques cas particuliers où les chefs de patrouille négligent d'informer l'ensemble des forces de police et de gendarmerie compétentes d'une relève, les informations qui nous remontent sont très élogieuses, au point d'être parfois préoccupantes : en province, certains collègues nous indiquent qu'ils ne pourraient pas fonctionner sans l'appoint de la force Sentinelle, laquelle exerce des gardes statiques qui relevaient auparavant des forces de police – et qui leur reviendront peut-être un jour, à moins qu'elles ne soient confiées à des sociétés de sécurité privées. Dans ce domaine, en effet, aucune piste n'est à exclure car, selon l'ensemble des experts compétents, la problématique du terrorisme devrait durer vingt-cinq à trente ans ; il nous faut donc bâtir des réponses pérennes.
En clair, le degré de coordination est satisfaisant à ce stade. Des interrogations persistent quant à ce que les militaires prévoient désormais en termes d'articulation de leurs interventions. Le 13 novembre, des soldats de la force Sentinelle se trouvaient à proximité du Bataclan : un gradé de la BAC, parvenu à l'issue de secours, leur a demandé d'intervenir, ce à quoi ils ont répondu qu'ils n'avaient pas reçu d'ordres en ce sens ; il va de soi qu'ils n'ont pas non plus prêté leur arme, un Famas, aux policiers. Sans doute y a-t-il là une marge d'amélioration des modes d'intervention. Nombreux sont nos collègues qui, le soir même du 13 novembre, se sont présentés spontanément à leur commissariat alors qu'ils étaient en congé ou en récupération – comme l'ont également fait les secouristes – pour se mettre à disposition du plus gradé. L'un de nos commissaires a ainsi pu cheminer dans le passage Saint-Pierre Amelot avec une unité de marche composée d'éléments hybrides. À l'époque, l'articulation avec les militaires était impossible, car elle n'avait pas été pensée en amont. Des travaux en ce sens ont été entrepris, et nous espérons qu'ils se traduiront par l'adoption de mécanismes de mise à disposition et d'identification du commandant opérationnel.
Le mécanisme de remontée des informations provenant du dépôt de mains courantes a été affiné dès avant les attentats à mesure que montait en puissance le dispositif de suivi de la radicalisation. L'objectif est d'encadrer la multitude de constats locaux provenant de responsables d'établissements scolaires ou de travailleurs sociaux selon lesquels une personne en voie de rescolarisation, par exemple, aurait soudain interrompu tout contact. Avec la création de la plateforme nationale d'appels de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT), le processus a été formalisé. Quant aux mains courantes, elles donnent lieu à un compte rendu écrit lorsque la personne s'est déplacée en personne ou, s'il s'agit d'un appel téléphonique à la plateforme de l'UCLAT, à un message transmis au service de renseignement territorial local à qui il appartiendra de contacter la personne en question afin de prévoir un entretien. Dans un deuxième temps, des mesures plus ou moins discrètes et poussées pourront être prises : nous disposons désormais d'un fichier digne de ce nom et d'outils de travail plus adaptés.
Non, plus maintenant. Au contraire : nous recevons trop d'informations, ce qui rend leur discrimination difficile. Le problème se pose notamment de la sortie de la liste des suspects : une personne qui y aurait été inscrite suite à un signalement et sur lesquelles des vérifications auraient été effectuées sans résultat doit-elle vraiment y demeurer ? Faut-il par exemple en déduire son incapacité à travailler sur une plateforme aéroportuaire où dans d'autres métiers ? Tout est question de proportion : il s'agit d'un processus vivant dans lequel nous tâchons de nous faire l'idée la plus précise de telle ou telle personne, étant entendu que l'erreur est possible dans un système qui, en tout état de cause, demeure démocratique – les suspects n'étant pas soumis à des questionnements trop vigoureux, nous sommes pour partie prisonniers des apparences, en particulier pour ce qui concerne les suspects les plus habiles. De ce point de vue, se pose la question de l'accès aux données chiffrées des téléphones portables. Le moindre petit caïd local, en effet, sait très bien qu'il doit crypter son téléphone.
Nous nous posons en effet la question de la sortie des tableaux de suivi de la radicalisation, car le danger pour les services est de disposer d'une liste sans fin qu'ils n'auraient pas les moyens de traiter. D'autre part, les signalements qui parviennent aux services de police doivent être articulés avec les informations que reçoivent les autres services de l'État chargés de contribuer à la déradicalisation et à l'accompagnement de personnes qui, sans être forcément dangereuses, méritent d'être suivies.

Selon l'état-major opérationnel de prévention du terrorisme (EMOPT) et l'UCLAT, que nous avons interrogés en janvier, la sortie du fichier de suivi se fait déjà. En êtes-vous informés ?
J'ignore le détail du fonctionnement de ce fichier. En revanche, lors de sa création, l'EMOPT, dont le périmètre de compétence chevauche quelque peu celui de l'UCLAT, a repris un certain nombre de fichiers d'individus répertoriés çà et là pour les insérer dans le fichier dit FSPRT. De ce fait, certaines antennes du renseignement territorial ont eu à démontrer une nouvelle fois l'inanité de l'inscription de tel ou tel individu sur la liste des personnes radicalisées, alors que cette démonstration avait déjà été faite. Or, refaire une démonstration déjà faite plusieurs mois auparavant entraîne une charge de travail supplémentaire dans une période où les services n'en manquaient pourtant pas, puisque nous étions entrés dans une phase d'attaques. Cela étant, cette difficulté devrait être résolue dès lors que les tâches accompagnant la mise en place du FSPRT auront été purgées.
En matière de contrôle judiciaire, nous ignorons si de nouvelles consignes ont été données. La difficulté tient non seulement au traitement ciblé des intéressés, mais aussi à l'absence de partage de l'information entre la justice et les services répressifs – qu'il ne faut pas attribuer à une quelconque intention malicieuse, mais plutôt à la différence des processus bureaucratiques. Un service de police typique gère quelques dizaines de contrôles judiciaires par semaine, et les carences donnent la plupart du temps lieu à la rédaction de rapports qui ne se traduisent jamais par un sursis ou par la révocation de la mesure de contrôle. Il se peut que se glisse parfois dans le lot des contrôlés un individu éventuellement radicalisé, mais surtout connu pour des faits de vol à main armée ou de trafic de stupéfiants. J'ose espérer que de tels cas donnent lieu à un coup de fil particulier : s'il est saisi de la spécificité d'un cas, un service de police en tient compte. C'est ce qui se produit pour les délinquants sexuels inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, le FIJAISV : sans doute faudrait-il reproduire le système d'alertes automatiques dont ce fichier est assorti pour affiner le suivi de certains individus radicalisés.

Il est pourtant arrivé qu'il faille plus d'un mois avant que le commissariat signale le non-respect d'un contrôle judiciaire : c'est problématique.
Le contrôle judiciaire est une mesure s'appliquant dans le cadre d'une ouverture d'information à une personne mise en examen mais qui n'est pas placée en détention provisoire. Les fiches de contrôle judiciaire dont sont saisis la plupart des commissariats portent sur des affaires de toute nature qui n'ont pas forcément de lien avec le terrorisme. Cependant, la réalité est la suivante : les services compétents établissent des dizaines de rapports de violation du contrôle judiciaire, que les violations en question portent sur l'interdiction de se trouver en présence de telle autre personne ou sur tel territoire. C'est tout particulièrement vrai dans des quartiers touchés par une délinquance chronique. Or, les services de police ont constaté l'inanité, en quelque sorte, de ces rapports de violation, puisqu'il est parfois nécessaire d'en rédiger plusieurs dizaines avant de susciter l'attention du juge d'instruction – lequel fait face à une forte masse de travail et n'est pas toujours en mesure de révoquer le contrôle judiciaire pour prononcer la détention provisoire.
Sommes-nous parvenus à mettre en place un dispositif d'alerte permettant de ne pas laisser passer la moindre violation du contrôle judiciaire dans certains cas particuliers ? Sur ce sujet comme sur d'autres, nous voulons veiller à éviter tout glissement de responsabilité. Les services des commissariats, qui sont chargés du suivi du contrôle judiciaire, exercent aussi un très grand nombre d'autres missions, et il ne faudrait pas que la responsabilité de la perte de tel signalement soit attribuée au seul policier en poste au moment concerné. De ce point de vue, il serait sans doute opportun, en effet, d'envisager un système de signalement sur le modèle de celui qui accompagne le FIJAISV.
Ajoutons qu'il est impossible, dans les entrées du fichier de la DGSI, de mentionner des antécédents judiciaires. On ne peut donc pas y recenser les infractions reprochées à tel ou tel individu. Cette approche cloisonnée, qui offre certes des garanties, pose question.
Quoi qu'il en soit, les commissariats redoublent de vigilance. Ils se heurtent toutefois à deux difficultés que nous avons toujours déplorées : d'une part, les modalités du contrôle judiciaire ne sont pas précisées, ce qui permet aux individus concernés de pointer au moment de leur choix – au milieu de la nuit, par exemple, ce qui oblige une patrouille à rentrer. D'autre part, les individus en questions déclarent des adresses qui ne font l'objet d'aucune vérification poussée. Or, il s'agit parfois d'adresses fictives – adresse inexistante ou adresse d'une « copine » résidant dans un territoire où l'intéressé n'est pas connu des services de police locaux. Tout cela ne facilite pas la capacité des services à détecter les manquements au contrôle judiciaire.

Quel est votre point de vue de représentants des commissaires sur les primo-intervenants – sachant que la situation diffère naturellement selon que l'on se trouve en région parisienne ou en province ? Jusqu'à quel point pouvez-vous envisager d'intervenir, et qui décide en la matière ?
D'autre part, quel lien entretenez-vous avec le service central du renseignement territorial, en particulier suite aux événements de 2015 ?
Enfin, comment travaillez-vous avec les gendarmes et avec certaines unités spécialisées, sachant que des changements sont à attendre de ce point de vue ?

Plusieurs articles de presse sont récemment parus sur la progression du fondamentalisme religieux dans les commissariats. Êtes-vous alertés par certains de vos collègues qui s'en inquièteraient ? Le risque pourrait en effet exister, comme on l'a vu aux États-Unis et en Afghanistan, que des policiers radicalisés se retournent contre leurs collègues.
À ce jour, monsieur le rapporteur, nous n'avons reçu aucune remontée défavorable concernant le déploiement du plan d'équipement BAC-PSIG, qui vient d'être lancé. Les attentes étaient fortes, en effet, non seulement parmi les fonctionnaires des BAC, mais aussi parmi tous les autres primo-intervenants – police-secours, services généraux, compagnies d'intervention. Le fusil HK G36 a suscité une polémique qui ne nous concerne guère, tant les conditions d'utilisation sont différentes ; un certain nombre de services en sont déjà équipés, qu'il s'agisse des brigades de recherche et d'intervention (BRI), des compagnies républicaines de sécurité (CRS) ou du RAID, par exemple. Ce matériel donne entière satisfaction par sa facilité d'emploi et de transport. Quant à l'équipement de protection, il consiste en gilets pare-balles particuliers et accessibles qui permettent de se mouvoir aisément, en casques balistiques à visière et en toute une palette d'équipements qui répondent aux attentes de nos collègues, qui s'en disent satisfaits.
Cela étant, ce plan d'équipement ne concerne que les BAC ; nous souhaiterions qu'il soit largement étendu à d'autres services. Encore une fois, il n'est pas question d'équiper les fonctionnaires de police-secours comme des fantassins, mais au moins de mettre à leur disposition l'équipement leur permettant d'intervenir – ne serait-ce que dans les circonscriptions sans BAC.
En tant que chefs de service, nous nous sommes opposés à l'emploi du terme « primo-intervenant », qui laisse entendre qu'un équipage part toujours en mission en connaissant son objectif d'intervention ; c'est artificiel. En zone urbaine comme en zone rurale, l'hypothèse qu'un équipage de police ou de gendarmerie intervienne sans le savoir dans une tuerie terroriste est envisageable – connaissant l'ampleur du risque de passage à l'acte, nous en sommes convaincus. Notre priorité, qui rejoint celle des services de terrain, a donc été de niveler les équipements en fonction de la vocation des unités, les unes étant destinées à intervenir jusqu'au bout – dans un lieu fermé lors d'une prise d'otages, par exemple – tandis que d'autres, intermédiaires – les BAC et les PSIG notamment – sont formées à des types d'interventions qui peuvent là aussi justifier un niveau d'équipement supérieur, sans pour autant négliger les policiers primo-arrivants qui effectuent leurs missions quotidiennes sur la voie publique, et qui peuvent se trouver confrontés à une tuerie. Nous exigeons qu'ils aient le droit de vendre chèrement leur peau, si j'ose dire, en étant protégés comme les autres policiers, mais aussi qu'ils ne soient pas condamnés à l'impuissance. Il est très difficile pour un policier confronté à une attaque de se savoir identifié comme représentant de la puissance publique et de ne pouvoir rien faire pour que cesse la tuerie.
En clair, s'il n'est pas question de faire des policiers généralistes des Robocop et s'ils doivent se concentrer sur leurs missions prioritaires du quotidien, il faut toutefois leur donner les moyens de se défendre et de défendre les citoyens grâce à des équipements embarqués de manière protégée dans les véhicules. Aujourd'hui, les équipages les plus formés sont habilités à porter l'arme ; les autres équipages – c'est particulièrement important dans les circonscriptions qui ne bénéficient pas de la présence permanente d'une BAC – doivent pouvoir transporter de manière sécurisée des équipements dont ils peuvent s'armer en quelques minutes pour protéger la population, car c'est leur devoir.
La voiture de police-secours conviendrait telle quelle si elle était plus grande, car ces équipements prennent de la place, en effet. J'ai été choqué, à Creil, que deux de nos véhicules soient « pliés » par de grosses berlines volées ou achetées avec l'argent de la drogue, nos voitures étant mises hors d'usage tandis que les berlines en question roulaient toujours. Face à une menace en constante évolution, il faut renforcer les moyens en conséquence. Certes, cela a un coût. Il faut par exemple prévoir un support pour sécuriser les armes, car certains n'hésitent pas à se servir dans les véhicules de police. Sinon, les patrouilles devraient se composer de quatre agents car, dans certains quartiers, les interventions à trois agents peuvent mal tourner, ou bien les agents devraient transporter sur eux l'ensemble de leur équipement, depuis le lance-grenades et le pistolet à impulsion électrique jusqu'au fusil d'assaut, alors qu'ils n'interviennent que sur un différend conjugal, par exemple. Ce n'est pas cette police que nous voulons. Il faut simplement permettre l'accès rapide et sécurisé à bord des véhicules à un équipement permettant de répondre à une attaque terroriste. Les terroristes choisissent leurs cibles : on peut envisager qu'ils attaquent simultanément dix patrouilles de police et de gendarmerie en dix endroits différents. Il faut alors que les agents puissent disposer d'au moins une arme collective pré-positionnée pour réagir.
Cela va de pair avec une adaptation du cadre juridique permettant d'utiliser ces armes en s'affranchissant de l'extrême subtilité des règles de la légitime défense – auxquelles nous sommes par ailleurs très attachés, car elles contribuent à une culture de la force maîtrisée dont nous sommes fiers – en cas de situation exceptionnelle ou d'attaque terroriste, à supposer que les fonctionnaires concernés en aient conscience, notre collègue Ahmed Merabet étant sans doute mort sans même savoir qu'une attaque avait eu lieu dans les locaux de Charlie Hebdo. Tout en restant raisonnable, il faut donc tenir compte du fait que nous avons changé d'ère. Nous ne l'avons pas souhaité et le regrettons, comme tout le monde. Puisque les attaques terroristes se produisent, nous devons en prendre acte et permettre à la police de paix publique de se muer rapidement en police plus affermie qui n'aura pas à subir une quelconque impuissance.
L'année 2015, monsieur Cavard, a été une année de consolidation du renseignement territorial qui, par la force des choses, a bénéficié d'une mise à niveau de ses moyens à la hauteur de sa mission. Les fonctionnaires du renseignement territorial ont, au lendemain des attentats de janvier et de ceux de novembre, fait la démonstration remarquable de leur réactivité et de leur mobilisation. Des efforts restent à accomplir, mais les responsables des services départementaux du renseignement territorial sont pleinement mobilisés pour que l'information circule et que les synergies se développent. Le lien entre le renseignement territorial et les services de la sécurité intérieure ne pose désormais plus aucun problème. L'enjeu reste donc de donner au service du renseignement territorial les moyens de son bon fonctionnement, car il est en première ligne en matière de radicalisation.
De même, s'agissant du lien avec la gendarmerie, il est vrai que certaines concurrences se sont développées car rien n'a été fait – y compris en termes de décisions politiques – pour les enrayer, mais ce débat relève davantage des administrations centrales. Dans les territoires, cependant, les fonctionnaires sont avant tout soucieux de travailler main dans la main. Mieux vaut consolider les capacités à travailler ensemble plutôt que déstabiliser le système tel qu'il existe, car le moment paraît peu adapté.
Enfin, comme toute institution, la police nationale présente des points de vulnérabilité, mais les cas de radicalisation qui ont été signalés sont extrêmement peu nombreux. On constate plutôt des problèmes liés au respect de la laïcité et à la pratique religieuse dans les services, qu'il s'agisse de l'exigence d'un temps de culte pendant le service ou de l'expression d'une pratique religieuse un peu radicale.
Là est toute la difficulté. L'article de presse que vous avez cité, monsieur Verchère, faisait suite à une note confidentielle de vigilance qui, en réalité, ne faisait que mettre noir sur blanc ce qui est une pratique habituelle de vigilance entre collègues – qu'il s'agisse de radicalisation, de consommation de drogue ou d'autres problèmes. Selon les informations dont nous disposons, le phénomène de radicalisation dans la police demeure très marginal et se cantonne à des unités qui emploient des agents de surveillance sur la voie publique, qui sont davantage des collaborateurs du service public que des policiers à part entière. Il faut donc trouver un juste équilibre en n'empêchant pas ceux de nos collègues qui le souhaitent de s'épanouir spirituellement tout en demeurant assez vigilants pour qu'ils ne franchissent jamais la ligne rouge.

Quels sont les moyens juridiques dont vous disposez pour traiter le cas des personnes revenues du djihad ? Le Premier ministre nous dit qu'un millier de personnes seraient parties et plus de 250 revenues. L'ancienne garde des sceaux avait pris une circulaire afin que ces personnes ne puissent être poursuivies qu'au titre de deux qualifications pénales seulement : l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et l'entreprise terroriste individuelle. N'ayant aucun lien avec les services syriens, nous ne disposons que d'informations parcellaires et fortuites. Or, les autorités judiciaires se sont régulièrement prononcées contre la détention provisoire des personnes concernées, ce qui suscite une menace diffuse. Pensez-vous que l'on pourrait recourir à d'autres incriminations prévues dans le code pénal, comme l'intelligence avec une puissance étrangère, qui est passible d'une peine de trente ans de réclusion, ou d'autres qualifications plus précises ? L'initiative qu'a prise le Gouvernement de compléter, dans le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le dispositif applicable aux personnes sur lesquelles nous manquons d'informations, montre que le dispositif actuel est lacunaire.
Ma deuxième question porte sur les effectifs. J'examine chaque projet de loi de règlement avec la plus grande attention, et je constate d'après le dernier d'entre eux, qui porte sur 2014, que le nombre de postes pourvus dans la police et la gendarmerie n'a pas été augmenté de cinq mille emplois pour la période 2011-2014, bien au contraire : il a diminué de deux mille dans la police, comme s'en est fait l'écho Le Monde. À chaque fois que je l'interroge sur ce point, le ministre de l'intérieur me fait une réponse hors sujet sur les plafonds d'emplois qui, eux, augmentent de manière incontestable, quoique virtuelle. J'espère que cette tendance changera en 2015 : certains services spécialisés, dans le renseignement notamment, semblent bénéficier de renforts. Plus globalement, le nombre élevé de recrutements est lié à l'évolution de la pyramide des âges. Quelle analyse faites-vous du volume actuel des effectifs ?
S'agissant de la judiciarisation des personnes revenant d'un théâtre d'opérations terroristes, la première des difficultés consiste à fournir la preuve des actes commis. Certaines personnes se rendent dans les pays en question en tant qu'authentiques travailleurs humanitaires ou journalistes, voire parlementaires : il n'est donc pas aisé de définir l'infraction pour discriminer entre tous ces cas. Selon nos collègues, une infraction manque néanmoins à notre dispositif juridique : il serait opportun d'adapter à la détention d'un important volume d'images d'actes faisant l'apologie de la violence le même régime qui fonctionne très bien en matière de pédophilie. En effet, la détention d'images pédophiles constitue une infraction, mais pas celle de plusieurs dizaines de giga-octets d'images d'égorgements que l'on montre à tous les copains de l'immeuble. Cette demande nous est transmise de manière régulière, et je vous la livre telle quelle, en attendant que nous la formalisions.
L'ouverture d'une instruction judiciaire pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ou pour entreprise individuelle de terrorisme repose la question de la judiciarisation du renseignement. Certes, nos liens officiels avec les services de renseignement syriens sont quasi inexistants, mais nous recueillons tout de même des éléments via d'autres capteurs. Tous ces éléments sont couverts par le secret défense et le code de procédure pénale ne prévoit pas de les exploiter dans le cadre d'une procédure judiciaire. Le mode de transformation de ces éléments d'information en preuves judiciaires reste donc à bâtir. En effet, il arrive souvent que des renseignements recueillis au moyen d'interceptions téléphoniques couvertes par le secret défense ne puissent être versés au dossier d'un procès contradictoire. De ce point de vue, la perquisition administrative, souvent décriée et qui a fait l'objet de tant de fantasmes, a au moins eu le mérite de lever des doutes sur des individus signalés via la plateforme de signalement, en contact avec des milieux salafistes et ayant par exemple mentionné leurs caches d'armes lors de conversations téléphoniques. En l'état actuel du droit, aucune procédure judiciaire ne permet d'aller vérifier ces éléments au domicile des intéressés, sauf à trouver un prétexte ou à ce qu'ils soient interpellés en compagnie de trafiquants de stupéfiants, par exemple. De même, les quelque 80 assignations à résidence encore en cours ont bien des défauts et ne concernent pas le haut du spectre des suspects, mais elles ont au moins le mérite de permettre la géolocalisation – une géolocalisation du pauvre, en quelque sorte – d'individus qui, en dépit de leurs protestations outrées dans les médias, ont passé la nuit du 13 au 14 novembre à se féliciter des attentats par téléphone. Ces personnes sont tenues de pointer trois fois par jour, et tout manquement déclenche immédiatement un mécanisme d'alerte. Peut-être pourrait-on s'en inspirer en fixant la date et l'heure des contrôles judiciaires, afin de tenir compte de la charge de travail des services.
S'agissant des effectifs, disons d'emblée ceci : la police nationale n'a pas été épargnée par la réduction générale des politiques publiques. Depuis 2008, les pertes d'effectifs ont été considérables. À titre de comparaison, la police nationale comptait vingt-cinq structures de formation en 2000 ; en 2015, elle n'en avait plus que dix. Avec moins de la moitié des structures de formation, nous devons pourtant former un nombre équivalent de fonctionnaires – recrutés ou intégrant les écoles. Dans les années 2000, 5 617 élèves gardiens de la paix étaient formés chaque année ; aux 2 917 fonctionnaires formés en 2015 dans les dix structures restantes, il faut ajouter un nombre substantiel d'adjoints de sécurité et de cadets de la République qui portent le nombre total de personnes formées à plus de cinq mille. Les écoles se trouvent en surchauffe car, si le besoin de recrutement est réel dans le services, les moyens de formation peine à y répondre. Pour y remédier, l'administration a suggéré de diminuer de plus de 40 % la formation des gardiens de la paix qui étaient auparavant adjoints de sécurité ; de notre point de vue, une telle réduction n'est pas satisfaisante car il n'est pas question de dispenser des formations moins bonnes, même si les intéressés ont déjà acquis des compétences dans le cadre de leurs missions antérieures. Le métier de policier se complique du fait, entre autres, de l'emploi des nouvelles technologies et de l'évolution du cadre juridique. Cette question de la formation constitue donc un réel problème.

Depuis les attentats de 2015, le dispositif de sécurité dans son ensemble – renseignement, intervention ou encore surveillance – monte en puissance. Combien de temps allez-vous tenir ainsi ? Nous saluons le professionnalisme, l'état d'esprit et la disponibilité de nos forces de police, mais les temps de récupération sont tout de même nécessaires. Or, de grandes manifestations – sportives, par exemple – se profilent à l'horizon, qui susciteront la mise en place de dispositifs importants. Comment envisagez-vous la question des congés, du temps de travail, des heures supplémentaires, de la récupération ?
Ensuite, vous avez beaucoup évoqué les moyens en armement et en protection, mais qu'en est-il des moyens technologiques dont disposent les équipages en matière de géolocalisation, de numérisation, de cartographie, d'utilisation des fichiers en temps réel, de partage de l'information ?
Enfin, s'agissant des doctrines d'emploi – une question qui dépend pour partie de celle des moyens –, la logique de police-secours est-elle toujours adaptée à la situation actuelle ? Ne devrait-on pas privilégier le maillage permanent du territoire en temps réel ? En situation d'attentat, il faut certes que les délais d'intervention soient très rapides, comme ce fut le cas en 2015, mais que répondrez-vous si l'on vous impose une nouvelle doctrine consistant à accélérer les délais de neutralisation dans la foulée d'une intervention ?
Dès le 7 janvier 2015, notre fédération syndicale a alerté le ministre sur le fait que la mobilisation des fonctionnaires de l'ensemble des services du corps d'encadrement et d'application s'inscrirait hélas dans la durée, et qu'il faudrait donc, en quelque sorte, ménager les troupes. Il ne sert à rien de mobiliser la totalité des agents à 100 % dans les jours et les semaines qui suivent un attentat ; mieux vaut conserver des ressources. Cette demande a été en partie entendue et chacun a eu la possibilité de fixer des périodes de congé et de récupération. En effet, il arrive souvent que les missions de police consistent aujourd'hui en décalages ou en rappels dans de petites unités, et pour cause : nombreux sont les services de police qui connaissent des problèmes d'effectifs. Nos collègues en poste dans les aéroports, par exemple, sont en nette surchauffe car ils doivent contrôler tous les vols, y compris ceux qui proviennent de l'espace Schengen. Au-delà d'une certaine limite, ce rythme ne pourra plus être tenu et il faudra bien trouver un créneau permettant à chacun de récupérer ou répartir autrement les missions.
La question de la récupération va de pair avec celle de la réorganisation permettant de conduire toutes nos missions de façon durable. La direction générale de la police nationale conduit déjà des réflexions à ces fins. Ce souci de réorganisation s'articule avec la nécessité de ne pas déstabiliser l'architecture générale du dispositif : encore une fois, mieux vaut consolider que révolutionner.
Peut-être payons-nous aujourd'hui les effets collatéraux de telle ou telle réforme de services, celui du renseignement par exemple. Ainsi, l'information générale telle qu'elle a été restructurée lors de la création de la DCRI se compose d'un tiers des effectifs des anciens renseignements généraux pour un spectre de missions inchangé. Comment cela pouvait-il ne pas se traduire par un amoindrissement du maillage ? En théorie, l'idée était excellente : il s'agissait d'allier la rigueur quasi militaire de la direction de la surveillance du territoire (DST), qui avait fait la preuve de son efficacité dans la lutte contre les espions soviétiques, avec le sens de l'initiative et le maillage territorial des renseignements généraux, pour obtenir une sorte de FBI à la française. Malgré les alertes lancées dès cette époque, nous en constatons aujourd'hui pour partie les résultats.
L'équipement des forces de police en nouvelles technologies progresse – je pense au projet de police 3.0 ou encore à la tablette NéOGEND. Le déploiement de ces équipements est en phase expérimentale, non seulement parce que les moyens disponibles ne permettent pas encore d'en généraliser l'emploi, mais aussi parce que les policiers et les gendarmes ont besoin d'un temps d'acculturation, car ils sont loin d'être tous des geeks.
De plus, la priorité actuelle consiste à former les agents aux techniques de tir et de maniement de nouvelles armes – ce qui m'amène à aborder la question de la doctrine d'intervention. Elle est la suivante : le premier arrivé sur place n'est pas forcément le premier à intervenir, sachant qu'il faut distinguer entre les zones de gendarmerie, où la densité est souvent moindre, et les zones de police, où les patrouilles peuvent à tout moment être confrontées à des actes de violence, comme l'illustre le cas récent d'un braquage dans Paris qui s'est transformé en fusillade. Il va de soi qu'il ne revient pas au centre de commandement et d'information de la police de déterminer si, en cas d'attaque terroriste, il convient d'envoyer la BAC plutôt que la patrouille de police-secours ; c'est l'inverse qui se produit. Une patrouille de police, quelle qu'elle soit, qui passerait dans une rue adjacente au site d'une tuerie, n'attendra évidemment pas l'arrivée des « primo-intervenants » pour agir. C'est pourquoi nous réclamons le pré-positionnement dans tous les véhicules de police, a fortiori lorsqu'ils ne sont pas banalisés, de moyens plus puissants tels que des pistolets-mitrailleurs, comme l'ont fait depuis dix ans les Allemands, qui ont connu des massacres dans des écoles.
La mission de police-secours, au fond, a trait aux missions régaliennes de l'État en matière de sécurité. Nous devons toiletter la répartition des compétences avec d'autres acteurs de la sécurité, ce dont il faudra reparler en vue des grandes manifestations qui se profilent et que nous évoquions déjà avant les attentats de l'an dernier. La mobilisation pour faire face aux attentats ne doit pas faire oublier la pression migratoire et les effectifs qu'elle consomme dans le secteur de Calais et Dunkerque, par exemple, ou encore dans les Alpes-Maritimes ; or, cette situation n'est pas non plus vouée à s'améliorer rapidement.
Se pose donc la question de la contribution des forces de sécurité privées et de celle des autres forces de sécurité publiques, y compris municipales et locales. Certes, nous sommes très attentifs à ce que certaines missions continuent de relever du rôle régalien de l'État, car il y va de l'égalité de traitement et de l'égalité des territoires. La question doit néanmoins être posée, car nous sommes convaincus que la menace actuelle perdurera pendant des années, voire des décennies.
J'ajoute que l'état de la police et de la gendarmerie du quotidien est directement lié à la qualité de la lutte antiterroriste, car les détecteurs de proximité des signaux faibles sont les patrouilles qui connaissent la réalité de la radicalisation et savent remonter les informations. Or, la police du quotidien est aujourd'hui empêtrée dans des gardes statiques, à commencer par celles des commissariats eux-mêmes. Sans doute faut-il envisager d'investir aujourd'hui des moyens dans la sécurisation passive, qu'il s'agisse de bâtiments cultuels ou d'installations sensibles, afin d'économiser demain sur les coûts de fonctionnement des forces militaires mobiles comme Sentinelle.
D'autre part, il faut rétablir les patrouilles de police sur la voie publique, ce qui suppose que les policiers ne soient pas accaparés par des travaux de saisie informatique visant à recueillir des plaintes. Une patrouille de trois agents qui constate une infraction et interpelle son auteur est, à son retour au commissariat, neutralisée pendant trois heures, car l'un des trois agents dresse le procès-verbal et les deux autres ne ressortent pas sans lui tant, dans bien des quartiers, patrouiller à deux est une forme de provocation et supposerait en outre une intervention seul pendant que l'un des deux agents en question garde le véhicule. En tout état de cause, les travaux en cours sur la réforme de la procédure pénale sont primordiaux pour redonner des marges de manoeuvre et de l'efficacité à l'action des services de police.

Je vous remercie pour la qualité de vos réponses complètes et riches, qui nous permettront de formuler des propositions dans le sens que vous avez exprimé.
L'audition s'achève à 20 heures 30.
Table ronde, ouverte à la presse, de M. Olivier Janson, secrétaire général adjoint de l'Union syndicale des magistrats, et M. Benjamin Blanchet, chargé de mission ; Mme Clarisse Taron, présidente du Syndicat de la magistrature, et Mme Laurence Blisson, secrétaire générale ; Mme Béatrice Brugère, secrétaire générale de FO Magistrats, et M. Jean de Maillard, membre associé.
La table ronde commence à vingt heures trente.

Nous achevons nos travaux de ce jour en recevant des représentants syndicaux de la magistrature, dont l'éclairage nous sera très utile : M. Olivier Janson, secrétaire général adjoint de l'Union syndicale des magistrats (USM), et M. Benjamin Blanchet, chargé de mission ; Mme Clarisse Taron, présidente du Syndicat de la magistrature, et Mme Laurence Blisson, secrétaire générale ; Mme Béatrice Brugère, secrétaire générale de FO Magistrats, et M. Jean de Maillard, membre associé.
Mesdames, messieurs, je vous rappelle que cette table ronde est ouverte à la presse ; elle fait donc l'objet d'une retransmission en direct sur le site internet de l'Assemblée nationale et son enregistrement sera disponible pendant quelques mois sur le portail vidéo de l'Assemblée. Je vous signale, par ailleurs, que la Commission pourra décider de citer dans son rapport tout ou partie du compte rendu qui sera fait de cette audition.
Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relatif aux commissions d'enquête, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Olivier Janson, M. Benjamin Blanchet, Mme Clarisse Taron, Mme Laurence Blisson, Mme Béatrice Brugère et M. Jean de Maillard prêtent serment.)
Nous vous remercions pour votre invitation. Nous sommes sensibles au fait qu'il vous ait paru important d'entendre la parole des magistrats dans son expression syndicale. Nous sommes également sensibles à la manière dont vous avez conduit vos travaux jusqu'ici. En effet, lorsqu'une commission d'enquête parlementaire est créée pour enquêter sur des faits relevant d'une information judiciaire, on est à la limite des compétences respectives de l'autorité judiciaire et du Parlement. Or vous avez su faire en sorte que vos travaux portent sur l'avenir et sur l'état du dispositif législatif plutôt que sur les faits eux-mêmes.

Je profite de cette occasion pour dire publiquement à ceux qui l'auraient mal compris que, contrairement à ce qu'a prétendu la presse, notre commission d'enquête n'a effectué aucune reconstitution au Bataclan. Il s'agissait uniquement pour nous d'analyser les moyens d'intervention des forces et des unités d'élite – on ne parle pas des enquêteurs – afin de comprendre la manière dont ils sont parvenus à neutraliser les terroristes et comment les services de secours ont pris en charge les victimes. Je précise que cette salle de spectacles est actuellement en travaux, qu'aucun scellé n'y avait été posé et que nous n'avons pas empiété sur le domaine judiciaire. Je tenais à faire ce rappel, car j'ai cru comprendre que certains avaient exprimé des états d'âme. Êtes-vous d'accord avec moi, monsieur le rapporteur ?
L'Union syndicale des magistrats souhaite exprimer un triple message.
Premièrement, bien que l'autorité judiciaire ait une compétence reconnue en matière de lutte contre le terrorisme, qu'il s'agisse du passé ou des faits les plus récents, elle est dotée de moyens absolument insuffisants. Ce manque de moyens est un problème récurrent qui affecte autant les services de renseignement que les services d'enquête et l'autorité judiciaire. Deuxièmement, les instruments juridiques, qui ont évolué au fil du temps, répondent à des besoins, qu'ils soient exprimés par les services de renseignement, par les enquêteurs qui agissent sous la direction du procureur de la République ou par le juge d'instruction. Mais, et c'est le troisième point – sans doute le plus intéressant pour les travaux de votre commission d'enquête –, cette évolution n'a été accompagnée d'aucune réflexion d'ensemble sur la mise en cohérence des interventions respectives des services de renseignement, des services d'enquête et de l'autorité judiciaire. C'est cette absence de réflexion d'ensemble qui suscite le plus d'inquiétudes pour l'avenir : qui décide que telle intervention relève du renseignement et telle autre du judiciaire ? Qui décide de la mise en cohérence des informations ?
Je commencerai donc par évoquer le manque de moyens. Il se trouve que les services placés sous l'autorité du procureur de la République ont été, hélas, mis en lumière par les attentats de janvier et de novembre 2015. J'insiste sur ce point, car, pour l'opinion publique, celui qui symbolise, de fait, la lutte contre le terrorisme, c'est, qu'il le veuille ou non, le procureur de la République de Paris. Celui-ci a en effet démontré, par ses interventions et son mode de communication, la réactivité de l'autorité judiciaire et sa capacité non seulement à remplir sa mission immédiate, mais aussi à prévenir les troubles à l'ordre public. Il ne s'agit pas, ici, de faire son panégyrique : c'est ainsi. Et la magistrature se félicite, de manière sans doute assez unanime, de l'image qui a été donnée de son travail et de celui de l'ensemble des fonctionnaires placés sous l'autorité du procureur de la République de Paris. Pourtant, les moyens dont dispose ce dernier sont dérisoires. Qu'on en juge. La section antiterroriste du parquet de Paris, dite « C1 », qui est compétente pour l'ensemble du territoire français, comprend actuellement, après une évolution intervenue dans le courant de l'année 2015, douze magistrats ! Quant à ceux de la 16e chambre, chargés de juger les infractions terroristes, ils sont au nombre de neuf. Enfin, le pôle antiterroriste, surnommé « la galerie saint-Éloi », compte désormais dix magistrats.

M. Molins, le procureur de la République de Paris, nous a indiqué que des renforts étaient prévus au parquet et à l'instruction.
Les chiffres que j'ai cités incluent les renforts prévus dans le Plan antiterroriste « PLAT 1 », qui date du début de l'année. Le PLAT 2 prévoit en effet d'autres renforts, mais ils ne sont toujours pas arrivés à l'heure où je vous parle. Du reste, pendant l'année 2015, la communication du ministère a eu tendance à exagérer les renforts apportés notamment à la section antiterroriste. Des appels à candidature ont été lancés, mais la réalité est celle que je viens de vous décrire. Certes, des magistrats ont intégré le parquet de Paris, mais ils sont appelés à renforcer la section antiterroriste de manière tout à fait subsidiaire, en cas d'événements graves ; ils ne sont pas membres de cette section. J'ajoute qu'un seul juge de l'application des peines est spécialisé dans l'antiterrorisme – un second poste devrait être créé au cours de l'année 2016.
Par ailleurs, la cour d'assises spéciale, dont je rappelle qu'elle est entièrement composée de magistrats, requiert sept juges en première instance – neuf en appel –, pour un dossier, sachant que ces affaires sont d'une durée extraordinaire. Des effectifs extrêmement importants sont donc mobilisés, alors que nous ne disposons pas des moyens nécessaires par ailleurs. Je n'évoque pas la situation des juges civils, bien que de très nombreux contentieux soient attendus, notamment en matière de préjudices corporels.

Les représentants des autres syndicats partagent-ils l'avis de l'USM sur l'insuffisance des effectifs, malgré l'annonce de renforts ? Vous auriez pu évoquer également la situation des greffes, monsieur Janson.
En effet. La chambre correctionnelle chargée de juger les délits terroristes compte sept agents des greffes. Les effectifs sont – le terme n'est peut-être pas adapté compte tenu de la gravité du sujet – ridicules.
Nous établissons une distinction entre les moyens spécialisés – qui ont été renforcés dans les proportions indiquées et qui, même s'ils sont insuffisants, ont bénéficié d'un réel effort – et les moyens locaux. Une circulaire de décembre 2015 prévoit que, en cas d'attentats multiples, les juridictions et les parquets locaux devront être activés. Des magistrats référents en matière antiterroriste ont donc été désignés au sein de ces juridictions, mais il ne s'agit pas de postes supplémentaires : ces magistrats se voient confier cette tâche en sus de leur service. J'ajoute que nous avons de réelles inquiétudes quant à l'articulation de ces services et à la mobilisation des parquets locaux en cas de besoin. En effet, dans ce domaine, rien n'est fait et, pour ce qui est des moyens techniques, ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui dans les juridictions, c'est-à-dire globalement lamentables – je pense notamment à l'informatique et à la téléphonie.
Nous abordons ce sujet extrêmement important de façon un peu différente. Pour FO Magistrats, en effet, la question des moyens doit s'analyser en fonction des objectifs visés. Tout d'abord, on a annoncé, après chaque attentat, un renfort substantiel de moyens qui n'est pas arrivé. Mais la désignation de 178 référents locaux pouvait laisser penser que nous allions sortir du dogme jacobin de la centralisation du parquet de Paris. Je m'explique.
La centralisation à Paris de la lutte contre le terrorisme est un choix, qui avait sa raison d'être : le terrorisme a toujours eu un aspect politique, les services de renseignement compétents se trouvent à Paris et les menaces étaient, du point de vue quantitatif, relativement restreintes par rapport à ce qu'elles sont aujourd'hui. Or, comme nous avons désormais affaire à ce que nous appelons des nouvelles menaces extrêmement nombreuses, il nous semble intéressant de lier la question des moyens à une réflexion portant sur une nouvelle organisation de la lutte contre le terrorisme. Celle-ci pourrait ainsi, dès lors que le terrorisme est désormais susceptible de se développer sur l'ensemble du territoire, reposer sur un maillage territorial semblable à celui qui existe en Italie. Certes, les parquets italien et français ne sont pas tout à fait comparables puisque le juge d'instruction n'existe pas en Italie, mais, dans ce pays, plus de 150 magistrats connaissent des affaires de terrorisme, contre une dizaine au parquet antiterroriste français.
Notre vision du terrorisme est séparée de la lutte contre la criminalité organisée alors que la frontière entre ces deux types de criminalité est poreuse. Maintenir la centralisation de la lutte antiterroriste à Paris avec aussi peu d'effectifs traduit surtout, selon nous, un défaut de vision : on n'a pas anticipé la réalité de la menace à venir. En décembre dernier, 178 parquetiers de province ont été désignés référents antiterroristes. Ainsi le ministère a annoncé que les effectifs avaient augmenté alors qu'en réalité, ces magistrats n'ont qu'un pin's « Antiterrorisme » : cette mission s'ajoute à toutes leurs autres tâches.

Pouvez-vous nous dire précisément ce qu'est un référent antiterroriste dans une juridiction de province ? A-t-il des pouvoirs d'enquête ?
Ils aimeraient le savoir eux-mêmes… Lors du séminaire auxquels ils ont été invités à participer à Paris, lundi dernier, « C1 », c'est-à-dire le parquet antiterroriste, leur a rappelé que le code de procédure pénale prévoit, en matière de lutte contre le terrorisme, une compétence parisienne, que Paris interprète comme une compétence exclusive – et, de fait, c'est la réalité. Dès lors, pour le parquet antiterroriste de Paris, ces magistrats référents ne doivent surtout rien faire : leur rôle est de fluidifier l'information et de la lui faire remonter. S'il estime – et cela pose un problème de procédure et, éventuellement, d'efficacité – que le début de la procédure relève du terrorisme, il prendra les choses en main et des magistrats parisiens se rendront sur place. S'il estime qu'il ne s'agit pas de terrorisme, les parquetiers doivent traiter l'affaire comme une affaire de droit commun, à l'exception des affaires d'apologie du terrorisme, qui seront traitées en régions, car elles sont considérées comme relativement mineures.
La question des moyens se pose, certes, mais il faut savoir de quoi nous parlons. Actuellement, pour « C1 », la lutte contre le terrorisme doit être centralisée à Paris. C'est un point important, car si, demain, des attaques terroristes sont disséminées sur l'ensemble du territoire, je ne sais pas comment, compte tenu des moyens dont il dispose, « C1 » pourra absorber ces multiples attaques, qui nécessiteront notamment des déplacements et une prise de procédures immédiate afin d'éviter que celles-ci ne soient attaquées par les avocats des terroristes – car ces derniers font du droit et ils choisissent de bons avocats. Une telle organisation poserait donc un problème de fluidité et de garantie des procédures.

N'est-il pas utile que l'information soit centralisée pour éviter qu'elle ne se perde ? Certes, trop d'information tue l'information, mais il est logique que les référents locaux la fassent remonter au parquet antiterroriste afin que celui-ci puisse opérer un tri et repérer les informations pertinentes. C'est d'autant plus important que, même au sein de « C1 », il arrive que des informations se perdent.

Madame Brugère, déduisez-vous du constat que vous avez dressé qu'il faut supprimer la section antiterroriste de Paris et redonner des compétences aux juridictions de province ou bien qu'il faut conserver cette centralisation en augmentant très sensiblement les effectifs ?
Je décris l'existant. Je ne remets pas en cause le modèle jacobin parisien, qui a eu sa légitimité et sa raison d'être. Je dis simplement que, si l'on conserve ce schéma, on se prive, compte tenu des nouvelles menaces, de renseignements, de la possibilité d'agir avec efficacité et d'une capacité de réaction sur l'ensemble du territoire. Je précise, monsieur le rapporteur, que le renseignement ne remonte pas à Paris, car tel n'est pas le rôle confié aux magistrats dits référents : si un délit est commis, ils doivent interroger « C1 » pour savoir si celui-ci est compétent ou s'ils peuvent eux-mêmes traiter l'affaire.
Il se trouve en effet que j'ai été juge antiterroriste – à la 14e chambre, à l'époque. J'ai donc, dans ce domaine, une expérience qui explique peut-être la passion avec laquelle je m'exprime. Quoi qu'il en soit – et c'est un choix politique crucial pour l'avenir de la justice –, si l'on continue à séparer, d'un côté, le terrorisme et, de l'autre, la criminalité organisée – et on peut penser que c'est nécessaire – en estimant que les deux types de criminalité ne se rencontrent jamais, on empêchera que des enquêtes conduites par des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) ou portant sur la criminalité organisée permettent d'anticiper ou, en tout cas, de démanteler des affaires de terrorisme. Mais, encore une fois, ce choix peut se comprendre.

Vous ne nous avez pas dit quel était, selon vous, le schéma idéal. Manifestement, vous n'avez pas la solution.
Si, mais nous vous l'exposerons plus tard.
L'USM est d'un avis différent : on ne peut pas avoir 178 pôles antiterroristes particulièrement compétents et réactifs, agissant en parfaite cohérence sur l'ensemble du territoire. Il y a une certaine confusion entre deux notions, qui m'amène au deuxième point que je souhaitais évoquer : l'absence de cohérence et de réflexion structurée sur le rôle et la place de chacun.
Nous sommes confrontés à une évolution radicale du mode terroriste : aux filières se sont ajoutées des entreprises terroristes individuelles – la législation a été modifiée pour tenir compte de cette évolution – ; les attentats, qui étaient centralisés et s'attaquaient à des symboles, ont lieu maintenant – et peut-être, hélas, à l'avenir – en province… Le renseignement doit donc reposer sur un maillage complet du territoire. En revanche, le travail qui consiste à remonter les filières, assurer la cohérence de différentes enquêtes et repérer des liens entre les informations doit évidemment être centralisé. C'est une question, non pas de jacobinisme, mais d'efficacité. Le législateur a créé, dans des domaines tout autres, des pôles de compétence ; il serait tout de même curieux que l'on suive, en matière de terrorisme, une logique inverse qui consisterait à décentraliser.
Le Syndicat de la magistrature est depuis longtemps favorable à ce que l'antiterrorisme soit traité au niveau des juridictions interrégionales spécialisées. Celles-ci, qui sont au nombre de sept, ont des compétences particulières et la possibilité de mobiliser des moyens un peu plus importants que ceux des juridictions de province, avec lesquelles elles ont, en outre, des contacts fréquents. L'échelon des JIRS, dont je rappelle qu'elles sont spécialisées dans la lutte contre la criminalité organisée, nous semble le plus efficace, car il permettrait de prendre en compte les convergences entre terrorisme et criminalité organisée, dont on sait qu'elles existent, notamment en matière de financement.

Vous seriez donc, quant à vous, plutôt favorables à la fin de la centralisation en tant que telle. Vous ai-je bien compris ?
Tout à fait, sous réserve cependant que des formations ciblées soient dispensées aux magistrats concernés. Il ne s'agit pas de réunir une centaine de magistrats pour un séminaire d'une journée. Actuellement, les compétences des référents antiterroristes se résument à la consultation de l'annuaire du « C1 » et aux affaires d'apologie. La circulaire du 18 décembre évoque une compétence, théoriquement en concurrence, mais de fait exclusive. Il nous semble nécessaire de sortir de cette réalité et de privilégier l'échelon des JIRS.
Notre revendication est motivée par un souci d'efficacité. Je rappelle que certaines des personnes mises en examen sont mineures. Or ce statut implique une logique particulière et un suivi qui se fera mieux dans un cadre qui n'est pas celui de la centralisation.
Au-delà de la question de l'efficacité, la centralisation, qui a été un mouvement continu jusqu'à la création du juge d'application des peines antiterroriste en 2006, a une dimension politique. Non seulement elle n'est pas un gage d'efficacité, mais elle comporte un risque d'affaiblissement du contrôle par l'autorité judiciaire de l'activité des enquêteurs et des services de renseignement. Concrètement – cela a été étudié par des chercheurs –, elle risque de produire, au sein de la galerie saint-Éloi, des formes d'évidence commune et des méthodes de travail qui ne permettent pas à l'autorité judiciaire de jouer son rôle de contrôle, rôle qui suppose qu'elle soit extérieure aux services d'enquête et de renseignement. La remise en cause de la centralisation présenterait donc un intérêt en termes d'efficacité et sur le plan des principes. Sous ces deux aspects, les JIRS permettraient d'améliorer le fonctionnement de la lutte antiterroriste. Il ne s'agit pas de nier les qualités des magistrats chargés de ces contentieux, mais de rappeler qu'il est important pour l'institution de fonctionner dans un cadre qui lui permet d'agir efficacement dans le respect des prérogatives de chacun.

Ce que vous préconisez supposerait de nombreuses modifications. Vous dites que les magistrats du parquet ou ceux de la galerie saint-Éloi doivent exercer un contrôle. Mais ils sont également là pour enquêter eux-mêmes. Le parquetier et le juge d'instruction dirigent l'enquête, jusqu'à preuve du contraire.
Sur ce point, je vous renvoie au projet de loi « Urvoas », et plus précisément à son article 22, qui précise le rôle du magistrat du ministère public – dont la définition a fait l'objet de nombreuses missions de réflexion, notamment la mission Nadal et la mission Beaume. Outre la direction d'enquête, le magistrat du parquet, en tant que membre de l'autorité judiciaire, exerce une mission de contrôle de la proportionnalité des actes d'enquête et de la légalité.
La position exprimée par le Syndicat de la magistrature n'est pas une synthèse de deux conceptions extrêmes, mais la reprise, sous une autre forme, de ce que nous avons dit. Il est évident, pour nous, que ce n'est pas dans 178 TGI que doit être traitée la question du terrorisme ou de la criminalité organisée. Une « filiarisation » est nécessaire, mais nous estimons qu'il faut aller beaucoup plus loin. En effet, le terrorisme lui-même doit être compris comme une menace parmi d'autres, articulée avec d'autres menaces et indissociable d'elles, même si chacune d'entre elles a ses spécificités. Lorsque Daech vend du pétrole, des objets archéologiques ou alimente des réseaux de traite des êtres humains, qu'il y a des trafics d'armes, de drogue ou de contrefaçons et que tout cela alimente, à différents niveaux, le terrorisme, il est contre-productif et inefficace de dissocier la lutte contre le terrorisme de la lutte contre les autres menaces.
Or la question des moyens fait ressurgir la totalité de la problématique de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, qui n'est pas prise au sérieux, en dépit de toute l'agitation produite. Même si l'on a mis, paraît-il, 800 millions d'euros sur la table et que l'on a promis des centaines, voire des milliers de créations d'emplois, on s'aperçoit, en réalité, qu'il n'y a ni doctrine ni méthodologie, et que les services sont défaillants. Même si nous pensons, bien entendu, que le rôle de la magistrature consiste également à produire des procédures de qualité qui respectent les droits fondamentaux des personnes, nous estimons – et c'est peut-être sur ce point que nous nous séparons du Syndicat de la magistrature – que le problème ne réside pas tant dans le contrôle de ces procédures que dans le fait que la justice ait été mise hors-jeu dans la lutte contre ces nouvelles menaces. Cette mise hors-jeu, qui a débuté il y a longtemps, a été consacrée par la loi sur le renseignement et sera définitivement acquise avec la loi sur le terrorisme, qui élimine le juge d'instruction, confie au parquet des pouvoirs qu'il n'est pas en mesure d'exercer et soulève, du reste, la question de la conformité du ministère public aux critères de la Cour européenne des droits de l'homme.
Il ne s'agit donc pas uniquement d'une question de moyens. La centralisation souligne le problème de l'absence de méthodologie. Je terminerai par une comparaison des situations française et italienne. Les Italiens, qui ont été confrontés dans les années 1980 et 1990 à des phénomènes d'une extrême violence, qu'il s'agisse du terrorisme rouge ou du terrorisme noir, sont familiers de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Or, aujourd'hui, ils n'ont pas affaire au terrorisme auquel nous devons faire face. Je ne sais pas dans quelle mesure cette situation est due à la qualité de leur justice et de leur police, mais on peut penser que l'existence de directions antimafia dans les tribunaux de district et d'un parquet national antimafia – chargé de réaliser la coordination qui vous préoccupe à juste titre, monsieur le rapporteur – a contribué à créer une culture du renseignement qui permet aux magistrats d'agir de façon stratégique et proactive. Voilà ce qui manque au système français !

Je suis convaincu, comme vous, que nous devons être beaucoup plus attentifs au continuum entre criminalité et terrorisme. Pourquoi ne pas imaginer un système qui reposerait sur les JIRS, tout en maintenant un parquet antiterroriste à compétence nationale qui connaîtrait, à l'instar du parquet financier, des affaires les plus importantes ?
Nous sommes d'accord. Nous pensons en effet qu'un parquet national est nécessaire, pour traiter des attentats ou des affaires relevant du niveau national ou international et pour assurer une coordination.

Je souhaiterais connaître votre sentiment sur le quantum des peines applicables en matière de terrorisme. Cette question fait l'objet d'une réflexion du parquet antiterroriste, qui considère que la peine sanctionnant l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (AMT) délictuelle n'est pas suffisante.

Je compléterai la question du rapporteur en vous interrogeant sur un sujet qui a été abordé, hier, lors des questions au Gouvernement : la création, pour les crimes de terrorisme, d'une forme de perpétuité réelle, sans aménagement de peine, à laquelle le Premier ministre semble ouvert.
Les peines prononcées en matière d'AMT sont en effet souvent à la limite du maximum prévu dans la loi…

Et encore : pour cette infraction, je crois qu'elles sont en moyenne de six à sept ans d'emprisonnement, la peine maximale étant de dix ans.
Dans de nombreux dossiers, les peines prononcées sont de huit, neuf ou dix ans d'emprisonnement. Or, le fait est qu'il est relativement rare qu'une infraction soit sanctionnée, la première fois, de peines aussi lourdes. Cela peut indiquer, en théorie, que la peine n'est pas adaptée. Mais, en pratique, n'oublions pas que seuls les crimes sont punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à dix ans. Or, crime égale cour d'assises – cour d'assises spéciale, en l'espèce. Si le législateur, qui vote également notre budget, nous donne les moyens de juger les crimes d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, pourquoi pas ? Mais s'il s'agit uniquement de décider que cette infraction constitue désormais un crime, nous ne serons pas en mesure d'en juger les auteurs.
L'échelle des peines fait en effet l'objet d'un débat, notamment depuis qu'un juge d'instruction antiterroriste a pris position en faveur d'un relèvement à quinze ans d'emprisonnement de la peine maximale encourue en matière d'association de malfaiteurs délictuelle. Mais avant d'évoquer l'échelle des peines, il convient de rappeler que l'incrimination d'association de malfaiteurs criminelle existe et peut être retenue lorsqu'il est établi que le projet en germe est de nature criminelle.

Permettez-moi de préciser ma pensée. La réflexion porte, en fait, sur le cas des personnes qui reviennent de Syrie après y avoir participé à un certain nombre d'exactions relevant, par exemple, de la police de la charia ou de crimes de guerre. Faut-il, en ce qui les concerne, rester dans le domaine délictuel, comme c'est le cas aujourd'hui ?
Je rappelle tout d'abord, s'agissant des cas que vous évoquez, que la compétence des juridictions françaises est étendue aux crimes – voire, depuis la loi du 21 décembre 2012, aux délits – commis sur un territoire étranger. Ensuite, le Syndicat de la magistrature attache beaucoup d'importance au fait que, dans le cas de l'association de malfaiteurs, un rapport de proportionnalité doit exister entre les éléments de preuve et la sanction prononcée. Il s'agit en effet d'une infraction très particulière, car il suffit de réunir les preuves d'actes préparatoires qui, en eux-mêmes, n'ont pas nécessairement de caractère illicite et de l'associer à une intention qui doit être caractérisée, sans l'être forcément de manière précise, pour aboutir à une condamnation. Partant de ce constat, il ne nous paraît pas légitime d'augmenter l'échelle des peines sanctionnant cette infraction, car on aboutirait à une déconnexion, préoccupante au regard du droit pénal, entre ce qui est concrètement reproché à une personne et la sanction qui lui est infligée. Nous sommes donc résolument hostiles à une augmentation des peines sanctionnant l'association de malfaiteurs. Et nous ne pouvons pas accepter que l'on justifie la nécessité de relever la peine maximale par le fait que les peines prononcées s'en rapprochent.
S'agissant de la perpétuité réelle, je rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Grande-Bretagne pour avoir créé une perpétuité « réelle » – les termes sont souvent impropres – sans possibilité de réexamen. La CEDH estime en effet qu'une personne peut être incarcérée à vie – et c'est le cas de nombreux détenus condamnés à perpétuité en France –, mais que la loi doit prévoir la possibilité d'un réexamen. En l'espèce, le projet de loi « Urvoas » vise à étendre la perpétuité incompressible, c'est-à-dire assortie d'une période de sûreté de trente ans au terme de laquelle un éventuel aménagement peut être examiné. Nous y sommes hostiles.
Il convient de rappeler, à cet égard, un élément fondamental. Il est évident que la perpétuité dite « incompressible » concerne des crimes d'une extrême gravité, qui suscitent une émotion très forte et ont de lourdes conséquences sur la société. Pour autant, il nous semble que la loi ne doit pas perdre de vue les principes d'un droit pénal humaniste, qui ne peut pas s'envisager comme un droit de l'élimination sociale totale. Concrètement, il existe aujourd'hui, pour les personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité, un délai – de dix-huit à vingt-deux ans – au terme duquel elles peuvent solliciter un aménagement de peine. Elles doivent, pour cela, se soumettre à de multiples expertises, passer devant le Conseil national de l'évaluation et la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, qui émettra un avis, et faire l'objet d'un examen de dangerosité très minutieux. Et, en définitive, il est difficile de leur proposer un aménagement de peine.
Toute la philosophie pénale française est fondée sur l'idée que la peine sert, certes, dans un premier temps, à punir et à mettre la société hors de danger, mais aussi à prévoir le retour des personnes condamnées dans la société, car elle se refuse à présupposer que celles-ci, quelles que soient la nature et la gravité de leur crime, puissent être irrécupérables par principe. Il est important que l'on ne perde pas de vue, sous le coup d'une émotion légitime, ces principes, que nous jugeons fondamentaux, du droit pénal.

Votre raisonnement vaut également pour celui qui, dans l'hypothèse où il aurait été capturé vivant, a tué, avec sa kalachnikov, quatre-vingt-dix personnes au Bataclan. Pardonnez-moi la brutalité de ma question, mais pensez-vous que ce type d'individu peut, un jour, retrouver le chemin de la société ?
Je refuse absolument de présupposer le contraire. La juridiction saisie décidera de prononcer, ou non, une peine de réclusion criminelle à perpétuité, puis la juridiction de l'application des peines examinera la situation, après un parcours de plusieurs dizaines d'années. L'incarcération doit avoir, nous semble-t-il, pour objectif de tenter, par tous les moyens, de faire évoluer les personnes.
J'ajouterai que le Conseil constitutionnel a indiqué, dans une décision du 20 janvier 1994, que toute sanction pénale devait avoir pour objectif l'amendement et la resocialisation du condamné. Si la perpétuité réelle, lorsqu'elle a été introduite dans notre droit pour les meurtres d'enfants accompagnés de viol ou d'actes de torture et de barbarie, a pu passer avec succès l'épreuve du contrôle de constitutionnalité, c'est parce que la possibilité a été prévue, au-delà d'un délai de trente ans, de réexaminer la situation de la personne condamnée et, le cas échéant, d'envisager une mesure de libération. En l'état actuel de notre droit constitutionnel, il n'est donc pas possible, à mon avis, de prévoir une perpétuité réelle, c'est-à-dire une peine de privation de liberté définitive, qui ne connaîtrait aucun aménagement possible.
Le problème, pour FO Magistrats, n'est pas tant celui de la peine extrême – qui, comme la déchéance de nationalité, aurait sans doute très peu d'occasions de s'appliquer – que celui des peines de durée moyenne. Vous rappeliez, monsieur le rapporteur, que les peines prononcées pour association de malfaiteurs étaient en moyenne de six ou sept ans d'emprisonnement. Or il faut savoir que, dans notre système, l'érosion des peines est telle qu'une personne condamnée à six ans d'emprisonnement est, dès l'entrée en détention, « conditionnable » à partir d'environ deux ans, compte tenu des réductions de peines automatiques qui lui seront accordées.
Nous pensons, de manière générale, que l'échelle des peines telle qu'elle a été fixée lors de la réforme du code pénal est insuffisante, en particulier en matière de criminalité organisée et de terrorisme. De fait, en matière correctionnelle, le plafond est de dix ans, c'est-à-dire qu'en pratique une personne condamnée à cette peine maximale n'effectuera, pour les raisons que je viens d'indiquer, qu'une peine d'emprisonnement d'environ cinq ans, ce qui nous paraît extrêmement insuffisant pour des faits relevant de la criminalité organisée notamment.
Les plafonds devraient donc être rehaussés, d'autant plus que, dans ces domaines-là, la correctionnalisation est importante, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, beaucoup de dossiers terroristes sont traités en association de malfaiteurs. En effet, la plupart du temps, les terroristes ne sont plus présents pour assister à leur procès, qui n'a donc pas lieu. En revanche, ils peuvent être arrêtés, jugés et condamnés lorsqu'on a agi préventivement ; c'est pourquoi la majeure partie des affaires de terrorisme sont des affaires correctionnelles. Ensuite, la correctionnalisation peut intervenir – même si c'est sans doute moins le cas en matière de terrorisme – pour des raisons qui tiennent à la gestion des flux. En effet, la justice n'étant pas en mesure, comme l'a indiqué mon collègue de l'USM, de tout assumer, elle préférera correctionnaliser certaines affaires, y compris peut-être des affaires de terrorisme.
Mais notre préoccupation est ailleurs. Vous avez évoqué, Monsieur le président, la question de savoir ce que l'on fait des personnes qui sortent de prison après avoir purgé leur peine. La dangerosité de certaines d'entre elles n'est pas forcément moindre, quels que soient les efforts qui ont pu être été faits, car notre système pénitentiaire n'est certainement pas en mesure aujourd'hui de garantir la réinsertion des anciens détenus. Il s'agit donc d'une réelle préoccupation, et nous pensons que ce débat devrait être ouvert sans exclusive, ni crainte, ni honte. Les nombreuses discussions suscitées par les infractions de violences sexuelles commises par des personnes ayant des caractères psychiatriques prononcés ont abouti à des mesures telles que la rétention de sûreté. Nous nous demandons s'il n'est pas nécessaire que des mesures graduées puissent être envisagées une fois que la personne a purgé sa peine. Lorsque des détenus comme auraient pu l'être les frères Kouachi, par exemple, sortent de prison après avoir été placés en détention pendant X années, ils sont toujours les frères Kouachi : que fait-on ?
Bien entendu, se pose le problème de la prédictibilité, nous en avons bien conscience ; c'est pourquoi nous n'apportons pas de réponse. Mais nous pensons qu'il ne faut pas refuser ce débat.

Je souhaiterais prolonger la question de notre rapporteur sur les djihadistes de retour de Syrie, qui font peser une menace terrible sur la sécurité de nos concitoyens. L'opinion ne manquerait pas d'être interpellée si, par malheur, une personne qui avait été poursuivie, voire condamnée, repassait à l'acte. La difficulté à laquelle nous sommes confrontés tient à la nécessité de réunir des éléments de preuve suffisants, d'autant qu'une des personnes que nous avons auditionnées nous a indiqué que certains renseignements, couverts par le secret-défense, ne pourraient pas forcément, aussi graves soient-ils, constituer des éléments de preuve. Nous nous retrouvons donc dans une situation où des djihadistes ou des personnes participant à une entreprise djihadiste sont condamnés « par défaut » pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, cette qualification étant un peu, si l'on reprend les circulaires de Mme Taubira, l'alpha et l'oméga de la politique pénale sur ce sujet.
Je me demande donc pourquoi on n'utilise pas d'autres incriminations qui figurent dans le code pénal. Je pense notamment à l'intelligence avec une puissance étrangère, prévue à l'article 411-4, qui est punie de trente ans de réclusion. Bien entendu, cet article n'a pas été appliqué depuis 1944, ce qui peut soulever des questions, mais cette incrimination figure dans notre droit positif, et l'objet de notre commission d'enquête est de savoir si l'on applique bien la loi dans notre pays. On trouve également, dans les livres II et IV bis, la complicité de génocide ou la complicité de crime de guerre. Je suis bien conscient que, là encore, la preuve de tels actes est difficile à établir, mais la complicité est une notion que les juges ont l'habitude de manier. En tout état de cause, ces incriminations pourraient au moins justifier, dans un certain nombre de cas, un placement en détention préventive qui laisserait davantage de temps que les poursuites pour association de malfaiteurs pour examiner la situation de certaines personnes.

Certains proposent même l'application du livre IV, qui a trait aux infractions militaires.
Votre question est paradoxale à divers titres. Tout d'abord, il me semble que, pour ses dirigeants, le fait que l'on qualifie Daech de puissance étrangère serait sans doute une forme de victoire – nous nous souvenons des débats qu'a suscités l'utilisation de l'expression « État islamique ».
Ensuite, la situation que vous évoquez est au coeur des difficultés rencontrées tant par les services de renseignement que par l'autorité judiciaire. Je veux parler de ces centaines de personnes qui se sont rendues sur des théâtres d'opérations terroristes, qui en sont revenues ou vont en revenir et dont on ne sait pas grand-chose de plus, ce qui est en soi particulièrement inquiétant. Or, bien que le Parlement ait très récemment légiféré sur ce sujet dans le cadre de la loi sur la criminalité organisée, ce comportement ne correspond actuellement à aucune incrimination, quelle qu'elle soit. Ainsi, les services de renseignement se plaignent de ne pouvoir judiciariser ce type de comportements parce qu'il leur manque souvent un des éléments constitutifs des infractions pénales existantes. Pour que l'infraction d'entreprise individuelle terroriste soit retenue, par exemple, il faudrait prouver, en outre, que la personne a acquis ou tenté d'acquérir des armes ou des substances explosives. Or le législateur a estimé que la réponse – il en a décidé ainsi dans l'article 20 du projet de loi sur la criminalité organisée – ne doit pas être pénale, mais administrative !
Le Sénat avait pourtant suggéré, dans le cadre d'une proposition de loi qu'il a adoptée en décembre dernier, que cette réponse soit pénale, donc judiciaire, en créant un délit nouveau qui correspond point par point à la définition du comportement qui relèverait, aux termes du projet de loi, d'un arrêté administratif, à savoir le fait de s'être rendu ou d'avoir tenté de se rendre, sans motifs légitimes – cette précision permet d'éviter que le personnel humanitaire ou les journalistes n'entrent dans le champ de cette nouvelle incrimination – sur un théâtre d'opérations terroristes. La création d'un tel délit constituerait une réponse autrement plus efficace à ce type de comportements qu'une assignation à résidence d'un mois, éventuellement renouvelable une fois, ne serait-ce que parce qu'elle permettrait de décider un contrôle judiciaire ou de prendre une mesure de détention provisoire. J'indique au passage que le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé est en cours d'examen au Sénat. S'il fait l'objet d'une commission mixte paritaire, peut-être le législateur devrait-il envisager de ne pas se soumettre à une vision qui est celle des services de renseignement.
Je souhaiterais revenir sur le fantasme de la correctionnalisation : je ne crois pas que beaucoup de magistrats envisagent de correctionnaliser des infractions terroristes. La correctionnalisation est, certes, parfois utilisée pour des raisons qui tiennent à la gestion des flux devant la cour d'assises, mais, entre la correctionnalisation d'un vol à main armée avec une arme factice et celle d'une affaire de terrorisme, la marge est tout de même importante.
En ce qui concerne la rétention de sûreté, le Syndicat de la magistrature est très clairement opposé à l'extension de cette mesure, dont on se doutait bien qu'elle risquait de revenir par la fenêtre dans le cadre de la lutte antiterroriste. Il semblerait, du reste, que Jean-Jacques Urvoas partage cet avis puisqu'il a indiqué qu'elle ne devait pas être envisagée pour ce type d'infractions.
Enfin, il convient de rappeler qu'existe l'imputation d'association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, qui permet de punir les actes préparatoires – dont on disait pourtant, il n'y a pas si longtemps, qu'ils n'étaient pas plus punissables que la seule intention délictuelle. L'association de malfaiteurs délictuelle s'applique donc à des comportements qui, objectivement, n'ont pas à recevoir de qualification criminelle et pour lesquels la peine actuellement encourue est suffisante.
Il est évident, pour le Syndicat de la magistrature, que les personnes qui reviennent de théâtres d'opérations doivent faire l'objet d'une attention toute particulière des services de renseignement et des services d'enquête dans le cadre d'enquêtes judiciaires. Toutefois, les deux réponses proposées – d'une part, l'assignation administrative à résidence prévue à l'article 20 du projet de loi renforçant la lutte contre la criminalité organisée et, d'autre part, la création d'une infraction pénale spécifique pour ainsi dire purement matérielle qui serait constituée dès lors que l'on s'est rendu ou que l'on a tenté de se rendre sur un théâtre d'opérations terroristes –, ces deux solutions ne sont pas satisfaisantes. Lorsqu'une personne est de retour en France et que les éléments permettant de caractériser l'association de malfaiteurs ou l'entreprise individuelle – infraction qui est fort peu utilisée, si bien que l'on peut se demander si elle était vraiment nécessaire –, il est possible de la mettre en examen et de la placer en détention provisoire. Ainsi, soixante-treize des personnes revenues de ces théâtres d'opérations sont placées en détention provisoire et d'autres ont été placées sous contrôle judiciaire.
Dans un système démocratique, il n'est pas acceptable que l'on envisage de créer une mesure administrative afin de combler le vide créé par l'absence des indices graves et concordants que requiert la loi pour mettre une personne en examen puis, le cas échéant, prendre une mesure de sûreté. Dans un tel cas, l'enquête – accompagnée, éventuellement, de mesures de surveillance – doit se poursuivre afin de réunir les preuves suffisantes. Il a été dit que l'on était souvent confronté à une difficulté probatoire. Je rappelle à cet égard que les membres des services de renseignement sont soumis, au même titre que tout autre fonctionnaire, à l'article 40 du code de procédure pénale, qui leur impose de signaler au procureur de la République toute infraction qui serait portée à leur connaissance.
Quant à la création d'une infraction pénale autonome, elle nous paraît extrêmement problématique, car, cette fois-ci, on déconnecterait l'infraction de tout contenu concret. De fait, l'action pourra être caractérisée – « Il y est allé » –, mais on ne cherchera pas à savoir ce qui s'est passé ni, par conséquent, quel est le préjudice pour la société. Je ne dis pas que les personnes qui reviennent de ces théâtres d'opérations n'ont pas commis ou ne préparent pas des infractions ; je dis simplement que, dans un système pénal démocratique, il est nécessaire, lorsqu'on définit une infraction pénale, qu'elle soit constituée par des éléments matériels qui portent préjudice à un intérêt protégé par la loi et par un élément intentionnel. Or tel ne serait pas le cas de cette infraction.
Le droit pénal et la pratique antiterroriste utilisent très largement les infractions existantes. Il ne serait pas de bonne législation de les étendre sur le versant administratif ou sur le versant pénal.
Juste un mot sur la question de la correctionnalisation des affaires de terrorisme. Il ne s'agit évidemment pas de correctionnaliser les attentats du 13 novembre, par exemple. Mais, entre une association de malfaiteurs correctionnelle et une association de malfaiteurs criminelle, on choisira la première, car on ne peut pas saisir la cour d'assises sur de tels motifs.
Les incriminations évoquées par M. Marleix pourraient en effet être utilisées, mais il faudrait étendre leur qualification, car les textes ne sont pas adaptés. On retomberait néanmoins sur le problème du basculement du correctionnel vers le criminel, qui n'est pas la démarche privilégiée. En effet, on ne conçoit pas que l'action du juge puisse être un moyen de lutter contre le terrorisme : tout est axé sur le renseignement et l'aspect judiciaire est sacrifié. Nous estimons – et nous nous différencions sur ce point du Syndicat de la magistrature – que le fait de se rendre sur un théâtre d'opérations sans motifs légitimes doit devenir une infraction objective, car, dès lors que cette qualification existera, ce sera à la personne qui revient de ce théâtre d'opérations de se justifier en donnant les raisons pour lesquelles elle s'y est rendue, et, si elle n'en a aucune, tant pis : au moins, la société pourra se protéger.

Je précise que le quantum des peines fait encore débat au sein de l'Assemblée. Nous sommes en effet un certain nombre à penser que ce n'est pas en se livrant à une surenchère dans ce domaine que nous nous protégerons mieux des actes terroristes. Nous non plus, nous ne sommes pas d'accord sur tout. Par ailleurs, on a évoqué le rôle de l'incarcération et la question de la sortie de prison, qui m'intéresse tout particulièrement. Il est évidemment impossible, dans le contexte actuel, de débattre de ce que deviendra Salah Abdeslam après sa détention : l'émotion est trop forte. En revanche, on peut s'interroger sur l'accompagnement, au moment de sa sortie de prison, d'un jeune qui revient d'un théâtre d'opérations et dont il est prouvé qu'il a participé à un certain nombre de faits. Je souhaiterais donc avoir votre avis sur les mesures qui permettraient de favoriser la réinsertion d'anciens détenus potentiellement dangereux tout en garantissant la protection de la société.

C'est vrai, mais on peut me répondre par écrit.
Par ailleurs, je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'est pas forcément nécessaire de créer de nouvelles infractions. Or une mesure administrative permet de neutraliser une personne le temps que dure l'enquête. Certes, le délai n'est peut-être pas suffisamment long pour que cette enquête puisse être menée à son terme. Mais c'est une des raisons pour lesquelles un certain nombre d'entre nous ont défendu cette mesure.
Je vais essayer de vous répondre brièvement. L'article 66 de la Constitution fait de l'autorité judiciaire la gardienne des libertés individuelles. Or, du fait de l'accroissement du rôle de l'administration en matière de rétention et de contrôle administratif des personnes revenant de théâtres d'opérations, le juge judiciaire est de plus en plus écarté, voire disparaît du traitement de ces questions et d'une partie importante de la lutte contre le terrorisme. C'est un véritable problème. Les parlementaires manifestent-ils une défiance vis-à-vis des juges et, si tel est le cas, quelle est la cause de cette défiance ?

Le juge ne peut pas aller enquêter en Syrie actuellement et il ne peut donc pas réunir de preuves !
Le fameux article 20 du projet de loi renforçant la lutte contre la criminalité vise à sanctionner un comportement, le fait de s'être rendu sur un théâtre d'opérations terroristes, par une décision administrative. Le caractère probant ou non des éléments n'est finalement pas si important, semble-t-on penser, puisque l'intéressé pourrait éventuellement saisir le juge administratif a posteriori. Mais comme, de surcroît, vous avez écarté le principe d'un référé, le droit commun s'appliquerait, de sorte que le juge pourrait statuer dans un délai de quatre mois, alors que la durée de la mesure est de un mois... On comprend bien que, dans une telle procédure, la liberté serait garantie d'une manière qui n'est peut-être pas tout à fait conforme à l'esprit du constituant de 1958…
Cette question est lancinante, puisqu'elle s'était déjà posée à propos de l'interdiction administrative du territoire. Il ne s'agit pas d'une querelle de chapelles entre le juge judiciaire et le juge administratif, comme ont voulu le faire croire ceux qui ont caricaturé notre critique de l'état d'urgence. Dans une démocratie, la privation de liberté doit reposer sur un fondement clair, c'est-à-dire une infraction clairement définie à la loi pénale, et non une dangerosité potentielle. Elle doit être précédée d'un débat contradictoire et la décision doit être prise a priori par une autorité juridictionnelle indépendante. Elle ne saurait faire uniquement l'objet d'un contrôle juridictionnel a posteriori, celui du juge administratif, qui est, au demeurant, comme on l'a vu pendant l'état d'urgence, limité par les termes mêmes de la loi. On ne peut pas, dans une démocratie, prendre une mesure privative de liberté si la base juridique sur laquelle elle repose est vague, comme c'est le cas dans ces dispositifs.

Je précise que la dernière réforme que nous avons adoptée confie au juge de la liberté et de la détention (JLD) un rôle important, puisque le parquet travaille de plus en plus avec lui.
Le problème que pose cette évolution de la procédure pénale – qui est ancienne, puisqu'elle a débuté avec les lois Perben –, c'est qu'elle marginalise et retarde l'intervention du juge judiciaire, alors même que le statut du parquet ne sera modifié, s'il l'est, qu'à la marge – puisque cette modification, nous annonce-t-on, serait limitée à l'avis conforme du CSM – et que celui du JLD est encore fragile puisqu'il n'est toujours pas nommé par décret et peut donc être muté par décision du président. En outre, le JLD intervient de manière sporadique dans un dossier ; il n'en a pas la connaissance qu'en a un juge d'instruction. Concrètement, il est sollicité dans l'urgence par un magistrat du parquet dans un dossier sur lequel il n'est pas en mesure d'exercer un contrôle suffisant pour que ce décalage de la procédure soit acceptable. Nous ne sommes donc pas favorables à ces mesures.
En ce qui concerne les peines, il y aurait beaucoup à dire sur un système dans lequel des personnes seraient par principe, à raison de l'incrimination terroriste, exclues de la logique qui préside à l'exécution et à l'application des peines en matière de réinsertion. Peut-être les sciences sociales, qui se focalisent actuellement sur la question de la détection a priori, se trompent-elles d'objet. On nous dit en effet qu'il n'est pas possible de détecter le passage à l'acte violent. En revanche, on peut mener une réflexion approfondie sur la manière dont on peut tenter de faire sortir les gens d'un tel parcours. D'autant que l'on sait que les profils des personnes revenues d'Irak ou de Syrie et les conditions dans lesquelles elles reviennent sont très différents.

Notre commission d'enquête doit bientôt se rendre à La Haye pour visiter Eurojust. Je souhaiterais donc avoir votre sentiment sur le niveau de la coopération judiciaire dans le domaine de la lutte antiterroriste.
Il est difficile de vous répondre de manière synthétique. Les instruments existent ; la difficulté est liée à la marginalisation de l'autorité judiciaire qui vient d'être rappelée. Certes, le terrorisme n'est pas le même aujourd'hui qu'il y a dix ans, mais, à cette époque, la justice antiterroriste était représentée par le juge d'instruction antiterroriste. La coopération internationale fonctionnait bien parce que ces juges étaient clairement repérés, qu'ils occupaient leurs fonctions pendant une durée significative et qu'ils avaient des contacts réguliers avec leurs homologues étrangers. Aujourd'hui, les juges d'instruction sont marginalisés par les textes et par la pratique ; ils ne sont plus les interlocuteurs classiques des référents antiterroristes européens. Mais le parquet n'est pas pour autant en mesure de répondre à toutes les attentes légitimes en la matière.
Je souhaiterais, à ce propos, évoquer certains points qui n'ont été qu'effleurés alors qu'ils sont, selon nous, au coeur des difficultés liées à la lutte antiterroriste. Comment fait-on pour gérer une masse considérable d'informations – les moyens techniques que vous avez donnés aux services de renseignements produisent une telle quantité d'informations qu'ils reconnaissent eux-mêmes être dépassés – et, dans le même temps, remonter des filières ? Ces deux problématiques ne se traitent pas de la même manière. Où placer le curseur pour distinguer ce qui relève de l'administratif, c'est-à-dire du renseignement, et ce qui relève des enquêtes judiciaires ? Dans les lois qui ont été adoptées depuis juillet dernier, le législateur a confié de fait aux services de renseignement le soin de répondre à cette question. Les textes ne prévoient en effet ni contrôle ni coopération : ce sont les services de renseignement qui décident du moment où ils vont judiciariser, de ce qu'ils vont faire connaître et de ce qu'ils gardent pour eux. C'est un problème particulièrement important au regard de l'efficacité de la réponse antiterroriste en général.
J'ai bien conscience de m'être écarté de votre question, monsieur le président, mais quelle est notre légitimité vis-à-vis de nos interlocuteurs européens lorsque nous nous présentons en ordre dispersé, comme c'est le cas actuellement ? Il faudrait peut-être que le législateur redonne une certaine cohérence au dispositif en confiant aux services de renseignement le soin de traiter la masse des informations qu'ils collectent, en prévoyant que l'autorité judiciaire doit intervenir dès qu'est repéré le début de quelque chose qui relève d'une infraction, et en décidant que les dossiers au long cours seront traités par des juges antiterroristes. Il faut revenir aux fondamentaux !

Je retiens de tout ce que vous avez dit au moins un point d'accord entre les trois syndicats que vous représentez : les moyens dont bénéficie la section C1 sont dérisoires, ridicules, avez-vous dit – dix juges d'instruction et douze parquetiers pour l'ensemble du pays –, alors que les affaires sont d'une extrême complexité et sans doute loin de se terminer.
Et alors même que la compétence de ces magistrats est reconnue !
Il me semble que nous nous accordons également sur un autre point, celui de la compétence du juge judiciaire.
Pour nous, la question des moyens révèle – et c'est le point essentiel – une absence de doctrine, de méthode et de cohérence de l'action. Nous souffrons, dans notre pays, de carences considérables dans la compréhension de ce phénomène, voire dans la volonté de le comprendre, et c'est grave.
La séance est levée à 21 heures 55.