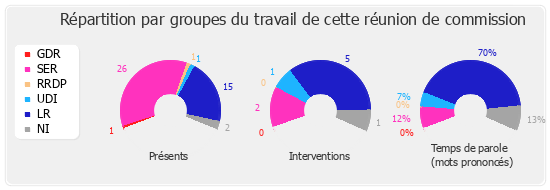Commission des affaires étrangères
Réunion du 5 octobre 2016 à 9h30
La réunion
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Nous recevons ce matin, pour une audition ouverte à la presse, Mme Dorothée Schmid, qui dirige le programme « Turquie contemporaine » à l'Institut français des relations internationales (IFRI), et M. Hamit Bozarslan, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Je vous remercie, madame, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Nous allons traiter trois thèmes principaux : la situation intérieure en Turquie, sa politique régionale et la question kurde.
S'agissant de la situation intérieure, nous avons suivi attentivement ce qui s'est passé au moment de la tentative de coup d'État, le 15 juillet dernier. Celle-ci a fait l'objet d'interprétations différentes quant à son origine et à son déroulement. Le gouvernement turc met en cause le mouvement de Fethullah Gülen, qui a longtemps été un allié très proche du Parti de la justice et du développement (AKP), mais qui est aujourd'hui accusé d'être une organisation terroriste. Que pouvez-vous nous dire sur la nature de ce mouvement, qui est très actif et dispose de nombreuses représentations à l'étranger ? Qu'en est-il de l'ampleur de la répression ? Des dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées, limogées, condamnées ; même si certaines ont été remises en liberté, cela reste très impressionnant. Nous venons d'apprendre que le gouvernement turc a décidé de prolonger de trois mois l'état d'urgence instauré après le putsch avorté. Une certaine unité nationale s'est manifestée, incluant l'opposition mais non le parti pro-kurde. Où en sont aujourd'hui les principaux partis ?
Les autorités turques ont reproché aux capitales européennes de ne pas avoir suffisamment réagi au moment de la tentative de coup d'État – j'en ai eu des témoignages directs. D'autres estiment, au contraire, que nous avons été un peu trop indulgents à l'égard d'Ankara et qu'il faudrait être plus ferme. Quel est votre point de vue à ce sujet ? Quels messages convient-il d'adresser aux autorités turques ? En tout cas, nous constatons que le fossé s'est creusé entre l'Union européenne et la Turquie. La question de la libéralisation des visas, qui fait partie de l'accord négocié par Mme Merkel et endossé par les Européens, constitue évidemment un point très délicat, pour ne pas dire plus. Comment voyez-vous les choses en la matière ?
D'autre part, nous avons bien noté le rapprochement entre Ankara et Moscou, après la crise très grave déclenchée par la destruction d'un avion russe par la chasse turque au-dessus de la frontière turco-syrienne. Comment analysez-vous ce rapprochement ? Jusqu'où pourrait-il aller ? Quelles pourraient en être les conséquences sur le dossier syrien ?
La question kurde se pose dans des termes très différents en Turquie et dans les pays voisins.
En Turquie, comment analysez-vous l'enchaînement qui a conduit à la reprise des hostilités ? Quelles pourraient être les perspectives ? Selon vous, les négociations pourraient-elles reprendre à terme, notamment dans l'hypothèse d'un affaiblissement durable du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et d'une consolidation de la situation interne en Turquie ?
En Syrie, la situation du Parti de l'union démocratique (PYD) est beaucoup moins favorable depuis le déclenchement de l'intervention militaire directe de la Turquie, à la fin du mois d'août. Cette opération, intitulée « Bouclier de l'Euphrate », visait à sécuriser la frontière turco-syrienne et à lutter contre Daech, mais surtout, du point de vue turc, à empêcher la jonction des trois enclaves kurdes et la formation d'un territoire kurde continu le long de la frontière turque. Nous sommes très intéressés par tout ce que vous pourrez nous dire sur ce point. Nous voyons bien que les Américains essaient de maintenir un équilibre délicat entre leur coopération avec le PYD dans la lutte contre Daech et leur soutien à l'opération militaire turque. Comment voyez-vous la suite ?
Enfin, nous pourrons aussi évoquer la question du gouvernement régional du Kurdistan irakien, avec lequel Ankara n'entretient pas du tout les mêmes relations, et dont les rapports avec Bagdad sont difficiles. La situation politique interne reste complexe au Kurdistan irakien.
Merci, madame la présidente, de votre invitation. Vous avez posé une liste de questions très impressionnante : un analyste a rarement eu autant de sujets ingérables à traiter en une seule fois ! Je tenterai de brosser un rapide panorama de ce que change la tentative ratée de coup d'État.
En préambule, je souhaite rappeler que les analystes qui travaillent sur la Turquie ont de plus en plus de difficultés à accéder à l'information. Dès qu'une crise se produit, le gouvernement turc impose un black-out aux principaux médias. Actuellement, on assiste à une véritable chasse aux sorcières qui touche non seulement les médias pro-Gülen, mais aussi les médias libéraux. Quant aux réseaux sociaux, ils sont étroitement administrés par le gouvernement. En outre, il est plus difficile aujourd'hui de faire s'exprimer des personnes dissidentes : elles s'inquiètent de la façon dont leurs propos pourraient être enregistrés ou restitués à contretemps, et des conséquences que cela pourrait avoir pour leur sécurité personnelle.
Nous sommes confrontés à un deuxième problème : le contrôle de notre propre expression. Tout ce que nous disons est scruté par les autorités turques, ce qui est parfois un peu compliqué à gérer au quotidien.
Par ailleurs, les interférences très nombreuses entre les différents dossiers que vous avez évoqués rendent l'analyse malaisée, d'autant qu'il est difficile de rester neutre lorsque des sujets aussi politiques et électoralement sensibles que l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne ou la question des réfugiés sont abordés.
À la fin de l'année 2005, nous sommes entrés dans une phase de négociation sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, le présupposé étant qu'elle satisfait aux critères politiques de Copenhague. Aujourd'hui, il me semble nécessaire d'aborder la question de la définition de la démocratie dans notre discussion avec la Turquie. De mon point de vue, il s'agit actuellement de la principale problématique, si l'on se place à un niveau très macroscopique.
Je traiterai successivement trois points : la situation interne en Turquie après la tentative de coup d'État, ses conséquences sur le positionnement de la Turquie dans la région, ses conséquences sur les relations de la France et de l'Union européenne avec la Turquie.
Les circonstances de la tentative de coup d'État restent assez floues. Celle-ci a été une surprise. Lorsque l'on travaille sur les questions politiques en Turquie, on est habitué à entendre régulièrement des gens prévoir des coups d'État militaires. Cependant, en l'occurrence, il semblait que l'AKP avait réussi à renvoyer l'armée dans ses casernes. On pouvait donc s'attendre à toutes sortes de difficultés du point de vue sécuritaire en Turquie, mais guère à une tentative de coup d'État. Apparemment, celui-ci n'a pas été très bien mené. Face au flou qui entoure ses circonstances, le gouvernement turc véhicule un scénario d'explication très cohérent, qui aide à en faire passer le traumatisme : le « scénario Gülen » présente le mérite d'être rassurant pour la majorité des Turcs. C'est une des bases de la manifestation d'unité nationale que l'on observe effectivement en Turquie : le gouvernement a gagné en crédit politique parce qu'il a résisté à cette tentative de coup d'État militaire.
On peut voir la réaction du régime de la façon la plus positive comme de la façon la plus négative.
Le discours unanimiste du régime sur le triomphe de la démocratie fonctionne sur le papier. Je me suis moi-même étonnée pendant des années que l'on considère les interférences de l'armée dans la vie politique turque comme le garant de la progression démocratique du pays. Désormais, un coup d'État militaire n'est plus acceptable pour la majorité de la population, ce qui est rassurant.
D'un autre côté, la reprise en main va un peu au-delà des cercles gülenistes étroits que le gouvernement a désignés au départ comme l'ennemi. La répression semble s'étendre à d'autres milieux, notamment aux milieux pro-kurdes et aux libéraux qui ne soutiennent pas l'AKP. Telles sont aujourd'hui les trois communautés politiques en présence en Turquie : l'union nationale autour du régime, un milieu kurde partiellement en dissidence, des libéraux coincés entre le marteau et l'enclume.
Si l'on tente une synthèse entre ces deux visions, on peut dire que, après ce coup d'État raté qui aurait pu après tout réussir, et qui s'est retourné en très peu de temps, la reprise en mains était absolument inévitable – pour ma part, je m'attendais à ce qu'elle soit plus violente encore. Finalement, le « scénario Gülen » a le mérite de proposer une sorte de façade légale à cette reprise en mains. On pourrait du reste prendre le gouvernement turc au mot, car des personnes plutôt favorables à l'AKP se retrouvent aujourd'hui prises dans le maelström de la répression ; on sent que des erreurs sont commises, y compris à l'égard de la communauté qui soutient le régime. L'AKP a d'ailleurs promis des ajustements.
Au bout du compte, la stabilité du pays apparaît dégradée, les très nombreux limogeages ayant ébranlé les principales institutions de l'État, d'abord l'armée et la justice, puis l'éducation et la police – dans laquelle de nouvelles purges ont eu lieu hier. Le président de la République est, à mon sens, plutôt affaibli, puisqu'on lui découvre régulièrement de nouveaux ennemis. Une dynamique d'instabilité traverse le paysage politique et social, car l'intensité de la répression risque de susciter une nouvelle forme d'opposition, sachant que les anciennes menaces sécuritaires, le PKK et Daech, sont toujours présentes. Il y a deux jours, le premier ministre turc a pris la peine de démentir les rumeurs d'un nouveau coup d'État. Enfin, l'économie est fragilisée par la montée des risques politiques : il y a une dizaine de jours, Moody's a été la deuxième agence à abaisser la note de la Turquie au-dessous du niveau investment grade – risque de défaut faible –, ce qui n'est pas bon pour l'économie turque, surtout si le prix des hydrocarbures remontent.
En conclusion, l'onde de choc ne s'est pas encore entièrement propagée, et le moment de faire le bilan n'est pas encore venu.
J'en viens à la posture régionale de la Turquie.
Avant même la tentative de coup d'État, nous étions dans une période de remise en question de la politique étrangère turque : le premier ministre Ahmet Davutoğlu, artisan de la grande politique étrangère turque, avait été limogé au mois de mai. La Turquie réorganisait ses alliances et ses partenariats : elle était en train de se réconcilier avec Israël et avait déjà scellé sa réconciliation avec la Russie, après la brouille très spectaculaire de l'automne dernier.
La ligne diplomatique d'Ankara semble aujourd'hui beaucoup moins claire que par le passé. La Turquie traverse une crise d'image et de crédibilité assez large : la presse arabe du Moyen-Orient a commenté abondamment et avec beaucoup d'inquiétude la tentative de coup d'État ; même si elle loue le rapprochement avec Moscou, la « bonne » presse russe reste encore très critique à l'égard du régime turc. On sent que tout le monde retient son souffle. Les alliés de la Turquie, à savoir les États-Unis et les pays européens, n'ont fait preuve d'une empathie ni très forte ni très spontanée, ce que les Turcs nous reprochent aujourd'hui. Des tensions se dessinent avec ces alliés, notamment avec les États-Unis, le point de contentieux central étant la présence de Fethullah Gülen aux États-Unis et la question de son extradition.
C'est sur ce fond d'interrogations quant à la possibilité d'une nouvelle politique étrangère qui remplacerait celle d'Ahmet Davutoğlu qu'est survenue, un peu plus d'un mois après la tentative de coup d'État, l'intervention turque en Syrie. Il s'agit, à mon sens, d'une deuxième surprise, qui traduit la volonté des Turcs de se remettre au centre du jeu régional, de montrer que l'État turc ne va pas si mal et que la Turquie n'est pas simplement un soft power dans la région, mais qu'elle peut aussi recourir à la puissance militaire. Toutefois, on ne sait pas très bien quels sont les objectifs de cette intervention, on n'est pas sûr qu'elle ait été vraiment négociée avec les principaux protagonistes de la crise syrienne et on ignore quelles seront ses suites. Les Turcs annoncent que leur présence pourrait être durable et donnent des signes indiquant leur volonté de se rendre utiles sur différents fronts, en Irak et éventuellement à Alep. Or on ne voit pas très bien quel pourrait être leur rôle au sein de l'imbroglio syrien, le jeu étant actuellement dominé par l'antagonisme négocié entre les États-Unis et la Russie. Le parlement irakien a voté cette nuit une résolution condamnant l'intervention turque en Syrie et excluant catégoriquement toute participation turque à la reprise de Mossoul.
En conclusion, la Turquie tente d'apparaître comme une puissance, mais dans un contexte où elle ne peut pas dicter l'avenir. En voulant faire une démonstration de force, elle se place plutôt, à mon sens, en position de fragilité.
Quelles sont les conséquences pour l'Union européenne et la France ? Il y a, selon moi, deux points importants.
Premièrement, dans le contexte politique interne européen, on assiste à une montée des tensions au sein des communautés turques présentes dans les différents pays de l'Union européenne – rappelons que les personnes originaires de Turquie forment la première communauté de migrants en Europe. Aux tensions existantes entre Turcs et Kurdes s'ajoutent désormais des tensions entre les légitimistes pro-AKP et les pro-Gülen. Des incidents violents se sont produits en Belgique, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et en Autriche. À ce titre, la question des extraditions se posera avec acuité. J'attends d'ailleurs impatiemment les prochains développements concernant l'éventuelle extradition des militaires turcs qui se sont réfugiés en Grèce au moment du coup d'État.
Deuxièmement, la relance du dossier de l'adhésion intervient, à mon sens, à contretemps. Selon l'argumentaire turc, la solidarité oblige les Européens à relancer ce dossier, car c'est précisément ce qui va conforter la Turquie. Mais, d'une part, la question des valeurs politiques est posée, ainsi que je l'ai indiqué en introduction, et, d'autre part, on peut s'interroger sur la capacité du gouvernement turc à mener à bien les réformes techniques nécessaires pour se conformer aux trente-cinq chapitres de l'acquis communautaire. Quant au dossier des réfugiés, il constitue, en quelque sorte, une « annexe » de la relation turco-européenne. Il faut mesurer aujourd'hui s'il doit être relié strictement à la question plus large de la négociation d'adhésion ou bien géré de façon bilatérale à plus court terme.
En conclusion, j'ai le sentiment que l'Union européenne est aujourd'hui marginalisée sur la plupart des dossiers stratégiques qui concernent la Turquie, car elle ne parle pas d'une seule voix. C'est l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) qui compte. Mais l'OTAN elle-même n'a pas vraiment été mise dans la boucle, notamment sur la question de l'intervention en Syrie. La tentative de coup d'État a finalement accentué certaines dynamiques négatives qui étaient déjà à l'oeuvre en Turquie. Même si actuellement, du côté turc, les événements s'emballent et la dictature de l'urgence prévaut, du côté européen, il est indispensable de garder notre sang-froid et d'avoir à l'esprit les vertus de la lenteur. À mon sens, notre capacité de levier sur ce qu'il se passe aujourd'hui à l'intérieur de la Turquie est extrêmement faible. En revanche, tous les dossiers de politique étrangère doivent être examinés, avec un préalable : ne pas précipiter les décisions.
J'insisterai sur le coup d'État qui vient d'échouer, sur le coup d'État qui est en cours et sur les autres tentatives de coup d'État qui pourraient se produire. Dans un deuxième temps, j'aborderai la question kurde et le dossier syrien. Enfin, je conclurai avec une note assez pessimiste sur l'Europe – d'ailleurs, je ne sais même pas s'il faut encore en parler.
Je reviens sur le coup d'État qui a échoué. Le gouvernement a accusé l'organisation de Fethullah Gülen d'être derrière ce coup d'État. Il ne fait pas de doute que cette organisation dispose d'un service de renseignement et qu'elle mène une politique d'infiltration au sein de l'État : elle a notamment infiltré les ministères régaliens tels que la justice, l'intérieur – très massivement –, l'éducation nationale et, depuis peu, les affaires étrangères. Il n'en reste pas moins que, près de trois mois après le coup d'État, le déroulement des événements reste encore obscur.
Un premier point n'est toujours pas éclairci : pourquoi le gouvernement, qui avait pourtant été informé de la tentative de coup d'État, n'a-t-il rien fait, au moins de 16 à 22 heures ? Je ne pense pas du tout qu'il se soit agi d'une manipulation d'Erdoğan. Au contraire, la tentative de coup d'État a été tout à fait réelle, et d'une très grande brutalité. En réalité, il y a eu une sorte de paralysie, qui s'explique très largement par le fait que tous les mécanismes de contrôle et d'équilibre au sein de l'État turc ont été détruits. C'est un problème extrêmement sérieux, sur lequel je reviendrai. On a l'impression que, même lorsque l'information est disponible, l'État est très largement paralysé par ses propres dysfonctionnements, l'absence de rationalité en son sein et l'absence de chaîne de transmission de l'information. La destruction de l'avion russe avait résulté, elle aussi, de ce manque de rationalité et de l'absence de mécanismes de contrôle et d'équilibre.
Deuxième point, très important selon moi : sans doute y a-t-il, derrière ce coup d'État, des officiers proches de la mouvance de Fethullah Gülen, mais, plus largement, il faudrait s'intéresser de plus près à la fragmentation très sanglante qui existe au sein de l'État turc lui-même. Cette fragmentation du monde sécuritaire turc n'est pas récente : c'est une constante de l'histoire de la Turquie de 1957 à nos jours. Dans les années 1990, une guerre civile meurtrière a eu lieu au sommet de l'État ; elle s'est soldée par l'enlèvement et l'exécution d'agents de sécurité de l'État par d'autres organes de sécurité. Aujourd'hui, on a l'impression que ce cycle de fragmentation s'accélère. Donc, réduire tout ceci à l'organisation de Fethullah Gülen me paraît relever de l'aveuglement. Je le souligne d'autant plus que j'ai toujours été opposé à cette organisation, y compris lorsque l'AKP en était très proche.
J'ai parlé d'un coup d'État en cours : c'est le coup d'État Erdoğan. La répression est effectivement très impressionnante, madame la présidente : environ 130 000 personnes ont été limogées au sein de la fonction publique d'État ; quelque 30 000 contrats privés ont été rompus ; plusieurs milliers d'associations, de fondations, de journaux, de chaînes de télévision et d'universités ont été soit interdites, soit dissoutes ; des fonds à hauteur de 40 milliards de livres turques, soit 12 à 13 milliards d'euros, ont été confisqués aux entreprises supposées proches de Fethullah Gülen ; il y a sans doute aujourd'hui plus de 30 000 personnes en prison ; parmi les personnes arrêtées, quatorze se sont suicidées. On est donc dans la démesure. C'est un putsch civil.
Une question se pose : comment le pouvoir d'Erdoğan se maintient-il aujourd'hui, malgré cette fragilisation extrême ? Les raisons sont multiples.
En premier lieu, le bloc hégémonique qui est derrière Erdoğan tient. Ce bloc représente, il faut le dire, 60 à 65 % de la population. C'est, là aussi, une constante de la politique turque depuis les années 1950 ou 1960 : l'électorat turc sunnite vote en grande majorité pour un parti conservateur ou un autre. Il y a une légitimité de principe, voire une obéissance à l'État. Ce bloc hégémonique comprend non seulement une bourgeoisie puritaine – de moins en moins puritaine, d'ailleurs –, à laquelle l'État transfère des centaines de milliards de dollars de fonds publics, mais aussi des couches très largement défavorisées, qui sont convaincues que la pauvreté est non pas une question sociale ou politique, mais un problème qui se traite par la charité. Or l'AKP mène une politique de charité, et répond aux demandes conservatrices des couches sunnites et turques. Le gouvernement est également soutenu par un puissant mouvement syndical. Il s'agit d'un système corporatiste, et il y a très peu de raisons que ce système se trouve fragilisé.
Deuxième raison pour laquelle ce pouvoir se maintient : la logique plébiscitaire. Erdoğan se veut l'homme qui incarne la nation, son histoire et son avenir, et s'adresse directement à la population, sans la médiation des institutions. Par exemple, il s'adresse directement aux maires de quartier, ou encore aux artisans et aux commerçants, en leur expliquant qu'ils sont non seulement des artisans et des commerçants, mais aussi des juges et des policiers de leur quartier. Il y a une logique de légitimation permanente du président, au détriment de toutes les institutions. On peut dire aujourd'hui que la Turquie est un pays très largement désinstitutionalisé.
Troisième raison : on assomme la population. Le pays est toujours en crise ou en guerre, même s'il ne sait plus contre qui : le mouvement de Fethullah Gülen, l'allié d'hier, est devenu l'ennemi ; Abdullah Gül, premier président issu de l'AKP, et Ahmet Davutoğlu, successeur d'Erdoğan à la tête de l'AKP et au poste de premier ministre, sont aujourd'hui considérés comme des traîtres potentiels ; on peut être en guerre avec Israël, la Russie ou l'Europe à un moment donné, et s'y allier quelque temps après. Il y a une idée de guerre permanente, à l'intérieur et à l'extérieur. La société est privée de ses repères, pour se penser, se critiquer, lire son passé immédiat et se projeter dans l'avenir. Cette situation de guerre permanente se traduit aussi par un discours politique très violent : Erdoğan répète souvent qu'une terre ne peut devenir la patrie qu'à la condition d'être arrosée par le sang des martyrs – ceux-ci étant érigés en éléments fondateurs de la nation – ou que la Première Guerre mondiale n'est pas terminée, qu'elle se poursuit aujourd'hui entre la Turquie et les puissances occidentales, dont le seul objectif est de détruire la Turquie. Tout ceci assomme la société. Or une société assommée produit, de manière quasi mécanique, des réflexes d'obéissance.
De ce point de vue, Erdoğan n'a perdu ni sa popularité ni sa base sociale. Au contraire, cette base sociale est mobilisée, et elle est d'ailleurs susceptible de devenir de plus en plus paramilitaire. D'où le risque de coups d'État à venir ou, du moins, d'une période de violence.
En effet, compte tenu des centaines de milliers de personnes limogées, dont un tiers des généraux du pays et de très nombreux policiers – hier, 12 000 policiers ont été limogés en une seule fois –, le champ militaro-sécuritaire turc est devenu un champ de ruines. Il faut remplacer ceux qui ont été arrêtés ou limogés par d'autres. Deux types d'acteurs sont recrutés : d'une part, d'anciens kémalistes, qui avaient eux-mêmes été limogés en 2008 et 2009 à la suite de procès intentés par des juges ou des procureurs proches de Fethullah Gülen – ces kémalistes sont de retour, mais ils ne seront pas loyaux envers Erdoğan ; d'autre part, des acteurs paramilitaires, à savoir des forces spéciales, des organisations et des entreprises sécuritaires islamistes ultra-radicales – ces organisations seront loyales envers Erdoğan, mais elles ne s'inséreront pas dans le cadre d'un État légal rationnel.
Le renouvellement du champ sécuritaire auquel nous assistons aujourd'hui porte donc en lui les germes d'une nouvelle fragmentation et d'une nouvelle période de violence, sans doute annonciatrice d'autres tentatives de putsch. Le fait de concentrer toute l'attention sur Fethullah Gülen empêche le pouvoir de percevoir les éléments structurels au sein du système politique et du champ militaro-sécuritaire turcs. Il ne voit pas que la machine est devenue incontrôlable, ce qui est extrêmement inquiétant.
J'en viens à la question syrienne et à la question kurde.
Dans le dossier syrien, nous sommes face à un double phénomène. Premier phénomène : l'échec total de la politique arabe de la Turquie depuis 2010. N'oublions pas qu'Erdoğan avait reçu le prix Kadhafi des droits de l'homme en novembre 2010, quelque mois avant que la guerre éclate en Libye. La Turquie avait normalisé ses relations avec tous les pays arabes, y compris avec les régimes les plus autoritaires et les plus anti-islamistes. Les contestations révolutionnaires arabes ont donc été un choc pour Ankara. La Turquie a mis beaucoup de temps à s'adapter à la nouvelle situation – de même que de nombreux pays européens.
À la fin de l'année 2011 et au début de l'année 2012, la Turquie a pensé que le moment était venu de s'imposer dans la région non pas comme une puissance impériale, mais comme un primus inter pares, en créant une sorte d'alliance qui regrouperait les Frères musulmans libyens, les Frères musulmans égyptiens, le parti Ennahdha tunisien et les Frères musulmans syriens, d'autant que le régime d'Erdoğan pensait que Bachar Al-Assad n'avait plus que quelques mois devant lui. Or les choses ne se sont pas passées ainsi : en Libye, les Frères musulmans n'ont pas réussi à obtenir la majorité, et le pays a sombré très rapidement dans la fragmentation ; en Égypte, le général Al-Sissi a fait un coup d'État très sanglant ; en Tunisie, le gouvernement d'Ennahdha ont été obligés de démissionner, puis le parti a perdu les élections. Dès lors, La Syrie restait, en quelque sorte, le seul point d'entrée. Or ce point d'entrée unique était malgré tout contrôlé, avec une brutalité extrême, par Bachar Al-Assad, soutenu par le Hezbollah et l'Iran et, de plus en plus, par la Russie. L'insistance de la Turquie dans sa politique anti-Bachar Al-Assad et ses compromissions d'abord avec le front Al-Nosra, puis avec l'État islamique s'expliquent très largement par sa frustration de voir les portes du monde arabe se fermer les unes après les autres devant elle.
Deuxième phénomène : le conflit avec les Kurdes. Erdoğan n'aurait eu aucun problème avec un acteur kurde qui aurait accepté de se mettre au service non pas de la Turquie, mais de la « nation turque sunnite ». Car n'oublions pas que, en Turquie, le nationalisme va toujours de pair avec une dynamique confessionnelle. Or, que ce soit en Syrie ou en Turquie, l'idée des acteurs kurdes – du PKK et du parti légal kurde en Turquie, du PYD en Syrie – était de renégocier sur le fond avec la Turquie, de refonder la Turquie sur une autre base. Cet antagonisme explique très largement pourquoi la Turquie a laissé passer par sa frontière des milliers de djihadistes non seulement européens, mais aussi tunisiens et marocains ; pourquoi, au moment de la bataille de Kobané, elle a eu une politique malgré tout bienveillante à l'égard de l'État islamique ; et pourquoi, lorsque les Kurdes ont voté très massivement en faveur du HDP, parti dit pro-kurde en juin 2015, Erdoğan a rompu le processus de paix et adopté une politique de la terre brûlée, qui a consisté à détruire massivement le tissu urbain d'une bonne dizaine de villes kurdes.
Aujourd'hui, la situation est un peu différente : la Turquie a capitulé devant la Russie ; le fait qu'elle n'ait pas prononcé un seul mot depuis le lancement de la nouvelle offensive sur Alep est significatif à cet égard. Sans doute y a-t-il eu aussi une forme de négociation avec les États-Unis, dont nous ne connaissons pas les termes. Et l'intervention de la Turquie, qui était désirée depuis très longtemps, mais qui résulte d'un échec de sa politique étrangère, a finalement eu lieu.
Cette intervention comporte énormément de risques. Il faut souligner un fait majeur : jusqu'à maintenant, l'État islamique n'a pratiquement pas résisté. Or ce même État islamique a montré qu'il était capable, malgré tout, de riposter. Ainsi, tout en appliquant une stratégie de non-combat, il a détruit six tanks turcs et tué une dizaine de soldats turcs et, surtout, organisé plusieurs attentats suicides très sanglants qui ont visé non pas l'armée turque en tant que telle, mais son alliée, l'Armée syrienne libre (ASL). Signalons que l'ASL d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle qui a été fondée le 29 juin 2011 : il s'agit désormais d'une coalition plus ou moins islamiste, soutenue par la Turquie, comprenant 2 000 à 2 500 membres, dont une bonne partie n'est pas entraînée ; l'ASL n'est donc pas en mesure de se battre contre l'État islamique. Notons aussi que de nombreux membres de l'ASL sont profondément anti-américains et ne sont pas très différents, finalement, de ceux du front Al-Nosra – lequel a pris un nouveau nom.
On se demande désormais ce que va faire la Turquie. Va-t-elle continuer sa progression vers Al-Bab ? Il s'agit d'une ville très importante pour l'État islamique, visiblement surarmée. Va-t-elle aller à Rakka ? Le peut-elle sans le soutien des Américains et, éventuellement, une participation kurde ? Que va-t-il se passer à Mossoul ? Bref, nous sommes vraiment dans l'inconnu. On a l'impression que, quarante-cinq jours après le début de l'intervention, la situation est bloquée : on ignore dans quelle direction la Turquie peut aller car, quelle que soit l'étape qu'elle franchisse, elle devra exposer ses soldats, et le prix à payer risque d'être très lourd. Est-elle prête à payer ce prix ? Telle est la question qu'il faut se poser.
Pour finir, vous nous avez demandé d'évoquer les rapports de la France et de l'Europe avec la Turquie. Je suis assez désespéré à ce sujet : je suis impressionné par l'aveuglement des Européens et des Américains à propos de ce qui se passe au Moyen-Orient. À plusieurs reprises, je l'avais répété dans mes interventions, que Falloujah, ville de 325 000 habitants, était tombée aux mains de l'État islamique, le 4 janvier 2014. Cet événement majeur était passé comme un fait divers dans la presse et cela n'avait suscité aucune réaction dans les chancelleries, ni à Washington, ni à Paris, ni à Bruxelles. Il a fallu attendre la chute de Mossoul, ville de 1,3 million d'habitants, le 10 juin 2014, pour que l'on prenne enfin la mesure de la gravité de la situation. De même, l'opposition syrienne nous avait avertis dès la fin de l'année 2011 qu'on allait avoir un gros problème de réfugiés. On a été dans l'aveuglement total, jusqu'à ce que le drame de 2015 se produise.
J'ai l'impression que l'Union européenne a décidé de devenir un non-acteur, un non-sujet. Aujourd'hui, cela n'a aucun sens de parler de l'Europe et de ses rapports avec la Turquie, car les marges de manoeuvre n'existent pas : l'Europe s'en est totalement privée, non seulement par son aveuglement, mais aussi par sa décision de ne pas devenir une puissance, de ne pas peser sur les affaires du monde. Aujourd'hui, vu de Turquie, l'Europe ne pèse pas. Je le sais d'autant mieux que nous entreprenons depuis plusieurs mois des démarches auprès des autorités françaises pour que quelque chose soit fait en faveur des milliers d'universitaires menacés en Turquie, avec lesquels nous sommes en contact permanent. On a l'impression que l'Europe est incapable de faire un geste, même symbolique. La paralysie est totale. Dès lors, je préfère ne pas trop m'étendre sur le sujet.

Je remercie nos deux intervenants.
Monsieur Bozarslan, on a connu Erdoğan premier ministre aux côtés du président Abdullah Gül, très ouvert sur le monde, copain de Lula, développant des relations avec la Chine, ayant envie d'acheter des terres en Afrique, ayant l'ambition que la Turquie prenne le leadership du monde arabe à la place de l'Égypte. Or on le retrouve aujourd'hui cloîtré dans son immense et superbe palais, conduisant ces derniers mois une politique que l'on ne pourrait pas du tout se permettre dans un pays tel que le nôtre. Comment expliquez-vous cette mutation de l'homme, abstraction faite d'une éventuelle fascination pour le pouvoir ?
Les événements en Turquie ont effectivement eu des incidences au sein des communautés turques d'Europe, notamment en France, où nous avons constaté des crispations très importantes, avec des menaces, à plusieurs endroits du territoire. Selon vous, comment les choses vont-elles évoluer ?
Pour le reste, je suis assez d'accord avec vous : dans le contexte actuel, l'Europe est un non-acteur et un non-sujet.

J'ai beaucoup apprécié les propos de nos deux orateurs. L'analyse de M. Bozarslan sur ce qui se passe en Turquie, en particulier, m'a frappé par son exactitude. J'aimerais vous poser deux questions, monsieur.
En premier lieu, selon vous, comment Erdoğan va-t-il utiliser la carte des migrants dans les mois qui viennent ? Il y a une dizaine de jours, il a déclaré que les engagements qui avaient été pris pour le mois de juin 2016 n'avaient pas été tenus et que sa patience s'épuisait. Je crois que vous avez raison : Erdoğan méprise l'Europe, qui est inexistante à ses yeux. Il a d'ailleurs remarquablement utilisé l'Europe pour casser l'armée turque, dernier rempart du kémalisme : ce rempart a sauté, avec la bénédiction du Parlement européen. Ensuite, il a changé de pied car, en fait, il n'a jamais souhaité entrer dans l'Union européenne et accepter des règles qu'il considère comme complètement baroques. Il a une vision à la fois nationale, ottomane et islamiste. Il rêve de recréer, en 2024, cent ans après l'abolition du califat, une sorte de néo-califat ottoman et islamiste, prétendument moderne. En attendant, il a fait chanter l'Europe. En mars dernier, les Français ont commis une erreur fondamentale en laissant Mme Merkel donner les clés des frontières européennes à la Turquie. Car c'est à cet homme-là que nous avons confié les clés des frontières de l'espace Schengen ! Compte tenu de la guerre civile larvée à l'intérieur de la Turquie et à ses frontières, que va faire Erdoğan sur la question des migrants, vis-à-vis de ce voisin faible et pathétique qu'est devenu l'Europe ?
Une deuxième question se pose : quel rôle va jouer la Turquie dans la décomposition de la Syrie et de l'Irak, alors que l'autre puissance islamique non arabe de la région, l'Iran, est déjà pleinement entrée en scène et que les pays arabes se sont effondrés ? Quelles évolutions géopolitiques anticipez-vous ? L'une des tâches de la diplomatie française devrait être d'imaginer le futur Moyen-Orient, très différent de celui qui a été façonné par les accords Sykes-Picot, dans lequel des puissances musulmanes non arabes vont avoir un poids majeur, celui des colonisateurs il y a cent ans.
Il y aurait beaucoup à dire aussi sur la manière absolument épouvantable dont s'est comportée la Turquie face au passage de djihadistes européens, notamment français, et au commerce d'êtres humains. Quand on connaît un peu le pays, il paraît étonnant que la police turque n'ait rien vu alors que le nombre de migrants était de 10 000 par jour en 2015. Nous avons loupé notre relation avec ce pays très important, aux yeux duquel nous ne sommes plus crédibles puisque nous ne disons rien. Nous ne sommes pas capables de dire quoi que ce soit sur la répression qui s'abat en Turquie, un pays avec lequel nous avons repris les négociations sur son adhésion à l'Union européenne, et auquel nous donnons des milliards de dollars pour qu'il s'occupe des réfugiés. Si les Hongrois faisaient un quart du dixième de cela, toutes les institutions européennes seraient saisies. Dans le cas de la Turquie, c'est silence radio général. Comme vous, j'aimerais que la diplomatie se montre un peu plus vivante sur ce sujet.

Pour ne pas paraphraser mon collègue Lellouche, je vais être beaucoup plus bref que prévu. Pour moi, c'est la France qui est un « non-sujet » dans cette affaire : l'Union européenne et Mme Merkel ont pris un parti clair et ont mis en place une négociation, dans le dos ou avec la complicité de la France. Cette négociation est ahurissante comme l'a dit Pierre Lellouche.
Pour ma part, j'aimerais vous interroger sur l'exemption de visa que réclame la Turquie pour les courts séjours dans l'espace Schengen. Où en est-on ? La décision, qui devait être prise en juin, est désormais attendue en octobre. L'Union européenne ne dit rien et Mme Merkel agit dans le dos de ses partenaires pour avoir de bonnes relations avec la Turquie. Comment va-t-on gérer cette affaire ? Comment va réagir le président turc, sachant que la situation a évolué, comme vous l'avez très bien expliqué ?
Ma deuxième série de questions est liée à la situation en Syrie. La Turquie profite d'une certaine abstention des États-Unis qui sont en période électorale. Comment voyez-vous évoluer les relations entre ces deux pays ? Dans ce contexte, comment pouvons-nous reprendre pied et exister à nouveau dans le futur Moyen-Orient ? Il ne sert à rien de nous lamenter sur les événements puisque nous avons disparu, que nous nous sommes évanouis.

Avant le putsch, deux élections législatives se sont déroulées, qui ont donné des résultats très différents. Comment l'expliquez-vous ?
Ne croyez-vous pas que la Turquie fait semblant de négocier son adhésion à l'Union européenne alors qu'elle ne veut pas de cette Europe ? Comme mon collègue Dupont-Aignan, j'aimerais aussi savoir où en est la négociation concernant l'exemption de visa réclamée par Turquie. Il me semble que le président Erdoğan avait lancé un ultimatum à l'Europe.
Comment a réagi la population turque après les déclarations du président Erdoğan sur la reconnaissance par l'Allemagne du génocide arménien ?

Nous voyons actuellement les limites de ce qu'on appelle la diplomatie d'influence. Pour autant, soyons un peu prudents et ne confondons pas les dirigeants et les États. En critiquant Poutine, ce qui n'est pas illégitime, on a un peu oublié que la Russie restait une grande puissance. Il n'est pas illégitime de critiquer Erdoğan, mais il ne faut pas oublier la dimension historique de la puissance ottomane. C'est la France et l'Europe qui sont interrogées. La France pourrait-elle à nouveau avoir seule une diplomatie d'influence ? J'en doute. C'est au titre d'une construction européenne ressourcée, plus volontariste et cohérente, que nous pourrions retrouver cette diplomatie d'influence. La France et l'Europe doivent d'abord entreprendre un travail sur elles-mêmes avant de pouvoir se mêler à nouveau des affaires du monde.

Rappelons deux caractéristiques fondamentales de Recep Tayyip Erdoğan. Premièrement, il appartient à la confrérie des Frères musulmans et il a joué à plein sur cette dimension. Deuxièmement, sa nostalgie du grand empire turc a inspiré sa politique, comme vous l'avez fort bien rappelé.
Entre l'Égyptien Mohamed Morsi et le Tunisien Rached Ghannouchi, il y avait un verrou nommé Bachar Al-Assad. Au début du conflit en Syrie, Erdoğan serait allé voir al-Assad en lui demandant de prendre des Frères musulmans dans son gouvernement. Arguant que ces gens étaient des terroristes mêlant politique et religion, le président syrien aurait refusé. À ce moment-là, Erdoğan est intervenu fortement en Syrie puisque, aux dires mêmes du chef des services secrets turcs, le MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı – Organisation nationale de renseignements), il a livré 2 400 camions d'armes aux islamistes prétendument modérés. Cette livraison a été à l'origine de l'arrestation des journalistes et de la fermeture de l'organe de presse qui avaient divulgué ces informations, ce qui a marqué le début de la répression vis-à-vis des médias. Bien évidemment, Erdoğan a aussi voulu continuer la lutte contre le PKK, notamment en enclenchant la guerre civile en Turquie.
Il est en échec total, interne et externe. À ce stade, je me pose la question : n'est-ce pas un suicide ? Il y a des gens intelligents et même une classe politique intelligente en Turquie. Va-t-il passer la main après cet échec total ? Je ne vois pas d'autre évolution possible de ce régime car l'histoire ne s'arrête pas et, à un moment ; il faut solder les comptes. Où va-t-il ?

Nous n'allons pas avoir le temps d'analyser les vingt dernières années. Pourtant, au cours de cette période, des initiatives colossales ont été prises dans le bassin méditerranéen et le Moyen-Orient : Camp David en 2000-2001, l'Initiative de coopération d'Istanbul (ICI), le Dialogue méditerranéen, l'intervention en Irak, etc. En additionnant tous ces échecs, on comprend mieux mais cela ne donne pas de solution. Vous n'allez pas faire cette analyse en deux minutes, mais quelles raisons majeures expliquent-t-elles cet échec.

Monsieur Bozarslan, vous avez dressé un constat assez tragique concernant la réalité de la nouvelle ASL : à peine 2 500 personnes, plus ou moins islamistes. L'ASL est-elle un partenaire sérieux ou un partenaire plus médiatique que militaire ? Comment voyez-vous évoluer les rapports entre la Turquie et Daech ? Après une période de bienveillance, la situation a un peu changé.
Madame Schmid, comment voyez-vous évoluer à long terme les relations entre la Russie et la Turquie ?

Quel est, selon vous, l'impact des quelque 2,5 millions de réfugiés syriens en Turquie ?
Que pensez-vous du recul de certaines libertés dans la société turque au moment où se manifeste dans la région – en Égypte en particulier – une volonté inverse de revenir à certains standards internationaux ?
À un moment, il faudra penser au rôle que pourra jouer la Turquie dans la stabilité méditerranéenne. J'ai le sentiment qu'il faut maintenir un dialogue constructif avec ce pays pour éviter un isolement qui serait plutôt négatif. Comment voyez-vous son rôle à venir dans une perspective qui, je l'espère, ne sera pas trop lointaine ?

Avant de laisser répondre nos invités, je formulerais deux ou trois remarques et questions complémentaires.
Le nationalisme turc, dont chacun connaît l'ancienneté, perdure. Chacun sait que ce pays ambitionne de jouer un rôle sur le plan régional, et même au-delà, depuis très longtemps, sur fond de vieil antagonisme avec les pays arabes. Chacun sait que la Turquie est membre de l'OTAN. Pour toutes ces raisons, je partage l'avis de Nicole Ameline : nous aurions un intérêt, en tant que Français et Européens, à avoir une relation aussi constructive que possible avec ce grand pays, afin d'éviter que le nationalisme turc bien connu n'explose et ne devienne absolument incontrôlable, ajoutant encore à l'instabilité dangereuse de la région.
Ayant dit cela, je dois admettre que M. Erdoğan n'aide pas. Les torts sont partagés. Depuis quelques années déjà, l'Union européenne a complètement abandonné la défense de ses valeurs, sous l'influence d'un libéralisme dominant qui la considérait de plus en plus comme une zone de libre-échange dont l'intérêt était de défendre le commerce et non pas ces politiques communes. Certaines commissions – je pense notamment à la Commission Barroso qui a quand même duré dix ans – ont une responsabilité écrasante dans cette évolution, de même que des gouvernements nationaux.
Nicole Ameline a soulevé un point important concernant les réfugiés. Si nous sommes submergés par des réfugiés et que nous sommes obligés de prendre des mesures en catastrophe, c'est bien parce que nous ne sommes pas allés au bout de Schengen. Pour avoir fait ratifier et l'accord de 1985 et la convention d'application, je pense que si nous avions mis en oeuvre ce qui était écrit sur le contrôle des frontières extérieures, au fur et à mesure des alternances, nous n'en serions sans doute pas là. Je veux bien que l'on accable la France et l'Union européenne mais, au moins, revenons un peu en arrière, comme le suggère Guy-Michel Chauveau. Croyez bien que si ces arguments sont employés, nous saurons remettre les pendules à l'heure !
M. Bozarslan, je déplore comme vous que l'Union européenne ne dise rien concernant ces personnes, notamment ces universitaires. C'est comme cela depuis longtemps. Si nous ne disons rien, c'est parce que les politiques qui auraient dû accompagner la mise en place de ce grand marché ont été perdues de vue. Le problème que pose M. Viktor Orbán est symptomatique de la manière dont se sont déroulées les négociations sur l'élargissement de l'Union européenne. La Commission a fait ce que les bureaux ont l'habitude de faire, sans aucune espèce de contrôle politique. On s'est bien gardé de rappeler que c'était aussi une union de valeurs contenues dans les critères de Copenhague. Il fut une époque, que j'ai connue de très près, où tout cela était sur le devant de la scène.
Une fois ce paysage européen dessiné, j'en viens à ma question. Sachant que M. Erdoğan a une légitimité démocratique incontestable, comment la société turque analyse-t-elle ses intérêts nationaux ?
Constatant que ces questions globalement négatives s'ajoutent à notre perspective plutôt critique, je tiens à dire que je partage la position de Nicole Ameline : il va falloir maintenir un dialogue constructif avec la Turquie.
Il ne faut surtout pas prendre des décisions dans la précipitation, même si les Turcs nous mettent constamment en demeure de répondre aux ultimatums qu'ils nous lancent sur toutes sortes de questions, parce qu'ils changent aussi très souvent d'avis. Hamit Bozarslan a relevé toutes les incohérences de la diplomatie turque qui fait des demi-tours à peu près tous les quinze jours. Sur la question des visas, par exemple, le gouvernement turc a d'abord fait des déclarations très dures, puis il a rétropédalé avant de mettre un nouveau coup de pression pour des raisons tactiques, d'opportunité. Il ne faut pas prendre au sérieux tout ce qui est dit, sous prétexte que le ton est dur et les menaces – la libération de flots de migrants, etc. – importantes. Quoi qu'il en soit, il semble que les deux côtés se soient résolus à admettre que le dossier des visas ne serait pas réglé dans l'immédiat, qu'il y aurait un délai.
La Turquie va effectivement perdurer en tant que pays. Elle avance au milieu du chaos sur un nouveau chemin politique, vers une nouvelle configuration. Les Turcs retiennent le fait que, pour la première fois, un coup d'État militaire n'est pas parvenu à son terme. La majeure partie de la population y voit le signe d'un énorme progrès démocratique, même si la démocratie sociale n'est pas ancrée dans le pays. Cet apprentissage de la démocratie sociale consiste à comprendre que l'on peut demander des comptes à un gouvernement qui a été élu : les différentes votations sont un moment où, en principe, on devrait pouvoir remettre en cause certains points de l'agenda.
Que s'est-il passé entre les deux élections législatives de l'année dernière ? En juin 2015, le HDP (Halkların Demokratik Partisi – Parti démocratique des peuples), pro-kurde, a recueilli 13 % des suffrages, un résultat relativement bon qui a apparemment mis en fureur le Premier ministre. La séquence suivante nous montre que Recep Tayyip Erdoğan n'a pas besoin de réforme constitutionnelle pour gouverner comme il le souhaite. Sans que la Constitution ait été modifiée, c'est le Président de la République qui gouverne et non pas le Premier ministre. Depuis trois ans, on continue pourtant à nous servir le discours suivant : Recep Tayyip Erdoğan a besoin de renforcer sa majorité pour pouvoir changer la Constitution.
Quand on est dans une logique de personnalisation du pouvoir à l'extrême, sans aucun contrepoids, on fait ce que l'on veut. Quand la question de la peine de mort s'est posée, juste après le coup d'État, Erdoğan pouvait faire absolument ce qu'il voulait. Or le gouvernement turc a pourtant tenu compte des signaux très clairs qui lui ont été envoyés par les institutions européennes, signifiant que ce serait un point de non-retour. C'est très instructif sur le dialogue entre l'Union européenne et la Turquie. Les Européens doivent être très présents et très attentifs sur tous les points de forces dont ils disposent, alors qu'ils ont trop tendance à se percevoir comme en position de faiblesse vis-à-vis de la Turquie.
La période de juin à novembre 2015 a été marquée par des attentats et par la fin du processus de paix avec les Kurdes. Or, il faut le rappeler, l'aboutissement de ce processus de paix est absolument indispensable au retour à une situation normale en Turquie. Focalisés sur la guerre en Syrie, nous avons tendance à moins regarder ce qui se passe à l'est de la Turquie. Pour ma part, je considère que la Turquie est en guerre depuis un an sur son propre territoire. Après l'attentat à Ankara, dont les circonstances ne sont pas très claires et qui a coûté la vie à une centaine de personnes, une ambiance de terreur s'est installée pendant les trois dernières semaines de la campagne électorale. Les partis d'opposition ont été extrêmement gênés dans leur campagne et tous les efforts du HDP ont été pratiquement bloqués. Il y a eu des arrestations parmi les militants qui se sont laissé gagner par un fort découragement. Malgré tout, le parti a réussi à se maintenir. À quoi cela sert-il puisque les députés sont sous la menace d'une levée de leur immunité pour des accusations de proximité avec le PKK ?
La loi a été votée avant le 15 juillet. Ils ont été convoqués au commissariat mais ils ont refusé de s'y rendre.
Concrètement, le couperet peut tomber à tout moment.
Pour des raisons spécifiques, à la fois institutionnelles et liée à la culture politique turque, la démocratie sociale met du temps à s'ancrer dans ce pays. C'est pourquoi il faut tenir bon sur un certain nombre de valeurs politiques européennes.
Pierre Lellouche explique que cela a été une grande erreur de laisser l'Allemagne s'occuper toute seule des migrants. Pourquoi les Français n'ont-ils pas participé à cette discussion un peu en amont ? On sent bien que la France n'était pas en position de leadership, peut-être parce que l'Allemagne l'avait mise au pied du mur en annonçant qu'elle allait accueillir un million de migrants. À ce moment-là, il aurait fallu organiser une discussion franco-allemande en urgence, avant que toute la séquence un peu catastrophique qui a suivi ne se mette en place et ne conduise à faire exactement le contraire de ce qui avait été décidé au départ, c'est-à-dire à fermer la route des Balkans.
À mon avis, le tarissement du flux de réfugiés n'est pas uniquement un effet de l'amélioration du contrôle par la police turque, il s'explique aussi par le message politique qui a été envoyé lors de la fermeture de la route des Balkans : sachant qu'ils vont être refoulés, les migrants ne vont pas aller se noyer dans la mer Égée. Ces communautés sont mobiles et nous devons comparer les politiques d'accueil des autres pays voisins de la Syrie, notamment celles de la Jordanie, du Liban et du Kurdistan irakien.
Comment les Turcs vont-ils gérer ce dossier des réfugiés, qui est évidemment très lourd en termes de politique intérieure ? Recep Tayyip Erdoğan a proposé de leur donner la nationalité turque mais il n'est pas certain que cette idée soit très populaire dans le pays. Nous n'avons pas eu de nouveaux effets d'annonces puissants sur le sujet, mais nous avons des coups de sonde, de temps en temps. Les Turcs vont être embarrassés par la présence de ces réfugiés syriens mais, pour le moment, elle bénéficie à l'économie. Il a fallu un certain temps avant que l'on comprenne à quel point le secteur informel de l'économie turque soutenait une bonne partie de la croissance, en cette période de crise où les mauvaises nouvelles s'accumulent : absence de touristes, baisse des financements extérieurs, risques de hausse du prix des hydrocarbures et donc de la facture extérieure. Dans un tel contexte, le pays a besoin de tout un secteur informel qui travaille pour l'exportation et de tous ces trafics à la frontière turco-syrienne pour alimenter la croissance économique.
Une autre manière de gérer le dossier serait de réinstaller une partie des réfugiés dans la fameuse zone tampon. Dans ce scénario à la Frankenstein, l'armée turque se présente en sauveur puisqu'une intervention terrestre est attendue depuis au moins deux ans en Syrie. En réalité, l'armée turque est en position de compliquer énormément la situation. Va-t-elle aller vers Al-Bab ou vers Alep, sachant que le siège de cette dernière ville est sous contrôle des Russes ? Avec qui va-t-elle s'allier ? Les incidents sont probables car les Turcs risquent de rencontrer le Hezbollah, l'armée syrienne, les Russes.
S'agissant des relations Russie-Turquie, je suis contente de voir qu'Hamit Bozarslan partage à peu près mon point de vue : les Turcs sont en position de totale faiblesse vis-à-vis de la Russie, et leur intervention en Syrie ne rééquilibre pas particulièrement le rapport de force. La crise de confiance est extrêmement forte. Poutine envisage la Turquie comme un coin à enfoncer dans l'Alliance atlantique plutôt que comme un allié avec lequel organiser des coups diplomatiques efficaces au Moyen-Orient.
Où va le régime ? Comment les Turcs voient-ils leurs intérêts nationaux ? Depuis le limogeage d'Ahmet Davutoğlu, j'ai l'impression que le régime est lancé dans une course à sa propre perte. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait, en plus, un coup d'État militaire raté et une intervention en Syrie. Cependant, comme Hamit Bozarslan l'a très bien expliqué, l'AKP dispose d'une base sociale solide en Turquie. Fragilisé à l'extérieur pour de nombreuses raisons, Recep Tayyip Erdoğan peut compter sur la loyauté d'une bonne partie du peuple turc. C'est de la radicalisation potentielle des oppositions que dépendra, à mon avis, l'avenir du régime. La manière de gérer certains dossiers – les Kurdes, Gülen, Daech – et de traiter les libéraux est lourde de menaces à court terme pour le régime.
S'agissant des intérêts nationaux de la Turquie, il est très frappant de voir que l'on assiste à un rétrécissement de la perspective. En termes psychologiques, on pourrait dire que le trauma d'après coup d'État militaire est extrêmement présent. La Turquie est en train de se replier vraiment sur son syndrome de Sèvres ; elle développe une sorte de paranoïa vis-à-vis des interférences étrangères ; elle diabolise des minorités, sachant que Gülen en représente une variante confrérique. Je ne suis pas sûre qu'il y ait de grandes perspectives stratégiques à tirer des agissements successifs du gouvernement depuis deux mois.
Une partie des questions posées ne concerne pas que la Turquie, mais elle a une dimension régionale.
En premier lieu, comment expliquer la trajectoire d'Erdoğan ? Nous sommes face à un problème qui concerne à la fois le Moyen-Orient et la Turquie. Au cours des années 1990, nous avons observé une bifurcation très claire au sein de l'islamisme à l'échelle régionale : d'un côté, al-Qaïda fondée en 1988 ; de l'autre côté, une branche qui a évolué vers le néolibéralisme, le conservatisme social, donc vers un islamisme non révolutionnaire. L'AKP en Turquie, mais aussi Ennahdha en Tunisie et le Parti de la justice et du développement (PJD) au Maroc appartiennent à ce deuxième courant.
Il y a eu un deuxième processus de déradicalisation en Turquie où les islamistes étaient réprimés et ne parvenaient pas à dépasser le seuil de 20 % de l'électorat. D'où cette grande ouverture vers les classes moyennes, vers les Kurdes et les intellectuels de gauche. N'oublions pas que l'AKP a flirté pendant plusieurs années avec des intellectuels de gauche, avant de les remplacer par des intellectuels ultranationalistes.
En revanche, à partir de 2010-2011, s'est opéré un processus de re-radicalisation mais de l'État cette fois et non pas du mouvement islamiste révolutionnaire. Maintenant qu'il contrôle l'État, Erdoğan entend refonder la société, en ayant trois repères chronologiques : 2023, le centenaire de la République ; 2053, le six centième anniversaire de la conquête d'Istanbul c'est-à-dire de Constantinople ; 2071, le millénaire de l'arrivée des Turcs en Anatolie. Il faudrait donc que d'ici à 2071, la société soit refondée pour entrer dans une nouvelle période millénaire. En tant qu'enseignant, je ne vois pas comment je vais gérer l'arrivée du mois de janvier 2017, mais Erdoğan, lui, pose à la Turquie l'horizon de 2071. La refondation doit absolument avoir lieu d'ici là
Voyez comment tout ceci crée une redéfinition du temps : le temps long doit être respecté ; le temps court doit obéir impérativement aux objectifs de ce temps long. Cela implique de construire la puissance en interne – homogénéiser la société, créer une nation organique obéissante à son chef – et à l'échelle régionale et mondiale.
C'est vrai qu'à l'été 2015, la presse de l'AKP disait très clairement ceci : puisque la Première Guerre mondiale continue, puisque les batailles décisives sont encore à venir, il faut inonder l'Europe de réfugiés. À ce moment-là, nous avons prévenu les chancelleries du drame humain considérable qui se préparait, et de la volonté de la Turquie d'utiliser ce qu'on appelle la puissance de nuisance en sciences sociales. Celle-ci ne se cantonne pas aux rapports bilatéraux, elle a une dimension historique. Une fois de plus, la Turquie est revenue sur l'idée que la Première Guerre mondiale n'avait qu'un seul objectif : détruire l'empire ottoman. Je crois qu'Erdoğan ne sait même pas que la Turquie a été alliée de l'Autriche-Hongrie et de l'Allemagne pendant la guerre ! Une nouvelle lecture de l'histoire a émergé avec cette perspective de 2071 et elle est omniprésente dans le discours d'Erdoğan.
Il faut effectivement prendre en considération l'Iran et la Turquie dans la nouvelle géographie du Moyen-Orient, avec la Russie. Néanmoins, j'ai de plus en plus l'impression que l'Iran, la Turquie et l'Arabie saoudite ne produisent pas le même type de radicalité. L'Iran a une diplomatie milicienne. L'Iran est présent organiquement dans les communautés chiites du Moyen-Orient, qui sont brutalisées. Le Hezbollah n'est pas du tout un enfant de choeur, je puis vous l'assurer, mais l'Iran arrive à consolider les communautés chiites, à un prix très élevé. Or l'Arabie saoudite et la Turquie produisent une sur-radicalité sunnite, tout en n'étant pas en mesure de la contrôler. Actuellement, l'Arabie saoudite n'est pas en mesure de contrôler l'État islamique ou al-Qaïda au Liban. Cette sur-radicalité finit par détruire la communauté sunnite. Nous sommes face à quelque chose d'asymétrique qui s'explique peut-être par l'histoire du chiisme et du sunnisme. L'Iran et la Turquie vont être présents, mais pas du tout de manière symétrique : la Turquie n'a pas de répondant dans la région, contrairement à l'Iran qui a du répondant au Liban mais aussi au Yémen, à Bahreïn, au Koweït.
Qu'en est-il de l'Europe ? Européen convaincu, je critique l'Europe parce que je pense que le monde a besoin d'elle et qu'elle ne le comprend pas. L'Europe renonce à avoir de la puissance alors qu'on ne peut pas être la première puissance économique mondiale sans avoir de la puissance tout court : avoir des valeurs, une vision du monde et la capacité d'y intervenir. Il ne s'agit pas là d'impérialisme.
La Russie actuelle peut mobiliser ses repères du XIXe siècle pour pouvoir prendre sa revanche sur la guerre froide. L'Europe, heureusement, ne peut pas mobiliser ses repères du XIXe siècle – Sedan, deux guerres mondiales, le darwinisme social. Ces repères n'ont pu être remplacés par d'autres qui puissent nous permettre de penser le monde de demain. On le voit à tous les niveaux, notamment dans le traitement de la question des réfugiés. Depuis 2008 et le naufrage de la Grèce, j'étais très critique par rapport à Mme Merkel. Le seul moment où elle a voulu se montrer généreuse, elle n'a pas eu de répondant. Au Mali aussi, on voit que l'Europe n'a pas de repères pour penser le monde de demain. La crise en Méditerranée, que vous avez évoquée, n'est pas du tout terminée. Les catastrophes sont encore à venir. Je ne voulais pas que la France intervienne au Mali mais qui d'autre pouvait le faire ? Il n'y avait personne. L'Europe n'était pas là pour décider d'aller au Mali où les choses ne vont toujours pas très bien.
On ne peut pas reprocher à l'Europe de vouloir dominer les politiques françaises. Il y a vraiment une absence d'Europe. Si les politiciens voulaient servir à quelque chose à l'avenir, ils pourraient éventuellement penser à la façon de dépasser ces narcissismes nationaux pour consolider l'Europe. Il y a là quelque chose à prendre en considération. La Russie, elle, pense en termes de puissance voire, très vulgairement, en termes de virilité. À cet égard, les discours de Poutine sont hallucinants. Et en face, il n'y a rien.
Comment la Turquie a-t-elle réagi à la reconnaissance du génocide arménien par l'Allemagne ? Finalement, elle a plus ou moins été obligée d'avaler la couleuvre. Comme lors de la crise avec la France, elle a rappelé son ambassadeur puis, quelques mois plus tard, elle a expliqué que cette reconnaissance était une décision du Parlement et non du gouvernement. Du coup, la situation a été gelée.
Comme vous, monsieur Myard, je pense que même si Erdoğan a énormément de ressort et de ressources, une stratégie de fuite en avant permanente ne peut pas durer indéfiniment. Madame la présidente, c'est peut-être la réponse à votre question : nous sommes impressionnés de voir à quel point les repères dans le temps et dans l'espace, qui sont nécessaires pour toute société, disparaissent en Turquie. Les repères d'altérité y ont disparu. Or une société, surtout lorsqu'elle se veut conservatrice en a besoin, un État a fortiori. Il semble que la peur ait remplacé tout cela. Il faut voir la peur qui s'est installée au sein de l'État en Turquie, au sein de l'AKP qui, on le sait, va être la cible de la prochaine purge. Les ministres, les députés, les maires ont peur. Plus le système a peur, plus il règne par la peur. Pour plagier le fameux adage, je dirais : qui règne par la peur périra par la peur.
Pour pouvoir sortir de ce régime de peur, il faudrait re-rationaliser l'État, reconsolider les institutions, penser à l'indépendance de la justice. Or quelque 4 500 des magistrats ont été arrêtés, soit le tiers de la profession. Il faudrait que des commissions d'enquête totalement indépendantes de l'exécutif puissent répondre aux questions qui se posent. Que s'est-il effectivement passé pendant le coup d'État ? Nous n'avons toujours pas d'organigramme. Il y a tous ces généraux qui disent avoir été putschistes mais pas du tout partisans de Fethullah Gülen. Que s'est-il passé entre les deux élections de 2015, interlude marqué par une terreur massive ? Qu'en est-il des fonds secrets, à la discrétion du président, dont le montant a triplé ou quadruplé ? Alors qu'il faudrait ré-institutionnaliser la Turquie pour que les risques de dérapage diminuent, on a l'impression que l'État est dans une fuite en avant permanente. On ne sait pas où cela va se terminer.
L'ASL n'est pas du tout une force de confiance, monsieur Mariani, même sur le plan militaire. Sa fragilité est visible sur le terrain. Sachez qu'il y a aussi un État islamique en Turquie. Selon les services de renseignement, il y aurait entre 1 000 et 3 000 membres de l'État islamique en Turquie. Nous avons des transcriptions, y compris venant de tribunaux, qui permettent de savoir à quel point la complicité a été massive à l'intérieur de la Turquie. Pour le moment, cette armée secrète de l'État islamique en Turquie n'a pas bougé, mais elle a des capacités de nuisance qu'il faut prendre en considération.
Pour compléter les propos de Dorothée Schmid, je précise que le Kurdistan irakien – 5 millions d'habitants – a reçu 1,8 million de réfugiés dont 250 000 Kurdes. Au Liban, les réfugiés sont très visibles dans les rues de Beyrouth : ils sont un million pour une population de 4 millions d'habitants. Ne parlons pas de la Jordanie, le pays qui a organisé de la manière la plus intelligente l'arrivée de 700 000 personnes. La Turquie n'est pas le seul pays concerné, mais elle tient un discours de misère et crie à l'abandon plus fort que les autres alors qu'elle compte 80 millions d'habitants. Quant à l'Arabie saoudite, elle s'adonne au chantage économique. Notons que le Liban, un pays qui se meurt économiquement et qui n'a plus d'État, ne fait pas de chantage. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider la Turquie ; je ne suis absolument pas contre le transfert des 6 milliards d'euros. Mais il s'agit d'une question régionale et non pas uniquement turque.
Pour conclure, je dirais qu'il faut évidemment négocier avec la Turquie. Je ne défends pas une stratégie de rupture, de sortie de la logique diplomatique. Restent à trouver les bases sur lesquelles négocier, en tenant compte des exigences du droit européen. Je répète que plus de 30 000 personnes ont été arrêtées, que quatorze d'entre elles se sont suicidées. Je n'ai guère de sympathie pour les membres de l'organisation de Fethullah Gülen, croyez-moi, mais, en tant que démocrate, ne dois-je pas défendre ceux qui ne sont pas nécessairement de mon camp ? Nous sommes face à un gouvernement qui déclare que les allégations de torture concernant les membres de Fethullah Gülen ne seront pas prises en considération. Une partie de la nation va être en dehors du corps national. Ceux-là ne disposeront que de la vie nue, comme on l'entendait dans l'empire romain : sans aucune protection, ils pourront être sacrifiés, mis à mort. La Turquie entre de plus en plus dans cette logique : les traîtres à la nation ne peuvent pas profiter du droit.

Merci beaucoup à tous les deux. Vos interventions étaient vraiment extrêmement intéressantes.
J'aimerais faire trois remarques.
D'abord, nous constatons que dans nombre d'endroits se développe un ultranationalisme particulièrement dangereux quand il est couplé à une certaine radicalité religieuse, qu'elle vienne des partisans de l'Occident chrétien qui pointent l'islam ou de ceux qui pratiquent une islamisation forcée voire brutale de la société. Il va falloir réagir face à cette donnée.
Ensuite, le succès de tous ces dirigeants nationalistes tient au fait qu'ils arrivent à intégrer le temps long dans leur projet politique. Cet aspect est extrêmement intéressant et nous ferions bien d'en prendre de la graine que ce soit pour nous souvenir du passé ou pour nous projeter dans le futur.
Enfin, depuis les années 1990, je suis convaincue que si l'Europe ne se tourne pas vers l'extérieur en ayant une politique extérieure dans tous les domaines, elle ne répondra pas aux angoisses de ses peuples. Au XXe siècle, elle a su répondre aux angoisses, principalement internes, de ses peuples. Il ne s'agit donc pas de tirer un trait sur l'Europe. Ce n'est pas non plus en bêlant « plus d'Europe ! Plus d'Europe ! » que nous trouverons la solution. Nous devons faire une Europe différente, adaptée au monde d'aujourd'hui.
Pardonnez-moi d'avoir profité de cette tribune pour vous délivrer mon message, mais je l'ai tellement écrit dans quatre bouquins différents que cela me démangeait de le faire.
La séance est levée à onze heures cinq.