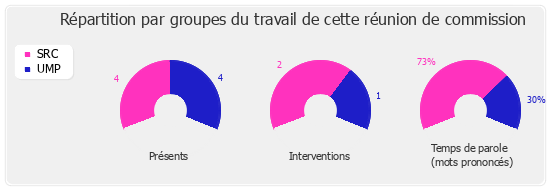Mission d'information sur les coûts de production en france
Réunion du 22 novembre 2012 à 10h30
La réunion
La mission d'information a entendu MM. Pierre Gattaz, Président du directoire de Radiall, président du Groupe des fédérations industrielles (GFI) et Vincent Moulin Wright, Directeur général du GFI.

Nous accueillons ce matin MM. Pierre Gattaz et Vincent Moulin Wright, respectivement président et directeur général du Groupe des fédérations industrielles (GFI). Celui-ci rassemble quinze fédérations et trois groupements, représentant 80 % de l'industrie française, à l'origine de 75 % de nos exportations et de 85 % de la recherche privée.
M. Gattaz est également membre du comité exécutif du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et il préside le directoire de Radiall, une entreprise familiale fortement exportatrice, comptant environ 2 000 salariés et faisant donc partie de ces entreprises de taille intermédiaire (ETI) trop rares en France.
Monsieur Gattaz, vous nous commenterez sans doute le rapport de M. Louis Gallois, pour l'élaboration duquel vous avez été consulté, et vous nous donnerez certainement aussi votre sentiment sur le pacte de compétitivité et sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), mais nous sommes prêts à vous entendre plus généralement sur tout ce qui touche à cette question de la compétitivité, essentielle pour notre économie.
Je commencerai, si vous le voulez bien, par ce dernier sujet, qui est bien loin de se limiter à la compétitivité-coûts.
En effet, la compétitivité dépend à la fois de facteurs internes et de facteurs externes à l'entreprise. Les premiers, dits aussi facteurs endogènes, sont constitués par l'innovation, par la qualité des produits, en somme par tout ce que nous pouvons maîtriser. Les seconds, facteurs exogènes, renvoient à ce que nous ne maîtrisons pas, ou même subissons : le coût du travail, celui du capital, la fiscalité et les prix des matières premières, dont l'énergie.
L'industrie française a perdu 700 000 emplois au cours des dix dernières années. Elle ne contribue plus que pour 14 ou 15 % à notre produit intérieur brut (PIB), ce qui est un peu plus qu'aux États-Unis, où cette proportion s'établirait à 12 %, mais beaucoup moins qu'en Allemagne, où elle se situe entre 24 et 25 %.
Une grande partie des emplois perdus l'a été dans les services, dont l'industrie est la fois cliente et fournisseuse – c'est d'ailleurs pourquoi il ne faut pas opposer ces deux secteurs. Depuis une vingtaine d'années, nous sous-traitons en effet de nombreuses activités, comme la logistique, le recours aux personnels intérimaires, le transport, l'informatique, la restauration, la maintenance et l'entretien des locaux… Pour un emploi industriel créé, il s'en crée deux ou trois dans ces services dits associés, pour lesquels nous formons des professionnels qui y trouvent de meilleures rémunérations que dans les centres d'appels, par exemple. D'où l'importance de l'industrie en tant que noyau dur d'une économie innovante et exportatrice.
Le rapport Gallois, dont nous saluons la qualité, l'intégrité, la neutralité et le souci d'équilibre entre l'économique et l'humain, insiste à juste titre sur la question des marges qui se pose à notre économie. La marge brute des entreprises, soit le rapport entre valeur ajoutée et chiffre d'affaires, s'établit à 27 % en France, contre 37 % en Allemagne, et n'est même que de 21 % dans l'industrie. Depuis dix à quinze ans, elle n'a cessé de se réduire, ce qui entraîne une contraction de nos capacités à nous autofinancer, à investir et à innover. Dès lors, le tissu industriel ne pouvait que s'atrophier, faute d'oxygène.
Le coût actuel de la main-d'oeuvre souffre d'une explosion des charges sociales, qui a conduit à un écart global de 70 milliards d'euros avec l'Allemagne. Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, auquel nous sommes bien sûr favorables mais dont le montant a été fixé à 20 milliards, laisse donc un important fossé à combler. D'où une certaine déception du GFI, qui s'attendait plutôt à un allégement des charges sociales d'environ 50 milliards d'euros, au prix d'un transfert à la fois sur la CSG et sur la TVA. Le fait de jouer sur cette dernière aurait en particulier eu l'avantage de renchérir les importations, notamment en provenance des pays asiatiques, cependant que les taux intermédiaires auraient permis une modulation évitant de trop taxer les matières premières.
Ce crédit d'impôt constitue donc un premier pas dans la bonne direction, mais un pas encore insuffisant pour améliorer sensiblement la compétitivité de nos entreprises.
Nos homologues allemands ont su modérer l'évolution des rémunérations, en la contenant en général en deçà de l'inflation. Des accords sociaux en faveur de la compétitivité et de l'emploi ont été conclus en Italie et en Allemagne. Des réductions de salaires ont été pratiquées dans le secteur privé en Espagne, en Italie, au Portugal et en Grèce. Des efforts ont été consentis dans le secteur public au Royaume-Uni, en Espagne et au Portugal.
Nous avons ramené la durée légale du travail de 39 heures hebdomadaires à 35 heures, mais la durée annuelle effective du travail est également plus brève en France que dans les pays comparables. Cependant, nous avons éprouvé tant de mal à mettre en place les 35 heures en 2000 et 2001 que nous ne sommes pas favorables à leur remise en cause : le « détricotage » d'une telle mesure, avec son lot de négociations sociales, soulèverait aujourd'hui plus de problèmes qu'il n'en résoudrait. Mais il est certain qu'on ne travaille pas assez en France.
Se pose en particulier la question de la durée du travail sur l'ensemble d'une carrière professionnelle, avec, à la fois, des arrivées tardives des jeunes sur le marché du travail et des départs en retraite trop précoces. Je n'ai pas de solution à proposer car il s'agit d'une question sensible, mais il faudra s'y pencher un jour ou l'autre.
Pour aller au-delà du CICE, nous proposons de transférer une partie des charges sociales pesant sur les entreprises vers la CSG et la TVA. Nous sommes également favorables à une politique de modération des salaires, dans le secteur public comme dans le secteur privé, et à l'ouverture d'une réflexion sur la durée globale du travail ainsi que sur les régimes de protection sociale, dont il faut améliorer l'efficacité.
Les dépenses publiques doivent être réduites si l'on veut alléger une fiscalité qui tend à s'alourdir un peu plus chaque année. Pour cela, l'expérience des entreprises peut être mise à profit : nous nous attachons en permanence à réduire nos coûts structurels en appliquant les techniques de lean manufacturing et de recherche de la qualité totale inspirées du système de production de Toyota ; nous mobilisons également nos troupes, appelées, elles aussi, à fournir des idées d'économie et de plus grande efficacité. Il faudrait agir de même avec les fonctionnaires. Il ne s'agit nullement de contraindre : cette mobilisation est au contraire facteur de motivation en même temps qu'elle contribue à la formation.
Le coût du capital comprend celui du crédit – le « bas de bilan » – et celui des fonds propres – le « haut de bilan ». Le crédit est devenu plus rare et plus difficile à obtenir depuis la crise des subprimes. Un contrat qui, avant 2007, tenait en une dizaine de pages en comporte aujourd'hui une centaine, tellement les garanties exigées sont lourdes et complexes. Ce sont les PME industrielles qui ressentent le plus ce durcissement. Pour l'ensemble des PME, PMI et ETI, l'encours national de crédit s'est contracté de 50 milliards d'euros depuis 2008 et, entre 2000 et 2010, il est passé de 16 % de la valeur ajoutée à 12 %. L'évolution a été similaire pour les financements « export ». Il en résulte un ralentissement des investissements et de l'innovation, au détriment donc du renouvellement du parc industriel et de la montée en gamme de nos produits.
Or l'industrie française est très faiblement automatisée. Nous manquons de robots : nous n'en avons que 35 000, contre 70 000 en Italie et 150 000 en Allemagne. Je souligne à ce propos que ces pays n'ont pas pour autant perdu des emplois : l'automatisation, dans l'industrie, n'accroît pas le chômage mais elle améliore la fiabilité des fabrications et la qualité des produits, et donc la compétitivité hors coûts. Le fait que nos robots datent des années quatre-vingt ou quatre-vingt-dix ne fait qu'ajouter à nos handicaps.
Quant aux fonds propres, ils font structurellement défaut aux PMI. La collecte de capital risque a chuté de 12 milliards d'euros en 2006 à moins de 6 milliards en 2012.
Pour améliorer le financement de l'industrie, la Banque publique d'investissement (BPI) ne doit surtout pas être une structure trop complexe. Les patrons de PME, accaparés par de multiples tâches, ont besoin de systèmes simples, comme l'est Oséo. Mais beaucoup d'autres questions se posent encore à propos de cette nouvelle banque : peut-on en attendre des financements à court terme ? Quelle sera l'articulation avec Oséo et avec le Fonds stratégique d'investissement (FSI) ? Quelle gouvernance va-t-on mettre en place ? Quel sera le rôle des régions ? Il est important que les entreprises trouvent des interlocuteurs à ce niveau, mais attention aux clientélismes locaux et aux dérives politiques ! La fâcheuse expérience des sociétés de développement régional (SDR), qui s'est soldée par un gouffre financier, doit nous inciter à contrôler de près les investissements.
Il faut également agir sur les délais de paiement dans les filières : autrement dit, appliquer enfin la loi sur la modernisation de l'économie (LME), qui a fixé un délai maximal de 60 jours.
Troisième point : il faut orienter l'épargne à long terme vers l'industrie. Cela exige de ne pas commettre d'erreur, comme on l'a fait en septembre, dans la taxation des plus-values. Nous ne sommes pas contre le fait de taxer la rente et la spéculation financière, mais en envoyant de mauvais signaux aux épargnants, nous allons les détourner d'investir dans les PME.
Enfin, il faut assouplir et simplifier la réglementation bancaire en matière de prêts, car les entreprises sont aujourd'hui enclines à chercher des sources de financement alternatives, parfois à l'étranger.
(M. Laurent Furst, vice-président de la mission d'information, remplace M. Bernard Accoyer à la présidence de la séance.)
Dernier coût imposé de l'extérieur, le prix des matières premières et de l'énergie a beaucoup augmenté au cours des trois dernières années : l'indice du cours des métaux de base est passé de 100 à 250, celui du cours des matières premières agricoles de 70 à 160 cependant que le prix du baril de pétrole grimpait de 30 à 90 euros. La maîtrise du coût de l'électricité, que nous devons à des choix régaliens, nous procure aujourd'hui un avantage de compétitivité, mais la filière nucléaire va coûter de plus en plus cher, essentiellement pour des raisons de maintenance et de sécurisation des installations. Considérons donc soigneusement toutes les sources d'énergie alternatives – dont les gaz de schiste, si l'on parvient à les exploiter proprement – et réfléchissons à toutes les économies possibles afin d'améliorer l'efficacité énergétique. La transition énergétique peut être une chance pour l'industrie française, en suscitant de nouvelles filières autour de nos grandes entreprises du secteur électronique, pour les économies d'énergie dites actives, ou du secteur des matériaux, pour les économies passives. En réglant les problèmes d'environnement, on peut aussi créer des emplois !
Nous disons donc oui aux énergies renouvelables, pourvu que leur développement ne se fasse pas au détriment de l'industrie.
Nous souhaitons d'autre part que soit mobilisé le Conseil national de l'industrie (CNI), issu de la conférence nationale de l'industrie créée par le précédent gouvernement. Il y a là, en effet, un cadre où État, patronat et salariés peuvent réfléchir ensemble à l'avenir. Nous n'attendons rien d'un État colbertiste et de ses plans, mais nous attendons de la puissance publique qu'elle nous aide à définir la stratégie d'une dizaine de filières.
Attention, enfin, à la fiscalité sur les entreprises, qui serait la plus lourde d'Europe à en croire la presse. La compétitivité passe par une fiscalité incitative, et non coercitive ou punitive. Et si nous allons vers une fiscalité écologique, faisons en sorte qu'elle se rapproche du modèle du crédit d'impôt recherche ou du CICE.

Selon vous, l'écart des coûts sociaux entre la France et l'Allemagne est-il dû à la politique de modération salariale pratiquée par nos voisins, ou à ce que vous avez qualifié d'« explosion » des cotisations sociales dans notre pays ?
Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE, annoncé par le Gouvernement à la suite du rapport Gallois, devrait bénéficier aux différentes filières industrielles dans des proportions variables. Selon le journal Les Échos, les services aux particuliers seraient les premiers gagnants, les services aux entreprises et le secteur industriel arrivant bien loin derrière. Le Parlement devant se saisir bientôt du sujet, quels critères préconiseriez-vous de privilégier pour ce nouvel instrument ?
Selon le SYMOP, que nous avons entendu tout à l'heure, la France aurait pris beaucoup de retard dans la modernisation de son outil industriel. Pourrait-on plus facilement combler ce retard, selon vous, si le coût du travail était abaissé dans des proportions significatives ?
Pensez-vous enfin que la création d'une bourse réservée aux PME serait de nature à faciliter leur financement ?
La comparaison du coût de travail entre la France et l'Allemagne montre une dégradation depuis dix ans en notre défaveur, dans l'industrie et, plus encore, dans les services. Le niveau de nos prélèvements obligatoires est, d'autre part, parmi les plus élevés d'Europe. Pour résumer, nous sommes mauvais en termes relatifs comme en termes absolus ! C'est pourquoi nous sommes heureux de la prise de conscience suscitée par le rapport Gallois.
Nous pâtissons également d'un cours de l'euro trop élevé par rapport au dollar, ce qui n'est bon ni pour nos exportations ni pour nos emplois. Plusieurs secteurs industriels souffrent ainsi par rapport à leurs concurrents américains d'un désavantage compétitif de l'ordre de 20 %. C'est notamment le cas de l'aéronautique : les transactions sur ce marché se font en dollars…
Comme le préconisait le rapport Gallois, nous serions favorables à ce que le CICE s'applique jusqu'à trois fois et demie le SMIC car il faut faciliter l'embauche de techniciens et d'ingénieurs qui, depuis des années, ont tendance à déserter l'industrie au profit des services et du secteur financier.
Il faut enfin distinguer les emplois de services « tactiques », à la personne, qui créent des emplois mais ne suscitent ni innovations ni exportations, des emplois de services « stratégiques », comme l'informatique, qui permettent l'innovation et se traduisent par des exportations de sorte qu'un emploi créé dans ce secteur en génère plusieurs autres ailleurs. Je comprends qu'on encourage les premiers afin de réduire le chômage à court terme mais seuls les seconds le réduisent durablement.
Selon les estimations que nous avons réalisées avec l'aide de COE-Rexecode, le CICE profiterait, pour quatre milliards, directement à l'industrie, pour le même montant aux services à l'industrie, auxquels nous recourons de plus en plus, et pour un à deux milliards à nos clients, dont le BTP. Ce serait donc environ la moitié de ces vingt milliards qui irait au monde de l'industrie, entendu au sens large. Ce n'est pas si mal. Cela étant, un ciblage sectoriel se heurterait probablement au droit européen et au veto de Bercy.
Le GFI et le MEDEF ont formulé trois demandes concernant le CICE : faute d'élargir sa fourchette jusqu'à trois fois et demie le SMIC, qu'au moins son assiette soit constituée des salaires bruts « chargés », pour ne pas avantager les services au détriment de l'industrie ; qu'on aménage la sortie en biseau, non comme prévu entre deux fois et deux fois et demie le SMIC, mais entre deux fois et demie et trois fois le SMIC ; enfin, que ce crédit d'impôt puisse entrer en vigueur dès 2013, comme l'ont promis le Président de la République et le Gouvernement, ce qui suppose de ne pas poser des conditions réglementaires interdisant de le porter dans les comptes en créance certaine. Dans le même souci, il faudrait d'ailleurs lever une autre incertitude : où les entreprises devront-elles s'adresser pour obtenir les avances ? La BPI ne disposant pas de guichets, sera-ce auprès des banques commerciales, par délégation, ou auprès du Trésor public ?
La modernisation de notre secteur industriel se mesurera à trois critères : l'innovation sous toutes ses formes, l'excellence opérationnelle et la qualité du service aux clients. Nous devons proposer sur le marché des produits de qualité, robustes, livrés en temps voulu et au juste prix. C'est cela qui a fait le succès des automobiles de la marque Audi, de moyenne gamme il y a trente ans et maintenant de haut de gamme, avec un prix de 15 à 20% supérieur à ceux de la concurrence. La règle se vérifie dans tous les secteurs de l'industrie et, par exemple, pour nos connecteurs : la réputation de la marque en matière de qualité et de délais de livraison, et ce sur l'ensemble de la gamme de produits, est devenue fondamentale.
L'avantage concurrentiel résulte de l'activité des bureaux d'études, mais aussi du travail effectué sur les matériaux. Ainsi, chez Radiall, nous sommes passés en trente ans du bronze à l'acier, puis à l'inox, à l'aluminium, au zamac et, aujourd'hui, au composite, et il nous faut réfléchir demain à ce qui prendra la suite. En France, nos laboratoires et nos pôles de compétitivité permettent d'atteindre l'excellence en puisant dans le vivier de l'innovation dont on ne dispose pas forcément en Chine.
Après le choix du bon matériau, vient son traitement – décolletage, traitement de surface, moulage, etc. –, qui exige des équipements adaptés et des process industriels solides. Les Allemands ne s'y sont pas trompés, et se sont montrés experts à combiner sous-traitance et process intégrés de manière à réduire coûts, délais et stocks, afin d'accroître la qualité des produits.
L'innovation ne doit pas seulement s'appliquer à la production brute, mais aussi à la gestion des ressources humaines, déterminante pour la mobilisation, la motivation et l'épanouissement de tous les salariés : c'est le lean manufacturing que je mentionnais tout à l'heure. Quand on est cher, il faut savoir se mettre en « déséquilibre avant », comme des conquérants à la proue des vaisseaux de la conquête des marchés d'aujourd'hui et de demain. Ainsi fera-t-on communier sous la même espèce l'économique et l'humain.
L'excellence opérationnelle suppose d'investir dans l'automatisation, en particulier sur tous les points où il importe de conserver ses secrets de fabrication. Une chaîne de fabrication en série coûte cher mais cette dépense en vaut la peine quand les débouchés sont assurés pour quelques années : elle garantit le respect de la qualité exigée par le client, conformément à la méthode « six sigma ».
Permettant de conserver et d'accroître des parts de marché, la robotisation ne va pas à l'encontre de l'emploi. Cependant, du fait de la variabilité des volumes de production, on ne peut pas tout automatiser. Il est, par exemple, plus facile d'automatiser la production d'automobiles que celle d'armements et d'avions. La diversité des petites séries n'exige pas les mêmes équipements que les grandes séries : aux automates de volume on préférera alors des automatisations de process hybrides ou mixtes.
La bourse n'est pas forcément une bonne affaire pour les entreprises familiales, qui ne cherchent pas une « surcroissance » de 20 ou 25 % par an mais plutôt un développement dans la durée, grâce à des taux de croissance modérés, de 3 à 10 % par an. Dans ce cas, la présence en bourse ne rapporte pas grand-chose, si ce n'est des dépenses supplémentaires, en rapports obligatoires, en honoraires d'analystes financiers, en frais de communication divers… – de 300 000 à 500 000 euros par an pour Radiall, ce qui est beaucoup rapporté à notre chiffre d'affaires de 220 millions d'euros. En outre, cela contraint à une totale transparence vis-à-vis des concurrents qui, quand il s'agit par exemple d'entreprises familiales allemandes, ne livrent rien de leurs affaires et de leur stratégie. Enfin, une fois entré en bourse, on peut difficilement s'en retirer : il suffit qu'un actionnaire « flottant » détenant plus de 5 % du capital fasse preuve de mauvaise volonté pour que vous en restiez prisonnier.
Pour toutes ces raisons, un nouvel instrument de financement à long terme adapté aux PME ne serait pas superflu, à condition qu'on puisse en sortir aussi facilement qu'on y sera entré. À tout le moins, il conviendrait de fixer, pour la proportion de capital flottant, les mêmes seuils à l'entrée et à la sortie. Pourquoi ne pas envisager aussi des introductions en bourse pour une durée limitée, par exemple de cinq ou dix ans ?
Si on parle maintenant de bourse pour les PME, c'est aussi parce qu'on ne veut pas parler des autres leviers de financement qui se sont resserrés. Le premier est le crédit bancaire, auquel elles n'ont pratiquement plus accès, surtout lorsqu'elles sont fragilisées. Espérons que la BPI desserrera un peu l'étau ! Les banquiers essaient de propager l'idée selon laquelle la demande serait inexistante mais, si cette demande s'est tarie, c'est que les entreprises se sont elles-mêmes limitées compte tenu des déficiences de l'offre : volumes trop chiches, taux d'intérêt élevés, durée d'amortissement trop brève, demande de garanties excessives…
À cela s'ajoutent les problèmes de financement en fonds propres : comme l'a dit le président Gattaz, le volume de capital risque a, en France, diminué de moitié.
Du coup, les entreprises s'en remettent à des formules « alternatives » de financement. Elles jouent sur le crédit interentreprises, sur les délais de paiement : les grands groupes n'hésitent pas à presser les PME car l'application de la loi LME, qui n'a jamais été satisfaisante, tend encore à se relâcher. Certaines recourent au marché obligataire, mais il est encore plus fermé aux PMI que la bourse et il faudrait donc envisager de leur en ouvrir l'accès grâce à un cadre légal plus approprié.

Quelle serait pour vous la durée du travail idéale ? Doit-elle être fixée nationalement ou par branche, voire par entreprise ? L'activité économique est cyclique : comment pourrait-on adapter cette durée lorsque le carnet de commandes de l'entreprise se réduit ?
L'entreprise d'aujourd'hui est en quelque sorte prise entre deux tapis roulants : les marchés et les clients, d'une part, et les sciences et les technologies, de l'autre, ne cessent d'évoluer. De plus, elle est confrontée à un environnement mondialisé, producteur de chocs violents : de vraies montagnes russes ! Elle doit donc continuellement s'adapter.
Comment, dans ces conditions, conserver l'emploi en France ? Ce doit être une préoccupation constante : je m'insurge en effet contre l'idée selon laquelle les entreprises auraient pour obsession unique de pouvoir licencier facilement. Former un décolleteur ou un régleur prend cinq ans et investir dans cette formation donne un atout que nous souhaitons bien évidemment conserver. Et puis il s'agit d'êtres humains, de Français… Il faut donc penser tous les matins à ce maintien de l'emploi, mais cela ne suffit pas.
Dans le cas de crises courtes, conjoncturelles, il faut réduire la voilure pour éviter de perdre trop d'argent et donc demander des efforts à tous. La réponse réside par conséquent dans plus de flexisécurité et d'adaptation, locale ou temporaire, en agissant sur trois leviers : l'emploi, la durée du travail et les salaires. Il conviendrait en particulier d'assouplir et de simplifier le recours au chômage partiel, à l'image de ce qui se fait en Allemagne. Mais chaque entreprise est un cas particulier ; c'est donc à ce niveau qu'il faut agir ou, tout au plus, à celui de la branche, en tenant un discours de vérité, en en appelant à la responsabilité collective tout en ouvrant la perspective d'un retour à meilleure fortune : « Nous allons souffrir pendant six mois, un an, mais nous nous en sortirons ! ».
Mais il y a des crises plus graves, qui peuvent entraîner la disparition de tout un marché : ainsi celle des télécommunications, qui a amputé de 40 % le chiffre d'affaires de Radiall. La mondialisation produit souvent de ces à-coups extrêmement brutaux. Licencier est alors inévitable, mais il ne faut pas le faire de façon sauvage. Il ne faut pas condamner nos ouvriers au chômage de longue durée. Cela implique qu'ils aient été formés tout au long de leur vie professionnelle, qu'ils aient amélioré leur qualification, peut-être même qu'ils aient eu l'expérience d'autres métiers : la formation continue est tout à fait cruciale pour garantir cette employabilité.
Si les salariés savent qu'ils retrouveront un emploi parce qu'ils sont formés, leur crainte – légitime – du licenciement en sera atténuée. Inversement, si le licenciement devient plus facile pour l'entreprise et cesse de représenter pour elle un risque juridique majeur, elle redoutera moins d'embaucher. Il faut faire reculer simultanément ces deux peurs qui nous paralysent collectivement depuis des années.
Sur la durée du travail, je n'ai pas de position absolument arrêtée. Il serait bon de l'accroître, non pas pour la porter à 45 ou 50 heures de travail par semaine comme au Mexique ou en Chine, mais pour nous situer dans la moyenne européenne – celle de la plupart de nos concurrents et clients. Je ne sais pas si cette question pourra être abordée dans la négociation en cours entre les partenaires sociaux, qui porte plutôt sur la flexisécurité et sur la sécurisation des parcours professionnels, mais il faudra en tout cas en discuter, de façon sereine et équilibrée.
Certes, la réduction de la durée légale du travail à trente-cinq heures constitue toujours pour le patronat une source de regrets, mais elle n'est plus aujourd'hui pour lui le coeur du problème. Et s'il doit y avoir une évolution sur ce point, elle ne doit pas être négociée au niveau national, mais au niveau des branches ou, mieux encore, des entreprises, seules à même de connaître parfaitement leurs propres besoins.
Le vrai problème réside dans la durée effective du travail et plus précisément, parce que la situation n'est pas si dramatique que cela en ce qui concerne la durée effective hebdomadaire – pour les salariés, elle est de trente-neuf heures et demie, avec une productivité élevée –, dans le volume annuel d'heures effectivement travaillées, qui est inférieur de 260 heures à ce qu'il est en Allemagne. C'est là qu'une décision au niveau national pourrait être pertinente : celle qui consisterait à assouplir le régime des heures supplémentaires. Surtout, il serait bon de s'attaquer à cette spécificité française qu'est l'entrée trop tardive sur le marché du travail, suivie d'une sortie trop précoce. On touche dans notre pays son premier salaire entre vingt et vingt-cinq ans, en Allemagne souvent dès dix-sept ou dix-huit ans, grâce à l'apprentissage ; on reçoit ses derniers salaires en France entre cinquante-cinq et soixante-deux ans, en Allemagne entre soixante et soixante-sept ans. C'est donc bien sur le travail des jeunes et l'apprentissage d'une part, sur le travail des seniors d'autre part, que la réflexion doit porter en priorité. La question de la durée légale hebdomadaire n'est, au regard de cela, qu'une question assez politique.
En tout cas, plus généralement, le terroir français doit être propice au développement économique. Les Allemands raisonnent systématiquement en termes de croissance et d'emploi : ainsi, lorsqu'ils ont constaté que leurs apprentis éprouvaient des difficultés pour se rendre au travail, ils ont abaissé à seize ans l'âge minimum requis pour passer son permis de conduire ; parce qu'ils produisent des berlines haut de gamme, ils ont adapté leur fiscalité et leur réglementation en conséquence, pour créer un marché intérieur important – est-il besoin de rappeler qu'il n'y a pas de limite de vitesse sur les autoroutes allemandes ?
Si la France pouvait enfin mesurer l'importance d'un environnement favorable au développement économique, ce serait merveilleux. Nous souhaiterions ainsi une réglementation sociale, fiscale, environnementale simplifiée et surtout stabilisée. Il est facile de modifier la législation fiscale tous les six mois, mais les investissements dans l'industrie se font à échéance de vingt ou trente ans. Constituer une entreprise patrimoniale prend des décennies ; la vendre à un fonds de pension américain, une après-midi seulement, quitte à ce qu'elle soit ensuite fermée tout aussi rapidement de Palo Alto, parce qu'insuffisamment rentable ! Il est bon que le rapport Gallois ait permis d'ouvrir le débat sur ces sujets. Nous avons impérieusement besoin d'un environnement réglementaire propice à la transformation de nos PME en entreprises de taille intermédiaire, dont nous manquons, mais aussi à la création d'entreprises en France plutôt qu'ailleurs.
Nous avons une Formule 1, mais nous sommes debout sur le frein depuis des années : libérons les énergies ! Le modèle allemand comporte bien sûr certains défauts, mais il est intéressant parce que tout est mesuré dans ce pays à l'aune du développement de l'emploi. La durée du travail est une question qu'il nous faudra traiter de plus en plus dans le cadre de l'entreprise et qu'il faudra régler dans les mois à venir si nous voulons relancer notre économie.
C'est bien difficile à évaluer ! Ce que je peux dire, c'est que lorsque je suis arrivé chez Radiall en 1992, j'avais une vingtaine de concurrents patrimoniaux en France et une quarantaine en Allemagne. Vingt ans après, toutes ces entreprises françaises ont été vendues, achetées, dépecées, en général par des Américains ; toutes les entreprises allemandes existent encore, et se sont même énormément développées. Le constat est terrible. Que s'est-il passé ?
La France a eu du mal à sortir des Trente Glorieuses ; nous avons, c'est un fait, très mal géré les trente années qui viennent de s'écouler. Certains ont vendu leur entreprise plutôt que d'affronter une conjoncture devenue plus difficile, mais les gouvernements successifs et les décideurs en général ont négligé l'industrie, se laissant séduire par le fabless. L'économie du numérique, Internet, c'est merveilleux, certes, mais cela ne flotte pas dans l'air ! Il faut des réseaux, des faisceaux hertziens, des connecteurs… Cela, on l'a oublié – ce qui m'a tellement meurtri que j'en ai fait un livre, Le printemps des magiciens.
En France, il n'est pas facile d'être patron ! Quand on y réussit, on est armé pour réussir partout, me dit-on… J'insiste donc sur la nécessité d'assurer la sérénité en matière fiscale : notre législation n'a pas su protéger les entreprises patrimoniales. Certes, il faut s'attaquer aux horribles spéculateurs, aux 5 % de brebis galeuses ; mais il aurait fallu encourager les 95 % restants. Au lieu de cela, il y a eu l'ISF, les droits de succession confiscatoires… La loi Dutreil a permis, enfin, la transmission des entreprises dans de bonnes conditions.
On sait que nous n'avons pas assez d'entreprises de taille intermédiaires (ETI), c'est-à-dire d'entreprises employant entre 250 et 5 000 salariés : nous n'en comptons que 4 500, contre 12 500 en Allemagne, mais, sur ce nombre, il y en a moins de mille qui soient des ETI industrielles patrimoniales, contre 5 000 à 6 000 Outre-Rhin. Il faut donc aider les PME à devenir des ETI. Pour la plupart, celles-ci ont leur centre de décision en France, et n'agissent donc pas de la même façon que des directions installées à New York ou à Palo Alto.
Sans qu'il soit pour autant question de sombrer dans un ultra-libéralisme débridé, nous devons prendre en compte les contraintes de la mondialisation. On n'élèvera pas de herses autour de notre pays pour le protéger ! La France peut néanmoins trouver une nouvelle harmonie, mais elle devra pour cela faire confiance à ses entrepreneurs et à leurs salariés.
Depuis six mois, le GFI a commencé à mettre en place un observatoire des emplois menacés ; la tâche n'est pas facile, car nous recensons en réalité des situations bien diverses, allant de l'annonce de plans sociaux à la simple menace, voire à la possibilité de tels plans. Il en ressort toutefois une certitude : le chômage continuera d'augmenter en 2013, comme l'a d'ailleurs dit le Président de la République. Les secteurs les plus exposés sont l'automobile, l'ameublement, le textile, et aussi l'agro-alimentaire et la pétrochimie.
Quant à la part de ces emplois dépendant de centres de décision situés à l'étranger, elle est plus difficile encore à évaluer : peut-être un tiers ? En outre, les problèmes peuvent se poser très différemment selon que ces centres sont aux États-Unis, en Chine ou off-shore…

Je ne pensais pas aux seuls licenciements, mais aussi aux nombreuses décisions stratégiques qui influent sur la localisation des entreprises ou qui contribuent à une érosion de l'emploi, hors plans sociaux.
La première urgence pour préserver l'emploi, c'est de s'attaquer au coût du travail : le choc de compétitivité redonnerait un peu d'oxygène aux entreprises et leur rendrait confiance, ce qui leur permettrait ensuite d'innover et d'améliorer la qualité de leurs produits, tous processus qui demandent plus de temps – de six mois à plusieurs années. L'intérêt du rapport Gallois tient certes à la qualité de ses propositions, mais aussi au fait qu'il a permis de parler de ces sujets dans un pays qui n'a pas une forte culture économique.
Compétitivité coûts, compétitivité hors coûts : nous devons ensuite constituer de nouvelles filières et prendre pied sur de nouveaux marchés. D'abord, comme les Allemands l'ont déjà compris, il faudra équiper les pays émergents : Chine, Inde, Russie, Amérique latine… Il y a donc un avenir pour nous ! En second lieu, de nouveaux besoins se font régulièrement jour dans nos propres sociétés – énergie, santé, mobilité, sécurité, développement durable, efficacité énergétique, chimie verte… Pour y répondre, il faut des infrastructures numériques très haut débit et des infrastructures électriques intelligentes, les smart grids. Ce sont là aussi des opportunités gigantesques ! Il faut donc arrêter de dire qu'on n'a pas besoin de réflexion à long terme, de plan, de conseil national ou de ministère de l'industrie. Je ne suis pas bolchevique, vous l'avez compris, mais j'estime que des décisions régaliennes importantes sont nécessaires. Les Coréens ont développé en trente ans dix filières superbes, les Chinois se sont dotés d'une machine de guerre terriblement efficace et aux États-Unis, l'adoption de la National Strategy for Homeland Security s'est soldée par un investissement annuel de 4 milliards de dollars en recherche et développement !
Mais ce n'est pas pour autant que les fonctionnaires de Bercy doivent tout décider : ce sont les entreprises qui savent ce qui est bon pour le pays. Il faut par conséquent rapprocher l'État, les entrepreneurs, les salariés, les chercheurs, et choisir cinq ou dix filières sur lesquelles nous pourrons prendre des positions fortes.
Enfin, il faut encore construire l'Europe.
Voilà de quoi donner un cap à notre pays, et de l'espoir aux Français !

Il semble que la France, lorsqu'elle transpose les directives européennes, ait tendance à ajouter à la complexité de ces textes, quand le législateur allemand ou néerlandais intervient de façon beaucoup plus modeste. L'explication de cette différence tiendrait notamment à ce que les professionnels de ces pays savent mener des actions de lobbying à Bruxelles tandis que leurs homologues français considéreraient que tout se joue en définitive à Paris, lors de l'élaboration de la loi de transposition, et agiraient en conséquence. C'est en tout cas l'un des éléments, bien identifié, qui font que la France a fini par décrocher par rapport à ses concurrents – et cela ne coûterait rien de nous corriger ! Qu'en pensez-vous ?

La compétition au sein de l'espace économique européen ne peut pas obéir aux mêmes règles que la compétition mondiale. Comment la comprenez-vous ? Quelles synergies pourrait-on envisager au sein de l'Union ?
Vous dites ne pas être bolchevique, mais certaines de vos propositions n'évoquent-elles pas la NEP de l'Union soviétique des années vingt ? (Rires.) Cela étant, vos suggestions en faveur du développement de filières – bien éloignées de ce qui se pratique depuis vingt ans – pourraient faire consensus.
Enfin, qu'attendez-vous du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi ?
Sur le rôle du lobbying auprès des instances européennes, monsieur Carré, vous avez tout à fait raison : les entreprises françaises y ont consacré de moins en moins d'efforts, et le travail a été de moins en moins bien fait. Mais c'est aussi un effet de la désindustrialisation.
La norme doit plutôt inciter à innover que décourager et contraindre ; les Allemands en ont pleinement conscience. Les Français ont été moins bons pour édicter des normes qui aident les entreprises au lieu de les brider.
Le rôle des pouvoirs publics est majeur à cet égard, et il serait nécessaire de rapprocher la sphère publique des entreprises. Comme entrepreneur, je souffre de leur défiance mutuelle – défiance que je ne ressens pas à Singapour, aux États-Unis ou en Allemagne. Créer un environnement de confiance est fondamental ! Il serait sans doute bon que les forces vives de la nation, comme on dit, soient mieux représentées au Parlement ; ces deux mondes devraient en tout cas se respecter et se comprendre. On pourrait également imaginer que les élites de la nation, formées dans des écoles prestigieuses, fassent des stages d'une certaine durée dans des PME : cela les conduirait à voir le monde d'un oeil différent.
Notre pays fait beaucoup de choses très bien ; nos atouts sont nombreux. Notre État a la réputation d'être pesant, mais efficace. Mais vous avez raison en ce qui concerne le poids que font peser les directives telles que nous les transposons : en ce qui concerne l'environnement par exemple, c'est un vrai scandale !
Ce que nous voulons, je crois, c'est une France forte dans une Europe forte. Balayons donc d'abord devant notre porte : nous serons influents à l'extérieur si nous sommes forts chez nous.
L'Europe a beaucoup travaillé pour les consommateurs et pour l'environnement ; elle a péché par oubli de l'emploi, des entreprises, de l'industrie, de la recherche. Tous consommateurs, tous verts, mais tous chômeurs : est-ce ce là notre avenir ?
J'aimerais que l'Europe mène une véritable réflexion économique. « Peu importe qu'un chat soit blanc ou noir, s'il attrape la souris, c'est un bon chat », disait Deng Xiaoping. En France, quelle que soit la couleur politique du Gouvernement, il faut faire de l'économie : il n'y aura pas de croissance, pas de social, pas d'environnement, pas d'avenir tout simplement, sans respect des règles de l'économie. Il faut absolument, en toutes circonstances, se poser la question de la création d'emplois : 3 millions de chômeurs, c'est insupportable !
Quant aux filières, je crois effectivement que l'État doit se préoccuper de déterminer quelques domaines où investir, non pas cinquante, mais peut-être une dizaine, cela en se fondant sur une réflexion économique et sur une analyse du marché mondial. Et les retours sur investissement devraient être clairement évalués : dans l'entreprise, si un investissement se révèle non rentable, on l'arrête tout de suite ! Les domaines prometteurs ne font pas défaut : l'aéronautique, la santé, mais aussi le tourisme, domaine dans lequel les États-Unis investissent aujourd'hui massivement.
Cela permettrait de redonner un cap, d'insuffler un nouvel enthousiasme. Que sera la France dans cinq ou dix ans ? Où allons-nous ? C'est l'incertitude sur l'avenir qui est angoissante pour nos concitoyens. Nous faisons beaucoup de choses, mais un peu désordonnées : où est le projet d'ensemble ? Il faut faire au niveau de notre pays ce que nous faisons au niveau de nos entreprises : fixer des perspectives, quitte à demander des efforts. À partir de là, tout suivra : formation, recherche, emploi, voire conquête de positions dominantes !
Membres présents ou excusés
Mission d'information sur les coûts de production en France
Réunion du jeudi 22 novembre 2012 à 10 h 30
Présents. - M. Bernard Accoyer, M. Frédéric Barbier, M. Olivier Carré, M. Laurent Furst, M. Daniel Goldberg, M. Jean Grellier, M. Michel Lefait, M. Claude Sturni
Excusés. - Mme Marie-Anne Chapdelaine, Mme Annick Le Loch, M. Olivier Véran