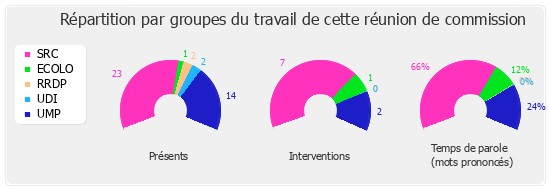Commission des affaires étrangères
Réunion du 23 janvier 2013 à 9h30
La réunion
Table ronde sur la Russie avec Mme Marie Mendras, chercheuse au CNRS et professeure à l'Institut d'études politiques de Paris, et M. Pierre Morel, ancien ambassadeur en Russie
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Nous accueillons aujourd'hui deux éminents connaisseurs de la Russie. Mme Marie Mendras, chercheur au CNRS et au CERI, a beaucoup écrit sur la Russie contemporaine, je renvoie notamment à l'un de ses derniers livres «Russie. L'envers du pouvoir ». M. Pierre Morel a été conseiller du président François Mitterrand dans les années 1980, avant de devenir ambassadeur à Moscou puis à Pékin ; il a été tout récemment le représentant spécial de l'Union européenne pour l'Asie centrale et pour la crise en Géorgie.
Notre commission a confié à deux de ses membres, Mme Guittet et M. Mariani, une mission visant à répondre aux nombreuses interrogations et incertitudes que suscite la Russie en France et chez nos partenaires européens.
Les relations franco-russes présentent à la fois des points de convergence, comme sur le Mali, et des antagonismes assez forts, comme sur la Syrie. J'espère que nos invités pourront nous éclairer sur les fondements de la position russe face à ces crises.
La dégradation de l'image de la Russie dans l'opinion publique française est frappante, malgré des liens culturels et historiques anciens et très vivaces entre nos deux pays et une très grande estime réciproque entre nos deux peuples. On constate la même évolution en Europe, comme le montre notamment la résolution votée il y a deux mois par le Bundestag.
Les négociations européennes sur le renouvellement du partenariat avec la Russie sont enlisées depuis des années, ce qui donne le sentiment qu'il n'y a pas de politique européenne vis-à-vis de ce pays. Les différends portent notamment sur la question énergétique, sur la situation économique de Gazprom et sur le fait que les pays européens se présentent en ordre dispersé, mais le malaise n'est-il pas plus général ? Comme beaucoup de mes collègues, je déplore que l'Union européenne ne parvienne pas à élaborer une véritable politique commune vis-à-vis de ses partenaires extérieurs. Nous attendons beaucoup, chers invités, de vos avis sur ces sujets.
Derrière ces incertitudes se posent des questions de fond. Quelle est la nature réelle du régime du président Poutine et quelles sont ses perspectives d'évolution, s'il y en a ? Quelles sont la réalité et la pérennité de la puissance russe ? La Russie est-elle encore une grande puissance – car la diplomatie fait la part du réalisme et il est de fait que notre comportement varie en fonction de la puissance de nos interlocuteurs ? Que pensent les Russes de l'Union européenne ?
Je vous laisse la parole pour un exposé liminaire, après quoi nos collègues vous poseront des questions.
Je suis heureuse de pouvoir partager avec vous mes réflexions sur la Russie, et me réjouis de le faire avec M. Pierre Morel, qui a été un ambassadeur remarquable et très accueillant pour les chercheurs qui pouvaient alors s'aventurer sans permission ni visa sur les terres russes durant l'exaltante période de découverte que furent les années Eltsine.
L'un des paradigmes forts de la Russie tient à sa complexité et à sa diversité. Il n'y a pas de Russie « moyenne », mais une Russie plurielle, de plus en plus disparate, inégale et fragmentée. La vision que les Russes ont de l'Europe, de la Chine et du Japon à Vladivostok est très différente de celle qu'ils peuvent en avoir dans le Sud-Ouest du pays, près du Caucase ou en Carélie. Cette complexité est précisément ce qui justifie mon travail de chercheuse et d'universitaire.
Poser en quelques minutes les grandes questions de politique étrangère et intérieure de la Russie est un défi. Dans un article de la revue Commentaire qui vous a été distribué, je souligne que, pour comprendre la pensée et les comportements des dirigeants russes en politique extérieure, il est indispensable de comprendre leur conception de leur propre pays et leur conception des défis internes dans les domaines politique, économique, social et culturel, ainsi qu'en matière de sécurité. Cette observation vaut certes pour tous les pays, mais elle est encore plus vraie pour la Russie qui est, pour citer l'économiste finlandais Pekka Sutela, non pas tant un pays émergent qu'une ancienne superpuissance qui a échoué.
Il importe d'autant plus de comprendre le mode de pensée des dirigeants russes que la Russie n'est pas un pays démocratique, mais autoritaire et personnalisé, où l'opinion publique n'a pratiquement pas d'influence sur les choix de politique étrangère.
La Russie est aujourd'hui gouvernée par un régime contesté, sur la défensive, qui a peur du changement, peur de l'autre, peur de l'imprévu et peur du risque. Or, à l'époque où nous vivons, on ne choisit pas le risque et le rythme s'est accéléré : pour les dirigeants de Moscou, l'imprévu est bien plus important aujourd'hui qu'il y a quarante ans. La question du rythme, du temps et de l'espace est donc au coeur de la problématique russe.
L'an dernier, la contestation des élections et la mobilisation d'une partie de la société et des élites ont montré qu'un écart se creuse entre, d'une part, une direction politique et des groupes dirigeants qui résistent au changement pour préserver leur position et, d'autre part, une partie de la société et des élites – entendues cette fois en un sens plus large – qui souhaitent certains changements et sont inquiètes de la difficulté qu'éprouve le régime à innover et à moderniser le pays.
La Russie possède un potentiel considérable, mais elle pourrait l'utiliser beaucoup mieux – c'est là un effet de la « malédiction du pétrole », qui réduit la capacité des dirigeants à opérer des réformes lorsque l'argent afflue sans effort dans les caisses de l'État. Dans tous les pays, la réforme implique pour la classe dirigeante un peu de risque – et un peu plus encore dans un pays autoritaire qui ne dispose plus des relais, des dynamiques sociales et de l'esprit entrepreneurial qui peuvent, ailleurs, porter le changement sans que les réformes viennent d'en-haut.
Mon analyse de la politique russe actuelle s'organise autour des limites d'un régime conservateur et autoritaire de moins en moins légitime. En un temps où le monde change, les 140 millions de Russes sont presque tous connectés, directement ou par l'Internet, avec le monde extérieur – jusqu'à la grand-mère qui, dans sa campagne, sait par ses petits-enfants et par les nouvelles formes de communication que Vladimir Poutine n'a pas été élu honnêtement.
En désignant, en mars dernier, le nouveau mandat de Vladimir Poutine comme son « quatrième mandat », je tenais à souligner que, pendant le mandat présidentiel de Dimitri Medvedev, Vladimir Poutine était resté le chef tout-puissant de l'exécutif et qu'il exerçait donc en réalité un troisième mandat, en qualité de Premier ministre. En août prochain, V. Poutine sera au pouvoir depuis 14 ans !
Deux grandes questions se posent, qui portent respectivement sur la politique intérieure et extérieure : les dirigeants russes peuvent-ils et veulent-ils moderniser leur pays ? La Russie peut-elle et veut-elle être un partenaire actif de la France, de l'Europe et de la communauté internationale ?
En politique intérieure, les dirigeants russes ont-ils un projet et, s'ils n'en ont pas, peuvent-ils encore consolider leur pouvoir politique, économique et financier sans propositions pour l'avenir et sans une dynamique de changement ? Cette question est au coeur des événements politiques des 18 derniers mois et, au vu des témoignages que je reçois quotidiennement, occupe de plus en plus les esprits, non seulement au Kremlin, dans les administrations et parmi les conseillers des dirigeants, mais aussi au sein des classes moyennes. Ces dernières commencent à être saisies par le doute, alors que le régime de Poutine bénéficiait encore, voici quelques années, d'un fort soutien, dû en grande partie à la hausse constante, de 2001 à juillet 2008, du prix des matières premières.
Pour la première fois, les Russes sont devenus des consommateurs et ont pu commencer à faire des projets. Tandis que certains entrepreneurs pouvaient s'organiser, d'autres étaient mis en prison, comme Mikhaïl Khodorkovski, le pouvoir tenant à garder le contrôle non seulement de l'exploitation des matières premières, mais aussi de leur vente et de tous leurs revenus – rappelons que plus de 75 % des revenus d'exportation de la Russie proviennent de la vente de matières premières. Dans le dernier rapport d'analyse de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), en date de décembre dernier, l'économiste en chef de cette institution écrit que « la Russie continue de suivre un modèle de croissance basé essentiellement sur des matières premières. L'expérience internationale montre que de telles politiques conduisent à un ralentissement de la croissance à long terme. De plus, ces politiques sont très souvent associées à des institutions faibles et à une distribution inégale des revenus et de la richesse ». C'est le paradoxe de l'État faible, qui se caractérise par des institutions publiques faibles et des réseaux forts. Nos gouvernements ne font pas assez la distinction entre l'État russe, c'est-à-dire les institutions publiques, et le pouvoir poutinien. Or, si les deux fonctionnent parfois en symbiose, Poutine s'est affirmé en affaiblissant les institutions publiques – qu'il s'agisse de la justice ou de la Douma d'État – chambre basse du Parlement.
Il existe en Russie une imbrication étroite entre les aspects politiques et les aspects économiques et financiers. La plupart des personnages les plus importants du régime sont aussi – ou ont été – à la tête des très grandes entreprises, notamment de celles qui exportent des matières premières : il est donc difficile de séparer oligarchie économique et oligarchie politique.
En matière de politique étrangère, un État non démocratique ne se comporte pas comme un État démocratique. De plus, une ancienne puissance qui souhaiterait l'être encore ne raisonne pas comme un pays ordinaire.
Vladimir Poutine et les hommes, peu nombreux, qui le conseillent sur la politique étrangère, considèrent que le monde extérieur est hostile et qu'il faut se protéger de son influence politique, mais que la Russie en a néanmoins besoin pour assurer son développement économique – à tout le moins les rentrées budgétaires de l'État – et pour consolider une sphère de sécurité nationale et, selon l'expression employée par Dmitri Medvedev lorsqu'il était président, la sphère des intérêts privilégiés de la Russie, c'est-à-dire les républiques qui faisaient précédemment partie de l'URSS et qu'évoquera tout à l'heure l'ambassadeur Morel.
Le pouvoir russe affiche une vision protectionniste, quelque peu craintive et défensive, car l'influence de l'extérieur a toujours un effet sur les sociétés et sur les économies, et donc aussi sur les régimes politiques. Le protectionnisme intérieur implique une forme de protectionnisme en politique étrangère. Il y a là une certaine contradiction pour un pays qui veut aussi avoir une place importante en Europe et en Asie, comme au Sud de ses frontières et à l'ONU, et participer à une forme de gestion de certains grands dossiers avec les États-Unis pour sauver un partenariat privilégié qui remonte à l'époque de la guerre froide. Aujourd'hui encore, la Russie ne peut prétendre être une grande puissance que parce que les États-Unis et les institutions des Nations Unies reconnaissent structurellement qu'elle en est encore une.
La Russie a donc soif de reconnaissance, mais chaque fois qu'elle a l'occasion de jouer un rôle positif et d'imprimer sa marque sur un dossier pour le faire avancer, elle hésite avant de le faire ou s'y refuse, comme c'est le cas pour la Syrie. Les facteurs qui l'expliquent sont nombreux : la crainte à Moscou de la nouvelle chute d'un dictateur ami, le refus de soutenir la position occidentale, de surcroît partagée par la Ligue arabe, la question iranienne, l'indifférence devant l'extrême violence et le désastre humanitaire.
Une autre contradiction réside dans la relation ambivalente qu'entretiennent les dirigeants russes avec la Chine et avec l'Europe. Cette contradiction, que j'observe depuis des années, a été particulièrement visible lors de l'intervention militaire russe en Géorgie, en août 2008. Alors que la Russie s'efforce de combler son retard dans la relation avec la Chine, elle manifeste un réel tropisme vers l'Europe et l'Occident. C'est là une bonne nouvelle, malgré une rhétorique assez pénible pour les pays membres de l'OTAN, de savoir que la société russe et ses élites voient et continueront de voir en l'Europe la région la plus proche, la plus amie et la plus à même d'accompagner les transformations de leur pays.
En passant le témoin à M. Pierre Morel, je soulignerai enfin que, si nous sommes conscients du besoin et du désir des Russes de vivre en bonne intelligence avec les pays européens, nous sommes confrontés à un défi politique et économique majeur en ce qui concerne les pays de l'entre-deux, ou « pays sandwiches » – les six États du « partenariat oriental » de l'Union européenne : Biélorussie, Ukraine, Moldavie, Arménie, Géorgie et Azerbaïdjan –, qui jouissent d'une souveraineté faible dont la Russie se satisfait fort bien, quand elle n'en joue pas. Ces pays se voient ainsi privés de perspectives de se développer sur le plan économique et social et en tant qu'États de droit. Nos gouvernements et l'Union européenne devraient aborder avec plus de dynamisme la question des relations avec ces pays et de l'avenir de ces derniers.
Si la relation franco-russe mérite une attention privilégiée, c'est qu'elle a une histoire millénaire, ayant survécu à toutes les vicissitudes de nos pays respectifs. Cette relation a contribué à la formation du monde contemporain, des grands débats de la guerre froide – que la France a marqués avec le triptyque « détente-entente-coopération » – à la collaboration scientifique et spatiale. Aujourd'hui encore, sa dimension stratégique et opérationnelle lui donne une importance particulière.
La relation fut d'abord économique. Dès l'époque du général de Gaulle, la Grande et la Petite Commission avaient porté des initiatives remarquables ; la coopération a pris depuis des formes différentes, notamment au sein du Conseil économique, financier, industriel et commercial (CEFIC). Les dernières années ont également vu se développer une véritable relation politique et stratégique, marquée par les rencontres régulières des ministres des affaires étrangères et de la défense russes et français. Les liens ne concernent pourtant pas les seules autorités, l'échange entre nos sociétés respectives étant également très vivant, comme en attestent, entre autres, les années France-Russie 2010 et 2012 ou, par exemple, la récente exposition sur l'intelligentsia de nos deux pays.
Le 24 septembre 2011, le Premier ministre Vladimir Poutine annonçait qu'il se présenterait pour un troisième mandat présidentiel. Si celui-ci ne mérite pas, à mes yeux, d'être qualifié de quatrième, c'est que je souscris à la formule employée par un spécialiste russe pour lequel, à l'époque de la présidence Medvedev : « Il n'y [avait] pas deux pouvoirs à Moscou, mais un et demi ». Le partage des tâches entre un président tourné vers la classe moyenne et la jeunesse, et un premier ministre faisant appel aux tréfonds du pays, avait, en effet, introduit une certaine complexité au sein de l'exécutif. Malgré l'argument de la nécessité de prolonger l'effort, avancé par M. Poutine, l'annonce de la permutation a dès lors été perçue par les Russes comme un « roque » témoignant d'un déni de respect. C'est donc avec grande vigilance que la population a abordé les élections législatives, la tension entre la base et les autorités se traduisant ensuite par des manifestations.
L'évolution de ces manifestations est remarquable. La première, organisée au lendemain des élections, prit la forme d'une action de protestation classique, et fut gérée par les forces de l'ordre avec la rudesse habituelle. En revanche, la manifestation massive du 10 décembre 2011 fut marquée par l'importance des réseaux sociaux dans la mobilisation et par le souci des autorités d'éviter les violences. Les deux parties prenantes ont donc fait appel à de nouvelles ressources et méthodes, cet échange de signaux entre la population et le pouvoir témoignant d'une nouvelle forme de gestion du mécontentement.
Certains s'attendaient alors à revivre à Moscou un équivalent de la place Tahrir ; si rien de tel ne s'est produit parce que le contexte n'était pas le même, le parallèle peut être esquissé. Dans les deux cas, on a assisté à une explosion civique sans force politique structurante, les partis russes d'opposition restant incapables de proposer un autre gouvernement. Malgré le reflux de la mobilisation, ces manifestations représentent un tournant, dans la mesure où elles signent l'émergence d'une classe moyenne politiquement disponible, d'un hyperconsommateur prêt à redevenir citoyen.
Si M. Poutine a souhaité briguer un troisième mandat, c'est que le poste de président donne des fonctions différentes de celui de premier ministre, même au sein d'un tandem aussi contrôlé. De retour à la tête du pays, il engage la Russie sur la voie d'une logique autocentrée, celle d'une politique de puissance dans un jeu multipolaire. Il ne s'agit plus de courir après le rêve d'une reconquête complète de l'influence d'antan. Le monde extérieur est perçu comme menaçant, difficile et n'offrant pas à la Russie beaucoup de perspectives, ce qui exige un recentrage et une remobilisation des forces russes. Cette vision assez dure est marquée par le sentiment d'urgence, la vigilance, une certaine nostalgie, la volonté de retrouver sa propre histoire et d'en dépasser les césures, et de faire appel à la dimension morale. Il s'agit, en somme, d'un redéploiement du patriotisme, la personnalité de M. Poutine lui conférant une dose d'intimidation, voire de sarcasme, dont on est familier depuis son discours à Munich. Celui qu'il a prononcé le 12 décembre dernier insiste ainsi sur la nécessité de « dé-offshoriser » la Russie : alors que les forces vives sont aujourd'hui dispersées, que des centaines de milliers de Russes vivent et travaillent à l'étranger, il faut concentrer les forces dans un jeu à la fois solitaire et multipolaire, impliquant un partage du travail entre plusieurs puissances.
Cette vision explique le pragmatisme offensif dont fait preuve la diplomatie russe : tout doit être négocié, rien n'est automatique, et la capacité de riposte fait partie des atouts sur lesquels il faut compter. C'est ainsi que la position russe sur la Syrie constitue une réponse à la guerre en Libye. Il y a eu, semble-t-il, divergence entre le président Medvedev et le premier ministre Poutine au moment du vote de la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations unies ; et lorsque M. Poutine a repris les commandes, il a tenu à afficher le retour à cette ligne « réalpoliticienne ».
La situation dans le Caucase du Nord compte pour beaucoup dans ce surcroît de vigilance. Après la Tchétchénie, le Daghestan – où les assassinats se multiplient – souffre d'un problème d'autorité majeur. La tentative de mettre en place un plan de modernisation économique de cette région – désormais plus intégrée, avec la nomination d'un vice-premier ministre résidant sur place, M. Khloponine – n'a pas réglé la question. L'« émirat du Caucase » du chef terroriste Dokou Oumarov dispose d'un millier de combattants semble-t-il, mais avec des ramifications, comme en témoigne l'attentat de juillet dernier au Tatarstan – république riche et paisible –, où le mufti adjoint a été assassiné. La perspective des Jeux olympiques de Sotchi, en 2014, constitue un défi sérieux, alors que les zones proches – la Kabardino-Balkarie et la Karatchaï-Tcherkessie – sont en proie à de fortes tensions. Cette situation intérieure n'est pas étrangère à la vision réaliste – voire hyperréaliste – du rapport des forces dans le monde contemporain, que porte aujourd'hui la Russie.
La CEI constitue une zone d'intérêts privilégiés pour la Russie, et celle-ci est prête à aller jusqu'au conflit militaire lorsque cela est nécessaire. La guerre en Géorgie, en août 2008, l'a amplement démontré, avec la reconnaissance consécutive de l'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud – pratique que la Russie évitait, par crainte d'éclatement du Caucase. La CEI représente un espace stratégique : dès lors que l'on adopte une logique multipolaire, il faut avoir maîtrisé son espace et son environnement. L'immigration et la sécurité font également partie des enjeux ; réservoir de main-d'oeuvre vitale pour un pays qui connaît un déclin démographique, la CEI est également une région où l'importance de l'islam va croissant, la frontière du Sud étant ponctuée de foyers de crise et d'incertitudes. Elle garantit un complément indispensable en matière énergétique, car les grands gisements russes n'ont pas été suffisamment exploités pour en récupérer toute la ressource. Plusieurs pays de la CEI jouxtent enfin l'Afghanistan – souvenir douloureux, mais aussi réalité tragique en matière de drogue. Le responsable de l'agence fédérale de contrôle des drogues, M. Ivanov, fait état de 30 000 morts par an par héroïne, avec sans doute plus d'un million d'héroïnomanes. La perspective du retrait des troupes de l'OTAN en 2014 préoccupe particulièrement la Russie.
La CEI est au centre du projet d' « Union eurasiatique », porté par la Russie. Lancé au moment de l'annonce de la nouvelle candidature de M. Poutine, en septembre 2011, ce thème a été repris pendant la campagne présidentielle. Il s'agit de partir de l'Union douanière et du marché intérieur unique que représente la Communauté économique eurasiatique (EURASEC) pour aller, à terme, vers un projet politique, sur le modèle de la Communauté, puis de l'Union européenne. Beaucoup d'anciens membres de la représentation de la Russie auprès de l'UE sont d'ailleurs désormais envoyés auprès des services de cette nouvelle structure, afin d'y apporter leur connaissance des règlements et des modes de définition de normes communes européennes, ce qui montre la volonté de créer un système efficace. Le projet de nouvelle union ne concerne d'abord que la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan, mais les autres pays d'Asie centrale – hormis l'Ouzbékistan, très opposé – savent que leur adhésion est, à terme, inéluctable, même s'ils en retardent l'échéance. L'adhésion du Kirghizistan et du Tadjikistan offrirait en effet l'opportunité de créer un espace économique unique face à la Chine ; l'adhésion de l'Ukraine, en revanche, bien qu'étant sans doute l'objectif principal du projet, reste incertaine.
Le Grand Nord représente un autre projet important de ce troisième mandat. Dès 2007, la Russie avait planté son drapeau sous la calotte de l'Arctique ; l'an dernier, l'expédition Arktika s'est livrée à une véritable exploration, au moyen de sous-marins spécialement équipés, montrant, si besoin en était, que la Russie ne manque pas de ressources dans ce domaine. Avec l'ouverture croissante de la route du Nord-Est à la suite du réchauffement climatique, RosAtomFlot peut espérer qu'un jour, les brise-glace russes de Mourmansk deviendront plus rentables que le passage par le canal de Suez. Cette ambition – qu'il ne faut pas ignorer – est à relier à l'opération Rosneft. Cette compagnie vient de passer une alliance avec BP, après la confrontation majeure qui avait opposé, pendant des années, au sein de TNK-BP, cette grande société internationale à des oligarques russes. Au terme de cet accord où TNK-BP passe des mains de l'oligarchie à une firme d'État, M. Setchine – ancien vice-premier ministre et proche du président Poutine, désormais à la tête de Rosneft – récupère des capacités technologiques considérables, tout en permettant à BP de redorer son image après les ennuis que la compagnie a connus dans le golfe du Mexique. Cette opération intervient dans un contexte de redistribution énergétique où Rosneft prend ses distances par rapport à Gazprom, envisageant pour la première fois l'utilisation du gaz associé par les compagnies pétrolières, que le monopole de Gazprom rendait, jusque là, impossible. Près d'un tiers des exportations potentielles de gaz était ainsi perdu dans ces torches que l'on aperçoit lorsqu'on survole la Russie de nuit. Le projet autour du Grand Nord est donc à relier à celui de maîtrise de l'espace stratégique russe.
En matière de politique étrangère et de sécurité, la Russie investit méthodiquement dans l'approche multipolaire, cherchant à définir une ligne autonome. Cette position l'amène, pour le moment, à jouer – au moins en façade – la carte asiatique, à travers sa relation avec la Chine. Comme l'a souligné Marie Mendras, la Russie ne se fait aucune illusion quant au risque chinois ; mais à court terme, elle estime plus avantageux de se ranger du côté des BRICS. Son rapport aux États-Unis devient, en effet, de plus en plus critique depuis que l'opération « Reset » – redéfinition de la relation russo-américaine – semble avoir montré ses limites, et surtout depuis la guerre en Libye.
En même temps, le pays mène un programme de modernisation des forces armées, sur fond de débats intérieurs. En témoignent le limogeage du ministre de la défense, M. Serdioukov, et l'achat des Mistral qui montre que les dirigeants mesurent les limites d'une industrie militaire trop enfermée dans ses habitudes, réflexes et complicités, et souhaitent la secouer. Ces efforts, qui visent à reconstruire la capacité militaire du pays, sont mal perçus à l'extérieur ; ils participent pourtant de cette vision âpre des relations internationales où tout est négociable – jusqu'aux accords nucléaires antérieurement passés –, comme le prouvent les tensions autour des accords nucléaires conclus entre les Etats-Unis et la Russie..
Suivant cette logique de négociation permanente, la Russie peut se retrouver – aux yeux des pays occidentaux – du bon comme du mauvais côté. Dans le conflit syrien, elle est ainsi dans une logique d'opposition, l'évolution sur le terrain pouvant toutefois finir par l'obliger à rechercher un compromis ; sa position sur l'Iran est un mélange d'opposition et de coopération ; sur l'Afghanistan, enfin, offre un exemple de coopération indéniable, qu'il convient de noter si l'on cherche à avoir une vision équilibrée du rôle de la Russie sur la scène internationale. Au moment du blocage complet des routes du Pakistan, la remarquable mise en place par les Etats-Unis et l'OTAN du « réseau de distribution du Nord » – Northern Distribution Network – a permis le transfert transcontinental du ravitaillement des forces de la coalition du port de Ventspils, près de Riga, à Mazar-e-Charif. Il implique une traversée par voie ferroviaire avec des compléments aériens, ainsi que des relais par route dans certains aéroports. Cette collaboration est un des bénéfices substantiels, mais encore méconnus, de l'opération « Reset », et elle restera vitale durant le retrait de la coalition, qui prendra des mois, voire des années, et sera très complexe. L'attitude de la Russie à l'égard des événements au Sahel est également a priori positive. En Amérique latine toutefois, sa relation avec le Venezuela d'Hugo Chavez suscite des interrogations.
Pourtant, même si la Russie cultive l'orientation « asiatique » et s'est attachée au jeu multipolaire, je rejoins Marie Mendras dans l'idée que ce pays reste fondamentalement tourné vers l'Europe. Il suffit d'ailleurs de voir où sont les Russes : s'il y a, depuis toujours, un petit quartier russe à Pekin, abritant des commerçants habiles qui pratiquent la navette entre les deux pays, cette présence est sans commune mesure avec celle des Russes en Occident, où l'on accueille une bonne partie de leurs élites. Lorsqu'on réfléchit, en Russie, à l'opportunité de partir à l'étranger, c'est à l'Ouest que l'on pense en priorité, même si apparaissent, depuis peu, des trajectoires plus originales. Sans minimiser ces tendances, la vocation fondamentale de la Russie est de retrouver les chemins d'une grande politique européenne, dans laquelle la France aurait un rôle à jouer, au sein d'une démarche coordonnée au sein de l'Union européenne.

En tant que président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, je me réjouis de la présence de Russes de bonne compagnie dans ma région. L'attitude parfois rude que l'on a vis-à-vis de la Russie ne renforce-t-elle pas une réaction de fierté blessée nourrissant le nationalisme, qui fait l'affaire du pouvoir de Poutine ? Ne portons-nous pas, dès lors, une part de responsabilité dans son maintien au pouvoir ?

D'après votre exposé, Monsieur l'Ambassadeur, la politique intérieure comme extérieure de la Russie obéit à une même logique : préserver les intérêts russes en utilisant la position déterminante du pays dans le monde multipolaire, qui lui donne le pouvoir dire « non » et, de temps en temps, de se rapprocher de l'un ou l'autre des camps, jouant de cette possibilité comme d'un chantage.
Existe-t-il aujourd'hui une opposition intérieure réelle et structurée à Vladimir Poutine qui incarne, à lui seul, le pouvoir en Russie ? Dès lors que les 140 millions de Russes commencent à sourire au monde extérieur, peut-on espérer – et à quel terme – une évolution plus démocratique de ce pays ?

Les Russes semblent, en effet, se sentir très européens, d'autant que l'essentiel de la population se concentre dans la partie européenne du pays, et qu'il existe une communauté d'esprit importante avec l'Europe, qui excède le seul aspect culturel.
À côté de l'obsession de la puissance impériale, celle de la faiblesse démographique est non moins cruciale. Avec ses 140 ou 150 millions d'habitants, la Russie peut faire le poids face à l'Europe, mais non face à la Chine.
Jusqu'aux années 2008 ou 2009, la Russie avait tenté de faire de l'énergie un véritable levier de sa diplomatie de puissance. Elle n'y est pas parvenue, en particulier à cause de la crise qui a montré que le pays était touché par le syndrome hollandais – la malédiction du pétrole. Les Russes ont alors essayé de faire du chantage à l'égard des Occidentaux, les menaçant de livrer leur pétrole et leur gaz aux Chinois – mais les pas concrets réalisés dans cette direction ont été peu nombreux. Peuple fantasque, les Russes sont animés, en matière de politique internationale et énergétique, par plusieurs fantasmes. Le passage du Nord-Est en est un depuis longtemps. Autre fantasme : celui du gaz naturel liquéfié (GNL) – en particulier celui du gisement Chtokman – que les Russes avaient imaginé, un temps, exporter aux États-Unis, avant de s'apercevoir du caractère chimérique du projet. Cette succession de fantasmes aboutit à une politique énergétique incohérente. Si Poutine a repris les choses en main, au sein d'une commission présidentielle sur l'énergie, la politique énergétique russe apparaît beaucoup trop centralisée, la Russie souhaitant toujours s'en servir comme d'un levier de sa politique diplomatique.

En tant que présidente du groupe d'amitié France-Russie et rapporteure de cette mission d'information, je vous remercie, Madame, Monsieur, pour vos exposés passionnants.
En matière de politique extérieure, quelles conséquences pour les relations russo-américaines aura le vote, par la Douma, de la loi sur l'adoption, dite loi Iakovlev ou loi anti-Magnitski ?
Les relations de la Russie avec le monde sont marquées par un éloignement idéologique – si l'on a longtemps cru que la Russie allait se rapprocher du modèle européen, cette époque est révolue – et par une volonté de compter sur le plan économique. Le rapprochement et la coopération économiques sont réels, par exemple dans le lancement des satellites. En adhérant à l'OMC, la Russie souhaite donner plus de poids aux BRICS, et notamment modifier les quotas du FMI pour renforcer le pouvoir de ces pays. Comment jugez-vous ces objectifs, et quelles sont leurs chances de réussite ?
Sur le plan intérieur, la Russie a récemment voté une grande loi sur l'éducation ; contrairement à ce que prévoit la Constitution russe, les différentes confessions auront désormais le droit de participer à l'élaboration des programmes scolaires d'histoire des religions et d'éthique. Quelle est votre opinion sur cette implication de plus en plus forte de l'Église dans les affaires d'État ?

Quelle est la situation militaire de la Russie ? Est-elle encore une grande puissance militaire, en termes de matériel, d'effectifs, de compétences et d'innovation ?
Dans un colloque sur les échanges commerciaux entre la Russie et la France, Jean-Pierre Chevènement a affirmé que la Russie ne peut connaître de basculement brutal car elle vit actuellement les Trente glorieuses, entrant dans un cycle de consommation intérieure ; si les crises restent possibles, elles ne sont pas idéologiquement encadrées. Il estime également que la vision que nous avons de Poutine est caricaturale, car s'il n'est pas un grand démocrate, il n'est pas le dictateur que l'on dépeint ici.

Que reste-t-il de l'URSS dans la conduite de la politique extérieure russe ? J'y vois, pour ma part, une grande continuité. À ce propos, comment le Kremlin voit-il Berlin, Paris et Pekin, ainsi que le problème islamique ?
Monsieur Guillet, la politique énergétique russe n'est pas complètement incohérente. Les « huit glorieuses » – années exceptionnelles qui ont suivi l'avènement au pouvoir de Vladimir Poutine – avaient quelque peu faussé le jugement, tout en enfermant la Russie dans la logique d'exportation des matières premières et de l'énergie. Cette phase très favorable aurait pu permettre d'augmenter les investissements et de moderniser l'appareil de production ; si elle a permis de récupérer des ressources au-delà des frontières – dans les pays d'Asie centrale notamment –, la rénovation des puits et le forage ont souffert d'un sous-investissement manifeste, la priorité ayant été donnée au maintien d'un prix bas de l'énergie pour la satisfaction de la population. Le statut de monopole dont disposait Gazprom avait verrouillé ce système ; mais la nécessité de se procurer les nouvelles technologies, indispensables au développement de la production dans le Nord sibérien et dans le Grand Nord, peut redistribuer les cartes. Gazprom pèse lourd dans les orientations de la Russie, amenant un lot de confrontations. Le gazoduc Nord Stream a ainsi constitué la riposte au risque de pression de la part de l'Ukraine – alors même que ce pays évoluait dans un sens pro-russe –, et le projet South Stream, consistant à bloquer l'idée du quatrième corridor énergétique européen, en est la continuation logique. Le gazoduc Transcaspien finira par aboutir – l'accord sur la construction du Trans-Anatolian Pipeline (TANAP) vient de montrer qu'au moins pour le gisement Shah Deniz II, les choses s'amorcent – mais la Russie bloque délibérément, avec les propos les plus catégoriques, la traversée de la Caspienne pour le gaz turkmène. Sa démarche est donc marquée par une certaine cohérence, même si elle nous paraît à courte vue.
Quant au GNL, la Russie n'était pas seule à parier sur cette technologie, à une époque où l'on ne connaissait pas encore les opportunités en gaz de schiste. Pourtant, si Total s'est engagé sur l'exploitation du gisement Chtokman, c'était moins pour le GNL russe, que pour assurer la poursuite de l'approvisionnement européen. La situation est donc volatile, mais la ligne russe est maintenant assez claire.
Même si les initiatives de l'UE sont, en effet, globalement modestes, l'Europe s'est fait entendre à propos du « troisième paquet énergie ». La ligne selon laquelle Gazprom, ayant accès au marché européen, doit en respecter les règles, crée une tension sérieuse avec la Russie, évoluant vers un contentieux. Ce problème finira par être réglé, car l'exigence n'est en rien anti-russe ; les règles sont les mêmes pour tout le monde, et mettre Gazprom au régime général n'a rien d'anormal. Mais cette politique de l'UE remet en cause l'avantage structurel que la Russie pensait avoir par rapport aux pays européens consommateurs, et le levier considérable que représentait pour elle la dépendance énergétique quasi-complète des pays d'Europe de l'Est et des Balkans.
Cependant, l'UE a fait un premier pas vers une politique énergétique commune : les interconnecteurs permettent désormais – y compris grâce aux efforts de l'Allemagne qui a compris qu'elle devait compenser le choc qu'avait constitué Nord Stream – des transferts de gaz à l'intérieur de l'espace européen, inexistants au moment des embargos de janvier 2006 et de janvier 2009. Les choses commencent donc à se structurer, et il est bon que ce point difficile soit au centre du débat entre l'UE – qui remplit son rôle – et la Russie.
Madame Guittet, l'appartenance de la Russie aux BRICS – sur laquelle elle a, en effet, joué – est un élément de façade. Ces cinq ou six pays émergents – ou qui se présentent comme tels – sont profondément différents, et il serait insensé pour nous, Français, de ne considérer la Russie qu'en tant que membre de ce groupe. Ramener à cette fausse catégorie un pays qui a toujours été un partenaire historique, et que l'on connaît infiniment mieux que beaucoup d'autres, serait appauvrir notre relation vieille de mille ans. C'est par choix tactique, en fonction du contexte international, que le président Poutine a considéré qu'il était utile d'adhérer à ce club. Cela lui permet, tout en étant extrêmement prudent vis-à-vis de la Chine, de partager un message contestataire en direction des puissances occidentales, dans un moment et dans des circonstances donnés. En réalité, si les BRICS revendiquent une meilleure place au soleil, ils ne veulent pas prendre de responsabilités internationales. Ils tergiversent lorsqu'on leur demande, dans les sommets du G20, de construire des normes monétaires, sociales ou environnementales. Ils représentent une construction provisoire, et lorsqu'on y regarde de près, non seulement la Russie, mais également la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Inde sont aujourd'hui obligés de revoir le modèle qui a fait leur succès. Leur situation n'est pas mauvaise – elle est meilleure que celle de bien d'autres pays, y compris peut-être le nôtre –, mais le progrès n'est plus garanti, et ils ne peuvent pas se contenter de continuer sur leur lancée.
S'agissant enfin de la capacité militaire, la Russie a longtemps vécu sur sa base soviétique, mais cette phase est aujourd'hui terminée. Le pays crée une armée de métier ; le corps des officiers, qui était surchargé, a été considérablement réduit, ce qui a entraîné des conséquences sociales dramatiques, car le statut militaire était garanti à vie. L'idée de forces plus mobiles s'est développée au sein de la Russie et de la CEI, selon la formule de l'OTSC, l'organisation du traité de sécurité collective – en russe ODKB –, bras armé que la puissance multipolaire russe veut déployer dans son espace. Cette mutation n'est pas achevée. Elle appelle de nouveaux investissements militaires, auxquels s'ajoutent ceux que le défi tactique lancé aux États-Unis implique en matière nucléaire – avec notamment de nouveaux missiles –, et le budget militaire reste le premier du pays. Mais elle suscite des débats internes aigus dont on a pris la mesure au moment du départ de Serdioukov, le 6 novembre dernier, et qui ne sont pas tranchés, comme le montrent les redistributions et les reprises en main que l'on a pu observer.
Politique soviétique ou politique russe ? C'est un sujet de débat parmi les Russes eux-mêmes. Le meilleur ouvrage sur le sujet est sans doute le livre de Dmitri Trenin Post Imperium, qui montre bien qu'une politique néo-impériale ne peut être envisagée, faute de moyens. Ce qui ne signifie pas que la tentation d'y recourir n'existe pas : j'ai évoqué la CEI ; je songe aussi aux conflits prolongés, en Géorgie, au Karabakh –le plus aigu sans doute – ou en Moldavie. Une nouvelle forme de coopération aurait pu être expérimentée pour mettre fin à ce dernier conflit, conformément à la proposition allemande ; il est regrettable qu'un compromis n'ait pu être trouvé alors qu'il semblait à notre portée. Quoi qu'il en soit, en Afghanistan, pour ne citer qu'un exemple, la coopération à laquelle nous sommes parvenus aurait été inconcevable à l'époque soviétique.
Je partirai de la question démographique, de la fragmentation de l'espace et de l'immigration pour en venir à l'identité de l'État, à l'idéologie et à la religion. Il faut en effet tenir compte de tous ces éléments pour s'interroger sur l'identité russe, celle du sujet post-impérial : comment passer de l'empire tsariste, puis de l'URSS, à ce qu'est aujourd'hui la Russie – un pays moyen, moins performant et compétitif du point de vue économique que nombre de ses voisins, dont les dirigeants n'ont rien d'autre à proposer que la consolidation des acquis et leur propre maintien au pouvoir ? Voyez les craintes qu'inspirent à Poutine, dans le domaine énergétique, l'émergence du gaz de schiste et la perspective d'une rupture avec le confort des revenus considérables du pétrole et du gaz naturel.
Le déclin démographique est beaucoup plus accentué dans la partie asiatique de la Russie : on vit moins longtemps qu'ailleurs dans la plupart des régions de Sibérie et d'Extrême-Orient, on les quitte beaucoup plus que les autres, on y immigre aussi beaucoup moins. En outre, les populations qui vivent dans ces régions communiquent peu avec les habitants de ce que les Russes nomment la Russie centrale et que nous appelons la Russie européenne. On constate ainsi une tendance à la fragmentation démographique, économique et sociale du pays, qui n'est pas politique, mais humaine, et qui affecte les perspectives offertes à chaque région. N'oublions pas que la Russie est une fédération au sein de laquelle les petites républiques du Nord-Caucase, par exemple, n'ont été conquises qu'au xixe siècle, au terme de violents conflits, notamment en Tchétchénie, qui a subi deux terribles guerres depuis 1994.
Il convient par conséquent de distinguer, d'une part, la tendance longue au déclin de la démographie russe, principalement affectée par le nombre anormalement élevé de décès parmi les hommes âgés de 45 à 60 ans ; et, d'autre part, une croissance démographique venue de l'immigration.
Or, Moscou peine à prendre la mesure de ce problème, pour des raisons qui éclairent un phénomène a priori incompréhensible : pourquoi les dirigeants russes ont-ils autant de mal à instaurer une véritable politique d'immigration, notamment par l'intégration des populations ex-soviétiques, dont la démographie est généralement plus dynamique et qui, souvent, travaillent dans la Fédération de Russie, mais pour la plupart de manière illégale ?
Ces raisons sont d'abord politiques ; elles sont liées à l'inquiétude qui entoure la définition de l'identité russe. Malheureusement, Poutine et ses conseillers ont choisi de celle-ci une version de plus en plus « ethnique ». « La Russie aux Russes » a ainsi été l'un des grands slogans de campagne lors des dernières élections et de celles de 2007-2008. On entend dire que « le Caucase, ce n'est pas vraiment chez nous », qu'il ne faut pas nourrir les Caucasiens alors que les Russes ont besoin d'argent et d'investissements.
Cette politique a conduit à une définition de l'État et de la nation russes sans précédent dans l'histoire de la Russie, ni pendant la période tsariste, ni pendant l'ère soviétique. À l'époque soviétique, la politique était officiellement « multinationale » : on était soviétique avant d'être arménien, russe ou ukrainien. Et cette construction idéologique d'un État principalement russe, fait pour les Russes, pose de nombreux problèmes : pour le percevoir, il suffit de regarder, sur la carte, les petites républiques qui portent encore le nom d'un peuple – le Tatarstan, la Tchétchénie, l'Ingouchie, la Carélie – ou de songer à la question de l'islam et des religions en général.
C'est après le début de la crise financière et la guerre de Géorgie, en août 2008, que Poutine, qui n'est pourtant pas un idéologue, a, pour la première fois depuis 1999, éprouvé le besoin de bâtir une idéologie afin de renforcer sa légitimité vacillante. Il a fondé cette idéologie sur l'identité russe et sur un discours hostile aux populations non russes, notamment les Géorgiens et les Ukrainiens – la « révolution orange » survenue en Ukraine en 2004 fait partie des événements importants de l'histoire récente de la Russie. Quant à l'Église, elle s'est immédiatement impliquée dans l'affaire des Pussy Riot et le régime montre de plus en plus ouvertement que le patriarcat gouverne avec lui. Ce qui – vous avez raison, Mme Guittet – est contraire à la Constitution ; mais nous en aurions pour plusieurs heures si j'entreprenais de dresser la liste de toutes les violations récentes des grands principes inscrits dans la Constitution russe.
Il existe par ailleurs un décalage entre les mesures affichées, ou la rhétorique employée, et la réalité. Ainsi, on prétend réformer l'armée, mais on limoge le ministre Serdioukov à l'automne 2012, alors que Poutine déteste être obligé de se séparer de ses proches publiquement et brutalement. Cette affaire révèle la corruption qui gangrène le pays et que tous, à tous les niveaux, reconnaissent. En outre, contrairement à ce que l'on entend dire, ce n'est pas une armée de métier mais une armée de conscription qui a été envoyée à deux reprises en Tchétchénie et devra livrer à nouveau, le cas échéant, des combats du même type.
Le problème de la Russie me semble moins tenir aux fantasmes de ses dirigeants, monsieur Guillet, qu'à leurs peurs – du changement, de l'Autre, de ce qu'ils ne contrôlent pas. Ces peurs montrent qu'ils ne sont plus tout à fait sûrs de pouvoir porter seuls leur pays et son avenir. De fait, la grande bataille livrée par les oppositions – j'emploie le pluriel à dessein – et par tous ceux qui, au sein de la société russe, s'inquiètent de l'avenir visait à mettre enfin à bas ce qui représente le coeur de la construction poutinienne en matière politique : ce que Poutine lui-même appelle le « système sans alternative » et qui exige le maintien du régime, fût-il imparfait. « Il existe une alternative à Poutine et au poutinisme » : tel est le message que sont parvenus à transmettre les manifestants et tous ceux qui se sont mobilisés sur Internet. Les manifestations massives sont d'autant plus remarquables qu'il y a un an et demi encore, sous ce régime autoritaire et qui demeure policier, quelques dizaines de personnes qui se réunissaient dans les rues de Moscou s'exposaient au risque d'être immédiatement arrêtées. En brandissant pour la première fois, dans les rues de Moscou, de Saint-Pétersbourg et de Vladivostok, des banderoles proclamant : « Putin, ukhodi ! » – « Poutine, va-t'en ! » –, les manifestants ont touché à la dimension quasi sacrée du personnage.
Cela montre que le régime doit bien plus au système de réseaux et de clans qui entourent Vladimir Poutine et ses proches qu'à des institutions publiques qui conforteraient une dictature. Je suis d'accord pour dire que ce dernier terme n'est pas le plus approprié. Il s'agit en revanche d'un régime autoritaire, clientéliste, toujours personnalisé et irrespectueux des droits de l'homme, de la liberté des médias et de l'indépendance des juges. Toutefois, ce système contesté ne saurait durer éternellement ; Pierre Morel l'a dit, la Russie ne pourra rester un pays enfermé qui se voile la face et se bouche les oreilles : elle ne peut qu'évoluer, ouvrir son territoire par le commerce et la compétitivité, et les élites russes l'ont bien compris. Nous avons donc des raisons d'espérer une évolution progressive, mais qui ne sera pas portée par les politiques poutiniennes.

Nous avons assez peu parlé de la stratégie militaire. En évoquant la Russie, l'on ne peut manquer de songer à l'OTAN et au rôle actif qu'elle a joué au cours de la guerre froide. Aujourd'hui, le rideau de fer est tombé mais, entre la Russie et nous, la confiance n'est pas totale. Dans son rapport sur la réintégration de la France dans le commandement militaire intégré de l'OTAN, publié en novembre dernier, Hubert Védrine s'interroge sur le paragraphe 62 de la déclaration de Chicago, aux termes duquel « la défense antimissile de l'OTAN n'est pas dirigée contre la Russie et elle ne portera pas atteinte aux capacités de dissuasion stratégique russes ». Pensez-vous comme lui que les intentions de l'OTAN s'y expriment dans un langage très diplomatique ? Le récent point de friction apparu en Géorgie en août 2008 n'est-il qu'une anomalie dans les relations entre l'OTAN et la Russie ? Ne révèle-t-il pas la persistance d'une forme de méfiance ? Enfin, le centre conjoint OTAN-Russie de fusion des données sur la défense antimissile, dont la création est prévue au même paragraphe 62, connaît-il un début de mise en oeuvre ?

Mme Mendras l'a dit, la Russie est gouvernée par un régime contesté. M. l'ambassadeur l'a rappelé, il n'existe pas de force politique d'opposition structurante. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce que vous avez appelé « les oppositions » ?

La mobilisation de la société civile fait espérer une alternative contre laquelle Poutine fait blocage. Ce qui n'est pas sans lien avec la question énergétique, qui n'a selon moi rien d'un fantasme. Le passage du Nord-Ouest est devenu réalité, du fait du réchauffement climatique en Arctique. Pour s'en assurer, il suffit d'observer l'empressement avec lequel les grandes compagnies pétrolières internationales s'y précipitent, ainsi que vers le Groenland. À l'époque de la glasnost gorbatchévienne, j'avais rencontré les représentants du mouvement Ecoglasnost. Evguenia Tchirikova, qui s'est battue contre la destruction de la forêt de Khimki, est devenue l'une des stars des protestations de Moscou. Les questions environnementales, évoquées de manière quelque peu adjacente par M. l'ambassadeur, mais qui sont essentielles – voyez la mer d'Aral –, peuvent-elles contribuer à faire progresser l'exigence démocratique ?
Par ailleurs, l'attitude de la Russie sur la question syrienne ne s'explique-t-elle pas par le refus de se « faire avoir » une seconde fois après l'intervention en Libye ?

La France peut-elle encore agir pour accélérer la libération des deux jeunes femmes membres du groupe Pussy Riot qui purgent une peine de deux ans de prison ?
En décembre 2012 ont eu lieu les quatrièmes rencontres franco-russes des collectivités territoriales. Pour les années à venir, de grands événements sportifs et culturels sont prévus : les Jeux olympiques de Sotchi, en 2014, l'Euro de football en France, en 2016, la Coupe du monde de football en Russie, en 2018. Quelles pourraient en être les retombées sur les échanges sportifs, culturels et touristiques entre les deux pays ?
Le cas des Pussy Riot est extrêmement révélateur, comme celui de Sergueï Magnitski – du nom de l'avocat tué en détention provisoire en 2009. Pourquoi les Américains ont-ils décidé de faire de ce dernier cas l'affaire de la décennie ? Pourquoi le sort des Pussy Riot a-t-il été pour nous, et d'abord pour notre jeunesse, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ? Ces deux affaires témoignent de profonds dysfonctionnements : les institutions publiques susceptibles de contrecarrer le pouvoir exécutif ont perdu tout sens et toute marge de manoeuvre, de sorte que ceux qui, en Russie et ailleurs, sont révoltés par ces abus savent qu'ils ne peuvent faire appel à la médiation institutionnelle. Il est devenu inutile de s'adresser au parti au pouvoir, de demander qu'un débat soit organisé à la Douma d'État ou d'attendre du juge qu'il fasse preuve d'indépendance. Il faut donc en appeler l'opinion publique en Russie et à l'étranger.
Nous, Européens, sommes donc confrontés à un véritable dilemme. Nous sommes régulièrement informés de cas de ce type, qui choquent de plus en plus notre population, en particulier la jeunesse. À ce propos, je suis convaincue que l'affaiblissement du système poutiniste en Russie résulte d'abord de clivages générationnels, les jeunes Russes constatant que Poutine ne leur propose aucun avenir, qu'ils soient pauvres ou aisés – et beaucoup fuient un régime conservateur et fermé pour aller faire leurs études à l'étranger. Quoi qu'il en soit, ces affaires nous invitent à réfléchir à la nature du régime et à son espérance de vie.
Pour résoudre ce dilemme, il me paraît essentiel de réagir avec honnêteté à chaque violation d'une loi, d'un principe fondamental, d'un texte international reconnu par la Russie. Au lieu de nous attaquer aux dérives que connaît la Russie, nous devrions constamment rappeler les fondements de notre système et de nos sociétés démocratiques. Ce faisant, nous n'inquiéterons pas les citoyens russes ; au contraire, nous les rassurerons puisqu'ils sauront que, chez leurs voisins européens, ces principes et ces valeurs sont respectés, que les institutions publiques y fonctionnent et permettent de sanctionner le pouvoir en place, sans risque de violence ni de guerre. La médiation pacifique, qui permet d'éviter les violences, est essentielle aux yeux des Russes, et l'Europe est pour eux un exemple. Or, le sort de Magnitski ou des Pussy Riot témoigne de la violence politique, pour ne rien dire des guerres menées par le pouvoir. Sans agresser le régime, nous devons donc répéter sans cesse : « Nous ne sommes pas comme vous. » Nous, Français, tentons trop souvent de plaire aux dirigeants russes, et à eux seuls, en leur disant qu'ils sont comme nous, qu'ils sont européens, que nous leur faisons confiance et que, pour cette raison, nous allons leur vendre des Mistral ! Eux-mêmes ne comprennent pas ce langage, qui révèle notre propre incompréhension à leur endroit. Il nous faut au contraire leur montrer que nous connaissons bien la Russie, ses forces comme ses faiblesses, et ses perspectives d'avenir.
L'engagement de la société civile en matière d'écologie est lui aussi révélateur, monsieur Mamère. En ce qui concerne le patrimoine écologique, il n'y a jamais eu de blocages au sein de la société soviétique. Mon tout premier travail d'étudiante, aux États-Unis, était un mémoire sur les écologistes en Sibérie dans les années soixante : ce sont les scientifiques de Novossibirsk, avec leur revue Eko, qui ont réussi à faire barrage au projet fou des brejnéviens, lesquels voulaient détourner les fleuves sibériens pour alimenter l'Asie centrale en eau. Pour les habitants de cette grande Russie, le patrimoine, l'espace, les ressources sont absolument primordiaux. Mais le pouvoir en place n'en parle guère ; du reste, comment faire appliquer une charte écologique lorsque règne la corruption contre laquelle se bat Evguenia Tchirikova ?
Quant aux forces d'opposition, je répète qu'aucune opposition au régime ne peut se développer et se structurer au sein des institutions publiques actuelles. Il ne faut donc espérer aucun miracle puisque toute la stratégie poutiniste consiste à empêcher ceux qui ne font pas partie de la clientèle d'user de ces institutions pour critiquer le régime. Il en est une seule que les activistes ont réussi à utiliser : le suffrage universel, qu'ils ont bousculé en montrant que ni les députés ni le président Poutine n'ont été honnêtement élus, écornant ainsi la légitimité et l'autorité des grands personnages de l'État.
L'investissement de la sphère institutionnelle – partis politiques, associations, pouvoirs locaux – devrait être l'étape suivante, mais le clientélisme, l'étendue du pays et sa fragmentation compliquent la tâche des opposants. La bataille politique se joue aujourd'hui sur deux fronts : d'une part, la contestation des fausses informations, en particulier grâce aux sites et réseaux sociaux sur Internet ; d'autre part, la dénonciation de tous les abus dont la corruption au sein du complexe militaro-industriel qui a coûté son poste au ministre de la défense. Les Russes s'y attellent. « Non au parti des voleurs et des escrocs » : c'était le premier grand slogan de décembre 2011, inventé par le juriste et blogueur Alexeï Navalny et qui ajoute l'accusation de vol des voix à la critique plus ancienne de la corruption du pouvoir. Pour la première fois, on a ainsi exprimé l'imbrication de l'économique et du politique sous un régime vieillissant et de plus en plus rigide. Mais le combat est rude, car le pouvoir conserve et monopolise des ressources et des moyens considérables.
Il convient d'ajouter que l'Église orthodoxe, attachée à la protection de la nature et au respect de la Création, fait partie des forces qui militent en faveur de l'écologie et a joué un rôle précurseur en la matière dans les milieux religieux.
Du point de vue politique, s'il est vrai que le régime vieillit, je note toutefois la manière dont, après la manifestation du 10 décembre 2011, Poutine s'est félicité de la capacité de son régime à produire et à contrôler une forme de puissance tribunicienne, ainsi que son insistance nouvelle, dans son discours du 12 décembre dernier, sur la lutte contre la corruption.
L'affaire ABM continue de poser problème à la Russie. Du point de vue stratégique, l'on craint une dérive vers une autre conception du rôle des armes nucléaires. La France a connu les mêmes difficultés au sein de l'OTAN. Ensuite, la crédibilité de l'offre de l'OTAN est jugée insuffisante. Sur ce point, j'avoue ne pas savoir exactement où en est le comité. Enfin, même si le sud est bien la direction visée, la capacité d'observation de l'horizon et la puissance du système donnent à l'OTAN et, en son sein, aux États-Unis une allonge supplémentaire, porteuse d'un déséquilibre qui paraît contraire à la conception russe très classique de l'équilibre en matière nucléaire.
Parmi les événements sportifs que vous avez cités, madame la députée, nous devons être particulièrement attentifs aux Jeux de Sotchi, dont l'approche a fait resurgir ici ou là l'idée de boycott, qui avait circulé à l'époque soviétique, et pouvait également réveiller le souvenir de l'affaire tcherkesse, drame occulté qui a conduit, entre 1870 et 1880, à de très importants déplacements de population, dont le Nord-Caucase est sorti transformé. Le risque de déstabilisation de la région est une cause de crispation. Ainsi cet événement sportif international, qui suscite des investissements considérables, se prépare dans un contexte politique et sécuritaire qui reste complexe.
S'agissant enfin de la Syrie, les Russes nous accusent de tous les maux, nous reprochant d'y alimenter le désordre comme par un mauvais réflexe acquis en Libye, alors que l'on pourrait tout aussi bien soutenir que c'est à cause du blocage russe qu'aucune solution n'a pu être trouvée. Je l'ai dit au printemps dernier à des parlementaires russes, ajoutant que nous aurions pu travailler ensemble en novembre 2011, lorsque la situation était certes difficile, mais pas dramatique. Au lieu de quoi la Russie s'est raidie et a fait de son intransigeance un thème de campagne. Il me semble qu'une occasion a été manquée alors. Sans doute la dégradation dramatique de la situation en Syrie nous en fournira-t-elle une autre. Or, dans le contexte d'instabilité internationale que nous connaissons, nous devons veiller, des deux côtés, à saisir les occasions qui se présentent.
La séance est levée à onze heures trente.