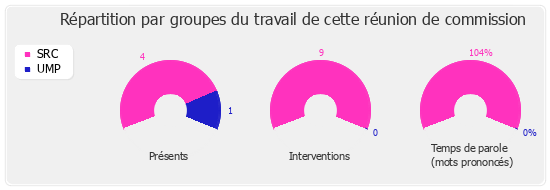Délégation de l'assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
Réunion du 27 mars 2013 à 18h00
La réunion
La Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a procédé à l'audition de Mme Ernestine Ronai, responsable de l'Observatoire des violences envers les femmes du conseil général de la Seine-Saint-Denis, coordinatrice nationale de la lutte contre les violences envers les femmes au sein de la Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences (MIPROF).
La séance est ouverte à dix-huit heures.

Mes chers collègues, nous accueillons aujourd'hui Mme Ernestine Ronai, responsable de l'Observatoire des violences envers les femmes du conseil général de la Seine-Saint-Denis, qui a été nommé récemment coordinatrice nationale de la lutte contre les violences envers les femmes au sein de la Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences.
Madame Ronai, nous sommes très intéressés par votre expérience et votre témoignage, car votre bilan dans le département de la Seine-Saint-Denis est exemplaire.
Nous travaillons actuellement sur le futur projet de loi sur l'égalité en préparation au sein du Gouvernement, qui comportera un volet consacré à la lutte contre les violences. Dans l'attente du projet de loi, deux membres de la Délégation, Mme Édith Gueugneau et Mme Monique Orphé, préparent une contribution sur ce thème. En outre, l'Assemblée examine ces jours-ci un projet de loi, qui transpose dans notre droit interne la directive européenne du 5 avril 2011 sur la lutte contre la traite des êtres humains et plusieurs conventions internationales, notamment la convention d'Istanbul de 2011 sur la prévention des violences envers les femmes. La semaine prochaine, notre collègue Marietta Karamanli, rapporteure de ce texte, viendra s'exprimer devant notre Délégation.
Madame Ronai, dans quelle mesure votre action au sein de l'Observatoire de Seine-Saint-Denis peut-elle être une source d'inspiration pour votre travail au sein de la Mission interministérielle ? De quels moyens dispose cette dernière et quels sont ses objectifs ?
Plus précisément, nous aimerions vous entendre sur l'ordonnance de protection, le bracelet électronique pour les auteurs de violences graves et le téléphone portable d'alerte pour les femmes reconnues en très grand danger.
Mes collègues vous poseront des questions sur l'application de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes. Je reçois, comme certainement d'autres députés, des témoignages de femmes victimes de violences et faisant état de dysfonctionnement des procédures censées protéger les victimes, et de la difficulté de joindre les associations aussi d'ailleurs.
Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je rappelle que la loi de juillet 2010 et celle du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ont été votées à l'unanimité, preuve que les parlementaires ont joué un rôle extrêmement important pour faire évoluer notre cadre juridique.
En plus d'une meilleure connaissance des problématiques, mon travail en Seine-Saint-Denis m'a appris au moins trois choses.
D'abord, la lutte contre les violences faites aux femmes exige l'existence d'un partenariat fort entre tous les acteurs concernés : les services de l'État – justice, police, gendarmerie, mais aussi Éducation nationale, et plus largement milieu hospitalier, CAF, – ; les services départementaux, comme le service social départemental, les crèches, les centres de protection maternelle et infantile (PMI), l'Aide sociale à l'enfance (ASE) et les collectivités locales, qui jouent un rôle très important dans la proximité ; enfin, les associations.
Ensuite, la notion de confiance est un élément très important. Dans le cadre de ce partenariat, nous allons travailler sur les dysfonctionnements auxquels vous avez fait référence, madame la présidente, pour réfléchir, dans la confiance, aux moyens d'améliorer le fonctionnement de la police, de la gendarmerie et de la justice.
Enfin, un partenariat durable nécessite deux choses. Il faut, d'une part, des temps où tout le monde se retrouve comme c'est le cas le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, et le 8 mars, journée internationale de la femme, mais auxquelles je pense important que soit ajouté le 6 février, journée internationale contre les mutilations sexuelles féminines, célébrée dans certains pays africains mais aussi, depuis cinq ans, en Seine-Saint-Denis. Il faut, d'autre part, des conventions, des chartes, des protocoles, dont l'intérêt est de s'inscrire dans la durée. C'est le cas du « protocole pour la mise en oeuvre de l'ordonnance de protection en Seine-Saint-Denis », signé par le président du conseil général, le Parquet, les associations, la chambre départementale des huissiers et le Barreau.
Ainsi, notre travail doit s'inscrire dans la durée, mais aussi être mené pas à pas et collectivement : comme dans un match de rugby, il faut avancer, surtout ne pas reculer, et passer la balle.
La ministre des droits des femmes m'a fait l'honneur de me demander de coordonner la lutte contre les violences au sein de la Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences (MIPROF), à laquelle quatre objectifs sont assignés.
Le premier est la formation des professionnels, à commencer par celle des magistrats. Fin avril, l'École nationale de la magistrature, avec laquelle j'ai commencé à travailler, devrait me transmettre un état des lieux et une évaluation des marges de progrès. La formation des policiers et des gendarmes est également fondamentale, tout comme celle des médecins car un certificat médical bien établi permet d'apporter au magistrat une preuve des violences, violences physiques, mais aussi psychologiques dues au stress post-traumatique. Les avocats doivent également être formés pour aider les femmes à constituer leur dossier en vue de la délivrance d'une ordonnance de protection. Plus largement, les personnels de l'Éducation nationale et les travailleurs sociaux devraient aussi bénéficier d'une formation.
Ainsi, il faut travailler à la mise en place de ce plan de formation – car celui contenu dans la loi de juillet 2010 n'a malheureusement jamais vu le jour –, après avoir réalisé, au préalable, un état des lieux de ce qui existe déjà.
La deuxième mission qui m'a été confiée dans le cadre de la MIPROF, composée de six personnes, est l'animation des politiques territoriales et la mutualisation des bonnes pratiques. Les collectivités territoriales jouent en effet un rôle central dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous travaillons actuellement sur l'expérimentation du téléphone portable d'alerte pour les femmes en très grand danger, et j'espère que nous aboutirons rapidement.
Troisièmement, la Mission aura une fonction d'enquête et d'observatoire. Il s'agira donc de rassembler, d'analyser et de diffuser les données relatives aux violences faites aux femmes en contribuant à la réalisation d'études et de travaux de recherche et d'évaluation, ce qui représente un travail de grande ampleur. Nous travaillerons, par exemple, à l'amélioration de l'enquête sur les homicides, celle qui établit le nombre de femmes qui meurent du fait de la violence de leur conjoint, avec l'idée de prendre en compte également les tentatives d'homicides et donc la dangerosité des hommes violents dans notre société.
Enfin, la Mission mènera une action dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains.

Quel bilan établissez-vous de l'ordonnance de protection ? Selon vous, la mise en place du plan de formation a-t-elle été freinée en raison de son coût ?
Je ne pense pas que le coût soit l'élément déterminant. Qu'elle porte sur les atteintes aux biens ou sur les atteintes aux personnes, la formation initiale d'un auditeur de justice coûte le même prix. En outre, ce n'est pas la formation des formateurs qui ruinera le budget de l'État. Je pense qu'il s'agit d'un problème de prise de conscience dans notre société : la problématique des violences faites aux femmes doit être intégrée dans toutes les formations initiales, ce qui à mon sens sera moins coûteux que de faire intervenir des associations ou des organismes de formation par la suite.
Mme Vallaud-Belkacem a expliqué très justement pourquoi elle a choisi d'écarter le bracelet électronique. Le principe de ce dispositif anti-rapprochement est de garantir une certaine distance entre Monsieur et Madame par GPS interposés, mais ils restent en relation « dans leur tête », alors que l'objectif est d'aider Madame à sortir de l'emprise. En outre, dans les trois lieux où devait avoir lieu l'expérimentation, aucun bracelet n'a été mis en place car aucun homme n'était condamnable à une peine d'emprisonnement correspondant au seuil pour lequel le dispositif s'applique.
Si la femme se retrouve infirme, l'homme sera certainement condamné à une peine de prison, et le dispositif du bracelet ne s'appliquera pas. Un récidiviste dont les sursis sont tombés sera condamné à un ou deux ans de prison. En moyenne, les peines vont de trois à six mois, ce qui est peu, et sont souvent assorties d'un sursis simple ou d'un sursis avec mise à l'épreuve. Je pense que le bracelet électronique anti-rapprochement n'est pas une bonne solution en matière de violences dans le couple.
Globalement, 90 % des auteurs sont condamnés. En Seine-Saint-Denis, une enquête réalisée pendant quatre mois sur 408 affaires en correctionnelle a montré que, sur 285 d'entre elles – les autres ayant été renvoyées –, 45 auteurs de violences ont été condamnés à un emprisonnement ferme (16 %), 23 à un emprisonnement ferme partiellement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve (8 %), 51 à un emprisonnement ferme totalement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve (18 %), 131 à un emprisonnement avec sursis simple (46 %), 2 à des travaux d'intérêt général, 33 à des pénalités financières (12 %). La durée moyenne de la peine d'emprisonnement est de trois mois et sept jours – la peine prononcée la plus faible est de huit jours, la plus importante de douze mois. Pendant cette période, deux affaires ont été jugées aux Assises. Toutes ces données figurent dans le dossier que je vous ai remis.
Nous avons en outre mené une expérimentation sur le téléphone portable d'alerte pendant trois ans. Ainsi, à ce jour, 108 femmes bénéficient ou ont bénéficié de ce dispositif, ce qui a permis de protéger 173 enfants mineurs – la loi de juillet 2010 prend en compte les incidences des violences sur les enfants.
Devant le succès enregistré en Seine-Saint-Denis, le dispositif du téléphone portable d'alerte a été étendu aux TGI de Paris, de Strasbourg et du Val-d'Oise, auxquels devrait s'ajouter prochainement celui de la Martinique. Une dizaine de départements ont demandé à entrer dans le dispositif. Nous travaillons donc avec le ministère de la justice pour la mise en place d'un dispositif cadre.

Pour quelle raison le dispositif n'a-t-il pas été dupliqué dans tous les départements ? Il constitue pourtant une vraie réponse, en particulier en milieu rural, où les associations sont très rares et les gens éloignés des services.
Quel en serait le coût ? Quelle part incomberait à l'État et au conseil général ? Je pense d'ailleurs que les communautés de communes seraient prêtes à participer aux mesures à prendre.
L'ordonnance de protection concerne les femmes en danger, le téléphone portable d'alerte les femmes en très grand danger.
Ce moyen est utilisé lorsque Madame accepte d'être munie d'un téléphone portable d'alerte, ce qui signifie qu'elle doit être séparée de son conjoint, sinon ce dernier jettera l'appareil. En outre, elle doit accepter de faire des tests bimensuels en appuyant sur une touche du téléphone, ce qui la met en lien avec le téléassisteur et permet de s'assurer que l'appareil fonctionne et est chargé.
Le téléphone portable d'alerte est délivré sur décision du Parquet. Pour ce faire, une évaluation du danger est menée en amont par une association de juristes. Elle tient compte, d'une part, des critères de dangerosité de Monsieur – la plupart du temps, il a des antécédents judiciaires car il a déjà été violent. En Seine-Saint-Denis, sur les 108 femmes admises dans le dispositif, 8 hommes seulement n'étaient pas concernés par une procédure judiciaire. L'évaluation tient compte, d'autre part, de la vulnérabilité de Madame, en particulier de son isolement. Le dispositif constitue donc une vraie solution en milieu urbain comme en milieu rural, surtout quand Monsieur a réussi à couper Madame de ses amis et de sa famille. En substance, il y a soit de petites violences qui sont en train de monter en intensité – l'homme finit par menacer Madame de mort et l'on pense qu'il va finir par la tuer –, soit une grande violence d'un seul événement, laquelle suffit à dire que Monsieur est dangereux et a passé la limite. Dans les deux cas, il y a un très grand danger.
Les quatre expérimentations au niveau national sont menées grâce à des partenariats financiers entre les collectivités territoriales et l'État. Les collectivités territoriales paient le dispositif technologique : les appareils et l'abonnement, ce qui représente 1 500 euros par appareil. Elles paient également le téléassisteur : ce service permet de vérifier l'existence d'une situation de danger car, si l'appareil est coincé dans le sac de Madame et qu'elle ne répond pas, l'équipage de police part en pensant qu'elle est en danger, alors qu'une autre femme peut l'être réellement ailleurs.
Les femmes munies d'un téléphone portable d'alerte sont répertoriées auprès des services de police qui connaissent ainsi les lieux qu'elles fréquentent. En cas de danger, l'équipage part tout de suite. En Seine-Saint-Denis, il arrive sur le lieu de l'agression dans les dix minutes, ce qui a permis de sauver en début de semaine dernière une dame qu'un ami de son ex-compagnon était venu attaquer avec un couteau : des gens sont intervenus pour aider la dame, celle-ci a appuyé sur le bouton d'appel d'urgence de son téléphone, la police est arrivée et a interpellé l'agresseur. Le dispositif est donc très efficace.
Pas encore, mais elle sera bientôt mise en place, ce qui rendra le dispositif un peu plus cher. Nous attendons l'obtention d'une plateforme de géolocalisation.

Pour l'instant, il faut que la femme sache où elle est et soit en capacité de le dire. Je connais une femme dont le mari l'a attaquée alors qu'elle se trouvait dans sa voiture : il a d'abord détruit sa voiture, puis l'a frappée car elle était sortie de l'habitacle sous le coup de la panique.
Le dispositif a-t-il sauvé des vies ?
Avec le téléphone portable d'alerte, cette dame serait restée dans la voiture et aurait attendu l'arrivée de la police. La Seine-Saint-Denis va expérimenter cette année la géolocalisation. Pour l'heure, donc, la femme ne se contente pas d'appuyer sur le bouton d'alerte, elle doit savoir dire où elle se trouve.
Quant à l'État, il finance le dispositif du téléphone portable d'alerte via des crédits du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD). Le ministère de la justice a financé, à certaines périodes, l'accompagnement assuré par l'association. Il faut dire que cet outil technologique est d'autant plus efficace qu'un accompagnement global permet à la dame de sortir de manière durable de sa situation en l'aidant à réaliser toutes ses démarches juridiques (séparation, garde des enfants, logement), voire à trouver un travail.
Le dispositif est attribué pour une période de six mois renouvelable une fois.
Le téléphone d'alerte a sauvé une vie à Strasbourg, comme me l'a dit le procureur général, et une vie dans le Val-d'Oise. En Seine-Saint-Denis, il a sauvé au moins deux vies. Le dispositif n'empêche pas l'attaque, mais il est efficace, d'autant que tout est repéré en amont.

Quel est la procédure à suivre pour demander une ordonnance de protection et dans quel délai une femme peut-elle l'obtenir ? J'entends parler de deux mois, trois mois…
Par ailleurs, y a-t-il eu des condamnations prononcées pour des faits de violences psychologiques ? Le législateur doit-il préciser les choses en la matière ?
En Seine-Saint-Denis, le délai pour obtenir l'ordonnance de protection est de douze jours.
Quand le danger est vraisemblable, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence l'ordonnance de protection. Le « protocole pour la mise en oeuvre de l'ordonnance de protection en Seine-Saint-Denis», fruit d'un engagement du président du tribunal, du juge aux affaires familiales et du Parquet, établit le parcours que doivent suivre les femmes pour obtenir l'ordonnance.
Concrètement, la femme se rend à la permanence des avocats du tribunal – un groupe d'avocats spécialisés bénévoles au nombre de 35 –, qui se tient les lundis et jeudis matin. Elle explique son cas, l'avocat examine ses papiers et lui demande le cas échéant de rassembler les papiers manquants, ceux qui feront la preuve de la vraisemblance des violences. Si elle est en possession de tous les papiers nécessaires, elle se rend avec l'avocat à la permanence du juge aux affaires familiales qui fixe une date d'audience et lui remet l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Dans la même matinée, cette femme se rend au bureau de l'aide juridictionnelle où lui est attribuée immédiatement l'aide juridictionnelle et remis le permis de citer. À Bobigny, elle se rend à la chambre départementale des huissiers, qui se trouve à un quart d'heure à pied du tribunal, où elle remet le permis de citer et l'admission à l'aide juridictionnelle : la chambre départementale des huissiers accepte de délivrer dans les quarante-huit heures maximum le permis de citer si l'aide juridictionnelle est attribuée. Ainsi, dans un délai de quarante-huit heures, Monsieur reçoit la convocation pour l'audience qui, selon la gravité des faits et le danger, est fixée à une date plus ou moins proche par le juge. Si Madame a très peur, elle est accueillie dans un service de mise en sécurité pendant huit jours au plus, délai au terme duquel elle aura obtenu son ordonnance de protection et le droit de rester dans son logement pendant que Monsieur en est évincé si elle le souhaite. La plupart des femmes demandent en effet à rester dans le logement, d'autres ne le souhaitent pas car elles ont trop peur.
Ce circuit fonctionne car il est très organisé et que les intervenants sont très réactifs.
C'est totalement exagéré.
Au plan national, je pense qu'un travail doit être mené avec la Chancellerie, en lien avec les chefs de juridiction, en vue de la mise en place d'une réelle organisation.
En Seine-Saint-Denis, entre le 1er octobre 2010, date d'entrée en vigueur de la loi, et le 31 décembre 2012, 508 décisions sur des requêtes en ordonnance de protection ont été rendues ; dans 50 cas, la procédure n'est pas allée au bout (désistement, caducité, radiation). Ainsi, sur 458 décisions motivées qui ont été rendues, 346 ordonnances de protection ont été accordées, soit 75 %, et 112 ont été rejetées au motif que la situation de danger n'était pas établie, soit 25 % – ce qui fait trois ordonnances sur quatre accordées.
Pour l'année 2012, 234 décisions ont été rendues ; dans 26 cas (10 %), il a été constaté que la demanderesse ne s'était pas présentée ou avait fait savoir qu'elle renonçait à sa demande. Ainsi, sur 208 décisions motivées qui ont été rendues, 143 ordonnances de protection ont été accordées et 65 rejetées, soit un taux positif de 69 %.
Le délai moyen entre le dépôt de la requête et la décision a été de douze jours. Les citations aux défenseurs ont été délivrées dans des délais compris entre vingt-quatre et quarante-huit heures.
En outre, 92 % des requérantes étaient assistées d'un avocat, et le défendeur était assisté d'un avocat dans 41 % des cas – il comparaissait seul dans 25 % des cas, et ne comparaissait pas du tout dans 23 % des cas.
Pour faire une requête d'ordonnance de protection, Madame n'est pas obligée d'avoir porté plainte. Cela est très important car elle a très peur et à juste titre puisque, dans un certain nombre de cas, des femmes ont été tuées après avoir porté plainte. Cela signifie qu'il n'y a pas forcément de réquisition pour les unités médico-judiciaires (UMJ), ni d'enquête préliminaire de police. Par conséquent, il faut faire la preuve de la vraisemblance des violences.
La vraisemblance des violences peut être prouvée grâce au médecin de famille, au psychologue ou au psychiatre qui suit la dame – une femme sur deux victimes de violences est dépressive, d'où la nécessité de former les médecins –, à l'assistante sociale à qui elle a demandé un logement et parlé de ses dettes de loyer que Monsieur ne paie pas, au directeur d'école à qui elle a parlé de ses problèmes. Sur le modèle d'une lettre de signalement en matière de protection de l'enfance, ces professionnels pourront écrire un courrier indiquant : « J'ai rencontré Mme X. qui m'a dit : "… " ». Dans le cadre du contradictoire, ils n'affirment pas que les faits sont réels, mais que Madame leur en a parlé. L'ensemble des éléments de vraisemblance va amener le juge à prendre une décision. S'il est bien formé et qu'il a compris les mécanismes de la violence, il pourra rendre une décision positive. D'où, là encore, l'intérêt de former les juges.
À la Cour d'appel de Douai où je me suis rendue récemment, une juge aux affaires familiales m'a raconté l'histoire suivante. Une dame de soixante-dix ans, victime des violences de son conjoint qui montaient en intensité, est venue lui demander une ordonnance de protection. En tant que juge correctionnel, elle n'aurait pas eu suffisamment d'éléments de preuve. Mais en tant que juge aux affaires familiales (JAF), dans le cadre du principe de précaution, elle a décidé d'accorder l'ordonnance car la dame avait très peur. Monsieur a fait appel, la Cour a donné raison à la JAF, mais, malheureusement, cette dame a été tuée par son conjoint. La JAF m'a alors fait part de son soulagement d'avoir fait droit à la demande de cette femme, en tout cas d'avoir fait ce qu'elle a pu. Ainsi, un des éléments de preuve, que je considère très important, est la peur que l'on perçoit chez les femmes.

La femme ne peut-elle être mise à l'abri après le lancement de la procédure, sachant que la colère de Monsieur va être décuplée et que Madame a des raisons d'avoir peur ?
La colère de Monsieur peut augmenter, mais il peut aussi « se tenir à carreau ».

Le problème est de trouver un logement pour ces femmes, sachant que les foyers d'accueil et d'hébergement sont pleins.

En Saône-et-Loire, une association accueille les femmes en danger pour les abriter, mais n'a jusqu'à présent reçu aucune communication sur l'ordonnance de protection – même la déléguée départementale juge le dispositif très compliqué. Or je pense que les déléguées départementales ont des messages très importants à faire passer et doivent s'emparer de ce sujet, sachant que le Gouvernement a clairement affirmé sa volonté de lutter contre les violences faites aux femmes.
En Charolais-Brionnais, quelques villes ont mis à disposition des logements d'urgence. Néanmoins, les collectivités sont éloignées des associations et du tribunal, d'où la nécessité d'un travail en milieu rural.

Nous n'avons pas ce type de problème en ville, où des organisations et des structures existent. Je pense que nous devons mener une réflexion sur la situation des femmes victimes de violence en milieu rural – et elles sont nombreuses –, où les gendarmes sont insuffisamment formés et de moins en moins nombreux, ce qui fait que le téléphone portable d'alerte n'est peut-être pas la solution.
Cette idée de protocole, de contractualisation entre les acteurs, me paraît très importante car elle permet de pérenniser l'action.
Les certificats d'ITT (incapacité totale de travail) sont la plupart du temps très mal faits par les médecins. Je pense d'ailleurs que la femme devrait consulter un médecin qu'elle ne connaît pas, et non son médecin de famille qui connaît toute la famille et cherchera peut-être à la rassurer en lui disant que son conjoint va se calmer. Dans le cadre de la formation indispensable des médecins, la brochure qui leur est envoyée tous les deux mois par le Conseil de l'Ordre des médecins pourrait comporter une information sur la réalisation des certificats d'ITT, qui constituent un élément très important dans la procédure.
Je suis d'accord avec vous, madame Ronai : la formation ne coûte pas grand-chose. À Lyon, le centre de formation des policiers avait mis en place il y a quelques années une semaine de formation sur les violences envers les femmes avec des intervenants extérieurs – Planning familial, SOS Femmes – et un psychologue. Pour les policiers, il suffirait donc d'animer le réseau formation, ce qui ne semble pas très compliqué.
Enfin, le logement est un réel problème. À cet égard, les préfets pourraient, sur le contingent préfectoral, de 20 % à 25 % suivant les départements, attribuer des logements pour les femmes victimes de violences, cette possibilité figurant déjà dans la loi. Très souvent en effet, les femmes ne souhaitent pas rester dans l'appartement qui leur rappelle de très mauvais souvenirs. Quant aux logements d'urgence, le loyer doit être payé par une association.
Je suis entièrement d'accord avec vous sur la situation en milieu rural, où j'ai fait beaucoup de formation. Je pense même qu'un groupe de travail, associant les collectivités territoriales, les services de l'État et les associations, pourrait être mis en place pour mener la réflexion sur le sujet. À titre expérimental, un ou deux départements pourraient être choisis et les procédures de traitement des cas de violence qui seraient élaborées pourraient avoir valeur d'exemple. Les femmes sont en effet terriblement isolées, ne serait-ce que parce que beaucoup d'entre elles dépendent de leur conjoint pour les transports, car ce sont eux qui ont la voiture.
En Seine-Saint-Denis, je l'ai dit, nous avons mis en place un service de mise en sécurité de sept jours, payé par l'État. Ainsi, à partir du dépôt de l'ordonnance de protection – moment où la femme est en très grand danger –, cette dernière est mise à l'abri, et, une fois l'ordonnance de protection obtenue, elle peut réintégrer son logement si son conjoint en est évincé. Dans le cas contraire, effectivement, elle part dans l'errance et fait appel au 115 car les foyers sont surchargés.
Selon l'article 19 de la loi du 9 juillet 2010 sur les violences faites aux femmes, « des conventions sont passées avec les bailleurs de logements pour réserver dans chaque département un nombre suffisant de logements à destination des personnes victimes de violences, protégées ou ayant été protégées par l'ordonnance de protection ». Il s'agit là d'un très beau projet auquel il ne faut pas renoncer ! En région parisienne, si chaque bailleur social accordait un logement, cela représenterait 500 logements pour les personnes victimes de violence, ce qui serait considérable ! Une telle obligation pourrait être envisagée. Le dispositif « Un toit pour elle », mis en place par la Seine-Saint-Denis, permet à chaque ville volontaire d'accorder un logement sur son contingent, sachant que l'office départemental en accorde 10, la CAF 5, la préfecture 5, ce qui fait 48 par an. Si le dispositif était dupliqué dans les autres départements, cela permettrait aux femmes accueillies dans les structures d'hébergement spécialisées, comme SOS femmes ou l'Amical du Nid, d'en sortir et à d'autres d'y être accueillies. En la matière, vous avez un rôle à jouer en lien avec le ministère du Logement, sachant que cet article 19 n'a toujours pas fait l'objet d'un décret d'application.
Toujours au chapitre des propositions, je dirais que la durée de l'ordonnance de protection devrait être portée à six mois. Nous constatons en effet une inégalité entre les couples mariés et les autres types de partenaires. L'ordonnance de protection est automatiquement prolongée jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation pour les couples mariés, alors que pour les autres, elle s'arrête au bout de quatre mois. Il conviendrait donc que la loi mette à égalité les couples mariés, les couples pacsés et les couples concubins en prenant en compte le fait qu'une démarche de séparation a été effectuée dans chacun des cas.
En outre, il convient de fixer un délai précis et raisonnable entre le dépôt de la requête de l'ordonnance de protection et la tenue de l'audience. L'Assemblée nationale avait proposé soixante-douze heures, ce que le gouvernement a refusé à l'époque. Un délai de deux ou trois mois, comme vous l'avez évoqué, madame la présidente, est beaucoup trop long et ne peut pas correspondre à une mesure de protection.
Ensuite, l'article 6 de la loi du 10 juillet 1991 réformant l'aide juridique, selon lequel l'aide juridictionnelle peut être accordée à toute situation « digne d'intérêt », devrait être davantage appliqué dans le cadre de l'ordonnance de protection. En effet, les femmes victimes de violences subissent aussi, la plupart du temps, des violences économiques : non seulement elles peuvent se retrouver sans revenus, mais si leur conjoint leur a confisqué leurs papiers, elles ne peuvent déposer leur requête d'ordonnance de protection.
Par ailleurs, il faudrait améliorer la procédure de la dissimulation de l'adresse. L'ordonnance de protection donne la possibilité à la demanderesse de dissimuler son adresse et d'élire domicile chez l'avocat ou auprès du procureur. Or une fois l'ordonnance de protection échue, l'homme peut retrouver la femme car, conformément à la loi, il a le droit de savoir où vivent ses enfants. Il faudrait donc que le juge aux affaires familiales puisse prolonger la mesure de protection dans un délai précis, ce qui éviterait à certaines femmes de déménager plusieurs fois. En outre, si le JAF a interdit à l'auteur des violences d'entrer en relation avec la victime, mais lui a accordé le droit de visite et d'hébergement, les enfants sont en danger car ils se retrouvent dans un conflit de loyauté : leur père leur demande où ils vont à l'école pour savoir où vit leur mère et la retrouver. Il faudrait donc, dans le cas où l'auteur a interdiction d'entrer en contact avec la victime et où celle-ci a obtenu l'autorisation de dissimuler son adresse, que le juge puisse ne pas accorder le droit de visite et d'hébergement pendant les six mois. En tout cas, nous attirons l'attention des JAF sur ces situations dangereuses.
Il faudrait également résoudre le problème des dettes de loyer. En effet, si Madame veut déménager, les conjoints mariés sont solidaires des dettes de loyer. Il conviendrait donc d'indiquer, soit la possibilité d'attribution des dettes à Monsieur exclusivement, y compris pour les couples mariés, soit l'extinction ou la reprise de la dette par un service social, pas forcément départemental, mais grâce à un nouveau dispositif.
Enfin, en cas d'homicide conjugal, le retrait de l'autorité parentale pourrait être rendu automatique.

Les préfets pourraient mobiliser les bailleurs sociaux pour l'attribution de logements aux femmes victimes de violences. En effet, un certain nombre de bailleurs sociaux n'accordent pas de logement aux femmes tant que la procédure de divorce n'est pas engagée, or ce n'est pas le non-paiement de quelques loyers qui mettra l'organisme en faillite.
Je suis réservée sur votre proposition. En effet, accorder un logement n'est pas prudent car tant que le divorce n'est pas prononcé, Monsieur peut venir s'installer dans le deuxième logement de Madame. Je crois donc qu'il vaut mieux inciter cette dernière à engager une procédure de divorce car, à partir du moment où l'ordonnance de non-conciliation est prononcée, les bailleurs sociaux accordent en général un logement.
L'ordonnance de protection devrait pouvoir s'articuler avec la procédure de divorce et, ainsi, apporter une respiration, un peu de temps.

S'ils ne sont pas mariés, le problème ne se pose pas car la femme peut prendre un logement à son nom. S'ils sont mariés, le bail est aux deux noms.
Vous pouvez modifier la loi pour que les droits au bail des couples non mariés soient les mêmes que pour les couples mariés. Ainsi, que le bail soit aux deux noms ou au nom de Monsieur, la femme victime de violences pourra rester dans le logement.
Si l'on veut que l'ordonnance de protection soit efficace, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, former les professionnels, mais il faut aussi informer les femmes. À cet égard, je rêve d'une grande campagne nationale au moyen d'affiches, de flyers, de petites cartes – comme ceux de la Seine-Saint-Denis que je vous ai apportés –, qui fassent passer aux femmes un message très fort tel que : « Vous êtes en danger, la loi vous protège. » En la matière, la MIPROF, la ministre des droits des femmes et votre Délégation pourraient faire avancer les choses. L'important est de s'adresser aux femmes directement et par tous les moyens – télévision, abribus, etc., afin d'en toucher le plus grand nombre possible, y compris en milieu rural. Comme nous le faisons en Seine-Saint-Denis, ce travail pourrait être mené en lien avec les collectivités territoriales. Il s'agirait alors d'une campagne nationale avec des déclinaisons au niveau local en fonction des moyens des collectivités qui souhaiteraient s'impliquer. Ainsi, cette information s'inscrirait dans la durée, au contraire des campagnes des ministères qui, elles, sont toujours trop courtes. La durée est une vraie garantie de succès. Vous pourriez donc inscrire cette action dans le cadre des budgets nationaux, sachant que le coût des violences faites aux femmes dans notre pays est estimé à 2,5 milliards d'euros – coûts médicaux, coûts des pertes de production, notamment.

Pour la campagne d'information, les sociétés de transport jouent un rôle important : tout le monde remarque une affiche apposée sur un bus. Il faudrait obtenir d'elles la gratuité de l'affichage.
S'agissant des violences psychologiques, le ministère de la Justice n'a pas encore publié de chiffres. S'il y a eu relativement peu d'affaires, des condamnations ont cependant été prononcées et, en Seine-Saint-Denis, douze poursuites ont été engagées.
Je trouve très important que le législateur ait introduit ce délit dans le code pénal. Les violences psychologiques interviennent en effet toujours en amont des violences physiques. Et la société doit dire ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Ainsi, même en cas de preuves insuffisantes, la femme sait que ce qu'elle subit est interdit par la loi.
Les violences psychologiques peuvent être prouvées grâce aux SMS, aux mails et aux messages sur répondeur faisant état, par exemple, de menaces de mort. Ce sont des éléments de preuve tout à fait valables. Dans certains cas, il est donc possible de poursuivre l'auteur. Le tribunal de Seine-Saint-Denis le fait en lien avec l'ordonnance de protection.

Il faudrait aussi prendre en compte la manipulation dont sont victimes les femmes en étant constamment dévalorisées par leur conjoint sur leur physique, leur travail, etc., sans menace par SMS ou autres. Ce problème se pose à tous les niveaux dans la société, et les conséquences sont désastreuses pour les victimes.

Certes, mais le juge a besoin de preuves. Sinon, le risque serait que des femmes dénoncent leur conjoint sans qu'il n'ait rien fait.
Pour ce faire, les psychotraumatologues utilisent des échelles qui leur permettent d'évaluer le degré de traumatisme chez la femme. La Seine-Saint-Denis compte treize consultations de psychotraumatisme, assurées par des psychologues, non remboursées par la sécurité sociale et donc financées par les collectivités territoriales – le conseil général ou la ville. Les consultations des psychologues et psychotraumatologues titulaires d'un diplôme universitaire (DU) ou d'un master de victimologie ou de psychotraumatologie pourraient être remboursées : cela permettrait aux femmes de se faire soigner, mais aussi d'apporter la preuve des violences qu'elles subissent. Le certificat médical du psychologue pourrait être ainsi rédigé : « Mme X. présente un niveau de psychotraumatologie de … qui indique qu'elle est très traumatisée. Les symptômes qu'elles développent sont compatibles avec des violences dans le couple. »
L'audition se termine à dix-neuf heures trente-cinq.
Compte rendu de Mme Edith Gueugneau sur sa participation à la délégation du Forum parlementaire européen auprès de la 57ème réunion des Nations unies sur la condition de la femme (4-8 mars).

J'ai participé à une mission parlementaire organisée par l'ONG « the European Parliamentary Forum on population and development ». J'ai ainsi assisté à la 57ème réunion de la commission sur la condition des femmes de l'ONU. Le thème central de cette session était l'élimination et la prévention de toute forme de violence à l'encontre des femmes et des filles.
EPF est un réseau de parlementaires basé à Bruxelles, qui sert de plateforme pour la coopération et la coordination de ses 33 groupes (ouverts à tous les partis politiques au sein des parlements à travers l'Europe, pour promouvoir et défendre les droits reproductifs et sexuels de chaque individu, l'égalité de genre et l'équité, l'amélioration du statut des femmes et éliminer toute discrimination, coercition et violence à l'encontre des femmes).
La commission de l'ONU sur la condition des femmes se réunit annuellement. Des accords conclusifs sont négociés par les gouvernements des Etats membres pendant les deux semaines de session, accords qui servent aux pays membres de texte de référence pour aborder la législation nationale sur la santé et les droits des femmes et des filles.
L'an passé, la commission de l'ONU sur les droits des femmes a été le théâtre de nombreux débats sur des sujets variés tels que les mariages forcés, le genre et l'égalité de genre, l'éducation sexuelle, la santé sexuelle et reproductive mais aussi sur les pratiques traditionnelles nuisibles aux femmes, le rôle de la famille, les droits des parents. Certains acteurs tels le Saint-Siège ainsi que des associations conservatrices de la société civile ont souvent pour objectif affiché d'empêcher l'écriture de messages forts en direction des femmes.
La délégation de l'Union européenne peut présenter sa position si un consensus a été trouvé parmi les 27 Etats membres ; ses représentants semblent déterminés à parvenir à une position commune et à la conclusion d'un accord, et cela sans compromission dans la défense des droits des femmes
Cette 57ème session de la commission de l'ONU sur la condition de la femme a été un moment crucial dans la perspective des objectifs du millénaire pour le développement 2015. Ces objectifs, comme les conférences du Caire et de Pékin, ont fait considérablement progresser les droits des femmes. Six mille représentants de la société civile y étaient présents, faisant de cette session le plus grand rassemblement international jamais organisé pour mettre fin aux violences contre les femmes.
Bien que 160 pays aient adopté des lois contre les exactions, l'impunité est encore la norme, pas l'exception. Certains pays comme le Vatican, l'Iran, la Russie, tentent de freiner les efforts pour lutter contre les violences faites aux femmes. Ces pays s'opposent ainsi à ce que les relations sexuelles imposées à une femme par son mari ou son compagnon, soient considérées comme un viol.
Des grands progrès ont néanmoins été accomplis. Aujourd'hui, il existe des accords et des traités internationaux visant à assurer aux femmes et aux filles, le respect, la dignité, les choix et la liberté dont tout être humain devrait jouir. Ainsi, 125 pays sont dotés de lois qui sanctionnent la violence domestique. Toutefois 603 millions de femmes vivent dans des pays où la violence domestique n'est pas considérée comme un crime. Il reste beaucoup à faire comme au Cameroun, en Guinée, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Gabon.
Les femmes âgées de 15 à 44 ans meurent plus de violences que du cancer, sida, paludisme réunis. C'est une violation flagrante des droits fondamentaux qui brise les familles, les communautés, coûte aux pays des milliards de dollars ou d'euros tous les ans en soin de santé et en perte de production.
A la fin de la session, la signature d'un accord partagé par l'ensemble des pays membre a été actée. Un paragraphe important de ce texte souligne que « la violence contre les femmes et les filles ne pourrait se justifier par aucune coutume, tradition ou considération religieuse ». L'accord indique aussi que « Les pays doivent traiter et éradiquer les violences domestiques ».
Pour la première fois, ce texte mentionne les droits fondamentaux des femmes en matière de sexualité et de procréation, en pressant les gouvernements de procurer des préservatifs féminins, des soins accessibles physiquement et financièrement, comme la contraception d'urgence ou l'avortement, en cas de violence.
Cette session m'a permis de mesurer la responsabilité des parlementaires qu'il faut impérativement mobiliser sur tous ces sujets.
Les Parlements doivent élaborer et promulguer des lois qui criminalisent la violence conjugale. Tous les pays devraient disposer d'une législation criminalisant la violence à l'encontre des femmes, quelle qu'en soit la forme. C'est pourquoi les Parlements jouent un rôle clef dans le suivi et la mise en oeuvre de la législation. Lorsque les lois ne sont pas appliquées, nous nous trouvons face à un échec de gouvernance, dans l'incapacité de protéger les femmes et les filles contre la violence.
Le rôle du parlementaire est de sensibiliser l'opinion, car une loi n'est efficace que s'il existe des ressources financières et humaines pour la mettre en oeuvre. Aujourd'hui, au sein de la Délégation aux droits des femmes, avec la présidente Catherine Coutelle, je veux que la sensibilisation des élus des territoires soit une priorité, ainsi que la consultation des différents groupes politiques représentés à l'Assemblée nationale, en vue de participer à des actions.
Nous devons renforcer la mise en oeuvre des lois, des politiques, des programmes pour mettre fin aux violences faites aux femmes. Nous avons besoin d'une action efficace et de budgets suffisants pour mettre en oeuvre les politiques décidées.
L'accent devrait être mis sur la prévention qui est un pilier majeur, notamment en s'attaquant aux causes profondes des inégalités sexuelles et en protégeant les droits fondamentaux des femmes et des filles. Il importe de favoriser l'évolution des comportements avec des actions de sensibilisation, des programmes éducatifs, une aide aux enfants et aux jeunes exposés à la violence. Il s'agit de faire prendre conscience à notre jeunesse que les acquis peuvent être menacés.
Cette action de prévention nécessite l'engagement de tous les acteurs de la société, en particulier des hommes et des garçons, partenaires dans la lutte pour l'égalité des sexes. Il faut s'appuyer sur des réseaux, impliquer les collectivités et les associations, pour faire passer le message du caractère prioritaire de la lutte contre les violences faites aux femmes au niveau national comme au niveau international, et de l'autonomie réelle des femmes, qui passe par la libre disposition du corps.
Le volet de la formation est aussi un axe primordial en direction des magistrats, de la police et de la gendarmerie, comme l'accompagnement des auteurs de violences.
Les défis sont grands, nous devons, en tant que parlementaires, redonner de l'espoir mais pour cela il faut agir. Ce sont les actes et non les paroles qui comptent.
Permettez-moi de conclure avec les principaux points évoqués dans la déclaration de notre ministre Najat Vallaud-Belkacem :
- la France fait de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité tant au niveau national qu'au niveau international ;
- la France est attachée au caractère universel des droits des femmes et de tous les droits de la personne humaine ;
- l'égalité entre les sexes passe par l'autonomie économique, par le droit des femmes à disposer de leur corps, et par les droits fondamentaux qui constituent les droits sexuels et reproductifs ;
- la France, avec le gouvernement de M. Ayrault, a pris des mesures fortes portées par la ministre des Droits des femmes, comme la création de la MIPROF ou la réunion du comité interministériel aux droits des femmes fin novembre 2012. Un projet de loi ambitieux sur l'égalité est en préparation. Ce sont là des avancées, même si le chemin à parcourir est encore long.

Je crois en effet qu'il est important que des parlementaires des Délégations aux droits des femmes soient présents dans ces enceintes, afin de montrer que la France s'implique plus que jamais dans ces questions, et aussi pour contrer les éventuelles tentatives de certains pays d'entraîner les droits acquis par les femmes vers la régression, en faisant d'abord adopter des résolutions internationales aux termes ambivalents ou en recul par rapport aux acquis des conférences du Caire et de Pékin. Il nous faut être très vigilants. Je vous remercie donc d'avoir suivi ces travaux très attentivement.
La séance est levée à 20 heures.