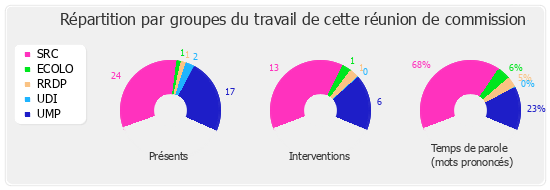Commission des affaires économiques
Réunion du 18 février 2015 à 10h00
La réunion
La commission a auditionné Mme Geneviève Fioraso, secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur et à la recherche auprès de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Madame la secrétaire d'État, c'est votre première audition devant la Commission des affaires économiques, au sein de laquelle vous avez longtemps siégé lorsque vous étiez parlementaire.
Je rappelle que la recherche compte pour 45 milliards d'euros de dépenses intérieures. Il faut ajouter à ce montant le crédit impôt recherche (CIR) auquel notre commission est très attachée. De plus, 542 700 personnes travaillent dans ce secteur, dont 249 000 sont chercheurs : 10 800 dans le public et 148 300 en entreprise. Chaque année 12 000 doctorats sont délivrés. Notre pays est au sixième rang mondial – au quatrième dans le système européen de brevets et au septième dans le système américain de brevets.
La France a reçu trente-quatre prix Nobel dans le domaine scientifique depuis 1901, ce qui la place en pointe. Quant aux médailles, madame la ministre, je connais votre point de vue : les critères mondiaux ne favorisent pas notre mode d'organisation.
Le budget de la MIRES 2015 a été stabilisé à 23 milliards d'euros dans un contexte difficile : il convient de s'en réjouir. Le lien entre la recherche et l'enseignement supérieur, d'une part, et les entreprises, d'autre part, notamment le transfert de technologie, est, à vos yeux, un enjeu majeur pour garantir aux découvertes un prolongement dans l'industrie. Les deux mondes se regardent-ils à l'heure actuelle en chiens de faïence ? Je ne le crois pas.
Qu'en est-il du statut d'étudiant entrepreneur que vous avez créé ? Peut-on être à la fois bon étudiant et bon entrepreneur ? Arrive-t-on à concilier les deux approches ?
Nous sommes attachés aux centres de ressources technologiques et aux centres techniques industriels comme les instituts Carnot, qui permettent d'établir des liens étroits avec les PME. La recherche ne doit pas être l'apanage des grands groupes : pour permettre aux PME d'y avoir accès, il convient de fluidifier leurs relations avec les centres de recherche.
Quel sera le sort de la recherche dans les contrats de plan État région (CPER) 2015-2020 ?
Dans quelle mesure les appels à projet européens sont au service d'une dynamique de recherche ? L'Europe est-elle en retrait par rapport à des pays comme la Chine ou les États-Unis, qui procèdent à des investissements lourds dans le domaine de la recherche ?
La recherche est un levier essentiel pour l'émancipation, tout d'abord, et l'acquisition de nouveaux savoirs, ainsi que pour les emplois à forte valeur ajoutée, notamment d'innovation.
Vous avez rappelé les indicateurs globaux : nous sommes au sixième rang mondial pour les publications scientifiques toutes disciplines confondues. Au cours des dix dernières années, nous avons obtenu huit prix Nobel, quatre médailles Fields – elles sont décernées aux mathématiciens de moins de quarante ans – et un prix Turing – l'équivalent du prix Nobel pour l'informatique. C'est un Grenoblois d'origine grecque qui l'a reçu : Joseph Sifakis.
L'année 2014 a été, pour la recherche française, exceptionnelle : le prix Nobel d'économie a été décerné à Jean Tirole, la médaille Fields au franco-brésilien Artur Avila, le prix Lasker et le prix Breakthrough pour la médecine et les sciences du vivant au professeur Alim-Louis Benabid – un Grenoblois également –, spécialiste de la stimulation électro-cérébrale. Le prix Breakthrough a également été accordé à une jeune biologiste française. C'est la première fois que deux Français se sont vus récompensés par ce prix décerné par Google. Quant au prix Kavli pour les nanosciences, il a récompensé un Alsacien.
L'année 2014 a été également, outre celle de la réussite de la mission Rosetta, celle de la décision, fondatrice, de la construction du nouveau lanceur Ariane 6, qui relance l'Europe de l'espace face à une concurrence internationale très vive. La même année a vu l'implantation d'un coeur artificiel par la société Carmat, grâce à une technologie, certes issue d'Airbus, mais également fondée sur la recherche et la science françaises. Cette implantation, qui est une réussite exceptionnelle saluée au plan international, ne concerne encore que les hommes en raison de la taille du coeur. Des recherches sont actuellement menées pour créer un coeur plus petit, pouvant être implanté sur des femmes. Enfin, l'année 2014 a permis de poser les premiers jalons en matière de diagnostic et de vaccin contre le virus Ébola. Les recherches menées pourront être utiles à d'autres pandémies.
Le champ de nos compétences est donc très étendu.
Les budgets de l'enseignement supérieur et de la recherche (ESR) ont été sanctuarisés par le Gouvernement, dans un contexte contraint. L'ESR est la priorité du deuxième programme des investissements d'avenir (PIA), puisque deux tiers des 12,5 milliards d'euros de la deuxième vague du PIA seront consacrés à la recherche – il convient donc d'ajouter, en termes d'abondement, 1 milliard d'euros aux 15 milliards d'investissements publics et aux 30 milliards d'investissements privés, eux-mêmes encouragés par le CIR. Le budget de la recherche est donc quasiment stable dans le périmètre du ministère depuis deux ans.
L'emploi scientifique public total, titulaires et contractuels réunis, est en croissance, sur la période 2009-2013, de 0,99 % dans les établissements publics scientifiques et techniques (EPST) – cette croissance concerne principalement le CNRS –, de 4,37 % dans les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) – dont le CEA –, et de 2,23 % dans les universités. Le nombre de chercheurs permanents est quasi stable dans les organismes de recherche et le nombre des enseignants-chercheurs est en croissance grâce à la création de 1 000 postes par an durant tout le quinquennat. Au total, la France compte 8,8 chercheurs pour 1 000 actifs, un chiffre supérieur à ceux de l'Allemagne – 7,9 ‰ – et du Royaume-Uni – 8,3 ‰. Si nous sommes distancés par les États-Unis, nous sommes également devant le Japon.
Nous ne saurions pourtant omettre les inquiétudes du secteur ainsi que ses points faibles : le Gouvernement a déjà entrepris d'y remédier.
Les chercheurs s'interrogent à la fois sur la pérennité des succès que j'ai évoqués, sur l'avenir de la recherche fondamentale et sur sa liberté d'exercice. Quant aux jeunes chercheurs, notamment en biologie et en sciences humaines et sociales (SHS), ils s'inquiètent pour leur insertion professionnelle.
De plus, la société, hors du monde de la recherche, doute parfois de la pertinence des réponses que la science et la technologie apportent aux défis des sociétés développées : d'aucuns s'alarment des risques liés à certaines applications. C'est tout l'enjeu du maintien de la confiance à l'innovation. La Commission des affaires économiques, je le sais d'expérience, est très attachée aux notions de progrès et d'innovation. D'ailleurs, le projet de loi dit « Macron » a été l'occasion de rappeler votre attachement au principe d'innovation par le biais de l'adoption de deux amendements.
Une autre faiblesse, objective celle-là, est celle de notre recherche technologique, même si nous avons pris des mesures depuis deux ans pour y remédier. La recherche technologique ne représente en effet que 10 % de l'ensemble de la recherche – un taux inférieur à celui des États-Unis ou de l'Allemagne. Comme la recherche fondamentale, qui représente 50 % de nos crédits de recherche, n'est pas prédictible et bénéficie d'une grande liberté, elle est moins médiatisée, alors que la recherche technologique est davantage sur le devant de la scène car c'est elle qui fait le lien entre la recherche fondamentale et ses applications industrielles, tout en servant de levier à la création d'emplois.
Le Gouvernement a décidé de renforcer les instituts Carnot en y injectant notamment 150 millions d'euros du PIA et en établissant un lien entre ces instituts et les trente-quatre filières industrielles – ce sont les « Carnot 3.0 ». Des plateformes technologiques CEA Tech ont également été mises en place : elles sont plébiscitées par les présidents des régions car elles permettent de faciliter la diffusion des innovations dans le tissu industriel, particulièrement les PMI-PME, en vue de les aider à se transformer en entreprises de taille intermédiaire (ETI). C'est par l'innovation et sa diffusion que nous y parviendrons. Je tiens également à mentionner les instituts de recherche technologique (IRT) et les pôles de compétitivité : ceux qui ont été évalués favorablement ont été renforcés.
Il nous faut développer le transfert, que ce soit dans le domaine des sciences sociales ou dans celui des sciences dites dures ou exactes. Les événements tragiques du mois de janvier impliquent évidemment d'approfondir la recherche sur les fondements du radicalisme, notamment religieux : auparavant, toutefois, il convient de faire un état de la recherche en ces domaines, ce que j'ai demandé à l'Alliance des sciences humaines et sociales, placée sous la présidence d'Alain Fuchs, président du CNRS. Les recherches existantes en la matière sont en effet mal diffusées, notamment auprès des décideurs et des institutions. Il faut rendre plus fluide le transfert de la science vers la société, qu'il s'agisse des milieux socio-économiques ou, je le répète, des décideurs. Lorsque j'étais élue locale, j'avais établi une convention entre la communauté d'agglomération et les universités et les organismes de recherche présents sur le territoire, pour favoriser ce transfert. Qu'il s'agisse du vieillissement ou des facteurs qui concourent à la radicalisation, qu'il s'agisse de la politique de la ville ou de la santé, nous avons tout intérêt à nous appuyer sur les résultats de la recherche. Nous le faisons insuffisamment.
Vous l'avez compris, maintenir l'effort de financement public de la recherche est une priorité : avec un effort total consacré à la recherche de 2,3 % du PIB, la France est encore loin des 3 % définis par la stratégie de Lisbonne – l'Allemagne s'en rapproche. C'est la part du privé qui est trop faible en France, puisque la part de l'effort public, qui s'élève à 0,8 %, est supérieure à celle du Royaume-Uni et du Japon – 0,5 % et 0,56 % – et voisine de celle des États-Unis et de l'Allemagne – 0,86 %. Il convient toutefois d'observer qu'en France la part du privé dans l'effort de recherche est proportionnelle à la part de notre industrie dans le PIB. Si la part du privé est encore insuffisante en France, c'est donc que la taille de notre industrie, y compris des services à l'industrie, a fondu, contrairement à l'industrie allemande. Or c'est l'innovation qui permet à l'industrie d'entrer sur la voie de la régénération. Le CIR est un des outils qui permettra d'y parvenir, aux côtés des instituts Carnot et de tous les dispositifs visant à améliorer la fluidité des transferts.
Il conviendrait également de solliciter davantage les crédits européens : nous sommes encore loin du compte. En effet, alors que la France contribue pour 16 % au budget européen, elle ne retire que 11 % des crédits européens. L'Allemagne, qui est le premier contributeur, retire autant qu'elle verse, à savoir 19 %. Le manque à gagner pour la recherche publique française sur les crédits affectés au programme Horizon 2020 s'élève chaque année à 700 millions d'euros : c'est exactement le budget de l'Agence nationale de la recherche. Certes, parler bruxellois est compliqué. Toutefois, nos chercheurs, qui sont habitués à la complexité de l'administration française, sont mieux armés que d'autres pour face à la complexité de l'administration bruxelloise dont, de plus, la France a contribué à simplifier les procédures en les rendant plus accessibles aux PMI-PME et en améliorant la prise en compte par l'Europe des préciputs – les frais qui environnent les efforts de recherche –, à hauteur de 25 %. Il faut savoir qu'en France l'ANR tourne autour de 10 % et le PIA, malheureusement, autour de 8 % seulement. Il conviendrait de parvenir à 25 %, conformément, du reste, à la demande des chercheurs, qui jugent la prise en compte des préciputs en France trop faible. Nous avons également renforcé l'ingénierie d'accompagnement pour que les chercheurs et les laboratoires français de recherche bénéficient davantage des programmes européens. Il faut parvenir au « un pour un » allemand – les Suisses, quant à eux, sont à trois pour un ; quant à l'investissement britannique, il est également bénéficiaire. Il serait bien que nous soyons récompensés de notre vertu européenne.
En matière de recrutement des docteurs, nous sommes confrontés à une difficulté objective. En effet, le nombre des docteurs diplômés ne cesse de croître, les doctorats étant désormais passés en un laps de temps plus faible – en trois ans ou quatre ans et non plus en six ou sept ans, notamment en SHS. Si, chaque année, 12 000 nouveaux doctorats sont délivrés, dix ans après l'obtention de leur diplôme seuls 25 % des docteurs travaillent dans le privé contre 50 % dans la recherche publique – une proportion inverse à celle du taux de financement des recherches privée et publique. C'est pourquoi nos efforts visent à améliorer la formation des doctorants au milieu de l'entreprise et à les inciter à se tourner vers le secteur privé, dont il convient, parallèlement, de modifier la culture, en le convainquant de la capacité des docteurs à impulser l'innovation de rupture dans les entreprises. Il faut savoir que l'innovation de rupture a un retour sur investissement six à sept fois supérieur à celui de l'innovation incrémentale, qui ne modifie pas les paradigmes. L'acculturation des entreprises est donc essentielle : elle a eu lieu aux États-Unis, en Allemagne et dans l'ensemble des pays où l'équivalent de notre doctorat représente un plus pour être embauché dans le secteur privé. C'est pourquoi j'ai rencontré chacune des branches d'activité et les grandes entreprises du CAC40 pour les convaincre d'embaucher un plus grand nombre de docteurs. Un changement s'opère – les conventions que j'ai signées avec de grands groupes le prouvent : toutefois, il est encore trop faible. Or il convient d'autant plus de l'accentuer que nous sommes confrontés à un problème d'ordre démographique.
En effet, la période de départs à la retraite des baby boomers dans les grands organismes de recherche est derrière nous : le nombre des départs a été divisé par deux. À budget constant, le nombre des entrées se trouve, lui aussi, mécaniquement divisé par deux.
C'est pourquoi j'ai demandé aux organismes de recherche de faire peser tous leurs efforts en matière de gestion des ressources humaines et de primes d'excellence scientifique sur l'insertion des jeunes docteurs. En 2015, pour la première fois depuis dix ans, le CNRS, qui regroupe 35 000 chercheurs, remplacera intégralement les départs à la retraite des chercheurs comme des ingénieurs, des techniciens et des personnels de soutien. Cette mesure, qui comble des faiblesses en ingénierie et en formation des personnels administratifs, permettra d'obtenir davantage de crédits européens.
La création de 1 000 emplois par an pendant cinq ans dans les universités et les regroupements de site contribuera également à accueillir et mieux intégrer les jeunes docteurs.
Nous avons en outre maintenu contre Bercy le soutien de l'État aux conventions CIFRE. Ce doctorat en alternance concerne aujourd'hui 4 000 personnes dont 2 000 en première année. Il permet d'intégrer des jeunes docteurs dans l'industrie : ceux-ci sont embauchés à plus de 96 % par les entreprises au sein desquelles ils sont accueillis.
L'objectif à dix ans est d'équilibrer l'insertion des docteurs entre le secteur public et le secteur privé.
Le Gouvernement a également mis en place une stratégie nationale de la recherche (SNR) afin de répondre à une demande exprimée lors des assises de l'enseignement supérieur et de la recherche. Prévue dans la loi, la SNR a été conçue avec la participation régulière de 400 chercheurs. Nous avons également procédé à une consultation en ligne et réuni des assemblées générales. Cette stratégie vivante bénéficiera, de plus, des échanges prévus dans la loi avec l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), les académies, les alliances et les pays membres de l'OCDE. La stratégie nationale ne saurait être coupée des stratégies internationales : à cette fin, mes services ou moi-même participons à des réunions régulières dans le cadre du G8 et du G20.
Cette stratégie a également été enrichie par le Conseil stratégique de la recherche, qui a terminé ses travaux fin janvier. Elle pourra donc être présentée au Premier ministre et rendue publique dans les trois prochaines semaines.
Il convient enfin de s'appuyer sur le dynamisme des écosystèmes territoriaux. Les vingt-cinq regroupements universitaires, dont vingt communautés d'universités et d'établissements (COMUE) y contribueront : dix-huit sont déjà complètement formalisées, quinze sont passées devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) et deux sont en cours d'achèvement. Ces deux dernières, suscitées par le terrain, sont les plus ambitieuses : inter-académiques, elles concernent en effet, d'une part, la Bretagne et les Pays-de-la-Loire et, d'autre part, le Centre, le Limousin et le Poitou-Charentes. Leur objectif est de regrouper de sept à dix universités.
S'il est nécessaire de prévoir une stratégie nationale, il convient également de faire confiance à la force des écosystèmes. Il ne faut être ni complètement jacobin ni complètement girondin. Les pays les plus dynamiques en matière de recherche s'appuient sur la dynamique de leurs écosystèmes. Cette démarche, encouragée par l'Europe, donnera à nos universités une plus grande visibilité.
La recherche, c'est l'espoir et c'est l'avenir. Hier, j'étais à Matignon aux côtés de Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, pour rencontrer le président de la FNSEA. On n'associe pas immédiatement l'agriculture à la recherche : c'est un tort. Le président de la FNSEA a exprimé le besoin de changer l'image du secteur agricole pour accueillir de nouveaux publics. La sociologie des nouveaux exploitants agricoles est désormais en partie urbaine. Il souhaite s'appuyer sur l'innovation et la recherche pour donner un nouvel élan à l'agriculture – il avait lu un rapport que j'avais rendu sur la biologie de synthèse et la biologie des systèmes.
Tous les secteurs ont besoin de la recherche : qu'il s'agisse des sciences humaines ou sociales, dans la difficile période que nous traversons, ou de la santé, dont les acteurs doivent travailler davantage avec les économistes de la santé ou se former aux pratiques de prévention aux côtés des psychologues ou des sociologues. Nous devons également avoir confiance dans les sciences dites exactes.
Ce sentiment de confiance et ce message d'espoir, nous avons le devoir de le faire partager par l'ensemble de la société en s'appuyant sur une culture scientifique et technique intelligente et ouverte.
La recherche dans tous les domaines est un formidable passeport d'avenir pour la jeunesse de notre pays.

Je tiens à revenir sur les MOOC, à savoir l'enseignement à distance massif en ligne – CLOM en français pour cours libres ouverts et massifs. La plateforme France université numérique – FUN – comptait 400 000 inscrits à l'automne dernier : pourriez-vous nous dresser un tableau des publics visés, tant en formation initiale qu'en formation continue ? Qui est intéressé ? Qui s'inscrit ? La France doit jouer un rôle précurseur dans ce domaine.
Quel bilan tirez-vous, par ailleurs, du lancement du statut d'étudiant entrepreneur et des pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entreprenariat – plan PEPITE ? Le succès est-il au rendez-vous ? Le dispositif est-il suffisamment identifié par les publics visés ? Trop souvent, les jeunes entrepreneurs méconnaissent les dispositifs existants.

Le président Brottes a évoqué le statut national des étudiants entrepreneurs qui permet aux jeunes étudiants et aux jeunes diplômés d'élaborer un projet d'entreprise dans un PEPITE. Dans ce cadre, le diplôme d'étudiant entrepreneur (D2E) permet de mener à bien son projet avec un maximum de visibilité et de sécurité. Quels sont les résultats obtenus à ce jour ?

Le bilan 2014 des laboratoires français établi par l'Agence nationale de la recherche (ANR) n'est pas complètement satisfaisant : alors même que l'ANR est devenue leur principale source de financement, seuls 8,5 % des projets soumis seront financés.
C'est vrai que la France est spécialiste de la non-mobilisation des crédits européens : dans un milieu qui a tendance à regarder de haut la recherche de crédits, une ingénierie dédiée ne serait-elle pas à même de faire ses preuves ? Elle les a déjà faites au sein des collectivités territoriales, notamment. Dans le cadre de la stratégie Horizon 2020 que vous avez évoquée, seule une telle ingénierie permettrait aux laboratoires d'être plus performants dans l'obtention des crédits européens.
Il faudrait par ailleurs redéfinir et redéployer partiellement le CIR en direction des entreprises innovantes, des TPE et des PME notamment, de la recherche publique et de l'enseignement supérieur. Une large partie du CIR est en effet devenue une simple niche fiscale sans impact significatif sur l'effort de recherche. Ne conviendrait-il pas de réallouer quelque 10 % du CIR à la recherche publique ?

Bien que le CIR soit une niche fiscale fortement contestée, la France demeure dans le groupe des suiveurs de l'innovation pointée par la Commission européenne.
Je tiens à vous interroger sur les orientations de la recherche par rapport aux enjeux majeurs que sont la lutte contre le réchauffement climatique ou le développement durable de l'économie, notamment dans le secteur agricole pour assurer la relocalisation, la souveraineté ou la sécurité alimentaires. L'évolution des pratiques agronomiques ne saurait être laissée à la recherche privée, qui favorise la consommation d'intrants.
S'agissant du secteur industriel, quelles recherches sont actuellement menées dans le domaine des énergies renouvelables, des transports efficients ou du développement du numérique ?
L'aménagement du territoire aurait un impact positif écologique sur les sols, l'eau et l'air, c'est-à-dire, en fin de compte, sur la santé humaine et celle de la planète.
Enfin, quelle est l'orientation de la recherche en sociologie pour favoriser la transversalité de la démocratie, de la laïcité, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité dans le développement économique ?
Comment, en effet, accepter un développement économique faisant de la précarité, notamment des chercheurs, la norme ?

Ma première question porte, dans le cadre de l'Agenda France Europe 2020, sur la formation et les infrastructures du numérique. Comment ce plan s'articulera-t-il avec le travail mené par Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État chargée du numérique ? Le décret portant création de l'Agence du numérique a été publié le 3 février dernier. Cette agence a pour vocation de regrouper plusieurs missions, dont le plan « France très haut débit » et le programme « French Tech ». Elle a également pour mission de favoriser la diffusion des outils numériques et le développement de leur usage auprès de la population.
Comment le plan d'action relatif au conseil stratégique de la recherche s'articulera-t-il aux autres dispositifs ? Les territoires qui sont dépourvus de la couverture numérique ont de fortes attentes en la matière.
Je tiens également à vous interroger sur le rapport de la mission agroéquipement, qui vient d'être rendu : il comprend différentes recommandations visant à préparer l'agriculture de demain dans une vision prospective, à encourager l'innovation et à organiser son écosystème et à renforcer les compétences et les moyens de la filière. Quel sort le Gouvernement entend-il réserver à ces recommandations ?

L'examen du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe) a commencé hier : quid de la régionalisation des cartes de formation, qui a été fraîchement accueillie par la Conférence des présidents d'université (CPU) ?
Je ne manquerai pas de le souligner dans l'hémicycle : je regrette que le texte ne fasse aucune référence à la nécessaire réorganisation territoriale du pilotage de l'innovation. Si nous voulons développer l'efficacité territoriale et favoriser l'innovation en région, la gouvernance doit être collégiale et partagée par l'ensemble des acteurs. Le texte n'évoque pas non plus la question de l'audit des agences de développement économique ou des agences de l'innovation sur leur façon de travailler. Ne conviendrait-il pas de les réorganiser, voire de les fusionner ? La pléthore des dispositifs existants entraîne la dispersion des fonds, qui ne sont pas, de ce fait, efficacement utilisés. Que comptez-vous faire pour améliorer la situation ?
Les incubateurs subissent la baisse, il est vrai programmée, des financements de l'État : entendez-vous les voir tous intégrer les sociétés d'accélération du transfert de technologies (SATT) ? Ce serait dommageable car les jeunes pousses issues de la recherche publique ne sont pas les seules concernées : il convient également d'accueillir de jeunes pousses issues du secteur privé ou de grosses entreprises désireuses d'essaimer ou de développer de plus petites unités.
Enfin, s'agissant des financements européens, je tiens à rappeler que la région Alsace a fusionné toutes les agences dédiées à l'innovation pour créer Alsace Innovation, qui est très efficace : un service, très utile aux chefs d'entreprise, y est entièrement consacré à l'accompagnement, à la rédaction et à l'instruction des dossiers européens en vue de récolter et d'utiliser efficacement les fonds européens.

Le projet de loi relatif à la transition énergique pour la croissance verte fixe une nouvelle ambition qui ne pourra être atteinte que si tous les acteurs et toutes les filières industriels se mobilisent et adoptent une stratégie fondée sur un mix énergétique diversifié, dans un usage rationnel et complémentaire des différentes énergies.
Vous le savez, madame la secrétaire d'État, de nombreux scientifiques travaillent sur ces questions essentielles pour notre avenir, qui intéressent un nombre croissant de Français, notamment en matière de stockage de l'énergie ou d'économies d'énergie. La France présidera à la fin de l'année la COP 21 : répondre au défi du dérèglement climatique est un enjeu important.
Quelle place les chercheurs peuvent-ils espérer se voir reconnaître dans la préparation de ce rendez-vous très attendu ? Comment votre ministère s'engagera-t-il dans ce tournant important ?

Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer ensemble votre passion pour la recherche, l'innovation et la culture scientifique lors d'un dîner auquel participaient des prix Nobel invités par M. Accoyer, alors président de l'Assemblée nationale. À l'époque parlementaire de l'opposition, vous étiez intervenue pour souligner qu'un pays qui inscrivait le principe de précaution dans sa constitution était voué à la régression.
Pensez-vous toujours la même chose ? Si oui, avez-vous fait part de votre inquiétude au Président de la République ?

Le projet de loi présenté par M. Macron pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques comprend un principe d'innovation fort.

Vous avez décidé de vous attaquer à l'échec des bacheliers professionnels qui poursuivent leurs études à l'université, rappelant que leur taux de réussite en première année n'est que de 3,5 % : il convient donc d'accueillir les titulaires d'un bac professionnel dans des conditions leur permettant de réussir.
Près d'un tiers de ces bacheliers poursuivent leurs études dans le supérieur : tous ne peuvent s'orienter vers un BTS, en dépit de l'orientation prioritaire des « bacs pro » vers ces formations inscrite dans la loi de juillet 2013.
Or si le taux de poursuite dans le supérieur passe de 30 % à 50 % dans les années à venir, le flux à absorber, qui dépassera 200 000 étudiants par an, sera largement supérieur à la capacité d'accueil des BTS.
Afin de créer une nouvelle filière qui leur serait réservée en priorité, vous avez confié une mission en 2014 à M. Christian Lerminiaux, ancien président de la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Selon sa lettre de mission, cette nouvelle filière post-bac doit offrir « un parcours spécifique et adapté aux bacs pros […] leur permettant d'accéder à un diplôme de niveau III, puis, le cas échéant, à une licence professionnelle ».
Cette nouvelle voie pourrait être dénommée « Section professionnelle supérieure » et déboucher sur un « Brevet professionnel supérieur », qui répondrait aux besoins non satisfaits, exprimés par les milieux professionnels, en qualifications professionnelles nouvelles.
Pouvez-vous nous apporter des précisions en la matière ?

J'ai eu l'occasion de discuter avec un ancien champion du monde qui a souffert de son manque de diplôme pour aborder sa vie après la pratique du sport. Or, alors même que les sportifs de haut niveau intéressent les entreprises, ils sont obligés, dans leur carrière, de privilégier l'entraînement plutôt que l'obtention de diplômes. Ne pourrait-on pas prévoir, comme aux États-Unis, un système de validation des acquis sur le long terme, ce qui impliquerait d'imaginer de nouveaux référentiels ?
Ne pourrait-on pas mieux accompagner les sportifs de très haut niveau ?

Madame la secrétaire d'État, la France aura en 2016 une médaille supplémentaire, puisque M. Patrick Cordier, professeur à l'université de Lille-I, spécialiste de physique des matériaux, sait d'ores et déjà qu'il sera bénéficiaire de la médaille Dana, décernée, pour la première fois, à un chercheur français par la Mineralogical Society of America.
J'ai eu l'occasion de rédiger pour la Commission des affaires européennes un rapport d'information sur le huitième programme-cadre pour la recherche et l'innovation « Horizon 2020 », rapport qui a révélé, non seulement, que notre taux de retour pourrait être meilleur, mais également qu'il est variable d'un secteur à l'autre, voire particulièrement faible dans les secteurs des matériaux et du numérique, secteurs dans lesquels, pourtant, la France est bien positionnée et qui sont pourvoyeurs d'emplois. Nous aurions donc tout intérêt à mieux accompagner nos chercheurs et nos entreprises, d'autant que – c'est le paradoxe français –, si nous n'avons pas un bon taux de retour, nous avons en revanche un très beau taux de succès lorsque nous allons chercher les crédits européens.
Peut-être conviendrait-il de moins disperser nos appels à projet : où en sommes-nous sur ce point ?
Mon autre question porte sur l'inquiétude des présidents des universités et des écoles publiques d'enseignement supérieur qui doivent faire face à des injonctions contradictoires de la part de l'État. Celui-ci, d'un côté, projette de ponctionner leurs fonds de roulement quand, de l'autre, il demande l'établissement de prévisions pluriannuelles. Or les fonds de roulement servent à financer des projets d'investissements étalés sur plusieurs années et à anticiper des problèmes d'immobilier très lourds, dus notamment à la vétusté des bâtiments, d'autant que les crédits des CPER ne sont pas à la hauteur des besoins. Il serait tout de même paradoxal que l'État ponctionne les organismes qui, dans le cadre d'une saine gestion, s'efforcent d'anticiper leurs besoins. Je me permets de relayer ici leur inquiétude.

Vous avez rappelé que l'Allemagne avait, dans le domaine des fonds européens, un retour de un pour un – contribuant pour 19 % au budget européen, elle perçoit 19 % des crédits – quand la France, qui contribue pour 16 % à ce même budget, n'a qu'un retour de 11 %.
Je ne mettrai pas en doute la grande qualité des fonctionnaires français. Toutefois, la concurrence existant entre les différents secteurs décisionnels ne nuirait-elle pas à notre efficacité ?

Vous avez souligné votre attachement aux écosystèmes : or le financement des pôles de compétitivité n'est pas sans soulever des inquiétudes. Les aides relevant du fonds unique interministériel (FUI) seraient à la baisse et de nouveaux critères rendraient plus difficiles l'éligibilité des projets au FUI : ils doivent avoir été labellisés par au moins un pôle de compétitivité – le pôle labellisateur chef de file doit être identifié et obligatoirement figurer en tête de liste des pôles labellisateurs – et comporter des travaux de R&D réalisés en majorité dans les territoires de ces pôles et à 25 % a minima dans le territoire du pôle labellisateur chef de file.
Qu'en est-il exactement ?

Êtes-vous favorable à une plus grande popularisation et démocratisation de l'année de césure ? Les écoles françaises, plus particulières les écoles d'ingénieurs, sont encore trop frileuses pour l'accorder.
Les échanges internationaux figurent dans les objectifs de Business France, notamment l'accueil d'étudiants étrangers qui, formés dans nos écoles d'ingénieurs, seront demain nos meilleurs ambassadeurs dans leurs pays. La France souhaite cibler à la fois des pays à fort potentiel et des disciplines correspondant aux intérêts économiques français : quels sont ces pays et quelles sont ces disciplines ?
Pouvez-vous nous en dire davantage sur cette nouvelle politique de bourses et sur la stratégie d'internationalisation de l'enseignement supérieur ?

En novembre 2014, Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales, Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie, et vous-même en tant que secrétaire d'État chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche, avez présenté le plan maladies neurodégénératives 2014-2019.
Ce plan ambitieux définit quatre priorités, dont l'adaptation de la société aux enjeux de ces maladies pour en atténuer les conséquences sur le quotidien.
Un des enjeux poursuivis dans ce cadre est l'atténuation des conséquences économiques de la maladie. Quels moyens seront mis en oeuvre à cette fin ?
Vous avez abordé le lien entre la recherche et l'agriculture : pour répondre aux enjeux de la mise en oeuvre de l'agro-écologie, l'innovation, l'expérimentation et la recherche sont indissociables de la notion de bon sens : il est en effet indispensable de lier l'expertise scientifique à une pratique issue du bon sens paysan.
En tant que secrétaire d'État chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche, ne pensez-vous pas que l'alternance peut y trouver tout son sens ? Je rappelle que c'était une promesse du candidat Hollande.

De quelle manière se fait le passage de la recherche à la mise en oeuvre industrielle et productive et à son financement ?
Le fait que le CIR soit plébiscité par les investisseurs étrangers – il l'est également par les industriels français – permet aux capitaux étrangers de s'approprier les résultats de la recherche. Une organisation de régulation ne permettrait-elle pas de garantir une appropriation plus nationale des résultats de la recherche dans leur mise en oeuvre industrielle ?
Par ailleurs, la complexité des mécanismes français pour solliciter les fonds européens n'est-elle pas en partie responsable du fait que les Français y ont insuffisamment recours ?

Vous avez évoqué les difficultés objectives, liées notamment à la démographie, auxquelles nos doctorants sont confrontés. Il convient également que les universités approfondissent leur culture d'entreprise – la loi les y incite désormais – afin de favoriser le développement économique et industriel de la recherche. La culture de la recherche et de l'innovation doit se faire en lien avec le monde de l'entreprise. Nous avons encore des progrès à réaliser en la matière. Embaucher des docteurs ne suffira pas : les progrès ne seront pas mécaniques car il faut avant tout persuader le monde de l'entreprise du caractère majeur de cet enjeu.
Nous avons affaire à un double blocage : trop souvent, en effet, la culture de la haute fonction publique et celle des ingénieurs s'opposent.
Quelles mesures prévoyez-vous de prendre pour favoriser le rapprochement des doctorants avec le monde de l'entreprise ? Où en est la publication des décrets facilitant l'accès des docteurs à la haute fonction publique ?

Un stage doit être la rencontre entre le besoin d'un organisme et une structure d'accueil qui peut être une jeune pousse innovante. Parler de recherche, c'est également parler de recherche appliquée.
Or je crains que les contraintes adoptées dans la loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires et qui vise à donner davantage de sens au temps passé en entreprise, n'aboutissent au résultat inverse.
Comment comptez-vous favoriser des stages en entreprise permettant, y compris à des PME, de s'associer à la recherche et de trouver des solutions innovantes ?
Mme Lemaire et moi-même travaillons ensemble à la question du numérique, qui est à ce point transversale, du reste, qu'elle concerne la plupart des ministères, qu'il s'agisse de la simplification administrative, de l'évolution de l'industrie avec les imprimantes 3D ou de la robotique. Le numérique s'invite dans nos vies, y compris dans l'organisation du travail.
Notre plan d'action numérique est cohérent. Les universités et la recherche ne sont pas directement concernées par les problèmes touchant la couverture numérique du fait que, contrairement aux écoles du primaire, les organismes d'enseignement supérieur et de recherche sont tous sur des territoires disposant du très haut débit.
Des solutions existent, auxquelles nous n'avions pas encore pensé, pour faciliter l'accès au numérique : c'est ainsi que des satellites situés à une hauteur raisonnable permettront à des territoires qui ne disposent pas actuellement du très haut débit d'y accéder. Cette solution est également valable pour les pays francophones ou d'autres pays : un protocole a été signé entre Eutelsat par M. Michel de Rosen et des territoires anatoliens qui ne pouvaient pas accéder à internet. Ainsi, internet est désormais accessible à des écoles en plein secteur montagnard.
Nous avons lancé, pour le supérieur, un grand plan numérique francophone qui peut être étendu à l'éducation secondaire – l'enseignement supérieur est dépendant de l'amont : un nombre d'autant plus grand de jeunes issus de milieux ou de territoires peu favorisés accédera à l'enseignement supérieur que ces jeunes auront connu en amont un parcours de réussite. Les assises du numérique de la francophonie, prévues pour le 5 juin prochain et que nous préparons, ont suscité une appétence incroyable. La France dispose de toutes les compétences en matière de recherche et de toutes les solutions techniques pour donner des réponses à la fois en termes d'infrastructures et de contenus. Tel est également l'objet de la plateforme France université numérique évoquée par Mme Erhel : mettre à la disposition du plus grand nombre les contenus très riches de nos établissements d'enseignement supérieur – écoles, CNAM, universités.
Parmi les plus de 400 000 inscrits qui suivent avec assiduité les cinquante-trois programmes de la plateforme figurent non seulement des étudiants, mais également des lycéens qui veulent approfondir certaines de leurs connaissances, des enseignants du secondaire, des salariés des secteurs privé et public et des retraités. Le MOOC sur la guerre de 1914-1918, qui repose sur des témoignages et des objets scannés, a été réalisé par des enseignants d'histoire du secondaire. Les MOOC, qui permettent de partager l'accès au savoir, font rayonner l'université au-delà de ses limites. Quelque dix ministres francophones de tous les continents sont venus à la première réunion, qui était pourtant technique, visant à développer la coproduction de MOOC avec les pays de l'Afrique subsaharienne et du Maghreb.
Les trois MOOC les plus suivis sont, dans l'ordre, le MOOC du CNAM sur le management de l'innovation, le MOOC sur la philosophie réalisée par l'Université Paris-Ouest Nanterre La Défense intitulé « De Socrate à Foucauld » – ce qui révèle un besoin de voir réaffirmer les valeurs fondatrices de la république et de la laïcité – et le MOOC sur la culture scientifique et technique intitulé « QuidQuam ». Nous attendons l'arrivée de trente-cinq nouveaux MOOC, dont un, très attendu, du mathématicien Cédric Villani. Un nouveau MOOC vient de paraître, consacré à Ébola et à la lutte contre les pandémies, réalisé en coopération avec la Suisse et l'OMS et supervisé par le professeur Delfraissy, qui est le coordinateur interministériel de la lutte contre Ébola. Ce MOOC, destiné aux pays touchés, est interdisciplinaire. En effet, les pandémies, en Afrique, ne sauraient être traitées uniquement au plan scientifique : il convient également de prendre en considération les coutumes, notamment les rites funéraires, pour parer à la diffusion de l'épidémie. Nous avons donc besoin, par-delà les compétences médicales ou biologiques, de connaissances en sociologie et en anthropologie. La Fondation Bill-et-Melinda-Gates a compris qu'il convient de s'appuyer sur des communautés et de faire de la coproduction.
Les MOOC permettent de recourir à une pédagogie vivante parce qu'interactive. J'ai visité des universités comme celle d'Albi ou de Brive, qui sont leaders en matière de jeux sérieux ou d' « amphis inversés » : les cours magistraux en amphithéâtre sont remplacés par des clés USB. Parallèlement, des cours sont assurés en configuration plus personnalisée, ce qui correspond aux besoins des étudiants, surtout de première année. La réussite n'est pas qu'une affaire de moyens : c'est également une question de pédagogie. Or le numérique est un outil d'innovation pédagogique et donc un facteur de réussite : les étudiants qui entrent à l'université sont nés avec le numérique. Ils sont habitués à zapper ou à travailler de façon coopérative : le numérique permet de partager les informations dans le cadre d'un travail plus coopératif, qui repose moins sur la performance individuelle.
J'en viens à l'entreprenariat étudiant. 30 % des jeunes, étudiants ou lycéens, ont envie de monter une entreprise ou de créer une activité. Or 3 % seulement le font. Voilà pourquoi nous avons créé le statut d'étudiant entrepreneur qui permet d'avoir accès à un diplôme et surtout d'être accompagné par les « PEPITE », c'est-à-dire des lieux de compétences dans les universités, proches des incubateurs, proches des laboratoires de créativité coopératifs, les fab lab, et d'avoir un tutorat avec un cadre ou un chef d'entreprise. L'activité que le jeune peut créer va de l'économie sociale et solidaire à une association, en passant par une entreprise de technologie de pointe, etc. Les efforts qu'il réalise pour créer son entreprise sont intégrés dans l'obtention du diplôme.
Il est difficile de disposer d'un bilan dès maintenant. On sait que près de 1 000 étudiants ont demandé ce statut. On a surtout instauré un accès à la culture d'entreprise pour l'ensemble des étudiants qui le souhaitent, qu'ils soient en sciences humaines et sociales, en sciences exactes, en sciences économiques. 100 000 étudiants ont demandé d'avoir accès à ces formations.
La culture des entreprises s'acquiert aussi dès l'université. Il est clair que la responsabilité du blocage entre le public et le privé est partagée, c'est-à-dire que l'académie se méfie de l'entreprise et vice versa. Les barrières sont faites pour être détruites. Vous avez bien compris que nous essayons de rendre les choses davantage transversales parce nous sommes confrontés à des enjeux de plus en plus complexes. On a besoin des sciences sociales pour comprendre les sciences humaines, et des sciences exactes pour trouver des solutions à la fois dans la recherche fondamentale et dans la recherche technologique. Les instituts de recherche sont dynamiques, et c'est le cas dans le domaine de la santé. Je pense à l'Institut du cerveau, à l'Institut Imagine, lieu de recherche contre les maladies rares, aux plates-formes à Strasbourg avec le professeur Marescaux, à l'Institut de la vision. Ce sont des endroits où la recherche fondamentale est internationalisée et où l'on trouve le public concerné puisqu'ils sont près d'un milieu hospitalier voire dans l'hôpital.
31 % chercheurs du CNRS et plus de 40 % de nos thésards sont étrangers. Il ne faut pas avoir peur que les étudiants partent à l'étranger et d'accueillir des étudiants étrangers. Plus de 50 % de nos étudiants étrangers viennent des pays de la francophonie, du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. Il est donc essentiel de conserver cette influence de la francophonie qui véhicule des valeurs importantes sur les plans culturel et sécuritaire. Et comme ces pays connaissant une croissance de 5 à 6 % par an, ce sont aussi de véritables leviers pour nos exportations.
Les étudiants chinois vont davantage étudier dans les universités anglo-saxonnes qu'en France ou dans le reste de l'Europe qui sont pourtant des interlocuteurs culturels naturels. Nous n'accueillons pas non plus suffisamment d'étudiants d'Amérique latine ou des pays asiatiques. Nous voulons attirer davantage les pays émergents, les Indonésiens, les Japonais, les Chinois. Nous y parviendrons en leur proposant des cours en Anglais. D'où l'article 2 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et la recherche. Cet enseignement en Anglais aidera aussi nos étudiants et nos chercheurs, non seulement à faire de bons exposés, mais à répondre de façon pertinente aux questions. On peut regretter que l'Anglais soit devenu la langue internationale dans le domaine scientifique, mais c'est ainsi. Il est donc important de le maîtriser. J'ajoute que lorsque l'on parle plusieurs langues étrangères, on maîtrise d'autant mieux sa propre langue. Il faut s'ouvrir au monde car, plus que tout autre secteur, la recherche n'a pas de frontières.
Le travail réalisé avec les pays de la francophonie est différent de celui qui était effectué il y a une dizaine d'années. L'idée, ce n'est pas que les chercheurs désertent leur pays mais qu'ils y retournent et que cela permette des collaborations beaucoup plus fortes. Nous sommes dans une coopération d'égal à égal qui n'a rien à voir avec la coopération issue des années postcoloniales. J'insiste toujours pour que l'Europe soutienne davantage le dialogue 5 + 5 et toutes les initiatives Partnership for research and innovation in the mediterranean area (PRIMA) de coopération avec ces pays. Les Chinois ne s'y sont pas trompés puisqu'ils sont très présents dans ces pays.
En ce qui concerne la stratégie nationale de recherche, nous sommes déjà très présents dans le domaine de l'agriculture et du développement durable. S'agissant de l'agriculture, notre investissement est deux fois supérieur au pourcentage que représente l'agriculture dans notre PIB. Nous voulons une alimentation durable, traçable, sûre, des méthodes agricoles modernes qui se fondent sur le biocontrôle, sur les capteurs, sur les dispositifs techniques et qui soient plus respectueuses de l'environnement. Il n'est pas normal que la France soit le pays qui utilise le plus de pesticides. L'agro-écologie, ce n'est pas un retour en arrière, c'est un bon en avant vers une agriculture qui respecte davantage le développement durable, qui utilise moins de pesticides, qui soit très moderne, qui améliore la productivité, qui contribue à nos exportations et nous permette de nourrir 9 milliards d'individus dans le monde. Là aussi, l'espace nous aide parce que nos meilleurs indicateurs sur la déforestation et sur l'épuisement des sols sont des images qui nous viennent de l'espace. Que ce soit dans le domaine de la santé, des matériaux, de la connectique, de la cryogénie, l'espace est un formidable pourvoyeur d'innovations. Tout ce que l'on teste en milieu extrême peut ensuite être utilisé, déployé et disséminé, diffusé grâce à la recherche technologique.
L'Institut national de la recherche agronomique (INRA) est connu dans le monde entier pour ses recherches fondamentales et appliquées. Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a développé une recherche fondamentale et partenariale très importante dans ce domaine. En matière d'agroéquipements, de biocontrôle et de biotechnologies, y compris végétales qui ont parfois donné lieu à des débats assez vifs, il faut laisser toutes les portes ouvertes et examiner les choses avec la plus grande sérénité. La biologie des systèmes et la biologie de synthèse auxquelles s'intéresse Xavier Beulin, le président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), sont aussi des pistes formidables. Il ne faut pas avoir peur du débat car il fait partie de la démocratie ni de prendre ses responsabilités avec courage car c'est ce que l'on attend aussi des politiques.
S'agissant de la loi NOTRe, pour respecter la vivacité et la réactivité des écosystèmes, moins on norme, plus on a de chances que l'innovation soit présente. Ce n'est pas du libéralisme, ce n'est pas du laisser-faire. Comme vous l'avez dit, madame Rohfritsch, il y a une trop grande complexité dans les territoires. Il faut donc qu'ils fassent le ménage. J'avais constaté que ma région comptait plus de 600 structures d'aides à l'innovation. Après ce recensement, il avait été procédé aux regroupements nécessaires.
Vous avez raison, il faut préserver la mission des incubateurs, de la même manière que l'on ne doit pas tout englober dans les sociétés d'accélération du transfert de technologies (SATT). Souvent, l'innovation s'appuie aussi sur des compétences, sur une histoire. En tant que bonne praticienne d'un écosystème reconnu, je peux vous dire que l'histoire de l'innovation s'inscrit paradoxalement dans des pratiques et une expérience confirmées de travail entre des PMI-PME, le secteur public et le secteur privé. Si nous ne sommes pas très présents dans la loi NOTRe, c'est aussi parce que nous n'avions pas envie que la norme soit la même pour tous les territoires car c'est antinomique avec l'innovation. Je crois n'avoir jamais dit que le principe de précaution allait induire de la décadence. J'ai indiqué que ce principe, inscrit dans la Constitution par Jacques Chirac et Michel Barnier au titre de l'environnement et de l'impact sur l'environnement, après des jurisprudences successives, avait été élargi à bien d'autres secteurs et que s'il n'était pas contrebalancé par une dynamique d'innovation, on allait s'enkyster et prendre du retard par rapport à d'autres pays. Le projet de loi pour la croissance et l'activité comprend deux amendements de Mme Anne-Yvonne Le Dain et M. Jean-Yves Le Déaut qui réhabilitent l'innovation, et c'est une bonne chose. Le principe de précaution et l'impact sur l'environnement ne sont pas antinomiques avec le principe d'innovation dès lors que l'on a un cadre juridique, car nous avons abouti à des dérapages inadmissibles. Vous vous souvenez sans doute que le tribunal de Bobigny s'est prévalu de ce principe de précaution pour interdire, en 2009, l'installation d'antennes de téléphonie. Il faut donc rappeler le principe d'innovation. Nous l'avons fait et vous devriez en être satisfaits.

Le gouvernement de l'époque m'avait demandé de présider le comité opérationnel (COMOP) chargé de traiter de la relation rationnelle entre les ondes électromagnétiques et nos concitoyens. Tout cela pour vous dire que j'ai l'habitude de gérer des choses faciles !
Dans la loi NOTRe, l'emprise régionale était trop forte sur l'enseignement supérieur et la recherche, ce qui avait suscité, à juste titre, une réaction de la Conférence des présidents d'université (CPU). Nous avons introduit deux amendements qui visent à préserver cet équilibre entre le respect des écosystèmes et un accès égalitaire à tous sur l'ensemble du territoire. Mais nous ne souhaitons pas trop légiférer car tout le monde ne peut pas entrer dans la même chaussure. On ne peut pas comparer Bordeaux, Strasbourg, Grenoble, Toulouse, Paris intra-muros et l'Île-de-France.
S'agissant des incubateurs, nous avons rétabli une subvention pour pouvoir prendre en compte les spécificités locales. Nous avons donné les directives nécessaires à notre direction.
Monsieur Giraud, les financements de l'Agence nationale de la recherche (ANR) ne représentent pas l'essentiel des budgets. Lorsque l'on parle du financement de la recherche, on oublie trop souvent de prendre en compte les salaires. Notre pays compte un grand nombre de chercheurs puisque nous sommes devant l'Allemagne et le Royaume-Uni. Notre modèle français est spécifique puisque notre financement est pérenne à 90 %, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays où l'on a souvent un équilibre de 60 % de financements pérennes et 40 % de financements sur projet. Nous ne tenons pas à déséquilibrer notre modèle auquel nos chercheurs sont très attachés. Nous sommes une exception culturelle, scientifique mondiale et c'est ce qui explique que notre recherche fondamentale soit d'aussi bonne qualité. Si notre système n'est pas menacé, pour autant il nous faut développer davantage la recherche technologique par les instituts Carnot, les plates-formes technologiques, les Centres techniques industriels (CTI) et nous le faisons avec force.
7,7 milliards de crédits sont dédiés à la recherche auxquels il faut ajouter 3,8 milliards puisque 50 % du temps des enseignants-chercheurs est consacré à la recherche. À cela, il faut ajouter ce qu'affectent les autres ministères ainsi qu'un milliard d'euros annuels du Programme d'investissements d'avenir (PIA), ce qui fait que l'on arrive à plus de 15 milliards d'euros de fonds publics, à comparer avec les 600 millions d'euros du budget de l'ANR.
Nous avons mis en place une nouvelle méthode qui a été moyennement comprise par les chercheurs. Nous avons voulu un affichage par grand enjeu sociétal et ainsi se rapprocher du modèle Horizon 2020 selon de grandes thématiques sociétales et faire en sorte que le passage de la demande de financement national à la demande de financement européen se fasse plus facilement et que les citoyens comprennent mieux. Cela favorise le dialogue science-société.
À la demande des chercheurs, nous avons simplifié les thématiques et fait une sélection en deux temps : dans un premier temps, on demande un résumé et l'on procède à une présélection et dans un second temps un dossier plus approfondi doit être présenté. Lorsque l'on demande un résumé de trois ou quatre pages, on a un plus grand nombre de candidats – le nombre de dépôts a doublé –, ce qui fait que le pourcentage de reçus est moindre. Mais on est au même niveau que l'Europe, c'est-à-dire autour de 8 à 9 %, ce qui n'est certainement pas assez.
Le nouveau directeur de l'ANR est d'origine américaine. Il a travaillé en Suisse et connaît bien le milieu international. Il va collaborer davantage que ses prédécesseurs avec le ministère et c'est utile. Ce n'est pas à l'ANR de définir les programmes. C'est un outil au service de l'État et d'une stratégie nationale. L'agence avait pris trop d'autonomie faute de stratégie. L'État doit prendre ses responsabilités. La loi prévoit que la stratégie nationale, qu'il faut voir comme quelque chose de vivant, d'évolutif, pourra être discutée à l'Assemblée nationale.
Nous faisons tout notre possible pour stimuler les chercheurs, les laboratoires. Les regroupements vont abriter de plus en plus d'unités mixtes, le CNRS ayant signé des conventions avec la plupart des grands regroupements. Il ne s'agit pas d'une fusion à marche forcée. Ces regroupements permettront une meilleure expertise, une meilleure ingénierie pour accompagner l'accès aux financements européens.
Le Conseil européen de la recherche, qui est présidé par le mathématicien français Jean-Pierre Bourguignon, encourage la recherche fondamentale, celle qui fait vraiment la différence quand elle est diffusée dans les entreprises. C'est ce que l'on appelle les innovations de rupture qui nous permettent de nous différencier vraiment en matière de compétitivité de nos entreprises. Dans ce domaine, notre taux de réussite est vraiment bon. Seulement, nous ne faisons pas suffisamment de propositions. Là aussi, l'ANR, en harmonisant son programme avec le grand programme Horizon 2020, avait cette volonté d'acculturer davantage les chercheurs français aux programmes européens.
Nous avons instauré Les Étoiles de l'Europe, c'est-à-dire un système de récompense des meilleurs projets européens dans des domaines très variés. On sollicite les entreprises, les organismes, ce qui stimule les chercheurs et leurs équipes. Par ailleurs, les Keys enabling technologies (KETs) mettent en place cette culture des partenariats entre le public et le privé que Christophe Borgel plébiscitait à juste titre. C'est ce qui nous permettra d'insérer davantage nos jeunes chercheurs dans les entreprises privées. Je veux à nouveau rendre hommage aux Conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE) gérées par l'Association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT). C'est un exemple de doctorat en alternance qui est extrêmement bénéfique et qui fonctionne très bien.
S'il y a des blocages, c'est parce que l'on recrute moins de fonctionnaires de la haute fonction publique. Certaines écoles, dont l'ENA, veulent favoriser la promotion interne. Du coup, elles ne regardent pas toujours d'un oeil très favorable les apports externes que nous souhaitons. Cela dit, nous avançons. Récemment, le Conseil d'État a précisé que le dispositif concernait la plus grande partie de la catégorie A et que l'insertion des docteurs concerne non seulement l'organisation de nouveaux concours mais aussi l'adaptation des concours existants. Nous avons reçu une écoute très favorable de l'ENA et de l'École polytechnique qui souhaitent que leurs étudiants passent davantage de thèses et s'intéressent davantage à la recherche. Qui aurait imaginé, il y a encore deux ou trois ans, voir des cartes de visite sur lesquelles sont inscrites à la fois les mentions « École polytechnique de Paris » et « Université Paris-Saclay » ? On arrive à rapprocher ce système dual très français qui pénalisait les docteurs issus de la formation académique, ce qui permettra d'intégrer davantage de docteurs dans le secteur privé. En tout cas, nous y mettons toute notre énergie et nous travaillons filière par filière. De grands groupes comme Schneider Electric ont signé des conventions. Le président de bioMérieux est aussi président d'une Communauté d'universités et d'établissements (COMUE), ce qui prouve à quel point il se fonde sur l'université. Il fait très souvent l'apologie des partenariats entre des groupes industriels et des universités. Airbus effectue aussi tout un travail de promotion des doctorants, et en particulier des doctorantes dans un secteur qui ne parvient pas à attirer suffisamment de femmes.
De nombreux programmes de recherche concernent le développement durable. Je pense aux énergies alternatives. Madame Battistel, vous savez que l'Institut national de l'énergie solaire implanté en Savoie travaille avec la direction de la recherche technologique du CEA, le CEA Liten et le CEA Leti. Je citerai aussi tout ce qui concerne l'efficacité énergétique dont on parle peu mais qui fait vraiment appel aux logiciels. Comme vous le disiez durant le précédent quinquennat, monsieur le président, – et j'espère que vous continuez à le dire – la meilleure énergie, c'est celle que l'on ne consomme pas.
Pour ce faire, il est nécessaire d'avoir des systèmes intelligents. Ce n'est pas le disjoncteur qui est intelligent mais le logiciel. Là aussi, nous disposons en France de grands groupes qui peuvent le faire.
J'en viens au bac pro, sujet qui me tient à coeur car on assiste, dans ce domaine, à un massacre social. Actuellement, sur 600 000 bacheliers, 30 % sont titulaires de bacs professionnels, 20 % de bacs technologiques et 50 % de bacs généralistes. Les bacs pros ont été créés il y a quarante ans environ, ce qui correspondait alors à une demande de notre industrie qui avait besoin d'une montée en puissance des qualifications. Or depuis, tandis que notre industrie a perdu près d'un million d'emplois, les nouvelles industries ont monté en qualification, ce qui implique qu'un élève sur deux poursuit des études après le bac. Certains sont en BTS, d'autres en alternance, d'autres vont à l'université. Chaque année, 180 000 jeunes vont dans l'enseignement supérieur. Or ils ne sont absolument pas formés pour réussir à l'université. S'ils ne réussissent pas, ce n'est pas parce qu'ils sont moins doués, mais parce qu'ils ont été habitués à être en petit nombre et à être encadrés. Ils n'ont pas été habitués à la prise de notes, à l'enseignement conceptuel. Seulement 3,5 % réussissent leur licence en trois ans et un peu moins de 5 % réussissent leur première année. Comme 80 % d'entre eux sont issus des milieux les moins favorisés, je trouve qu'il y a là un massacre social. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de ces jeunes qui souvent vivent dans les quartiers qui ne sont pas les plus favorisés ou dans des territoires très ruraux éloignés des pôles de compétences.
Pour autant, faut-il charger la seule université de la formation de ces jeunes ? Je ne le crois pas parce qu'il est compliqué d'avoir des niveaux aussi hétérogènes en première année. Il faut donc agir avant, c'est-à-dire au niveau de ce que l'on appelle le -3 +3. Voilà le sens de la mission qui a été confiée à Christian Lerminiaux, l'ancien président de la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs (CDEFI) qui connaît aussi bien le secteur académique, le secteur privé, les ingénieurs que les standards internationaux. Nous lui avons indiqué des orientations pour qu'il les confronte au réel, c'est-à-dire aux besoins du milieu économique et à ce qui se fait dans les lycées car aujourd'hui on oriente souvent par défaut les jeunes dans les filières professionnelles parce qu'ils ne réussissent pas ailleurs. Voilà pourquoi je souhaite que la voie professionnelle et technologique soit valorisée. J'emploie à dessein le mot « voie » et non celui de « filière » pour éviter une fois de plus d'enfermer les élèves. Peut-être disposons-nous déjà des éléments avec le BTS, les licences pros, les IUT, les passerelles vers les écoles d'ingénieurs et qu'il suffit d'assembler les pièces du puzzle pour donner davantage de visibilité et de valeur à cette voie. Nous disposerons d'un rapport d'étape à la fin du mois de mars. Je peux juste vous dire que M. Lerminiaux travaille avec l'éducation nationale car il est indispensable que ce travail soit fait en commun. Nous parlerons à la fois orientation, progression, passerelles et anticipation des besoins de l'industrie dans les nouvelles filières comme l'agro-écologie, les technologies numériques, le développement des énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la robotique, bref toutes ces filières industrielles que nous voulons développer.
Je me suis battue pour que l'on ne siphonne pas les fonds de roulement des universités car je souhaite qu'elles continuent à investir. Par ailleurs, je ne voulais pas que celles qui sont bien gérées soient pénalisées. Pour avoir les réponses les plus objectives possible et un dialogue fructueux et constructif avec Bercy, nous avons mandaté une inspection commune entre le ministère des finances et celui de l'enseignement supérieur et la recherche pour analyser budget par budget, université par université, ces fonds de roulement. Nous ferons la même chose pour les écoles d'ingénieurs et d'ici un mois nous serons en mesure de fournir des éléments chiffrés.
Le fonds de roulement des universités et des établissements qui dépendent directement du ministère s'élève à 1,5 milliard environ. Le rapport indique que la partie libre représente près de 25 %. Lorsque l'on analyse les budgets de façon très précise, on constate que ce sont moins de 400 millions d'euros qui sont ainsi mobilisables, le reste étant destiné à des projets structurants ou à des travaux de sécurité. Pour autant, va-t-on mobiliser 400 millions d'euros ? Non, parce qu'il faut garder de l'argent pour des investissements utiles. Nous nous sommes engagés à mobiliser 100 millions d'euros sur le budget 2015 et 100 millions d'euros sur les fonds de roulement. Ce sont donc 200 millions d'euros qui seront utilisés pour augmenter notre aide en direction des universités.
Il faut le dire : il n'y a pas de trésor caché, les présidents d'université ne sont pas des Picsou, ils ne sont pas assis sur un tas d'or. Malgré tout, on peut solliciter un peu d'argent. Nous avons fixé un curseur, ce qui fait que beaucoup d'universités vont échapper à cette ponction ponctuelle sur les fonds de roulement. C'est aussi une incitation à ce qu'elles investissent. À la télévision, j'ai vu un reportage qui montrait des fuites ou des toilettes bouchées dans une université alors que je savais qu'elle disposait d'un fonds de roulement de trois mois – on estime la durée prudentielle des fonds de roulement à un mois. Avec un tel fonds de roulement, on doit être capable d'appeler un plombier pour lui demander de réparer des sanitaires bouchés ou une fuite.
Les plans Campus permettent d'investir dans l'immobilier. À Lille, par exemple, j'ai eu le plaisir de signer, avec Pierre Moscovici, le premier emprunt fait à la Banque européenne d'investissement (BEI). Par ailleurs, un décret impulsé par mon ministère prévoit que les universités peuvent être managées librement, ce qui leur permet de contracter des emprunts quand leur trésorerie le leur permet. La BEI avait dégagé plus de 3 milliards d'euros pour les universités, celle de Lille ayant été l'une des premières signataires.
En termes de développement durable, la convention que l'on a signée avec la Caisse des dépôts et consignations à Strasbourg, en avril 2013, permet que soient financées toutes les études liées à la mise en efficacité énergétique des universités qui ont souvent été construites dans les années 70 et qui sont de vraies passoires. Nous sommes actuellement, c'est vrai, dans une période ingrate de travaux, mais je suis sûre que mes successeurs ne manqueront pas de se prévaloir de tous ces projets que nous avons débloqués. Quand je suis arrivée au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, alors que cela faisait cinq ans que les plans Campus avaient été mis en place, seulement 58 millions des 5 milliards prévus initialement avaient été engagés. Or, lorsque des projets relatifs à l'innovation ne sont pas encore concrétisés cinq ans après, on peut se dire que l'innovation n'est plus très innovante.
Vous savez qu'il avait été prévu que, quelques années après leur lancement, les pôles de compétitivité puissent s'autofinancer. Nous regardons cela de près avec l'industrie. Là aussi, nous ferons attention aux écosystèmes et aux spécificités. En tout cas, nous nous y sommes engagés.
Nous faisons attention aussi à ce qu'il y ait une juste répartition entre les plates-formes technologiques, le CEA Tech, les instituts de recherche technologique et les pôles de compétitivité pour que chacun soit bien dans sa mission et que l'on ne crée pas à nouveau un millefeuille où chacun défendrait son pré carré plutôt que l'intérêt général. Chacun est dans cet état esprit, qu'il s'agisse des partenaires publics ou privés. Nous avons bien conscience que l'urgence consiste à impulser de l'innovation car c'est de cette manière que l'on sauve des emplois.
Nous sommes très sensibles à l'année de césure. J'ai défendu la proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires car il y avait trop d'abus en la matière. Il était inadmissible de voir que certains instituts de sondage, certaines agences de communication fonctionnaient à 80 %, voire à 90 %, avec des stagiaires. D'ailleurs, on peut se demander si le peu de justesse de certains sondages lors d'élections municipales n'était pas lié à une utilisation abusive de stagiaires assez peu formés. Et il est anormal de demander à un stagiaire de savoir parler plusieurs langues et d'avoir des compétences en matière de management et de ressources humaines. À ce moment-là, il ne s'agit plus d'un stage.
Pour que les jeunes aient une meilleure image du secteur privé, il convenait aussi de mettre fin à des abus. Cette loi permet à la fois de protéger les jeunes et de favoriser les stages. La loi Cherpion de 2011 n'avait pas du tout obéré le nombre de stagiaires, puisqu'elle avait permis de passer de 600 000 à 1,2 million de stagiaires. Les années de césure peuvent parfaitement s'adapter avec des statuts différents. Nous nous sommes adaptés également à la spécificité des maisons familiales et rurales et des stages agricoles en trouvant les amendements nécessaires, notamment au Sénat où le débat a été très fructueux.
Nous avons présenté, avec Marisol Touraine et Laurence Rossignol, un plan sur les maladies neurodégénératives. Des progrès formidables ont été réalisés en matière de recherche. Il existe un grand programme européen, le Human brain project, et un sommet du G8 sur la démence a eu lieu, le G8 dementia. Nous avons beaucoup de mal avec le mot français de « démence » que nous associons à la sénilité, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. C'est pourquoi nous préférons parler de maladies neurodégénératives. Au plan international, nous disposons des meilleurs atouts scientifiques et des meilleures équipes scientifiques. La recherche est de qualité et le nombre de programmes lancés est à la hauteur des défis. Il faut savoir qu'actuellement 800 000 personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer en France. Mais quand on ajoute celles qui souffrent de la maladie de Parkinson ou d'autres maladies neurodégénératives, on aboutit à près de 1,5 million de personnes. Plus nous vivrons vieux – et c'est une bonne nouvelle –, plus le nombre de malades s'accroîtra mais plus on saura prévenir ces maladies. Nous avons aussi introduit les sciences humaines et sociales parce que tous nos efforts étaient concentrés sur les sciences exactes et pas assez sur les sciences humaines et sociales. Or on sait bien que l'entourage doit être préservé et aidé grâce à un parcours de soins mais aussi un accompagnement social, certains proches succombant parfois par épuisement. Le numérique joue aussi un rôle. En effet, parce qu'il n'existe pas de dossier patient sécurisé, on fait parfois faire au patient le même examen trois ou quatre fois. Or on sait que chez une personne âgée fragilisée, cela peut accélérer le processus neurodégénératif.
Nous avons fait tout ce qui était possible pour fluidifier le transfert de la recherche publique. La loi de juillet 2013 prévoit un mandataire unique de la propriété intellectuelle pour les brevets en copropriété publique. Mais le Conseil d'État a mis un an et demi pour signer le décret. Il est enfin paru et nous en sommes très satisfaits car cela va permettre de faciliter la vie des start-up. Le temps de mettre d'accord les cinq copropriétaires d'une invention, les start-up avaient le temps de mourir. J'avais même reçu une délégation de Japonais qui était intéressé par l'achat d'une licence. Pour les rassurer, je leur avais dit que même s'il y avait cinq copropriétaires, le CNRS était leader. Ils m'avaient alors demandé s'ils pouvaient acheter le CNRS !

Madame la secrétaire d'État, vous avez beaucoup parlé de votre attachement aux écosystèmes. Je vois notre rôle de parlementaire comme celui d'une mise en relation. En tout cas, c'est ce que je constate quand je vais visiter un laboratoire ou une entreprise dans ma circonscription. Aussi, je souhaiterais qu'à l'avenir les parlementaires soient informés un peu plus en amont des Étoiles de l'Europe car ils peuvent jouer un rôle de promoteurs des lauréats de leur territoire, de leur circonscription ou de leur département.
Vous avez parlé d'orientation. À Lille, une suggestion a émergé de manière très concrète qui vise à permettre que la réserve citoyenne que le Président de la République et le Premier ministre ont appelé de leurs voeux puisse servir aussi à l'orientation des élèves des collègues ou des lycées parce que l'on sait bien que si les élèves qui habitent dans les quartiers en difficulté ne rêvent pas de devenir chercheur, avocat ou chef d'entreprise, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ces métiers-là. Des bénévoles pourraient se rendre dans les établissements tout simplement pour expliquer aux élèves ce qu'est leur métier, afin de les faire rêver et de les inciter à devenir eux-mêmes un jour avocat, chercheur, chef d'entreprise, etc.

Madame la secrétaire d'État, je vous remercie pour votre disponibilité car il est important que nous puissions aller au fond des choses.
(Présidence de Mme Frédérique Massat, vice-présidente de la Commission)

Madame la secrétaire d'État, je vous prie de m'excuser de ne pas avoir pu être présent tout à l'heure, le Bureau de l'Assemblée nationale dont je suis membre se réunissant ce matin.
Je suis très attaché au développement de votre secteur qui constitue un atout pour l'avenir de la France qu'il nous faut préserver. Je sais que le monde de la recherche est inquiet. La recherche a besoin de chercheurs. Comment créer les conditions d'une meilleure confiance en matière de budget, de postes, de statut, de précarité ? J'ai été sollicité par des laboratoires, des institutions qui se disent en souffrance.

Madame la secrétaire d'État, je vous remercie pour votre soutien sans faille sur le dossier du laboratoire souterrain de Modane, même si j'ai bien compris que les budgets étant ce qu'ils sont, nous ne sommes pas sûrs de gagner. Ce n'est jamais facile d'être sur une matière aussi particulière et ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas rapidement de nouvelles pistes pour la recherche mondiale qu'il faut abandonner. Cela suppose quelques investissements complémentaires. Il est urgent de prendre une décision.
En ce qui concerne l'orientation des élèves, nous avons essayé de simplifier le système de l'admission post bac (APB). Même s'il était compliqué, il était tout de même meilleur que les bousculades que l'on a pu connaître les uns et les autres à la fac. Pour autant, il ne faut pas faire l'impasse sur l'information. Pour que le système APB ne soit pas une source d'anxiété pour les familles, il est nécessaire que, très en amont, c'est-à-dire dès la classe de seconde ou de première, les métiers puissent être présentés et qu'il y ait davantage de porosité entre la connaissance des métiers et le parcours scolaire des jeunes. Lorsque l'on a autour de soi un réseau relationnel suffisant, on arrive à se repérer. En tant qu'élu, j'ai dû accompagner à de nombreuses reprises des jeunes dans la recherche de leur stage de troisième parce que dans leur quartier ils n'avaient le choix qu'entre une société de vigiles ou un hammam. Ils se retrouvaient alors dans le milieu dans lequel ils vivaient déjà et le stage ne leur ouvrait pas des voies nouvelles. Or les stages de troisième sont faits pour confirmer ou infirmer des envies, découvrir des milieux professionnels nouveaux. Combien de fois j'ai vu des curriculum vitae discriminés par le nom ou par l'adresse, combien de fois on est venu me demander ce qu'était une classe préparatoire ou une université et comment y entrer. J'ai bien vu que ceux qui venaient demander des informations ne bénéficiaient pas de cet environnement qui permet de décrypter une offre de formations souvent complexe.
Nous avons donc simplifié l'offre de formations, ce qui du reste m'a valu quelques pétitions peu sympathiques. Mais il faut assumer de ne pas toujours être populaire quand on est au Gouvernement. Nous sommes passés de plus de 5 800 intitulés de master à 400. Cette prolifération de masters rendait totalement illisible notre offre de formations, tant pour les étudiants que pour les entreprises. On ne peut pas demander aux entreprises d'embaucher davantage de docteurs issus du système académique, davantage de jeunes issus de master plutôt que des jeunes issus des écoles d'ingénieurs, de commerce ou de management alors que les intitulés des formations sont incompréhensibles. La simplification a porté également sur le nombre de licences, puisqu'on est passé de 1 800 intitulés de licences générales à moins de 200. Quant aux intitulés des licences pros qui étaient au nombre de 1 800 également, on en compte maintenant entre 300 et 400 et ils correspondent à des spécificités de branche. Cette simplification n'a pas été faite de façon technocratique. Elle a fait l'objet d'un dialogue avec les acteurs eux-mêmes, même s'il y a eu quelques réactions ici ou là. Il faut savoir que 30 % des masters comptaient moins de quinze étudiants, et pas nécessairement dans des matières rares et que dans certaines universités, un seul étudiant était inscrit en master de mathématique. J'ajoute que si l'on veut que nos formations soient reconnues à l'international, encore faut-il qu'elles soient lisibles.
Dans le système APB, c'est l'université qui a été mise en premier choix, alors qu'auparavant elle était au dixième rang. On revalorise donc le choix de l'université car les meilleurs formateurs sont à l'université. Ce sont en effet des chercheurs, des enseignants, des pédagogues. Ils ont face à eux une masse d'étudiants qui n'est pas du tout homogène, ce qui les conduit à innover sur le plan pédagogique.
Par ailleurs, de plus en plus d'établissements s'inscrivent sur APB, ce qui prouve que le système est apprécié. Pour autant, je le répète, il faut accentuer les contacts d'orientation en amont. Toutefois, je dois dire que des organismes comme le CNRS, le CNES viennent dans les établissements, et pas uniquement durant les journées portes ouvertes ou les semaines de la science. Ils organisent des rencontres avec les organismes socioculturels. C'est ce que j'ai vu par exemple à Douai ou dans les Landes. Le musée de l'homme actuellement en rénovation souhaite favoriser cette science que l'on voit en aménageant des rambardes où l'on pourra justement voir les scientifiques en train de faire la science. Jean Perrin, qui est un peu l'ancêtre de « la main à la pâte », parlait d'apprendre la science en la faisant. Il est important de le faire dès le plus jeune âge pour donner le goût de la science. Ce genre d'initiative ne nécessite pas beaucoup d'argent, seulement un décloisonnement de part et d'autre. J'ajoute que les enseignants apprennent des choses et que certains sont partants pour le faire. J'ai vu des lycées professionnels travailler avec des laboratoires de nanosciences, et à Villetaneuse une section d'IUT fabrique des nano-objets. Les laboratoires publics jouent donc le jeu, et je les en remercie.
Monsieur Laurent, la période de départ à la retraite des baby-boomers dans les grands organismes de recherche est derrière nous : le nombre de départs à la retraite a été divisé par deux. Quand il y a moins de départs à la retraite, il y a mécaniquement moins d'entrées. C'est pourquoi il nous faut davantage orienter les docteurs vers le secteur privé. Il est anormal que, dix ans après leur thèse, seuls 25 % des docteurs travaillent dans la recherche privée où l'on embauche davantage des ingénieurs même s'ils n'ont pas fait de thèse. S'il faut tout faire pour que les filières industrielles et de services accueillent davantage de jeunes issus des filières académiques, encore faut-il que les enseignants-chercheurs expliquent aux doctorants que leur avenir n'est pas seulement dans la recherche publique qui ne peut accueillir 12 000 docteurs par an. La France n'est pas en déficit en ce qui concerne le nombre de chercheurs puisque, si l'on rapporte le nombre de chercheurs à la population active, la France, avec 8,8 chercheurs pour mille actifs, se place devant l'Allemagne et le Royaume-Uni mais presque à égalité avec les États-Unis. Un travail très important a été réalisé avec les organismes de recherche pour que tous leurs efforts en matière de primes et d'insertion portent sur les doctorants et l'insertion des docteurs. En dix ans, on a diminué le temps d'insertion, même si le ressenti n'est pas celui-là, y compris pour les biologistes.
Je le répète, dix ans après l'obtention d'un doctorat, 50 % travaillent dans la recherche publique et 25 % dans la recherche privée. Les 25 % restants ont créé une start-up, sont devenus journalistes ou font de la médiation culturelle, scientifique. Ce qui est anormal, c'est le déséquilibre qui existe entre le public et le privé, même si le crédit impôt recherche prévoit une bonification fiscale pour les entreprises qui accueillent pour la première fois un docteur issu de la recherche académique. L'élargissement de l'assiette du crédit d'impôt recherche a permis de multiplier par trois le nombre de docteurs qui ont bénéficié de ce dispositif.
Nous avons maintenu nos efforts en direction des conventions CIFRE, ces doctorats en alternance. Ils sont 4 000 en tout, dont 2 000 en première année. Ce dispositif bénéficie beaucoup aux PMI-PME et aux start-up, celles qui naturellement n'auraient peut-être pas embauché un docteur. J'ajoute que 80 % sont ensuite intégrés dans le secteur privé.
On fait tout notre possible pour intégrer dans la haute fonction publique les docteurs qui y sont actuellement insuffisamment présents. Introduire des docteurs permettait aussi d'avoir une culture plus transversale car on est face à des enjeux de plus en plus complexes et transdisciplinaires. Il faut que les sciences humaines et sociales (SHS) travaillent davantage avec l'industrie, la haute administration publique. C'est ce à quoi nous nous employons. En ce domaine, le Conseil d'État nous a suivis.
Monsieur Laurent, les réponses objectives à vos questions figurent sur le document que je vais vous faire parvenir et vous trouverez des réponses qualitatives à travers tout ce que nous faisons pour insérer davantage les docteurs. La réduction de la précarité dépend aussi de la gestion des organismes de recherche, de leur politique de ressources humaines. Les efforts portent maintenant sur leurs dix premières années et non plus sur leurs dix dernières années. Avec 90 % de crédits récurrents et seulement 10 % d'appels à projet, notre système français est une exception culturelle internationale. Il y a donc beaucoup moins de précarité qu'ailleurs. Malgré tout, ces appels à projet ont généré davantage de contrats à durée déterminée. La loi Sauvadet que nous avons tous votée n'avait pas suffisamment anticipé son impact sur le secteur de la recherche. Les CDD n'ont pas pu tous être renouvelés, ce qui a permis d'intégrer moins de jeunes docteurs. Il faut donc trouver un équilibre entre appels à projet, crédits récurrents et insertion des jeunes, mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas encourager des parcours à l'international qui sont bénéfiques pour les jeunes. J'ajoute que 31 % des chercheurs du CNRS et 41 % de nos doctorants sont étrangers. C'est une bonne chose car la recherche n'a pas de frontières.
Il faut donc avoir un discours ouvert, global et il faut conserver notre modèle français car, comme notre exception culturelle, il est précieux. Il permet à notre recherche publique d'être de qualité mais il doit travailler davantage avec la recherche privée.
Madame Santais, s'agissant du laboratoire souterrain de Modane, nous nous battons. Encore faut-il que les scientifiques soient convaincus, que la qualité soit au rendez-vous et que les collectivités s'engagent. En tout cas, je tiens à vous féliciter car vous avez toujours servi ce projet avec passion. Ce dossier sert un territoire qui a pâti d'une désindustrialisation. Je le répète, la recherche est un moyen de tirer vers le haut les territoires et l'on sait bien que les villes qui accueillent des étudiants et ont des laboratoires de recherche ne sont pas tout à fait comme les autres. On doit continuer à soutenir ces initiatives.
Membres présents ou excusés
Commission des affaires économiques
Réunion du mercredi 18 février 2015 à 10 heures
Présents. – M. Damien Abad, Mme Brigitte Allain, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Thierry Benoit, M. Yves Blein, M. Marcel Bonnot, M. Christophe Borgel, M. François Brottes, M. Dino Cinieri, M. Jean-Michel Couve, M. Yves Daniel, Mme Corinne Erhel, Mme Marie-Hélène Fabre, M. Daniel Fasquelle, M. Christian Franqueville, M. Georges Ginesta, M. Joël Giraud, M. Daniel Goldberg, M. Jean Grellier, M. Henri Jibrayel, M. Philippe Kemel, M. Jean-Luc Laurent, M. Thierry Lazaro, M. Michel Lefait, Mme Annick Le Loch, M. Philippe Le Ray, Mme Audrey Linkenheld, Mme Marie-Lou Marcel, M. Philippe Armand Martin, Mme Frédérique Massat, M. Jean-Claude Mathis, M. Yannick Moreau, M. Germinal Peiro, M. Hervé Pellois, M. Dominique Potier, M. Patrice Prat, M. Franck Reynier, Mme Béatrice Santais, M. Michel Sordi, M. Éric Straumann, M. Alain Suguenot, M. Jean-Charles Taugourdeau, M. Fabrice Verdier
Excusés. – M. Bruno Nestor Azerot, Mme Ericka Bareigts, M. Denis Baupin, Mme Michèle Bonneton, M. André Chassaigne, Mme Jeanine Dubié, M. Franck Gilard, Mme Pascale Got, Mme Anne Grommerch, M. Jean-Pierre Le Roch, M. Serge Letchimy, M. Kléber Mesquida, M. Bernard Reynès, M. Frédéric Roig, M. Jean-Paul Tuaiva, Mme Catherine Vautrin
Assistaient également à la réunion. – Mme Sophie Rohfritsch, M. François Vannson