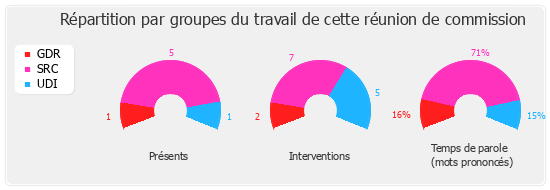Groupe de travail sur l'avenir des institutions
Réunion du 13 février 2015 à 9h00
La réunion
La séance commence à neuf heures cinq.
Table ronde sur le thème des partis politiques, avec M. Frédéric Sawicki et M. Guillaume Liegey.

Monsieur le président, cher Michel Winock, mesdames et messieurs les parlementaires, chers collègues, mesdames et messieurs les personnalités qualifiées, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette sixième réunion du groupe de travail sur l'avenir des institutions consacrée aux partis politiques et au statut de l'élu.
Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Frédéric Sawicki, professeur agrégé de sciences politiques à l'université Paris I - Panthéon-Sorbonne. Spécialiste de l'étude des partis politiques, du militantisme et de la politique locale, vous êtes également l'un des fondateurs de la revue Politix.
À vos côtés, Guillaume Liegey. Lors de vos études à Harvard, vous avez observé de près, avec vos camarades Arthur Muller et Vincent Pons, la première campagne présidentielle de Barack Obama en 2008. Riches de ces enseignements, vous avez notamment publié ensemble un livre intitulé Porte-à-porte, Reconquérir la démocratie sur le terrain. Actuellement maître de conférences à Sciences Po, vous consacrez vos travaux au militantisme et aux campagnes électorales. S'agissant plus particulièrement des partis politiques, vous avez récemment publié dans le Huffington Post une tribune intitulée « Les partis politiques peuvent-ils se renouveler grâce aux nouvelles pratiques de proximité ? »
Messieurs, nous vous remercions pour votre présence aujourd'hui.
Il est difficile d'évoquer la question de notre démocratie sans s'intéresser aux partis politiques qui, en vertu de la Constitution française, « concourent à l'expression du suffrage ». Or, nous le savons tous ici, si les Françaises et les Français continuent à se passionner pour la politique, ils font en revanche preuve d'une immense défiance vis-à-vis des partis politiques. Ainsi, si l'on en croit le « baromètre de la confiance » publié en janvier 2015 par le CEVIPOF, le centre de recherches politiques de Sciences Po, 91 % de nos compatriotes n'ont pas confiance dans les partis politiques. Notons que ce phénomène n'est pas propre à la France et qu'il touche bon nombre des formations politiques européennes.
Dès lors, il s'agit ici de se demander si les partis politiques, sous leur forme actuelle, sont amenés à disparaître ou plutôt à se transformer en profondeur, et dans ce dernier cas, pour prendre quelle forme.
Après les clubs politiques sous la Révolution française, après les partis de cadres et les partis de masse aux XIXe et XXe siècles, un nouveau type de parti politique est-il sur le point d'apparaître ?
Plus généralement, les partis doivent-ils se reconnecter au monde associatif et au monde syndical ? Doivent-ils encourager de nouvelles formes d'engagement citoyen ? Peuvent-ils redevenir de véritables lieux de débats ?
Voici quelques-uns des sujets sur lesquels nous serions très intéressés de pouvoir connaître votre avis.
Mais avant de vous laisser répondre, je cède la parole à Michel Winock qui va nous permettre, une fois de plus, de mettre en perspective nos débats en nous invitant à nous plonger dans notre roman national.
L'article 4 de la Constitution déclare : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation. »
C'est seulement cette Constitution de 1958 qui consacre l'existence et la liberté des partis politiques. Ils existaient cependant depuis longtemps. La Révolution de 1789 en est à l'origine ; la réglementation napoléonienne y a mis fin provisoirement, mais le retour d'une vie parlementaire sous la monarchie restaurée entre 1815 et 1848 a relancé le processus : l'activité électorale en était la source. L'instauration du suffrage universel en 1848, pour élire non seulement l'Assemblée mais aussi le Président de la République, a été le véritable signal de départ d'une structuration politique à l'échelle nationale et non plus seulement locale.
Le coup d'État de 1851 et le Second Empire ont mis fin, provisoirement, au développement des partis. Mais Napoléon III, qui gouvernait au nom du peuple, avait conservé le suffrage universel et même si celui-ci était diminué par la candidature officielle et les privations de liberté, les élections avaient lieu régulièrement et offraient à l'opposition un moyen de se faire entendre. Au cours des années 1860, le régime bonapartiste s'est progressivement libéralisé : de nombreux journaux sont nés et, en 1868, une loi a autorisé les réunions publiques. Bref, la vie politique s'est ranimée, les comités électoraux se sont multipliés. Parallèlement, un autre phénomène est apparu : les ligues. Ce ne sont pas des partis, elles ne préparent pas les élections, mais elles mobilisent autour d'un objectif précis. La plus célèbre d'entre elles, qui existe encore, la Ligue de l'enseignement, a ainsi été créée en 1866. Cet élan du renouveau politique est arrêté en 1870-1871 par la guerre franco-prussienne et la guerre civile. La véritable naissance des partis politiques date de la IIIe République.
En 1900, on compte cinq partis à gauche, presque autant à droite. Ils n'ont toutefois pas de statut légal ; ils sont simplement tolérés. C'est la loi sur les associations de 1901, destinée à neutraliser les congrégations religieuses, qui légalise leur existence. Les principaux partis politiques français sont créés entre 1900 et 1905, en attendant la fondation du parti communiste en 1920.
La critique des partis politiques s'est affirmée dès leur origine. La pensée révolutionnaire, inscrite dans la ligne du Contrat social de Rousseau, a dénoncé les « associations partielles aux dépens de la grande », la « volonté générale » étant exaltée contre les « factions ». Dans le même ordre d'idée, de manière plus contemporaine, le général de Gaulle, nostalgique de l'Union sacrée, s'est élevé contre le régime des partis, au nom de l'idéologie du « rassemblement ». Cette pensée a été clairement exprimée lors de la fondation du Rassemblement du peuple français en 1947 ; elle inspire la Constitution de la Ve République, dont le Président est la clef de voûte. « Il faut choisir, déclarait de Gaulle à Alain Peyrefitte en 1963, entre le régime d'assemblée, c'est-à-dire le régime des partis, et l'autre régime, c'est-à-dire le mien. Quand il y aura plusieurs candidats à la présidence de la République, ce sera toujours un choix entre des hommes, avec leur coefficient personnel et la ligne politique qu'ils représenteront ; ce ne sera pas un choix entre des partis. Si ça devait être un choix entre des partis, on retomberait dans la IVe et l'UNR aurait contribué à y faire à nouveau retomber le pays. » Toutes choses égales d'ailleurs, c'est cette volonté d'unité, voire d'unanimité, qui inspire la création du parti unique dans les États totalitaires.
Une autre contestation s'est développée non contre le principe des partis, mais contre le multipartisme, l'éparpillement des forces, la rivalité des clans. Dans son ouvrage L'Ancien régime et la Révolution, Tocqueville perçoit ce phénomène à l'oeuvre dès avant 1789 : « Nos pères, écrit-il, n'avaient pas le mot individualisme, que nous avons forgé pour notre usage, parce que, de leur temps, il n'y avait pas en effet d'individu qui n'appartînt à un groupe et qui pût se considérer absolument seul ; mais chacun des mille petits groupes dont la société française se composait ne songeait qu'à lui-même. C'était, si je puis m'exprimer ainsi, une sorte d'individualisme collectif, qui préparait les âmes au véritable individualisme que nous connaissons. »
La science politique a voulu démontrer le corrélat qui existe entre le mode de scrutin proportionnel et le multipartisme : tous les groupes de 1' « individualisme collectif » – selon l'expression de Tocqueville – le prônent pour exister, quitte à faire tomber le régime dans l'ingouvernabilité, ce qui fut largement le cas sous la IVe République. Il faut cependant noter que l'instabilité de la IIIe République s'est produite non pas avec le scrutin proportionnel mais bel et bien avec le scrutin majoritaire, le scrutin d'arrondissement. L'ultra-division du peuple français paraît défier les modes de scrutin. C'est le second tour de l'élection du président au suffrage universel qui a pu neutraliser les effets du multipartisme.
Une autre critique des partis, toujours d'actualité, porte sur leur nature oligarchique. En 1914, dans son ouvrage Les Partis politiques, Robert Michels avait établi ce qu'il appelait une « loi d'airain » : la tendance inévitable des organisations démocratiques à la formation d'une oligarchie. Il observait que c'étaient toujours les mêmes individus qui, en dépit de la réglementation démocratique, se maintenaient à la direction du parti. Toujours les mêmes têtes, et la télévision ne le prouve que trop !
Aujourd'hui, la désaffection des partis est généralisée. Dans les partis de gouvernement, le nombre des adhérents et des militants n'est que de très peu supérieur au nombre des élus ou des candidats à l'élection. On pourrait en énumérer plusieurs causes telles la montée de l'individualisme ou la révolution technique de la communication – à quoi sert de coller des affiches ou de distribuer des tracts à l'heure d'Internet ? Je n'en retiendrai qu'une : le déclin des idéologies. Les moments de fort militantisme ont été ceux des grands affrontements idéologiques. L'âge du scepticisme a succédé à l'âge des convictions. Des sondages répétés ont mis en lumière l'affaiblissement de l'esprit partisan, l'indifférenciation entre la droite et la gauche, la naissance de ce que les politologues ont appelé l'électeur stratège – celui qui vote selon ses intérêts sans préjugés d'appartenance.
À ce problème de discrédit, il est important de répondre car les partis politiques restent les médiateurs nécessaires entre les citoyens et le pouvoir. Mais les citoyens les voient surtout comme des machines électorales, à quoi leur fonction ne saurait se réduire.
Je voudrais doublement vous remercier, pour votre invitation bien sûr, mais surtout pour avoir choisi de consacrer une séance de votre groupe de travail aux partis politiques, instruments indispensables à l'exercice d'une vie démocratique, si l'on conçoit la démocratie comme une démocratie représentative. Les débats sur la réforme des institutions, très nourris ces dernières années, ont principalement porté sur les organes traditionnels du pouvoir – l'exécutif, le législatif et le judiciaire – et leurs relations ainsi que sur les institutions locales. Ils ont laissé dans l'ombre le rôle des partis politique, qui font figure de parent pauvre de la réflexion sur les institutions démocratiques, soit qu'ils soient considérés comme devant se gouverner eux-mêmes, soit que la recherche en fasse un objet d'étude de second plan.
Les travaux consacrés aux phénomènes politiques en France s'intéressent davantage aux formes de la démocratie participative qu'à celles de la démocratie représentative. De multiples études sont ainsi consacrées au potentiel de renouveau démocratique que recèle la société civile et laissent, ce faisant, de côté l'élaboration au plan national et local de projets politiques globaux. De la même manière, beaucoup d'attention est portée aux mouvements sociaux et aux pratiques contestataires – ce que Pierre Rosanvallon appelle la « contre-démocratie » – sans forcément qu'ils soient analysés comme une contrepartie de l'affaiblissement des partis politiques.
Il y a pourtant urgence à réfléchir aux causes de cet affaiblissement. Deux principales explications prévalent.
Selon la première, un faisceau de causes structurelles d'ordre social, économique, politique et idéologique vouerait inéluctablement les partis à la disparition – je vous renvoie au titre du livre de Robert Hue : Les partis vont mourir… et ils ne le savent pas ! Les partis appartiendraient donc à un moment historique.
Selon la seconde, l'affaiblissement des partis tiendrait aux règles du jeu politique elles-mêmes. Je ne prétendrai pas ici que tout ne serait dû qu'au cadre institutionnel dans lequel ils se situent, mais je pense qu'il est possible de jouer sur certains mécanismes pour les faire évoluer.
Ils doivent d'abord être plus démocratiques. Ils souffrent en effet d'une tendance à l'oligarchisation, moins au sens de Robert Michels, c'est-à-dire parce que ce seraient toujours les mêmes qui les dirigeraient au fil des ans, qu'au sens social. Le profil des représentants politiques est de plus en plus éloigné de la nation. Beaucoup d'efforts ont été consentis ces dernières années en matière de parité pour donner une plus large place aux femmes, même si nous sommes loin de la parité parfaite dans les assemblées désignées au suffrage majoritaire. Reste que les classes populaires ont totalement disparu de la représentation politique : les assemblées représentatives au niveau national et local ne comptent quasiment plus d'ouvriers ou d'employés. Il en va de même pour la représentation des jeunes et des minorités, sous toutes leurs formes.
Une des raisons pour lesquelles les citoyens ne se reconnaissent pas dans les partis tient au fait que leurs dirigeants leur apparaissent très éloignés de ce qu'ils sont, à tort ou à raison. Certes, l'idéal de la nation n'est pas que les représentants soient à l'image du peuple, toutefois, lorsqu'ils en sont à ce point éloignés, de multiples problèmes se posent.
Ou l'on considère qu'il s'agit d'un processus inéluctable, lié à une forme de sélection sociale – la politique requerrait de plus en plus de compétences techniques et pratiques acquises au terme d'une longue formation universitaire – et alors il n'y a plus rien à faire. Ou l'on réfléchit aux manières de redonner aux partis politiques un rôle dans l'éducation populaire et aux mécanismes pouvant les inciter à diversifier leur représentation. C'est une première piste de réflexion qui me semble très importante.
Deuxième aspect à prendre en compte pour comprendre la crise de la représentation : les règles de scrutin qui conduisent à laisser en dehors de la représentation politique des pans entiers de notre société.
Sous l'effet conjugué du scrutin majoritaire à deux tours et de la présidentialisation de nos institutions, beaucoup de nos concitoyens ne se sentent pas représentés dans les institutions centrales de notre pays. Ce processus aboutit à ce que 80 % des députés appartiennent soit au parti socialiste soit à l'UMP.
On peut certes considérer, au nom de l'efficacité, qu'il s'agit d'un mal nécessaire pour dégager une majorité. On peut estimer aussi que ce mécanisme a des vertus prophylactiques, en ce qu'il laisse les extrêmes à l'extérieur du jeu de la représentation. Je considère pour ma part que, dans l'état actuel de la société française, compte tenu de la diversité de ses sensibilités, de ses intérêts et de ses opinions, le système électoral apparaît à bout de souffle.
Le spectre du retour à la IIIe République est toujours agité mais, comme le soulignait fort justement Michel Winock, le scrutin majoritaire n'a pas empêché qu'elle soit marquée par l'instabilité gouvernementale. Beaucoup de pays démentent la règle de Duverger : il n'y a pas d'automaticité entre scrutin proportionnel et éparpillement des forces politiques. En Allemagne, même si certains déplorent qu'il y ait des coalitions SPD-CDU, il n'en reste pas moins que les gouvernements sont dotés d'une forte légitimité et que la crise des partis politiques est moins forte qu'en France.
Si nous ne prenons pas cette question à bras-le-corps, elle risque de nous exploser à la figure. Il est urgent d'y réfléchir.
Nous assistons déjà à une montée des formes de contestation radicale – nous en avons eu de nombreuses illustrations ces dernières années. L'abstention, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, a atteint des taux records depuis les débuts de la Ve République, et encore n'est-il pas tenu compte des taux de non-inscription sur les listes électorales qui concerne 30 % à 35 % des jeunes appartenant aux classes populaires. La proportion de personnes qui seraient susceptibles de voter mais qui ne votent pas atteint 30 % à 50 %, en dehors de certaines élections présidentielles. À cela s'ajoutent les votes qui se portent sur des partis autres que le PS et l'UMP. Nous ne pouvons que constater que cela ne va plus.
Si nos institutions contribuent au discrédit des partis politiques, c'est aussi – troisième aspect – du fait de la reconnaissance juridique très tardive dont ils ont fait l'objet. La Constitution de 1958 les définit a minima : « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. » Autrement dit, elle les cantonne dans l'organisation des élections. Les constitutions italienne et allemande envisagent leur rôle de manière beaucoup plus extensive : ils ne sont pas réduits à aller à la « pêche aux voix » pour reprendre une célèbre expression de Schumpeter, mais sont considérés comme contribuant à la construction d'un intérêt collectif et concourant à la « formation de la volonté politique ».
Il faut attendre en France la loi de 1988 sur le financement politique des partis politiques pour qu'ils accèdent à une véritable reconnaissance juridique. Cependant, malgré une codification progressive, leur statut reste flou. Ils ne sont pas dotés d'un statut propre et relèvent encore de la loi de 1901 sur les associations. À la différence de l'Allemagne, ils ne sont soumis à aucune obligation d'adopter des règles démocratiques, de nature à donner aux adhérents des garanties minimales en termes de sincérité des élections internes. On sait comme le Congrès de Reims du Parti socialiste et la bataille opposant François Fillon à Jean-François Copé ont constitué des spectacles catastrophiques aux yeux non seulement des militants mais de l'ensemble des Français.
Par ailleurs, il convient d'accroître la transparence de leur financement. Même si d'énormes progrès ont été accomplis depuis les affaires qui ont défrayé la chronique dans les années 1980, il existe encore beaucoup d'affaires de financement. La tolérance vis-à-vis de la possibilité de créer des micro-partis donne l'occasion à n'importe quel élu de collecter de l'argent auprès des particuliers, qui peuvent faire des dons dans la limite de 7 500 euros par an. Cela pose un double problème : d'une part, une autonomie très forte des élus vis-à-vis de leur parti ; d'autre part, une perte de confiance. Rappelons que les partis perçoivent directement ou indirectement plus de la moitié de leurs ressources du contribuable. Les cotisations des élus à leur parti proviennent de l'indemnité publique qui leur est allouée pour exercer leurs fonctions ; les cotisations des adhérents sont déductibles de l'impôt sur le revenu.
Une réflexion doit être menée sur les contreparties à apporter à cette contribution très importante de l'État. Il existe un premier mécanisme à travers la parité hommes-femmes : les partis sont pénalisés financièrement s'ils ne la respectent pas. Mais il faut rechercher d'autres moyens d'orienter davantage les dotations publiques. Je considère qu'une partie de ces sommes devrait, comme en Allemagne, être consacrée obligatoirement à des organismes de formation et d'éducation populaire. Ce serait l'un des moyens possibles pour les partis de former des citoyens n'ayant pas eu la chance d'étudier dans une grande école comme Sciences Po ou l'ENA ou de suivre un master de droit ou de sciences politiques.
Une telle orientation de l'utilisation des fonds publics serait très intéressante à mettre en oeuvre, surtout si elle s'accompagnait d'une forte proportionnalisation de la représentation.
Beaucoup protestent contre le parachutage d'élus par les partis. Je considère, pour ma part, qu'à partir du moment où ils sont légitimes, ils doivent pouvoir choisir leurs candidats et intervenir pour assurer la représentation la plus respectueuse de la diversité des intérêts qu'ils représentent. Le leader syndical lorrain Édouard Martin, député au Parlement européen, n'aurait jamais eu de chances d'être élu dans le cadre d'une élection à scrutin majoritaire. Il faut encourager ces processus. Cela contribuera également à resserrer les liens des partis politiques avec les organisations qui leur sont proches : organisations syndicales, associations. Si, lors des européennes de 2009, Europe-Écologie-Les Verts a réalisé un beau score, c'est parce qu'il a su agréger des représentants d'associations de défense des mal-logés, de Greenpeace, et d'autres organisations. Il faut aussi que ces responsables accèdent, grâce à leur expérience, à la représentation politique.
Pour résumer mon propos, je dirai qu'il existe de multiples leviers à activer pour redonner de la vitalité aux partis. Nous ne sommes pas dans la situation où le législateur pourrait leur dire : « Débrouillez-vous : après tout, si vous disparaissez, tant pis pour vous, vous serez remplacés par autre chose. »
Je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir invité. J'ajouterai une précision à la présentation que vous avez bien voulu faire de mon parcours. En plus d'observer la campagne de Barack Obama en 2008, j'ai eu la chance avec mes deux amis Vincent Pons et Arthur Muller de diriger en 2012 la campagne de terrain de François Hollande au cours de laquelle nous avons eu l'occasion de frapper à beaucoup de portes. C'est avant tout à une échelle micro que j'envisagerai les partis, en vous faisant part de mon expérience d'un point de vue opérationnel.
Beaucoup constatent un déclin des partis. Les chiffres incitent au pessimisme : baisse du nombre de militants, diminution de la participation. On assiste à l'émergence de mouvements contestataires, voire de mouvements spontanés comme Podemos, et à la disparition de partis de gouvernement comme le PASOK grec, processus qui a donné lieu au terme de « pasokisation » qui inquiète bien des dirigeants de partis politiques européens.
Toutefois, j'aimerais vous livrer un message d'optimisme car je crois qu'il y a énormément de choses à faire pour transformer la façon dont fonctionnent les partis politiques. C'est ce à quoi s'attache la start-up que je dirige : elle développe de nouveaux outils technologiques pour accompagner la transformation des partis politiques et les campagnes électorales.
Trois leviers principaux peuvent être activés.
Il s'agit, premièrement, des nouvelles technologies : non pas Twitter ou Facebook, mais des outils rendant plus facile la connexion entre militants et citoyens. Ainsi l'interface my.barackobama.com a-t-elle permis à des personnes n'ayant jamais participé à une campagne électorale de leur vie de s'inscrire en cinq minutes comme volontaire pour rejoindre la campagne présidentielle de 2008.
Deuxièmement, l'analyse du big data, qui se développe grâce aux données gratuites disponibles – vous connaissez le travail d'Etalab autour de l'open data –, permet d'élaborer des modèles prédictifs ciblant, par exemple, les endroits où les partis politiques ont le plus intérêt à tenter de recruter des militants.
Troisièmement, les partis peuvent mettre à profit les dernières avancées de la recherche scientifique. Michel Winock demandait si le collage et le tractage servaient encore à quelque chose à l'ère numérique. Eh bien, au même titre que les appels téléphoniques, le porte-à-porte, les tweets, ce sont des actions dont il possible de mesurer l'impact avec précision. Vous ne serez sans doute pas surpris si je vous dis que c'est le contact direct qui est le plus efficace pour encourager les gens à se reconnecter au monde politique.
Je ne vais pas vous raconter que j'ai inventé le porte-à-porte. Mme Buffet le sait mieux que moi, puisque le parti communiste menait déjà il y a plus de quarante ans des campagnes de terrain de très grande envergure. Celle que j'ai organisée avec mes amis en 2012 s'est d'ailleurs inspirée de cet exemple ainsi que de la campagne américaine de 2008. Nous avons simplement essayé d'envisager différemment cette pratique.
Comment peut-on saisir concrètement la transformation du champ des campagnes électorales ?
En 2008, lorsque je suis arrivé aux États-Unis, j'avais fait de nombreuses lectures concernant la campagne d'Obama, présentée comme la plus moderne jamais organisée, la première campagne du XXIe siècle : un simple clic permettait désormais de convaincre des milliers d'électeurs. Sur le terrain, je voyais avant tout des volontaires, sac au dos, allant frapper aux portes, ce qui me paraissait davantage s'apparenter à une technique du XIXe siècle. Derrière cette idée simple, il y avait en réalité beaucoup de réflexion et une énorme organisation. Des études scientifiques très rigoureuses, fondées sur l'évaluation randomisée, ont montré que frapper aux portes permet de mobiliser bien davantage d'électeurs que les appels téléphoniques. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : il faut frapper à quatorze portes pour convaincre un abstentionniste d'aller voter quand il faut distribuer 100 000 tracts ou passer quarante appels téléphoniques pour obtenir ce même résultat. Plus le contact se fait de manière directe, plus l'impact est grand, ce qui incline à l'optimisme.
En 2010, lors des élections régionales, nous avons mené une expérience dans les quartiers populaires d'Ile-de-France avec l'équipe de campagne de Jean-Paul Huchon pour voir si le porte-à-porte permettait encore de mobiliser les électeurs. Nous avons pu constater son efficacité, notamment auprès de personnes dont on pouvait penser qu'elles étaient éloignées définitivement de la politique. Je veux parler des Français d'origine étrangère et de leurs enfants, que nous avons ciblés grâce à la mention du lieu de naissance sur les listes électorales, les statistiques ethniques étant interdites en France. Aller vers les gens en leur parlant cinq minutes, dans un esprit ouvert, pour leur rappeler qu'il y a une élection et leur donner des informations contribue à les remobiliser. C'est ainsi que nous sommes parvenus à augmenter la mobilisation de cinq points, de 30 % à 35 %.
Autre question : quelles leçons tirer de l'analyse des transformations des campagnes électorales pour la vie des partis ?
Je vois deux vertus à ces campagnes de terrain. La première est la repolitisation de personnes que l'on pensait sorties définitivement de la mobilisation politique. La deuxième est d'inciter les militants à sortir de leurs zones de confort en allant faire campagne au-delà de leur environnement immédiat pour parler à des gens qu'ils ne rencontrent peut-être plus dans leur vie quotidienne.
Au vu de ces enseignements, les partis politiques pourraient continuer à faire du porte-à-porte en dehors des périodes de campagne pour encourager l'inscription sur les listes électorales. Mon collègue Vincent Pons a mené une expérience en ce sens à la fin de l'année 2011 : il a pu obtenir une augmentation de 30 % des inscriptions qui, fait intéressant, ont été suivies de votes effectifs.
Nous pourrions imaginer également des campagnes d'information en dehors de tout cycle électoral. Récemment, en Californie, des associations pro-avortement ont ciblé le comté d'Orange, réputé pour son conservatisme, afin d'essayer de convaincre les habitants du bien-fondé de leur cause. Elles ont dépêché des femmes ayant elles-mêmes subi un avortement pour faire du porte-à-porte : après une conversation d'une quinzaine de minutes – soit une durée plus longue que pour le porte-à-porte électoral – 30 % des personnes ont durablement changé d'avis, comme une enquête menée un mois plus tard l'a confirmé. Cette expérience donne espoir : elle montre que, même s'agissant de sujets compliqués, sources de clivages, aller sur le terrain pour prendre le temps d'échanger peut avoir un effet positif.
J'évoquerai, pour finir, un dernier bénéfice que l'on peut tirer de ces nouvelles chances. Les partis politiques sont des lieux de passage pour beaucoup de personnes qui occupent ensuite des positions de pouvoir, vous en êtes des exemples, mesdames, messieurs les députés. Si les candidats recourent de plus en plus à ces méthodes innovantes, apprennent à utiliser les résultats de la recherche scientifique, foisonnante en ce domaine, pour mener leurs campagnes électorales, on peut imaginer que de tels réflexes se développeront davantage une fois qu'ils seront au pouvoir. La professionnalisation des partis politiques débouchera sur une professionnalisation de la manière de concevoir et d'évaluer les politiques publiques.

La vision historique développée par Michel Winock et la vision théorique et pratique de Frédéric Sawicki et de Guillaume Liegey seront source, je le pense, de nombreuses questions…

Le cadre institutionnel a un impact certain sur l'évolution des partis politiques. Vous avez déjà cité l'effet du scrutin uninominal majoritaire à deux tours sur la non-représentation de certains courants de pensée. Pensons aussi au fait que l'élaboration du projet politique peut passer au second plan par rapport aux choix tactiques, les alliances variant d'une élection à une autre – je regarde avec complicité Claude Bartolone en pensant à nos expériences communes en Seine-Saint-Denis. Pensons encore à la transformation des partis en écuries présidentielles : à peine ont-ils fini une campagne qu'ils cherchent à se positionner sur un candidat ou une candidate et à élaborer une nouvelle tactique pour s'assurer de la victoire aux prochaines élections.
Je ne considère toutefois pas que ce soit la cause principale de ce que l'on pourrait appeler l'amaigrissement des partis, tant du point de vue de la pensée que du corps militant. Le déclin idéologique me semble avoir joué un rôle bien plus déterminant dans ce processus. Dans un parti comme le mien, la question de l'éducation populaire était centrale. Nous avions fondé des écoles de formation car, pour répondre à l'exigence de débat, il fallait former nos adhérents, qui étaient d'origine populaire. Prendre la parole dans nos structures était un acte militant important, exigeant de la personne qui intervenait connaissances et réflexions. Nous nous situions dans un combat idéologique qui demandait d'argumenter sur les idées et sur le projet.
À partir du moment où ce qui domine est l'idée que l'on ne peut faire bouger les choses qu'à la marge, avant tout en tenant un discours économique, la notion même de combat idéologique perd de son importance. Or j'estime qu'un parti doit être fondé sur la bataille idéologique. Dans cette perspective, se battre pour avoir des élus est pleinement légitime. Le communisme municipal s'est nourri de la volonté de faire vivre les idéaux du communisme dans les villes.
Porter un projet, voilà qui pourra, à mon sens, permettre aux partis de retrouver une place réelle dans la vie démocratique de notre pays. C'est aussi cela qui incite au militantisme. Quel intérêt y a-t-il à s'engager si c'est pour peser seulement à la marge ? Et si le discours dominant est que tout se règle in fine par Facebook ou Twitter, la pensée militante se réduit à peu. En revanche, si le débat avec les individus reprend de l'importance, alors le militantisme redevient utile et retrouve son objet.
Il faut toutefois veiller à ne pas tomber dans les faux discours sur la proximité. Je partage ce que vous avez dit, monsieur Liegey, sur l'efficacité du porte-à-porte. Là n'est pas la question. Je veux simplement insister sur le fait qu'être proches des gens ne suffit pas : rien ne sert d'aller les voir, si c'est seulement pour recueillir leurs doléances et leur promettre de régler leurs problèmes de logement. Revenir au débat d'idées me paraît essentiel.
Vous avez évoqué la démocratie à l'intérieur des partis. Le débat sur les statuts prend toujours une place disproportionnée lors des congrès. Établir des règles est nécessaire mais elles sont susceptibles de voler en éclat si le débat politique n'est plus à même de recréer une unité de pensée.
Oui, au retour aux débats de société, à l'éducation populaire, à la proximité à travers le militantisme. Encore faut-il que défendre un projet vaille encore le coup en politique.

J'ai trois questions.
Aujourd'hui, les partis disparaissent derrière des noms : un mécanisme de personnalisation à outrance, qui atteint un paroxysme durant les campagnes présidentielles, fait que ce ne sont plus des partis qui incarnent la politique mais des personnes. Ce phénomène trahit-il une crise des partis ou bien une crise des institutions ?
Il y a un parti qui ne se livre pas au porte-au-porte, qui ne repose sur aucune idéologie précise, qui n'aborde pas beaucoup les questions économiques sous l'angle social : c'est le premier parti de France, le Front national. Partout dans le pays il envoie des candidats qui, non seulement sont inconnus des populations locales, mais n'habitent pas les circonscriptions concernées. Les personnes qui se présentent sous l'étiquette Front national n'ont aucune importance ; ce qui compte, c'est uniquement le logo et le nom de Le Pen, père ou fille, sur le tract. Le signal du parti est d'une telle force qu'il l'emporte sur toute autre considération, y compris sur la personne du candidat. Ce mécanisme est-il propre à la France ?
Ma troisième question concerne le porte-à-porte, que tous les députés autour de cette table pratiquent, heure après heure, jour après jour. Ce n'est pas la capacité à faire basculer une opinion qui me semble centrale dans cette pratique, passionnante, je peux vous l'assurer. Ce qui frappe le plus, c'est que les gens ignorent tout des élections et des candidats. Le problème est donc moins la conviction que l'information. À cet égard, la comparaison avec les États-Unis me semble extrêmement dangereuse. Là-bas, les élections se jouent sur la publicité : plus vous avez d'argent, plus vous augmentez vos chances que les électeurs votent pour vous, tout simplement parce qu'ils auront entendu parler de vous. En France, au début du mois d'avril 2012, une personne sur quatre rencontrée lors d'opérations de porte-à-porte dans ma circonscription de Gap ne connaissait pas le nom des candidats à l'élection présidentielle. La question de l'information sur le mécanisme électif ne constitue-t-elle pas un problème institutionnel à part entière ? Comment le traiter ? En France, nous avons fait le choix de limiter drastiquement toute possibilité de publicité. Sauf erreur de ma part, monsieur le président Bartolone, l'interdiction de recourir à la publicité payante a été instituée par la loi Sapin. Ne peut-on s'inquiéter de ce que le système arrive ainsi à bout de souffle ?
Je remercie Frédéric Sawicki et Guillaume Liegey pour leurs contributions très stimulantes qui m'ont ramené, moi qui suis juriste, à des réalités empiriques que, de manière coupable, je ne connais que trop peu.
Mes interrogations rejoignent celles de Karine Berger et vont refléter un peu de la frayeur qu'ont suscitée leurs propos.
Qu'est-ce que concrètement l'éducation populaire au sein des partis ? Est-ce que cela consistera à faire des militants les perroquets du vide idéologique décrété au niveau de l'instance supérieure du parti ?
Est-il si rassurant de savoir qu'il suffit de quinze minutes d'entretien lors d'une opération de porte-à-porte pour qu'une personne change radicalement d'opinion ou passe de l'apathie politique à la participation, qui plus est dans un sens déterminé ? Cela ne pose-t-il pas le problème de l'idéologie ? De quels instruments critiques disposent les personnes pour faire face aux arguments des militants qui font du porte-à-porte ?
Guillaume Liegey, le fait que votre start-up soit associée au parti socialiste, incite-t-il les gens que vous rencontrez lors d'opérations de porte-à-porte à être davantage réceptifs à l'orientation politique que vous prônez ? Qu'en serait-il pour un organisme analogue, mais plutôt orienté à droite ? Êtes-vous capables de mesurer le basculement non pas seulement entre participation et non-participation mais aussi entre participation à gauche et participation à droite ?
Votre vision des partis semble reposer sur le postulat qu'ils sont animés de bonne volonté sur le plan politique. Ne peut-on pas, de manière très crue, envisager l'intérêt qu'ont certains d'entre eux, notamment les partis de gouvernement, à la non-participation de franges de plus en plus massives de la population ?
Enfin, vous avez évoqué le renouveau des forces du militantisme. Le porte-à-porte conduit les militants, soulignez-vous, à être plus conscients des types de population auxquelles femmes et hommes politiques vont s'adresser. C'est une dimension à laquelle je suis sensible, cependant je ne suis pas très rassuré par la professionnalisation politique que vous avez décrite en précisant que ces nouvelles pratiques auront un impact une fois les parvenus aux responsabilités. Cela laisse imaginer un militant d'abord membre d'un syndicat étudiant satellite du parti, puis du parti, ensuite élu du parti, qui, sans faire de poujadisme primaire, n'aurait jamais vu les « vraies gens » au nom desquelles il parlera au cours des quarante années que durera sa carrière politique.
Je remercie, moi aussi, nos deux intervenants pour leur contribution très enrichissante.
Monsieur Sawicki, si nous étions en 1990 ou en 1995, nous aurions également pris pour point de départ le constat d'une crise des partis. Il s'agit d'un « pont aux ânes », qui n'en est pas moins vrai. Sa permanence atteste paradoxalement la robustesse des partis, qui n'ont jamais été remplacés : comme de l'État, on en diagnostique inlassablement la crise mais ils survivent très bien, merci ! Parallèlement, leur structure et leur fonctionnement se renouvellent peu. En d'autres termes, sans doute parce qu'ils sont structurellement nécessaires à la démocratie représentative, les partis peuvent se permettre de continuer d'exister en état de maladie chronique. Les formes nouvelles de mobilisation dont on nous annonçait dès le milieu des années 1990 qu'elles allaient tout balayer sur leur passage ne l'ont pas fait, qu'il s'agisse des ONG, dont on promettait qu'elles résoudraient les problèmes internationaux, voire nationaux, ou de mouvements très intéressants car porteurs d'un matériau intellectuel nouveau, comme ATTAC ou la Confédération paysanne. Sans nécessairement dépérir, ces structures n'ont pas été capables de transformer la politique au point de remplacer les partis.
Pourquoi les partis survivent-ils ? Et, sans vouloir cultiver le paradoxe, cette survie n'est-elle pas l'une des causes de leur crise ?
En second lieu, je m'interroge sur la proportionnelle. Je crois savoir que, selon vous, le système majoritaire comporte certaines difficultés : le fait que 85 % des députés appartiennent à l'un des deux grands partis est problématique dès lors que l'on semble aller vers un tripartisme de fait. Sans être politiste, je sais bien qu'il n'existe pas véritablement de causalité en ces matières, que les corrélations mêmes sont douteuses, que les liens sont complexes entre les élections et la manière de gouverner, entre les coalitions électorales regroupant les partis et les coalitions de gouvernement, bref que le passage est délicat de la logique et de la science électorales aux conditions du gouvernement. Néanmoins, la proportionnelle en France ne créerait-elle pas des difficultés par son effet en aval ? Il me semble que le gouvernement par des coalitions pose dans notre pays un problème que l'accroissement de la proportionnelle, peut-être nécessaire par ailleurs, risque d'accuser. Les personnes présentes qui ont fait l'expérience de la gauche plurielle le savent, comme d'autres membres du groupe de travail aujourd'hui absents qui ont connu la première séquence du présent quinquennat : les coalitions de gouvernement ne fonctionnent pas très bien. C'est même le cas des coalitions d'opposition : le Front de gauche n'a rien d'un long fleuve tranquille. Or si l'on peut changer un mode de scrutin, il est plus difficile de modifier une culture politique et de gouvernement.
J'aimerais maintenant poser à M. Liegey trois questions notées à la volée et qui pourront de ce fait paraître abruptes – je m'en excuse par avance, car telle n'était pas mon intention.
Premièrement, comment les start-ups comme les vôtres sont-elles financées ? D'où les partis tirent-ils l'argent qui permet à ces sociétés de fonctionner efficacement, comme cela semble être le cas de la vôtre ?
Deuxièmement, si, de consultant électoral, vous deviez devenir une sorte d'Arthur Andersen, comme on disait autrefois, c'est-à-dire de conseiller en stratégie interne, que recommanderiez-vous aux partis quant à leur structure ? Autrement dit, leur suggéreriez-vous non seulement de modifier leur stratégie de porte-à-porte ou de tractage, mais, plus profondément, de changer de l'intérieur ? Y avez-vous réfléchi ?
Troisièmement, avez-vous également réfléchi au risque de scientisme que comporte votre manière d'aborder la politique ? On voit bien la culture américaine qui vous inspire. Ainsi, dans le New York Times, on trouve sans cesse des articles sur le thème : « tel ou tel problème sociétal se pose, mais, heureusement, nos laboratoires ont trouvé un moyen [ou : nos scientifiques ont posé une équation] qui permet de le résoudre ». Dans la Silicon Valley, on appelle cela le solutionnisme : à tout problème social, une solution technologique. Et ce n'est pas faux, au moins dans un premier temps – vous en êtes l'incarnation. Mais les personnes qui étudient ou vivent la politique depuis un certain temps – ce qui n'est pas mon cas – peuvent nourrir une certaine défiance envers la foi dans l'algorithme, qui risque d'accentuer le phénomène de « boîte noire » que les spécialistes de sciences politiques connaissent bien, ou encore l'oligarchie. Pourquoi remplacerait-on des oligarchies sociales ou de compétence par des oligarchies scientifiques ? La politique française n'aurait-elle pas à y perdre ? Car sa grande beauté, et ce qui fait qu'elle est problématique, certes, mais vivante, c'est qu'il s'y agit précisément de politique, de personnes qui se battent pour des idées. Mme Buffet vient de rappeler qu'un parti est fondé sur la bataille idéologique. Que devient celle-ci entre les mains d'experts comme vous ?
Merci beaucoup à tous deux de nous avoir livré vos points de vue, très riches et très complémentaires – l'un externe, l'autre plus interne. Merci également à Michel Winock pour ses propos, comme toujours très éclairants.
Sur la possibilité d'une représentation proportionnelle, je suis entièrement d'accord avec vous. En France, à cause de notre vision faussée de la Quatrième République, ce mode de scrutin est systématiquement associé à l'instabilité. En réalité, des vingt-huit pays de l'Union européenne, seuls le nôtre et la Grande-Bretagne ont recours au scrutin majoritaire tandis que tous les autres ont adopté un scrutin mixte ou proportionnel ; or la stabilité gouvernementale atteint cinq ans ou cinq ans et demi en Suède, quelque sept ans au Luxembourg ; en Allemagne, en Espagne, la proportionnelle n'empêche pas une alternance régulière et des gouvernements stables. Je partage donc entièrement l'analyse selon laquelle les raisons pour lesquelles on l'a longtemps écartée ne semblent plus valables dans la conjoncture politique actuelle. Mais si l'on adoptait la proportionnelle, quel type de proportionnelle conseilleriez-vous ? Par ailleurs, que penseriez-vous d'un scrutin binominal pour les élections législatives, comme pour les départements, mais en conservant le scrutin majoritaire ? Toujours en restant dans ce cadre majoritaire, quel serait votre sentiment sur le scrutin de liste ? On en parle assez peu ; il a été pratiqué, mais je connais mal les expériences qui en ont résulté.
J'ai pris un temps en considération l'hypothèse d'un vote obligatoire, mais si, comme vous le dites, l'abstention émane surtout des jeunes des classes populaires, on peut douter que cette obligation leur donne une image positive de l'élection ; cette idée serait donc plutôt contre-productive. Pouvez-vous me le confirmer ?
Comment améliorer la parité ? Est-il concevable de durcir les sanctions financières ? Quels autres moyens envisageriez-vous ?
En ce qui concerne l'inscription sur les listes électorales, dont vous avez justement souligné l'importance, ne pourrait-on la faire automatiquement découler de l'adresse retenue pour la carte de sécurité sociale, ce qui faciliterait les contrôles ? Car il est essentiel que tout le monde vote.
Je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit sur l'absence de projet. Je crois hélas que si le parti qui est aujourd'hui le premier de France a réussi à le devenir, c'est parce qu'il a un projet, lequel a le mérite d'exister même s'il n'est guère positif.
À mon sens, nos institutions sont tout de même largement responsables de ce rejet des partis. À ce sujet, disposez-vous de chiffres sur l'abstention dans d'autres régimes politiques ? Pourrait-on en déduire une corrélation entre régime politique et taux d'abstention ? Il me semble que ce dernier est beaucoup plus faible dans les démocraties du Nord de l'Europe et que cela découle d'une longue pratique de la proportionnelle et de la vision du débat politique qui en résulte, très différente de la nôtre. On invoque notre tradition bonapartiste, mais fait-elle partie des aspects les plus positifs de notre histoire ? Les esprits français ne sont-ils pas capables de s'ouvrir au dialogue, au respect d'autrui, au consensus ?
De Gaulle, en particulier, porte une lourde part de responsabilité, lui qui souhaitait que l'élection présidentielle soit détachée des partis, qui l'avait conçue ainsi et qui, voyant que les partis s'en emparaient à nouveau, avait eu cette formule : « si le diable est dans le confessionnal, alors, ça change tout » ! Ce qui en dit long de l'image du parti politique sous la Cinquième République.
Aujourd'hui encore, pour la plupart des Français, deux partis sont représentés, et ils se sentent exclus : pourquoi, se demandent-ils, discuter de politique alors que l'économie joue un rôle croissant et que l'on signe tous les cinq ans un chèque en blanc à un homme incontrôlable ? Dans les pays où l'on discute davantage au Parlement, comme en Allemagne, le débat peut être plus riche.
Deux questions seulement, dont la première s'adresse plus particulièrement à Michel Winock.
Le poids des apparatchiks – le mot n'a pas encore été prononcé ce matin – est-il plus grand aujourd'hui qu'il ne l'a été par le passé ?
Par ailleurs, la très faible représentation de la population française au sein des deux assemblées comme au niveau local n'est-elle pas très largement due au cumul des mandats dans le temps ?

Je dois dire au premier de nos deux intervenants qu'il m'a un peu sapé le moral ! Mais, comme j'ai foi en la politique, il n'y est pas entièrement parvenu.
Il est exact que le temps que les hommes et les femmes politiques passent en politique pose un vrai problème. Les futurs candidats à l'élection présidentielle étaient certainement déjà au Gouvernement ou au Parlement il y a trente ou quarante ans ! En Italie, en Grèce, aux États-Unis, on voit apparaître des personnalités qui ne représentaient pas grand-chose en politique dix ans auparavant. Quand je fais du porte-à-porte, ou d'une manière générale quand je parle avec des électeurs de ma circonscription, je constate que les gens seraient prêts à voter pour quelqu'un qui ne ferait pas partie de la classe politique depuis longtemps. Ce qu'ils veulent, c'est de la nouveauté, une expression nouvelle, quelqu'un qui soit éloigné de l'histoire des partis politiques et de leurs diverses turpitudes.
Ce qui m'amène au problème de l'argent, qui est récent. L'idée d'une contrepartie au financement public a été évoquée : pourquoi pas ? Moi non plus, je ne sais pas ce que c'est que l'éducation populaire, sinon l'école du parti. Tous les partis politiques – même ceux dont le président est en Seine-Saint-Denis, comme le nôtre ! – ont vocation à créer une telle école, et pour cela il faut de l'argent. Or les partis ont reçu de moins en moins de dotations de l'État au cours des dernières années.
Homme politique, est-ce un métier ? Ce problème a été assez peu évoqué. Quand on consacre à la vie politique cinquante, soixante ou soixante-dix heures par semaine, cela devient difficile d'avoir un autre métier. Pour qu'un chef d'entreprise entre en politique, il faut vraiment qu'il ait planté sa société ou qu'il l'ait vendue. Concilier les deux activités tiendrait du miracle. Je ne vois pas comment un cadre du secteur privé pourrait réussir à faire de la politique aujourd'hui. Il gâcherait sa carrière, ce serait une folie. On en revient donc à la question essentielle, que nous allons aborder ensuite, du statut de l'élu – et, pourquoi pas, de l'élu syndical.
Je ne suis pas certain que le passage à la proportionnelle résoudra tous nos problèmes. C'est une piste, mais ce n'est pas la panacée.
Enfin, comme l'a dit Karine Berger, nous sommes confrontés à un parti politique qui, malheureusement, attire les électeurs, sans avoir grand-chose de démocratique, sans être le plus proche des gens dans l'exercice quotidien de la fonction politique. C'est un problème qui ne me semble guère avoir été traité par nos deux intervenants.

J'aimerais pour ma part vous interroger sur la représentativité. Certes, le sexe, l'âge, l'origine sociale, la couleur de peau des élus ne garantissent en rien la qualité des lois votées, mais, si l'Assemblée était à l'image de la société, beaucoup de citoyens pourraient s'identifier aux députés. Les partis politiques ont la possibilité d'y veiller, mais comment, très concrètement ? Il me semble que l'une des raisons de l'attrait du Front national est la grande jeunesse de ses candidats.
Indépendamment de ce qui relève de leur responsabilité propre, les partis politiques sont confrontés à la quadrature du cercle sous la Cinquième République. On leur demande d'incarner l'intérêt général, de présenter à l'élection présidentielle un candidat qui, du fait de la nature de nos institutions, est, paradoxalement, au-dessus des partis, alors que l'une des dimensions proprement démocratiques d'un parti est de représenter la division sociale. En effet, les partis politiques sont statutairement destinés, si l'on peut dire, non seulement à constituer des majorités mais à représenter au sein de diverses assemblées le fait que nos sociétés ne sont pas unies, qu'elles sont traversées de conflits sociaux et symboliques.
On a beaucoup dit, à juste titre, que l'une des raisons de la sempiternelle crise des partis était leur dépolitisation. Mais n'est-ce pas aussi qu'ils ont trop facilement renoncé à l'idée, longtemps défendue par le Parti communiste, d'être les représentants sinon d'une classe, du moins d'une partie, précisément, de la société, et au fait de mettre en scène ce conflit plutôt que de le camoufler en une sorte d'unanimisme de façade qui renvoie à la rhétorique des éléments de langage et vise à ne fâcher personne, à ne pas « prendre parti » ?
Si le Front national est le mouvement politique le plus en vogue aujourd'hui, n'est-ce pas parce qu'il a trouvé une synthèse entre le discours général et la désignation de l'ennemi ? Cette synthèse, on peut estimer, et j'estime pour ma part, que ce n'est pas la bonne ; cet ennemi, il le trouve au sein de populations déjà discriminées. Toujours est-il qu'il a réussi cette synthèse qui caractérise un parti dans un système démocrate et républicain : il prétend être national, représenter l'intérêt de tous, mais sans tomber dans le piège sémantique qui consiste à dire qu'il n'existerait pas de divisions sociales. Certes, je le répète, il place la ligne de front social à un endroit où il ne faudrait absolument pas le faire, mais il assume ce discours de la division. N'est-ce pas un élément essentiel de sa réussite actuelle ?
Merci aux deux intervenants pour leurs présentations qui combinaient des aspects théoriques, pratiques et très concrets.
J'aimerais revenir au principe même du fonctionnement des partis politiques et à sa relation à l'idée d'empowerment des citoyens. La notion de parti politique me semble fournir un parfait exemple de la difficulté à concevoir une instance de médiation entre le politique et le social, entre le pouvoir et l'opinion. Cela étant, pour paraphraser Bernard Manin, il est évidemment impossible d'imaginer des formes viables de démocratie représentative sans parti politique.
Il s'agit là d'une problématique qui relève à la fois de la philosophie politique et de la sociologie, comme vous l'avez bien montré. Le problème est d'abord philosophique, parce que la logique partisane suppose un double mouvement : elle agrège et rassemble des opinions singulières, mais elle écarte toute divergence susceptible de nuire à l'unité d'ensemble. C'est ce qui fait dire à Marc Sadoun que le parti politique s'inscrit à la fois dans la dérive de l'hétérogénéité et dans la tentation de l'unité. Les partis constituent une tentative de réduire les incertitudes inhérentes au fonctionnement démocratique, ce qui est bien différent de l'état d'esprit de l'espace public, dans lequel, par définition, des divergences peuvent s'exprimer. Selon vous, ce principe de fonctionnement propre aux partis politiques est-il compatible avec l'idée d'empowerment, de capacité des personnes ?
Cette notion, abondamment développée dans les travaux de recherche et mentionnée dans les médias, est définie comme un fondement de la participation à la vie démocratique. Elle suppose deux dimensions : premièrement, que l'individu soit reconnu et représenté dans la société ; deuxièmement, qu'il dispose des moyens de son expression. Il faut donc des procédures par lesquelles cette reconnaissance s'exprime, mais cela ne suffit pas : que le citoyen ait les moyens de son expression suppose de donner des capacités à des gens qui n'en ont pas nécessairement. Par ailleurs, cette notion ne renvoie pas à un état de fait mais à un processus à long terme. C'est l'idée que, si quelqu'un a faim, il ne faut pas lui donner un poisson mais lui apprendre à pêcher. Autrement dit, l'empowerment suppose d'acquérir les moyens d'être son propre avocat, ce qui passe par la formation, la discussion, la valorisation systématique de l'espace public comme lieu d'échange, d'où le rôle fondamental de l'éducation populaire.

Derrière tout ce qui a été dit sur le porte-à-porte, la nécessité d'une représentation paritaire ou d'un renouvellement, il y a une question qui nous ramène à la réflexion sur les institutions.
« Vous êtes sympathiques », nous disent les électeurs, « mais à quoi servez-vous ? ». Voilà ce que me rapportent les élus et dont je fais moi-même l'expérience. Les élus locaux font beaucoup d'efforts pour communiquer avec les personnes qui vivent sur leur territoire, pour les séduire, et, au bout du compte, comme le rappelait Marie-George Buffet, on leur dit : « et mon logement, c'est quand ? ».
Si nous devons repenser l'organisation des partis politiques, c'est aussi dans le cadre de l'évolution de nos institutions. Je prendrai un exemple que je connais bien, celui de ma propre organisation politique. Qu'est-ce qui conduit quelqu'un à adhérer à un parti ? Jusqu'à présent, on disait : « vous adhérez, et vous pourrez désigner le candidat ou la candidate qui va vous représenter, et définir le projet politique auquel vous allez vous identifier ». Aujourd'hui, dans le cadre de la démocratie participative, on dit : « vous n'êtes plus assez représentatifs pour désigner votre candidat ; on va donc faire appel, dans le cadre d'une primaire ouverte, à d'autres que vous, ce qui donnera au candidat plus de légitimité ». Voilà qui met à bas l'une des motivations de l'adhésion.
Je vous parle d'une expérience que j'ai vécue, et qui m'a fait me poser beaucoup de questions. On travaille à définir le programme qui va servir à présenter et à soutenir un candidat, mais, à un moment donné, celui-ci se trouve être l'élu d'une base beaucoup plus large et, pour en tenir compte, veut porter ses propres orientations. Cela perturbe les raisons qui peuvent conduire un citoyen à adhérer à un parti.
On n'a peut-être pas assez pris en considération les conséquences de cette nouvelle forme de démocratie où tout le monde veut choisir, décider. Autrefois, d'une certaine façon, c'était plus facile. À l'époque du Mur, on était soit pour les rouges, soit pour les bleus ; il existait une dimension qui dépassait les décisions locales et permettait l'identification.
Les mouvements d'extrême droite ne se nourrissent-ils pas justement de cela ? Ce qu'ils présentent, c'est moins un projet national, ou même local, qu'un rejet total. C'est facile : « c'est la faute de l'Europe, donc on arrête l'Europe ; c'est la faute des immigrés, donc on arrête l'immigration ». Ils fédèrent par le rejet.
En ce qui concerne le financement des partis – j'ai fait vérifier, madame Berger : il s'agit de la loi du 15 janvier 1990 –, on imagine bien comment, si on ne le réforme pas, l'arrivée de financements privés pourrait affaiblir la démocratie. Quand on voit le budget nécessaire à une campagne électorale qui fasse surtout appel à la publicité à la télévision, on imagine les dérives auxquelles on pourrait assister.
Cela nous renvoie à la question, évoquée par plusieurs intervenants, du statut de l'élu. Il est exact que ce serait une folie, de la part de quelqu'un qui travaille dans le privé, de vouloir se lancer dans une carrière politique. Mais nous avons aussi, pour des raisons de morale politique, décidé de figer les carrières des élus issus du secteur public, mettant fin à ce qui représentait pour eux une forme de sécurité : c'est un sacrifice qu'on leur demande aujourd'hui. Le statut et la vie non seulement des partis politiques, mais aussi des représentants sont ici en jeu. Si nous n'abordons pas cette question, nous ne pourrons résoudre le problème du cumul des mandats dans le temps : un passage momentané par la politique est devenu trop dangereux, que l'on vienne du privé ou du public. Bernard Thibault l'a fait observer à propos des organisations syndicales lors de notre dernière réunion. Cela vaut également des responsables politiques, et c'est inquiétant. On a beaucoup glosé sur la place, au sein des partis politiques, des énarques et d'autres produits de nos grandes écoles républicaines. Mais, quand on va faire des planches devant ces étudiants, on constate qu'ils sont bien moins nombreux qu'il y a quelques années à avoir envie de faire de la politique.
En somme, il me paraît essentiel de s'interroger sur les partis politiques dans le cadre de la problématique de l'évolution des institutions. Quelle peut être la portée de l'organisation des partis lorsqu'il s'agit d'entrer dans une nouvelle hiérarchie institutionnelle ? Et quelles sont les institutions qui permettent de faire vivre la démocratie ? Car c'est aussi de cela qu'il est question.
Madame Lazerges, le phénomène des apparatchiks et de l'oligarchisation interne des partis est très ancien : l'étude de Robert Michels à laquelle je faisais allusion date de 1914. Elle se fondait sur l'analyse de ce qui était à l'époque le plus grand parti de masse au monde, la social-démocratie allemande.
Vous avez également, madame, soulevé un véritable problème en invoquant le cumul des mandats dans la durée. Le fait de voir s'éterniser toujours les mêmes personnes à la tête des partis ou au sein des gouvernements incite l'opinion à considérer la politique comme un job, comme une profession, plus du tout comme une vocation civique. Il est essentiel de s'interroger sur les conséquences de la limitation du cumul des mandats dans la durée, et cela concerne les institutions. Tout ce que nous avons pu dire sur le déclin de la politique, des partis, de l'image des politiques, est lié à cette professionnalisation continue. À quoi l'on pourrait répondre qu'il faut bien des techniciens, des experts, doués de connaissances, et que l'on ne peut pas donner un mandat au premier venu, sinon pour faire de la figuration. Devant cette objection, on peut estimer, je crois, que le moment n'est pas encore venu de faire cette réforme.
Merci beaucoup pour toutes ces questions passionnantes. Je vais m'efforcer de répondre à la plupart d'entre elles.
Il a été dit que ma société, LMP, est « de gauche ». Il est vrai que nous cherchons à créer des emplois et qu'en ce sens nous concourons à l'objectif présidentiel de réduction du chômage… Nous n'en sommes pas moins une société. À titre personnel, j'ai des opinions, j'ai participé à une campagne présidentielle de gauche, c'est vrai ; mais notre action et nos méthodes peuvent s'appliquer à n'importe quel parti politique. Si nous faisions du porte-à-porte pour mobiliser des électeurs de droite, nous ne ferions pas la même chose, nous n'irions pas aux mêmes endroits, mais l'idée du contact direct vaudrait tout autant.
En ce qui concerne notre financement, en France, les partis politiques dépensent environ 600 millions d'euros par an, campagne et hors campagne, ce qui représente beaucoup d'argent. Nos clients sont en effet des partis, ou des administrations, de sorte que, indirectement, ce sont les électeurs qui nous financent, comme d'autres sociétés travaillant pour le secteur public. Nos services sont par ailleurs remboursés au titre des règles de financement des campagnes électorales.
J'ai beaucoup aimé la question sur le solutionnisme et le scientisme. La campagne de Mitt Romney, ancien consultant, a été incroyablement bien organisée, de façon extrêmement professionnelle, avec les mêmes outils que ceux d'Obama, mais il lui a manqué un peu d'âme – ce charisme, cette magie que possède Barack Obama. J'espère qu'il n'y a pas de malentendu : mon message n'est évidemment pas que science et nouvelles technologies pourraient remplacer les élus ni que je serais capable de cloner et de développer l'élu parfait. Il y a dans la politique une part de magie, d'irrationnel, d'émotionnel. En bon Alsacien, c'est de sa part rationnelle que je m'occupe, et c'est à elle que touchent les outils auxquels je travaille. Il existe des aspects que l'on sait pouvoir améliorer du point de vue opérationnel et que l'on peut contrôler. Un Barack Obama, cela arrive tous les dix ou vingt ans ; on ne contrôle pas la survenue de candidats pareils ni la ferveur incroyable qu'il a pu susciter en 2008 et que l'on a tendance à oublier tant il est critiqué aujourd'hui.
Pour répondre à Mme Dagoma, si Barack Obama avait tenté de se présenter à une élection en France, il aurait eu beaucoup de mal à être élu conseiller général ou départemental. Ce qui a trait à l'une des recommandations que je ferais à un parti politique pour lequel je travaillerais, à très court terme : je suis tout à fait favorable aux primaires ouvertes, tout en étant parfaitement conscient des questions qu'elles soulèvent en modifiant radicalement le rôle et la fonction des militants que cela peut désarçonner – et il faut en tenir compte.
N'oublions pas que participer à l'activité d'un parti politique, ce n'est pas amusant tous les jours ; je parle d'expérience. Souvent, on vous demande d'aller « tracter » à cinq ou six heures du matin, lorsque les gens commencent à prendre le RER, de coller des affiches la nuit ; c'est dur, et on ne vous dit jamais merci. Il faut vraiment être très motivé ! Si donc je devais résumer l'objectif que j'assignerais à un parti politique, il consisterait à rendre le fait d'être militant aussi amusant et passionnant que possible.
Il y a bien des moyens d'y parvenir. Je suis navré : je vais encore parler de porte-à-porte ! En 2012, environ 80 000 personnes ont participé à la campagne de terrain de François Hollande, dont 60 000 militants et 20 000 sympathisants, qui n'étaient donc pas inscrits au PS et ne se sont d'ailleurs pas nécessairement inscrits ensuite – ils sont venus pour la campagne, puis repartis. Nous avons réalisé un sondage auprès d'eux : ils ont adoré ça. Un esprit de camaraderie régnait parmi eux, et ils ont adoré aller sur le terrain, cela les changeait.
J'ai grandi dans un quartier populaire, dont mes parents sont partis parce qu'ils sont profs et qu'ils pensaient que je subirais de mauvaises influences si nous y restions ; d'ailleurs, mes notes commençaient à baisser. Nous avons déménagé dans un quartier beaucoup plus calme et bourgeois ; étonnamment, j'ai fait de bonnes études, j'ai eu de bons postes, etc. – parce que je suis extrêmement brillant, rien à voir avec mon environnement, bien sûr ! J'avais donc des souvenirs de ce qu'était un quartier populaire, qui dataient de mon enfance à l'Elsau, à Strasbourg, un quartier vraiment délabré dans les années 1990. Je me rappelais les cages d'escalier sales, les ascenseurs en panne, qui restent d'actualité dans certains endroits. Mais, quand j'ai fait du porte-à-porte à Pierrefitte, à Villetaneuse ou à Bagneux pendant les régionales de 2010, j'ai découvert avec surprise – là où je suis allé en tout cas – des HLM propres, repeints. Cela signifie peut-être que la rénovation urbaine n'est pas le principal problème à résoudre aujourd'hui en banlieue puisqu'il l'a déjà été en partie. Des gens comme moi qui ne seraient jamais allés sur le terrain et qui accéderaient à des responsabilités pourraient croire, à tort, qu'il suffit de faire repeindre ou de construire des terrains de jeux. Il est donc essentiel d'aller sur le terrain.
En outre, les militants, je le répète, aiment ça, ont envie de revenir : 95 % des personnes qui ont fait du porte-à-porte en 2012 ont estimé qu'il fallait en faire davantage et se sont dits prêts à recommencer. Évidemment, aujourd'hui, c'est vraisemblablement un tantinet plus difficile.
Que peut faire un parti ? D'abord, former ses membres – vous avez parlé d'éducation populaire. Quand on forme quelqu'un, on lui donne quelque chose ; or, aujourd'hui, on a plutôt tendance à demander aux militants qu'à leur donner. Je serais donc favorable à ce qu'on leur délivre une formation et à ce qu'on leur donne des missions. Par exemple celle, noble, valorisante, d'aller inscrire les gens sur les listes électorales – en attendant que les règles d'inscription soient modifiées, ce qui serait évidemment très préférable : 7 % des Français ne sont pas inscrits sur les listes électorales, soit l'équivalent de Paris, Lyon et Marseille réunis, sans compter les « mal-inscrits », inscrits loin de chez eux et qui ne se déplacent pas le jour de l'élection parce qu'il faudrait prendre un bus, un métro ou sa voiture ; ils sont jusqu'à 25 % dans les quartiers populaires.
Je suis profondément convaincu que l'on peut beaucoup apprendre des expériences étrangères. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille les copier aveuglément. Je vous laisse imaginer la réaction de militants socialistes face à trois jeunes trentenaires arrivant d'Harvard, n'ayant travaillé que dans le secteur privé, qui leur affirment avoir trouvé la solution miracle à leurs problèmes : le porte-à-porte. Peut-être était-ce notre image au début, mais mon message est bien que l'on ne peut pas tout transposer et que des adaptations sont nécessaires. Simplement, nous avons à apprendre des États-Unis : il y a des choses que les Américains font bien et que l'on peut peut-être tester en France. Mais l'on peut aussi observer, beaucoup plus près de chez nous, la Suisse pour ses campagnes électorales, l'Italie pour ses changements institutionnels dont l'invention de la primaire ouverte, ou le Royaume-Uni : je travaille en ce moment avec une députée du Grand Londres qui fait un travail hors campagne absolument fascinant, notamment beaucoup de community organizing – je ne sais pas si cela s'apparente à l'empowerment. J'ai pu observer que les militants sont plutôt friands de ces expériences étrangères.
Il a été dit que ce qui fonctionne aux États-Unis, c'est la publicité. Il est exact que la publicité à la télévision représente 60 à 80 % d'un budget de campagne aux États-Unis, sachant que celui de la dernière campagne d'Obama atteignait 1,2 milliard de dollars. Selon des études scientifiques, l'effet d'une publicité à la télévision est réel mais éphémère, un peu comme celui des meetings sur les électeurs – je ne parle pas des militants –, localisé et temporaire. Pourquoi les Américains y recourent-ils néanmoins ? Parce que de très bons vendeurs leur en proposent, et parce que cela leur donne le sentiment de faire quelque chose. Vous donnez un million à quelqu'un, il vous produit une pub télé qui va être diffusée. Si vous donnez la même somme à un autre pour qu'il frappe à un million de portes, ce sera un peu plus compliqué : il faut aller chercher les militants, les motiver, les former, recueillir des données, etc. En revanche, dans tous les types d'élection, à forte comme à faible participation, le contact direct reste ce qui fonctionne le mieux.
Nous avons évalué l'effet de la campagne de terrain de François Hollande dans un papier d'une quarantaine de pages, bourré d'équations, disponible sur la page de mon associé Vincent Pons sur le site du Massachusetts Institute of Technology (MIT). Il détaille la méthodologie employée, une méthodologie d'évaluation randomisée qui s'inspire du travail de l'économiste Esther Duflo pour l'appliquer au porte-à-porte. Nous avons sélectionné au hasard des bureaux de vote couverts par le porte-à-porte et mis de côté plus de 5 000 bureaux de vote non concernés, puis nous avons comparé après l'élection leurs taux de participation et le score qu'y avait remporté chacun des candidats.
Nous avons été incroyablement surpris du résultat. Pendant la campagne, nous avions raconté à tout le monde que nous allions accroître le taux de participation électorale. Premier constat : le niveau de participation est resté identique. En revanche, le vote pour François Hollande était systématiquement plus élevé de trois points dans les bureaux couverts par le porte-à-porte – de 3,1 points au premier tour, de 2,8 points au second. Nous nous sommes alors demandé à qui nous avions fait perdre des voix : aux communistes, aux écologistes ? Non : au Front national. Le vote pour le Front national a diminué là où les gens étaient allés sur le terrain.
Le porte-à-porte n'est certes pas la baguette magique qui fera baisser le vote Front national, mais peut-être une partie de la recette. Et les personnes sur lesquelles il a eu un effet ne sont pas les électeurs historiques du Front national, mais ceux qui hésitent, chez qui ce vote est motivé non par l'antisémitisme ou le racisme, mais par le sentiment d'être exclus du champ politique, du système, délaissés par des hommes politiques éloignés d'eux, qu'ils voient à la télévision mais pas, sauf exception, près de chez eux. De ce point de vue, le porte-à-porte envoie un message positif : ceux qui le pratiquent ressemblent aux électeurs, ce ne sont pas des gens que l'on voit à la télévision. Vous parlez de personnalisation des campagnes présidentielles : c'est vrai, il y a eu François Hollande, mais il y a aussi eu 80 000 personnes qui sont allées sur le terrain, des personnes « normales », qui n'avaient aucun intérêt immédiat dans l'affaire, qui n'avaient ni élection ni poste à y gagner. François Hollande n'a pas frappé à 5 millions de portes, il a frappé à 53 portes deux semaines avant le premier tour, dans le quinzième arrondissement – il avait évidemment autre chose à faire.
En d'autres termes, on a montré aux gens que l'on venait les écouter. Car quand on fait du porte-à-porte, on ne vient pas donner un logement : le message n'est pas « Le logement, c'est maintenant » ; on vient les écouter. Un bon porte-à-porte, c'est un porte-à-porte où l'on écoute les gens. Cela paraît tout bête, mais ce n'est pas toujours facile.
Enfin, je n'ai pas véritablement d'avis sur les changements institutionnels ou sur la pertinence de la proportionnelle, mais, parmi les partis du Nord de l'Europe qui ont été cités, je connais bien les exemples suédois et norvégiens. En Suède, le parti social-démocrate a eu jusqu'à un million d'adhérents, ce qui représenterait trois ou quatre millions de personnes en France, rapporté à la population, bien au-delà de l'objectif de 500 000 adhérents que se sont fixé récemment le PS comme l'UMP. C'est sans doute lié en partie au cadre institutionnel, mais aussi, vraisemblablement, au rapport qu'entretient la population à la participation démocratique, à l'implication dans les partis, et à ce que ces derniers lui rendent. J'ai ainsi été invité il y a deux étés à une drôle de réunion sur une île en Suède où, pendant une semaine, se rassemblent tous les partis politiques, les dirigeants d'associations syndicales, d'ONG, les grands patrons – une sorte de La Rochelle géant, absolument fascinant, extrêmement ouvert, où tout le monde débat avec tout le monde et qui témoigne d'un rapport au militantisme entièrement différent du nôtre. Je ne dis pas que c'est un modèle pour la France, mais peut-être y a-t-il là des éléments qui mériteraient d'être observés.
Je suis ravi d'avoir eu l'occasion d'échanger avec vous et j'espère que vos travaux se poursuivront et seront utiles. Je serais heureux de poursuivre cette discussion ou d'apporter ma contribution si vous le jugez opportun.
Dans le temps limité qui m'était imparti, je ne m'étais pas attardé sur le diagnostic. Je suis naturellement d'accord avec ce qui a été dit sur les conséquences des transformations idéologiques et politiques intervenues au cours des vingt-cinq ou trente dernières années.
Il y a deux manières de concevoir le problème : soit l'on en reste à la déploration, au « c'était mieux avant », au fatalisme ; soit on tente d'identifier les quelques leviers sur lesquels il est possible d'agir. Guillaume Liegey vient d'en énumérer certains qu'il appartient aux partis politiques d'actionner, plutôt qu'à ce groupe de travail. Je tenterai pour ma part de cerner les moyens d'améliorer la situation, sinon de résoudre comme par magie toutes les difficultés.
Des interventions se dégagent plusieurs éléments convergents. La proportionnelle, tout d'abord, ne peut être réduite à une question technique. Cette revendication fait partie de l'histoire du mouvement ouvrier français et de celle du mouvement républicain. Les gambettistes estimaient que l'élection au suffrage universel devait s'accompagner de la représentation proportionnelle – la « RP » – parce que la France était tenue par des notables conservateurs, monarchistes, catholiques intégristes. Les républicains ont d'ailleurs introduit la proportionnelle lorsqu'ils ont pris le pouvoir, au début des années 1880, mais ils ont refermé la porte à la suite de l'épisode boulangiste, cet impressionnant mouvement de masse autour d'un leader charismatique – encore un, après Napoléon Ier et Napoléon III – qui, dans sa vaste opération marketing, s'inspirait déjà des États-Unis. Par la suite, les socialistes, puis les communistes, et aujourd'hui le Front national, ont repris cette revendication.
Pourquoi ? Parce que la proportionnelle, c'est la représentation de la diversité de la société : celle des catégories sociales, mais aussi celle des intérêts. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Je suis profondément d'accord avec Michaël Foessel sur ce point. Le scrutin majoritaire à deux tours accentue le phénomène analysé par le socio-économiste américain Anthony Downs : on ne cherche pas à gagner les élections pour appliquer son programme, on cherche à élaborer le programme qui permet de gagner les élections. Je ne parle pas là d'idéologie, seulement de programme.
À cet égard, ce qu'a dit Claude Bartolone sur le Parti socialiste est très juste. Il se trouve que c'est ce parti que j'observe de manière privilégiée, non parce que je suis socialiste moi-même, mais comme l'un de mes terrains d'étude. En 2010 et 2011, après le désastreux congrès de Reims, Martine Aubry, à qui on peut faire certains reproches, a néanmoins réussi, avec ses partenaires, à relancer la machine à élaborer le programme en interne. Puis les primaires sont arrivées, et c'est François Hollande qui les a remportées ; il avait bien dû se distinguer, sur différents points, au cours de la campagne des primaires, puis il a élaboré son propre programme, avant d'adopter une autre politique encore. Le phénomène est le même pour les députés, pour les maires, etc.
Il y a bien là une contradiction profonde avec ce qu'est le parti, étymologiquement chargé de défendre une partie – pars – de la société. On peut parler d'unité nationale, mais la manière dont la moindre loi provoque des manifestations de telle ou telle catégorie nous rappelle que la société est le lieu de la diversité des intérêts. En France, nous n'avons pas du tout la même attitude que les Américains vis-à-vis de cet état de fait. Eux l'assument : pour eux, la démocratie, c'est le pluralisme – la polyarchie, disent les spécialistes. Une multitude d'intérêts sont en jeu, chacun a le droit de s'exprimer, et les partis ont pour fonction d'agréger ces intérêts. Les conventions des partis démocrate et républicain aux États-Unis constituent ainsi, à la suite d'élections primaires, des espèces de gigantesques marchés où sont représentés la communauté gay, les Noirs, les partisans de la nourriture macrobiotique, etc., qui soutiennent tel ou tel candidat, lequel défendra en retour leurs intérêts – pour le meilleur et pour le pire : il n'y a guère de raison de s'étonner de ce qui advient quand le soutien est venu des banquiers ou des publicitaires. Quoi qu'il en soit, tout cela est beaucoup plus naturel qu'en France où prévaut le discours sur l'unité nationale. On a l'impression d'être au xixe siècle quand on entend François Mitterrand dire que le peuple de gauche a gagné, que la majorité sociologique a atteint la majorité politique. C'est pourtant la réalité.
Aujourd'hui, les institutions renforcent cette espèce de flou dans la pratique. Bien sûr, il y a la convergence des politiques économiques, les contraintes européennes, etc. Toujours est-il que le problème est évident à l'échelon local – auquel je me suis, c'est vrai, beaucoup intéressé et qui est essentiel pour mesurer ce qui fait que les gens se reconnaissent ou non dans la politique.
Le communisme municipal a été, si l'on ose dire, le meilleur produit d'appel du Parti communiste : s'ils avaient attendu les lendemains qui chantent et la révolution promise, les militants n'auraient pas tardé à aller voir ailleurs, mais ils restaient parce que, dans les municipalités communistes, il y avait de formidables centres aérés pour les enfants, des centres de soins, etc. Aujourd'hui, on élit des maires qui n'ont en fait aucun pouvoir, qui se retrouvent, tous partis confondus, dans des structures intercommunales où ils « dealent » entre eux, loin du regard des citoyens. 80 % des décisions politiques sont prises ainsi, que l'on ait voté pour un maire de droite ou pour un maire de gauche. Et que l'on ne dise pas que les poubelles, par exemple, ne sont ni de droite ni de gauche : on peut choisir de passer par une régie publique ou par une entreprise privée, etc.
Ce système de cogestion généralisée entraîne l'appel à des élus experts, ceux que l'on appelle en science politique les « technotables ». 30 % des nouveaux élus à l'élection municipale de 2014 n'ont jamais travaillé que pour la politique. Ils ont débuté comme assistants parlementaires ou responsables de cabinet d'un élu local, ils ont généralement un bac + 4 ou 5, un master, souvent en science politique – nous contribuons malheureusement, nous, universitaires, à cette évolution –, ils sont dans la roue d'un élu, ce qui permet de contrôler les sections, tâche d'autant plus facile qu'il y a moins d'adhérents, et ils attendent de prendre sa suite. Quelle est la socialisation de ces personnes ? Ils ne viennent pas d'une organisation de défense des droits de l'homme, ils ont toujours géré de petites affaires d'élus locaux et ont une vision souvent assez technique de la politique.
On s'étonne que le Front national prospère sur ce terreau. Mais le Front national est un parti idéologique, il n'a pas besoin de mettre en avant des personnes connues. Cette situation est toutefois en train de changer, et il serait intéressant d'observer les effets de la conquête de mandats locaux, qui sera sans doute massive lors des prochaines échéances électorales. J'appelle d'ailleurs votre attention sur les effets pervers du mode de scrutin pour les régionales. Quoi qu'il en soit, ce parti représente une offre idéologique, que l'on peut critiquer, juger démagogique, mais qui a l'avantage d'être omnibus : vous tapez sur les étrangers, cela fonctionne contre les Allemands en Europe, contre les Chinois, contre les Arabes, contre l'euro, etc. C'est un très bon produit, qui n'en est pas à son premier succès ; si le Front national n'est pas un parti nazi, la recette consistant à faire de l'étranger le responsable de tous les maux est aussi vieille que la politique démocratique. C'est un nationalisme exacerbé, un protectionnisme. Et en face, qu'est-ce qu'on a ? « Ouh là là, c'est très compliqué, les problèmes, aujourd'hui… » Et l'on s'étonne que les gens ne connaissent pas le nom de leur député ? Mais ils s'en foutent !
Certes, le phénomène est renforcé par la distance géographique et la mobilité des personnes. De plus, je caricature évidemment ces attitudes. Mais il faut ouvrir les yeux. On n'attrape pas les électeurs sans identité forte, sans message politique clair, sans leur dire que l'on défend leurs intérêts, des intérêts bien identifiés, en proposant une autre grammaire que celle du Front national. La grammaire de classe paraît aujourd'hui dépassée, vieillotte ; mais, après tout, le Front national, lui, sait bien l'utiliser quand il en a besoin.
Je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'il n'y aurait plus aujourd'hui de frontières idéologiques. On décide d'aller faire la guerre en Irak contre Daech, de maintenir l'enseignement privé dans le système scolaire : ce sont des choix qui engagent profondément notre pays. Bien des domaines peuvent être politisés. Mais pourquoi, aujourd'hui, les acteurs politiques ont-ils peur de cette politisation ? « Ce n'est pas de la politique », entend-on, « c'est technique ». Il y a là une responsabilité considérable, qui ne vient pas des individus mais qui est renforcée par le système électoral et par l'absence de vision claire des compétences. J'admire déjà les électeurs qui vont voter aux cantonales. Pour quoi votent-ils ? D'abord, nombreux sont ceux qui ignorent totalement ce que fait un département ; en outre, on ne sait même pas si cet échelon va perdurer.
Cessons donc de nous donner des excuses, d'être fatalistes et d'exhorter malgré tout à continuer de croire en la politique. On m'a reproché d'être un peu pessimiste, mais je me retenais ! Je prédis que trois ou quatre régions vont tomber dans l'escarcelle du Front national, la réforme régionale n'ayant pas arrangé les choses ; pour le malheur du Front national, d'ailleurs, car Marine Le Pen craint la montée des élus locaux qui vont développer des stratégies pragmatiques, contraints qu'ils seront, eux aussi, à s'adapter aux règles du jeu institutionnel. Mais, si les partis politiques ne réagissent pas, le réveil va être très brutal, ne serait-ce que par l'effet mécanique de l'abstention. On dit toujours qu'il faut apporter des réponses aux électeurs du Front national, mais on ne s'adresse pas à ceux qui sont perdus, qui ne se reconnaissent pas dans l'électorat FN, et dont l'abstention laisse le Front national prospérer.
En ce qui concerne la proportionnelle, une action de long terme me semble nécessaire, car beaucoup d'aspects y sont liés. La proportionnelle inciterait notamment les partis à assumer clairement leurs positions, quitte à ce qu'ils fassent des compromis dans un second temps. Vous avez rappelé, madame Cohendet, que la France était, avec le Royaume-Uni, l'un des seuls pays à recourir au scrutin majoritaire, chacun des deux ayant son propre système. Mais cette idée que la culture politique française serait par nature conflictuelle, à l'image de ce qui se passe dans le village d'Astérix, me paraît une ineptie : la France n'est ni plus ni moins diverse et traversée par des conflits que les autres pays. Si elle a une histoire conflictuelle, cela tient aussi aux blocages institutionnels : nos institutions ne poussent guère au compromis. La proportionnelle, elle, force les acteurs à s'entendre. Ainsi en va-t-il pour les organisations syndicales, qui défendent chacune leurs positions, voire s'affrontent, mais sont bien obligées, une fois autour de la table, de se mettre d'accord, sans que cela remette en cause leur identité propre. De même, si les différences entre patronat et syndicats sont loin d'avoir disparu, ils n'en arrivent pas moins à passer des accords.
Quant à l'argument selon lequel le scrutin majoritaire garantirait la stabilité et l'efficacité, il ne me paraît guère sérieux : le Président de la République n'applique pas le programme sur lequel il a été élu, et il est contraint d'aménager en permanence sa politique en fonction non pas tant des guérillas internes au Parlement que des levées de bouclier de la société, qu'il s'agisse de quelques patrons en colère, de manifestants bretons ou de militants qui occupent le site d'un futur aéroport.
D'autre part, stabilité n'est pas nécessairement synonyme d'efficacité. Si les partis sont toujours là malgré la crise qu'ils traversent, c'est que les règles les protègent – en un sens, heureusement. C'est d'ailleurs ce qu'énonce la théorie actuellement dominante dans le champ de la science politique au niveau international : les systèmes de partis se maintiennent grâce à des formes de cartellisation. En d'autres termes, les règles du jeu politique, notamment les modes de scrutin et les règles de financement – par exemple, le scrutin majoritaire à deux tours, le seuil d'éligibilité de 5 % appliqué à telle ou telle élection, le calcul des dotations basé pour moitié sur le nombre de parlementaires – favorisent systématiquement les partis en place, voire créent des rentes de situation. Voilà ce qui assure la stabilité, en dépit de la baisse régulière du nombre d'adhérents et de la participation.
Il n'a jamais été aussi difficile qu'aujourd'hui de se présenter à une élection si l'on n'appartient pas à un parti politique, notamment parce que cela coûte cher. D'autant que la limitation très stricte du financement privé en France – dont je me réjouis – empêche les milliardaires de surgir dans le paysage politique, phénomène que nous pouvons observer, en revanche, aux États-Unis. À cet égard, le système politique américain est une ploutocratie : les congressmen possèdent généralement une fortune personnelle, qu'ils avaient acquise au préalable ou qu'ils ont accrue grâce à leur activité politique. C'est l'argent qui leur permet d'entrer dans le jeu politique, car se présenter aux primaires coûte très cher, sauf lorsque l'on est soutenu par de généreux donateurs, mais on risque alors de n'être qu'une marionnette dans les mains des groupes d'intérêts économiques.
La contrepartie de cette logique de cartel, c'est que les partis ne sont plus, à l'exception du Front national, les lieux où les programmes se fabriquent, où les représentations de la société se diffusent et où les militants sont formés. Ils n'ont plus d'autre fonction sociale que celle de sélectionner les candidats. De ce point de vue, je porte un jugement mitigé sur les primaires. Certes, je suis d'accord avec le diagnostic que certains d'entre vous ont fait : en réservant aux seuls adhérents la possibilité de désigner les candidats, on leur donne un pouvoir considérable. Mais, si l'on généralise le mécanisme des primaires, à quoi cela servira-t-il d'adhérer à un parti ?
Quoi qu'il en soit, il faut réfléchir à tout ce qui pourrait inciter les citoyens, sinon à adhérer, du moins à se sentir concernés par la vie des partis politiques. Nous pourrions notamment nous inspirer des instruments utilisés à l'étranger. Ainsi, une partie des dotations publiques – par exemple un tiers – pourrait être affectée aux partis politiques par les citoyens eux-mêmes à travers l'impôt, sur le modèle de ce qui se pratique en Allemagne pour le financement des Églises. Néanmoins, un tel mécanisme se heurte au fait qu'une partie de la population ne paie pas d'impôts. En outre, le montant des dotations pourrait dépendre pour partie du nombre d'adhérents, à condition que celui-ci fasse l'objet d'un contrôle. Dans plusieurs pays d'Amérique du Sud et d'Europe centrale, notamment en Pologne, les partis doivent collecter des signatures à cette fin. Cela les oblige à solliciter le soutien des électeurs en continu, et non seulement de manière ponctuelle à l'occasion des élections. Enfin, nous pourrions prévoir que, pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, un candidat doive réunir soit 500 signatures d'élus comme c'est le cas actuellement, soit 500 000 signatures de citoyens. Là encore, cela pousserait les partis à aller davantage vers ces derniers. Ce sont là des pistes.
Je terminerai en évoquant la formation. J'ai notamment animé des travaux de recherche sur la formation syndicale, et je me réjouis, à cet égard, de la présence de Bernard Thibaut aujourd'hui. On parle parfois des écoles du parti communiste, mais on connaît moins le remarquable système de formation interne mis en place par les organisations syndicales en France. Pour la plupart, les syndicalistes se forment non pas à l'université, mais sur le tas, non seulement dans les luttes, mais aussi dans des écoles de formation. Cela vaut pour tous les niveaux : militant de base, conseiller prud'homme, etc. La formation est non seulement idéologique, mais aussi pratique – étude du code du travail, analyse économique –, car la rhétorique marxiste et l'invocation de la lutte des classes ne suffisent pas pour mener une négociation de branche ! Ce système coûte de l'argent aux organisations syndicales – une partie de l'activité est néanmoins bénévole –, mais c'est ce qui leur permet de fonctionner. De plus, à la différence des partis politiques, les syndicats proposent aussi des formations aidant à la reconversion professionnelle, notamment à leurs militants les plus aguerris qui pourraient susciter la méfiance des employeurs, à plus forte raison si le syndicat lui-même a une image négative auprès de ces derniers. S'ils disposaient des moyens matériels adéquats, les partis politiques pourraient faire, eux aussi, de la formation.
Je souscris tout à fait à la remarque qui a été faite sur la limitation du cumul des mandats dans le temps, mais celle-ci doit s'accompagner de l'élaboration d'un statut de l'élu, afin d'éviter la professionnalisation durable de la politique, qui est aujourd'hui un fait incontestable. Cela devrait nous amener à réfléchir, sans fausse honte, à des mesures spécifiques en faveur de ceux qui ont exercé des mandats électifs : pourquoi un ancien maire ou un ancien conseiller général ne bénéficierait-il pas d'une voie d'accès spéciale à certains corps de la fonction publique ? Pourquoi n'aurait-il pas droit à des crédits de formation importants pour l'aider à se reconvertir ? Pour ma part, je trouve plutôt positif qu'un ancien ministre, Arnaud Montebourg, ait créé sa propre entreprise. Certes, tout le monde n'a pas son carnet d'adresses, mais nous pourrions accompagner les démarches de cette nature. À tout le moins, il faut débattre de ces questions. Ne nous contentons pas de regarder passer les trains !
Il m'est difficile de rester silencieux sur ce sujet qui m'intéresse. Les éléments dont vous avez fait part, les uns et les autres, recoupent certains échanges que nous avons eus au cours des séances précédentes.
Qu'attendent les citoyens des partis politiques ? Selon moi, que ceux-ci fassent de la politique. Or les citoyens constatent, à regret, que tel n'est plus le cas : ce n'est plus au sein des partis que l'on débat des enjeux, des options, des représentations. Les jugements à cet égard sont parfois excessifs – je connais suffisamment d'élus et de responsables politiques pour savoir ce que signifie l'engagement politique –, mais, d'une manière générale, les partis remplissent toutes sortes de fonctions sauf celle-là. Ainsi que nous venons de l'évoquer, ils servent surtout à fabriquer des listes de candidats, c'est-à-dire de prétendants à l'exercice de certains métiers. Et cette réalité est de plus en plus perçue comme telle. Que devrait être un parti politique, sinon un espace organisé, fournissant un cadre démocratique – c'est-à-dire, dans une certaine mesure, pacifié et régi par des règles – pour l'affrontement des idées ?
Pourtant, à l'image des citoyens de beaucoup d'autres pays, les Français ne sont pas moins politisés qu'auparavant, ni moins intéressés par l'avenir, ni moins engagés dans la vie collective, notamment associative, à des échelles où ils estiment avoir prise sur la réalité quotidienne, même si celle-ci peut apparaître très éloignée des enjeux internationaux ou globaux. L'engagement citoyen peut d'ailleurs prendre des formes variées, parfois éphémères, associatives ou « mouvementistes », qui cherchent à se distinguer, par les valeurs qu'elles défendent et par le comportement qu'elles adoptent, des partis tels qu'ils existent. Ce n'est pas, là non plus, une spécificité française : on retrouve ce phénomène dans de nombreux pays, notamment avec le mouvement des Indignés. Même si l'on peut être critique à l'égard de ces derniers, il est intéressant d'analyser leurs motivations et leur mode de fonctionnement. On relève, en particulier, qu'ils n'ont pas de leader, c'est-à-dire qu'ils rejettent a priori tout mécanisme dont la vocation première serait de choisir une personne à laquelle on donne carte blanche pour un mandat donné. Si, de leur côté, les partis politiques ne font qu'organiser la confrontation entre les prétendants et choisir celui ou celle qui aura carte blanche à tel ou tel niveau – local, régional ou au-delà –, alors ils font tout sauf de la politique et ils ne répondent pas aux aspirations des citoyens.
Dans ce contexte, il y a un espace, dans la représentation politique, pour ceux qui prétendent incarner une réponse autoritaire, voire violente – je fais très directement allusion à l'extrême-droite. Mais, si l'on en arrive là, c'est faute d'autres réponses. Pour notre part, il nous revient de réfléchir aux réponses institutionnelles.
S'agissant des modes de scrutin, nous sommes tous conscients qu'aucun d'entre eux n'est neutre quant à ses effets, y compris au regard des principes démocratiques. Je n'ai pas d'avis arrêté sur le dispositif le plus approprié, mais il faut selon moi réfléchir à l'introduction de la proportionnelle ou, à tout le moins, d'autres mécanismes qui vont dans le sens d'une meilleure représentation des opinions des citoyens. Dans notre système institutionnel, à ma grande surprise, on considère qu'un vote majoritaire à l'Assemblée nationale équivaut à un vote majoritaire des Français. Or ce n'est absolument pas le cas, et ça l'est encore moins au Sénat ! Les citoyens ont, au contraire, le sentiment croissant que leurs opinions ne sont pas représentées ou pas prises en compte. Cela alimente d'ailleurs les mouvements sectoriels ou corporatistes, qui ne reconnaissent pas les décisions comme démocratiques, dans la mesure où les mécanismes institutionnels n'organisent pas une représentation véritablement démocratique du pays.
Les remarques des uns et des autres ont beaucoup porté sur les mécanismes. Pour ma part, je suis très réticent à considérer que les réponses aux défis qui se posent relèvent purement de la mécanique : la politique au sens large ne peut pas se résumer à la cuisine interne des partis pour désigner leurs leaders, leurs candidats aux élections et les responsables politiques. Là n'est pas la clé, selon moi. Certes, il est naturel que les partis cherchent à se doter d'outils pour être plus performants. Mais encore faut-il s'entendre sur le sens du terme « performance » : il arrive qu'un parti obtienne ponctuellement un très bon score à une élection et que, deux ans plus tard, le taux de satisfaction de la population atteigne un niveau très faible. Ainsi, l'euphorie électorale est parfois suivie, quelque temps après, d'une forme d'écroulement démocratique, et pas seulement en France.
Il serait utile, messieurs les présidents, que nous revenions sur le thème de la démocratie sociale au cours de nos séances suivantes.
Le cumul des mandats dans le temps, qui participe de la professionnalisation de la vie politique, concerne aussi la sphère sociale et syndicale. Les mouvements que j'ai mentionnés, qui essaient de s'organiser en dehors des partis, parfois en s'en défiant, se sont imposé comme règle une rotation – turnover – plus automatique aux postes de responsabilité. Je ne dis pas qu'il faut nécessairement reprendre cette règle, d'autant qu'elle ne peut pas être appliquée avec la même fluidité dans les institutions politiques. En outre, l'exercice des responsabilités représente toujours un défi : il s'agit d'être efficace, y compris dans la durée. Néanmoins, les personnes qui s'engagent en politique devraient considérer non pas qu'elles se lancent dans une carrière politique – ce qui est perçu de manière très négative –, mais qu'un mandat leur est confié pour une période déterminée. Il n'y a pas de raison que cette conception ne l'emporte pas. Le cumul des mandats dans le temps est l'une des causes de la baisse du nombre de salariés qui exercent des mandats politiques nationaux, non seulement des cadres, mais aussi des ouvriers. À certaines périodes, des ouvriers ont été remarqués dans la vie collective de la Nation. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui.
D'ailleurs, cela tient aussi à des aspects purement matériels. Pour ce qui est de la sphère sociale, l'entreprise a l'obligation légale de réintégrer un salarié dont le mandat syndical prend fin. Dans le secteur public, on reconnaît enfin ce droit à la reconversion professionnelle, et les choses se passent de manière relativement simple : le salarié concerné négocie avec l'entreprise les conditions de sa reconversion. Mais tel n'est pas le cas dans le secteur privé. Le même problème se pose pour les mandats politiques. Il s'agit, selon moi, d'une vraie question, qu'il n'est pas facile de traiter : nous devons permettre aux élus d'exercer plus largement leurs droits, notamment le droit à la reconversion professionnelle au terme de leur mandat, mais sans que cela apparaisse comme des privilèges ou un statut acquis. En tout cas, ne négligeons pas les aspects matériels liés à l'exercice des fonctions politiques.

Il faut que les partis affichent clairement les valeurs qu'ils défendent, ce qu'ils ne font pas suffisamment. En outre, il serait souhaitable que les partis ne soient plus de simples associations, mais qu'ils relèvent d'un statut spécifique, qui permette notamment d'exercer un contrôle extérieur sur leur mode de financement. Si les partis étaient vraiment exemplaires de ce point de vue, la défiance des citoyens à leur égard serait peut-être moindre.
Aux États-Unis, un professeur de droit, conseiller de Bill Clinton, avait proposé de tenir des « États généraux » avant le scrutin présidentiel afin que les citoyens puissent définir les orientations et le programme de campagne qu'ils souhaitent. Que pensez-vous de cette idée, monsieur Sawicki ? Selon moi, il serait intéressant d'organiser, avant une élection, même régionale ou départementale, une sorte de grand atelier auquel les citoyens seraient conviés pour faire valoir les orientations politiques qui devraient, selon eux, être adoptées par les candidats.
Je reviens sur la question de la personnalisation des partis, évoquée par Mme Berger. Ne nous faisons pas d'illusions : au cours de leur histoire, les partis ont toujours été représentés par un leader. Et, lorsqu'il n'y en avait pas, on parlait de crise de leadership. On a besoin du leader : c'est lui qui donne sa visibilité au parti. Jadis, nous avons eu « le parti de Jaurès », puis « le parti de Thorez ». Quant à l'exemple du Front national, il me semble mal choisi : plus que tout autre parti, le Front national a été pendant longtemps le parti d'un homme, Jean-Marie Le Pen. Et sa fille est, elle aussi, une personnalité représentative et bien connue. Ne tombons pas dans l'angélisme en réclamant des partis purement idéologiques : les individus comptent. Pour le général de Gaulle, d'ailleurs, seuls les individus comptaient, et pas les partis. Tel n'est pas mon avis, mais n'oublions pas le rôle très important du leadership.
S'agissant de la proportionnelle, les comparaisons internationales ne permettent pas de démontrer la pertinence de telle ou telle institution, car chaque peuple, chaque nation a sa spécificité, son idiosyncrasie. Or, dans notre cas, l'histoire montre à quel point nous avons peu d'aptitude au consensus. Ainsi que je l'ai rappelé, Tocqueville estimait très répandu en France ce qu'il appelait l'« individualisme collectif ». Je crois que tel est toujours le cas aujourd'hui et que, si l'on introduisait la proportionnelle intégrale, cela poserait le problème de la gouvernabilité du pays. Certes, il existe plusieurs formes de proportionnelle et on parle souvent d'une « dose » de proportionnelle, mais n'oublions pas notre histoire et les précédents.
Enfin, l'affaiblissement des partis tient aussi à l'amoindrissement des débats et des affrontements idéologiques. Le primat de l'idéologie, que j'ai évoqué dans mon propos liminaire, caractérise bien davantage les partis qui se trouvent dans l'opposition – je pense notamment au Front national. Car l'arrivée au pouvoir, c'est aussi la confrontation avec la complexité du réel. En général, l'image de « sauveur » du parti vainqueur en souffre beaucoup. J'ai écrit un jour : « Gouverner, c'est décevoir. » À cet égard, méfions-nous des programmes. Certes, il n'est pas possible de faire une campagne électorale sans programme, mais on peut être à peu près certain qu'un programme long, détaillé et péremptoire ne sera jamais appliqué, car les responsables politiques se heurtent à toutes sortes d'obstacles et de contraintes une fois arrivés au pouvoir. Voter, c'est d'abord faire confiance à un parti ou à un candidat.
Les Français ont une culture de la confrontation, notamment à cause du mode de scrutin, mais ces habitudes mentales peuvent évoluer. Nous l'avons constaté avec la cohabitation : avant cet épisode, les Français pensaient qu'il serait néfaste pour le pays, mais, au cours de la cohabitation elle-même, leur point de vue a complètement changé. Il faut donc tenir compte des habitudes, mais aussi être conscients que nous sommes capables de les surmonter.
Pour revenir à l'histoire, la vraie source de l'instabilité gouvernementale sous les iiie et ive Républiques a été non pas la proportionnelle – même si celle-ci a aggravé les choses sous la ive – ou la faiblesse présidentielle, mais les violations de la Constitution par les Présidents de la République, notamment les abus de pouvoir de Mac Mahon et de Grévy, qui ont refusé systématiquement – huit fois en tout – de nommer Gambetta président du Conseil. En agissant de la sorte, ils ont empêché que le chef du Gouvernement soit le leader de la majorité. Or, ce qui fait la stabilité, c'est le fait que le chef de l'exécutif soit légitimé et contrôlé par les représentants du peuple. Dépourvu d'une telle légitimité et privé de la possibilité de dissoudre la Chambre, le président du Conseil était très affaibli. Quant au Président de la République, il avait tout juste assez de force pour porter atteinte au pouvoir du président du Conseil.
Plusieurs d'entre vous ont évoqué le thème de l'éducation. Nous devrions réfléchir à nouveau au contenu des programmes scolaires : il convient notamment de dispenser, en classe, un enseignement sur les partis politiques et sur leur histoire. Car nous constatons, en tant qu'enseignants, que les étudiants ont une véritable phobie du politique : de leur point de vue, tout ce qui en relève est sale, y compris le terme « politique » lui-même – je ne parle même pas des partis. Et si l'on invoque alors la définition de la démocratie, certains se récrient en disant : « Attention, vous faites de la politique ! » Cela me semble très grave.
La discussion est passionnante. Je vous remercie, les uns et les autres, pour vos remarques et pour vos questions.
La proportionnelle n'est pas la seule question qui se pose, mais elle ouvre sur beaucoup d'autres : la professionnalisation des élus, la représentativité, les relations entre les différents niveaux de pouvoir, etc. Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur Winock, car l'Histoire risque de devenir un argument pour ne rien changer. La question de l'introduction de la proportionnelle pour l'élection des parlementaires ne se pose pas dans les mêmes termes aujourd'hui que lorsque François Mitterrand l'a instaurée en 1986. Certains changements intervenus récemment dans la vie politique française ont des effets très importants, en particulier le quinquennat – dont nous n'avons pas parlé – et l'inversion du calendrier électoral. Déjà légitimé par le scrutin majoritaire à deux tours – mécanisme particulier à la France, le scrutin présidentiel ne comptant souvent qu'un seul tour dans les autres pays – et doté de pouvoirs très larges, le Président de la République est désormais, en sus, élu avant l'Assemblée nationale et pour la même durée qu'elle. Cela le rend potentiellement très puissant, car les élections législatives qui se déroulent dans la foulée lui donnent, en principe, une majorité assez confortable, même si cela ne sera peut-être pas toujours le cas.
Deuxième évolution importante qui va changer la donne : l'interdiction du cumul des mandats. Les parlementaires seront désormais plus disponibles pour effectuer leur travail.
Troisième élément : le Front national. En 1945, le général de Gaulle a introduit la proportionnelle – en 1958, il n'y sera plus favorable – par crainte de voir le parti communiste l'emporter avec un scrutin majoritaire à deux tours. L'instauration de la proportionnelle visait donc à cantonner ou à endiguer le parti communiste. Cela a eu des effets pervers : deux partis politiques, le parti communiste et le nouveau parti créé par de Gaulle lui-même, qui rassemblaient respectivement 25 % et 20 % des voix, se sont retrouvés hors du jeu politique. Les autres partis ont alors inventé le mécanisme invraisemblable des apparentements, qui relevait clairement de la cartellisation.
Aujourd'hui, de nombreuses personnes sont attachées au scrutin majoritaire à deux tours, notamment parce qu'elles pensent que cela va empêcher la montée du Front national. Or c'est faux : il y a de plus en plus de triangulaires. En outre, un nombre croissant d'électeurs de l'UMP – la moitié d'entre eux actuellement – sont prêts à voter en faveur du Front national au second tour s'ils n'ont le choix qu'entre le PS et le Front national. Ce report de voix est dans une certaine mesure contraint : il est notamment le fait d'électeurs de droite qui éprouvent une aversion viscérale pour les socialistes – on peut estimer que leur vision est datée et que les socialistes devraient leur paraître moins « dangereux » aujourd'hui qu'il y a trente ans, mais il existe aussi des formes de haine de classe.
Enfin, je relève une forme de contradiction dans vos propos, monsieur Winock : certes, gouverner ne consiste pas nécessairement à appliquer un programme, et il est en effet important de responsabiliser les partis, mais comment le faire sans leur permettre d'avoir des élus ? Je vous renvoie à certains articles très intéressants sur la manière dont se sont comportés les quelque quarante députés du Front national entre 1986 et 1988 : l'Assemblée nationale a fonctionné, et certains d'entre eux ont rejoint les partis de la droite parlementaire pour avoir une chance d'être réélus. Nous ne pouvons pas maintenir indéfiniment le Front national hors du jeu politique : cela maintient l'illusion aux yeux de l'électorat que ce parti est brimé et qu'il a de véritables solutions à offrir. La proportionnelle permettrait, au contraire, de l'associer en douceur. Ou bien préférons-nous qu'il devienne majoritaire ? Je prévois – j'espère me tromper – la victoire du Front national dans deux régions au mois en décembre prochain. Pour l'emporter au second tour dans le cadre d'une triangulaire, il suffit en effet d'arriver en tête avec 35 % des voix.
Pourriez-vous préciser : parlez-vous de la proportionnelle intégrale ou non ? Car cela change tout.
Je ne suis pas en mesure de vous donner une réponse précise à ce stade, car la question mérite un examen approfondi. Je ne suis pas favorable à la proportionnelle intégrale. Selon moi, il convient, d'une part, de fixer un seuil d'éligibilité et, d'autre part, de déterminer si le scrutin doit se dérouler ou non dans le cadre d'une circonscription nationale unique – ces deux questions étant d'égale importance. En tout cas, il faut « proportionnaliser » les élections de manière significative, pour les raisons que j'ai indiquées, notamment pour garantir une plus grande diversité dans le recrutement du personnel politique, ainsi que l'a évoqué Mme Dagoma.
Certes, on peut craindre que les partis soient tentés de ne présenter que des apparatchiks à une élection à la proportionnelle. Mais, à moins d'être très marqués idéologiquement comme le Front national, ils ne peuvent guère se le permettre : loin de voter de manière aveugle, les électeurs sont attentifs à la représentativité des candidats. La proportionnelle favorisera donc la diversification, à condition que l'on encourage dans le même temps la formation des militants – ce n'est pas un gros mot ! – et que l'on réfléchisse aux mécanismes d'aide aux partis politiques. Il s'agit non pas de donner plus d'argent aux partis, mais de le répartir autrement. J'ai en tête quelques pistes pour réaliser des économies. Le président Bartolone en a d'ailleurs évoqué une récemment, ce qui lui a valu quelques anicroches avec le président du Sénat.
Se pose notamment la question du nombre de parlementaires : une fois que l'interdiction du cumul des mandats sera appliquée, je ne vois pas très bien à quoi pourront servir 577 députés !

Il y aura en effet une évolution inéluctable avec la fin du cumul des mandats. Mais je me garde de tomber dans un discours populiste : les propositions que j'ai formulées à titre personnel, notamment la diminution du nombre de députés, visent non pas à « économiser sur la démocratie », mais à répartir les moyens différemment, pour que l'Assemblée et les parlementaires soient actifs.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur le président. En France, depuis 1848, nous avons un complexe très fort par rapport à ces questions. Or nous devons assumer que l'exercice d'un mandat électif coûte cher. Les indemnités sont nécessaires, et moins les élus sont payés, plus on a de chances qu'ils soient des ploutocrates – propriétaires terriens, dans l'ancien temps ; détenteurs d'entreprises qu'ils font gérer, aujourd'hui – ou qu'ils fassent carrière.
Si nous voulons avoir des élus forts, nous devons leur donner des moyens pour qu'ils puissent se reconvertir, vivre dignement et faire leur travail de législateur et de contrôle de l'action du Gouvernement dans de très bonnes conditions. De ce point de vue, il faudrait, selon moi, diviser le nombre de parlementaires par deux, mais permettre à chacun d'eux d'embaucher une équipe d'une dizaine de personnes. Une partie du travail pourrait aussi être mutualisée au niveau des groupes politiques. En tout cas, nous devons tenir un discours courageux : il faut expliquer aux Français – qui ne sont pas aussi hostiles à la politique qu'on veut bien le dire – que ces mesures sont nécessaires au bon fonctionnement de la démocratie, à condition de leur adresser, dans le même temps, un certain nombre de signaux positifs. À cet égard, les lois relatives à la transparence de la vie publique ont leur importance, même si elles ne font pas de miracle. Pour les personnes qui souhaitent militer au sein des partis ou pour les sympathisants qui veulent leur apporter une aide ponctuelle, il est bon de savoir que ces partis sont gérés correctement et que leur fonctionnement interne est conforme aux règles démocratiques générales.

Je vous remercie d'autant plus, monsieur Sawicki, que les spécialistes des partis politiques sont relativement peu nombreux. Je l'ai découvert en préparant cette réunion avec M. Winock. De même, les études sur les partis sont moins abondantes qu'on pourrait le souhaiter, alors qu'il s'agit d'un sujet essentiel lorsque l'on réfléchit à la représentativité et à l'avenir des institutions.
Le Groupe de travail en vient à la table ronde sur le thème des élus.

L'un des enjeux essentiels de la réforme de nos institutions est de valoriser le Parlement, ce qui implique de valoriser ses travaux. C'est pourquoi j'ai invité notre collègue Philippe Doucet à se joindre à nous pour un débat sur le statut de l'élu. M. Doucet, membre du groupe socialiste, républicain et citoyen, et M. Philippe Gosselin, membre du groupe UMP, ont remis en juin 2013 un rapport d'information de grande qualité, intitulé « Pour un véritable statut de l'élu ». Je vous prie d'excuser M. Gosselin, qui a été retenu dans sa circonscription.
À la suite de la publication de ce rapport, monsieur Doucet, vous avez repris et amendé une proposition de loi du Sénat visant à favoriser l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat. Vous pourrez nous dire à quel stade en est l'examen de ce texte. Je vous remercie, au nom de notre groupe de travail, de votre présence parmi nous aujourd'hui.

Je vous remercie de votre invitation, monsieur le président. Je suis heureux de vous retrouver, monsieur Winock : j'ai « subi » vos livres lorsque j'étais étudiant, et je suis aujourd'hui avec un grand intérêt la controverse dans laquelle vous êtes engagé avec Zeev Sternhell sur le fascisme français.
Il est souvent question d'ouvrir la classe politique, mais il suffit de consulter les curriculum vitae des députés pour constater que les parcours sont souvent assez uniformes : très peu d'entre eux ne sont pas issus de la fonction publique au sens large ou des professions libérales. Vous faites partie de ce petit nombre de députés, monsieur le président de l'Assemblée nationale. Tel est également mon cas, puisque j'ai travaillé pendant vingt-cinq ans dans des entreprises privées, petites ou grandes, françaises ou internationales. À cet égard, je suis toujours apparu comme « un peu à part », notamment au sein du Parti socialiste. Et je n'ai pu exercer mes fonctions d'élu local en parallèle de mon activité professionnelle que par miracle : j'ai eu la chance d'avoir des patrons qui acceptent de jouer le jeu de la démocratie, tout en n'étant pas de la même sensibilité politique que moi. Cela a tenu non pas à un quelconque statut, mais au hasard des rencontres et à la qualité des relations que j'ai pu nouer avec eux. En outre, lorsqu'il m'est arrivé d'être contacté par des chasseurs de têtes, j'ai pu poser un certain nombre de conditions et faire valoir que j'étais déjà élu. Cependant, mon cas relève davantage de l'exception que de la règle.
Je me suis très vite intéressé à la question du statut de l'élu. Mon objectif est non pas d'élaborer un statut supplémentaire, mais d'ouvrir la classe politique, que je trouve, à bien des égards, beaucoup trop fermée, ce qui n'est pas sans conséquences politiques.
Les élus ne sont pas à l'image de la société, ainsi que le montrent les quelques chiffres suivants. D'abord, beaucoup d'élus sont âgés et, loin de s'améliorer, la situation régresse de ce point de vue : en dix ans, le nombre de maires de moins de quarante ans a été divisé par trois. En 2012, 32,4 % des élus locaux étaient des retraités. D'autre part, les femmes restent éloignées des fonctions exécutives : 14,4 % des maires seulement sont des femmes. Enfin, 15,6 % des maires et 11,1 % des conseillers municipaux sont des exploitants agricoles, alors que ceux-ci ne représentent que 1 % de la population active. À l'inverse, seulement 2 % des maires, 4,8 % des conseillers municipaux, 0,4 % des conseillers généraux et 1,1 % des conseillers régionaux sont des ouvriers, alors que ces derniers comptent pour 13,5 % des actifs. L'image globale est donc la suivante : beaucoup de seniors et peu de jeunes, une féminisation très faible, une représentation de certaines catégories professionnelles inversée par rapport à la réalité de la société française.
Si l'on examine les choses de manière plus détaillée, on se rend compte que les villes moyennes, nombreuses en France, sont gérées en majorité par des seniors : 58 % des maires de communes de 5 000 à 20 000 habitants ont plus de soixante ans. De plus, 50 % de ces mêmes maires sont issus du secteur public. Au total, si l'on exclut les seniors, les fonctionnaires et les professions libérales, il ne reste plus que 2 % de maires « normaux », si je puis dire, c'est-à-dire salariés du privé. Certes, les personnes âgées sont parfois nombreuses dans les villes moyennes, mais peut-on dire que la population soit ainsi représentée dans sa diversité ? Par ailleurs, un maire de plus de soixante-cinq ans n'est sans doute pas le mieux à même de gérer les problèmes de crèches – à moins qu'il ne s'occupe de ses petits-enfants – ou les questions qui se rapportent au monde du travail. Cela peut poser de vraies difficultés.
Il est donc indispensable d'ouvrir la classe politique. Cette analyse transcende d'ailleurs les clivages politiques, ainsi que Philippe Gosselin et moi-même avons pu le constater dans le cadre de notre mission d'information. Nous sommes en effet tous conscients que nous passons à côté de l'objectif en matière de représentativité de la classe politique. Or, si nous voulons préserver le lien entre la classe politique et les citoyens, il faut que les gens aient le sentiment d'être représentés. Il ne s'agit pas nécessairement d'instaurer des quotas, mais il faut tenir compte de l'ensemble des critères : l'âge, le sexe, l'origine, la classe sociale. À cet égard, lorsque l'on débat de la représentation politique, notamment au sein du parti socialiste, on se concentre généralement sur la question de la diversité, mais on oublie souvent – je trouve cela très frappant – celle des classes sociales. Rappelons que les ouvriers et les employés, toutes catégories confondues, constituent tout de même plus de 50 % du corps social en France. Comment cette moitié du corps social peut-elle se sentir représentée aujourd'hui ? Cela fait bien longtemps que nous n'avons pas eu un Pierre Mauroy ou un Pierre Bérégovoy au Gouvernement, serait-ce à des postes symboliques. En 2002, il a fallu que Pierre Mauroy explique à Lionel Jospin que le mot « ouvrier » n'était pas un gros mot ! Celui-ci n'apparaissait nulle part dans le programme du candidat à la présidentielle. On voit ainsi à quoi peut aboutir l'absence de représentation politique.
Nous sommes en train d'avancer sur le statut de l'élu, même si ce terme ne me plaît guère, car il laisse penser que les élus se fabriquent une réglementation en béton pour se protéger. En termes de communication, il sera donc préférable de parler d'ouverture de la classe politique.
Quelles sont les pistes qui ont été évoquées dans notre rapport d'information et reprises dans la proposition de loi ? Pour être élu, il faut d'abord être en mesure de se présenter aux élections. Nous souhaitons que davantage de personnes puissent le faire. Or les salariés qui pointent dans leur entreprise ne jouissent pas du tout de la même liberté pour gérer leur temps que les agents de la fonction publique, en particulier que les enseignants. Nous avons donc étendu le congé électif aux candidats à une élection municipale dans les communes d'au moins 1 000 habitants.
Ensuite, il faut que chacun ait la possibilité d'exercer son mandat. Lorsqu'un enseignant devient maire, il lui suffit d'adresser un courrier à l'administration de l'éducation nationale pour passer à mi-temps. Et, le jour où il cesse d'être maire, il envoie une nouvelle lettre pour demander de retrouver un temps plein. Or les choses sont loin d'être aussi simples pour les salariés dans les entreprises, car la pression sociale n'y est pas du tout la même. Nous avons donc abaissé de 20 000 à 10 000 habitants le seuil à partir duquel les adjoints au maire peuvent bénéficier du droit à la suspension de leur contrat de travail, ainsi que d'un congé de formation professionnelle et d'un bilan de compétence à l'issue de leur mandat.
En outre, nous avons fixé par principe l'indemnité de fonction des maires au taux maximal prévu par loi. Contrairement à ce que l'on peut lire ou entendre dans les médias, nous avons constaté que beaucoup d'élus ne touchaient pas le maximum de leur indemnité. Dans les communes petites ou moyennes, il est parfois difficile au conseil municipal de fixer l'indemnité du maire à ce niveau, compte tenu de la pression sociale. Or, si les retraités peuvent éventuellement se contenter de leur pension et les professions libérales des revenus qu'ils tirent de leur activité, il n'en va pas de même pour les salariés : leur patron compte le nombre d'heures qu'ils consacrent à l'exercice de leur mandat et ampute leur salaire d'autant. Pour eux, l'indemnité constitue donc un complément de rémunération essentiel. S'ils ne peuvent pas la percevoir, il y a là un facteur de fermeture. C'est pourquoi nous avons souhaité que le conseil municipal ne soit plus tenu de voter pour fixer le niveau de l'indemnité du maire.
Toujours dans le but de permettre aux élus d'exercer leur mandat, nous avons étendu le crédit d'heures aux conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. Ce crédit est égal à l'équivalent de 20 % de la durée hebdomadaire légale du travail, ce qui permet aux élus de dégager un jour par semaine pour se consacrer aux affaires de la collectivité locale.
Enfin, si l'on souhaite que davantage de personnes se présentent aux élections, il faut permettre à chacun de préparer son retour à l'emploi à l'issue du mandat. D'une certaine manière, les élus sont en contrat à durée déterminée. Encore une fois, les fonctionnaires sont certains de retrouver leur poste, mais tel n'est pas le cas pour les salariés : en théorie, la loi les protège, mais la pression sociale qui s'exerce au sein de l'entreprise est sans commune mesure avec celle qui peut exister dans la fonction publique, notamment territoriale. Il y a là un frein pour les salariés. Nous avons donc étendu le droit à la suspension du contrat de travail et le droit à la réintégration dans l'entreprise aux adjoints au maire des communes d'au moins 10 000 habitants. Nous clarifions ainsi les éléments de droit relatifs au contrat de travail des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle afin d'exercer leur mandat.
Chaque élection municipale est suivie d'un énorme « plan social », compte tenu du nombre de maires et d'adjoints battus qui ne retrouvent pas d'autres fonctions. Par conséquent, nous avons créé un dispositif obligatoire de « droit individuel à la formation » au bénéfice des élus et leur avons ouvert la possibilité de valider l'expérience acquise dans les mêmes conditions que les salariés. Nous avons aussi allongé de six mois à un an la durée de versement de l'allocation différentielle de fin de mandat, avec un taux dégressif au bout des six premiers mois.
Une commission mixte paritaire devrait se réunir au début du mois de mars pour examiner les dispositions de la proposition de loi restant en discussion. Son résultat devrait être positif, nos collègues sénateurs ayant fini par s'engager dans la discussion de manière constructive. L'ensemble de ces dispositions devrait donc entrer en vigueur le 1er janvier 2016.
Néanmoins, il faut aller plus loin. J'aborde ici une problématique qui ne figure pas dans le rapport de la mission d'information et qui mérite, selon moi, d'être débattue : lorsqu'un salarié accède à des fonctions d'élu local, sauf exception, la chose est plutôt mal vue par son entreprise. Il faut absolument déverrouiller cette situation. Or, compte tenu des logiques de blocage qui demeurent au sein de la société française, nous n'y parviendrons que par la loi, même si, à titre personnel, je n'apprécie guère cette méthode. Peut-être trouverez-vous la comparaison audacieuse, mais nous n'aurions pas avancé en matière de féminisation de la vie politique si nous n'avions pas imposé, par la loi, la parité sur les listes de candidats aux élections municipales et, désormais, sur les listes d'adjoints. Tout le monde a été obligé de se conformer à ces règles. De la même manière, la place des handicapés dans l'entreprise n'aurait pas connu d'amélioration sans un certain nombre de dispositions législatives, même si celles-ci sont parfois contournées et que les résultats sont moins probants en la matière.
Les entreprises reprochent souvent au Parlement et aux collectivités territoriales, notamment aux mairies, de ne pas suffisamment tenir compte de leurs réalités, de ne pas parler la même langue qu'elles. Chaque fois que je rencontre des chefs d'entreprise, je leur demande ce qu'ils font pour lutter contre cette coupure dont ils se plaignent : quel effort seraient-ils prêts à consentir en faveur de la citoyenneté ? Seraient-ils prêts à accepter qu'un plus grand nombre de leurs salariés exercent des fonctions d'élu local ? Seraient-ils disposés à les voir siéger au comité de direction ou au comité d'entreprise ?
Il serait intéressant que les entreprises s'imposent une sorte de « 1 % élu local » pour favoriser la citoyenneté et la représentation politique des salariés. Elles deviendraient ainsi actrices de la société civile et politique. À défaut, combien d'ouvriers exerceront des fonctions d'élu local ? Or, s'il n'y a pas d'ouvriers élus à ce niveau, il n'y en aura pas non plus aux niveaux départemental, régional et national. Chacun de nous a été, mes chers collègues, conseiller municipal, puis conseiller général ou maire, avant d'être élu député. Si nous voulons obtenir une meilleure représentation politique du monde du travail, il faut traiter le problème à la racine. Nous devons entamer un dialogue avec le patronat, qui détient une partie des clés. Mais nous ne nous en sortirons probablement pas, malheureusement, sans un autre texte de loi.
Nous avons tous, y compris les syndicats, notre part de responsabilité dans cette situation. La représentation des différentes classes sociales a été progressivement gommée du paysage politique. Or, ce n'est pas parce que Renault-Billancourt a disparu que la société française ne compte plus d'ouvriers. Que l'on songe au secteur des services ou à celui des PME, qui ont connu un essor important ces dernières années. Si nous avons progressé dans le domaine de la parité, la représentation du salariat, quant à elle, a régressé.

Philippe Doucet a exposé des problématiques qui sont rarement abordées. Je pense notamment à celle de la place des salariés dans la représentation politique, à laquelle je suis particulièrement sensible, étant moi-même issue du secteur privé – je sais, pour l'avoir vécu, ce que signifie avoir un engagement politique de gauche dans une entreprise. Il est vrai qu'en tant que salarié, on manque de disponibilité pour exercer une activité politique, non seulement pour mener campagne mais aussi pour participer à la vie du parti, ne serait-ce que pour assister à des réunions. La première question qui se pose est donc celle du temps dont dispose un salarié pour avoir une activité militante, citoyenne ou associative.
Par ailleurs, la neutralité politique des entreprises n'existe pas. Si elles avaient l'obligation de compter 1 % d'élus locaux dans leur effectif, certaines d'entre elles préféreraient certainement que ces derniers soient d'une certaine couleur politique plutôt que d'une autre. Comment résoudre cette tension, qui, du reste, existe également dans la fonction publique ?
Je souhaiterais également dire un mot de l'allocation de fin de mandat. Plus que toute autre, cette mesure suscite, sans doute à tort, une levée de boucliers, y compris chez ceux de nos concitoyens qui ne sont pas « antisystème », car ils considèrent que les élus bénéficient déjà d'une protection suffisante. Comment leur faire accepter la nécessité de donner des gages à ceux qui prennent le risque de s'engager en politique ?
Enfin, j'en suis convaincue, si l'on veut que la France de 2015 soit représentée dans la vie politique, il faudra instaurer des quotas, mais jusqu'où faut-il aller en la matière ?

On pourrait penser, en nous écoutant discuter de ces sujets, que nous faisons notre tambouille, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Que constate-t-on ? Au cours des vingt dernières années, la proportion des maires de moins de quarante ans a été divisée par dix, passant de 12 % en 1993 à 1,8 % en 2013 ; 32 % des maires sont des retraités. En outre, on accuse les élus nationaux d'être des cumulards, alors que les plus grands cumulards sont les élus locaux.
Je rappelle que les avancées les plus importantes concernant le statut de l'élu ont été obtenues, contre l'avis du Gouvernement, dans le cadre d'une commission mixte paritaire qui a abouti à la loi Vaillant de 2002. Parmi ces avancées figurait notamment l'extension du dispositif du crédit d'heures. Celui-ci est-il encore adapté à la situation actuelle ? Doit-il être rémunéré ? Je m'interroge. Quoi qu'il en soit, il me paraît nécessaire d'affirmer la dimension sociétale de l'entreprise en accordant aux élus locaux, comme le proposent les auteurs du rapport, le statut de salarié protégé dont bénéficient les représentants syndicaux.
Le statut de l'élu doit-il être lié à la fonction exercée ou à la personne ? Le retraité qui préside une association n'est pas rémunéré. Pourquoi le serait-il lorsqu'il est maire ? Si l'on veut rajeunir et diversifier la représentation politique, il faut adapter le statut de l'élu – même si le mot ne me plaît guère – et donner à celles et ceux qui le souhaitent les moyens de s'engager pour les autres. Combien de fois ai-je mis en garde ceux de mes amis salariés du secteur privé qui souhaitaient devenir adjoints au maire en les prévenant qu'ils prenaient un risque sur le plan professionnel !
Par ailleurs, j'ai rencontré, hier, des écoliers qui participent au Parlement des enfants. Tous nous croient milliardaires, et ils ont été étonnés d'apprendre que notre indemnité était équivalente à la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus haut des fonctionnaires.

À ce propos, je précise que l'indice de traitement de la fonction publique sur lequel nos indemnités sont indexées n'augmente plus depuis dix ans, cette stagnation étant compensée, pour les fonctionnaires, par une augmentation des primes, qui ne sont pas prises en compte dans le calcul des retraites.

Quoi qu'il en soit, à ceux qui considèrent que nous gagnons trop d'argent, je propose que l'on ne nous rémunère plus, et ils verront les élus qu'ils auront ! Il faut tout de même se rappeler les raisons pour lesquelles, lors de la Révolution, il a été décidé d'indemniser les députés.

Le compte rendu des débats de la période révolutionnaire est en effet très intéressant à cet égard ; il témoigne des pressions exercées par la noblesse pour interdire toute indemnité parlementaire.

Quant à l'allocation de fin de mandat, non seulement elle est, dans l'ensemble, moins favorable que le régime d'assurance chômage, mais elle est très peu utilisée : une demi-douzaine de personnes, je crois, en ont demandé le bénéfice en 2012.

J'ajoute que les éventuels revenus perçus par l'ancien parlementaire sont défalqués de cette allocation.

Pour conclure, à tous ceux qui considèrent que nous sommes privilégiés, je dis : « Présentez-vous, exercez un mandat, et nous en reparlerons ! »

Tout d'abord, je souhaiterais rappeler que l'on compte, parmi les élus locaux, 500 000 bénévoles, qui contribuent à l'enracinement de la République dans les territoires et à l'exercice de la citoyenneté. Il est néanmoins nécessaire d'offrir à ces élus qui s'engagent pour les autres un statut qui les préserve de la précarité, sans pour autant en faire des fonctionnaires. Ainsi, il n'y a rien de choquant à ce qu'après un mandat, ils puissent bénéficier d'un dispositif qui leur permette de se réorienter vers la vie professionnelle.
Par ailleurs, il me semble que les fonctionnaires, dès lors qu'ils sont élus, devraient être automatiquement mis en disponibilité, de sorte qu'ils ne progressent pas dans leur carrière pendant l'exercice de leur mandat.
Enfin, pour favoriser le renouvellement des élus, il faudrait envisager la limitation du cumul des mandats locaux. Il est vrai que celui-ci s'explique en partie par l'insuffisance des indemnités perçues par les élus d'un certain nombre de petites communes et qu'il est déjà interdit de cumuler la présidence d'un conseil général ou d'un conseil régional avec une autre fonction exécutive, mais il faut aller plus loin. Pourquoi ne pas interdire également le cumul dans le temps ? Plus les élus seront nombreux, plus les citoyens participeront à la vie politique, mieux ce sera.

La loi sur la parité a changé la représentation que l'on avait de la place de la femme dans la société. La législation peut donc modifier les mentalités. À l'époque où la représentation des classes populaires était une question politique, on s'est efforcé de trouver les moyens de favoriser l'accès au pouvoir de personnes issues de la classe ouvrière. C'est ainsi que les organisations syndicales et le Parti communiste ont créé le système des permanents, qui permettait à ces hommes et à ces femmes de disposer de temps, notamment pour se former. La question des moyens est donc importante. C'est pourquoi je me félicite qu'une réflexion ait été menée sur le statut – ce mot ne me gêne pas – des élus.
S'agissant des indemnités, j'entends bien ce que dit Arnaud Richard, mais l'on peut comprendre que les gens s'étonnent de l'écart qui existe entre le montant de l'indemnité d'un député et ce qu'est le salaire moyen aujourd'hui en France. L'attitude de nos concitoyens n'est d'ailleurs pas exempte de contradictions. Certains, c'est vrai, estiment que l'on s'en met plein les poches – c'est l'attitude la plus commune aujourd'hui –, mais lorsque j'explique à des lycéens que les élus du parti communiste reversent leurs indemnités à celui-ci, je vois bien un peu d'étonnement dans leur regard : ils ne comprennent pas que je ne profite pas des moyens qu'offre la représentation politique. En tout état de cause, l'indemnisation des élus ne peut être comprise par nos concitoyens que si la fonction politique n'est pas, comme ils le croient aujourd'hui, notamment les jeunes, une profession ou une carrière. C'est pourquoi il me paraît indispensable d'instaurer une limitation du cumul des mandats dans le temps.
Enfin, la validation des acquis de l'expérience concerne également les élus issus de la fonction publique. J'ai en tête l'exemple d'un infirmier de l'AP-HP qui a exercé trois mandats de maire ou d'adjoint au maire. Doit-il reprendre son poste d'origine, ou peut-on estimer que, compte tenu des compétences qu'il a acquises durant ses mandats, il peut exercer d'autres tâches, dans son intérêt et dans celui de son administration ? Du reste, la question se pose également pour les personnes bénévoles dans des associations, même si des progrès ont été accomplis dans ce secteur. C'est un point important. Le fait que l'engagement pour les autres, qu'il soit politique ou associatif, soit reconnu, notamment au plan professionnel, peut être une motivation.
Le mot « statut » ne me choque pas. Aujourd'hui, le statut est assimilé à des privilèges, alors qu'il s'agit d'un ensemble de règles qui prémunissent son titulaire contre toute mesure discriminatoire ou qui, au contraire, l'empêchent précisément de bénéficier de privilèges. Pour ma part, j'apprécie d'autant plus que nous abordions la question de la représentation politique de la diversité sociologique française que je suis de ceux qui pensent que la démocratie sociale participe de la démocratie en général et, par conséquent, que ce qui se fait dans le domaine social ne doit pas être opposé à ce qui se fait dans le domaine politique.
Si l'on veut favoriser réellement une plus grande diversité socioprofessionnelle de la représentation politique, il faut s'intéresser notamment à l'aspect matériel des choses. De fait, certaines catégories ont moins de difficultés que d'autres à se dégager des contraintes financières, par exemple. Un salarié n'a pas d'autres revenus que ceux qu'ils tirent de son emploi ; s'il doit abandonner celui-ci pour exercer une autre activité, il n'a plus de ressources. La solution suppose donc forcément une implication des entreprises. Au-delà de l'aspect financier, par quels moyens peuvent-elles permettre aux salariés d'avoir une plus grande liberté de s'engager ? Au plan syndical – et je crois que c'est également vrai au plan politique –, j'observe que les salariés s'engageraient plus volontiers s'ils étaient assurés de pouvoir le faire pour un temps limité. Or, pour des raisons juridiques notamment, cette fluidité n'est pas possible aujourd'hui.
On a évoqué les mandats syndicaux ; dans ce domaine, les progrès sont très lents. Ainsi, la reconnaissance d'engagements syndicaux autres que les mandats figurant dans le code du travail au sein d'un syndicat départemental ou d'une confédération, par exemple – dépend en grande partie du bon vouloir des employeurs. C'est pourquoi il me semble important de ne pas se limiter à la question des élus et de réfléchir également aux conditions dans lesquelles les salariés peuvent avoir une activité politique, notamment au sein d'un parti. Au plan social, je dois dire qu'il existe, à cet égard, beaucoup de situations illégales. Une entreprise qui accepte qu'un de ses salariés exerce un mandat syndical au sein d'une confédération peut en effet être accusée de lui fournir un emploi fictif. Certains de mes anciens collègues exerçant de très hautes responsabilités confédérales avaient publiquement reconnu s'être trouvés dans une telle situation.
En ce qui concerne la validation des acquis de l'expérience, il faudrait pouvoir établir des critères d'évaluation incontestables. Dans ce domaine, on a progressé, mais dans quelques régions seulement, où des programmes de formation ont été mis au point avec des universités pour que les permanents puissent disposer d'un bagage universitaire reconnu et opposable à tout employeur. Un dispositif similaire pourrait être envisagé pour les élus politiques.
En tout état de cause, si l'on parvient à élaborer un dispositif qui responsabilise collectivement les employeurs dans le domaine de la citoyenneté, il faudra veiller à ce qu'il s'applique à l'ensemble des entreprises. Je le précise, car, au motif qu'il faudrait distinguer le cas des entreprises de moins de onze salariés de celui des entreprises de plus de cinquante salariés par exemple, nous ne parvenons toujours pas à faire respecter concrètement l'article 8 du Préambule de la Constitution, selon lequel « tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. »
Enfin, la méthode « Clerc » – du nom du militant de la CGT qui est parvenu à la faire reconnaître par les tribunaux – permet d'éviter que ses engagements syndicaux ne nuisent à l'évolution salariale d'un militant ou, au contraire, ne lui permettent d'augmenter plus vite ses revenus. Elle consiste à comparer l'évolution salariale d'un représentant syndical à celle de ses collègues à qualification et ancienneté égales. Dès lors que l'engagement politique serait reconnu par les entreprises, on pourrait, là aussi, étendre ce dispositif aux élus politiques.

Je rappelle que, depuis la loi de 2013 sur la transparence de la vie publique, les fonctionnaires élus au Parlement sont placés en position de disponibilité, et non plus de détachement. En ce qui concerne la limitation du cumul des mandats dans le temps, je précise qu'en 2010, la durée moyenne d'un mandat de député était de sept ans et demi et celle d'un mandat de sénateur de dix ans.
Par ailleurs, bon nombre de salariés du secteur privé préfèrent ne pas évoquer leur engagement politique. Et pour cause : je me souviens que le lendemain du jour où le chef de l'entreprise dont j'étais un des cadres a vu mon visage sur une affiche électorale, il m'a convoqué dans son bureau et m'a demandé soit de démissionner de l'entreprise, moyennant un dédommagement, soit de mettre fin à mon engagement politique. Je ne suis pas certain que ce type de situation ne se produise pas encore de nos jours…
Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on ne propose plus de dédommagement !

J'ajoute que je travaillais dans l'industrie pharmaceutique et que, lors de mon premier mandat, chaque fois que j'intervenais dans un débat sur ce secteur, j'avais le sentiment de couper une de mes cordes de rappel.
La question du cumul des mandats et des indemnités des élus ne doit pas être séparée de celle des organisations politiques. Je sais, pour avoir affronté l'administration lorsque j'étais ministre, quel peut être son pouvoir face à des responsables politiques qui ne restent jamais très longtemps en fonction. Si nous n'affirmons pas la prééminence du politique, non seulement il sera difficile d'expliquer à nos concitoyens qu'il faut indemniser des élus sans pouvoir, mais la démocratie sera affaiblie. Ainsi une limitation du cumul des mandats dans le temps, qui accélérerait la rotation des élus, ne peut se concevoir sans un affermissement du rôle des partis politiques. Sinon, le pouvoir sera exercé par d'autres institutions : l'administration, les médias ou la justice. Ne perdons pas de vue l'objet de notre groupe de travail : examiner la question du statut de l'élu sans l'inscrire dans une réflexion d'ensemble sur le fonctionnement de nos institutions serait une grave erreur.

Un point m'a particulièrement frappé lorsque nous avons auditionné les différentes associations d'élus dans le cadre de notre mission d'information. On sait qu'en Allemagne les élus sont quasiment assimilés à des fonctionnaires, alors qu'en France ils se mettent au service du bien public en exerçant leurs fonctions à titre gratuit – c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils perçoivent une indemnité et non un salaire. Eh bien, j'ai été étonné de constater combien cette logique héritée de la Révolution est prégnante dans notre pays. En effet, aucune association d'élus ne réclame un statut similaire à celui qui prévaut en Allemagne. On veut garder la beauté du geste amateur ! Ce principe a plusieurs conséquences.
Tout d'abord, il est difficile de parler d'argent. Arnaud Richard et Marie-George Buffet l'ont dit, nos concitoyens pensent que nous sommes bien rémunérés. Peut-être faudrait-il d'ailleurs, monsieur le président de l'Assemblée nationale, publier un tableau comparant les rémunérations respectives des cadres de la fonction publique, de ceux du secteur privé et des élus. Lorsque je me suis présenté aux élections législatives, j'étais cadre supérieur dans un grand groupe français de défense ; aucun de mes collègues n'a compris mon choix, notamment parce que mon salaire allait être divisé par deux. Aujourd'hui, mieux vaut être footballeur que député : on ne se fait pas cracher dessus, on est bien payé et on peut même, comme Franck Ribéry, avoir sa statue dans son village ! Quoi qu'il en soit, nous avons intérêt à privilégier la transparence. Même si l'on peut regretter cette suspicion généralisée, chacun doit savoir combien coûte un élu, quel prix il est prêt à payer pour la démocratie.
Cette question est du reste liée à celle du cumul des mandats. Celui-ci s'inscrit, certes, dans une logique institutionnelle – s'il veut financer sa voirie, le maire d'une petite commune doit être conseiller général –, mais il permet aussi à l'élu local qui n'est pas fonctionnaire de passer en quelque sorte d'un CDD à un CDI : s'il perd un mandat, il lui reste un autre. C'est pourquoi si l'on veut limiter le cumul, il faut également réfléchir à la fin du mandat.
Par ailleurs, la représentation des différentes classes sociales a beaucoup pâti de la perte d'influence du parti communiste, dont l'école des cadres formait les militants politiques de la classe ouvrière. Sous cet aspect, il n'a pas été remplacé, et c'est une immense erreur du parti socialiste d'avoir oublié les classes populaires et pensé que l'ENA était la seule école de formation de ses cadres dirigeants. On assiste, de ce fait, à une coupure entre les élites et les classes populaires, l'entre-soi de l'énarchie ayant remplacé la représentation politique la plus large. Quant au Front de gauche, j'observe que ses candidats aux élections cantonales sont tous issus de la fonction publique territoriale. Dès lors, comment peut-il représenter la classe ouvrière ? Un parti d'insiders ne peut pas représenter les outsiders. C'est donc aux forces politiques de se fixer des objectifs en termes de représentation des différentes classes sociales, y compris dans leurs rangs militants. Or, au parti socialiste, par exemple, la question ne se pose même pas.
En ce qui concerne l'allocation de fin de mandat, je crois qu'il faut assumer une telle mesure. C'est pourquoi nous l'avons inscrite dans la proposition de loi visant à faciliter l'exercice de leur mandat par les élus locaux.
S'agissant de la situation des élus issus du secteur privé, je constate qu'aujourd'hui, la compétitivité et l'exigence de cohérence interne sont telles que le système de production accepte de moins en moins l'existence de « moutons noirs ». Néanmoins, la solution pourrait consister à négocier des accords de démocratie politique sur le modèle des accords de démocratie sociale. De fait, la situation des élus dans l'entreprise est encore pire que celle des représentants syndicaux. Or, au bout du compte, non seulement la démocratie est perdante, mais les patrons le sont aussi. Par exemple, combien de chefs d'entreprise ou de cadres ce groupe de travail compte-t-il parmi ses membres ? Par ailleurs, notre classe politique est très peu internationalisée, elle est encore très franco-française. À l'heure de la mondialisation, c'est une erreur fondamentale.
Notre proposition de loi est modeste ; elle comporte des mesures concrètes. Si l'on veut résoudre le problème de la représentation, il faut conclure des accords de démocratie politique. Invitons le MEDEF à discuter d'un système de quotas, car c'est la seule solution possible. La défiance de la société vis-à-vis des élus est grande. Les médias et la justice jouent un rôle de plus en plus important, de sorte que les petits arrangements auxquels on avait recours auparavant ne sont plus possibles aujourd'hui. Il est donc temps d'agir pour sortir de cette situation par le haut !
Pour comprendre la carence du parti socialiste dans le domaine de la représentation ouvrière, souvenons-nous qu'à sa création, en 1905, il était séparé du syndicalisme, à la différence des partis sociaux-démocrates scandinaves et allemand ou du parti travailliste anglais. Le Parti communiste, créé en 1920, a, quant à lui, entretenu d'emblée des liens très étroits avec la GGTU, puis la CGT. Je rappelle ces points d'histoire pour souligner combien il peut être difficile d'aller contre une tradition très ancienne.
Enfin, il est un événement historique emblématique de la question si importante du statut de l'élu : la grève de Carmaux de 1892. Cette grève, l'une des plus fameuses de l'histoire du mouvement ouvrier, a en effet été déclenchée parce qu'un mineur avait été licencié par la direction des mines après avoir été élu maire de Carmaux…

On a évoqué le Parti socialiste et le Parti communiste, mais l'organisation à laquelle appartient Arnaud Richard est également concernée par ces réflexions.
La réunion se termine à treize heures dix.