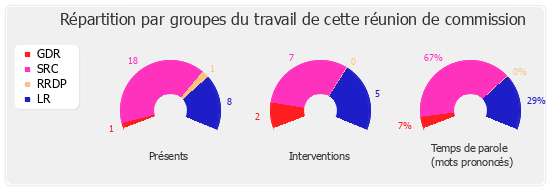Commission des affaires étrangères
Réunion du 16 février 2016 à 16h30
La réunion
Audition de Son Exc. M. Bertrand Besancenot, ambassadeur de France en Arabie Saoudite
La séance est ouverte à seize heures trente.

Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur, d'avoir accepté notre invitation à cette audition, qui est fermée à la presse.
Les questions que mes collègues et moi-même souhaitons vous adresser concernent trois grands domaines.
Premièrement, comment la situation intérieure évolue-t-elle en Arabie saoudite ? Dans la presse, on peut lire beaucoup de commentaires sur les choix opérés par le nouveau roi, qui a quelque peu bousculé les habitudes dynastiques, et sur le rôle joué par l'un de ses plus jeunes fils, le vice-prince héritier Mohammed ben Salman. La presse spécule notamment sur les relations de ce dernier avec le prince héritier, Mohammed ben Nayef. Qu'en est-il de ces jeux internes ? Quelle appréciation portez-vous sur la solidité du régime ? D'autre part, que pouvez-vous nous dire de la situation économique, après la chute spectaculaire du prix du pétrole ? Où en sont les réformes que le vice-prince héritier a l'intention d'engager ? Quid des évolutions sociétales ?
Deuxièmement, quelle analyse faites-vous de notre relation bilatérale avec l'Arabie saoudite ? Les visites ont été nombreuses et intenses dans les deux sens, au niveau ministériel et au plus haut niveau. Un certain nombre de contrats très importants ont été signés, notamment en matière de vente d'armes, ce qui est, selon moi, une bonne nouvelle pour notre industrie de défense. Comment la France se situe-t-elle par rapport aux autres partenaires occidentaux de l'Arabie saoudite ? On sait que Riyad entretient depuis longtemps une relation privilégiée avec les États-Unis. Qu'en est-il avec le Royaume-Uni ?
Troisièmement, nous avons l'impression que la politique étrangère de l'Arabie saoudite est beaucoup plus active qu'auparavant. Au Yémen, les conséquences de l'intervention militaire saoudienne ne sont guère positives pour l'instant – c'est le moins que l'on puisse dire : graves problèmes humanitaires ; coût important pour l'Arabie saoudite elle-même. Ce dossier est une préoccupation croissante pour nous. Avec l'Iran, si la rivalité ne date pas d'hier, les relations se sont nettement détériorées. En Syrie, on s'interroge sur l'attitude saoudienne. Lors de la conférence sur la sécurité de Munich, à laquelle j'ai participé, nous avons entendu des déclarations très inquiétantes : l'Arabie saoudite et la Turquie seraient disposées à intervenir au sol, ce qui n'a pas manqué de faire réagir l'Iran.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les députés, je vous remercie de votre invitation et de votre présence à cette audition. Avec votre permission, j'exposerai dans les grandes lignes ma vision des trois domaines que vous avez évoqués, afin de laisser la place aux questions.
Je commence par la situation intérieure. À la différence de son prédécesseur Abdallah, qui avait des préoccupations plus sociales, s'agissant notamment du rôle des femmes, le roi Salman est avant tout un manager et un homme d'autorité. Il a montré sa capacité à gérer la capitale, Riyad, dont il a été le gouverneur pendant près de cinquante ans. Il a eu une approche très « capétienne » : il a transformé une ville qui comptait 300 000 habitants en une capitale qui en rassemble désormais 6 millions et y a concentré les pouvoirs non seulement politiques et administratifs, mais aussi économiques. Il y a trente ans, 80 % des sièges d'entreprises se trouvaient à Djedda ; aujourd'hui, 80 % d'entre eux sont à Riyad.
Le roi Salman a également montré sa capacité à centraliser le pouvoir dans la façon dont il a structuré son gouvernement. Le roi Abdallah et ses prédécesseurs s'arrangeaient pour maintenir un certain équilibre entre les différents clans de la famille al-Saoud. Le roi Salman a une approche différente : tous les ministres sont des techniciens, souvent d'anciens hommes d'affaires. Il n'y a donc plus de membres de la famille royale au sein du gouvernement, hormis ce que nous appelons parfois la « Sainte Trinité », formée par le roi et les deux « super-ministres » que sont le prince héritier Mohammed ben Nayef et le vice-prince héritier Mohammed ben Salman, fils du roi. Le premier est responsable du pôle « sécurité », le second du pôle « développement », qui correspondent aux deux priorités du gouvernement. Ils président chacun, avant le conseil des ministres, une réunion hebdomadaire au cours de laquelle sont évoqués les projets des ministères techniques et où ils essaient de rationaliser l'action gouvernementale.
On entend beaucoup parler d'une compétition, voire d'un conflit entre les « deux Mohammed » au plus haut niveau de l'État. De mon point de vue, la réalité est un peu différente. Le prince héritier Mohammed ben Nayef a acquis une véritable légitimité au sein de la famille régnante, car il a été un bon gestionnaire au ministère de l'intérieur, où il a fait l'essentiel de sa carrière : il est considéré comme celui qui a réussi à rétablir la situation sécuritaire dans le pays après les attentats des années 2003 et 2004, ce qui permet le développement économique actuel. En tant que « monsieur sécurité », il tient tout le dispositif de sécurité du pays : les services de renseignement et le ministère de l'intérieur proprement dit dépendent directement de lui. Rappelons que, en Arabie saoudite, nous avons affaire non pas à une monarchie absolue, mais à une monarchie familiale : le roi est un primus inter pares qui doit veiller à recueillir l'assentiment de la majeure partie de sa famille. Mohammed ben Nayef a sans nul doute réussi à le faire.
Le prince Mohammed ben Salman sait très bien qu'il n'a pas, à la différence du précédent, de légitimité personnelle au sein de la famille régnante. Mais il a d'autres atouts : il jouit de la confiance totale de son père le roi, qui lui laisse carte blanche sur quelques dossiers importants, à savoir la politique étrangère, la politique de défense et les questions économiques – ce qui fait beaucoup pour un homme âgé d'une trentaine d'années seulement. Muni de cette confiance, il essaie de se créer une légitimité propre. Il le fait en jouant un certain nombre de cartes : en tant que ministre de la défense, il est l'homme du dossier yéménite ; en matière de politique étrangère, il a pris un certain nombre d'initiatives visant à convaincre les Russes de se dissocier de l'Iran, se distinguant un peu en cela de la politique pro-américaine traditionnelle de son pays ; il coopère aussi très activement avec la France sur un certain nombre de dossiers. Bénéficiant de la confiance de son père, il est considéré comme l'étoile montante, voire comme le nouvel homme fort du régime. Cependant, il sait qu'il dispose d'un temps peut-être limité pour construire sa légitimité personnelle.
Certes, comme dans tout premier cercle, il y a une forme de compétition entre Mohammed ben Nayef et Mohammed ben Salman. Si le roi Salman décédait, le premier deviendrait automatiquement roi et se passerait probablement des services du second. Tout dépendra de la façon dont Mohammed ben Salman aura assuré sa propre légitimité à un horizon de trois à cinq ans : l'opération au Yémen pourra-t-elle être considérée comme un succès ? La réforme économique aura-t-elle réussi ? L'Arabie saoudite sera-t-elle parvenue à dissocier Russes et Iraniens sur le dossier syrien ? Tels sont probablement les critères selon lesquels le vice-prince héritier sera jugé.
Contrairement à ce qui se passe en Égypte ou en Tunisie, le régime saoudien n'a pas de problème de légitimité politique. En revanche, le pays présente deux faiblesses sérieuses : il est excessivement dépendant à l'égard du pétrole, et il n'existe pas de véritable culture du travail au sein de la population. En réalité, 80 % des Saoudiens travaillent dans l'administration. Ils bénéficient d'un niveau de vie très correct et sont assez contents de leur sort. L'État providence est très développé. On oublie souvent que l'Arabie saoudite n'est riche que depuis quarante ans, c'est-à-dire depuis le premier choc pétrolier de 1973. Alors que son père était illettré et vivait dans le désert, le Saoudien moyen de quarante ou cinquante ans habite une maison de 400 mètres carrés, possède deux voitures, emploie deux domestiques et a des enfants qui vont à l'université. C'est l'une des principales explications au fait qu'il n'y a pas eu de printemps arabe dans le pays.
Néanmoins, le gouvernement a dû tenir compte de la nouvelle donne économique. Les hydrocarbures représentant 45 % du PIB et, surtout, 90 % des recettes de l'État, la baisse des cours du brut a eu un impact considérable sur la gestion des finances et de l'économie : en 2015, le déficit budgétaire a atteint près de 100 milliards d'euros, qui ont été ponctionnés sur les importantes réserves financières du pays – celles-ci sont donc passées, grosso modo, de 735 à 635 milliards. La baisse du prix du pétrole a accéléré les réformes qui étaient déjà à l'étude dans les ministères. Le prince Mohammed ben Salman a pris une première série de mesures pour limiter la casse, notamment en revenant partiellement sur les subventions sur le prix de l'essence, de l'eau et de l'électricité. En outre, il envisage des privatisations, notamment de certains actifs de la Saudi Arabian Oil Company (ARAMCO).
Il y a, dans l'esprit de la nouvelle équipe, en particulier de Mohammed ben Salman, une volonté de normaliser la gestion du pays, c'est-à-dire de sortir du schéma habituel, de mettre fin aux nombreux gaspillages occasionnés par les subventions et de réduire la dépendance à l'égard du pétrole en accélérant le processus de diversification de l'économie, afin de donner des emplois aux jeunes. Il pense naturellement à l'exploitation des importantes réserves de minerai qui existent dans le nord du pays et au développement du tourisme. À cet égard, avec 1 800 kilomètres de côtes sur la mer Rouge, l'Arabie saoudite ne manque pas de sites susceptibles de devenir autant de Charm-el-Cheikh. Cependant, compte tenu des contraintes en vigueur – ségrégation entre les hommes et les femmes, interdiction de l'alcool –, il apparaît a priori plus difficile d'y attirer des touristes qu'à Charm-el-Cheikh. Mohammed ben Salman est très conscient de la situation : il a bien compris que, dans ce pays soumis à une rigueur extrême, les distractions sont l'une des premières revendications de la population, dont les deux tiers ont moins de trente ans. Ses équipes travaillent actuellement sur un certain nombre de mesures. À ma connaissance, l'une d'entre elles est de créer des zones franches sur les îles de la mer Rouge afin d'y développer le tourisme sportif.
S'agissant du pétrole, l'approche des Saoudiens est assez claire. Dans les années 1990, lorsque le prix du brut avait baissé, les Américains leur avaient demandé de couper leur production pour permettre une remontée des cours. C'est ce qu'ils avaient fait, mais les cours n'étaient pas remontés et ils avaient perdu des parts de marché. Ils ont retenu la leçon : cette fois-ci, lorsque les Américains leur ont à nouveau demandé de baisser leur production, ils ont répondu qu'ils le feraient de façon proportionnelle et équitable si tous les grands producteurs se mettaient d'accord pour faire de même, y compris ceux qui ne font pas partie de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), notamment les États-Unis et la Russie. Ils font valoir qu'il est totalement antiéconomique de demander à ceux qui extraient le pétrole à 5 dollars le baril de réduire leur production tout en laissant faire ceux dont le coût d'extraction est de 60 dollars le baril, tels les petits producteurs de pétrole de schiste aux États-Unis.
Donc, a priori, à moins d'un accord avec les autres grands producteurs de l'OPEP et hors OPEP sur une réduction proportionnelle de la production, l'intention des Saoudiens est de poursuivre leur politique actuelle, à savoir défendre leurs parts de marché – ils les ont effectivement accrues en Asie – afin d'être en bonne position le jour où les cours du brut remonteront. Selon leurs prévisions, ceux-ci devraient revenir à environ 55 dollars le baril en 2017 et continuer à augmenter par la suite. Leur calcul est assez simple : pour le moment, ils sont obligés de faire attention, mais ils ont l'habitude des sinusoïdes et ont déjà connu des périodes analogues, notamment dans les années 1990 ; ils espèrent qu'ils seront capables de passer l'étape en cours, l'état de leurs finances leur permettant de tenir cinq à six ans, ce qui n'est pas le cas pour d'autres pays, notamment l'Iran et la Russie.
La France a en effet aujourd'hui une relation de confiance avec l'Arabie saoudite, qui repose sur une certaine convergence de vues sur les dossiers régionaux, qu'il s'agisse des questions de non-prolifération, notamment à l'égard de l'Iran, ou de l'analyse de la situation en Syrie.
Très déçues par l'attitude de l'administration Obama, les autorités saoudiennes cherchent à diversifier leurs partenariats. Il faut rappeler que l'Arabie saoudite a passé plus de soixante ans sous un statut de quasi-protectorat des États-Unis. Or les choses ont beaucoup évolué depuis l'invasion américaine de l'Irak en 2003, qui a totalement bouleversé les équilibres régionaux au profit de l'Iran et a porté un coup dur à la position traditionnelle de l'Arabie saoudite comme leader des sunnites dans la région. Au moment des printemps arabes, le président Obama a fait partie de ceux qui ont plutôt accéléré le départ du président Moubarak, ce qui a été mal perçu à Riyad. Au début des événements en Syrie, les Saoudiens, qui s'attendaient à une intervention directe des États-Unis, ont très mal pris que le président Obama se défile. En outre, ils ont constaté que les Américains avaient soutenu pendant longtemps deux de leurs adversaires, les Frères musulmans en Égypte et le premier ministre al-Maliki en Irak. Et, cerise sur le gâteau, le président Obama a beaucoup poussé pour obtenir la signature de l'accord nucléaire avec l'Iran, avec l'idée de parvenir un jour un rééquilibrage des relations dans la région. Dès lors, on entend souvent la phrase suivante à Riyad : « Avec de tels amis, qui a besoin d'ennemis ? » La déception des Saoudiens est d'autant plus grande qu'ils étaient habitués à bénéficier de la protection de l'unique superpuissance. Désormais, même si les États-Unis restent un protecteur et un allié stratégique, ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent plus du tout compter, comme par le passé, sur une sorte d'engagement automatique de leur part.
La diversification des partenariats se fait à différents niveaux. Les Saoudiens cherchent à renforcer le Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCEAG). De ce point de vue, on peut considérer que, d'une certaine façon, le Qatar est rentré dans le rang. D'autre part, ils soutiennent le régime du président al-Sissi, l'Égypte offrant la profondeur stratégique – densité humaine et puissance militaire – dont la péninsule arabique a besoin pour faire contrepoids à l'Iran. L'objectif de Riyad est donc à la fois de réorganiser le CCEAG et de l'adosser à l'Égypte. À cela s'ajoute la création de la coalition islamique – en réalité, sunnite – contre le terrorisme, qui vise non seulement Daech, mais aussi, implicitement, l'Iran, qui en est exclu. Enfin, Riyad a développé un partenariat privilégié avec quelques pays, dont la France.
À cet égard, je suis surpris par certains commentaires selon lesquels les Saoudiens promettraient beaucoup, mais « délivreraient » peu dans le cadre de la relation bilatérale. On peut répondre à cela que le montant cumulé des contrats signés entre la France et l'Arabie saoudite depuis quatre ans s'établit à un peu plus de 25 milliards d'euros, dont 7 milliards pour les contrats militaires et 18 milliards pour les contrats civils.
La politique étrangère saoudienne est, c'est vrai, plus active. Elle était traditionnellement discrète : Riyad s'abritait derrière les États-Unis et pratiquait la politique du chéquier. Aujourd'hui, les Saoudiens estiment que l'administration Obama ne les soutient pas autant qu'elle le devrait, alors que les Iraniens ont, de leur point de vue, le soutien de leur ami russe. Certes, ils espèrent toujours un partenariat fort avec Washington et un prochain président américain correspondant mieux au schéma traditionnel, mais ils savent que rien n'est garanti, car ils ont eu des surprises : ils ont souffert du temps de George W. Bush et ont été très déçus par Barack Obama, dont ils attendaient beaucoup. Chat échaudé craint l'eau froide. Et si c'est Donald Trump qui est élu, ils ont certaines raisons de s'inquiéter.
Jusqu'à récemment, le Yémen n'avait jamais été une priorité pour les Saoudiens. Selon eux, le pays comptait certes une population importante, mais il ne faisait pas vraiment partie du système des pays du Golfe. Il avait notamment pris des positions différentes de celles de ses voisins lors de la crise irakienne. Néanmoins, les Saoudiens ont toujours soutenu l'autorité en place : pendant des années, ils ont fait le nécessaire pour que le président Ali Abdallah Saleh garde la tête hors de l'eau. Cependant, de leur point de vue, le jongleur a perdu la main lors du printemps arabe au Yémen. Ils espéraient que l'on trouverait un nouveau jongleur en la personne du président Hadi, mais celui-ci n'a pas montré une autorité très forte. En mars 2015, ils se sont sentis obligés d'intervenir pour ne pas perdre la face, d'une part, parce que les houthistes avaient violé à plusieurs reprises les différents accords signés sous l'égide de l'envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies, à l'époque M. Benomar, et, d'autre part, parce que l'opinion saoudienne s'étonnait que le nouveau roi, censé être un homme d'autorité, puisse laisser une partie de la péninsule arabique passer sous influence iranienne.
Formés par les Américains, les Saoudiens étaient persuadés que leur aviation ferait des miracles et qu'ils n'auraient pas à engager de moyens supplémentaires. Toutefois, la situation ne s'est pas présentée sous ce jour-là. Certes, ils ont progressé sur le terrain du point de vue militaire : ils sont à la veille de prendre Ta'izz, et Sanaa est encerclée. Cependant, ils savent très bien qu'ils n'ont pas intérêt à intervenir au sol, car le Yémen risquerait alors de devenir un deuxième Afghanistan. Sous la pression des Occidentaux notamment, ils ont accepté de participer aux négociations menées à Bienne, en Suisse, qui n'ont malheureusement pas donné grand-chose à ce stade. Actuellement, ils maintiennent la pression militaire, mais ils se rendent bien compte que la dégradation de la situation humanitaire suscite des réactions au sein des opinions publiques, qui exercent une certaine pression sur eux. D'autre part, ils savent que la véritable capacité militaire de la rébellion est davantage dans les mains de l'ancien président Ali Abdallah Saleh que dans celles des houthistes. Leur politique consiste à voir si une solution politique se profile, tout en traitant en coulisses avec Ali Abdallah Saleh pour voir à quelles conditions il serait prêt à quitter le pays. Ils partent du principe que, dans une société tribale telle que celle du Yémen, tout le monde se ralliera à la nouvelle autorité une fois que le chef aura disparu. On ignore quelle peut être l'échéance de ces tractations.
L'Iran est naturellement le premier sujet de préoccupation des Saoudiens. D'après leur analyse, depuis l'invasion de l'Irak, les autorités de Téhéran sont persuadées qu'elles ont réussi à acquérir une nouvelle influence au Moyen-Orient et ont l'intention de poursuivre dans cette voie afin d'établir – c'est l'expression même des Saoudiens – leur hégémonie sur la région. C'est évidemment inacceptable pour Riyad, qui cherche à faire refluer l'influence iranienne. C'est essentiellement à travers ce prisme qu'ils perçoivent le dossier syrien. Les Saoudiens sont conscients de leurs propres faiblesses, mais ils connaissent aussi celles des Iraniens : ils sont convaincus que, avec le temps, Téhéran n'aura pas d'autre choix que le compromis. Or le temps n'a pas la même valeur au Moyen-Orient et en Occident…
Les Saoudiens pensent aussi que, à un certain stade, on pourra dissocier les Russes des Iraniens sur le dossier syrien, car Moscou intervient certes pour défendre ses intérêts dans la région, mais aussi pour des raisons extérieures : compétition avec les États-Unis et volonté de se venger de l'humiliation subie en 1991, notamment. D'où la visite du prince Mohammed ben Salman à Moscou, où il a dit aux Russes que, s'ils étaient coopératifs sur le dossier syrien et disposés à faire refluer l'influence iranienne, les Saoudiens seraient prêts à investir dans l'économie russe, à acquérir de l'armement russe et à coopérer dans les domaines pétrolier et nucléaire. À ce stade, même si quelques lettres d'intention ont été signées, ce sont surtout des promesses, et les Saoudiens reconnaissant eux-mêmes que leur tentative n'a pas eu beaucoup de succès. Mais ils restent persuadés qu'ils pourront, à terme, éventuellement avec d'autres, mettre un pied dans la porte entre les Russes et les Iraniens. Tel est actuellement leur objectif numéro un.
Quant à l'éventualité d'une intervention au sol en Syrie, les choses sont en réalité un peu plus complexes qu'on ne l'a dit. D'une part, il y a un aspect politique ou déclaratoire : les Saoudiens veulent faire comprendre qu'ils sont présents. Ils sont d'ailleurs en train d'organiser, avec les pays de la coalition islamique, un exercice militaire de grande envergure à proximité immédiate de la frontière irakienne, pour bien montrer qu'ils disposent de moyens militaires, qu'ils sont capables de mobiliser des effectifs importants – on parle de 150 000 personnes – et qu'ils seraient en mesure d'intervenir. D'autre part, leur objectif est de faire en sorte que, si Daech continue à reculer, le terrain abandonné ne soit pas occupé par les forces de Bachar al-Assad. À cette fin, ils souhaiteraient qu'il y ait une présence militaire arabe ou africaine sur le terrain. Mais ils savent qu'ils ont besoin d'une protection occidentale, au minimum symbolique, pour éviter que les Russes ne bombardent une telle force. Ils mènent actuellement des discussions sur ce point, notamment avec les Américains.

Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Je vous prie de m'excuser : je dois me rendre à Berlin avec une délégation de membres de la commission. Je laisse le soin à M. Giacobbi de présider la suite des échanges.
Présidence de M. Paul Giacobbi, vice-président de la commission

Qu'en est-il de la situation des droits de l'homme en Arabie saoudite ? Sait-on ce que le jeune blogueur Raif Badawi est devenu ?
Pouvez-vous nous en dire plus sur l'intervention au sol qu'envisageraient la Turquie et l'Arabie saoudite ?
La presse relate que l'Arabie saoudite, le Qatar, le Venezuela et la Russie viennent de conclure un accord sur un gel de la production de pétrole. Est-ce bien le cas ?

Indépendamment des querelles dynastiques, qui resteront au sein de la famille royale, quelle est la solidité du régime saoudien ? Je suis inquiet pour la sécurité intérieure du Royaume, qui est menacée par un certain nombre de mouvements radicaux. Où en est-on à cet égard ?

Vous avez décrit le triumvirat aux commandes à Riyad. Cependant, on entend dire que le prince Mohammed ben Salman détiendrait de plus en plus la réalité du pouvoir, y compris par rapport à son père. Le confirmez-vous ou est-ce totalement inexact ?
Du point de vue saoudien, quelle est aujourd'hui la menace la plus grande pour le Royaume : l'Iran ou bien l'État islamique sunnite, qui inspire une crainte croissante ?
Je n'ai pas très bien compris quels étaient les objectifs recherchés par les Saoudiens au Yémen. Vous dites qu'ils essaient de convaincre le président Ali Abdallah Saleh de quitter le pays, mais n'ont-ils vraiment aucun autre objectif que celui-là ? Où en sont les opérations militaires sur le terrain ? Est-il exact que des missiles Scud ont été tirés depuis le Yémen et ont atteint certains centres urbains en Arabie saoudite ?
La situation en Syrie est extrêmement complexe, et l'initiative saoudienne ne fait, selon moi, qu'ajouter à la confusion générale. Ne faut-il pas y voir le signe d'un rapprochement encore plus marqué entre l'Arabie saoudite et la Turquie ?
Il est clair que l'Arabie saoudite n'est pas un modèle en matière de droits de l'homme : absence de droit d'association et de liberté de culte ; ségrégation entre les hommes et les femmes ; proscription des spectacles ; contraintes très rigoureuses, dont certaines portent spécifiquement sur les femmes, notamment l'interdiction de conduire.
Il faut tenir compte du fait que la société saoudienne est très traditionnelle. N'oublions pas que l'Arabie saoudite est le seul pays du monde arabe à n'avoir jamais été colonisé par l'Occident. Contrairement à d'autres pays, elle a gardé une mentalité de « petit Empire du milieu ». Les Saoudiens ont une identité très forte : ils considèrent qu'ils forment le coeur de l'arabité et de l'islam. Le monde extérieur les intéresse et ils traitent avec lui, mais ils estiment qu'ils n'ont aucune raison d'accepter les pressions qui en viennent. Le roi Salman dit souvent : « Nous n'avons pas de modèle à l'extérieur. Nous nous développons et nous évoluons ; nous irons aussi loin que le peuple l'acceptera. »
Les autorités sont souvent critiquées par la population pour leur laxisme, notamment à l'égard des terroristes – on l'entend en permanence dans les majles. Ainsi, l'exécution de quarante-sept condamnés à mort le 2 janvier dernier a été une réponse à la fois aux accusations émises en Occident selon lesquelles l'Arabie saoudite serait complice de Daech et aux critiques internes sur le fait qu'aucun responsable des attentats de 2003 et 2004 n'avait encore été exécuté, ce qui révélait la faiblesse du pouvoir. De même, lorsque Raif Badawi a reçu ses cinquante coups de fouets, le public a protesté parce qu'il estimait qu'on ne le frappait pas assez fort. Cela peut paraître surprenant, mais il faut vivre avec cette réalité : il existe un écart culturel évident entre l'Arabie saoudite et l'Occident.
Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons rien faire. Nous tâchons d'intervenir discrètement auprès des autorités. En revanche, les campagnes de presse ont pour seul effet de les braquer.
Dans le cas de Raif Badawi, les Européens ont fait une démarche non publique pour demander la suspension de la sentence, qui a été effectivement accordée. Je suis en contact avec l'épouse de M. Badawi, et j'ai transmis une lettre de sa part au roi. Les autorités demandent que l'intéressé exprime, sans revenir sur ce qu'il a écrit sur son blog, une forme de regret, ce qu'il refuse de faire. Voilà où nous en sommes aujourd'hui.
Dans le cas d'Ali al-Nimr, condamné à mort pour avoir lancé des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre au cours d'une manifestation – un ou deux policiers sont malheureusement décédés – alors qu'il était mineur au moment des faits, les autorités nous répondent que l'âge de la majorité est non pas dix-huit ans comme chez nous, mais la puberté, ainsi que cela figure dans la charia. Nous n'arrivons pas à nous entendre sur ce point.
Lorsque nous intervenons discrètement, le cas échéant au niveau du président de la République, dans des affaires où la peine capitale est en jeu, nous arrivons dans certains cas à obtenir des grâces royales. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un crime de sang ou de trafic de drogue, ce qui est le cas pour la plupart des condamnations à mort, les autorités sont intraitables. Si on leur fait valoir que d'autres pays musulmans ont suspendu l'application de la peine de mort malgré ce qui est inscrit dans la charia, ils nous répondent que c'est là leur interprétation du texte sacré et que « Ce que disent nos amis nous intéresse, mais ce que nous dit Dieu nous importe bien davantage. » Les wahhabites ayant une lecture littérale du Coran, la discussion s'arrête souvent assez vite.
S'agissant de la relation avec la Turquie et du projet d'intervention en Syrie, il est clair que l'intervention russe a entraîné un rapprochement entre Saoudiens et Turcs, en dépit de leur antagonisme historique, qui tend de ce fait à s'effacer. D'autre part, on a le sentiment à Riyad que seule la Turquie serait réellement capable d'intervenir militairement en Syrie, voire d'aller un jour, le cas échéant, jusqu'à Damas. Dans l'esprit des Saoudiens, face aux interventions des Russes et des Iraniens, il est nécessaire de faire planer la menace d'une intervention de la coalition islamique antiterroriste. D'après ce qui nous a été dit au plus haut niveau, l'objectif de cette intervention serait pour le moment, ainsi que je l'ai indiqué, de déployer une présence militaire sur le terrain afin d'éviter que les territoires libérés de Daech ne tombent aux mains de Bachar al-Assad – ce qui reviendrait, du point de vue saoudien, à tomber de Charybde en Scylla. Nous ignorons quelle forme – contingent de soldats soudanais ou autre ? – cette force pourrait prendre. En tout cas, les Saoudiens songent sérieusement à ce projet, sachant qu'ils souhaitent en outre obtenir une forme de protection occidentale afin que les Russes ne bombardent pas cette force.
À ma connaissance, il n'y a pas eu, à ce stade, d'accord sur le gel de la production de pétrole. Les autorités saoudiennes ont dit très clairement qu'elles étaient prêtes à envisager une réduction de leur production dans le cadre d'un accord global entre les principaux producteurs de l'OPEP et hors OPEP prévoyant une répartition équitable de la charge. L'une des difficultés est que les Iraniens n'accepteront probablement pas de réduire leur production, qu'ils cherchent au contraire à accroître.
Concernant la solidité du régime et la sécurité intérieure, il est clair qu'il existe des cellules d'Al-Qaïda et de Daech en Arabie saoudite. Il y a d'ailleurs eu récemment des attaques contre des mosquées chiites dans la province orientale. Depuis les attentats de 2003 et 2004, les autorités ont parfaitement compris que le pays est la première cible de ces mouvements, dont l'objectif est de mettre la main tant sur les lieux saints de l'islam que sur le portefeuille saoudien. Elles sont très vigilantes et ont pris des mesures répressives évidentes. Elles tablent, d'une part, sur un contrôle social qui demeure assez puissant – bien que la population saoudienne soit désormais urbaine à 85 %, la structure familiale demeure largement tribale – et qui leur permet dans la plupart des cas d'arrêter les terroristes avant que les attentats ne soient commis, et, d'autre part, sur la coordination avec les services de renseignement occidentaux. Le système fonctionne correctement, mais, malgré leurs efforts, les autorités ne peuvent pas garantir la sécurité intérieure à 100 %. Il peut y avoir quelques échecs, comme chez nous d'ailleurs.
Compte tenu de la confiance que lui accorde son père, Mohammed ben Salman apparaît de plus en plus comme l'homme fort du régime. Cependant, à ce stade, à la différence de Mohammed ben Nayef, il n'a pas vraiment de légitimité propre et ne tient pas le système de sécurité. Ainsi que je l'ai expliqué, il y a certes une compétition entre les « deux Mohammed », comme il s'en produit dans tout premier cercle, mais il n'y a pas de conflit pour le moment. Il y a un partage des rôles, chacun ayant son domaine de compétence. Mohammed ben Nayef est à peu près sûr de sa légitimité, alors que Mohammed ben Salman est en train de créer la sienne. Ce qui se passera dans trois ans dépendra des succès ou des échecs de ce dernier.
La question de savoir qui de l'Iran ou de Daech est la plus grande menace n'est pas pertinente du point de vue des Saoudiens : si vous la leur posez, ils vont répondront que c'est la même chose. Dans leur vision, Daech se développe à cause de la politique iranienne dans la région : en Irak, c'est la politique sectaire d'al-Maliki qui a poussé les populations sunnites et les restes de l'armée de Saddam Hussein à se révolter et à tomber dans les bras de Daech ; en Syrie, les violences du régime de Bachar al-Assad ont eu le même effet, faute d'intervention occidentale. Les Saoudiens appellent notre attention sur le fait que Daech, qui est censé considérer les chiites comme des hérétiques, n'a jamais dirigé la moindre attaque contre l'Iran. Pour eux, il y a donc une complicité évidente entre Daech et l'Iran.
Quels sont les objectifs de l'intervention militaire saoudienne au Yémen ? À l'origine, cela a été, d'une part, une question de prestige pour le nouveau roi et, d'autre part, le moyen d'éviter qu'un régime sous influence iranienne ne s'installe dans la péninsule arabique. Aujourd'hui, les Saoudiens se rendent bien compte que l'opération militaire est plus compliquée qu'ils ne le pensaient. Toutefois, ils estiment qu'ils ont marqué des points et qu'ils disposent de temps. Ils espèrent que le château de cartes tombera d'un seul coup s'ils parviennent à « remercier » Ali Abdallah Saleh. J'ignore si ce pari est le bon, mais c'est ce qu'ils ont en tête.

Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur, après avoir accompagné le Premier ministre lors de sa visite à Riyad.
On a l'impression que l'exécution du contrat tripartite entre le France, le Liban et l'Arabie saoudite portant sur la livraison d'armes à l'armée libanaise pour 3 milliards de dollars est au point mort : les livraisons seraient interrompues. Est-ce lié à un problème de paiement par la partie saoudienne ?
Quel est notre degré d'implication dans l'intervention militaire saoudienne au Yémen ? On nous a dit officieusement que la France fournirait des images d'observation aux Saoudiens, compte tenu de la réticence des Américains à le faire. En outre, lors de mon séjour à Riyad, des compatriotes m'ont indiqué que des Français travailleraient pour le compte des Saoudiens à la frontière avec le Yémen dans l'entretien des forces héliportées. Certains ont même évoqué des « mercenaires ».

Vous avez évoqué la « politique du chéquier ». On entend beaucoup de choses sur l'éventuel financement d'organisations radicales par l'Arabie saoudite. Qu'en est-il aujourd'hui s'agissant non seulement de Daech, mais aussi des talibans ? Ces derniers reprennent du terrain en Afghanistan, ainsi qu'on me l'a confirmé lors de mon déplacement ce week-end à Kaboul.
Vous avez fait allusion au fait que les Saoudiens pourraient envoyer des soldats soudanais sur le terrain. Quelle est la valeur de l'armée de terre saoudienne ?

Quelle est la marge de liberté du roi et du gouvernement saoudien par rapport aux autorités religieuses wahhabites ? Dans quelle mesure le gouvernement a-t-il une influence sur les salafistes ?
Nous avons entendu dire que la stratégie saoudienne consistait à laisser le prix du pétrole baisser afin de neutraliser les explorations d'hydrocarbures de schiste aux États-Unis et de supprimer ainsi un concurrent. Qu'en est-il ?
Comment les relations entre l'Arabie saoudite et la Chine évoluent-elles ?
Dans le cadre du contrat DONAS – donation Arabie Saoudite –, les Saoudiens ont en effet affecté 3 milliards de dollars à l'armée libanaise pour acquérir des équipements français. Ils ont ainsi consenti, à la demande du président libanais de l'époque, Michel Sleiman, un effort visant à renforcer la principale institution libanaise restée véritablement nationale. Dès l'origine, ils ont été très clairs sur l'objectif de ce don : renforcer l'armée par rapport au Hezbollah dans une perspective de rééquilibrage des pouvoirs à long terme. Ils ont donc demandé des garanties pour que le matériel qu'ils financent ne tombe pas dans de mauvaises mains.
Après la signature de l'accord, les Saoudiens se sont posé un certain nombre de questions sur le destinataire final. Nous avons répondu à ces interrogations en signant récemment un accord qui rééchelonne les livraisons, de façon à ce que les premières concernent le matériel non létal et les dernières le matériel létal. Ainsi, lorsqu'on en arrivera aux livraisons de matériel létal, dans cinq ou six ans, les Saoudiens pourront avoir une vision plus claire de la situation au Liban – qui est liée, selon eux, à celle qui prévaut en Syrie – et, le cas échéant, prendre des décisions.
Au cours des dernières semaines, un certain nombre d'événements ont amené les Saoudiens à se poser de nouveau des questions : le fait que le Liban ait été le seul pays de la Ligue arabe à refuser de signer la déclaration conjointe condamnant le saccage de l'ambassade saoudienne à Téhéran ; la remise en cause de l'accord apparemment unanime sur le ticket formé par Sleiman Frangié pour l'élection à la présidence et Saad Hariri pour le poste de premier ministre.
Non, mais ils peuvent vivre avec lui comme président et avec Saad Hariri comme premier ministre.
Pour eux, il n'est pas question que Michel Aoun devienne président.
Le Hezbollah, qui avait donné des signaux indiquant qu'il pourrait, lui aussi, vivre avec Sleiman Frangié comme président, s'est finalement opposé à cette solution, sur instruction, pense-t-on, de Téhéran. Enfin, la libération de Michel Samaha par la justice militaire libanaise a été interprétée à Riyad comme un signe supplémentaire du fait que c'est le Hezbollah, et personne d'autre, qui est aujourd'hui à la manoeuvre au Liban.
La France et l'Arabie saoudite ont mené des discussions au sujet du contrat DONAS. Nous avons obtenu des garanties sur le fait qu'il serait respecté, mais, s'agissant des modalités, les Saoudiens se réservent le droit de faire jouer les clauses permettant de réaffecter le matériel à l'armée saoudienne s'il y a un doute sur le destinataire final ou un risque que le matériel tombe entre de mauvaises mains.
De bonne foi, selon moi.
Concernant le Yémen, la France fournit en effet des données de renseignement à l'Arabie saoudite. Il s'agit d'une aide à l'armée saoudienne, mais aussi d'un moyen d'essayer de limiter les dégâts collatéraux – les Américains ont le même point de vue que nous à cet égard. L'intervention au Yémen est la première opération d'envergure menée par les Saoudiens. L'aviation est la seule arme relativement efficace dont ils disposent. La France fournit également des équipements.
Une société française assure l'entretien du matériel français qui équipe la garde nationale saoudienne, laquelle est chargée de sécuriser la frontière avec le Yémen. Mais il n'y a pas, à ma connaissance, de mercenaires français.
Tous les services de renseignement occidentaux sont d'accord : il n'y a pas de financement de Daech par l'Arabie saoudite.
Deach n'existait pas avant les années 2003-2004. L'idée que les Saoudiens puissent financer Daech alors même qu'ils le bombardent paraît aberrante. Les Saoudiens ont renforcé leurs contrôles sur les financements à l'étranger. Ils sont désormais très stricts. Néanmoins, on ne peut pas totalement exclure que quelques personnalités envoient des valises de billets dans le désert.
L'Arabie saoudite n'est pas très impliquée dans le dossier afghan. À une autre époque, elle avait été l'un des rares États, avec les Émirats arabes unis, à reconnaître le régime taliban. Puis, il y a cinq ou six ans, on avait demandé aux Saoudiens de tenter une médiation. Mais, échaudé par son expérience avec le Hamas et l'Autorité palestinienne, le roi Abdallah avait été très prudent : il avait laissé le prince Muqrin, chef des services de renseignement, tâter le terrain. Riyad ayant posé un certain nombre de conditions, notamment la condamnation de tout contact avec Al-Qaïda, l'initiative était restée sans suite. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de nouvelle demande de médiation saoudienne. Pour le reste, les Saoudiens ont un partenariat avec les Pakistanais, et cela ne les dérangera pas si ces derniers essaient de « revenir » en Afghanistan.
L'aviation saoudienne peut être considérée comme relativement efficace, mais tel n'est pas le cas de l'armée de terre.
Ce sont des Saoudiens. Il y a des conseillers pakistanais dans la flotte saoudienne, mais pas dans l'armée de terre. C'est l'armée des Émirats arabes unis qui compte des ressortissants étrangers, notamment des Pakistanais.
La dynastie des al-Saoud tire une partie de sa légitimité du fait qu'elle a « réunifié » la péninsule arabique au nom de la « vraie foi ». Les liens entre le roi et les religieux remontent au pacte qu'ils ont conclu en 1743.
Je ne suis pas sûr que cela joue un rôle essentiel : les al-Saoud ont noué des alliances matrimoniales avec presque toutes les tribus.
Le roi a besoin de l'accord des autorités religieuses dans certains cas. Par exemple, en 1979, lorsque les autorités saoudiennes ont sollicité l'aide du Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) français pour reprendre le contrôle de la mosquée de La Mecque qui avait été prise par des extrémistes, il a fallu que le roi demande l'autorisation de l'establishment religieux pour que des non-musulmans puissent pénétrer dans le « saint des saints ». Après la libération de la mosquée, compte tenu de la nouvelle politique de l'Iran révolutionnaire à l'égard du monde musulman, notamment de sa tentative d'évincer les monarchies pétrolières, les autorités religieuses ont imposé une réislamisation de la société saoudienne. De nouveau, en 1990-1991, lorsqu'il s'est agi de reconquérir le Koweït, le roi a dû demander l'autorisation aux autorités religieuses pour que des troupes étrangères puissent être déployées sur le sol saoudien.
Oui, les autorités religieuses sont consultées formellement et donnent leur accord sous la forme d'une fatwa.
La présence de femmes en tenue jugée légère au sein des troupes américaines a suscité des réactions au sein de la population. Après la libération du Koweït, les autorités religieuses ont à nouveau imposé un certain nombre de règles, notamment le port de l'abaya pour les femmes étrangères.
Dans le même temps, aujourd'hui, l'establishment religieux dépend financièrement du gouvernement. Il y a un jeu entre les deux. Au cours de l'histoire, les rois saoudiens ont parfois pris des mesures contre les autorités religieuses : Ibn Saoud a utilisé les Ikhwan, puis les a massacrés lorsqu'il s'est rendu compte qu'ils souhaitaient une islamisation totale du pays ; le roi Abdallah a lancé une réforme visant à soustraire les systèmes judiciaire et éducatif à l'influence des religieux.
Du point de vue des Saoudiens, le fait que les États-Unis extraient du pétrole de schiste à 60 dollars le baril, alors qu'ils produisent eux-mêmes à 5 dollars le baril, est tout simplement antiéconomique. Ils font valoir qu'ils ne font qu'appliquer la loi de l'offre et de la demande que les Occidentaux leur ont apprise. Ils n'ont aucun état d'âme quant à l'éventuelle disparition de petits producteurs auxquels seuls des systèmes d'assurance ont permis de survivre jusque-là.
De plus en plus, les clients de l'Arabie saoudite se trouvent en Asie, pour des raisons évidentes. La Chine est, selon les années, le premier ou le deuxième partenaire commercial du pays, mais elle n'est pas perçue comme un acteur politique majeur. Les relations avec l'Inde se développent. Les Coréens sont très présents en Arabie saoudite, où ils remportent, souvent en pratiquant le dumping, la plupart des contrats dans le domaine de l'électricité et des centrales électriques.
Non, en tout cas pas encore. Ils ont obtenu le marché des centrales émiriennes et sont nos principaux concurrents pour les projets saoudiens dans le domaine nucléaire.

Vous avez évoqué la menace d'une intervention au sol de la Turquie et de l'Arabie saoudite en Syrie. J'ai dû mal à croire à cette hypothèse : ce serait une violation flagrante du droit international. Que l'on aime Bachar al-Assad ou non, il représente la Syrie au regard du droit international.
Cela se discute : environ 120 pays ne reconnaissent pas le régime syrien.

Il n'en reste pas moins que, du point de vue de l'ONU, Bachar al-Assad est le représentant légitime de la Syrie. Ce qui ne veut pas dire que je le soutiens ! En tout cas, une telle intervention au sol ne peut pas se faire sans la caution des États-Unis et de l'OTAN. Et elle mènerait à un chaos total.
Vous êtes un observateur très fin de la société saoudienne. Quid de la société civile saoudienne ? Percevez-vous des changements, une respiration, une forme de débat à l'intérieur du pays ?

Quelles sont les relations politiques entre l'Arabie saoudite et l'Égypte ? À votre avis, l'Égypte peut-elle jouer, dans un avenir proche, un rôle dans les conflits actuels au Moyen-Orient ?

Merci pour votre exposé très clair, monsieur l'ambassadeur. Vous avez affirmé de manière très catégorique qu'il n'y avait pas de financement direct de Daech par l'État saoudien. La presse fait état quasi quotidiennement de soupçons de financement non pas par la monarchie elle-même, mais par des personnalités saoudiennes influentes qui soit s'opposent au roi, soit ont mal vécu la fin de l'Irak de Saddam Hussein, l'humiliation des sunnites, la création d'un arc chiite et le rapprochement de Bagdad avec Téhéran, ce qui les conduit à considérer que Daech peut être l'instrument d'un rééquilibrage entre sunnites et chiites dans la région. Le gouvernement saoudien n'a-t-il pas fermé les yeux sur des financements qui proviendraient de telles personnalités influentes pourtant connues de lui ?
Au cours des années récentes, le fait que l'Arabie saoudite finance des librairies coraniques et des mosquées à l'étranger a été perçu comme une forme de prosélytisme, notamment dans notre pays. Y a-t-il aujourd'hui une volonté de prosélytisme ou une politique a visée expansionniste de la part de l'Arabie saoudite, y compris en Occident ?

Dans un rapport officiel écrit en 1871, M. William Hunter, administrateur britannique, décrivait déjà de manière précise et structurée l'influence considérable des wahhabites dans toute la plaine indo-gangétique jusqu'aux confins nord-ouest de l'Inde. Il détaillait notamment les circuits de financement via les marchands. Le problème est donc ancien.
Avec environ 30 dollars le baril actuellement, le prix du pétrole est proche de son niveau historique, si l'on excepte les pics de la fin du XIXe siècle, des années 1970 et de la période récente. En effet, le prix du pétrole revient toujours, corrigé de l'inflation, aux alentours de 30 ou 40 dollars le baril, ce qui est déjà très élevé au regard des coûts de production très bas. Seuls deux éléments peuvent le faire remontrer : des perspectives spéculatives à court ou moyen terme ou bien un déséquilibre entre l'offre et la demande. Avec l'irruption de l'Iran sur le marché et compte tenu du fait que nous n'avons jamais cessé d'être en surproduction pétrolière, notamment pour ce qui est des pétroles lourds, on voit mal comment cela pourrait se produire.
On entend parler d'une mise sur le marché de 5 % des parts de l'ARAMCO. Avez-vous des précisions à ce sujet ? La question de la valeur de mise sur le marché se pose. L'ARAMCO représente environ 10 % de la production mondiale de pétrole, mais sa capitalisation est inconnue – elle est estimée à 700 ou 800 milliards de dollars. D'autre part, si l'on retient le prix de 40 dollars le baril, la valorisation des réserves pétrolières supposées de l'Arabie saoudite s'élève à 8 000 milliards. En tout cas, si les Saoudiens ont besoin d'argent au point de mettre l'ARAMCO sur le marché, c'est qu'ils traversent une mauvaise passe. L'ARAMCO, c'est tout de même les bijoux de famille !
Les Saoudiens et les Émiriens ont clairement dit qu'ils n'interviendraient au sol que dans le cadre d'une opération de la coalition sous l'égide des Américains. Cela vaut aussi pour la Turquie, qui fait partie de l'OTAN. Des discussions sont en cours pour savoir si les Américains donneront leur autorisation et s'il y aura une présence, même symbolique, de pays de l'OTAN. J'ignore quel sera le résultat des courses.
La société civile saoudienne évolue en effet, ce qui est normal s'agissant d'une société jeune : les deux tiers de la population ont moins de trente ans. Les jeunes sont écartelés entre deux tendances. D'un côté, les liens familiaux et tribaux restent très puissants : même ceux qui ont fait leurs études à l'étranger et y ont vécu différemment sont repris par le cadre familial lorsqu'ils rentrent chez eux. Ils le disent eux-mêmes : tous les vendredis, ils vont en famille chez leur père, ainsi que l'exige la tradition. Et si un garçon ramène une Ouzbèke, une Américaine ou une Argentine, il s'expose à un tas de problèmes avec les autres membres de sa famille.
De l'autre, la population saoudienne est, dans le monde, celle qui est la plus présente sur les réseaux sociaux, ce qui s'explique tout simplement par l'absence de distractions. Elle est donc très bien informée de ce qui se passe ailleurs. L'évolution des mentalités est visible : on assiste à une floraison de start-up, notamment dans l'ouest du pays. Les Saoudiens sont très conscients que l'ancien modèle ne peut pas tenir : il est hors de question que les 300 000 jeunes qui entrent chaque année sur le marché du travail deviennent tous fonctionnaires de l'État. Ces jeunes, qui sont en général bien formés – notamment ceux qui ont étudié à l'université, en Arabie saoudite ou à l'étranger, ce qui n'est pas le cas de la masse de la population –, envisagent tout à fait de créer leur propre société et de sortir du schéma traditionnel.
La première revendication des jeunes Saoudiens, je l'ai dit, c'est d'avoir davantage de distractions. Un certain nombre de mesures sont à l'examen pour libéraliser le régime actuel, très rigoureux. On voit déjà se multiplier les galeries d'art contemporain, notamment à l'ouest, dans la région de Djedda, mais aussi à Riyad, ce qu'on n'aurait jamais imaginé auparavant. À l'issue de sa récente visite dans le pays, Jack Lang, président de l'Institut du monde arabe, s'est dit très impressionné par le nombre de jeunes artistes saoudiens qui apparaissent en ce moment.
Du fait de ses problèmes internes, l'Égypte s'est un peu effacée de la scène internationale. Néanmoins, elle reste le premier pays arabe par sa population, doté d'une influence et d'une tradition étatique forte. Les Saoudiens éprouvent une antipathie farouche à l'égard des Frères musulmans. Actuellement, ils soutiennent massivement l'Égypte, car elle est pour eux un facteur de stabilité au sein du monde arabe et offre à la péninsule arabique, je l'ai dit, la profondeur stratégique dont elle a besoin face à l'Iran. Même s'il peut exister parfois des différences sur le dossier syrien ou par rapport à la Turquie, la coordination entre les deux pays est très étroite.
Les Saoudiens sont tout à fait conscients que les mouvements extrémistes sont la première menace pour leur régime. Ils n'ont donc aucune raison d'avoir la moindre complaisance à leur égard, qu'il s'agisse de Daech ou d'Al-Qaïda. Ils ont souffert dans leur chair, et des actions terroristes ont lieu aujourd'hui encore sur le territoire saoudien. On ne peut pas dire que les autorités saoudiennes ferment les yeux sur les financements provenant de personnes privées : elles ont pris des mesures, notamment en adoptant une nouvelle législation en 2014. Nos services de renseignement soupçonnent qu'il existe encore des transferts de cette nature, mais ils seraient marginaux.
J'en viens aux réactions dans l'opinion publique. En Arabie saoudite comme dans d'autres pays de la région, une partie des sunnites ont le sentiment que, compte tenu de la lâcheté et de l'inaction de l'Occident, les combattants de Daech sont les seuls qui fassent quelque chose pour les défendre face aux ingérences de l'Iran, aussi peu recommandables soient-ils. Les autorités font ce qu'elles peuvent pour faire comprendre que ce sont des déviants, mais il faut bien reconnaître que la propagande assez habile de Daech fonctionne en Arabie saoudite, notamment sur les réseaux sociaux. Plus de 2 000 Saoudiens se battent actuellement en Irak dans les rangs de Daech, bien qu'ils aient été condamnés par les autorités politiques et religieuses de leur pays.
Pendant de très nombreuses années, les Saoudiens ont en effet utilisé le financement des mosquées, en Europe ou ailleurs, comme un élément de soft power. Aujourd'hui, ils sont devenus beaucoup plus regardants : les financements publics destinés à ces projets doivent recueillir l'accord des autorités. Cependant, certaines mosquées, en Afrique ou ailleurs, reçoivent aussi des financements privés de la part de riches Saoudiens. Les autorités essaient de s'assurer que cet argent n'est pas détourné, mais on ne peut pas garantir que tel soit le cas à 100 %.
Les wahhabites exercent en effet leur influence depuis longtemps et ont entretenu des relations avec des mouvements étrangers, notamment avec les Deobandi au Pakistan. Le wahhabisme est un mouvement quiétiste sur le plan religieux et conservateur sur le plan social, mais qui ne reconnaît pas, en principe, de rôle politique à l'islam. Dans ses écrits, Abd al-Wahhab indique très clairement qu'un wahhabite est censé respecter l'autorité quelle qu'elle soit, à condition qu'elle respecte la charia. Il y a donc une très grosse différence avec les Frères musulmans, qui ont une conception de l'islam politique. À l'époque de Nasser, les pays du Golfe ont accueilli un certain nombre de Frères musulmans qui étaient pourchassés en Égypte. Beaucoup d'entre eux ont été professeurs dans l'enseignement, et une sorte de mélange a eu lieu entre la tradition wahhabite conservatrice et l'islam politique des Frères musulmans. Oussama ben Laden en est le pur produit. Les wahhabites n'aiment guère les djihadistes, car ils considèrent que ceux-ci utilisent l'islam à des fins politiques, mais on ne peut pas nier qu'une partie de l'héritage spirituel des djihadistes vienne du mouvement wahhabite.
Le prix du pétrole dépend de l'offre et de la demande. La remontée des cours du brut dépendra de l'ampleur de la reprise économique aux États-Unis, en Europe ou ailleurs. Du côté de l'offre, on s'attend à ce que la production américaine baisse de 500 000 barils par jour cette année. Nous verrons si les Iraniens sont capables de produire 500 000 barils par jours supplémentaires. Pour ma part, je me méfie de toutes les prévisions, qu'elles concernent la bourse, le pétrole ou la météo ! En tout cas, s'appuyant sur les analyses de leurs experts, les Saoudiens sont persuadés que les cours remonteront progressivement à partir de 2017, compte tenu notamment du recul de la production de pétrole de schiste.
Les Saoudiens projettent de privatiser partiellement non pas l'ARAMCO en tant que telle, mais certaines raffineries telles que Satorp. Le capital de Satorp est détenu à 31,5 % par Total et a été introduit en bourse à hauteur de 15 %. Cette part pourrait augmenter. Compte tenu de la quantité d'argent disponible sur le marché saoudien, les actions trouveront preneurs sans difficulté.
Il n'est pas question d'y toucher. Les Saoudiens ont connu des périodes fastes et d'autres moins fastes, comme aujourd'hui. Mais ils ne sont pas particulièrement inquiets, car ils pensent que les cours du brut vont remonter et ils savent qu'ils peuvent de toute façon tenir cinq ou six ans au rythme actuel. Cela ne les empêche pas de prendre des mesures de salut public. Ils en ont déjà pris quelques-unes et prévoient, en outre, de privatiser certains actifs. On parle d'ailleurs de privatisations depuis longtemps. Il en a été beaucoup question du temps du roi Abdallah, mais peu d'entre elles ont été menées à bien, car le pétrole était alors à plus de 100 dollars le baril. Aujourd'hui, les circonstances sont différentes, et les privatisations sont envisagées plus sérieusement.

Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur, pour la qualité et la précision de vos réponses.
Examen, ouvert à la presse, du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (n° 3147) – Mme Chantal Guittet, rapporteure.

Madame la Présidente, mes chers collègues, le présent projet de loi vise à approuver l'accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
La pêche illicite, non déclarée et non réglementée, dite « pêche I.N.N. », est une activité dont les conséquences peuvent être désastreuses, d'abord en matière environnementale, puisqu'elle menace les ressources halieutiques et peut aboutir à la disparition de certaines espèces, mais également sur le plan économique et politique, puisque la pêche illicite prive de ressources des régions côtières et menace ainsi non seulement l'économie de ces régions, mais dans certains cas leur sécurité alimentaire.
De par son caractère clandestin, la pêche « I.N.N. » est difficile à quantifier, même si son chiffre d'affaire global a été récemment estimé entre 10 et 23 milliards de dollars par an.
Mais surtout, la lutte contre la pêche I.N.N. ne peut être efficace que si elle fait l'objet d'une coordination étroite entre l'ensemble des États du pavillon et des États du port. C'est ce que la communauté internationale s'est efforcé de mettre en place progressivement depuis un quart de siècle.
En 1992, à l'occasion de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement de Rio de Janeiro, plusieurs instruments internationaux non contraignants ont été adoptés en matière de protection des ressources halieutiques :
- l'Accord visant à promouvoir le respect par les navires pêchant en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion adopté en 1993 dans le cadre de la FAO ;
- l'Accord sur les stocks chevauchants et les poissons grands migrateurs adopté par les Nations Unies en 1995 ;
- le Code de conduite pour une pêche responsable adopté en 1995 sous l'égide de la FAO.
La lutte contre la pêche « I.N.N. » en tant que telle a fait l'objet d'un « Plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée », adopté en 2001 dans le cadre de la FAO.
Ce document invitait les États du pavillon à prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que leurs ressortissants ne soutiennent ni ne pratiquent la pêche I.N.N., ce qui impliquait la mise en place d'un système de contrôle et d'une surveillance systématiques et efficaces de la pêche, du commencement des opérations jusqu'à la destination finale.
Il s'agissait cependant d'un document non contraignant reposant sur la mise en oeuvre progressive de plans d'action nationaux.
Le Plan d'action de 2001 traitait par ailleurs principalement des mesures à prendre par l'État du pavillon. Il est rapidement apparu nécessaire de réfléchir également au renforcement du contrôle par l'État du port, c'est-à-dire les États dont les navires doivent utiliser les ports pour se livrer aux activités de pêche illicite.
Le Comité des pêches de la FAO a ainsi approuvé en 2005 un document non contraignant intitulé : « Dispositif type relatif aux mesures du ressort de l'État du port dans le contexte de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ». Puis, sur la base d'un projet préparé par un groupe d'experts en septembre 2007, les membres du FAO ont négocié entre juin 2008 et août 2009 le texte final de l'accord que nous examinons aujourd'hui.
Cet accord est composé d'un préambule, de dix parties contenant 37 articles et de cinq annexes. Après les dispositions générales, les parties 2 et 3 traitent de l'usage des ports et précisent dans quelles conditions les Parties ont l'obligation de refuser l'entrée de leurs ports aux navires suspectés de pratiquer la pêche I.N.N., ce refus étant également transmis aux autres Parties où aux États côtiers et aux organisations régionales de gestion des pêches.
La partie 4 oblige les Parties à l'accord à pratiquer des inspections régulières et en nombre suffisant pour atteindre l'objectif de l'accord. Leur conduite fait l'objet d'une procédure décrite à l'article 13 et précisée par les annexes B et C, ainsi que de la transmission à l'État du pavillon et aux autres États et organisations concernées des informations recueillies, ces dernières devant par ailleurs nourrir un système d'échange de données dont la mise en place est encouragée par l'article 16.
Les obligations de l'État du pavillon sont énumérées dans la partie 5. L'État du pavillon doit demander à ses navires de coopérer avec les inspections prévues par la partie 4 et prendre les mesures coercitives prévues par son droit interne lorsqu'un cas de pêche I.N.N. lui est signalé.
La partie 6 de l'accord traite des besoins particuliers des États en développement et encourage les Parties à leur fournir l'assistance dont ils ont besoin pour pouvoir mettre en oeuvre les dispositions de l'accord. Les parties 7 à 10 contiennent des dispositions finales classiques. L'article 29 précise notamment que l'accord entre en vigueur trente jours après la date du dépôt du vingt-cinquième instrument de ratification.
Les conséquences juridiques de l'accord pour la France sont limitées. En effet, le Règlement européen du 29 septembre 2008, dit « règlement I.N.N. », vise les mêmes objectifs mais son niveau d'exigence est équivalent ou supérieur à celui de l'accord. La ratification de cet accord par la France aura toutefois pour effet d'accélérer l'entrée en vigueur de ce texte, puisque sept États seulement l'ont à ce jour ratifié, sur les vingt-cinq requis pour son entrée en vigueur.
Je vous invite par conséquent à adopter le projet de loi qui nous est soumis.

Quels sont les sept Etats qui ont ratifié l'accord ? Est-ce que ce sont des membres de l'Union européenne ?

Seulement sept Etats ont ratifié ce texte : c'est très peu compte tenu de l'importance de la préservation des réserves halieutiques.

C'est une affaire importante. Même si cela ne suffira pas à régler l'ensemble des problèmes de la pêche irrégulière.
Suivant l'avis de la rapporteure, la commission adopte le projet de loi (n° 3147) sans modification.
La séance est levée à dix-huit heures quinze.